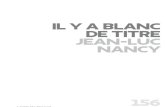Générations Jean-Luc Nancy
description
Transcript of Générations Jean-Luc Nancy
GNRATIONS, CIVILISATIONS Jean-Luc Nancy Association Vacarme | Vacarme 2009/2 - N47pages 48 50 ISSN 1253-2479Article disponible en ligne l'adresse:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-vacarme-2009-2-page-48.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nancy Jean-Luc,gnrations, civilisations, Vacarme,2009/2 N47,p. 48-50.DOI : 10.3917/vaca.047.0048--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Distribution lectronique Cairn.info pour Association Vacarme. Association Vacarme. Tous droits rservs pour tous pays.Lareproductionoureprsentationdecetarticle,notammentparphotocopie,n'estautorisequedansleslimitesdesconditionsgnralesd'utilisationdusiteou,lecaschant,desconditionsgnralesdelalicencesouscriteparvotretablissement. Toute autre reproduction ou reprsentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manire quecesoit,estinterditesaufaccordpralableetcritdel'diteur,endehorsdescasprvusparlalgislationenvigueurenFrance. Il est prcis que son stockage dans une base de donnes est galement interdit. 1 / 1Document tlcharg depuis www.cairn.info - - - 78.250.14.88 - 20/03/2015 06h27. Association Vacarme Document tlcharg depuis www.cairn.info - - - 78.250.14.88 - 20/03/2015 06h27. Association Vacarme chantiervacarme 47 printemps 200948gnrations, civilisationspar Jean-Luc NancyLa relation entre les gnrations nest pas de diffrence ou dopposition mais de syncope. La jeunesse actuelle le sait, dun pass fait de ruptures quelle na pas toutes vcues ; elle partage ainsi avec les autres ges de la vie le sentiment que notre civilisation est maintenant plus suspendue que pesante, quelle exige, non plus de se satisfaire de son hritage, mais de muter dans lurgence.Les gnrations ne se succdent pas toujours comme elles le font dans les rcits bibliques, et elles ne se rsument pas toujours la formule : X engendra Y qui engendra Z .Ellesnesontpastoujourssimplementdesengen-drements, elles ne sont donc pas toujours des gnrations. Comme dans toute gntique, dailleurs, il se produit des mutations, des sautes, des recombinaisons. Cest ce quon appelle lhistoire : ce qui fait vnement, perturbation, syncope dans la succession des gnrations.Ilestpossiblededirequela gnration quia aujourdhui environ vingt ans a t engendre, et surtout a grandi dans des conditions qui en font une gnration plus en rupture de succession que celles qui la prcdent. Il sufft de se remmorer quelques dates entre 1989 (le mur), 2001 (les tours) et 2008 (les bulles), mais mieux encore, il faut se rappeler que cette priode a vu se produire des transfor-mations comme celle que signale lexpansion de ltrange syntagme ressources humaines en mme temps que la dcomposition acclre des gauches politiques europen-nes, la recomposition frelate de toutes sortes de religiosits ou de mythologies identitaires et un accroissement exponen-tiel des carts de moyens tant entre les personnes quentre les entreprises et les collectivits nationales ou autres. La gnration des vingt ans daujourdhui (comme bien sr les plus jeunes qui la suivent) ne peut dcidment pas se situer comme une gnration relie sa provenance et ouverte sur lclosion de sa nouvelle identit. Quelque chose sans doute lui a t t de la possibilit de sprou-ver comme gnration , ou bien elle ne peut le faire que dans un rapport qui nest plus exactement de gnra-tions . Ce ne sont plus les parents ni les grands-parents qui forment les repres sur le fond desquels on accde sa vie et son ge propres. Cest dun changement de monde quil sagit.La priode dont je parle a sans doute form le dernier moment dune courbe amorce autour de 68 (et dont les vnements dalors furent les signaux puissants et mal compris) : cette courbe dessinait un infchissement dcisif, et irrversible, de ce qui jusque l stait toujours inscrit de gnration en gnration depuis assez longtemps sous les signes majeurs dune histoire plus ou moins doue de sens et en tout cas davenir, de lesprance dun progrs tantsocialethumainvoiremoral !quetechnique (ce dernier favorisant le premier) et de manire gnrale du projet sans doute dj troubl mais encore consistant dune mancipation de lhumanit.On peut sans doute le dire dune manire trs simple : depuis environ le milieu du xixe sicle, et en dpit des rvlations accablantes que furent les deux guerres mon-diales, chaque gnration pouvait se reprsenter quelle allait faire mieux que la prcdente. Chacune pouvait penser quelle saurait tirer les leons des checs en portant Document tlcharg depuis www.cairn.info - - - 78.250.14.88 - 20/03/2015 06h27. Association Vacarme Document tlcharg depuis www.cairn.info - - - 78.250.14.88 - 20/03/2015 06h27. Association Vacarme politique des gnrationsvacarme 47 printemps 200949plus avant les succs. Dj 68 a su faire entendre une autre attente, une autre exigence : celle dune rupture. Cest dailleurs pourquoi 68 ne fut pas rvolutionnaire : la rvolution, cest la rupture dans la refondation, dans la reprise inauguratrice, voire cratrice dun temps nouveau. Aprs 68, mais beaucoup plus sensiblement et massivement aprs 1989 nous sommes entrs dans la rupture suspensive : suspens de progrs, suspens de confance, suspens du sens mme quil y avait tre une nouvelle gnration .Peut-tre pourrait-on dire que depuis ce moment-l les gnrations ne se savent ni ne se sentent gnres mais plutt dposes, lches, sinon largues, sur le bord dune route qui elle-mme sinterrompt pas trs loin en avant ou va se perdre dans une rgion confuse prive de routes, de pistes, de signaux.Il sen suit au surplus que ce savoir et ce sentiment ne sont pas lapanage des jeunes . On le partage, de quelque gnration quon soit, pourvu quon soit sensible ces fractures profondes, ces tremblements ou ce malaise quon ne peut nommer autrement que Freud le ft il y a quatre-vingts ans cest--dire aussi quatre fois vingt ans. On peut aujourdhui avoir 80 ans et connatre un dsarroi, une perplexit ou un tourdissement qui ne doivent rien au grand ge (lequel dailleurs recule dj bien au-del), ni par consquent la trop bien connue laudatio temporis acti, mais tout la perception dune rupture et dune sorte dabandon de lhistoire du monde, des hommes et de la nature.Sans doute aujourdhui ne peut-on mme plus pour peu quon ne soit pas hbt ou somnambule se faire nostalgique dun temps pass parce que le pass nap-parat plus comme le temps dune gnration, au sens actif dun engendrement, qui certes peut tre suivie de vicissitudes mais qui nen ouvre pas moins une vie neuve, capable de recommencements (de rengendrements). Il apparat plutt comme la fois trop pass trop loin, trop coup de nous et comme trop peu pass trop coll nous. Trop loin, comme est loin toute la charge dattentes et dappels quont pu porter les mots commu-nisme , socialisme , humanisme , trop prs, comme nous colle la peau le flet inextricable des contraintes techniques et des contradictions morales que nous hri-tons de nos inventions lectro-atomico-biologiques. Trop loin comme sont loignes la raison et la science dans leurs gloires conqurantes, trop prs comme ces mmes raison et science sont poses devant nous, lourdaudes, emptres, en suspension davenir. Trop loin comme est le sens grec de dmocratie , trop prs comme est le sens moderne et incertain du mme mot. En 1936, Husserl publiait sa Krisis la crise des scien-ces europennes . Ce qui pour lui tait crise, cest--dire la fois phase aigu de maladie et moment propice intervention thrapeutique, nest plus crise pour nous, mais tat continu, install, de ce qui peut diffcilement tre distingu comme pathologie dune condition suppose saine ou normale. En vrit, il sagit dautre chose que dune crise, et de mme il sagit dautre chose que dun phnomne de gn-ration. Nous sommes entrs dans une mutation de la civi-lisation comparable celle qui ft apparatre le monde mditerranen des Phniciens puis des Grecs ou celle qui ft disparatre, quelque seize sicles plus tard, ce mme monde au proft de ce qui allait devenir le ntre. pareille chelle, les gnrations nont plus le mme sens que dans la proximit de leurs engendrements et encha-nements. Cest lhistoire elle-mme qui nenchane plus. Il se produit une disjonction du cours plus ou moins continu quon croit pouvoir lui attribuer aussi longtemps quon peut penser ou quon croit pouvoir le faire en termes de succes-sion, de passage ou mme de transformation, voire de rvo-lution (qui est encore une transmission). Nous ne sommes plus dans une dure de la transmission, du transfert de la tradition en sa valeur active mais dans une syncope de la mtamorphose. Cest le temps de la civilisation qui se trouve out of joint comme le dit Hamlet.Sans doute Shakespeare est-il le tmoin dune conscience de rupture, dinterruption ruineuse Hamlet ou Lear en sontparmidautresdesfguresremarquablesetqui doit donner penser que le sentiment de la fracture du temps et de lordonnance du monde est rcurrent dans le monde moderne, constitutif peut-tre du moderne en tant que tel. Constitutif mme dj du monde grec alexan-drin, puis romain chrtien. Une apocalypse est toujours suspendue sur lOccident. Aujourdhui pour la premire fois ce sentiment nest plus celui dun Occident plus ou moins obscurment adoss ou inscrit dans un reste du monde plus vaste, un ocan donnant au loin sur des terrae incognitae,uncielperdantsessphresdecristalmais encore plant de repres brillants. Notre sentiment est de ntre au milieu de rien que du vide intersidral. Que cette reprsentation puisse encore elle-mme tre suivie dune nouvelle faon de faire monde , de traverser le vide avec tre jeune aujourdhui cest tre dispos une survenue : un imprvisible qui ne va pas enchaner mais qui vient dun ailleurs entier, inentam. Document tlcharg depuis www.cairn.info - - - 78.250.14.88 - 20/03/2015 06h27. Association Vacarme Document tlcharg depuis www.cairn.info - - - 78.250.14.88 - 20/03/2015 06h27. Association Vacarme chantiervacarme 47 printemps 200950un sens nouveau, ce nest pas impossible : mais ce nest pas non plus possible au sens de ce dont on entrevoit uneamorce,uneesquisse.Etcela,pourlemoment,ne nousfournitpas,semble-t-il,leressortdefairesurgir pour dire notre disjonction une forme qui comme celle de Shakespeare a la puissance dun monde en soi. On objec-tera que ce monde de Shakespeare celui de Cervants, celui de Montaigne aussi cest nous quil est loisible de le saisir comme tel, et que nous ne pouvons pas savoir quelles formes ni quelles forces naissent autour de nous, en nous peut-tre et par nous, malgr nousEn tout tat de cause, dans le temps de la disjonction, sil nest pas juste de penser en termes de gnrations, dges et donc aussi de dclin ou de renouveau (de dcadence ou de renaissance , de dgnrescence ou de rgnration toutes valuations qui supposent une mesure, une valeur de rfrence), il nest pas pour autant exclu de parler de vieillesse et de jeunesse. Non pas au sens des ges de la vie, mais au sens de ce qui se ferme ou de ce qui souvre.Est-il suffsant de distinguer deux sens de ce couple jeune/vieux ? Ce nest pas certain. Pourquoi la jeu-nesse aurait-elle lapanage de louverture ? Pourquoi la vieillesse celui de la fermeture ? La vieillesse est aussi ce qui voit plus loin, aussi bien en arrire quen avant, et cela peut louvrir. Vieillesse peut vouloir dire expan-sion , et jeunesse, prcipitation ou bien mme la seconde peut faire bourgeonnement , mais la premire dclosion . Quoi quil en soit, quelque gnration que notre ge dtat-civil nous fasse appartenir aujourdhui, et que nous soyions vieux ou jeune , nous pouvons nous fermer ou nous ouvrir. Non pas un avenir comme ce qui procde dun engendrement, mais une venue comme ce qui surgit de linconnu et en tant quinconnu. une survenue. tre jeune aujourdhui cest tre dispos une survenue : un imprvisible qui ne va pas enchaner, qui ne va ni nous succder, ni hriter de nous, ni non plus nous dsavouer et nous destituer, mais qui simplement vient dun ailleurs entier, inentam. Il nous revient de savoir nous y disposer, nous y exposer.post-scriptum Onmedemandequelrapportnouspouvonsentretenir aujourdhui avec les termes de malaise et de crise qui donnent les repres dune conscience des annes 1930 que laprs-guerre a pens pouvoir oublier dans le nouvel lan dune civilisation meurtrie mais en voie de gurison. Il faudrait dabord prciser que ces termes taient jusqu un certain point des termes prudents par rapport un terme commeceluide dclin (Spengler)etdautresdela mme veine (dgnrescence, dcadence) qui en appelaient, eux, des rgnrations, des reviviscences ou des res-taurationselles-mmespensessurfonddapocalypse imminente.Onreconnatunetoiledefonddesfascis-mes. Par rapport au dclin auquel on ne peut que cder ou bien ragir au sens le plus courant de la raction , lemalaiseoulacriselaissentouvertouindterminle pronostic. Au demeurant, les sentiments de Freud et de Husserl diffrent beaucoup : le premier ne se dpartit pas dun pessimisme en mme temps exempt de toute rac-tion , le second au contraire met lanalyse de la crise au service dune confance renouvele dans cela la raison europenne qui traverse la crise. On pourrait ainsi dire que pour Freud la succession des gnrations reste plutt indiffrente ( il faut attendre , dit-il), tandis que pour Husserl, en dpit du scepticisme auquel la crise oblige, lhumanit ne devrait pas manquer de renouer le fl de lhistoire ouverte avec le logos. Ni lune ni lautre de ces attitudes ne peut tre entire-ment la ntre. Ni lattente sur fond de dsenchantement, ni la volont qui sarrache au doute. Nous sommes dans une situation telle que nous devons penser autrement quen des termes qui prsupposent leur contraire perdu ou dtrior : le contentement oppos au malaise, lnergie vivante oppose la crise. Ce quoi nous avons faire est dun autre ordre quune perturbation. Il y a dispa-rition du donn. Sous nos yeux, la nature et lhistoire, l homme mme et son monde seffacent sans quil nous soit permis de qualifer ce phnomne de malaise ou de crise, de malheur ou de dclin. Il sagit plutt de ce que jai plus haut dsign du terme de mutation . Il mest dj souvent arriv de lemployer. Une mutation est une transformation qui ne se laisse pas qualifer en bien ou en mal. Elle se drobe aussi linscription dans un pro-cessus continu. Les mutations gntiques surviennent au continuum dun gnome. Certaines sont ltales, dautres produisent de nouvelles possibilits de vie. Nous pouvons aussi parler de mue. Dans la mue de la chrysalide ou dans celle de la voix adolescente, il y a simul-tanment maintien dune identit et mtamorphose de sa manifestation. La mue est un phnomne privilgi pour penser la concidence dune continuit et dune rupture, en y pensant en mme temps la solidarit de la chose en soi et de la manifestation. La chose en soi, ici, cest nous , ou lhuma nit, ou le monde nature et histoire : autant denomsquitrahissentlimpossibilitdedirecequest cette chose. Kant la dit en ouvrant le temps prsent : on ne rpond pas la question quest-ce que lhomme ? . Nous pouvons rpter son affrmation dans la rponse : lhomme est un mutant. Le monde en totalit est mutant, mutation et mue. La manifestation larve ou papillon, voix labile ou voix timbre rvle autre chose de la chose mme, une autre vrit, ni meilleure, ni pire. Nous sommes en mue, nous laissons une peau, une voix, sans encore voir ni entendre celles que la mtamorphose engendre.Document tlcharg depuis www.cairn.info - - - 78.250.14.88 - 20/03/2015 06h27. Association Vacarme Document tlcharg depuis www.cairn.info - - - 78.250.14.88 - 20/03/2015 06h27. Association Vacarme










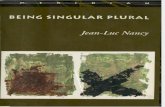




![[Jean-Luc Nancy] the Experience of Freedom(Bookos.org)](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/55cf97cc550346d03393b3a6/jean-luc-nancy-the-experience-of-freedombookosorg.jpg)