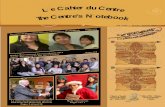Cahier d'anthropologie sociale n° 10
-
Upload
herne-editions -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Cahier d'anthropologie sociale n° 10
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
1/11
L'image
rituelle
cahiers10danthropologie
sociale
LHerne
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
2/11
CAHIERS DANTHROPOLOGIE SOCIALE
LHerne
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
3/11
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
4/11
LIMAGE RITUELLE
Ce Cahier a t dirig parCarlos Fausto et Carlo Severi
LHerne
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
5/11
Cahiers danthropologie sociale
Comit dhonneur
Claude Lvi-Strauss (1908-2009), Franoise Hritier,
Nathan WachtelDirecteurPhilippe Descola
Coordinateurs de la collectionSalvatore DOnofrio, Nolie Vialles
Comit de rdaction
Julien Bonhomme, Andra-Luz Gutierrez-Choquevilca,Monique Jeudy-Ballini, Dimitri Karadimas, Frdric Keck
Les Cahiers dAnthropologie Sociale publient les journes dtude et les sminairesdu Laboratoire danthropologie sociale (LAS), unit mixte de recherche du Collgede France, de lcole des hautes tudes en sciences sociales et du Centre national dela recherche scientifique.
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
6/11
Sommaire
Carlos Fausto et Carlo Severi
Introduction ..................................................................................... 9
Carlos Fausto et Isabel PenoniLeffigie, le cousin et le mort. Un essai sur le rituel du Javari(Haut-Xingu, Brsil) ........................................................................... 14
Aparecida VilaaLe contexte relationnel du cannibalisme funraire wari ............................... 38
Bruna Franchetto et Tommaso MontagnaniLangue et musique chez les Kuikuro du Haut-Xingu.................................... 54
Accio T. C. PiedadeLe chant des fltes : musique des esprits chez les Wauja du Haut-Xingu ........... 77
Julien BonhommeLa voix du mongngou comment faire parler un arc musical ........................ 93
Charles Stpanoff
Technologies cognitives du voyage chamanique. Cas iakoutes ........................ 112Carlo Severitre Patrocle. Rituels et jeux funraires dans lIliade ................................. 147
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
7/11
9
Introduction
Carlos Fausto et Carlo Severi
Depuis la publication deArt and Agency (Gell,1998, d. fr. 2009)ltude desformes daction, et donc de subjectivit, attribues aux artefacts est devenue undes thmes majeurs de la recherche anthropologique. Lorsque Gell parlait, il ya bientt vingt ans, dagentivit de lobjet, il se rfrait toutefois une notion de vie encore assez sommairement dfinie. Partout prsente dans nos socits, lidedune agentivit attribue aux artefacts engendrait ses yeux une croyance certesprofondment enracine dans la cognition humaine, mais aussi diffuse et volatile.Chacun de nous a, par exemple, lexprience dune parole virtuellement adresse des animaux ou des objets inanims, auxquels nous attribuons, presque sansle vouloir, une personnalit ou une forme humaine. Poupes, voitures, ou ordi-
nateurs nous apparaissent alors, le temps dune phrase et du jeu dinterlocutionquelle suppose, comme des interlocuteurs provisoirement lgitimes. Lorsquonsadresse ainsi aux objets de la vie quotidienne, ou quon leur attribue des penses,des affects, des perceptions semblables aux ntres, on suspend provisoirementcet tat dincroyance, pour utiliser la fameuse expression de Coleridge, qui nousdicte normalement une tout autre attitude envers les tres inanims. Cette suspen-sion peut nous paratre bien naturelle et spontane. Elle est aussi, toutefois, bieninstable, et rvocable tout instant.
On ajoutera que lagentivit de Gell tait troitement lie lide, bien propre lanthropomorphisme occidental, dune relation, presque spculaire, entre unobjet et une personne. Les artefacts, individuels ou distribus, quil tudie dansson livre, pensent, ressentent et parlent, souvent, comme des humains.
Que se passe-t-il lorsque des objets inanims assument dautres identits quecelle dun tre humain ? Comment changent-ils lorsquils se trouvent inscritsdans un contexte bien plus contraignant que la simple suspension dincrdu-lit , comme celui de laction rituelle ? Quelles formes prend alors la croyance ?
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
8/11
10
Limage rituelle
Comment prciser les relations qui se nouent entre lobjet et ltre vivant quil estcens incarner ? Telles sont les questions, que les textes ici rassembls (qui rsultentdune recherche collectivement mene1) tentent de poser.
En ce qui concerne la rfrence lhumain, constante chez Gell, une des contri-butions de ces recherches ici runies est sans doute que dans les traditions icono-graphiques non occidentales (notamment amrindiennes, sibriennes et africaines)quon a tudies, lanthropomorphisme ne semble pas jouer le mme rle quenOccident. Liconisme semble stablir dans ces traditions selon de tout autres prin-cipes. Dans le cas amrindien, par exemple, le problme de la figuration dun tredou de pouvoir, que dautres ont pu concevoir comme un invariant anthropolo-gique au sein dontologies diffrentes (Karadimas, 2012), ne conduit nullement la projection dune identit humaine sur lartefact, mais plutt lengendrementdimages hybrides et paradoxales, o les identits semblent senchsser les unesdans les autres, selon un dispositif de rfrences multiples (Fausto, 2011), composs
de traits contradictoires (Severi, 2007).En ce qui concerne linscription de lobjet dans un contexte rituel, on admettraque cest sans doute au sein de laction rituelle, o se construit progressivement ununivers de vrit distinct de celui de la vie quotidienne, que lexercice de la penseanthropomorphique ou, plus gnralement, subjectivante peut cristalliser etengendrer des croyances durables. Les objets y assument, de manire infinimentplus stable, un certain nombre de fonctions propres aux tres vivants. Ces mmesobjets, toutefois, peuvent aussi y prendre la place dun dfunt (Fausto et Penoni,Severi), ou tablir une relation avec un environnement spatial et social traversune forme spcifique de mouvement collectivement orient (Stpanoff). Ailleurs, les
artefacts peuvent chanter, faire de la musique (Bonhomme) ou prendre la parole la place dun tre audible, mais qui chappe la vue, tout en habitant un instru-ment (Piedade, Franchetto et Montagnani).
Dans lespace du rituel, sous forme de statuettes, dimages peintes ou sonores, lesobjets sont naturellement censs reprsenter des tres (esprits, divinits, anctres)et cest bien en tant que reprsentations iconiques que les anthropologues ou leshistoriens de lart les considrent habituellement. Il est pourtant clair que lorsquilagit sur la scne rituelle, lorsquil partage une exprience avec dautres acteurs durite, ou quil prend la parole pour eux, lobjet remplace ltre reprsent. En fait,plusieurs tudes ici runies montrent que cette focalisation sur la mise en acte delobjet dans le rituel peut nous amener considrer les artefacts non plus commedes systmes de signes, mais aussi et surtout comme des systmes dactions et derelations.
La prise en compte des dimensions pragmatiques et performatives des artefactsnous a paru, de ce point de vue, tout fait essentielle. Lorsquon les analyse dupoint de vue de leur agentivit rituelle, les objets napparaissent plus comme de
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
9/11
11
Introduction
simples supports inertes dun symbolisme, mais constituent de vritables moyensdagir sur autrui, des dispositifs complexes de mdiations investis de sens, devaleurs, dintentionnalits spcifiques. Il sagit donc daller au-del de la pure miseen place de schmas daction impliqus par les images, pour saisir, travers ltudedes relations impliques par liconographie, une dynamique propre lobjet rituel.En fait, si les objets jouent bien le rle de mdiateurs de relations sociales, cestdans le contexte de laction rituelle que linterprtation de leur agentivit se ralisepleinement. Dans ltude de la performativit attribue aux objets, on devra doncsattendre la mise en place didentits complexes, rsultant de ltablissementde relations rituelles, et non seulement au simple transfert dun anthropo-morphisme universel dans le monde des artefacts, comme lont propos, entreautres, Karadimas (2012) et Boyer (2001). On mettra donc lhypothse que plusle rseau de relations noues entre objets et personnes est pluriel et complexe, plusla croyance dans la vie de lartefact se rvlera saisissante et persistante dans le
temps.Dans cette perspective, lartefact napparat donc pas comme la simple incar-nation dun tre individuel, mais comme limage complexe dun ensemble derelations. Pour retrouver les traces de cette mmoire de laction rituelle dont lesartefacts sont porteurs, il faut en somme explorer le champ des subjectivits etdes agentivits possibles des objets.Tel est le domaine nouveau que ces travaux,chacun selon ses propres modalits, ont eu lambition dexplorer.
travers une analyse dune effigie funraire, le Javari des Kuikuro du Haut-Xingu (Brsil), Fausto et Penoni montrent comment un pantin rustique et vague-ment anthropomorphe fait figure de personnage central dun drame rituel. Grce
la parole et laction rituelles, le pantin devient progressivement le support desrelations incompatibles : symtriques et horizontales entre affins-ennemis, compl-mentaires et verticales entre vivant et mort. De son ct, Aparecida Vilaa prsenteune tude du cannibalisme funraire wari (Txapakura, Rondnia, Brsil), fondesur les narrations dtailles dinformateurs ayant particip eux-mmes ces rites, partir dune critique de la conception de condensation rituelle dveloppepar Houseman et Severi (1998) dans leur analyse du Naven Iatmul.Vilaa veutmontrer que ce rituel, ainsi que dautres brivement analyss la fin de larticle,nont pas comme but central de laction rituelle la production de personnes quicondensent diffrents rles sociaux, mais au contraire, quils visent la dcompacta-tion de rles multiples superposs.
Bruna Franchetto et Tommaso Montagnani introduisent la notion dimage rituellesonore. Chez les Kuikuro du Haut-Xingu il existe en effet un genre de musiquerituelle de flte (appel Kagutu), qui voque la fois le rfrent linguistique (lenom propre) et la prsence matrielle (sonore) de certains tres surnaturels. Dansce contexte dvocation rituelle des esprits, il est donc possible de parler dune
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
10/11
12
Limage rituelle
structuration linguistique de la matire musicale, tout autant que dune musicalitpropre la langue parle.
Acacio Piedade analyse un rituel des fltes sacres chez les Indiens Wauja duHaut-Xingu (Amazonie) qui soulve des questions importantes concernant lacosmologie, le chamanisme, et en particulier certaines caractristiques du systmemusical de ce rituel o lon peut observer lapplication de techniques trs spci-fiques de rptition et variation.
partir de lexemple dune tradition religieuse du Gabon, Julien Bonhommetudie lattribution dune forme aux instruments de musique rituelle. Dans leBwete, la harpe et larc musical sont en effet censs parler . Ils sont dots dunevoix conue limage de celle des hommes, mais prte aux entits surnaturellesdont le rituel sert convoquer la prsence. Cet anthropomorphisme repose sur unsavoir symbolique de type mythique, mais galement sur deux procds iconiquescomplmentaires : un iconisme visuel qui donne voir un visage et un iconisme
sonore qui fait entendre une voix. Le premier procd est illustr par leffigieanthropomorphe qui dcore la harpe ; le second, par la technique vocale-instru-mentale de larc musical.
Charles Stpanoff montre quen Sibrie, chez les Iakoutes, la qualit dagentrituel ne se dfinit pas seulement par la facult dexercer des pouvoirs causauxou par la possession dune intriorit, mais aussi par une capacit spcifique demouvement sur un territoire propre. Au cours du rituel chamanique iakoute, lamise en place de cet itinraire de lesprit est rendue possible par trois types deprocds linguistiques, gestuels et matriels , qui se renforcent conjointementpour former ensemble une technologie cognitive de laction rituelle.
Poursuivant une recherche commence ailleurs sur la relation rituelle entremorts et vivants en Grce ancienne, Carlo Severi (2009) analyse les jeux funrairesdestins, dans lIliade, honorer la mmoire de Patrocle. Il tudie, en particu-lier, comment une image rituelle du mort sy double dune image propre au jeu.Quelques considrations sur le cannibalisme funraire des Wari, en rponse auxobjections dAparecida Vilaa, concernant la notion de condensation rituelle, luipermettent ensuite desquisser deux prolongements possibles de lanalyse relation-nelle de laction rituelle inaugure dans Naven(Houseman-Severi, 1994) : ltudedes interactions quasi-rituelles, dfinies comme des interactions qui ne satisfontpas toutes les conditions qui dfinissent normalement une situation crmonielle(dont les jeux de lIliadesont un premier exemple) et lanalyse des situations mta-rituelles, qui mobilisent lanalyse de relations qui peuvent stablir, comme dans lecas Wari, entre rituels, et donc entre groupes de groupes de relations.
-
8/10/2019 Cahier d'anthropologie sociale n 10
11/11
13
Introduction
NOTE
1 Ce groupe de recherche, coordonn entre 2007 et 2012 par Carlos Fausto (Museo Nacional, UFRJ,Rio de Janeiro) et Carlo Severi (EHESS-CNRS, Paris), a runi des chercheurs brsiliens et franais,dans le cadre dun accord de coopration Capes-Cofecub (2007-2007) suivi par un Programme Saint-Hilaire (2011-2012). Il a aussi bnfici du soutien du projet ANR Art, Cration, Mmoire , dirigpar Carlo Severi au sein du Laboratoire danthropologie sociale (Collge de France, CNRS et EHESS).Nous remercions aussi, pour son aide amicale, le Groupe de recherche international Anthropologie delart du Muse du quai Branly. Nous tenons les remercier tous pour leur soutien gnreux.
Bibliographie
Boyer, P.2001 Religion explained. The human instincts that fashion gods, spirits and ancestors, Londres,Heinemann.
Fausto, C.
2011 Le masque de lanimiste : chimres et poupes russes en Amrique indigne , Gradhiva 13 :48-67.
Karadimas, D.2012 Animism and Perspectivism : still anthropomorphisms ? On the problem of perception in theconstruction of Amerindian Ontologies , Indiana29 : 25-51.
Gell, A.1998Art and agency : an anthropological theory, Oxford, Clarendon Press. Trad. fr. 2009 Lart et sesagents : une thorie anthropologique, Paris, les Presses du rel.
Severi, C.2007 Le principe de la chimre : une anthropologie de la mmoire. Paris, d. Rue dUlm-Muse duQuai Branly.
2009 La parole prte. Comment parlent les images , in C. Severi et J. Bonhomme, d.,Paroles enactes ( Cahiers dAnthropologie Sociale , 5), Paris, LHerne : 11-41.
Houseman M. et Severi, C.1994 Naven, ou le donner voir. Essai dinterprtation de laction rituelle, Paris, CNRS ditions etditions de la Maison des Sciences de lHomme, 224 p.