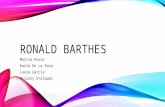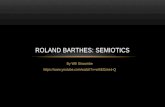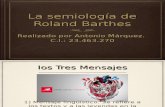Roland Barthes. L'Ecriture de l'Evenement
-
Upload
miguel-angel-maydana-ochoa -
Category
Documents
-
view
63 -
download
3
Transcript of Roland Barthes. L'Ecriture de l'Evenement

Roland Barthes
L'écriture de l'événementIn: Communications, 12, 1968. pp. 108-112.
Citer ce document / Cite this document :
Barthes Roland. L'écriture de l'événement. In: Communications, 12, 1968. pp. 108-112.
doi : 10.3406/comm.1968.1175
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1968_num_12_1_1175

Roland Barthes
L'écriture de l'événement
Décrire l'événement implique que l'événement a été écrit. Comment un événement peut-il être écrit? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire que « l'écriture de l'événement » ?
L'événement de mai 68 semble avoir été écrit de trois façons, de trois écritures, dont la conjonction poly graphique forme peut-être son originalité historique.
1. La parole.
Toute secousse nationale produit une floraison brusque de commentaires écrits (presse et livres). Ce n'est pas cela dont on veut parler ici. La parole de mai 68 a eu des aspects originaux, qu'il faut souligner :
a) La parole radiophonique (celle des postes dits périphériques) a collé à l'événement, au fur et à mesure qu'il se produisait, d'une façon haletante, dramatique, imposant l'idée que la connaissance de l'actualité n'est désormais plus l'affaire de l'imprimé mais de la parole. L'histoire « chaude », en train de se faire, est une histoire auditive \ l'ouïe redevient ce qu'elle était au moyen âge : non seulement le premier des sens (avant le tact et la vue), mais le sens qui fonde la connaissance (comme pour Luther il fondait la foi du chrétien). Ce n'est pas tout. La parole informative (du reporter) a été si étroitement mêlée à l'événement, à l'opacité même de son présent (il suffit de songer à certaines nuits de barricades), qu'elle était son sens immédiat et consubstantiel, sa façon d'accéder à un intelligible instantané ; cela veut dire que, dans les termes de la culture occidentale, où rien ne peut être perçu privé de sens, elle était l'événement même. La distance millénaire entre l'acte et le discours, l'événement et le témoignage, s'est amincie : une nouvelle dimension de l'histoire, liée désormais immédiatement à son discours, est apparue, alors que toute la « science » historique avait au contraire pour tâche de reconnaître cette distance, afin de la contrôler. Non seulement la parole radiophonique renseignait les participants sur le prolongement même de leur action (à quelques mètres d'eux), en, sorte que le transistor devenait l'appendice corporel, la prothèse auditive, le nouvel
1. Il faut se rappeler ces rues remplies d'hommes immobiles, ne voyant rien, ne regardant rien, les yeux à terre, mais l'oreille collée au transistor élevé à hauteur du visage, figurant ainsi une nouvelle anatomie humaine.
108

L'écriture de Vévénement
organe science- fictionnel de certains manifestants, mais encore, par la compression du temps, le retentissement immédiat de l'acte, elle infléchissait, modifiait l'événement, en un mot l'écrivait : fusion du signe et de son écoute, réversibilité de l'écriture et de la lecture qui est demandée ailleurs, par cette révolution de l'écriture que la modernité essaye d'accomplir.
b) Les rapports de force entre les différents groupes et partis engagés dans la crise ont été essentiellement parlés, en ce sens que le déplacement tactique ou dialectique de ces rapports le long des journées de mai s'est opéré à travers et par (confusion de la voie et de la cause qui marque le langage) le communiqué, la conférence de presse, la déclaration, le discours. Non seulement la crise a eu son langage, mais encore la crise a été langage (un peu au sens où André Glucksmann a pu parler du langage de la guerre) : c'est la parole qui a, en quelque sorte, labouré l'histoire, l'a fait exister comme un réseau de traces, comme une écriture opérante, déplaçante (ce n'est que par un préjugé poussiéreux que nous considérons la parole comme une activité illusoire, tapageuse et vaine, et que nous l'opposons aux actes) ; la nature « parlée » de la crise est ici d'autant plus visible qu'elle n'a eu, à proprement parler, aucun effet meurtrier, irrémédiable (la parole est en effet ce qui peut être « repris », son antonyme rigoureux, au point de la définir, ne peut être que la mort) K
c) La parole étudiante a débordé si pleinement, fusant de partout, allant et s'inscrivant partout, que l'on aurait quelque droit à définir superficiellement — mais aussi peut-être essentiellement — la révolte universitaire comme une Prise de la Parole (comme on dit : Prise de la Bastille.) Il apparaît rétrospectivement que l'étudiant était un être frustré de parole ; frustré mais non privé : par origine de classe, par vague pratique culturelle, l'étudiant dispose du langage ; le langage ne lui est pas inconnu, il n'en a pas (ou n'en a plus) peur ; le problème était d'en prendre le pouvoir, l'usage actif. Aussi, par un paradoxe qui n'est qu'apparent, au moment même où la parole étudiante revendiquait au seul nom des contenus, elle comportait en fait un aspect profondément ludique ; l'étudiant a commencé de manier la parole comme une activité, un travail libre, et non, malgré les apparences, comme un simple instrument. Cette activité a pris des formes différentes, qui correspondent, peut-être, à des phases du mouvement étudiant le long de la crise :
1) Une parole « sauvage », fondée sur 1' « invention », rencontrant par conséquent tout naturellement les « trouvailles » de la forme, les raccourcis rhétoriques, les joies de la formule, bref le bonheur d'expression (« II est interdit d'interdire », etc.) ; très proche de l'écriture, cette parole (qui a frappé assez vivement l'opinion) a pris logiquement la forme de Y inscription ; sa dimension naturelle a été le mur, lieu fondamental de l'écriture collective.
2) Une parole « missionnaire », conçue d'une façon purement instrumentale, destinée à transporter « ailleurs » (aux portes des usines, sur les plages, dans la rue, etc.) les stéréotypes de la culture politique.
3) Une parole « fonctionnaliste », véhiculant les projets de réforme, assignant à l'Université une fonction sociale, ici politique, là économique, et retrouvant de la sorte certains des mots d'ordre de la technocratie antérieure (« adaptation
1. L'insistance avec laquelle on a répété, de part et d'autre, que, quoi qu'il arrive, après ne pourrait plus être comme avant, traduit sans doute, dénégativement, la crainte (ou l'espoir) que précisément après redevienne avant : l'événement étant parole, il peut, mythiquement, s'annuler.
109

Roland Barthes
de l'enseignement aux besoins de la société », « collectivisation de la recherche », primauté du « résultat », prestige de « l'interdisciplinaire », « autonomie », « participation », etc)1.
La parole « sauvage » a été assez rapidement éliminée, embaumée dans les plis inoffensifs de la « littérature » (surréaliste) et les illusions de la « spontanéité » ; en tant qu'écriture, elle ne pouvait être qu'inutile (en attendant d'être intolérable) à toute forme de pouvoir, possédé ou revendiqué ; les deux autres paroles restent souvent mêlées : mélange qui reproduit assez bien l'ambiguïté politique du mouvement étudiant lui-même, menacé, en raison de sa situation historique et sociale, par le rêve d'une « social-technocratie ».
2. Le symbole.
Les symboles n'ont pas manqué dans cette crise, on l'a souvent remarqué ; il en a été produit et consommé avec une grande énergie ; et surtout, fait frappant, ils ont été entretenus par une complaisance générale, partagée. Le paradigme des trois drapeaux (rouge/noir/tricolore), avec ses associations pertinentes de termes (rouge et noir contre tricolore, rouge et tricolore contre noir) a été « parlé » (drapeaux hissés, brandis, enlevés, invoqués, etc.) par tout le monde, ou presque : bel accord, sinon sur les symboles, du moins sur le système symbolique lui-même (qui, en tant que tel, devrait être la cible finale d'une révolution occidentale). Même avatar symbolique pour la barricade : symbole elle-même, dès avant que la première fut construite, de Paris révolutionnaire, et elle-même lieu d'investissement de tout un réseau d'autres symboles. Emblème complet, la barricade a permis d'irriter et de démasquer d'autres symboles; celui de la propriété, par exemple, logé désormais, pour les Français, à ce qu'il est apparu, beaucoup plus dans l'auto que dans la maison. D'autres symboles ont été mobilisés : le monument (Bourse, Odéon), la manifestation, l'occupation, le vêtement, et bien entendu le langage, dans ses aspects les plus codés (c'est-à-dire symboliques, rituels 2). Cet inventaire des symboles devrait être fait ; non tellement qu'on doive en attendre une liste très éloquente (c'est peu probable, en dépit ou à cause de la « spontanéité » qui a présidé à leur libération), mais parce que le régime symbolique sous lequel un événement fonctionne est étroitement lié au degré d'intégration de cet événement dans la société dont il est à la fois l'expression et la secousse : un champ symbolique n'est pas seulement une réunion (ou un antagonisme) de symboles ; il est aussi formé par un jeu homogène de règles, un recours consenti en commun à ces règles. Une sorte d'adhésion presque unanime 8 à un même discours symbolique semble avoir marqué finalement acteurs et adversaires de la contestation : presque tous ont mené le même jeu symbolique.
1. Si l'on rassemble ces mots d'ordre, dispersés dans bon nombre de motions, comme les morceaux d'un puzzle, on s'aperçoit que l'image finale qu'ils forment n'est rien d'autre que celle de l'Université américaine.
2. Par exemple : lexique du travail révolutionnaire (« comités », « commissions », « motions », « point d'ordre », etc.), rituel de la communication (tutoiement, prénoms, etc.) 3. Le plus important, dans cet inventaire, serait au fond de repérer la façon dont chaque groupe a joué ou n'a pas joué le jeu symbolique : refus du drapeau (rouge ou noir), refus de la barricade, etc.
110

L'écriture de l'événement
3. La violence.
La violence que, dans la mythologie moderne on rattache, comme si cela allait de soi, à la spontanéité et à réflectivité, la violence, symbolisée ici concrètement puis verbalement par « la rue », lieu de la parole désenchaînée, du contact libre, espace contre-institutionnel, contre-parlementaire et contre-intellectuel, opposition de l'immédiat aux ruses possibles de toute médiation, la violence est une écriture : c'est (on connaît ce thème derridien) la trace dans son geste le plus profond. L'écriture elle-même (si l'on veut bien ne plus la confondre obligatoirement avec le style ou la littérature) est violente. C'est même ce qu'il y a de violence dans l'écriture, qui la sépare de la parole, révèle en elle la force d'inscription, la pesée d'une trace irréversible. A cette écriture de la violence (écriture éminement collective), il ne manque même pas un code ; de quelque façon qu'on décide d'en rendre compte, tactique ou psychanalytique, la violence implique un langage de la violence, c'est-à-dire des signes (opérations ou pulsions) répétés, combinés en figures (actions ou complexes), en un mot un système. Profitons-en pour redire que la présence (ou la postulation) du code n'intellectualise pas l'événement (contrairement à ce qu'énonce sans cesse la mythologie anti-intellectualiste) : l'intelligible n'est pas l'intellectuel.
Telles sont à première vue les orientations que pourrait prendre une description des traces dont se constitue l'événement. Cependant, ce genre de description risquerait d'être inerte si on ne la rattachait, dès le début, à deux postulats, de portée encore polémique.
Le premier consiste à séparer rigoureusement, selon la proposition de Derrida, les concepts de parole et d'écriture. La parole n'est pas seulement ce qui se parle réellement, mais aussi ce qui se transcrit (ou plutôt se translitère) de l'expression orale, et qui peut très bien s'imprimer (ou se ronéotyper) ; liée au corps, à la personne, au vouloir-saisir, elle est la voix même de toute revendication, mais pas forcément de la révolution. L'écriture, elle, est intégralement « ce qui est à inventer », la rupture vertigineuse d'avec l'ancien système symbolique, la mutation de tout un pan de langage. C'est dire, d'une part, que l'écriture (au sens où on l'entend ici, qui n'a rien à voir avec le beau style ou même le style littéraire) n'est nullement un fait bourgeois (ce que cette classe a élaboré, c'est plutôt une parole imprimée), et, d'autre part, que l'événement actuel ne peut fournir que quelques fragments marginaux d'écriture, dont on a vu qu'ils n'étaient pas forcément imprimés ; on tiendra pour suspects toute éviction de l'écriture, tout primat systématique de la parole, parce que, quel que soit l'alibi révolutionnaire, l'une et l'autre tendent à conserver l'ancien système symbolique et refusent de lier sa révolution à celle de la société.
Le second postulat consiste à ne pas attendre de la description scripturale un « déchiffrement ». Considérer l'événement sous l'angle des chances de mutation symbolique qu'il peut impliquer, cela veut dire d'abord rompre soi-même, autant qu'il est possible (ce n'est pas facile, cela demande un travail continu, commencé, il faut le rappeler, ici et là, depuis quelques années), avec le système de sens que l'événement, s'il se veut révolutionnaire, doit avoir à charge d'ébranler. Le versant critique de l'ancien système est Y interprétation, c'est-à-dire l'opération par
111

Roland Barthes
laquelleonassigne, à un jeu d'apparences confuses ou même contradictoires, une structure unitaire, un sens profond, une explication « véritable ». A l'interprétation, il faut donc peu à peu substituer un discours nouveau, qui ait pour fin, non le dévoilement d'une structure unique et « vraie », mais l'établissement d'un jeu de structures multiples : établissement lui-même écrit, c'est-à-dire décroché de la vérité de parole ; plus précisément encore, ce sont les relations qui nouent ces structures concomitantes, assujetties à des règles encore inconnues, qui doivent faire l'objet d'une théorie nouvelle.
Roland Barthes École Pratique des Hautes Études, Paris.