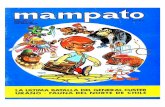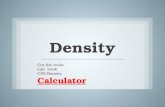DOCUMENT DE TRAVAIL 2015-011 - fsa.ulaval.ca › sirul › 2015-011.pdfOn-line publication updated :...
Transcript of DOCUMENT DE TRAVAIL 2015-011 - fsa.ulaval.ca › sirul › 2015-011.pdfOn-line publication updated :...

Publié 23 : Published by: Publicación de la:
Faculté des sciences de l’administration 2325, rue de la Terrasse Pavillon Palasis-Prince, Université Laval Québec (Québec) Canada G1V 0A6 Tél. Ph. Tel. : (418) 656-3644 Télec. Fax : (418) 656-7047
Disponible sur Internet : Available on Internet Disponible por Internet :
http://www4.fsa.ulaval.ca/la-recherche/publications/documents-de-travail/
DOCUMENT DE TRAVAIL 2015-011 Les stratégies des entreprises à l’ère de la civilisation écologique Document collectif Responsable : Zhan SU
Série électronique mise à jour : On-line publication updated : Seria electrónica, puesta al dia
09-2015

Avant-propos
L’économie linéaire héritée de la révolution industrielle qui repose sur une consommation massive des ressources est aujourd’hui condamnée à disparaître. L’économie circulaire représente une voie particulièrement porteuse du développement durable. L’économie circulaire s’inscrit dans un projet de société, impliquant la mobilisation et la collaboration de toutes les parties prenantes. Certes, elle vise à réduire l’utilisation des ressources non renouvelables et les émissions de gaz à effet de serre, mais bien au-delà, elle s’évertue surtout à faire passer d’un modèle de réduction d’impact à un modèle de création de valeurs aussi bien au niveau économique qu’au niveau socio-environnemental. Appliquée plus systématiquement depuis les années 90 dans les pays d’Europe du Nord (Allemagne, Suède, Danemark, …), ainsi que dans certains pays d’Asie (Japon, Chine, …), l’économie circulaire fait partie du programme ambitieux qui devrait être adopté par les États membres de l'ONU lors d'un sommet en septembre 2015. Cependant, produire sans détruire, régénérer au lieu de recycler uniquement, satisfaire à la fois les impératifs économiques et ceux écologiques, les défis relatifs au respect des principes de l’économie circulaire, demeurent aujourd’hui encore entiers pour les entreprises. Comment transformer les contraintes environnementales en de nouveaux avantages concurrentiels? Comment mener des changements efficaces dans le mode de production et le modèle d’affaires des entreprises? Quelles sont les expériences réussies des entreprises dans leurs efforts de conciliation des impératifs économiques et écologiques? Comment valoriser les compétences vertes des entreprises sur les marchés internationaux? Ce sont autant de préoccupations qui nécessitent des approfondissements. En collaboration avec Villes et Régions Innovantes et Commerce. Monde.Com, la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales a organisé un colloque le 24 novembre 2014. Au cours de ce rendez-vous scientifique, les étudiants au MBA de la FSA ULaval ainsi que ceux inscrits à d’autres programmes de maîtrise ont présenté les résultats de 11 projets d’études autour du thème central « Les stratégies des entreprises à l’ère de la civilisation écologique ». C’est avec un grand plaisir et une grande fierté que j’ai édité ce recueil qui réunit les 11 travaux réalisés par ces étudiants. Bonne lecture! Dr. Zhan Su Professeur titulaire de stratégie et de management international Titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales Faculté des sciences de l’administration Université Laval

TABLE DES MATIÈRES
SMARTCITIES:ENJEUXETIMPACTS 4Marion Duclos, Sabrina Grimard, Anne Leblanc, Mathieu Namèche et Boris Pirotte
LESENTREPRISESINTERNATIONALESFACEAUXDÉFISENVIRONNEMENTAUX:POLÉMIQUESETPRESSIONS 22Antoine Betat, Sophie Chillaud, Morgane Journeaux, Carla Panetta, Alexia Pellassy et Fanny Prost
EXPÉRIENCESDESENTREPRISESDEL’EUROPEDUNORD 50Geoffroy Boulnois, Mathilde Faivre‐Pierret, Ismaël Jeanneret, Odélia Jeannin et Maroua Khadim
EXPÉRIENCESDESENTREPRISESENAMÉRIQUEDUSUD 74Diva Berethet, Karim Douieb, Samuel Gouin, Jean Paumier et Thomas Poirier
EXPÉRIENCESDESENTREPRISESQUÉBÉCOISESETCANADIENNES 94Alexis Corradi, Louis‐Thomas Drapeau, Sanaa Hadri, Ghizlane Lahrougui et Mohamed Nabil Mihamou
EXPÉRIENCESDESENTREPRISESJAPONAISES 124Maïté Bernard, Maïlys Carlesso, Jean‐Romain Cordier, Charles Desbrosses et Olivier Devinck
OPPORTUNITÉS,DÉFISETFACTEURSDESUCCÈSSURLESMARCHÉSDETECHNOLOGIESVERTESAUXÉTATS‐UNIS 144Flavie Cohu, Mathilde Lainé, Morgane Lottmann et Constance Roncayolo
OPPORTUNITÉS,DÉFISETFACTEURSDESUCCÈSSURLEMARCHÉDESTECHNOLOGIESVERTESENCHINE 165Wesley Acolatse, Leila Gaizi Louriagli et Jie Zhao
CARACTÉRISTIQUESDESMARCHÉSDETECHNOLOGIESVERTESENAFRIQUEDANSLECONTEXTEDEL’INDUSTRIALISATION 180Maryse Ducharme, Caroline Favier, Vanessa Gallant, Valentin Goczol et Alexandre Raffin
LUTTECONTRELAPOLLUTIONETMARCHÉDESTECHNOLOGIESVERTESENINDE 201Aurore Martano, Flavio Molendini, Yassine Ouchraa Yassine, Marie Sailly et Audrey Texier
LESSOMMETSETLESTRAITÉSINTERNATIONAUXSURL’ENVIRONNEMENT:BILANETDÉFIS 218Guillaume Bourdeau, Adama Diallo, Marie‐Pier Morin, Sara Bennis Nechba et Romuald Somda

SMART CITIES : ENJEUX ET IMPACTS
Marion Duclos, [email protected] Sabrina Grimard, [email protected]
Anne Leblanc, [email protected] Mathieu Namèche, [email protected]
Boris Pirotte, [email protected]
Résumé
En résumé, le but premier de ce travail est de permettre une meilleure compréhension des impacts et enjeux d’une smart city. Cette étude commence par une mise en contexte expliquant que la croissance importante de la population dans les villes et les problèmes environnementaux furent les éléments déclencheurs des smart cities. D’autres phénomènes moins importants tels que la mondialisation et les inégalités sociales ont aussi joué un rôle important dans l’adaptation des villes actuelles en villes intelligentes.
Même si la notion de smart city reste difficile à définir actuellement, nous pouvons néanmoins affirmer qu’il s’agit d’un phénomène permettant de concilier les trois piliers du développement durable à savoir : environnemental, social, économique. De plus, selon l’expert Rudolf Giffinger, le concept de villes intelligentes peut être représenté par six facettes : une économie intelligente, une mobilité intelligente, un environnement intelligent, des habitants intelligents, une administration intelligente et un mode de vie intelligent. Ces smart cities sont aussi caractérisées par la mise en place d’une participation citoyenne importante et nécessaire à leur développement. Le développement de ces villes a également été marqué par l’apparition de nouvelles technologies visant à faciliter le quotidien des acteurs des villes concernées. Et enfin, une smart city se doit aussi de garantir un libre accès et une communication des données à ces différents acteurs.
À l’heure actuelle, plusieurs exemples de villes intelligentes ont déjà vu le jour. On peut penser à Copenhague qui tente de minimiser son empreinte écologique pour atteindre la neutralité carbone en 2025. De plus, certaines villes comme Lyon, Barcelone et Albuquerque essaient de capter de l’information par l’intermédiaire de la population pour ensuite la communiquer à l’ensemble de la population. Cette pratique vise essentiellement à faciliter le quotidien des acteurs par une mise à disposition plus efficace de l’information. En revanche, d’autres villes se sont focalisées sur l’implication de la population dans l’élaboration de nouveaux projets via un système de « crowdsourcing ». Cette étude se penche également sur le cas de Magog qui a préféré mettre sur place un organisme visant à faciliter les relations entre les entreprises et la ville tout en promouvant le développement de nouvelles technologies de l’information et de communication. Et enfin, Masdar est le cas particulier d’une ville construite dans le désert visant à être complètement autonome avec comme seule source d’énergie le soleil et le vent.
Le développement des smart cities a aussi permis l’apparition de toute une série d’opportunités. Grâce à l’innovation et aux technologies, les acteurs de ces nouvelles villes pourront bénéficier de services plus performants. De plus, la prise de décision au sein des villes intelligentes sera aussi facilitée par un accès à l’information beaucoup plus accessible qu’autrefois. Finalement, les entreprises pourront également satisfaire plus facilement les besoins des consommateurs grâce à la naissance d’une collaboration étroite avec le citoyen.
Cette étude met aussi l’accent sur les défis rencontrés lors du développement des smart cities. Parmi ceux-ci, nous retrouvons des défis d’ordre économique étant donné l’apparition de coûts quelques fois élevés lors des diverses adaptations requises. Un tel développement suscite également des défis sociaux étant donné l’implication des nombreuses parties prenantes actives au sein du projet. On retrouve aussi des défis liés à l’apparition des nouvelles technologies requérant un nouveau savoir-faire en terme de gestion de données, etc. Finalement, le développement des villes intelligentes sera également soumis à de nouvelles restrictions réglementaires liées à l’adaptation de certaines lois.

MISE EN CONTEXTE
En 2007, selon l’Institut National d’Études démographiques, une personne sur deux habitait en ville. Cette tendance irréversible tend à évoluer dans le même sens pour les années à venir. Il s’agit donc d’un véritable enjeu en termes d’urbanisation que les villes doivent relever aujourd’hui pour s’adapter aux besoins des générations de demain. C’est ainsi que l’Union européenne a investi environ 11 milliards d’euros pour permettre à 25 millions d’Européens de vivre dans des villes intelligentes.
La concentration de plus en plus importante d’habitants dans les villes leur confère un grand nombre d’opportunités, mais aussi de difficultés en terme de gestion d’urbanisation et d’environnement. En effet, une plus forte fréquentation des villes engendre de plus importantes émissions de gaz à effet de serre, une pollution atmosphérique croissante et donc une remise en cause des moyens de transport. Nous le savons, les ressources naturelles ne seront pas illimitées. Il incombe à tous d’adopter un comportement responsable et les villes peuvent aider les citoyens en proposant différentes mesures.
Par ailleurs, force est de constater que les changements climatiques profonds qui sont en train d’opérer nous poussent en tant que citoyen à s’interroger sur la nécessité d’avoir des infrastructures adaptées pour ce genre de phénomène. Ceci est une des raisons principales qui a conduit de nombreuses autorités à prendre des mesures nécessaires afin de contrer cette problématique alarmante.
Des phénomènes sociaux comme une augmentation des différences sociales peuvent aussi émerger et renforcer une dégradation de la pauvreté et de l’exclusion. Ceci peut notamment être lié à des inégalités d’accès à l’éducation, la santé ou la culture.
Enfin, la mondialisation, via une libération des échanges et un essor des technologies, complexifie le paysage urbain ainsi que les relations entre les différents acteurs. Les enjeux de la mondialisation les obligent à évoluer pour pouvoir rester compétitives. En effet, avec la mondialisation, on a vu apparaître un phénomène d’homogénéisation des attentes des personnes, il n’est donc pas impossible de penser à une évolution similaire des villes. Elles devront donc faire preuve d’originalité pour se différencier des autres villes. Cela est d’autant plus pertinent pour les moyennes villes qui veulent se démarquer par rapport aux métropoles. Le développement des technologies, notamment de communication, nous permet d’être de plus en plus connectés et d’avoir accès à de nombreuses données.
Ces différents enjeux poussent donc les villes à se repenser de manière plus durable et plus intelligente. Agir intelligemment c’est avoir une capacité d’apprentissage, de compréhension et d’adaptation en fonction des besoins. Il s’agit de qualités dont doit se doter une ville pour être caractérisée d’intelligente. Face à une urbanisation croissante, ce concept cherche à diminuer l’impact environnemental, mais également de repenser les modèles d’accès aux ressources, les transports et la gestion des déchets avec un mode de pensées axé sur le développement durable.
Pour mieux comprendre l’impact et les enjeux des smart cities, nous commencerons cet essai par une explication plus détaillée sur la notion de ville intelligente. Étant donné qu’il s’agit d’un phénomène existant, nous donnerons quelques exemples de cas précis et concrets à ce sujet.

Ensuite, nous aborderons diverses opportunités rendues possibles grâce au développement de ces smart cities. Un point sera également réservé pour recenser les défis auxquels la mise en place de smart cities doit faire face. Et enfin, nous terminerons cette rédaction sur les enjeux qui découlent du développement d’une « smart city ».
1 SMARTCITIES
Il est difficile de définir une smart city étant donné qu’il n’existe pas une seule définition. Il s’agit d’un concept qui est en plein essor. Les smart cities ou villes intelligentes ont pour objectif de concilier les trois aspects suivants : l’environnement, le social et l’économique. C’est à dire, les trois piliers du développement durable tout en prenant en compte le développement technologique. Dans le cadre d’une smart city, il est donc question de tout mettre en place pour améliorer le paysage urbain et de promouvoir un environnent éco-efficient. Certains auteurs caractérisent le développement durable comme la raison d’être de la smart city.
Ainsi, la smart city représente une version idéale de la ville dynamique qui cherche à durer et vivre avec son temps, tout en optimisant les services proposés aux habitants ainsi que la qualité de vie.
Deux types de smart cities existent aujourd’hui. Il y a celles qui émergent et qui sont entièrement conçues smart. On peut notamment citer Masdar. Ensuite, il y a les villes déjà existantes qui cherchent à s’adapter en intégrant des aspects intelligents aux services et infrastructures déjà présentes. Des exemples seront explicités dans la suite du rapport.
Rudolf Giffinger, expert en recherche analytique sur le développement urbain et régional à l’Université technologique de Vienne, s’est intéressé au phénomène des smart cities. Selon lui, il y a 6 facettes différentes aux smart cities :
- Une économie intelligente, basée sur l’innovation, l’entrepreneuriat et la productivité. - Une mobilité intelligente accessible par tous : mise en place d’un système de transport durable, innovant et sécuritaire. L’idée est de réduire l’emprunte écologique au maximum, d’optimiser l’espace urbain et offrir aux citadins une large gamme de solutions en termes de transport. C’est en ce sens qu’on voit de plus en plus l’émergence de mobiliers électriques. - Un environnement intelligent en jouant majoritairement sur la gestion des déchets et de l’énergie et sur la pollution. Les smart cities s’inscrivent comme une solution adéquate pour l’équilibre de l’offre et de la demande de ressources rares. - Des habitants intelligents, créatifs et ouverts d’esprit, participant à la vie communautaire. Un mode de vie intelligent avec un accès à la culture, aux services médicaux, à l’éducation, une attraction touristique et une cohésion sociale entre les habitants. Une administration intelligente qui prend en compte la participation citoyenne et qui est la plus transparente possible.
La participation citoyenne est nécessaire dans le développement d’une smart city. De plus en plus, les citoyens souhaitent collaborer et avoir un rôle cocréatif au sein de la ville. Il est donc important et nécessaire d’avoir une gouvernance qui repose sur la mobilisation des citoyens pour qu’ils se sentent plus intégrés, écoutés et qu’ils soient moins résistants aux changements.

Cette participation présente plusieurs avantages notamment l’amélioration de la démocratie, une meilleure réponse aux attentes des citoyens ainsi qu’une contribution positive à l’innovation.
Avec le développement des smart cities, on assiste à une rupture par rapport à l’urbanisme classique : de plus en plus, on cherche à inscrire la technologie au sein des objets, des infrastructures. Le développement technologique représente l’une des clés de succès d’une smart city. Il permet de révolutionner les façons de faire qu’avaient adoptées tous les citadins jusqu’alors. On assiste à une transformation de la ville grâce à des outils technologiques urbains destinés à favoriser la vie des citoyens. On peut notamment citer des outils facilitant l’accès aux services essentiels tels que la médecine (développement de la télésanté et de la télémédecine), l’éducation ou la culture avec des expositions virtuelles.
Figure 1 – Les six facettes d’une Smart City, Rudolf Guffinger
Le libre accès des données est aussi une caractéristique clé des smart cities. Il est
nécessaire, pour une ville, de définir une politique d’accès et d’exploitation intelligente des données.
Les Éco Cities ou villes durables regroupent l’ensemble des villes ayant mis en place des démarches s’inscrivant dans le développement durable. L’objectif des villes durables est de rester compétitive tout en respectant des considérations environnementales. Les deux concepts, Smart City et Eco City, sont extrêmement liés entre eux, car poursuivant les mêmes buts.

2 EXEMPLESDESMARTCITIES
Comme expliqué précédemment, de nombreux aspects peuvent représenter une ville intelligente et il est donc délicat de ne leur trouver qu’une seule définition. Dans cette optique, nous présenterons, à titre d’exemple, plusieurs villes intelligentes en nous focalisant sur les aspects présentés en introduction. Nous évoquerons aussi la ville de Magog qui propose un modèle impliquant directement les entreprises.
La ville de Copenhague est une des villes les plus « smart » d’Europe et du monde. Elle a opté pour la définition plus écologique du terme. La capitale vise à atteindre la neutralité carbone en 2025 (baker-marketing). Cet objectif ne semble pas irréalisable et la ville met de nombreux projets sur pied pour atteindre cet objectif. La ville a par exemple mis en place des lampadaires « intelligents », ceux-ci ne s’allument que lorsque les passants passent aux alentours et s’éteignent par la suite; ils transmettent aussi une quantité importante de données environnementales. De plus, Copenhague travaille en collaboration avec le MIT pour développer des vélos intelligents. Ils seraient équipés de capteurs permettant de transmettre de l’information sur la congestion routière et la pollution de l’air. Nous observons que la plupart des projets de la ville de Copenhague ont pour but de diminuer leur empreinte écologique et visent aussi à transmettre des informations à l’administration.
Selon le site de la ville de Lyon, la ville dispose d’un large réseau de communication. Cependant, l’accès et le partage d’informations sur ces moyens de communication sont fort dispersés. Dans cette optique, la ville de Lyon se veut, elle aussi, intelligente. Elle a mis au point la plateforme Optimod qui vise à centraliser toutes les données concernant la mobilité au sein de la ville. Ainsi, la ville pourra fournir des informations utiles, en temps réel, aux routiers sur l’ensemble des moyens de communication dont elle dispose. Le projet a deux enjeux majeurs. D’une part, il permettrait d’informer les usagers sur toutes les alternatives possibles pour se déplacer, diminuant ainsi l’utilisation de la voiture personnelle. D’autre part, ce système permettrait de faciliter les déplacements urbains. On observe, ici, que la ville de Lyon, avec la plateforme Optimod, se focalise plus sur l’aspect « mobilité ».
Nous pouvons aussi illustrer le critère de « l’économie intelligente » à la suite de l’analyse d’un document rédigé par l’institut Technologies de l’information et Société. Nous y apprenons que la ville d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, utilise une solution d'aide à la décision qui automatise le partage de données auprès de ses 7 000 employés répartis dans plus de 20 services. De telle sorte que chaque employé puisse demander l’avis aux autres employés quant à la décision qu’il doit prendre et, par la suite, faire le choix le plus judicieux. À la suite de cela, la ville a ainsi réalisé près de 2 000 % d'économies.
Comme expliquée précédemment, la participation citoyenne est essentielle. La ville d’Amsterdam, consciente de cet aspect, a mis au point, en 2010, « Amsterdam Opent » qui est un pilote de crowdsourcing. En visitant le site officiel de ce projet, nous avons appris qu’il permet de donner une chance aux citoyens de s’impliquer directement dans les problèmes de la société. La recherche de solutions aux problèmes est donc interactive. Les premières problématiques évoquées étaient principalement liées aux problèmes de stockage de vélos, à la diminution de criminalité, à l’attraction de nouveaux types d’entreprises et à l’utilisation plus efficiente de leur consommation d’énergie. De plus, une application web a été lancée permettant ainsi de faciliter l’interaction entre les citoyens et la ville.

Nous pouvons encore citer la ville de Barcelone qui, à travers « son smart city kit » (Smart Citizen), va permettre de mesurer et transférer en temps réel des informations concernant un ensemble de facteurs environnementaux tels que l’humidité, la qualité de l’air ou encore la température. Ces facteurs sont regroupés et communiqués à l’aide des citoyens qui joueront le rôle de capteurs regroupés dans différents quartiers de la ville. L’accès aux données va permettre à la population de connaître, comparer et transférer ces informations en temps réel entre les différents quartiers de la ville. Cet outil est très utile. Par exemple, il permet aux personnes souhaitant connaître les causes de l’effondrement des colonies d’abeilles de les aider dans la recherche de solutions. Voilà, à nouveau, un bel exemple où la ville compte sur ses citoyens pour recueillir, partager de l’information pour rendre leur vie plus facile et plus agréable.
Évoquons aussi le cas de Masdar, cette cité idéale, 100 % verte (reportage chaîne française TF1), en construction en plein désert. Elle est conçue pour optimiser le caractère écologique de la ville. En d’autres termes, Masdar a pour but d’être une ville sans déchets et qui n’aurait que pour seule source d’énergie, le vent et le soleil. L’utilisation de tout autre moyen de communication étant interdite, les seuls moyens de transport sont des voiturettes fonctionnant à l’électricité et dotées de capteurs magnétiques pour se diriger. La ville, bien que située dans le désert, est très vivable. L’architecture des bâtiments a été travaillée pour faire en sorte que la ville soit beaucoup plus vivable que ses villes voisines. Par exemple, la température au sein de Masdar est de dix degrés inférieurs à Abu Dhabi. De plus, les habitations sont disposées de telle sorte qu’elles ne nécessitent pas de climatisation.
Abordons, à présent, le cas Magog. Cette petite ville de 25 670 habitants a misé sur les technologies de l’information vertes. La ville a mis en place un réseau de fibre optique permettant d’offrir une grande panoplie de services aux citoyens et de possibilités aux entreprises. Ce projet est géré par « Magog Technopol » qui est un organisme qui vise à jouer un rôle de facilitateur entre la ville et les entreprises. En effet, leur but est de faire en sorte que les entreprises de Magog puissent se développer et tester leurs projets. En d’autres termes, il s’agit d’un laboratoire pour les entreprises. Par exemple, le site officiel de la ville met en avant la collaboration avec l’entreprise Zoutiz. Cette entreprise a mis au point une application permettant d’aider les citoyens dans la recherche de leurs besoins. L’application informe les consommateurs sur les produits qui sont vendus dans les magasins et à quel prix.

Tableau 1 – Comparaison des types de Smart Cities
Cette entente est bénéfique pour les deux parties. En effet, la ville de Magog avait pris conscience de l’importance de faire des promotions originales sur les tablettes et les Smartphones de la population pour les attirer dans les magasins de la ville; dans les grandes surfaces, des possibilités de renseignements sur les rabais sont aussi présentes. Pour Zoutiz, il s’agit d’une bonne manière pour tester ses produits et aussi une bonne voie de lancement sur le marché québécois et canadien.
En favorisant ces ententes avec les entreprises, la ville de Magog bénéficie des services offerts par les entreprises pour faciliter la vie des citoyens. Mais les entreprises bénéficient aussi d’un bon cobaye pour tester leurs produits et services et se développer sur le marché canadien.
Le tableau 1 présente et compare ces villes selon les types de focus des villes intelligentes qui existent : l’économie intelligente, l’environnement intelligent, la mobilité intelligente, les habitants intelligents, le mode de vie intelligent et l’administration intelligente.
3 OPPORTUNITÉS
Ce nouveau fonctionnement des villes liées avec la technologie et le développement durable apporte beaucoup de changements et d’opportunités autant du point de vue des entreprises que pour les citoyens.

3.1 Développementdenouveauxservicesperformants
Afin d’être conformes aux critères qui définissent une Smart City, les villes doivent développer des services performants. Des compagnies d’innovations seront donc appelées pour faire progresser les systèmes d’opérations afin d’améliorer la vie à l’intérieur de la ville. Cette nouvelle demande ouvrira un nouveau marché aux entreprises œuvrant dans le domaine de l’innovation et de la technologie.
http://blogs.cisco.com/sp/smart-cities-are-a-7-5-billion-annual-opportunity-for-technology-providers
De plus, La Commission de Régulation de l’Énergie stipule que ces nouvelles technologies apporteront de nombreuses opportunités pour les citoyens et les entreprises en leur offrant :
1) « Des innovations dans le transport et la mobilité à l’intérieur de la ville qui permettront une empreinte environnementale réduite, une optimisation de l’utilisation de l’espace urbain et procureront aux citadins une gamme variée de solutions de mobilité répondant à l’ensemble de leurs besoins. » (Citation CRE). Prenons l’exemple donné par IBM où Stockholm en Suède qui a réussi à faire une diminution de 20 % de la circulation et de 12 % des émissions de CO2 avec l’innovation de son système de mobilité. Ces systèmes de gestion de la circulation intelligents peuvent accroître également la productivité des entreprises en réduisant à la fois les embouteillages (perte de temps et productivité pour l’entreprise) et la consommation de carburant (diminution de coûts) tout en fournissant des données utiles et opportunes afin d’optimiser les prises de décisions. Un bon exemple donné par IBM est le cas de Dong Energy qui a installé des équipements de télésurveillances et de télécontrôle pour acquérir des informations très complètes sur l’état de son réseau. Résultat, il a réussi à réduire de 25 % à 50 % le temps de non-fonctionnement dans son entreprise.
2) Des solutions durables apportant de nouvelles méthodes d’approvisionnement, à la fois plus durables et moins coûteuses, de production et de commercialisation des biens et services. Selon CRE, les villes auront à mettre en place des systèmes efficaces de récupération et de valorisation des déchets, renforcer leur action en matière d’efficacité énergétique (développement de l’éclairage public à faible consommation) et mise en place de systèmes de production locale d’énergie (panneaux solaires sur les toits des édifices, production d’électricité à partir des déchets, etc.). Quant aux entreprises, elles auront à déployer des plateformes d’intégration transparentes et proactives avec les employés, les consommateurs et la société. Avec ces nouvelles méthodes, IBM en conclut qu’il sera possible pour celles-ci de consolider leurs centres de distribution pour réduire les émissions d’environ 15 % et les coûts de carburant d’environ 25 %.

En réinventant leur processus de fabrication dans un contexte écologique et durable, elles pourront bénéficier d’une diminution de la consommation d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Enfin, une entreprise intelligente peut réduire sa consommation de papier jusqu’à 80 % grâce à un phénomène de dématérialisation, peut abaisser ses coûts immobiliers de plusieurs dizaines de millions et éliminer 20 % du volume de programmation logicielle (et les coûts énergétiques associés) en remodelant l’activité de ses équipes (IBM).
3) Une urbanisation responsable et des habitats intelligents qui contreviendront au modèle actuel urbain coûteux en espace, en équipements publics et en énergie. Les nouveaux bâtiments intelligents assureront un ensoleillement suffisant et amélioreront la gestion de l’énergie, voire une réduction des consommations. Du côté des entreprises, IBM cite qu’elles pourront bâtir des centres informatiques écologiques répondant aux objectifs institutionnels et anticiper l’explosion de l’information et les contraintes croissantes de la réglementation environnementale. En possédant une vue globale de la consommation d’énergie, les entreprises pourront donc accroître l’efficacité des bâtiments, des flottes et des équipements. En ce sens, IBM donne l’exemple de l’entreprise Kikai Leiner qui a conçu et mis en place un nouveau centre d’information écoénergétique modulaire et évolutif qui lui a permis de réduire de 40 % sa consommation d’énergie.
3.2 Prendredesdécisionsefficacesàl’aidedestechnologiesdel’informationetdelacommunication
Grâce à l’installation de nouvelles technologies de l’information et de la communication, telles que des capteurs et compteurs intelligents, des supports numériques, des dispositifs d’information, etc., la ville possédera une meilleure gestion urbaine. Selon CRE, ces systèmes permettront une analyse d’informations clés qui faciliteront la prise de décisions aux administrateurs et assureront une amélioration constante des services existants (gestion de bornes de recharge de véhicules électriques, éclairage public intelligent, vidéosurveillance, gestion des péages urbains, stationnement intelligent, alertes civiles, gestion intelligente des déchets, etc.). Avec cette cueillette d’informations, les organismes de la sécurité publique auront également la chance de traiter celle-ci et d’identifier des tendances avant qu'elles n'aboutissent à des problèmes systémiques ou à des incidents criminels. Les citoyens pourront donc vivre dans une ville beaucoup plus sécuritaire et adaptée à leurs besoins. En plus de diminuer le risque de perte dû à la criminalité, les entreprises auront l’opportunité de connaître les tendances de leurs clients et de répondre plus rapidement et facilement à leurs besoins.
3.3 Lecitoyenestl’acteurcentraldelaVilleIntelligente
La Smart City a comme pilier la satisfaction et la participation de ses citoyens. Elle détient donc comme fonction de lier le développement urbain au développement humain. Les habitants deviendront une partie prenante au sein de la ville et non plus de simples consommateurs. Une démocratie plus transparente sera mise en place afin de permettre de créer des liens démocratiques entre les parties prenantes et les gouverneurs. Ainsi, la ville sera construite en fonction des préoccupations des habitants dans tous les domaines. Selon IBM, des programmes sociaux seront dédiés aux citoyens afin de leur donner un accès en temps voulu aux services appropriés et une garantie de prestation efficace.Des soins de santé plus réactifs au moment de prendre des décisions grâce à la transformation en temps réel des données d’informations médicales.

De plus, les organisations avant-gardistes connectent leurs données, leurs systèmes et leurs protocoles de soins afin de garantir une communication et un partage sécurisé des informations. Enfin, les progrès réalisés en matière de gestion et de technologie de l'éducation (analyse, systèmes d'alerte anticipée pour identifier les étudiants à risque, Cloud Computing, etc.) vont permettre aux citoyens une meilleure éducation et ainsi pouvoir être plus actifs au sein de la société.
Bien que le citoyen soit un élément primordial des Smart Cities, les entreprises sont pour autant tout aussi importantes. À cet effet, l’institut de l’entreprise identifie des moyens avec lesquels une Smart City valorise ses entreprises. En effet, l’élaboration de systèmes qui met d’avant les firmes situées à l’intérieur de la ville, apporteront donc celles-ci à s’entraider et ainsi bénéficier d’un partage de savoir. De plus, lors d’appels d’offres, grâce à l’instauration d’un « Local Small Business », les compagnies se retrouvant dans la ville sont privilégiées par rapport aux autres. Les petites entreprises ont donc une plus grande possibilité de croissance que si elles étaient situées dans une autre ville. Finalement, avec le fonctionnement et l’environnement de la Smart City, les entreprises seront apportées à développer de nouvelles compétences via l’émergence de nouveaux modèles d’affaire et ainsi être plus empreints à se démarquer.
4 DÉFIS
Les sections suivantes décriront les différents défis qui sont liés à la ville intelligente pour chacune des parties prenantes, particulièrement pour la ville et les entreprises, ainsi que les citoyens. Le tableau 2 vous présente plus simplement les différents défis par catégories.
4.1 Défiséconomiquesetapplicationsdesprojets
Tout d’abord, le virage des villes vers la « Ville Intelligente » place celles-ci devant plusieurs défis économiques.
L’élaboration et l’implantation des Smart Cities impliquent des coûts très importants, surtout lors de la période de démarrage. Les infrastructures existantes doivent être modifiées, de nouvelles créées, des technologies développées, etc. De bonnes analyses doivent être faites au niveau de ses ressources, infrastructures et fonctionnement énergétique. L’implantation peut être très longue et des plans concrets et des feuilles de route doivent être réalisés. La création peut en être difficile, car elle dépend des objectifs particuliers des villes ainsi que de leurs ressources. Avec l’expérience et l’apprentissage, le développement se fera plus rapidement et à moindres coûts. Stefano Carosio d’Appolonia en Italie met l’emphase sur l’importance de collecter de l’information directement auprès des différents agents afin d’identifier leurs besoins et d’adopter leurs visions.
Afin de bien contrôler le déroulement des projets et applications, les défis de la ville doivent être gérés un à un vu leurs singularités afin de bien veiller au fonctionnement de la ville intelligente. Des tests doivent aussi être effectués afin de connaître l’impact réel des projets ainsi que de s’assurer de leur fonctionnement. La transformation d’une ville intelligente peut prendre du temps et il faut donc être patient. De plus, une vision claire du gouvernement ou de la mairie est essentielle pour favoriser l’industrie à investir en toute confiance.

Bien que de nombreux aspects positifs découlent du développement d’une ville intelligente, les acteurs peuvent être confrontés à la peur du changement et donc des processus de divulgations d’information doivent être mis en place afin de réduire cette réticence des citoyens, entreprises, gouvernement, etc.
Pour assurer le bon développement de la ville et une bonne intégration, des coentreprises peuvent être nécessaires. Bien que ces partenariats apportent de la synergie, il peut en découler de nombreux problèmes et la division des coûts et économies entre les partenaires peut s’avérer très ardue. L’organisation est donc primordiale. Une fois ces synergies trouvées, la ville ne vivra que mieux!
La ville peut aussi devoir mettre en place des programmes de financement pour inciter les PME et grandes entreprises à participer dans le développement des villes intelligentes. Les recherches qui ont été faites ne fournissent pas assez d’informations au sujet des retours sur investissements ainsi que des avantages à long terme, ce qui peut freiner certains investisseurs. Certaines villes ont déjà fait le virage smart city, mais puisque c’est très récent, les effets à long terme et l’efficacité réelle de ces villes sont difficiles à connaître. En effet, un défi majeur identifié concerne la stimulation du dynamisme économique et l’attractivité de ces villes pour les entreprises. À titre d’exemple, la ville de Magog a mis sur pied un organisme sans but lucratif (Magog Technopole) afin de favoriser la croissance des entreprises dans le secteur des technologies vertes, de l’information et des communications. L’effort demandé aux entreprises est considérable, car elles doivent repenser leurs idées, reconstruire leurs modèles de business, s’adapter, collaborer, investir, innover, développer. En effet, Sehl Mellouli, professeur à l’Université Laval, mentionne que des changements doivent effectivement être faits au niveau de la culture organisationnelle. C’est donc une bonne idée pour la ville d’essayer de motiver les entreprises à le faire. Pour revenir au précédent exemple, Magog se propose également de servir de laboratoire pour toute une série d’entreprises innovantes voulant tester d’éventuels projets.
Finalement, considérant le caractère limité des ressources naturelles, la smart city doit être en mesure de penser à de meilleures manières d’utiliser au mieux ses ressources limitées afin de favoriser le développement durable.
4.2 Défissociaux
Comme mentionné dans le rapport du ministère de l’industrie et du commerce Espagnol, le côté social des villes intelligentes est vital, car ces villes impliquent la participation de toutes les parties prenantes de la ville soit les entreprises, les citoyens, la mairie, les organismes à but non lucratif, les autorités, les communautés, les dirigeants politiques, etc. Afin que l’implantation fonctionne, les gens doivent être bien informés de ce qu’est une “smart city”, ce que cela implique et quels en sont les avantages et inconvénients en découlant. Une participation importante est aussi requise dans les projets pilotes afin de bien planifier l’établissement des nouveaux processus. La volonté et la collaboration des parties prenantes est donc très importantes à cette étape d’implantation il est souvent difficile d’obtenir leur collaboration, car c’est souvent des implications bénévoles. Les gens ont tendance à croire que les coûts impliqués par les smart cities surpassent sa valeur. Il est donc important de leur démontrer les avantages à long terme que ces actions ont pour la ville.

De plus, la dynamique entre les différentes parties prenantes est fondamentale dans une ville intelligente. Il peut être très difficile de déterminer qui utilise telle infrastructure et comment les différentes parties prenantes doivent agir entre elles. Dans un projet, il peut y avoir de nombreuses parties prenantes avec toutes des objectifs différents, il peut donc alors être difficile d’aligner les priorités de ces groupes. La ville doit donc apporter beaucoup d’importance sur les aspects de collaborations, de communications. De plus, les villes ont de la difficulté à assurer la coordination entre les nombreux initiatives et projets. Bien que la place que prend la mairie soit souvent plus importante, la planification des projets ainsi que la détermination des objectifs doivent être effectuées par tous les différents acteurs et doivent être complémentaires les uns aux autres. Des visions claires doivent également être émises afin de ne pas créer d’écarts de compréhension et de but. En effet, le manque d’une vision forte a souvent été un problème mentionné dans le rapport du « Department for business innovation & skill » du Royaume-Uni. De plus, un autre enjeu important pour ces villes intelligentes est de garantir une gouvernance municipale transparente par l’ouverture des données. Une ville intelligente se doit de mettre à disposition du public une série de données pouvant leur être utiles.
Cette entremêlée de projets collaboratifs entre les parties ainsi que l’utilisation de technologies, amène à un autre point qui soulève de grands défis: la sécurité et la protection des données échangées (consommateurs, entreprises...), dans une “smart city” étant donné la précision et le volume de données échangées. Ces données peuvent révéler les locations, actions, habitudes des personnes ainsi que des informations personnelles. Leur sécurité et leur confidentialité sont donc primordiales afin de diminuer les risques, l’atteinte aux droits, etc.
4.3 Défistechnologiquesetdegestiondesdonnées
L’élaboration d’une ville intelligente requiert de nombreuses technologies. Non seulement il faut des efforts pour les développer, mais il faut aussi d’autres efforts afin de bien faire fonctionner l’infrastructure technique. De plus, ces technologies ainsi que leurs applications requièrent des examens de la législation applicable afin de respecter les lois, ce qui peut rendre la tâche des entreprises assez ardue et retarder des projets. Ces règles posent aussi des obstacles techniques au déploiement des réseaux intelligents. Par exemple, le stockage de données qui doit être effectué à partir de sources renouvelables seulement.
Certaines technologies « Smart Cities » sont déjà développées, mais la plupart ne sont pas entièrement arrivées à maturité et des coûts importants y sont associés. De nouveaux développements de technologies sont encore nécessaires, à la fois pour innover et à la fois pour réduire les coûts. L’interconnexion entre les technologies présentes dans les villes intelligentes nécessite aussi l’étude des technologies existantes telles que les voitures électriques par exemple qui pourraient être liées aux réseaux. Cela demande alors des efforts et des coûts supplémentaires d’analyse. Il serait aussi important d’augmenter le nombre et le type d’essais pilotes avant d’implanter de nouveaux projets afin d’en voir la pertinence, l’efficacité et les possibles avantages à long terme.
De plus, certains affirment que dans les Smart Cities l’accent est mis davantage sur la technologie, qui permet l’efficience et le développement durable en oubliant ce qui importe vraiment; soit vivre dans un meilleur environnement. L’accent devrait être davantage sur les approches centrées sur les humains, sur l’amélioration de la qualité de vie, etc.

Les systèmes de technologie de l’information devraient servir en plus des fonctions mentionnées précédemment, à faciliter l’usage des interfaces pour les utilisateurs en les simplifiant, etc.
Comme mentionné dans le rapport de Anne Galang, afin d’interconnecter la ville intelligente, plusieurs types de « sensors » sont normalement utilisés afin de collecter de nombreuses informations, de rechercher digitalement et d’interroger la ville, cela engendre énormément de flux d’information. Bien qu’elles nous permettent d’avoir de l’information en temps réel, le nombre de données utilisées et stockées dans les bases de données devient tellement important que leur gestion représente un élément fondamental très important, voire problématique. De plus, ces capteurs sont souvent accueillis avec scepticisme et inquiétude au niveau de la santé, sécurité et confidentialité des données. En effet, des groupes de protection des consommateurs affirment que ces compteurs intelligents émettent des ondes de radiofréquences nocives pour l’être humain.
De plus, le fonctionnement d’une ville intelligente demande d’avoir accès à de nombreuses données. Il peut cependant être difficile d’obtenir des données sensibles d’une entreprise. Des incitatifs quelconques pourraient être utilisés ou mis en surface afin d’attirer les entreprises à collaborer.
4.4 Défisréglementaires
L'intégration institutionnelle et réglementaire des exigences de planification urbaine pour l'intégration de fonctions intelligentes de la ville est primordiale. Les cadres réglementaires ne sont pas assez adaptés aux besoins des « Smart Cities ». Les lois devraient refléter les avantages économiques de ces villes et inciter les entreprises à investir dans les secteurs connexes. Certaines entreprises ne veulent pas investir et prendre le risque de ne pas pouvoir mettre en œuvre un projet, car les lois ne sont pas modifiées. Les entreprises vont généralement attendre l’application des lois avant d’investir et cela peut donc retarder le développement des villes intelligentes.
Tableau 2 – Résumé des défis des Smart Cities
Sphère Défis
Économie et application des projets
Coûts Modification des infrastructures Plans détaillés Feuille de route Définir objectifs particuliers Définir vision claire Analyses Collecte d’informations Tests Temps d’implantation Surmonter la peur au changement Programmes de financement Recherches sur retours sur investissement

5 LIENSAVECL’ÉCONOMIEFONCTIONNELLE
En conclusion, retenons que l’apparition des problèmes environnementaux et l’augmentation démographique ont conduit à repenser les villes d’aujourd’hui en villes intelligentes. Ce phénomène s’est caractérisé par une multitude d’adaptations de la part des différents acteurs y interagissant. N’oublions pas aussi que ce concept de « smart cities » est actuellement un phénomène en plein essor qui repose sur trois piliers fondateurs qui caractérisent celle-ci. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la définition donnée par R. Giffinger nous a aussi permis de mieux comprendre les différentes caractéristiques des villes intelligentes.
Retenons également que le développement de ces « smart cities » permet aussi l’apparition d’opportunités dont bénéficieront les acteurs de la ville. Premièrement, nous avons insisté sur le fait que les villes intelligentes allaient favoriser la mise en place de nouveaux services plus performants. Cette amélioration se fera essentiellement via l’innovation des entreprises, mais aussi par de nouvelles technologies qui permettront ainsi l’existence de nouveaux marchés. Deuxièmement, ce phénomène de villes intelligentes facilitera également les prises de décisions grâce à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. En effet, l’ensemble des acteurs pourra bénéficier d’un flux d’informations beaucoup plus abondant et accessible qu’autrefois. Troisièmement, le citoyen ne sera plus considéré comme un acteur passif vivant dans la ville, mais bien comme une source potentielle d’informations. Par conséquent, celui-ci se verrait accorder un rôle nouveau qui consisterait en une coopération avec les entreprises dans l’élaboration de nouveaux projets.
Sociale Implique la participation de toutes les parties prenantes Informations Démontrer avantages smart city Alignement des objectifs et vision Collaborations Atteinte aux droits des citoyens, risque de non-confidentialité des
données Technologie et gestion des données
Développement Coûts Fonctionnement Changement des législations Études, analyses Essais Focus sur approche centralisée humains Gestions des données Réticences capteurs Accès aux données
Règlements Différentes exigences Adaptation des lois Ralentissement des investissements par les entreprises

À l’heure actuelle, plusieurs d’entre elles ont déjà commencé à faire leurs preuves. Des villes comme Copenhague, Barcelone, Masdar et bien d’autres encore sont en train de réussir leur pari dans l’accomplissement des efforts requis pour lutter contre ces problématiques. Comme déjà évoquées ci-dessus, certaines excellent déjà en matière de coopération et d’intégration des différents acteurs présents via le crowdsourcing alors que d’autres focalisent leurs efforts sur leur attractivité envers les entreprises ou sur la mise à disposition d’une information via diverses plateformes.
Attention aussi que la réalisation de cet idéal ne se fait pas sans contraintes. En effet, le développement de ces smart cities doit faire face à plusieurs types défis économiques, sociaux, technologiques, de gestion des données et d’ordre réglementaire.
Étant donné que nous sommes à même capable de comprendre les difficultés pour nos entreprises de s’adapter à ce type de changements. Cette métamorphose des villes traditionnelles en villes intelligentes engendre un impact direct sur les stratégies à long terme des entreprises. Certaines firmes voient même leur business modèle changer à la suite de certaines exigences en matière de respect de l’environnement. De ce fait, il serait intéressant de se pencher sur cette problématique en élargissant notre domaine de recherche à des solutions innovantes pour ces entreprises. Pour bien faire, il serait judicieux de trouver une réponse permettant de satisfaire à la fois les exigences en matière de développement durable ainsi que le bien-être et la compétitivité des firmes. Une des solutions envisageables serait de proposer aux entreprises d’opter pour une économie de type fonctionnelle. Alors qu’on dénonçait précédemment un éventuel changement des business modèles, cette pratique vise justement à changer le modèle d’affaire des entreprises tout en favorisant une situation de « win-win » entre les différentes parties prenantes impliquées dans la transaction. L’objectif principal d’une telle pratique conduirait l’entreprise à changer son mode de production afin d’induire une valeur d’usage plus élevée et plus durable tout en consommant le moins de ressources matérielles et d’énergie possible. Le but étant ainsi d’atteindre une meilleure compétitivité accompagnée d’une augmentation des revenus de l’entreprise. À l’heure actuelle, ce type de pratique est déjà mis en place par quelques géants de l’industrie tels que Michelin qui ne vend plus des pneus, mais des « km » ou encore Xerox qui permet à ses clients de remplacer les pièces défaillantes et non plus l’appareil dans son entièreté. Bien entendu, nous terminerons ce rapport en disant que les objectifs à long terme de ces villes intelligentes seraient de devenir complètement autonome et avoir une gestion participative maximum entre les différents acteurs vivant au sein de ces villes.

6 RÉFÉRENCES
SitesInternet
Analyse des Smart Cities, disponible à l’adresse suivante : http://lechainonmanquant.be/analyses/ville_intelligente.html
IEEE, Smart Cities Challenges, disponible à l’adresse suivante : http://smartcities.ieee.org Indra, Smart-Cities, disponible à l’adresse suivante :
HTTP://WWW.INDRACOMPANY.COM/EN/SOLUCIONES-Y-SERVICIOS/SOLUCION/SMART-CITIES/14921/SUMMARY
Les Smart Cities répondent à l’enjeu du développement durable, et permettent de nouveaux usages en intégrant les innovations technologiques, disponible à l’adresse suivante :
http://www.fr.capgemini-consulting.com/blog/the-voices-of-capgemini-consulting/2012/05/les-smart-cities-repondent-a-lenjeu-de-developpement-urbain-durable-et-permettent-de-nouveaux-usages-en-integrant-les-innovations-technologiques
Les villes dans la mondialisation, disponible à l’adresse suivante : HTTP://WWW.STRATEGIE.GOUV.FR/SITES/STRATEGIE.GOUV.FR/FILES/ARCHIVES/INVITATION32E
MERDV.PDF Qu’est-ce qu’une ville intelligente, disponible à l’adresse suivante :
https://itunews.itu.int/Fr/4191-Villes-intelligentes.note.aspx Eco City, promotion de la mixité sociale et réduction de l’empreinte carbone, disponible à
l’adresse suivante : http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smartcities-eco-city Smart cities Council : 16 cities chosen for IBM's Smarter Cities Challenge 2014, disponible à
l’adresse suivante : http://smartcitiescouncil.com/article/16-cities-chosen-ibms-smarter-cities-challenge-2014
Smart cities in Europe, Challenges, disponible à l’adresse suivante : http://www.smartcitiesineurope.com/category/challenges/ Commission de régulation de l’énergie : Introduction : pourquoi la ville intelligente ?,
disponible à l’adresse suivante : http://www.smartgridscre.fr/index.php?rubrique=dossiers&srub=smartcities&action=imprimer
IBM, Une planète plus intelligente, disponible à l’adresse suivante : http://www.ibm.com/smarterplanet/fr/fr/index.html?re=sph
Digital Greenwich, Market Opportunities for Innovators in Smart Cities, disponible à l’adresse suivante : http://www.digitalgreenwich.com/market-opportunities-for-innovators-in-smart-cities-2/
Rita Baker, la ville intelligente et l’adoption de ses projets novateurs par les citoyens-partie1, disponible à l’adresse suivante : http://baker-marketing.com/la-ville-intelligente-et-ladoption-de-ses-projets-novateurs-par-les-citoyens-1-ere-partie-quest-ce-que-la-ville-intelligente/
Optimod Lyon, optimiser la mobilité durable en ville, disponible à l’adresse suivante : http://www.optimodlyon.fr/fr/accueil/objectifs
TF1, Masdar, ville verte en plein cœur du désert : découverte, disponible à l’adresse suivante : http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/masdar-ville-verte-en-plein-coeur-du-desert-visite-8341591.html
AmsterdamOpent, over ons, disponible à l’adresse suivante : https://amsterdamopent.nl/index/page/id/26

Open source technology for citizens’political participation in smarter cities, disponible à l’adresse suivante : https://www.smartcitizen.me/
Magog Technopole, communiqué de presse-deux nouvelles entreprises magogoises innovent dans le domaine des TIC, disponible à l’adresse suivante : http://magogtechnopole.com/deux-nouvelles-entreprises-magogoises-innovent-dans-le-domaine-des-tic/
Actualité
Stephane Roland, Les villes intelligentes, l'un des enjeux des élections municipales, Journal les Affaires : 8 juin 2013, disponible à l’adresse suivante : http://www.lesaffaires.com/archives/generale/les-villes-intelligentes-l-un-des-enjeux-des-elections-municipales/558440
Marie Schippers, La ville intelligente, utopie humaine ou mirage techno, journal Le Chaînon manquant : 27 octobre 2012, disponible à l’adresse suivante : http://lechainonmanquant.be/analyses/ville_intelligente.html
Journaux
Adel S. Elmaghraby, Michael M. Losavio , Cyber security challenges in Smart Cities: Safety, security and privacy, Journal of Advanced Research, Elsevier, 2014, Volume 5, Issue 4, July 2014, Pages 491–497
Nasrin Khansari, Ali Mostashari and Mo Mansouri, School of Systems and Enterprises, Stevens
Institute of Technology, USA, Impacting Sustainable Behaviour and Planning in Smart City, internaional Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, ISSN 1927-8845| Vol. 1 No. 2, pp. 46-61 (2013)
DocumentsPDF
Jacques Véron, Populations et sociétés “La moitié de la population mondiale vit en ville”, juin 2007, disponible à l’adresse suivante : https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19103/435.fr.pdf
Anne Galand, ENGL 794, Transmedia, Smart Cities and Big Data ARUP, Department for business innovation & skils, The Department for Business Innovation &
Skills, The Smart City Market Opportunities for the UK, big research paper no 136, 2013, disponible à l’adresse suivante : https://www.gov.uk/government/publications
Cover story, Smart city, CW prosperity, 2013 Felisa jover couce, 5o B IIND. Sustainable development, Smart cities,2012 Fundación Telefónica: Smart Cities: un primer paso hacia la internet de las cosas, 2011,
disponible à l’adresse suivante : http://www.socinfo.es/contenido/seminarios/1404smartcities6/01-TelefonicaSMART_CITIES-2011.pdf
Graziano Delrio, Presidente ANCI e Sindaco di Reggio Emilia, Smart cities nel mondo, Cittalia fondazione anci recherché, disponible à l’adresse suivante : http://www.cittalia.it/images/file/SmartCities.pdf

Ministerio de industria, turisme y comercio, Mapa tecnologico “ciudades inteligentes” Observatorio Tecnológico de la Energía lunes, 17 de octubre de 2011, disponible en ligne à l’adresse suivante: http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&catid=138%3Apresentaciones&id=1931%3Amapa-tecnologico-ciudades-inteligentes&option=com_content&Itemid=127
POLICIES OF SMART CITIES, power point Rudolf Guffinger, European smart cities: the need for a place related Understanding, 2011,
disponible à l’adresse suivante : http://www.smartcities.info/files/04%20-%20Rudolf%20Giffinger%20-%20SC_Edinburgh_VUT_RGiffinger.pdf
Sehl Mellouli, Professor, Faculty of Business Administration, Laval University, Smart cities, power point, 2012
IBM BÂTISSONS UNE PLANÈTE PLUS INTELLIGENTE (power point) par Thomas Coustenoble, Manager of Market Insight à IBM, disponible à l’adresse suivante : http://fr.slideshare.net/tcoustenoble/ibm-batissons-une-plante-plus-inteligente-dveloppement-durable-et-au-del-final?qid=2278b436-f997-4785-a781-50339b1e45cf&v=default&b=&from_search=24
INSTITUT DE L’ENTREPRISE, Smart Cities, efficace, innovante, participative : comment rendre la ville plus intelligente ?, disponible à l’adresse suivante : http://www.institut-entreprise.fr/sites/default/files/publication/docs/publication_extrait/fiche-synthese-vf.pdf
INSTITUT TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET SOCIÉTES, villes intelligentes, un bref survol, disponible à l’adresse suivante : https://www.itis.ulaval.ca/files/content/sites/itis/files/fichiers/Survol_VI.pdf

LES ENTREPRISES INTERNATIONALES FACE AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX : POLÉMIQUES ET PRESSIONS
Antoine Betat, [email protected] Sophie Chillaud, [email protected]
Morgane Journeaux, [email protected] Carla Panetta, [email protected]
Alexia Pellassy [email protected] Fanny Prost, [email protected]
Résumé
Comment l’entreprise internationale réagit-elle face aux défis environnementaux et à tout ce qu’ils engendrent? Voilà la question à laquelle nous avons tenté de répondre au sein de ce rapport. Dans un premier temps, nous avons énuméré les défis environnementaux en suivant une logique par secteurs d’activité. Chaque défi est illustré par des polémiques qui ont fait trembler notre société. S’ensuit un raisonnement objectif concernant les raisons qui peuvent expliquer le comportement des entreprises quand il s’agit de polluer. Les entreprises internationales sont-elles les bourreaux ou les victimes de l’environnement? On note deux sortes de compagnies : celles qui polluent sans se préoccuper du bien-être de notre planète; puis celles qui ont décidé d’intégrer la notion de développement durable à leur stratégie. Mais quelles ont été les raisons de ce changement? Est-ce les pressions exercées sur ces firmes qui en sont responsables? Tout au long de ce rapport, c’est ce que nous tenterons de vous exposer.
INTRODUCTION
Le 16 octobre dernier, François-Guy Trébulle, directeur de l'École Doctorale de Droit de la Sorbonne, a donné une conférence à l’Université Laval et y a défini l’information environnementale comme obligatoirement performative. C’est dire que l’objectivité est impossible. En effet, ce sujet nous amène obligatoirement à prendre position.
Ainsi, traiter de la question des entreprises internationales face aux défis environnementaux sans tomber dans le piège d’une condamnation stérile ou d’une défense hypocrite s’avère extrêmement compliqué.
Commençons donc par une définition des termes du sujet.
D’après le Larousse, un défi est « l’action de provoquer, de vouloir atteindre le même niveau que quelqu’un ». En d’autres termes, lorsque nous parlons de défi, nous pouvons également évoquer l’idée de challenge.
Quant à l’environnement, il s’agit selon le Dictionnaire Larousse d’un « ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins ». Mais nous pouvons également avancer une autre définition : « ensemble des éléments objectifs (qualité de l’air, bruit…) et subjectifs (beauté du paysage, qualité d’un site…) constituant le cadre de vie d’un individu ».
Alors, qu’est-ce qu’un « défi environnemental »? Il n’existe pas de définition officielle à ce jour, mais nous pouvons le qualifier comme étant la « recherche d’une cohabitation saine entre l’Homme/la Société et la Nature ».

Les entreprises, en tant qu’acteurs de la société, auraient alors une responsabilité sociétale de premier plan pour faire face aux défis environnementaux. Par ailleurs, sur une planète dont on mesure de mieux en mieux les limites et l’impact de l’activité humaine, ce constat dépasse les frontières et s’applique d’autant plus aux entreprises internationales.
Nous identifierons tout d’abord l’ensemble des défis environnementaux qui touchent l’entreprise internationale en adoptant une typologie par secteurs d’activité. Dans un second temps, nous chercherons à comprendre les causes de la pollution des entreprises : impasses technologiques ou décisions financières et commerciales? Enfin, nous étudierons les différentes pressions qui s’exercent sur l’entreprise internationale en matière environnementale et les manières dont elle y répond.
1 LESDÉFISENVIRONNEMENTAUXPARSECTEURS
Afin de réaliser une typologie exhaustive des défis environnementaux pour les entreprises internationales, nous les avons classées par secteurs d’activité. Ces derniers sont ceux établis par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
1.1 «Topofmind»dessecteurspolluants
Industriemanufacturière
Exploiter les ressources sans polluer, vrai ou faux?
L’INSEE définit ce secteur comme : « Les industries manufacturières sont des industries de transformation des biens, c'est à dire principalement des industries de fabrication pour compte propre, mais elles concernent aussi la réparation et l'installation d'équipements industriels ainsi que des opérations en sous-traitance pour un tiers donneur d'ordres. » Ainsi, cette industrie compte nombre d’activités : industrie lourde, chimique, pharmaceutique, automobile ; la cokéfaction et le raffinage; le textile ou encore les fabrications de caoutchouc et plastique.
Ce secteur fait face à de nombreuses polémiques environnementales :
Pollution de l’air
Avec sa grande diversité d’activités, il émet dans l’atmosphère toutes sortes de gaz. Il est notamment le premier pollueur en zinc, sélénium, plomb, arsenic, chrome. Ces émissions ont pour conséquences des phénomènes de pluies acides et la formation de nuages de pollution.
Conséquences négatives sur la santé
La pollution de l’air engendre des effets néfastes sur la santé des individus et des animaux. En effet, l’Agence Européenne Environnementale (AEE) affirme que « les taux de pollution de l’air élevés ont pour conséquence de réduire la durée de vie des habitants. » Aussi, elle est responsable d’environ 10 % des cancers du poumon. En effet, dans un article de La Presse, l’auteur écrit que « le CIRC montre qu'en 2010, 223 000 personnes étaient décédées d'un cancer du poumon en lien avec la pollution de l'air. » (Pedrero, 2013).

Aussi, l’un des rapports fait par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) stipule que « la seule année 2012, plus de 7 millions de morts dans le monde sont attribuables aux effets de la pollution de l’air » (Le Ngoc, 2014). En effet, cette dernière est « le facteur environnemental le plus important affectant la santé […] des pays riches aussi bien que des pays pauvres » selon le Docteur Maria Neira, directrice du département de la santé publique à l’OMS.
Pollution de l’eau
Une grande pollution de l’eau est engendrée par ce secteur d’activité. Nous allons ici nous concentrer sur l’industrie textile, notamment. La plupart des vêtements fabriqués aujourd’hui contiennent du coton. Or, selon une étude du Water Footprint Network, « un tee-shirt de 250 grammes requiert environ 2 500 litres d’eau; un jean de 800 grammes nécessite 8 000 litres rien que pour l’irrigation » (Combe, 2014). De plus, cette même étude affirme que « pour produire 1 kg de fibres de coton, l’irrigation requiert entre 6 000 et 27 000 litres d’eau » (Combe, 2014). Ces chiffres diffèrent selon les pays où ces fibres sont fabriquées. En Chine, l’empreinte eau est en moyenne de 6 000 L/kg (dernier du classement) tandis qu’en Inde elle est de 22 500 L/kg (Combe, 2014).
Ainsi l’industrie manufacturière a été victime à de nombreuses reprises de polémiques autour de ses activités.
Pour illustrer cette partie, nous pouvons nous appuyer sur le cas de Bhopal (Inde) en 1984. L’explosion de l’usine productrice de pesticides de l’entreprise américaine Union Carbide. Cette explosion aurait été causée par la politique de réduction drastique des coûts de la multinationale, engendrant des dysfonctionnements techniques majeurs. L’explosion aurait donc libéré une quantité importante de gaz iso cyanate de méthyle formant un nuage toxique ayant causé des effets irréversibles sur la santé des habitants de Bhopal. Cette tragédie a également causé la mort de 15 000 à 30 000 habitants. Par ailleurs, l’explosion a engendré près de 347 tonnes de déchets toxiques.
Nous pouvons également nous pencher sur l’industrie textile qui fait très souvent face à des polémiques environnementales. En 2012, dans plusieurs de ses rapports « Les dessous toxiques de la mode », « Dirty Laundry » et « Dirty Laundry 2 », Greenpeace attaque diverses entreprises textiles. En effet, selon l’Organisation Non Gouvernementale (ONG), ces dernières offriraient à ses clients des habits pouvant porter atteinte à leur santé. Ces vêtements sont tous fabriqués en Asie du Sud-Est (Chine, Viêtnam, Malaisie et Philippines). L’ONG a acheté 141 produits textiles dans 29 pays afin de procéder à des tests. Les résultats sont flagrants: « 63 % des articles contiennent des éthoxylates de nonylphénols, composés chimiques fréquemment utilisés comme tensioactifs, notamment détergent et imperméabilisant, dans la production de textiles » (Urus, 2012). Les marques dont les produits étaient le plus imprégnés de cette molécule sont : « C&A, Mango, Levi’s, Zara » (Urus, 2014) et bien d’autres. Ces habits ne sont pas directement dangereux au contact humain, mais ils le deviennent au contact de l’eau. Ainsi selon un article du Monde écrit par Audrey Garric, il est stipulé que « les NPE se dégradent en effet dans l'eau en nonylphénol (NP), considéré comme un perturbateur endocrinien et classé comme substance dangereuse prioritaire par l'Union européenne. » Aussi, dans ce même article il est écrit que « ce sous-produit toxique peut, à terme, s'accumuler dans les sédiments des rivières puis dans la chaîne alimentaire par l'intermédiaire des poissons ou des champs. »

De plus, lors de cette étude, « deux articles de la marque Zara contenaient des colorants azoïques qui peuvent libérer des amines cancérogènes. » (Urus, 2012). Par conséquent, les marques qui fabriquent les produits considérés comment les plus dangereux tant pour la santé que pour la planète sont: C&A (83 % des produits testés sont positifs aux NPE), Calvin Klein (88 %), GAP (78 %), ONLY (100 %) et VANCL (100 %).
Construction
Comment aménager le territoire sans nuire à l’environnement?
Le secteur de la construction rencontre un grand nombre de défis environnementaux, engendrant polémiques et scandales. En effet, il est responsable de la contamination de l’air, de la terre et de la pollution sonore.
Pollution de l’air
Il émet dans l’atmosphère nombre de particules fines toxiques restées en suspension dont notamment les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) et le Dioxyde de Souffre (SO2). Prenons l’exemple des sables bitumineux, un baril de pétrole produit in situ génère 0,082 tonne de CO2 et un baril de pétrole produit par extraction mécanique 0,073. De plus, à Fort McMurray au Canada, les pics de pollution sont passés de 47 en 2004 à 1556 en 2009.
Contamination des terres
Le rejet de déchets et l’érosion des sols engendrent une contamination des terres. Revenons aux sables bitumineux. Chaque baril produit génère 1,5 baril de déchets toxiques. Ces déchets sont ensuite enterrés et participent à la création de boues toxiques pour l’écosystème tout entier. D’ici 2022, 214 000 m3 de ces boues devraient être produits annuellement.
Pollution sonore
Cette pollution provient des véhicules et machines nécessaires à la construction. Ces derniers peuvent causer des effets néfastes sur la santé des populations avoisinant le site, tels que la diminution de l’ouïe, l’augmentation du stress et des troubles du sommeil. En effet, un marteau piqueur situé à cinq mètres a une pression sonore de 110 dB(A). Cette puissance peut engendrer de fortes douleurs. De plus, un gros camion diesel situé à sept mètres a, quant à lui, une pression sonore de 90 dB(A). Cette pression peut causer une fatigue auditive. Ainsi, sur le long terme, une exposition continue à ce type de perturbations peut être responsable d’une perte de l’audition.Afin de donner une idée plus précise de ces pressions, nous pouvons comparer le bruit des feuilles poussées par le vent, une conversation normale et le bruit d’un marteau piqueur. Le marteau piqueur sera onze fois plus puissant que le vent dans les feuilles et deux fois plus puissant qu’une conversation normale. Enfin, le seuil de décibels qui permet une absence totale de perturbation est de 40.
Dénaturalisation de sites et destruction des économies locales
Enfin, il peut être responsable de la dénaturalisation de paysages (e.g. déforestation), ainsi que de la destruction d’économies locales.

Afin d’illustrer cette partie, nous pouvons parler de la polémique envers le géant français du pneu, Michelin, et la délocalisation d’une de ses usines dans le sud-est de l’Inde dans le village de Thervoy (État du Tamil Nadu) en 2010. En effet, l’implantation de cette fabrique a détruit 456 hectares de forêt utilisés pour l’agriculture locale. Par ailleurs, la multinationale n’aurait pas attendu le « feu vert » des autorités indiennes avant de commencer la construction.
Nous pouvons également prendre comme exemple le cas de l’île artificielle Palm Jumeirah construite en 2007 par Nakheel Properties qui menace près de 50 espèces de poissons vivant autour de l’île. En effet, la société a dû extraire plusieurs millions de m3 de sable afin de réaliser cette construction.
Enfin, le projet de construction pharaonique d’un troisième aéroport à Istanbul est une parfaite illustration. En effet, nous pouvons qualifier ce projet de colossal, car l’aéroport, une fois ouvert, est censé accueillir 150 millions de passagers par an. Or, le Ministère de l’Environnement de Turquie reste sceptique à cette idée et affirme que « la zone prévue pour le projet compte 7.650 hectares alors que la superficie forestière est de 6.172 hectares », sachant que cet espace naturel accueille plus de 70 espèces (Albert, 2013). Enfin, si ce projet vient à être concrétisé, il engendrera la construction d’un grand nombre d’infrastructures à ses alentours tels que routes et hôtels, augmentant ainsi le niveau de pollution dans la ville.
Transport
Transporter sans polluer, réalité ou utopie?
Le secteur du transport est primordial dans la mobilité des biens, services et personnes. Or, cette activité crée un grand nombre d’effets néfastes sur notre planète. Il est notamment responsable en grande partie de la mauvaise qualité de l’air.
Pollution de l’air
En effet, la combustion de fossiles nécessaire au fonctionnement des divers véhicules (e.g. voitures, avions, navires, camions…) dégage une pollution importante dans l’atmosphère.
Problèmes de santé
Selon la Banque Mondiale, avec l’augmentation de la mobilité, nous remarquons aujourd’hui que cette pollution devient problématique dans de nombreux pays, se traduisant par des pluies acides, phénomène de smog, réchauffement climatique, baisse de la qualité de l’air causant des problèmes respiratoires aux populations.
Prenons l’exemple du transport maritime. En effet, en 2006, 7.4 milliards de marchandises ont été transportées par navires à travers le monde. Ce chiffre correspond à environ ⅘ du commerce international de marchandises. Aussi, un rapport de l’OCDE permet d’identifier certains effets indésirables sur l’environnement par le transport maritime dont notamment le rejet des eaux usées des bateaux, d’hydrocarbures et de produits chimiques ou encore la perte de cargaisons dans les océans. Ce type de transport fait d’autant plus polémique avec la fonte de la calotte glacière qui ouvre alors de nouvelles voies de passage. Le débat est très actuel avec l’arrivée en Finlande du premier bateau (NORDIC ORION) transportant du charbon.

Lors de la conférence intitulée « Ports et Transport maritime face aux défis du développement durable », Valérie LAVAUD-LETILLEUL affirme que les ports et le transport maritime sont responsables « de la dégradation des côtes, des écosystèmes littoraux, de la nuisance portant atteinte à la qualité de vie des populations » et la liste ne s’arrête pas là.
Par ailleurs, nous pouvons prendre comme exemple la conférence tenue à l’Université Laval le vendredi 10 octobre 2014 au Pavillon Desjardins: « Les baleines et le pétrole » avec Patrick GONZALEZ, Robert MICHAUD et Gale WEST. Lors de cette dernière, il est précisé que l’entreprise TransCanada souhaite construire un oléoduc à Cacouna pour que les navires-citernes voguant sur le Saint-Laurent puissent s’approvisionner. Cependant, ce projet pose quelques soucis. En effet, son terminal se situe près d’une zone d’alimentation pour les bélugas.
Les impacts possibles sont les suivants :
Bruits sismiques causant un stress élevé chez les mammifères marins et pouvant alors altérer leur reproduction
Destruction des zones de chasse Augmentation du trafic maritime puisque l’oléoduc permettra le réapprovisionnement des
bateaux plus facilement
Le défi de ce type d’entreprise et notamment celui de TransCanada est de rendre compatible le développement de ses activités et la préservation de l’habitat naturel des bélugas et de l’ensemble de l’écosystème.
Énergie
Selon l’Actu-Environnement, Jean-Marie CHEVALIER, professeur à l’Université Paris Dauphine estime que résoudre « l’équation de Johannesburg » est notre défi du XXIe siècle (Fabrégat, 2008). Cette équation consiste à « produire davantage d'énergie pour contribuer au développement économique des plus pauvres tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ». (Fabrégat, 2008)
Nombreuses sont les polémiques qui touchent l’entreprise internationale face au défi énergétique. Nous insisterons ici sur deux d’entre elles :
L’extraction de matières fossiles
L’extraction des gaz, de pétrole et d’autres matières fossiles est bien souvent au cœur des débats sur l’environnement.
Ainsi, la multinationale TOTAL a été épinglée pour avoir procédé à l’exploitation de gaz de schiste au cœur de la réserve naturelle d’Auca Mahuida en Argentine. En plus de l’impact sur l’écosystème local, l’utilisation de la technique de perforage hydraulique a été fortement critiquée. En effet, celle-ci est extrêmement consommatrice d’eau. Un forage de puits nécessite entre 10 000 et 20 000 m3 d’eau. Aussi, il génère d’importantes nuisances sonores. D’autre part, ces puits produisent moins de gaz qu’un forage classique. De même, British Petroleum (BP) a été montré du doigt à la suite de la tragique explosion de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique le 21 avril 2010. Cet évènement a engendré la mort de onze personnes, mais pas seulement. En effet, près de 4,4 millions de barils de pétrole se sont déversés dans l’océan causant la mort de nombreux mammifères marins,

affectant la population des oiseaux de mer, altérant l’écosystème et détruisant les côtes Américaines. Quatre ans après ce drame, une partie du pétrole est toujours présente dans l’océan.
L’énergie nucléaire
Tant l’utilisation de l’énergie nucléaire que l’extraction d’uranium ou le traitement des déchets sont au cœur des polémiques environnementales à l’international. En effet, selon la journaliste Laure Noualhat seulement 1,5 % des déchets nucléaires sont recyclés. L’entreprise AREVA est accusée d’avoir négligé les principes de sécurité de base dans ses mines au Niger et au Gabon depuis une quinzaine d’années et d’avoir profité du laxisme du gouvernement de ces pays pour alimenter ses centrales en Europe. En quarante ans d’exploitation au Niger, Areva a utilisé près de 270 milliards de litres d’eau dans un pays où l’eau est une denrée rare ce qui a provoqué la pollution de l’eau et l’assèchement de l’aquifère, qui mettra des millions d’années à se renouveler. De même, 35 millions de tonnes de déchets ont été accumulés depuis le début de l’exploitation et sont stockés à l’air libre. Ces déchets contenant 85 % de radioactivité d’origine du minerai resteront radioactifs pendant des centaines de milliers d’années. Conséquence de cette négligence, une personne passant moins d’une heure par jour dans les rues d’Akokan (village créé pour loger les employés de la mine) est exposée à une dose supérieure à la dose annuelle maximum autorisée (soit environ 500 fois le taux de radiation “normale“).
Agricolesetagroalimentaires
La Food and Agriculture of United Nations (FAO) pose la question suivante : « Comment nourrir 7,3 milliards d’individus et exploiter la biosphère aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à le faire? »
Plusieurs polémiques ont été soulevées face à ce défi :
Affaiblissement de la biodiversité et destruction des écosystèmes
Selon la Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), les activités de « l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et de la pêche heurtent la biodiversité de notre planète ». Par exemple, l’Indonésie a perdu en 50 ans 72 % de ses forêts anciennes. En effet, l’équivalent d’un terrain de football de forêt y disparaîtrait toutes les dix secondes, soit deux millions d’hectares tous les ans selon l’organisation écologiste les Amis de la Terre. L’une des conséquences de ces déforestations massives est la disparition de certaines espèces animales, telles que l’orang-outan ou le tigre de Sumatra. Principale cause de cette déforestation, la production de l’huile de palme. Elle est un ingrédient clé de nombreux produits alimentaires et cosmétiques et est une des huiles les moins chères du marché. Par conséquent, c’est également l’une des plus consommées au monde. Il s’en produit 1 600 litres par seconde dans le monde soit 50 millions de tonnes en 2011. Si certains groupes industriels, dont Nestlé, tentent de trouver des substituts à l’huile de palme, elle constitue toujours une matière première de premier choix pour la multinationale Ferrero dans la fabrication de sa pâte à tartiner Nutella par exemple.

Pollution des eaux
En effet, ces derniers, si rejetés dans les eaux, causeront une eutrophisation des lacs, des réservoirs et des mares. Ce phénomène provoque notamment une prolifération d’algues (algues vertes par exemple) envahissantes qui altèrent la chaîne alimentaire. Par ailleurs, les produits chimiques utilisés ainsi que les déchets agricoles en s’infiltrant dans les sols polluent les eaux souterraines.
Prenons le cas de l’usine de Coca-Cola à Vârânasî dans le nord de l’Inde qui a fait polémique. En effet, la production d’un litre de Coca nécessite neuf litres d’eau potable ce qui assèche les nappes phréatiques dont le niveau a terriblement baissé en passant de 45 mètres à 150 mètres de profondeur. De plus, la multinationale s’est mise à puiser en toute illégalité provoquant une diminution du rendement des récoltes de 10 %. De même, l’entreprise rejette des déchets toxiques qui à la saison des pluies entraînent la contamination des rizières, des canaux et des puits qui menacent l’environnement et la santé des villageois.
Pollution de l’air
La FAO affirme que « l'étendue et les méthodes de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche sont les principales causes de perte de biodiversité dans le monde. » Ce même organisme explique notamment qu’« ils constituent aussi les principales sources anthropiques des gaz à effet de serre - le méthane et l'oxyde nitreux - et ils contribuent massivement à d'autres types de pollution de l'air et de l'eau. » Enfin, il ajoute que « le bétail produit environ 40 pour cent des émissions de ce gaz dans le monde, les engrais minéraux 16 pour cent et la combustion de la biomasse et les résidus de culture environ 18 pour cent. »
Ceci se traduit également par le phénomène des pluies acides. Ces dernières selon la FAO « abîment les arbres, acidifient les sols, les lacs et les cours d'eau, et nuisent à la biodiversité. » Toujours selon la FAO, « la combustion de biomasse végétale est une autre source importante de polluants atmosphériques, dont le gaz carbonique, l'oxyde nitreux et les fumées », et « l’Homme est responsable d’environ 90 % de la combustion de biomasse. »
Lessecteursoubliés
Technologiesdel’informationetdelacommunication(TIC)
Le secteur des TIC est caractérisé par le Dictionnaire Larousse comme un « ensemble des techniques et des équipements informatiques permettant de communiquer à distance par voie électronique ». Il est souvent dit « écologique » par les entreprises qui considèrent qu’il permet notamment de remplacer le papier. Cependant, la question persiste : est-ce réellement possible de communiquer sans polluer?
Malheureusement, l’impact environnemental de ce secteur est conséquent :
Besoin d’énergie important
En effet, ces technologies requièrent de grandes quantités d’énergie afin de stocker les quantités massives d’information. Prenons l’exemple d’Equinix. Le centre de

traitement de données AM3 est une usine indispensable avec la croissance continue des technologies de l’information (Rolland, 2013). Elle accueille 80 000 serveurs. Ce centre de données consomme énormément d’énergie. En effet, pour fonctionner, chaque année il lui faut l’équivalent en énergie d’une ville comptant entre 20 000 et 50 000 habitants. Ceci peut correspondre, pour les Français, à des villes comme Biarritz (30 055) ou Fréjus (49 100) et pour les Canadiens, Chambly (20 938) ou Rimouski (50 912). En Europe, la Commission, estime que l’énergie nécessaire en 2008 était de 56 milliards de kilowatts et atteindra 104 milliards en 2020. Selon Greenpeace, les centres de données consomment environ 2 % de l’énergie mondiale.
Émission de CO2
Aussi, elles dégagent beaucoup de CO2 dans l’atmosphère. Effectivement, l’Agence environnementale de la Commission Européenne affirme que « les technologies de l’information et de la communication (TIC) contribuent ainsi à hauteur de 2 % aux émissions européennes de gaz à effet de serre », autant que le secteur de l’aviation. En résumé, voyager émet autant de CO2 que de stocker des données.
Nous pouvons notamment prendre l’exemple de Facebook qui fût au centre d’une polémique en 2010 lancée par Greenpeace sur son entrepôt de stockage situé dans l’Oregon aux États-Unis. En effet, ce dernier conserve toutes les informations du média social et nécessite énormément d’énergie. Ici, Facebook a choisi d’utiliser du charbon comme source d’énergie afin de conserver ses données, augmentant la pollution atmosphérique.
Notons également que le géant Apple fût également visé par Greenpeace pour son entrepôt de stockage « ICloud » en Caroline du Nord.
Industrietouristique
Les entreprises internationales du secteur touristique font face à deux polémiques principales :
Destruction des milieux naturels
Nombreux sont les cas à scandales soulevés par le développement du tourisme de masse sur les écosystèmes. Nous pouvons souligner ceux concernant les wastelands ou terres en friche. Ces sites naturels exceptionnels sont achetés par les grands tours opérateurs pour être convertis en villages vacances puis abandonnés sans remise en état en cas d’échec commercial. Le Club Med a ainsi été épinglé pour l’abandon de son village sur l’île de Bora Bora en Polynésie en 2007 ou encore de son Ressort en 2005 sur l’île de Moorea.
Rejet de gaz à effet de serre
En effet, le rejet de gaz à effet de serre dans l’air est notamment expliqué par les déplacements effectués pour partir en vacances. Ainsi, les compagnies aériennes, généralement exemptées des contraintes environnementales lors des grands accords internationaux sont très souvent pointées du doigt par les groupes de pression.

Comme constater plus tôt dans ce rapport, l’aviation émet 2 % de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Bien que ce chiffre reste raisonnable, il est important de garder en tête que l’utilisation du transport aérien ne cessera d’augmenter dans le futur. Cependant, le transport routier n’est pas un modèle comparé au transport aérien. En effet, selon l’article écrit dans l’Actu-environnement, Emmanuel Bouchez précise que « les véhicules particuliers sont les principaux responsables des émissions puisqu'ils représentent 56,7 % des GES émis par les transports routiers. » Il ajoute également qu’ « en comparaison, le transport par chemin de fer ne représente que 1,9 % de la consommation totale d'énergie et n'est responsable que de 0,4 % des émissions. »
Industriefinancièreetassurance
Les polémiques environnementales touchent l’industrie financière et l’assurance de manière indirecte.
En effet, l’ouverture des marchés aux capitaux étrangers va être favorable au développement des activités environnementales. Les entreprises présentant les meilleurs ratios économiques vont être favorisées, quel que soit leur impact environnemental. Celles qui font des efforts et les intègrent à leurs coûts peuvent alors se retrouver pénalisées.
Nous pouvons alors illustrer cette partie avec le scandale de biopiraterie qui a eu lieu au Brésil en 2012. En effet, 35 entreprises multinationales sont accusées de ne pas avoir respecté la loi brésilienne sur le partage des avantages issus de la biodiversité. Elles doivent donc payer 35 millions d’euros soit environ 50 millions de dollars canadiens. Au sein de ces 35 multinationales, nous pouvons retrouver Merck, Unilever, L’Oréal et bien d’autres. Donc nous remarquons que ces entreprises se sont certes fait épingler, mais elles continuent d’attirer les investisseurs étrangers.
2 LESENTREPRISESINTERNATIONALES:BOURREAUXOUVICTIMESDEL’ENVIRONNEMENT?
Comme nous avons pu le remarquer dans la section précédente, les polémiques liées aux divers défis environnementaux sont nombreuses et aucun secteur d’activité n’est épargné. Par conséquent, les entreprises internationales se trouvent souvent au cœur de ces scandales. Or, pouvons-nous vraiment toujours les incriminer sans chercher à comprendre leur comportement? Ainsi, pour répondre à cette question, nous analyserons dans un premier temps, dans quel contexte la compagnie se retrouve « bourreaux » de l’environnement, traduisant donc une attitude irresponsable vis-à-vis de ce dernier. Puis, dans un deuxième temps, nous démontrerons qu’elle peut également se trouver dans la position de victime lorsqu’il s’agit de protéger notre planète.

2.1 Lesentreprisesinternationales:criminellesdumonde
Depuis toujours, l’objectif phare de l’entreprise internationale est de développer sa stratégie d’internationalisation tout en réduisant ses coûts. Les raisons financières et commerciales peuvent être considérées comme principales amenant la firme à polluer de manière délibérée. Nous pouvons distinguer ces causes sous trois catégories : polluer pour baisser ses coûts, polluer pour développer son activité ou bien encore, polluer pour sauver son activité.
Polluerpourbaissersescoûts
Depuis la mise en place des accords de Kyoto en 1997, les compagnies des pays adhérents sont soumises à de forts investissements pour répondre aux différentes normes. Ainsi, elles ont vu leurs coûts environnementaux augmenter de manière drastique. Ces derniers, devenus gênants pour certaines entreprises, les ont amenés à se détourner vers deux nouvelles procédures permettant de les éviter : l’utilisation des différentes législations se trouvant davantage en leur faveur et le « dumping environnemental » mis en place dans certains pays. Nous parlons donc de la délocalisation des coûts environnementaux.
En droit, le « dumping environnemental » est défini comme « l’attitude d’un État qui cherche à accroître la compétitivité des entreprises présentes sur son territoire en allégeant les dispositions législatives qui protègent l’environnement ». Dans ce cas-ci, l’entreprise internationale est consciente des risques environnementaux dégagés par ses activités. Ainsi, elle va délibérément se servir de cette opportunité pour éviter les coûts supplémentaires engendrés par les normes environnementales, lui permettant donc d’éviter de prendre sa responsabilité quant à sa mise en danger de notre planète.
Le « dumping environnemental » est pratiqué de deux manières :
Législation souple
Ici, un pays aura une législation environnementale bien plus souple que les nations signataires du Protocole de Kyoto (Turki, 2009). Cette pratique a notamment donné naissance au phénomène de « concurrence environnementale » entre les pays du Sud, chacun cherchant donc à attirer les délocalisations des firmes dans leur pays. On parle ici de laxisme volontaire.
Prenons l’exemple du scandale des eaux polluées en Chine et l’implication de grandes entreprises internationales telles que Nike, Adidas ou bien encore H&M. En effet, ces multinationales ont été accusées par l’ONG Greenpeace de sous-traiter avec des entreprises chinoises responsables de la pollution des eaux via le rejet dans les rivières de quantités importantes de nonyphénol et de composés fluorés. Ces produits sont connus pour provoquer des troubles de la reproduction via un dérèglement hormonal des espèces. Les sous-traitants chinois, nommés Youngor et Well-Dyeing se sont justifiés ainsi : « Les rejets de Youngor dans la nature sont conformes aux normes chinoises. Les niveaux de Demande Chimique en Oxygène (DOC) et de Demande Biologique en Oxygène (DBO) sont en accord avec les niveaux maximums autorisés. Nous n’avons pas constaté de pratiques illégales. Quant aux composés perfluorés ou au nonyphénol, ils ne rentrent pas dans le cadre de nos tests. » (Greepeace.org)

Ainsi, l’argument avancé par ces entreprises chinoises prouve bien que les firmes internationales ne sont pas soumises aux mêmes législations quant aux rejets de composants chimiques dans la nature en Chine, où ces composés sont considérés comme légaux, et dans l’Union Européenne, où ils ont été bannis de l’industrie du textile depuis maintenant quinze ans (Garric, 2012). Rappelons que l’industrie textile est un des principaux pollueurs des eaux en Chine, où 40 % sont considérées comme gravement polluées et 20 % comme dangereuses pour l’Homme.
Cet exemple explique bien l’impact que peuvent avoir les différences de législation entre les pays. Aussi, il démontre que les entreprises internationales profitent de ces divergences législatives pour réduire leurs coûts environnementaux.
Législation non appliquée
Des législations environnementales strictes ont été instaurées par certains pays en voie de développement. Cependant, ces dernières ne sont pas appliquées correctement.
Sous couvert d’anonymat, un salarié d’une importante entreprise de production agricole en Afrique nous a ainsi expliqué que la plupart des pays de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Ouest n'ont pas vraiment réfléchi aux enjeux et aux vraies menaces des industries sur leur environnement. L’une des raisons est qu'un grand nombre de ces états sont peu industrialisés et doivent plutôt à faire face aux entreprises exploitant leurs ressources naturelles : pétrole, minerais, etc. Ces pays ont ainsi adopté telles quelles les réglementations européennes. Les normes s’avèrent ainsi surréalistes et les objectifs inatteignables pour la plupart des industries dont l’agroalimentaire.
Développementdel’activité
Au-delà d’une baisse des coûts liée à l’application des législations environnementales, la pollution peut aussi être réalisée de manière consciente et assumée par les entreprises internationales pour développer leurs activités.
Ainsi, l’entreprise MONSANTO, spécialisée dans la génétique agroalimentaire, a recours aux biotechnologies et modifications génétiques pour produire ses différentes semences. Ces procédés permettent de transférer les caractères désirés sur les plants d’espèces variées.
Cette innovation technologique plus communément appelée OGM (Organisme Génétiquement Modifié) est également la source de problématiques environnementales connues et reconnues, dont la disparition d’espèces locales ou encore la surexploitation des sols.
On peut aussi citer le problème des déchets nucléaires qui a été créé en toute connaissance de cause. Effectivement, il y a 50 ans, on a choisi de développer l’industrie nucléaire malgré les déchets dangereux qu’elle générait. On prédisait que la science saurait fournir une solution face à ce problème (nucléaire-non merci, comment l’industrie nucléaire pollue-t-elle).
Ainsi, nous parlons ici de cas de négligence totale de la part des entreprises et des gouvernements, échouant à protéger l’environnement.

Viabilitééconomique
Il arrive également aux entreprises de ne pas mettre en œuvre les bonnes pratiques environnementales, car celles-ci remettraient en cause la viabilité même de leurs modèles économiques.
Reprenons le cas de l’Afrique de l’Ouest : pour certains groupes agroalimentaires installés depuis deux ou trois décennies, les moyens nécessaires pour se conformer à la législation sont si onéreux par rapport à leurs marges que rien n'est fait pour améliorer la situation environnementale.
C’est le cas du traitement des eaux usées. Il suffirait parfois d’un traitement primaire des effluents avec un retour des eaux au sein du circuit d'irrigation. Mais les rejets sont si loin de cadrer avec les normes exigées par l'état qu’aucun effort n’est entrepris.
Ainsi nous avons pu voir que plusieurs raisons incitent l’entreprise à polluer délibérément. Cependant cette analyse ne devrait-elle pas remettre en cause l’idée d’éthique de l’entreprise? En effet, les firmes internationales sont conscientes de leurs actions et des dégâts environnementaux causés. D’ailleurs, elles continuent de commettre de tels actes criminels. Est-il juste de ne pas les condamner, sous prétexte, qu’elles respectent les normes environnementales locales? Il est malheureusement difficile pour les pays du Nord de répondre à ces questions soumises aux jeux du commerce international et à la déréglementation des marchés.
Or, pouvons-nous vraiment toujours les incriminer sans chercher à comprendre leur comportement? Après avoir compris les raisons internes à la compagnie l’amenant à polluer, nous allons maintenant essayer d’identifier les facteurs externes à celles-ci. Facteurs, qui ont un choix déterminant sur sa politique environnementale.
2.2 L’entrepriseinternationale,toujourscoupable?
Unecapacitétechnologiquelimitée
Les entreprises internationales sont parfois victimes d’un manque de capacité technologique. En effet, la demande mondiale de biens et de services ne cesse de croître sans forcément trouver de solutions technologiques écoresponsables. Ainsi, cette surproduction multisectorielle a pour conséquences d’aggraver les dommages causés à l’environnement et à long terme épuiser les ressources naturelles. L’accroissement de la demande mondiale s’explique par deux facteurs :
Population mondiale : elle atteindra 10 milliards d’habitants en 2050 (Hainzelin, 2013);
Les pays en voie de développement comblent petit à petit leur retard par rapport à ceux développés.
Elle a donc des besoins croissants demandant toujours plus en matière de production. Ainsi, différents scénarios expliquent les difficultés rencontrées par les firmes à répondre à cette demande sans endommager l’environnement.

En effet, soit la technologie qui permettrait de réduire les dégâts causés à l’environnement est inexistante; soit elle existe et elle engendrerait des contraintes financières importantes d’acquisition pour la compagnie, ne pouvant donc remplacer les anciennes à 100 %. Prenons les exemples suivants afin de prouver les deux points cités ci-dessus :
Besoins énergétiques
Les besoins énergétiques sont en constante augmentation. En effet, d’ici 2020, la consommation d’énergie mondiale devrait attendre les 600 exajoules.
Bien que de nos jours des énergies propres existent, elles restent chères et requièrent de lourds investissements ainsi que du temps avant de pouvoir être utilisées efficacement par l’entreprise internationale. Aussi, ces énergies répondront seulement à 25 % de la demande mondiale en 2030.
Ainsi, le charbon et le pétrole resteront encore longtemps les principales sources d’énergie.Ceci engendrera un rejet continu de gaz polluant et l’accumulation de déchets. En somme, tant que ces industries seront sollicitées, l’environnement continuera d’en pâtir. Enfin, les pays pauvres resteront le « terrain de jeu » des grandes entreprises internationales des nations les plus riches. Par exemple, le continent africain dispose de réserves minières colossales, principalement abusées par les multinationales.
Besoins agricoles
De la même manière, l’accroissement de la demande agricole va conduire à une augmentation de la pollution. En effet, l’activité agricole comme nous avons pu le constater dans notre première partie, engendre nombre de défis environnementaux pour les entreprises internationales. Pour faire face à l’ampleur des besoins, la seule solution viable à grande échelle aujourd’hui est l’utilisation d’OGM. Il n’existe pas ou peu d’alternatives techniques aujourd’hui.
Concernant l’impact sur les pays pauvres, les entreprises internationales continueront à exploiter leurs terres afin d’augmenter leurs capacités de production. Nous pouvons prendre l’exemple de la forêt amazonienne qui voit ses arbres tomber un à un pour que les multinationales puissent y étendre leurs surfaces agricoles. Aussi, nous ajouterons que l’élevage intensif de bétail est l’une des causes majeures de la déforestation au Brésil et de la diminution des réserves d’eaux. En effet, cette activité requiert une production massive de maïs et d’importantes quantités d’eau.
Échanges de marchandises à l’échelle mondiale
L’augmentation de la demande mondiale entraîne une explosion des échanges mondiaux. Ainsi, le secteur du transport ne cesse de croître. Il n’existe pas d’autres technologies que la combustion fossile (notamment de pétrole) pour répondre aux besoins du secteur. Par conséquent, le transport de marchandises continuera d’endommager l’environnement.

Les TICs
L’utilisation des TICs ne va cesser d’augmenter dans le futur. Aujourd’hui, elles représentent 2 % de l’énergie mondiale et ces cinq dernières années elles ont vu leur consommation augmenter de 56 %. Aujourd’hui, le charbon, dont l’exploitation est responsable d’importantes émissions de GES dans l’atmosphère, est largement utilisé pour refroidir les immenses entrepôts de stockage de données de Google, Facebook et également Amazon. Ainsi, de nombreuses pressions ont été faites par les ONG telles que Greenpeace invitant de gros groupes (e.g. Facebook et Apple) à utiliser des énergies renouvelables pour stocker leurs informations. Mais, comme nous avons pu le remarquer précédemment, il est onéreux et long de les mettre en place. De plus, elles ne sont pas encore fiables à 100 %.
Il est également possible que la technologie existe… Mais son impact sur l’environnement reste inconnu. C’est notamment ce qu’il se passe avec les nanotechnologies. La Nanotechnologie est définie par l’Actu-Environnement comme étant « un terme générique qui décrit des applications dans de nombreux domaines scientifiques, mais recouvre d'une manière générale la recherche sur les principes et propriétés existant à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire au niveau des atomes et des molécules. L'objectif des nanotechnologies consiste à produire des objets ou matériaux inférieurs à 100 nanomètres. Ces nanomatériaux sont composés de nanoparticules qui, contrairement aux particules très fines d'origine naturelle ou provenant d'une combustion, sont produites intentionnellement. Les nanomatériaux peuvent être des métaux, céramiques, carbones, polymères ou encore des silicates qui présentent l'intérêt d'avoir des caractéristiques spécifiques par rapport aux mêmes matériaux à l'échelle macroscopique. L'acquisition de ces nouvelles propriétés physico-chimiques ouvre ainsi un immense champ de recherches fondamentales et appliquées regroupées sous l'appellation de nanosciences. » (Actu-environnement, définition)
Apparues dans les années 1980, les nanotechnologies étaient considérées comme la solution clé pour produire en consommant moins d’énergie et réduire ainsi l’impact négatif des entreprises internationales sur l’environnement.
Cependant, dans le rapport « Nanotechnologie et environnement : un décalage entre les discours et la réalité », plusieurs ONG ont mis en avant : « La "face cachée" du coût environnemental de la production de nanomatériaux (tels qu'une demande accrue en énergie et en eau) qui est rarement reconnue, alors que leurs "bénéfices" affichés sont souvent exagérés, non testés et, dans un grand nombre de cas, à des années de pouvoir être concrétisés. » (Manach, 2009). Ainsi, les ONG doutent fortement de l’impact positif des nanotechnologies sur l’environnement.
L’entrepriseinternationale,contrainteàpolluercoûtequecoûte?
Dans certains cas, l’entreprise internationale, consciente de l’effet négatif de son activité, souhaite l’arrêter ou la limiter afin d’en diminuer les impacts sur l’environnement. Or, ce n’est pas chose facile. En effet, il arrive que la firme soit contrainte à continuer son activité puisque les enjeux sont trop grands. Ainsi, elle serait victime de pressions l’empêchant de « s’échapper » de ce cercle vicieux. Même si ceci ne justifie pas un tel comportement de l’entreprise, il permet de donner une raison expliquant pourquoi elle pollue.

Afin d’illustrer ceci, prenons l’exemple suivant : en 1995, la multinationale BHP Billiton décida de fermer sa mine à Ok Tedi en Papouasie Nouvelle-Guinée. En effet, Claire Fages dans son article intitulé « La Papouasie Nouvelle-Guinée nationalise la mine géante d’OK Tedi », explique qu’ « en 1995, les bassins de décantation de la mine de cuivre et d'or cèdent, les déchets se déversent dans une des principales rivières de l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entraînant une pollution des terres. » Consciente de la catastrophe écologique causée par sa mine, l’entreprise souhaita arrêter toute activité dans la région.
Cependant, BHP continua à faire fonctionner sa mine à la demande du gouvernement en vigueur à l’époque. Effectivement, cette activité rapportait 10 % du revenu du pays, il était donc inconcevable pour les dirigeants que la firme « plie bagage ». Ainsi, l’attitude adoptée par BHP Billiton fut négligente. Enfin, quelques années plus tard, BHP Billiton céda ces parts au gouvernement, ne pouvant plus supporter de causer des dommages environnementaux irréversibles dans ce pays.
Par conséquent, nous remarquons que l’incitation faite par le gouvernement rend l’activité de l’entreprise internationale, aussi polluante soit-elle, légale. Aussi, même si les gouvernements et pays dans lesquels les entreprises internationales polluent forcent ces firmes à continuer leurs activités pour des raisons économiques, elles restent responsables de leurs actes. En effet, elles devraient prendre leurs courages à deux mains et partir afin d’arrêter ces actions endommageant l’environnement. La firme est un acteur de la société qui se doit de la respecter et de montrer l’exemple aux citoyens.
Ainsi, cet exemple de BHP démontre l’existence d’une zone grise. Effectivement, même si certaines activités économiques sont considérées comme étant légales, elles ne sont pas forcément toujours morales.
Nous avons donc pu constater que le défi écologique est souvent un défi technologique. Néanmoins, les entreprises internationales coupables peuvent aussi être amenées à polluer contre leur grès sous l’influence de facteurs extérieurs.
3 LESPRESSIONSETRÉACTIONS
3.1 Influencessurl’entrepriseinternationale
Dans l’entreprise internationale, nous distinguons deux types de parties prenantes : les primaires qui sont directes à l’entreprise (e.g. fournisseurs, clients) et les parties prenantes secondaires (e.g. ONG, opinion publique, groupes de recherche, bailleurs de fonds) qui ont des relations dites indirectes avec la compagnie. Dans les années 1990, Mitchell propose une classification intéressante des pressions des parties prenantes secondaires sur la compagnie selon trois critères : le pouvoir d’influence sur la firme, la légitimé de sa relation avec l’entreprise et l’urgence de la satisfaction de ses exigences par cette dernière. Notons que le pouvoir et la légitimé de la demande sont les critères les plus influents pour faire pression sur l’entreprise.

Ainsi, trois groupes de parties prenantes sont identifiés :
Ainsi, selon son degré d’influence, la partie prenante secondaire pourra exercer plus ou moins de pression sur l’entreprise internationale. De plus, si une partie prenante à la firme est dite définitive, alors sa pression aura un grand impact sur l’activité de cette dernière.
Pressionssocialessurl’entrepriseinternationale
Les trois acteurs dont nous discuterons dans cette sous-partie, la population, les groupes de recherche et les bailleurs de fonds représentent la société et son impact sur son envie de défendre l’environnement.
Les pressions exercées par la population elle-même, les groupes de recherche et les bailleurs de fonds ont une grande influence auprès des organismes internationaux pour condamner non seulement les entreprises internationales, mais également les gouvernements qui ne font pas leur devoir.
En effet, la population est la source la plus crédible et les institutions internationales se doivent de l’écouter et de prendre soin d’elle. L’opinion publique est la pression la plus dangereuse pour la firme internationale. Les deux exemples qui suivent sont la parfaite représentation des pressions qu’exerce la population sur les compagnies internationales et les gouvernements.
Tout d’abord, nous avons assisté à la conférence « L’information environnementale et ses implications sur les particuliers et les entreprises » présentée par Monsieur François-Guy Trébulle (Directeur de l’École Doctorale de Droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne) à l’Université Laval au pavillon Charles-de-Koninck le 16 octobre dernier. Lors de celle-ci, le conférencier a présenté l’Arrêt Guerra contre Italie, qui nous a semblé pertinent de traiter dans cette partie sur les pressions.

En effet, les habitants de la ville de Manfredonia (Italie) n’avaient pas été mis au courant des dangers auxquels ils étaient exposés en vivant près d’une usine chimique locale ainsi que des règles d’évacuation en cas d’accident. Soit, en 1988, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné l’Italie pour l’affaire Guerra. En effet, elle a considéré que le pays avait fauté dans ses obligations en omettant d’émettre les informations sur les activités dangereuses de cette usine chimique qui pouvaient avoir des conséquences sanitaires graves. Ainsi, en produisant ces produits chimiques, elle dégageait dans l’atmosphère des substances toxiques. Par conséquent, les habitants vivant à moins d’un kilomètre de celle-ci voyaient leur santé impactée sans avoir été informés au préalable des risques que cette fabrication engendrait. La Cour Européenne conclut donc que « les autorités italiennes, en ne fournissant pas à la population concernée des informations essentielles, n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection efficace du droit des plaignants au respect de leur vie privée et de leur vie de famille et a ainsi enfreint l'article 8 de la Convention » (Voorhoof, 1998).
Ensuite, nous pouvons également prendre pour illustration sur le plan socio-économique, la Convention d’Aarhus signée en 1998 et basée sur le principe 10 de Rio. Cette convention institue le droit pour les communautés locales à la participation aux décisions affectant leurs terres. D’autre part, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté́ en 1989 une Convention sur les Peuples autochtones incluant le concept de « consentement préalable libre et éclairé́ (CLPE) » en cas de déplacement de population. Le CLPE, issu de la Déclaration des Droits de l’Homme, stipule que les Peuples autochtones ont le droit d’exiger d’être consultés et d’accorder leur aval avant qu’un projet de grande envergure dirigé soit par une multinationale soit par un gouvernement commence, notamment lorsque ce dernier concerne l’exploitation des ressources naturelles.
Concernant les groupes de recherches, ils peuvent avoir un impact indirect sur l’activité de l’entreprise. Comment? Par le biais de leur découverte scientifique qu’ils publient. En effet, ces publications alertent les médias qui font ainsi pression sur l’entreprise internationale dont l’activité est responsable d’un problème environnemental. Prenons pour illustrer cela un autre exemple donné lors de cette même conférence à l’Université Laval. Monsieur François-Guy Trébulle a présenté la dangerosité de l’exposition à des fumées bitumineuses pour la population et les travailleurs. En effet, dans la Revue des Maladies Respiratoires sous son article « Les fumées de bitume sont-elles un facteur de risque de cancer bronchopulmonaire? », il est indiqué que le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a fait des recherches scientifiques impliquant des travailleurs asthmatiques localisés dans huit pays différents. Il en a été déduit que l’exposition au bitume était cancérigène puisqu’elle augmentait les risques de cancers broncho-pulmonaires. Ainsi, La Cour Européenne a récemment reconnu par jurisprudence que si les entreprises exposent des individus à la fumée de bitume, elles seraient condamnées. En effet, seules les compagnies peuvent connaître les risques encourus d’une telle exposition. Par conséquent, un seuil d’exposition pour les travailleurs et la population a été fixé par l’Union Européenne à 5 mg/m3 pour une exposition de huit heures par jour.
Enfin, la dernière pression que nous pouvons donner vient des bailleurs de fonds qui fournissent les ressources financières aux entreprises internationales.
Ainsi, nous avons évoqué précédemment l’impossibilité que représenterait la mise en conformité des installations vieillissantes en Afrique dans l’industrie agroalimentaire.

Dans ce cas, la situation des nouveaux projets se présente différemment. Une étude d'impact environnementale est obligatoire pour obtenir l'autorisation des États d'opérer. Cependant, la pression la plus forte vient des bailleurs de fonds qui eux, ont l'obligation de s'assurer que les normes sont respectées.
En général, dans un audit couvrant les aspects environnementaux, les auditeurs dressent une liste comparative de la situation environnementale par rapport aux normes du FMI. Ils exigent ensuite l’élaboration d’un plan d'action afin de gommer les non-conformités.
LesONG,militantescontrel’entrepriseinternationale
Les ONG sont considérées comme des parties prenantes de l’entreprise. Elles exercent une forte influence et sont capables d’impacter les performances économiques de la firme, notamment par le biais de campagnes visant à la heurter.
Après de nombreuses polémiques sur l’impact négatif des entreprises internationales sur l’environnement, les ONG ont décidé d’agir afin que ces firmes répondent de leurs actes. Par conséquent, elles exercent différentes formes de pressions sur divers acteurs dans le but d’élever leurs voix.
Si nous prenons la catégorisation d’Antoine Mach des pressions exercées par les ONG pour atteindre les entreprises internationales, nous distinguons trois types de pressions.
Tout d’abord, les ONG peuvent exercer des pressions dites institutionnelles. Ces dernières s’adressent donc aux institutions gouvernementales et internationales sous forme de lobbying de la part des ONG afin que soit mis en place des réglementations et législations contraignant l’activité des compagnies. Effectivement, les ONG sont devenues les porte-paroles de l’environnement en exerçant des pressions lobbyistes auprès des gouvernements, notamment des pays développés; et lors de conférences internationales portant sur la protection de notre planète. Au cours de ces conférences, les ONG vont fournir des informations capitales soulevant des problèmes mondiaux portant sur l’environnement via des rapports d’expertises afin d’appuyer leur crédibilité. Ainsi, Gérard Perroulaz, membre de l’Institut de Genève, affirme que lorsque cette pression est exercée nous parlons de « démocratie participative », car elle permet d’ouvrir le « débat politique » sur la protection de l’environnement auprès des divers gouvernements. Enfin, les ONG et l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont un partenariat fort afin d’ouvrir le dialogue avec les autorités gouvernementales, et internationales sur le développement durable.
Ensuite, un autre type de pression appelée pressions informelles peut être exercée. Elles prennent la forme de manifestations, pétitions, ou grèves, ayant pour objectif de créer des polémiques sur le problème en question et montrer leurs mécontentements afin que les choses changent. Le but de ces pressions est d’alarmer les autorités nationales, ainsi que les organisations (OMC, FMI) et les entreprises internationales. Les ONG sont reconnues par leur capacité à mobiliser l’opinion publique et médiatique pour influencer les pouvoirs nationaux et internationaux. De plus, nous remarquons que via les diverses actions faites par ces acteurs une solidarité entre les peuples des pays développés pour venir en aide aux populations des pays pauvres. Afin d’illustrer ce type de pression, nous pouvons reprendre la polémique envers le géant français du pneu, Michelin, et la délocalisation de son usine dans le sud-est de l’Inde en 2010 (cf. défis environnementaux du secteur de la construction).

Pour lutter contre l’installation de Michelin, un mouvement social est né. Le Journal Le Monde stipule que les villageois, les ONG indiennes, françaises et mondiales ont organisé des manifestations sous formes notamment de grèves de la faim pour faire réagir l’institution internationale OCDE (Organisation de Coopération et du Développement Economique) et les autorités locales les implorant de prendre les mesures nécessaires pour suspendre ce projet.
Enfin, les ONG exercent des pressions ciblées. Pour cela, elles visent une entreprise en particulier et dénoncent certains de ses actes sous forme de campagnes. De ce fait, les médias sont alertés et le public est sensibilisé. L’objectif premier de cette pression est que la firme change sa manière de faire et adopte un comportement plus sain. Par exemple, l’ONG Greenpeace en 2010 lance une campagne contre le géant Suisse Nestlé et sa barre Kit Kat. Greenpeace a effectué une publicité « choc » afin d’alerter la presse et a créé un site internet parodique afin de sensibiliser le public. En effet, la recette de cette barre chocolatée contient de l’huile de palme que la multinationale achetait auprès de fournisseurs responsables de la destruction de la forêt tropicale en Indonésie. La déforestation dans ce pays au total équivaut à la disparition d’un terrain de football toutes les dix secondes, et l’exploitation de l’huile de palme en est l’une des principales causes. En effet, l’Indonésie n’a pas de règles environnementales strictes contraignant les entreprises qui en profitent. De plus, cette forêt se trouve être l’habitat naturel de plusieurs espèces, dont les orangs-outangs. Ainsi, cela laisse libre court à une production massive de l’huile de palme sans conséquence pour les multinationales qui l’achètent. Ces dernières se défendent en arguant qu’elles ne sont pas responsables de la déforestation et de la mise en danger des orangs-outangs. Elles s’appuient sur le fait qu’elles se procurent seulement l’huile de palme sans être au courant des pratiques exercées par ses fournisseurs. Pour revenir à notre exemple, après une réaction négative de Nestlé, Greenpeace a redoublé d’effort et a permis à sa campagne d’être davantage visible. Par conséquent, les consommateurs ont freiné leurs achats de la barre Kit Kat et les défenseurs du développement durable se sont mobilisés autour cette cause. C’est pourquoi, un an après le scandale, Nestlé a « capitulé » et décidé de ne plus faire affaire avec des fournisseurs n’ayant pas un comportement écologiquement responsable et de supprimer l’huile de palme de la recette de sa barre chocolatée.
Cependant, la question de l’efficacité de ces pressions exercées par les ONG reste entière. En effet, de nombreux auteurs doutent de l’impact positif que peuvent avoir ses actions, dû notamment au fait qu’aucun rapport ne témoigne des résultats de leurs campagnes de sensibilisation médiatique et publique. Un manque de transparence persiste donc sur l’efficacité des ONG. Aussi, d’autres considèrent que la mobilisation des médias et de l’opinion publique via les évènements créés par les ONG est amplifiée et surévaluée. Enfin, beaucoup pensent que le pouvoir donné à ces acteurs par le biais d’actions lobbyistes n’est que superficiel et que les gouvernements mis en place ne leurs laissent volontairement qu’un minimum de maîtrise sur eux, juste pour que ces organisations se « sentent importantes » aux yeux des dirigeants.
Au‐delàdespressions,lesincitations
Il convient cependant de nuancer notre discours. Au-delà des pressions diverses qui s’exercent sur l’entreprise, le pouvoir en place peut également mettre en œuvre des législations incitatives pour cette dernière.

Ainsi l’International Standard Organisation a édité en 1996, la norme internationale ISO 14001. Elle propose aux organisations un « Système de Management Environnemental (SME) » pouvant être certifié si certaines exigences sont satisfaites : définition d’une politique environnementale, planification, documentation, contrôle… (La norme ISO14001, 2012) La certification s’avère alors fortement utile à l’international lorsque les partenaires de l’entreprise demandent un certain nombre de preuves de bonne gouvernance.
Cette certification a rencontré un véritable succès puisque 100 000 installations dans le monde étaient certifiées ISO 14001 moins de 10 ans après sa mise en place en 2005.
Cependant, l’impact réel reste difficile à évaluer. Les études menées s’avèrent souvent biaisées par le caractère déclaratif des données et l’endogénéité potentielle du management environnemental. En effet, les démarches de management environnemental sont davantage mises en place par des entreprises à rejets élevés (à cause de leur production par exemple) que par celles dont le contrôle de leurs émissions représente un enjeu moindre (Thévenot et Riedinger, 2008).
Ainsi, on ne peut affirmer qu’il y ait une preuve de causalité entre la mise en place de ces normes et l’évolution des comportements des entreprises.
3.2 Lesréponsesdesentreprises
En 2003, lors d’une intervention publique intitulée « Un nouvel enjeu stratégique pour l'entreprise : la prise en compte de la protection de l'environnement dans son management », le professeur de management Béatrice Bellini explique que face aux pressions dont ils sont victimes, les dirigeants d’entreprises peuvent adopter trois types de comportement :
« Écoconformiste » « Écodéfensif » « Écosensible »
Écoconformiste
Les entreprises vont se plier aux législations environnementales mises en place, sans pour autant en faire plus.
Ce sont les aspects techniques (production, transport…) qui sont privilégiés et non les aspects managériaux. Ainsi, l’entreprise va acquérir des technologies afin de maîtriser les effets néfastes de son activité sur l’environnement. Cependant, elle n’intégrera pas la notion environnementale à sa stratégie puisqu’elle ne sera pas considérée comme une priorité à ses yeux. Les objectifs environnementaux sont faibles, voire inexistants. Aucune stratégie ou rédaction de rapport n’est engagée.
Écodéfensif
L’écologie est synonyme de coûts économiques et sociétaux (pression sur les entreprises) supplémentaires. Les firmes décident alors d’ignorer les pressions publiques et tentent d’influencer les pouvoirs en place.

Par exemple, un certain nombre d'entreprises s'en sortent jusqu'à présent en payant les contrôleurs en Afrique de l’Ouest.
La pression peut également être inversée. Elle prend la forme du lobbying :
Au niveau exécutif
La compagnie va s’adresser directement au gouvernement et tenter de le faire infléchir sur sa politique environnementale.
Au niveau législatif
La firme va tenter d’influencer les organes de réglementation. Ce type de pression s’exerce principalement dans les pays à fort niveau de développement où le pouvoir législatif est fort. Des lobbyistes officiellement déclarés ou non vont alors tenter d’influencer les députés nationaux (États-Unis, Canada…) ou même supranationaux (Union Européenne à Bruxelles).
Ainsi, cinquante personnes étaient inscrites au registre des lobbyistes du Québec en janvier 2014, dont douze d’entre eux uniquement sur le secteur pétrolier et sept représentant la TransCanada Corporation. Cette forte présence s’explique par la mise en place du grand projet de pipeline qui doit relier l’Alberta au Nouveau-Brunswick et dont nous avons parlé précédemment.
Écosensible
Qu’il s’agisse d’une réponse aux pressions subies ou de leur propre initiative, les entreprises peuvent décider d’adopter une politique active face au défi environnemental.
Cette action prend différentes formes :
Mise en place d’une relation privilégiée avec une ONG
Le tableau suivant synthétise les formes d’ententes qui peuvent s’instaurer entre entreprises et ONG :
Source : « Agriculture Suisse et Mondialisation » Jacques Forster, chapitre : « le pouvoir des ONG sur les entreprises :
pression, partenariat, évaluation » par Antoine Mach
Par exemple, le Journal Les Affaires en 2009, en 1998, la World Wildlife Fund France (WFF)1 a mis en place un partenariat avec Carrefour2 afin que ce dernier puisse développer sa stratégie de développement durable. Selon cet article, ce
1 World Wildlife Fund WFF est une ONG qui lutte pour un meilleur respect de l’environnement et des espèces vivantes (WFF France-Site Officiel) 2 Carrefour: Groupe français et deuxième leader mondial dans le domaine de la grande distribution après Wal-Mart

partenariat a évolué au fil du temps, se focalisant tout d’abord sur la protection des forêts, pour ensuite s’étendre à la mise en place de politiques environnementales au cœur de la stratégie d’affaires du géant du supermarché français (par exemple, élaboration d’un code de conduite pour mieux choisir ses fournisseurs). Ainsi, Jérôme Dupuis, directeur du partenariat avec les entreprises de WWF France, précise dans un article du journal Les Affaires intitulé Partenariat ONG-entreprises en juillet 2009 que « L'entreprise sait très bien que si elle travaille avec nous, c'est aussi pour que l'on lance des alertes et qu'on mette le doigt sur des choses désagréables. »
Intégration au business model
Le développement durable est l’un des enjeux majeurs du développement à long terme. L’entreprise de demain intègre dans tous les aspects de son business model la dimension environnementale. Cela va de la conception (choix des matériaux, mais aussi redéfinition des attentes et des produits à offrir) à la distribution (livraison) en passant par la production (respectueuse des normes) et la commercialisation (approche du client et mise en valeur du caractère écologique des produits et de l’entreprise).
3.3 Bilanetévolutiondansletemps
Ces 3 modèles comportementaux mettent en avant deux logiques :
La première est additive (comportements écoconformistes et écodéfensifs). L’entreprise ne remet pas en cause son processus de décision.
La seconde est systémique (comportement écosensible). Dans ce cas, l’environnement va modifier la structure de décision en profondeur. Seule cette logique révèle de la stratégie d’entreprise.
Ces comportements ont évolué dans le temps. En 1956, suite aux vagues d’industrialisation et à la mise en place d’une économie sauvage, l’émergence de pressions écologiques fait son apparition. Les comportements des dirigeants ont alors été fortement écodéfensifs.
En 1990, les pays développés signent le Protocole de Kyoto, responsable de l’élaboration d’une législation environnementale dans le monde. Ceci s’est traduit par des comportements écoconformistes de la part des dirigeants.
Ce n’est que depuis une dizaine d’années qu’une vague significative de comportements écosensibles est apparue chez les dirigeants d’entreprises. Ainsi, en 2011, en France, l’organisme INSEE recense que 44 % des sociétés de plus de 50 salariés avaient entamé une « démarche d’amélioration énergétique ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre » et 46 % avaient mis en place un « Management environnemental » en 2011.

4 CONCLUSION
Pour conclure, nous avons exposé au cours de ce rapport les différents défis environnementaux rencontrés par l’entreprise internationale selon son secteur d’activité. Chacun connaît ses propres challenges engendrant polémiques et scandales pour les firmes.
Cependant, nombreuses sont les causes expliquant et amenant la compagnie internationale à impacter négativement l’environnement.
Nous les regroupons en deux points :
Le manque de capacité technologique résultant de la négligence et l’ignorance de la firme;
Les raisons financières et commerciales poussant la compagnie à vouloir diminuer ses coûts et augmenter son rendement, en particulier via le dumping environnemental.
De plus, différentes formes de pressions peuvent être exercées sur l’entreprise internationale, notamment par les ONG qui veulent que ces firmes prennent leurs responsabilités et répondent de leurs actes. Pour cela, elles vont attaquer directement la compagnie ou décider d’aller plus loin en alertant les autorités et les institutions internationales. D’autres acteurs entrent également en jeu pour faire pression sur les entreprises, tels que les populations qui décident de saisir les Cours de Justice pour faire respecter leurs droits ou les groupes de recherche qui tentent de comprendre les conséquences de certaines activités économiques sur l’environnement et la santé des individus afin de les protéger, et enfin les bailleurs de fonds eux-mêmes de plus en plus scrutés.
L’entreprise internationale réagit à ces pressions en optant pour un comportement soit :
Écoconformiste en respectant les législations; Écodéfensif en considérant les règles écologiques comme des contraintes et en
essayant d’influencer les pouvoirs en place pour les contourner; Écosensible en adoptant une politique active face au défi environnemental.
Un point important sur lequel nous souhaitons insister est le caractère toujours très sensible de ce sujet auprès des entreprises. Ainsi, nous avons essuyé près de 10 refus dans nos tentatives d’approche des lobbyistes de la province de Québec. Ce n’est que grâce à un contact très proche que nous avons pu obtenir des informations sur les pratiques des entreprises dans le cadre de l’industrie agroalimentaire en Afrique.
Pour conclure, nous recommandons aux entreprises d’adopter un comportement respectueux de l’environnement en l’intégrant dans leurs activités. L’aspect environnemental ne peut être seulement perçu comme étant une contrainte par la firme, mais plutôt comme l’ouverture de nouvelles opportunités dans les affaires tout en protégeant le bien-être de notre planète. Dans une vision à long terme, l’aspect environnemental est une source de croissance pour l’entreprise internationale. Effectivement, il existe des firmes qui ont réussi à concilier impératifs économiques et écologiques avec succès à travers le monde.

Par ailleurs, nous pensons qu’il est important de nuancer les points de vue et remettre en cause les idées reçues. D’une part, l’entreprise internationale ne peut être accusée de tous les maux et la contrainte technologique rend parfois la réduction de l’impact environnemental impossible. À l’opposé, il serait peu productif de considérer les pressions exercées par les acteurs de la société sur l’entreprise comme uniquement défavorables au développement de son activité, mais bien comme un moyen de la forcer à prendre part à la transition écologique.
5 RÉFÉRENCES
Nous nous sommes appuyés sur le témoignage d’un employé d’une multinationale, grande productrice de canne à sucre à travers l’Afrique, en Côte d’Ivoire et au Tchad notamment. Pour des raisons de confidentialité, nous avons préservé l’anonymat de notre source.
Albert, Caroline (2013). « 658.000 Arbres Rasés Pour Le Nouvel Aéroport D'Istanbul ». SOS Planète. Web. Consulté en novembre 2014.
BACHIMON, Philippe. « Tourist wastelands in French Polynesia - Examination of a destination in crisis and manner of resistance to international tourism », Viatourismreview.net, 28 septembre 2012
Bailly, Olivier (2004). « Bhopal, L'infinie catastrophe ». Le Monde Diplomatique. Web. Consulté en novembre 2014.
Bellavance, Joel-Denis. (2012). « Une industrie des sables bitumineux moins polluante? ». La Presse, Economie - Energie et ressources : publié le 4 septembre 2012. Consulté en novembre 2014.
BELLINI, Béatrice (2003). "Un nouvel enjeu pour l’entreprise: la prise en compte de la protection de l’environnement dans son management – Etat des lieux et perspectives" Agence Universitaire de la Francophonie. Actes du 1er Atelier DD de l’AIMS, Angers. Web. Consulté en octobre 2014.
BENYAHIA-KOUIDER, Odile (2004) " Volkswagen invente la délocalisation de sa pollution " Libération. Consulté en novembre 2014.
Blavier, Sébastien (2012). "Apple, Champion De La Pollution Au Charbon : à Greenpeace, on Tire La Sonnette D'alarme." Leplus.nouvelobs.com. Web. Consulté en novembre 2014
Bouissou, Julien (2012). "A Bhopal, L'impossible Décontamination." Le Monde.fr. Web. Consulté en novembre 2014
BRULE Elodie, et RAMONJY Dimbi. « La collaboration : Pourquoi et avec quelles parties prenantes ? ». Thèse de Doctorat. Web. 25 oct. 2014.
Bouchez, Emmanuel (2014). "Le trafic routier responsable de la majorité des émissions de CO2 du secteur des transports." Actu-Environnement. Web. Consulté en novembre 2014.
Cabal, Christian et Gatinal ,Claude (2005). "Rapport du Sénat : Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. " Assemblée Nationale Française. Web. Consulté en novembre 2014.
Combe, Matthieu (2014). "L'industrie Textile Du Coton, Des Impacts à Tous Les Niveaux." Natura Sciences. Web. Consulté en novembre 2014.
Cuvelier, Antoine ; Blanc, François-Xavier ; Roche, Nicolas ; Pamphile, Daniella (2004). " Revue des Maladies Respiratoire- Les fumées de bitume sont-elles un facteur de risque de cancer bronchopulmonaire ?. EM Consulte. Web. Consulté en novembre 2014.
Delcourt, Laurent (2014). "Groécologie - Enjeux Et Perspectives." Centre Tricontinental - CETRI. CETRI, Syllepse. Web. Consulté en novembre 2014.
Dermagne, Jacques (2014). "Comment nourrir le monde ?." Agriculture et Société- Gouvernement Français. Web. Consulté en novembre 2014.
Dixon, Andrea.(2010) "Abandonnés Dans La Poussière: L'héritage Radioactif D'Areva Dans Les Villes Du Desert Nigérien." GreenPeace International (n.d.): n. pag. Web. Consulté en novembre 2014.

Ernst, Emilie, division Enquêtes thématiques et études transversales, Insee et Yolan Honré-Rougé Ensae , "La responsabilité sociétal des entreprises : une démarche déjà répandue", Insee Première N°1421, Novembre 2012. Consulté en novembre 2014.
Ensae , "La responsabilité sociétal des entreprises : une démarche déjà répandue", Insee Première Fabrégat, Sophie (2008). " Le défi énergétique : entre réalité économique et nécessaire mutation." Actu-
Environnement. Web. Consulté en novembre 2014. Fages, Claire (2013). " La Papouasie-Nouvelle-Guinée nationalise la mine géante d'OK Tedi." RFI.fr,.Web.
Consulté en novembre 2014. Ferrand, Dominique et Villeneuve, Claude (2013). "L’industrie Minière Et Le Développement Durable."
UQAC. Web. Consulté en novembre 2014
Fitiavana, Tanindrazana, Fandrosoana (2014). " Projet Poles Intégrés de croissance- Cadre de Gestion Environnemental et Sociétale (GES)." Banque Mondiale. Consulté en novembre 2014.
FORSTER, Jacques, et MACH, Antoine "Agriculture Suisse et Mondialisation, chapitre : le pouvoir des ONG sur les entreprises : pression, partenariat, évaluation" Annuaire suisse de politique de développement, N°21, 2002
Garric, Audrey (2013). "Le Fléau De La Pollution Des Rivières Chinoises." Le Monde Blog. Le Monde. Web. Consulté le 22 novembre 2014
Garric, Audrey (2013). "Gaz à Effet De Serre : Les 50 Entreprises Les plus Polluantes." Le Monde Planète. LeMonde.fr,.Web. Consulté en novembre 2014.
Garric, Audrey (2012). "Vingt Marques épinglées Pour Des Produits Toxiques Dans Leurs Vêtements." Le Monde Blog. Le Monde. Web. Consulté en novembre 2014.
Garric, Audrey (2012). "Combien de CO2 pèsent un mail, une requête Web et une clé USB." Le Monde Blog. Le Monde. Web. Consulté en novembre 2014.
GLEIZES, Jean-François (2011). "COMMENT NOURRIR LE MONDE ?" Editions de l’Aube. Agrobiosciences-Gouvernement Français. Web. Consulté en novembre 2014.
Greenpeace (2012) "Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up." GreenPeace International (n.d.). Web. Consulté en novembre 2014.
GROU, Vincent (2011). "Campagne Contre Nestlé : L’occasion D’apprendre De Ses Erreurs." RadioCanada.ca. Web. Consulté en octobre 2014.
Hainzelin, Etienne (2013). " Cultiver la biodiversité pour transformer l’agriculture." Editions Quae, février 2013, 264 pages. Agrobiosciences-Gouvernement Français. Web. Consulté en novembre 2014.
Jacob, Marc (2008). " Internet Fr figure parmi les finalistes du trophée ADEME." Global Security Mag- Business. Web. Consulté en novembre 2014.
LaLibrePlume in Environnement, Politique (2012). "Le Poids Du Lobby Des ONG Sur Les Politiques Publiques." La Libre Plume. N.p.Web. Consulté en novembre 2014
Lamiable, Elise (2013). "Quels Sont Les Impacts écologiques Des TIC ?" Agence Web AntheDesign. Web. Consulté en novembre 2014.
Lautre, Yonne (2004). " L’APPEL de PARIS : Déclaration internationale sur les dangers sanitaires de la pollution chimique." YonneLautre.fr. Web. Consulté en novembre 2014.
Lavaud-Letilleul, Valérie (2009), "Ports et transport maritime face aux défis du développement durable." Archives du Centre National de Documentation pédagogique. Web. Consulté en novembre 2014.
LECLUYSE, Eric (2010), "Faut-il boycotter l’huile de palme", L’Express. Consulté en novembre 2014. Le Ngoc, Boris (2014). "Le Nucléaire contre la pollution de l’air." Energies Société Française d’Energie
Nucléaire. Le Blog. Consulté en novembre 2014. Lopes, C. (2014) "Miser Sur L'industrie Extractive En Afrique Pour Une Transformation économique
Inclusive - ECDPM." ECDPM. Web. Consulté en Novembre 2014. Kloff Sandra ; Wricks Clive ; Siegel Paul. (2010) "Industrie Extractives Et Développement Durable: Guide
Des Meilleures Pratiques." (n.d.): n. pag. WFF. Web. Consulté en Novembre 2014

MACH, Antoine (2012), « Le pouvoir des ONG sur les entreprises : pression, partenariat, évaluation », Annuaire suisse de politique de développement [En ligne], N°21 | 2002, mis en ligne le 24 Septembre 2012, Consulté le 05 Octobre 2014.
Magdelaine, Christophe (2012). "Marée Noire Américaine Du Golfe Du Mexique : Pire Marée Noire De L'histoire De L'humanité !" Notre-planete.info. Web. Consulté Novembre 2014.
Manach, Jean-Marc (2009). " Nanotechnologies : le point de vue environnemental" Le Monde Manach, Jean-Marc (2009). "Nanotechnologies : Le Point De Vue Environnemental." Le Monde.fr. Web.
Consulté en Novembre 2014
MARTIN, Jean-Christophe, et Sandrine MALJEAN-DUBOIS (2011). "La Cour Européenne Des Droits De L'Homme Et Droit à Un Environnement Sain." Séminaire UNITAR/ENM. Web. Consulté en 25 Octobre 2014.
MELI, Benoît (2010). "Greenpeace a Fait Plier Nestlé." Journaldunet.com L'économie De Demain. Web. 24 Consulté en Octobre 2014
Pedrero, Agnes (2013). "L'OMS Classe La Pollution De L'air Comme Cancérigène Pollution." LaPresse.ca.. Web. Consulté Novembre 2014.
PERROULAZ, Gérard, « Le rôle des ONG dans la politique de développement : forces et limites, légitimité et contrôle », Annuaire suisse de politique de développement [En ligne], Vol. 23, n°2 | 2004, mis en ligne le 15 mars 2010, Consulté en Novembre 2014.
RIEBER, Arsène et Tran, Thi Anh-Dao. "Dumping Environnemental Et Délocalisation Des Activités Industrielles: Le Sud Face à La Mondialisation." (n.d.): n. pag. APREIS. Web. Consulté Novembre 2014.
Riedinger, Nicolas et Thévenot, Céline (2008). "La norme ISO 14001 est-elle efficace ? Une étude économétrique sur l’industrie française", Economie et Statistique n°411, 2008
Rolland, Catherine (2013). " Au Danemark, des huiles de cuisine remplacent le carburant." Rfi.fr. Web. Consulté Novembre 2014.
SAULQUIN, Jean-Yves (2008). "La Théorie Des Parties Prenantes Comme Grille De Lecture Du Comportement Solidaire Des Banques Envers La Communauté." 5e Congrès De L’ADERSE – Colloque « Transversalité De La Responsabilité Sociale De L’Entreprise » - Grenoble. Web. Consulté en 25 Octobre 2014
Scherer, Arthur (2013). "Trafic Aérien, Quel Impact Pour L'environnement ?" Toutvert. Web. Consulté Novembre 2014.
Shiva, Vandana. "Les Méfaits De COCA-COLA En Inde (+ Video)." International News. Web. Consulté Novembre 2014.
TREBULLE François-Guy (2014). « L’information environnementale et ses implications sur les particuliers et les entreprises. » Conférence à l’Université Laval au pavillon Charles-De-Koninck, 16 Oct 2014.
Turki, Ahmed (2009), "Villes et Environnement : impacts et défis autour de la spécialisation et requalification des espaces urbains : Les comportements écologiques des dirigeants des entreprises tunisiennes" , Vertigo, Volume 9, Numéro 2.
Urus (2012). "Les Dessous de la mode- Tous des Fashion Victims." Quat’rues. Web. Consulté Novembre 2014.
VOORHOOF, Dirk.(1998) "Cour Européenne Des Droits De L’homme Quatre Jugements Récents Sur La Liberté D'expression Et D'information." Cour Européenne Des Droits De L’homme : quatre Jugements Récents Sur La Liberté D'expression Et D'information. IrisMerlin,. Web. Consulté en 27 Octobre 2014
(2014) "Pollution From Construction." SustainableBuild. Web. Consulté Novembre 2014. (2014). " Définition de l’environnement. " Dictionnaire Laurousse. Web. Consulté Octobre 2014. (2014). " Définition des TIC. " Dictionnaire Laurousse. Web. Consulté Octobre 2014. (2013). " Comment va la planète en 2013 ? Les excellentes nouvelles se succèdent… (1)- Fashion, mais
toxique ! La mort dans ton T-shirt. " Pour la transition écologique des territoires. Web. Consulté Novembre 2014.

(2012) "Transport." Environnement Canada. Gouvernement Du Canada. Web. Consulté Novembre 2014. (2012). " La Norme ISO 14001." 1819EntreprendreàBruxelle. Web. Consulté Novembre 2014. (2012) "Des ONG Dénoncent Les Conditions D'implantation D'une Usine Michelin En Inde." Le Monde.fr.
N.p.. Web. Consulté en Novembre 2014 (2012). "Union Européenne: la pollution de l'air réduit l'espérance de vie." Bipom- Almata. Consulté
Novembre 2014. (2012). "Les Dessous Toxiques de la Mode- Nous sommes tous des Fashion Victims." Quatrules.com. Web.
Consulté Novembre 2014. (2011) "Bitume : Prévention, Valeurs D’exposition." AtouSante RSS. N.p. Web. 23 Oct. 2014. (2011) "LE CUIR, UNE INDUSTRIE ALLIANT CRUAUTÉ ET POLLUTION." OneVoice. N.p. Web.
Consulté en Novembre 2014 (2011) "Dirty Laundry Unravelling the Corporate Connections to Toxic Water Pollution in China."
GreenPeace International. N.p. Web. Consulté Novembre 2014. "Comment L'industrie Nucléaire Pollue-t-elle ?" NucléaireNonMerci.net. N.p., n.d. Web. Consulté
Novembre 2014. (2011) "Industrie et Environnement: Les rejets dans l’air de polluants et de gaz à effet de serre de l'industrie
manufacturière." OBSERVATION ET STATISTIQUES. Ministère De L'Ecologie, Du Développement Durable Et De L'Energie. Web. Consulté en Novembre 2014
(2010) "Greenpeace Contre La Pollution De Facebook." Dailymotion. L'OBS. Web. Consulté en Novembre 2014
(2009)"Construction Et Bâtiments: Rejet De Pollution Dans L'Air." OBSERVATION ET STATISTIQUES. Ministère De L'Ecologie, Du Développement Durable Et De L'Energie. Web. Consulté en Novembre 2014.
"Evolution Et Tendances De La Demande Mondiale En énergie." Energiecreative.com. N.p., n.d. Web. Consulté en Novembre 2014.
(2009). " Partenariat ONG-Entreprises" Les Affaires. Web. Consulté Novembre 2014. (2009) "Le nucléaire, une source de problèmes" site Agissons pour une Europe sans nucléaire lancé lors du
Sommet international de Copenhague sur le climat. Consulté Novembre 2014. (2008) "Revue D'économie Du Développement." De Boeck Supérieur. N.p.. Web. Consulté en Novembre
2014. (2007) "Palm Jumeirah, La Polémique écologique." Moyen-Orient.fr. N.p.,. Web. Consulté Novembre 2014.
(1999) "Energie Les Cinquantes Prochaines Années." ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE). Web. Consulté en Novembre 2014.
(1997) “Protocole de Kyoto a la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques“ Nations Unies. Consulté Novembre 2014.
"Dossiers - La Pollution Due Aux Transports." Avem. N.p., n.d. Web. Consulté Novembre 2014.
"Campagne publicitaire pour faire face aux défis environnementaux", site corporatif Total "L’huile de palme en bref", site officiel Greenpeace International. Consulté Novembre 2014.
"Catastrophe De Bhopal." Futura-Sciences. N.p., n.d. Web. Consulté en Novembre 2014.
"Industrie Manufacturière." Insee. N.p., n.d. Web. Consulté en Novembre 2014.
"Définition De Nanotechnologie." Actu-Environnement. N.p., n.d. Web. Nov. 2014.
" GlobalSecurityMap.fr. Web. Consulté Novembre 2014. " L'alimentation Et L'agriculture Dans Le Contexte National Et International." Achives De Documents De La
FAO. N.p., n.d. Web. Consulté en Novembre 2014. "Dumping Environnemental." Droit24.fr. Web. Consulté Novembre 2014. "Perspective pour l’Environnement : L’agriculture et l’environnement." Archives de la FAO- Département
économique et social. Web. Consulté Novembre 2014. "Mission et Vision de WFF France. " WFF France- Site Officiel. Web. Consulté Octobre 2014.

EXPÉRIENCES DES ENTREPRISES DE L’EUROPE DU NORD
Geoffroy Boulnois, [email protected] Mathilde Faivre-Pierret, [email protected]
Ismaël Jeanneret, [email protected] Odélia Jeannin, [email protected]
Maroua Khadim, [email protected]
Résumé
Depuis de nombreuses années, les pays industrialisés mettent l’emphase sur la réduction de leur impact environnemental. De ce fait, les entreprises visent à mieux concilier impératifs économiques et écologiques en adoptant de bonnes pratiques. Malheureusement, cela n’est pas suffisant, car pour faire face à des ressources toujours plus limitées d’autres approches doivent être implémentées. L’objet du présent rapport vise à montrer les différentes pratiques d’économie circulaire mises en place en Europe du Nord qui parviennent à répondre à ce nouvel impératif en matière d’écologie. Dans un premier temps sera abordée une description du modèle nordique. Ensuite, différents exemples d’entreprises viendront illustrer les différentes approches de l’économie circulaire dans les pays nordiques : économie de fonctionnalité, approche cradle to cradle, éco-conception et symbiose industrielle. Finalement, l’une des clés de succès pour concilier impératifs écologiques et économiques en entreprise repose sur un environnement propice et donc sur le modèle nordique. En effet, ce modèle bénéficie d’un soutien au niveau du système juridique, réglementaire, éducatif et social. Ceci constitue une limite à ce modèle, car on constate qu’en l’absence de support des organismes gouvernementaux, les entreprises ne réussissent pas à mettre en place les prémisses de l’économie circulaire à travers le globe.
INTRODUCTION
Le développement durable prend une place de plus en plus importante dans nos économies depuis le début du XXIe siècle. La signature du protocole de Kyoto par 184 états en 1997 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre a entraîné une multiplication de sommets internationaux pour une économie durable. Les décisions prises par les gouvernements afin de réduire les émissions néfastes pour la planète et les générations futures gagnent petit à petit les entreprises, actrices majeures de l’économie mondiale. Le concept du développement durable, apparu pour la première fois en 1980 (site du gouvernement du Québec), intègre les aspects économiques, environnementaux et sociaux sur une vision de long terme. Il vise en d’autres mots à maintenir l’intégrité de l’environnement, à assurer l’équité sociale et à parvenir à l’efficience économique. Ce sont ces aspects que doivent s’approprier les entreprises afin d’affecter positivement leur structure et leur pérennité.
Désormais, 93 % des chefs de la direction de leur entreprise considèrent que le développement durable est important pour la réussite future de leur structure (Bertels S., 2011). De ce fait, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire du développement durable. Certaines considèrent que s’associer avec une société voisine pour le transport des produits permet de réduire l’impact environnemental et par voie de conséquence de s’impliquer pleinement dans une démarche écologique intégrant le concept de développement durable. D’autres incluent des processus écologiques, sociaux et économiques dans leurs chaînes de valeurs et promeuvent ces bonnes actions auprès de leur client. Il est intéressant de se demander si ces actions ressortent d’une réelle conscience de l’urgence écologique ou s’il est seulement question d’image et de bonne conscience.

Aujourd’hui, on parle de mieux concilier impératifs écologiques et économiques. Autrement dit, comment mieux concilier les impératifs écologiques liés aux ressources existantes en quantité finie sur terre et les impératifs de croissance et de rentabilité des entreprises? Les pays d’Europe du Nord semblent être les mieux armés pour répondre à cette question. L’économie des pays scandinaves a été modernisée par des réformes de marché (Nordlund V., 2011) ce qui leur permet de se hisser dans le haut des classements internationaux comme le KPI ou l’index de compétitivité globale du Forum Économique Internationale.
Suite à cette constatation, il semble pertinent d’étudier de plus près la situation en Europe du Nord. Ainsi, nous réaliserons une étude du modèle nordique afin de maîtriser l’ensemble des éléments influençant le développement durable. Puis, nous verrons quelles sont les industries nord-européennes prédominantes (d’après l’index KPI) en matière de développement durable. Le cœur du travail consistera en l’étude de plusieurs bonnes pratiques au sein de différentes entreprises pour concilier écologie et économie. Enfin, la question de la portée des modèles évoqués sera étudiée afin de voir quels sont les facteurs principaux qui permettraient de les implémenter dans d’autres régions.
1 LEMODÈLENORDIQUE:UNESOURCED’INSPIRATIONENDÉVELOPPEMENTDURABLE
Le modèle nordique fait souvent référence aux pays membres de la Scandinavie, qui comprend au sens strict du terme : la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark. Cependant, les Pays-Bas possèdent des caractéristiques similaires aux pays scandinaves ce qui tend à les inclure dans le modèle nordique. Ces cinq pays possèdent une culture individuelle forte, mais font preuve d’une collaboration politique, économique et sociale importante depuis plus d’un siècle, efficace au point que l’on parle aujourd’hui de « modèle nordique ». Ce modèle attire l’intérêt des gouvernements et des citoyens, car il démontre une capacité élevée à atteindre l’efficience et l’équité au sein de la société (Sapir, 2006), ceci avec une forte propension à l’ouverture à la mondialisation, une protection sociale efficace et un système prônant l’égalitarisme (Milne R. et Ward A., 2009). Largement plébiscitée par les médias, on vient à se demander si un tel modèle est applicable dans d’autres pays.
1.1 Unehistoirepropiceàlacollaborationpolitique
Plusieurs facteurs peuvent expliquer une telle situation politique en Europe du Nord, le principal étant un passé particulièrement soudé en terme de géopolitique. Les empires du Nord (Danemark, Norvège et Suède) ont subi de nombreuses mutations politiques à partir du XIIe siècle jusqu’au XXe siècle : aujourd’hui, ces trois royaumes ont été divisés entre le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, les Iles Féroé et l’Islande (Kessler N., 2009). Les peuples du Nord partagent donc la même origine germano-scandinave, ce qui les rapproche sur le plan culturel et les a menés à s’identifier et à s’entraider (Blaise R., 2008). On peut ajouter que ces pays n’ont pas été impliqués dans de grands conflits depuis plus d’une centaine d’années, ce qui favorise grandement les échanges et la stabilité politique. Enfin, on peut souligner les efforts de transparence dans la gestion des affaires politiques qui offrent une information exhaustive aux citoyens et donc un taux de participation dans la vie politique très élevé.

La politique en matière de développement durable dans la région nordique est une des plus engagée au monde avec une participation active des gouvernements dans l’établissement de lois et l’adoption de plusieurs règlements et normes (Envinronmental Protection Act, Objectifs Qualitatifs de l’Environnement, certification ISO 14001,…), de traités (Brundtland, Maastricht, Lisbonne,…), de protocoles (Tokyo et Post-Tokyo) (Lidskog, R. et Elander I., 2011), mais aussi un engagement concret auprès des citoyens et des entreprises avec des aides pour l’aménagement, l’achat et l’utilisation de biens écoresponsables (Raynault M. F., 2010), notamment via la publicité de bonnes pratiques (encourager les transports publics, programmes éducatifs pour la jeunesse proposés en espaces naturels, réduction de l’utilisation de l’électricité, etc.). Par exemple, Diana WONG, conseillère en Énergie et Climat au Département Environnemental de Stockholm, résume cette volonté du gouvernement suédois : « Le gouvernement permet aux entreprises qui adoptent un comportement écoresponsable d’être exonérées de certaines taxes […], de bénéficier de conseils gratuitement et reçoivent parfois une bourse allant jusqu’à 30 000 SEK (environ 4 750 CAD). » Le gouvernement suédois a par ailleurs évoqué ce besoin de « léguer à la prochaine génération une société où les principaux problèmes environnementaux […] auront été réglés » (Regeringskansliet, 2010) et montre ainsi sa volonté d’atteindre une meilleure utilisation des ressources, une réduction de l’impact humain (Lidskog, R. et Elander I., 2011), et enfin l’utilisation de sources d’énergies renouvelables (vent, soleil, eau).
1.2 Unesituationéconomiqueetenvironnementaledynamique
Alors que la plupart des pays rencontrent encore aujourd’hui des difficultés à se remettre de la crise financière de 2008, le modèle nordique (Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Pays-Bas) semble quant à lui afficher une situation plus qu’enviable avec une reprise plus rapide que les autres pays européens (Ali-Yrkkö J., Rouvinen P. et Ylä-Anttila P., 2011).
Tableau 1 – Comparaison des données économiques entre le modèle nordique et le reste des pays de l’OCDE
Aspect économique (2012) Modèle nordique Pays membres de l’OCDE
Chômage 6,3 % 8 %
Inflation 1,8 % 2,8 %
PIB/habitant 62 600 $ 37 500 $
Balance commerciale +35,1 milliards de $ -273,4 milliards de $
Concernant l’aspect économique, celui-ci se porte bien. Le PIB par habitant est élevé, en 2012 la Norvège était classée au niveau mondial (selon l’Index Mundi) 9e, les Pays-Bas 18e, la Suède 22e, le Danemark 30e et la Finlande 33e. En comparaison, le Canada était 21e et le Royaume-Uni 34e. Les pays du Nord possèdent un coût de main-d’œuvre élevé comme le montrent les statistiques de l’OCDE en 2013 : Norvège 2e, Pays-Bas 5e, Finlande 7e, Danemark 13e et Suède 14e. Cela favorise notamment la délocalisation qui aura un impact sur la

performance des entreprises scandinaves sur leur impact environnemental. Il faut aussi noter que 1 à 2 % du PNB sont dédiés au développement durable. Un autre indice intéressant est celui du taux d’imposition disponible sur le site de Central Intelligence Agency, car il traduit aussi le comportement politique des pays du Nord. En effet, la fiscalité est lourde : Norvège 6e (avec 57 % d’impôts sur le revenu), Danemark 8e, Finlande 10e, Suède 12e, Pays-Bas 24e (43 %). Cependant, ces pays offrent une transparence des redistributions, montrent un taux faible de corruption (« freedom from corruption » supérieure à 85 % selon le site Heritage.org) et une taxation proportionnelle au revenu.
Concernant l’environnement, les pays du Nord aussi montrent l’exemple. Les émissions de CO2 par habitant sont parmi les plus faibles des pays développés en 2009 : la Suède est 75e (seulement 4,70 tonnes métriques par habitant par an), le Danemark 35e, la Norvège 25e, la Finlande 24e et les Pays-Bas 20e. Le Canada se place 11e (15,24 tonnes métriques par habitant par an selon l’Index Mundi). La protection des eaux marines aussi est un bon indicateur en 2010 : les pays du Nord se placent entre la 17e place (22,11 %) et la 72e place (2,35 %), tandis que le Canada est placé 88e (1,25 %), juste après la Chine. L’indice sur la perte d’électricité dans son acheminement jusqu’au consommateur montre aussi la capacité des pays à limiter leur impact sur l’environnement en diminuant le gaspillage énergétique. En 2010, sur 135 pays, la Finlande est 133e (3,43 % de perte seulement), les Pays-Bas 130e, suivi du Danemark (109e) et de la Suède et Norvège (100e et 99e, avec environ 7 %). À titre de comparaison, le Canada est 72e avec 10,80 %.
Tous ces éléments nous poussent à croire que les efforts des gouvernements en matière de stabilité économique sont plutôt efficaces et que l’impact des pays du Nord sur le plan énergétique et naturel (eau et air) est plus limité que la plupart des autres pays du monde.
1.3 Unesociétésoucieusedubien‐êtredesescitoyens
Un autre point primordial du modèle nordique concerne la vision sur le long terme de l’équité sociale avec une prise de conscience du bien-être des générations actuelles et futures. Les pays du Nord se caractérisent par un esprit égalitaire et protecteur très inscrit dans la culture scandinave, qui pousse les citoyens à agir de façon responsable pour la communauté et le bien de tous. Ainsi, les populations en Europe du Nord bénéficient toutes d’un accès à l’éducation et aux soins, avec une répartition équitable et transparente des impôts, ce qui suggère un niveau de vie global élevé, moins d’inégalités sociales, un sentiment de sécurité, une conscience accrue du statut de chacun et une baisse de mouvements contestataires lorsque les gouvernements souhaitent implémenter des changements. Concernant les frais de scolarité, le taux appliqué est le même pour tous les citoyens et permet à tous d’avoir accès à l’école aux frais de l’État, même pour les écoles privées (Loisel, 2012).
Pour la santé, l’OCDE a classé les pays selon leur taux de dépenses en 2012 : Pays-Bas 2e, Danemark 7e, Suède 13e, Norvège 17e et Finlande 19e.
À partir des années 70, de nombreux mouvements activistes ont eu lieu en Suède et dans les pays scandinaves en général dont les thèmes principaux étaient l'égalité hommes-femmes, la paix et l’environnement. Les ONG telles que Green Peace ont largement contribué à la médiatisation des dégâts humains sur l’environnement. Cela a fait vivement réagir les pouvoirs politiques pour reprendre du pouvoir par rapport à celui des ONG, car leur influence sur les citoyens et leur activité dans la sphère politique avaient pris une ampleur inégalée.

Ceci a favorisé la compréhension de l’enjeu d’une diminution de l’impact environnemental et de l’équité sociale avec l’adoption des gouvernements d’une politique qui conjugue démocratie, croissance économique et respect des individus et de l’environnement. Un ensemble de mesures ont été prises au niveau national afin de favoriser les citoyens et les entreprises à adopter un comportement responsable. Cela se traduit par un effort des communes et des localités pour financer des projets moins énergivores, de programmes éducatifs pour étudier en plein air et se sensibiliser à la nature, des conseils et aides pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans le développement durable (par volonté propre ou par obligation législative). Ainsi, le but est de pouvoir permettre aux générations d’aujourd’hui et de demain d’agir ensemble pour un meilleur environnement global. Ces efforts sont d’autant plus encouragés, car c’est une situation où chacun y trouve son compte et perçoit des retombées économiques : nouvelles sources de revenus, réduction des dépenses et argument de vente pour les entreprises, mais aussi sources de revenus pour les citoyens (recyclage de cannettes, compost, etc.).
Ainsi, l’implication des gouvernements est soutenue par les citoyens et gagne de la visibilité sur le plan international sur leur bonne conduite environnementale. Cette volonté de faire du modèle nordique un modèle mondial passe donc par une éducation des politiques, des citoyens et des entreprises pour atteindre un comportement responsable envers les humains, mais aussi envers l’environnement.
2 EXPÉRIENCESRÉUSSIESDESENTREPRISESD’EUROPEDUNORD
2.1 L’économiedefonctionnalité:remplacerlapropriétéparlalocation
CasdesentreprisesFloow2etTurntoo–Philips
Dans beaucoup d’industries se pose la question de l’obsolescence programmée. Prenons le célèbre exemple d’Ellen Macarthur : quand un frigidaire est en fin de vie, il est simplement jeté. Dans quel intérêt? L’objectif est-il d’avoir un frigidaire ou de la nourriture fraîche? La réponse est implicitement donnée. Les matériaux ne cessent de devenir plus rares et plus coûteux. Il est intéressant de voir s’il est possible que le fabricant devienne le propriétaire. Le frigidaire serait conçu pour être refabriqué. Lorsqu’il arrive en fin de vie il retourne chez son fabricant pour le prochain cycle de vie. Les matériaux sont donc conservés et réutilisés. C’est une idée adoptée par plusieurs entreprises d’Europe du Nord et notamment aux Pays-Bas.
L’entreprise FLOOW2 (d’après le site de l’entreprise) s’est spécialisée dans la location de machineries lourdes, en particulier pour les travaux d’excavation dans la construction ou l’agriculture. Selon ses estimations, le temps d’utilisation de ces engins ne serait pas maximisé dans un modèle classique. Ce système permet de réaliser des économies pour l’entreprise locatrice et de ralentir la production effrénée d’outils pour la construction et l’agriculture. Le travail réalisé sera le même, mais l’investissement de base peut être réduit de moitié. FLOOW2 ne vend pas un produit, mais met en relation des propriétaires et des loueurs pour la vente d’un usage.

Quant à elle, l’entreprise Philips a développé une pratique de développement durable à la demande de Turntoo. Le président de Turntoo à Amsterdam, l’architecte Tomas Rau, a constaté qu’il était intéressé par la performance d’un produit et non par sa possession. C’est dans cette optique qu’il a pensé à louer des heures d’éclairage plutôt que de payer des ampoules, des heures de station assise plutôt que des chaises ou encore du passage plutôt que d’acheter de la moquette (Ellen MacArthur Fondation, 2012). Pour l’éclairage, il a fait appel à la société Philips et ils ont développé un nouveau concept ensemble. Philips a créé un « plan de lumière » (Ellen MacArthur Fondation, 2012) utilisant autant que possible la lumière du jour. L’installation consiste en un système de capteurs qui permet de réduire la consommation d’énergie à son strict minimum en réglant automatiquement l’éclairage artificiel en fonction des mouvements ou de la lumière naturelle. Turntoo a réalisé une économie de 55 % sur son éclairage grâce à ce système. Aussi, Philips reste propriétaire de ses installations et ne vend que la lumière consommée en accord avec le fournisseur, par le biais d’un système de location. En fin de vie, le fabricant peut récupérer les matériaux utilisés pour les incorporer dans la fabrication de son prochain produit. Dès la conception, le fournisseur incorpore l’idée de recyclage afin de réduire ses coûts de fabrication. Cette approche est plus complète que l’idée de FLOOW2 puisqu’en fin de vie le produit revient au fournisseur qui doit penser à sa réutilisation.
Figure 1 – Économie de fonctionnalité appliquée à Philips
2.2 ImpactsenvironnementauxetéconomiquespourPhilips
Avec une telle politique d’innovation, Philips a su réduire considérablement son impact sur l’environnement. D’après son rapport annuel sur le développement durable l’entreprise a amélioré de 25 % l’efficacité énergétique opérationnelle et a réduit dans le même temps les émissions de CO2 de 25 % entre 2007 et 2012. Sur l’ensemble de ses produits, Philips a collecté et recyclé 14 000 tonnes en 2012 afin de boucler le cycle de vie des matériaux.
En 2013, le résultat brut de l’entreprise Philips concernant ses produits d’éclairage était de 695 millions d’euros, soit une augmentation de 443 % par rapport à l’année précédente. L’investissement en recherche et développement de nouvelles pratiques n’ont pas était vain puisque la rentabilité financière est au rendez-vous.

2.3 FacteursclésdesuccèsdumodèledeTurntoo&Philips
Coopération entre les parties prenantes (fournisseur et client) Accord sur un système de valeurs pour une industrie durable Volonté de revoir le cycle de vie du produit Accord sur l’investissement en R&D Intégration de la valeur ajoutée du distributeur dans celle du fabricant Absence d’investissement pour le client
2.4 L’approchedel’économiedefonctionnalité
Ces deux approches de l’usage d’un bien permettent de repenser les modèles de consommations pour les entreprises. Philips, grâce à son partenariat avec Turntoo, propose un service plus complet en matière de développement durable puisqu’en tant que fabricant, elle peut recycler et réutiliser le produit lorsqu’il devient obsolète. Ces pratiques sont considérées comme faisant partie de l’économie de fonctionnalité. Cette dernière vise à substituer à la vente d’un bien la vente d’un service ou d’une solution intégrée remplissant les mêmes fonctions que le bien, voire des fonctions élargies, tout en consommant moins de ressources et d’énergie et en créant des externalités environnementales et sociales positives.
2.5 Limitesetdéfis
Le concept de FLOOW2 représente les prémisses du développement durable. L’impact sur l’environnement est réduit et les économies sont mesurables pour le locataire. Mais FLOOW2 n’aborde pas concrètement le recyclage des produits mis en location sur sa plateforme. Elle ne les fabrique pas et ne se pose pas la question de la réutilisation en fin de vie. Aussi qu’en est-il des constructeurs qui fournissent cette entreprise? Ils voient leurs ventes diminuer et ne bénéficient pas des avantages du modèle. Dans un autre registre, Philips répond à cette problématique.
Mais la création d’un tel modèle n’est pas viable pour Philips si elle fournit une seule entreprise. Les coûts de conception et de fabrication ne sont supportés que par elle. En effet, elle ne facture que la location de l’éclairage à Turntoo, et cela ne peut se faire sans l’accord du fournisseur d’énergie puisqu’il faut mesurer l’électricité consommée par le seul mécanisme d’éclairage.
Il faut donc s’assurer par une étude de marché de la faisabilité et de l’intérêt d’un tel investissement en recherche et développement. Mais elle dispose en revanche d’un avantage concurrentiel qui peut convaincre d’autres clients. Si la promotion d’un tel usage est bien maîtrisée, Philips peut accroître ses revenus en permettant à ses clients de réduire leur consommation. Le résultat réside dans l’étude de projet au préalable comme tout projet en entreprise. C’est donc un défi surmontable.

Les principales limites d’un tel système sont :
Plus difficile à mettre en œuvre pour un produit de consommation que pour les produits industriels;
Une mauvaise entente peut faire échouer la collaboration (ex. : Electrolux sur le site Économie de fonctionnalité) et réduire l’ensemble du modèle pour le fabricant et le client;
Une analyse de cycle de vie ne tenant pas compte des évolutions technologiques futures (inconnues) peut voir l’ensemble du produit non réutilisé dans le processus de production de l’entreprise.
2.6 LeCradletoCradle:repenserlaconceptiondesproduits
Pour beaucoup d’entreprises, respecter les impératifs écologiques signifie émettre le moins de CO2 possible ou encore réduire son utilisation de ressources naturelles. Mais cette approche de l’écologie ne permet pas de résoudre des problèmes de fonds tels que l’utilisation de ressources polluantes, de produits chimiques ou toxiques, etc. En somme, aucune modification n’est effectuée sur la conception du produit lui-même. Pourtant, dans une vision de long terme il s’agit bien là du vrai enjeu : repenser la manière dont on conçoit les choses. L’innovation et la conduite de changements profonds sont au cœur de cette approche que l’on nomme le « cradle to cradle ».
En 2002, William McDonough et Michael Braungart publient « Cradle to Cradle : Remaking the way we make things ». Le Cradle to Cradle (C2C), dont la traduction littéraire signifie du berceau au berceau, prône la conception de produits biodégradables ou indéfiniment recyclables et s’oppose ainsi au Cradle-to-grave (du berceau à la tombe). Il s’agit donc de repenser la conception des choses en s’appuyant sur 5 principes : l'utilisation de matériaux qui sont biodégradables et réutilisables (suppression des éléments toxiques), la réutilisation des composants des produits, l'utilisation d'énergie renouvelable, une utilisation efficace des ressources et en particulier de l'eau, et l'équité sociale. À ce point, certains se disent certainement que la conception selon les principes du Cradle to Cradle semble difficilement applicable pour de nombreuses industries. Pourtant, plusieurs entreprises nord-européennes réussissent ce défi alors même qu’elles évoluent dans des industries considérées comme très polluantes. Nous verrons ici les exemples du Danois Maersk et du Suédois H&M.
CasdugroupeMaersk
Le groupe Maersk est un conglomérat danois, qui compte plus de 89 000 employés et dont les opérations sont déployées dans plus de 130 pays. Maersk est le leader mondial du transport maritime qui représente 74,2 % de son chiffre d’affaires en 2013. Il réalise également des activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz (22,2 % du CA en 2013) et d’autres activités (3,6 % du CA) telles que des activités de construction de chantiers navals et de gestion d’usines. Depuis 2009, l’entreprise est signataire d’UN Global Impact. En ce sens, le groupe cherche à adopter une attitude corporative responsable. C’est pourquoi il s’engage chaque année à développer la santé et la sécurité de ses employés, à réduire son impact sur l’environnement, à lutter contre la corruption, à intégrer la responsabilité sociale dans ses affaires, à offrir de bonnes conditions de travail, à intégrer la diversité et à développer ses relations avec ses fournisseurs afin d’assurer un approvisionnement responsable.

Par ailleurs, le groupe s’engage aussi à la mise à disposition de ses capacités logistiques en cas de crises humanitaires. L’entreprise prend effectivement part au Logistique Emergency team (LET) qui achemine les premières nécessités en cas de désastre naturel. Par exemple, il faisait partie de ceux qui ont acheminé l’aide nécessaire lors du séisme à Haïti.
Depuis 2009, Maersk multiplie les actions liées au développement durable, mais il multiplie aussi les récompenses concernant son travail et ses efforts en la matière. Depuis plusieurs années, le groupe est récompensé pour produire le meilleur « Sustainability report » parmi les entreprises danoises. En 2014, l’entreprise a introduit une nouvelle stratégie de développement durable dont l’objectif est la création de valeur pour la société et pour l’entreprise. Cette stratégie repose sur 3 grands piliers : rendre possibles le commerce, l’éco-efficience et l’investissement dans l’éducation. La direction de Maersk pense que l’association de ces 3 actions permettra la croissance durable de l’entreprise et de la société.
En effet, le groupe part du constat qu’il y a aujourd’hui encore de nombreuses barrières au commerce : corruption, barrières administratives, manque d’infrastructures, manque de savoir-faire en logistique, etc. D’ailleurs, la logistique coûte plus cher dans les pays en développement que dans les pays industrialisés du fait de l’utilisation réduite des nouvelles technologies et du manque d’infrastructures. Pour ces raisons, le groupe souhaite s’investir pour réduire les barrières aux commerces. La facilitation des échanges doit permettre le développement des économies, mais aussi la croissance de Maersk du fait de son activité de transport maritime.
Ensuite, l’entreprise rencontre beaucoup de difficultés à trouver de la main-d’œuvre qualifiée dans les pays à forte croissance. Il pense donc investir dans l’enseignement et la formation. Ainsi, le groupe contribue au développement des sociétés locales tout en s’assurant une main-d’œuvre qualifiée pour ses activités.
Mais le point le plus important dans la stratégie de Maersk est celui de l’éco-efficience. Par éco-efficience, le groupe entend réduire au maximum l’utilisation des ressources naturelles, mais aussi réduire son impact environnemental.
2.7 Impactenvironnementaletéconomique
L’engagement pour l’environnement permet à l’entreprise de réaliser des réductions de coûts importants. En 2013 seulement, les initiatives éco-efficientes qui ont été menées par le groupe lui ont permis de réaliser 764 millions de dollars d’économie en carburant. Maersk group s’était fixé une réduction de son émission de CO2 de 20 % d’ici à 2020 sur la base de 2010, mais en 2013 il avait déjà diminué son émission de CO2 de 17 %. De même pour son objectif de réduction de ses émissions par conteneur : il visait une réduction de 40 % d’ici à 2020 sur la base de 2007, mais en 2013 l’émission de CO2 par conteneur avait déjà été réduite de 37 %. L’avance dans la réalisation de ses objectifs est une excellente chose, sachant que les activités maritimes de Maersk sont responsables de 90 % du footprint du groupe. La réduction de son impact environnemental est possible grâce à des innovations technologiques, l’amélioration de la performance de ses réseaux, et des économies d’échelles.
En réalité, les efforts de Maersk en matière d’éco-efficience vont de pair avec la nouvelle approche C2C qu’il a développée. L’entreprise a lancé un projet dont l’objectif final est la construction de nouveaux navires à partir de navires en fin de vie.

En effet, il s’avère que l’industrie maritime est dépendante de 2 ressources principales : le carburant et l’acier. Or l’acier compose à 98 % un navire, et son prix tout comme celui du carburant est très volatile.
Actuellement, lorsqu’un navire arrive en fin de vie, il est envoyé en Chine pour être démantelé. Cependant, la variété des matériaux et des types d’acier utilisés dans la construction d’un navire ne permettent pas un bon recyclage. Les composants du bateau sont certes recyclés, mais comme on n’en connaît ni les caractéristiques ni leurs origines, les différents aciers sont recyclés conjointement et le résultat donne un acier de basse qualité.
C’est pourquoi Maersk a eu l’idée de développer une base en ligne qui recense tous les matériaux qui composent ses nouveaux navires et leurs caractéristiques. Ce recensement facilitera la maintenance du navire pendant sa durée de vie puis l’optimisation du recyclage en fin de vie. De plus, il est estimé que 60 à 70 % des composants des navires existants pourraient également être documentés.
Cette initiative a demandé d’énormes efforts en matière de R&D, pour re-designer les nouveaux bateaux et utiliser de nouvelles technologies. Si l’objectif des recherches de Maersk est d’être en mesure de construire de nouveaux bateaux à partir d’anciens, il est pour le moment seulement capable de recenser et de construire les navires afin de pouvoir ensuite optimiser la qualité des matériaux recyclés. Mais déjà à ce stade cela lui permet de réaliser des économies conséquentes et de générer de nouveaux revenus liés à la vente de l’acier recyclé et à la réutilisation du cuivre dans la fabrication de câbles. À terme, son initiative n’a pas d’impacts seulement sur l’entreprise, mais sur toute l’industrie de l’acier.
CasdugroupeH&MHennesandMauritz
H&M Hennes and Mauritz design, manufacture et commercialise des articles de mode. Le groupe a commencé avec une seule boutique en Suède en 1947 et compte aujourd’hui plus de 3400 boutiques à travers le monde. Plus de 116 000 travaillent pour le groupe qui a généré en 2013 un chiffre d’affaires de plus de 150 milliards de SEK (environ 20.3 milliards de dollars). De même que Maersk, le groupe adopte une attitude corporative responsable et multiplie les initiatives en faveur des sociétés locales.
Impact environnemental et économique
Le « Sustainable report 2013 » est le 12e que le groupe publie. Consciente de la limite des ressources disponibles sur la planète, H&M travaille activement à réduire son utilisation en ressources et en énergie. En 2013, le groupe a utilisé 340 millions de litres d’eau en moins pour la production du denim. Depuis 2007, il a réduit sa consommation d’électricité de 14 % et souhaite la réduire de 20 % d’ici à 2020 par rapport à 2007. En parallèle, H&M réduit sa production de déchets.
H&M cherche à utiliser pour la fabrication de ses vêtements des produits plus respectueux de l’environnement. Par exemple, 15,8 % du coton utilisé provient de sources durables. L’entreprise souhaite augmenter à 100 % l’utilisation d’un tel coton d’ici à 2020. De plus, H&M utilise des produits recyclés pour concevoir ses vêtements. En 2013, elle a utilisé du polyester recyclé en quantité équivalente à 15 millions de bouteilles PET. Depuis de nombreuses années, le groupe tente de supprimer l’utilisation de produits chimiques et polluants dans la conception de ses produits, et ce, dès la production de la matière première.

Toutes ces mesures vont dans le sens du Cradle to Cradle. Et pour cause, en 2014, H&M a lancé ses premiers produits réalisés à 20 % à partir des vêtements qu’elle collecte. Le groupe tente de développer de nouveaux vêtements à partir d’anciens vêtements, et donc de fabriquer des vêtements en cycle fermé. En 2013, H&M a collecté plus de 3000 tonnes de vêtements, l'équivalent de 15 millions de T-shirts, qui pourront servir à fabriquer de nouveaux habits.
Dernièrement, afin de pousser encore plus loin ses actions et de réduire au minimum son impact environnemental, H&M étudie la possibilité de se fournir intégralement en énergie renouvelable. Aujourd’hui, 18 % de son approvisionnement en énergie provient d’énergie renouvelable.
Finalement, comme beaucoup de grandes entreprises, H&M et Maersk, ont pris conscience que leur croissance était limitée par les ressources en quantité finie qu’elles utilisent et par le développement des sociétés et de l’économie mondiale. C’est pourquoi elles adoptent une attitude corporative responsable. Pour faire face à la limite en ressources desquelles elles dépendent, elles ont, dans un premier temps, adopté une approche éco-efficiente. Cependant, faire preuve d’éco efficience n’est pas suffisant, car cela limite les impacts environnementaux, mais ne les supprime pas. Aujourd’hui, elles développent l’approche Cradle to Cradle en développant une production en cycle fermé. Mais repenser la conception d’un produit implique des changements profonds des modèles d’affaire et des chaînes de valeur, et des investissements parfois colossaux. Cependant, les bénéfices à en tirer sont largement supérieurs et peuvent révolutionner toute une industrie. Il s’agit pour les différents acteurs d’accepter que le changement et l’innovation constituent la nouvelle donne dans le monde des affaires, tout comme la coopération entre entreprises, dans une vision stratégique de long terme. Maersk et H&M l’ont bien compris et n’ont pas peur de dire que la conduite de tels changements nécessite la coopération de l’ensemble des acteurs économiques.
La conciliation de leurs impératifs écologiques et économiques pour assurer leur avenir repose donc sur des éléments clés.
2.8 Facteursclésdesuccès
Une gestion durable de la chaîne d’approvisionnement, qui permet plus de stabilité et de confiance.
Collaboration tout au long de la chaîne de valeur : approvisionnement, sous-traitances, partenariats, R&D, etc.
Éco-efficience : réduire au maximum son utilisation en ressources naturelles. Innovation.
2.9 Bénéficeséconomiquespourlesentreprises
Image du groupe. Réduction des coûts. Réduction de la dépendance liée aux matières premières. Revenus supplémentaires. Croissance durable.

2.10 Défisetlimites
H&M et Maersk appartiennent à des industries polluantes (utilisation de produits chimiques) et gourmandes par nature en énergie et en ressources naturelles. Les deux entreprises font certes des efforts considérables pour réduire leur impact environnemental, mais la route est encore longue. À chaque trajet effectué par un de ses navires des substances sont rejetées dans les océans. Malgré les innovations en logistique, et par conséquent la réduction d’émission de CO2 et d’utilisation en pétrole, de nombreux conteneurs sont transportés à moitié vides… H&M aura toujours besoin d’eau dans la production de ses vêtements. Mais les deux entreprises imposent leur volonté de changement.
D’autre part, leurs projets de développement nécessitent la coopération d’autres entreprises et acteurs spécialisés dans des domaines différents. De plus, ce sont des entreprises globales. Or, si bien elles rencontrent un appui dans leur pays d’origine de la part des gouvernements pour la mise en place des infrastructures nécessaires (notamment logistiques), et de la part d’autres entreprises qui partagent la culture du développement durable, les choses se compliquent à l’étranger et en particulier dans les pays en développement.
3 L’ÉCOCONCEPTION:CONCEVOIRDESPRODUITSPLUSRESPECTUEUXDEL’ENVIRONNEMENT
Cas de l’entreprise Stora Enso
Stora Enso est une entreprise finno-suédoise basée à Helsinki active dans l’industrie des matériaux, plus précisément dans l’industrie de la papeterie et des produits issus du bois. Cette entreprise constitue un bon exemple dans la pratique du développement durable des pays d’Europe du Nord pour plusieurs raisons.
Premièrement, celle-ci fait partie d’un ensemble d’entreprises utilisant la même source de matière première : le bois. En Finlande, le secteur de la foresterie est très réglementé et pour chaque arbre coupé, la loi demande d’en replanter un automatiquement, assurant ainsi que cette ressource soit disponible durablement. Mais la force du secteur de la foresterie ne vient pas uniquement de la gestion de cette ressource. En effet, plusieurs entreprises viennent ainsi se greffer à cette dernière et utilisent différents composants du bois. Le schéma ci-dessous montre les entreprises qui utilisent cette ressource (Food and Agriculture Organization, 2013) :

Figure 2 – Modélisation de l'utilisation du secteur de la foresterie en Finlande
Cultor (Danisco) : est une entreprise qui produit du Xylitol un substitut au sucre qui utilise comme matière première le sucre de bouleau (Danisco, 2014)
Haltia nature : est un centre de recherche et d’éducation sur l’utilisation du bois en tant que matériel de construction (Metsähallitus, 2014)
Hôpital de Toölo : qui utilise un plâtre issu du bois afin de traiter ses patients. Ce plâtre est 100 % renouvelable.
Université d’Helsinki : qui crée des produits à partir de la sève de bouleau. UPM : qui est une entreprise active, entre autres, dans le secteur énergétique, plus
précisément dans le biocarburant et utilise le bois afin de produire ce dernier (UPM, 2014). PME : plusieurs petites et moyennes entreprises qui utilisent le bois comme matière première
(scierie, construction des biens publics, etc.).
L’intérêt ici est de montrer la diversité des entreprises qui viennent utiliser une ressource gérée de manière durable. En effet, on voit comment une matière première parvient à être divisée en plusieurs composants (bois, sèvre, sucre de bouleau,…) qui entrent chacun dans la conception d’un produit. Néanmoins, peu d’interactions, ou connexions entre les entreprises et leurs chaînes de valeurs existent : elles agissent toutes, plus ou moins, indépendamment les unes des autres.
Mais ce qui fait aussi que Stora Enso illustre le cas d’une bonne pratique du développement durable est que l’entreprise fait de l’ « écoconception ».
3.1 Principedel’écoconception
Cette approche vise à concevoir un produit respectueux des principes du développement durable et de l’environnement tout en utilisant le moins possible de ressources non renouvelables, notamment en recourant majoritairement à des ressources renouvelables qui sont exploitées en faisant attention à leur taux de renouvellement (Philippe R. et al., 2005).

Mais l’écoconception ne s’arrête pas là, elle cherche aussi à valoriser les déchets produits par l’entreprise afin de leur trouver une nouvelle fonction (réemploi, recyclage,…). Ainsi, cette approche tient compte des impacts sur l’environnement durant la conception et le développement du produit tout en implémentant les aspects liés à l’environnement à chaque étape du cycle de vie du produit (matière première utilisée, transport de celle-ci, emballage du produit, recyclage, etc.). Une des méthodologies utilisées par cette approche est l’analyse du cycle de vie du produit (ACV).
L’ACV a fait l’objet d’une normalisation ISO dans le but d’assurer une utilisation cohérente et comparative de cette méthodologie. L’ACV vise à quantifier tous les flux entrants et sortants des éléments analysés. Le résultat est un bilan complet de ces flux sur l’ensemble du cycle de vie du produit. On parle ici d’un « inventaire du cycle de vie » (ISO 14041).
3.2 L’écoconceptionappliquéeàStoraEnso
Comme expliqué précédemment, l’entreprise utilise en Finlande du bois provenant de sources qui sont gérées durablement et dont les machines utilisées pour la taille des arbres répondent à des critères écologiques.
Pour le transport de ces ressources, l’entreprise cherche à diminuer l’impact en CO2 en imposant à ses fournisseurs des normes environnementales dans un code de conduite appliqué à l’ensemble de ses partenaires. De plus, l’entreprise cherche à s’approvisionner localement en matière première afin d’assurer le développement des communautés locales.
Tous les produits en papiers, emballages, ainsi que les pièces en bois qu’ils produisent se basent sur des matières premières renouvelables et recyclables. De plus, tous les développements des produits se font en collaboration avec les parties prenantes de l’entreprise, mais aussi au moyen de rétroactions de leurs clients.
L’entreprise cherche aussi à augmenter la quantité de papier recyclé utilisée comme fibre dans la production de ses produits ainsi, en 2013, le papier recyclé représentait 28 % du montant total de la fibre utilisée (soit une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à 2012). L’entreprise génère aussi une partie de son électricité nécessaire à son entreprise et à son processus de production (Stora Enso, 2013).
3.3 Impactenvironnemental
L’électricité générée à l’interne représente en 2013 environ 37 % de son besoin énergétique. Au niveau de sa production de CO2, depuis début 2006, celle-ci a diminué de 28 %. Mais ce n’est pas la seule diminution enregistrée par l’entreprise : sa consommation d’eau pour son processus de production a baissé de 6 % depuis 2010. Stora Enso est en recherche perpétuelle d’efficience dans les matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits. Ainsi, en 2013 97 % des déchets produits par l’entreprise étaient réutilisés. Cela est rendu possible par l’analyse du processus de production de ses produits. Ces déchets sont des fibres, des cendres, des boues d’épuration, etc. La majeure partie de ces déchets sont réutilisés pour leur production interne de bioénergie, mais aussi dans l’agriculture et par exemple dans la construction de routes par leurs partenaires (Stora Enso, 2013).

Figure 3 – Utilisation des déchets par l'entreprise (Stora Enso, 2013)
3.4 Bénéficeséconomiques
En 2013, le revenu généré par la réutilisation de ces déchets se monte à environ 11 millions d’euros. Durant la même année, la marge opérationnelle pour l’ensemble des produits de l’entreprise est de 5.5 % du chiffre d’affaires, soit EUR 578 millions (Stora Enso, 2013). Cette marge opérationnelle est confortable lorsqu’on la compare à celle des entreprises canadiennes du même secteur pour la même année qui est de l’ordre de seulement 1 % (gouvernement du Canada, 2014).
3.5 Défisetlimites
Une ACV est souvent très coûteuse à mener (on parle de 20 000 à 30 000 euros en fonction du produit ou du processus). Cependant, l’entreprise y retrouve son compte par la suite grâce aux économies réalisées (Stora Enso, 2013).
Nécessite de mettre en place de nouvelles compétences afin d’assurer la formation et la sensibilisation de son personnel et des parties prenantes à cette approche.
Afin de mener à bien une ACV, une transparence accrue est demandée, cependant les secrets de fabrication ne garantissent pas cette dernière.
L’écoconception est facilement applicable aux produits nécessitant une ressource disponible en grande quantité. Toutefois, avec l’évolution de la technologie, l’utilisation de métaux rares rend le recyclage beaucoup plus difficile et coûteux.
Chaîne Symbiotique : complémentarité et échange de ressources entre entreprises
3.6 Symbioseindustrielle
Une symbiose industrielle est une combinaison de synergies interreliées entre au moins trois entreprises consistant en l’échange d’au moins deux ressources (méthode 3-2 de M. Chertow). Il s’agit, en effet, d’une forme d’échange d’énergie, d’eau et de matières premières visant à fermer la boucle d’utilisation des ressources entre un réseau d’entreprises dans le cadre d’une approche collaborative et de développement industriel durable. Il s’agit d’initiatives d’entreprises privées souvent propulsées par des organismes locaux.

À la base de la symbiose se trouvent des synergies industrielles de mutualisation ou de substitution :
Mutualisation d’approvisionnement et de traitement lorsqu’il s’agit d’un même produit consommé ou rejeté par deux ou plusieurs entreprises. Celles-ci décident de mettre en commun leurs activités de transport, de traitement et d’approvisionnement.
Substitution d’un flux entrant par un flux sortant : les déchets d’une entreprise sont utilisés comme matières premières ou sources d’énergie pour une autre entreprise.
3.7 CasdelasymbiosedeKalundborg
La symbiose de Kalundborg a été créée en 1961 grâce à la mise en œuvre de la première synergie entre la raffinerie Statoil et la centrale électrique Asnaesvaerket. La municipalité de Kalundborg a été impliquée au tout début de la symbiose par son rôle de support en participant au financement du réseau d’eau nécessaire à l’approvisionnement de Statoil sous condition de la rationalisation des flux d’eau entre les acteurs de la région.
En effet, de nombreux échanges ont été effectués dans le cadre d’un processus évolutif pour donner lieu à un réseau complexe de synergies industrielles. Actuellement, la symbiose de Kalundborg compte 26 échanges et sept principaux acteurs situés à proximité les uns des autres (Jacobsen, 2006) :
Asnaesvaerket, une centrale électrique de 1 300 mégawatts; Statoil A/S, une raffinerie pétrolière; Novo Group, une entreprise pharmaceutique et biomédicale; RGS 90, entreprise de dépollution; Gyproc Nordic East, un producteur de panneaux de gypse; Soilrem A/S, une entreprise d’assainissement des sols; La municipalité de Kalundborg.
L’eau et la vapeur sont distribuées au moyen de pipelines. En effet, la centrale électrique
Aesnaes alimente la raffinerie Statoil en vapeur contre les eaux usées qu’elle utilise dans son processus de refroidissement. La centrale fournit également de la vapeur à la société Novo Nordisk, à la société Gyproc, et à la municipalité de Kalundborg qui l'utilise pour son système de chauffage urbain. L’eau de refroidissement chauffée formée par le procédé de condensation à la centrale électrique est envoyée à un site de pisciculture pour amélioration de sa productivité. Tandis que l'unité de désulfuration de ses gaz de combustion lui permet de fournir du gypse à Gyproc. Finalement, les dérivés de production tels que les cendres produites par la combustion de charbon, les boues du système public d’épuration ainsi que la biomasse de fermentation provenant de la manufacture pharmaceutique sont réutilisés de différentes façons, notamment comme fertilisants pour les fermes et pour la construction routière.
La figure suivante illustre les différentes synergies créées entre les acteurs de la symbiose à la suite des échanges d’eau, de déchets solides et d’énergie.

Figure 4 – Symbiose de Kalundborg, Danemark
3.8 ImpactsdelasymbiosedeKalundborg
Impactenvironnemental
Le tableau ci-après récapitule les économies réalisées en termes de consommation de ressources, d’émissions de gaz à effet de serre et de déchets recyclés :
Tableau 2 – Données (2010) de l’impact environnemental de la symbiose de Kalundborg
Réduction annuelle de la consommation de ressources
Quantité annuelle de déchets recyclés
Réduction annuelle des émissions
Pétrole 20 000 t Cendres volantes
65 000 t CO2 240 000 t
Azote 1 300 t Soufre 4 500 t SO2 380 t Eau 3 000 000 m3 Biomasse
liquide 280 000 m3 H2S 2 800 t
Phosphore 550 t Biomasse solide
97 000 t
Gypse 200 000 t

Bénéficeséconomiques
Peu d’études empiriques ont été menées pour quantifier les retombées économiques du phénomène de la symbiose de Kalundborg. Il en ressort ce qui suit :
150 000 tonnes de levures produites représentent 70 % de la nourriture destinée à l’élevage de 800 000 cochons (Orée, 2008).
84 000 000 euros investis par les différentes entreprises au fil des 30 ans d’existence de la symbiose permettent la réalisation d’un rendement annuel consolidé de 15 000 000 euros (Orée, 2008), ce qui a permis un retour sur investissement estimé à 5 ans.
FacteursclésdesuccèsdumodèledeKalundborg
Proximité géographique Possibilités de synergies créées par les entreprises en place Collaboration entre les acteurs principaux de la symbiose Instauration d’un climat de confiance entre les entreprises et les collaborateurs Incarnation d’un système de valeurs mettant l’emphase sur le développement industriel
durable par les différents acteurs Initiatives des entreprises privées Mobilisation des acteurs clés et incitation aux échanges et au dialogue Implication des institutions publiques locales dans la mise en place de la symbiose
3.9 LimitesdelasymbiosedeKalundborg
Selon Erkman (2004), on recense quatre principales limites à la symbiose de Kalundborg :
Rigidité : le nombre d’acteurs participant est très restreint. Ainsi, la typologie des coproduits pouvant être échangés est relativement faible;
Vulnérabilité : tout changement de procédé d’une des industries peut inhiber le fonctionnement d’une ou de plusieurs synergies;
Imperméabilité : il est très difficile pour les petites et moyennes entreprises de s’intégrer à cette démarche à cause du faible volume de coproduits qu’elles sont susceptibles de générer ou d’utiliser;
Dépendance à une activité très émettrice de gaz à effet de serre (GES) : la centrale électrique est au cœur de cette symbiose en participant à 10 synergies industrielles.
L’économie circulaire nécessite la coopération des acteurs économiques, des changements organisationnels et de l’innovation.
Afin de pousser les analyses des différentes entreprises un peu plus loin. Nous avons regroupé celles-ci dans un tableau qui comporte trois dimensions :
Implication privée/gouvernementale : l’exemple cité demande plus une implication privée de l’entreprise à la base ou nécessite plus une implication gouvernementale.
Approche organisationnelle/technologique : cette approche demande d’être plus axée sur comment l’organisation doit prendre forme ou plus sur des technologies à implémenter dans l’entreprise.

Nombre d’interactions de l’entreprise/concept : l’entreprise interagit avec combien d’autres parties prenantes pour assurer le bon fonctionnement d’un tel concept.
Voici le résultat obtenu :
Figure 5 – Matrice des exemples nordiques réussis en fonction du nombre d’interactions
Comme nous pouvons le constater, l’économie de fonctionnalité n’est qu’un premier pas vers un état de symbiose. On voit ici clairement que Philips et Floow2 se retrouvent excentrés. De plus, plus les entreprises entament une implémentation graduelle de l’économie circulaire plus les cercles se dirigent vers le centre, un état symbiotique. Cela montre plusieurs choses : premièrement, la symbiose demande à la fois que l’approche soit organisationnelle afin d’assurer le bon fonctionnement des nombreuses interactions entre les parties prenantes, mais aussi technologique dans le sens où ces échanges sont réfléchis et doivent pouvoir être utilisés et transportés correctement d’une entreprise à l’autre. Deuxièmement, la Symbiose de Kalundborg est avant tout une réussite grâce à l’implication de la municipalité locale. En revanche, c’est tout une région qui vit et stimule l’expansion de cette symbiose depuis ses débuts. En ce sens, on voit que les implications dans le cas présent viennent des deux côtés.
Finalement, on voit que plus ces interactions sont nombreuses, plus les entreprises se retrouvent au centre du tableau. Cela montre clairement la nécessité de travailler avec l’autre, de mettre en place une atmosphère d’échanges basée sur la confiance et le partenariat. En clair, penser économie circulaire demande de s’ouvrir aux autres, de communiquer, mais surtout avoir la confiance des parties prenantes et vouloir travailler avec l’autre en partageant un objectif commun. Ces échanges permettront de produire des synergies qui viendront améliorer l’impact de l’écologie circulaire, conciliant plus efficacement impératifs économiques et écologiques.

Cependant, fort de ces constats, une question reste sans réponse : la taille de l’entreprise influence-t-elle la position de l’entreprise sur ce schéma? Pour répondre à cette question, la dimension interactions a été remplacée par la taille de l’entreprise, symbolisée par ses fonds propres. Voici le résultat obtenu :
Figure 6 – Matrice des exemples nordiques réussis en fonction de la taille de l’entreprise
Comme on peut le remarquer, les entreprises ayant plus une approche basée sur la technologie auront une taille, en moyenne, plus importante que celles ayant une approche plus organisationnelle. Cela peut s’expliquer par le fait que l’approche technologique demande beaucoup plus de ressources que l’approche organisationnelle. De plus, si l’on compare la matrice du haut avec celle-ci, on constate que le nombre d’interactions n’est, visiblement, que peu influencé par la taille de l’entreprise. En somme, ces interactions seraient plus le fruit d’une volonté d’ouverture qu’un besoin de s’interconnecter après l’atteinte d’une certaine taille. Cela vient conforter l’idée que le nombre d’interactions est avant tout une volonté propre à l’entreprise, quelle que soit sa taille.
Cependant, ces matrices ne constituent qu’une ébauche de réflexion. En effet, les différentes positions occupées par les entreprises ont été décidées à la suite de l’analyse des rapports financiers, des rapports de responsabilité sociale des entreprises ainsi que des différentes approches ou concepts implémentés au sein de celles-ci.

4 CONCLUSION
Les entreprises nord-européennes, conscientes des impératifs écologiques auxquels le monde est aujourd’hui confronté, multiplient les initiatives. Elles ne se contentent pas de faire quelques efforts en matière d’environnement, mais elles transforment leurs organisations et leurs processus, grâce à davantage d’innovation et de coopération avec les différents acteurs économiques. Ainsi, elles réduisent de manière considérable leurs impacts environnementaux tout en multipliant les bénéfices économiques (revenus supplémentaires, réduction des coûts, croissance durable, nouvelles opportunités, etc.).
En instaurant les principes de l’économie circulaire, ces entreprises participent à la transformation de leurs industries, du monde des affaires, mais aussi des pays dans lesquels elles opèrent. À l’instar de Novo Nordisk qui, via sa volonté de s’approvisionner à 100 % en énergie renouvelable, contribue à cette transition dans l’ensemble du Danemark. Bien sûr, ces initiatives ont un coût, cependant on peut voir au travers des nombreux exemples développés que l’investissement est très vite rentabilisé.
Cependant, l’application des principes de l’économie circulaire nécessite un cadre favorable. Si le modèle nordique, qui consiste en un équilibre entre gouvernement, société et entreprises, offre le dynamisme économique et les infrastructures nécessaires au changement vers l’économie circulaire, qu’en est-il des autres zones du monde? Notamment dans les pays en développement où la culture du développement durable est très peu présente?
En effet, les entreprises dont nous parlons sont des entreprises globales. Or, dans leur démarche pour concilier au mieux impératifs écologiques et économiques, elles se heurtent à des difficultés, notamment dans les pays en développement du fait du manque d’infrastructures et de la faible culture du développement durable. De plus en plus, elles imposent leurs standards à leurs fournisseurs ou à leurs partenaires étrangers, et investissent en accord avec les gouvernements locaux dans la construction de nouvelles infrastructures, transmettant alors leurs bonnes pratiques.
Ainsi, le modèle nordique constitue un modèle économique équilibré, qui se présente comme un modèle inspirant faces aux impératifs et enjeux d’aujourd’hui. En ce sens, les entreprises globales des pays d’Europe du Nord s’imposent comme des ambassadeurs de ce modèle à travers le monde. On peut espérer que leur influence à l’étranger conduira à une nouvelle révolution industrielle, celle de l’économie circulaire.

5 RÉFÉRENCES
Articlesdejournauxourapports
Chertow M., Ashton W., Kuppalli R. (2004). The Industrial Symbiosis Research Symposium at Yale: Advancing the Study of Industry and Environment. Yale school of forestry & environmental studies. Rapport n° 3, Yale Publishing Services Center, p.41.
Dain A. (2010). Analyse et évaluation de la pérennité des démarches d’écologie industrielle et territoriale. Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de Sherbrooke.
Ehrenfeld J., Gertler N. (1997). Industrial ecology in practice.The Evolution of Interdependence at Kalundborg. Journal of industrial ecology, Massachusetts Institute of Technology.
Nordlund V. (2011). Le modèle nordique. Global Utmaning N.B Jacobsen (2006). Industrial symbiosis in Kalundborg, Danemark: A quantitative assessment
of economic and environmental aspects. Journal of Industrial Ecology (1-2), p. 239-255.
Livres
Ali-Yrkkö J., Rouvinen P. et Ylä-Anttila P. (2011). Le modèle nordique et les défis associés aux chaînes de valeur mondiales. ETLA Institut de recherche de l’économie finlandaise
Le Moigne R., (2014). L’économie circulaire : Comment la mettre en œuvre dans l’entreprise grâce à la reverse supply chain?
Chapitresdelivres
Sapir, A. (2006). Globalization and the Reform of European Social Models. Journal of Common Market Studies, vol. 44, no 2, p. 369-390.
Kessler N. (2009). Scandinavie. Paris, Presses Universitaires de France, 406 p. Lidskog, R. et Elander I. (2011). Le développement durable en Suède : la rhétorique, les
politiques et la pratique. Télescope, vol. 17, n° 2, p. 71-91. Philippe R. et al. (2005). Écotechnologies et écoconception : concepts et mise en œuvre.
Ingénieries, n°42, p. 55-70.
PublicationsInternet
Batenbaum J.C. (2009). Ercsson et TeliaSonera évoluent vers une fabrication sans plomb. Actualité News Environnement [consulté le 04/11/2014].
Bertels S. (2011). Ancrer le développement durable dans la culture organisationnelle. Université Simon Fraser et REDD.
Blaise R. (2008). L’Europe du Nord, modèle politique pour l’Union européenne ?. Le Taurillon C. Adoue et L. Georgeault. Écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, positionnements
et perspectives communes [version électronique]. Guizien D. (2011). L'ONUDI s'allie à Statoil : accès du monde en développement à l'énergie
propre [consulté le 08/11/2014]. H&M, (2013) Sustainability report, H&M [consulté le 06/11/2014].

Kumar S. et Putnam V. (2008) Cradle to cradle: Reverse logistics strategies and opportunities across three industry sectors. . International Journal of Production Economics, Volume 115, Issue 2, Pages 305–315 [consulté le 17/11/2014].
Latieul S. (2012). Neste Oil veut produire du diesel à partir de déchets. Formule Verte [consulté le 08/11/2014].
Loisel M. (2012). Le modèle scandinave démythifié. Jobboom Milne R. et Ward A. (2009). Le modèle scandinave ? Pas si idéal que ça. Courrier International
[consulté le 12/11/2014]. Food and Agriculture Organization, (2013). Innovations dans le secteur forestier européen :
tracer un chemin vers une économie verte. Youtube [consulté le 20/10/2014]. McDonough W. et Braungart M. (2007) Cradle-to-cradle design: creating healthy emissions – a
strategy for eco-effective product and system design, Abstract. Journal of Cleaner Emission, volume 15 [consulté le 19/11/2014].
Metsähallitus (2014). Projects, The Finnish Nature Centre Haltia – featuring Finland’s natural treasures under the same roof [consulté le 20/10/2014].
Novo Nordisk, (2010) The blueprint for change programme, Facing up to the climate change. Site de Novo Nordisk [consulté le 05/11/2014].
Gouvernement du Canada (2014). Les marges d’exploitation des produits du bois augmentent, Coupes Sélectives [consulté le 15/11/2014].
Stora Enso (2013). Global Responsibility Report. Stora Enso [consulté le 11/11/2014]. Stora Enso (2013). Financial Report 2013. Stora Enso [consulté le 11/11/2014]. Orée (2008). Ecologie industrielle et territoriale. [consulté le 12 novembre 2014]. Orée (2008). Ecologie industrielle. [consulté le 12 novembre 2014]. Raynault M. F. (2010). Le développement durable dans les villes nordiques. Centre Léa-Roback Site de ACCID. Mobilité durable. [consulté le 04/11/2014]. Site ADR.com [consulté le 16/11/2014]. Site de la Banque Mondiale [consulté le 11/11/2014]. Site du Central Intelligence Agency. The World Factbook [consulté le 11/11/2014]. Site de Dansk Bank. Environment [consulté le 03/11/2014]. Site de l’Énergie d’Avancer. Eolien offshore : Statoil commande 67 éoliennes à Siemens
[consulté le 20/11/2014]. Site de FLOOW2 [consulté le 28/10/2014]. Site de la Fondation Ellen MacArthur. Case Study. Maersk Line [consulté le 10/11/2014]. Site de la Fondation Ellen McArthur. Symbiose industrielle de Kalundborg [consulté le
12/11/2014]. Site de la Fondation Ellen MacArthur. Le projet collaboratif établi entre Philips et
TurnToo illustre l’un des tout premiers exemples du modèle «Pay-per-lux». [consulté le 08/11/2014].
Site du Gouvernement du Québec. À propos du développement durable [consulté le 11/11/2014].
Site Heritage.org [consulté le 11/11/2014]. Site de l’Index Mundi [consulté le 11/11/2014]. Site d’Inex eco system exchange. Kalundborg, cas d’économie circulaire. [consulté le
12/11/2014]. Site de Kalundborg symbiosis [consulté le 12/11/2014]. Site de Maersk. Sustainability [consulté le 03/11/2014].

Site de MBDC. C2C Framework [consulté le 03/11/2014]. Site de l’OCDE [consulté le 11/11/2014]. Site de economiedefonctionnalite.fr pour exemple Electrolux [consulté le 24/10/2014]. Site Danisco. Food & Beverages [consulté le 22/10/2014]. Site UPM. Home [consulté le 22/10/2014].

EXPÉRIENCES DES ENTREPRISES EN AMÉRIQUE DU SUD
Diva Berethet Karim Douieb Samuel Gouin Jean Paumier
Thomas Poirier
Résumé
Les pays d’Amérique du Sud font face à de nombreux défis en matière d’environnement, tels que la pollution de l’air, la dégradation des terres et la déforestation. De plus, la croissance économique rapide de cette région, sa forte dépendance envers ses ressources naturelles ainsi que sa faible capacité à investir dans des technologies vertes rendent très difficile la conciliation des impératifs écologiques et économiques. Dans cette étude portant sur trois entreprises situées en Argentine, au Brésil et au Chili, nous mettons en lumière des exemples d’innovation et de réussite en matière d’écologie, et nous tentons de montrer les leçons que l’on peut en tirer. Le producteur de biodiesel argentin Oil Fox, qui est notre premier exemple, a adopté des mesures concrètes afin de lutter contre les problèmes de déforestation, d’usure des sols et de l’utilisation accrue d’OGM. Au niveau du Brésil, nous exposons le cas de l’entreprise Agropalma, un producteur d’huile de palme ayant implanté des mesures pour combattre la déforestation de la forêt amazonienne, la baisse de rentabilité due aux facteurs environnementaux et la décrédibilisation de l’industrie de la palme causée par son impact sur l’environnement. Finalement, pour notre troisième exemple, nous présentons l’entreprise viticole chilienne Miguel Torres, qui a misé sur la diminution de la consommation d’énergie polluante, l’utilisation de bouteilles utilisant moins de verre et la lutte contre la déforestation entraînée par la plantation des vignes.
INTRODUCTION
La notion de développement durable allie les dimensions économique, environnementale et sociale qui permettent de répondre aux problèmes écologiques. Malgré la crise financière de 2008, l’Amérique du Sud présente des résultats encourageants vers un développement durable. On assiste ainsi à une progression du sous-continent avec de nouvelles initiatives vertes visant à préserver la nature. Avec la mondialisation néolibérale, l’Amérique du Sud se reconvertit en une économie centrée sur les exportations. Elle est, de ce fait, un continent en développement mettant en exergue des activités agricoles, industrielles… dans des pays comme l’Argentine, le Brésil, et le Chili, sur lesquels nous avons choisi de porter notre étude.
En termes de développement écologique, les trois pays ci-dessus cités connaissent quelques difficultés notamment en matière de déforestation, la pollution de l’eau, la dégradation des sols et la menace de la biodiversité. Nonobstant ces difficultés, les trois pays ont su se distinguer par des réussites dans le domaine agricole et énergétique. Ainsi, plusieurs techniques novatrices ont été mises en place par les entreprises afin d’améliorer la situation économique et écologique de l’Amérique du Sud. Afin de mieux mener notre étude, elle sera effectuée en deux volets : la première est une mise en contexte des défis écologiques réels en Argentine, au Brésil et au Chili, la seconde porte essentiellement sur des exemples de « success stories » réalisées dans ces trois pays.

1 DÉFISÉCOLOGIQUESENAMÉRIQUEDUSUD
Les pays émergents et en développement partagent certaines caractéristiques et certains problèmes communs en matière d’environnement. Premièrement, la mondialisation du commerce a multiplié et déplacé vers ces pays plusieurs phases de production des biens de consommation. De plus, à cause de ses richesses naturelles, l’Amérique du Sud est un gros fournisseur de matières premières, d’aliments et d’énergie pour les pays développés. En même temps, les pays développés essaient de transférer les coûts environnementaux des industries les plus « sales » aux pays d’Amérique latine (Sabbatella 2010). Cela rend difficile la conciliation des impératifs économiques et écologiques, d’autant plus que les gouvernements ont une certaine pression à soutenir l’activité industrielle afin d’assurer la poursuite du développement économique et l’augmentation du niveau de vie de la population. La majorité des programmes de subvention soutiennent l’extraction et la consommation des ressources, alors qu’il y a peu d’incitatifs à l’utilisation efficace des ressources et à l’adoption de comportements écoresponsables.
De plus, l’essor économique de plusieurs pays d’Amérique du Sud au cours des dernières décennies a donné lieu à l’émergence d’une classe moyenne, représentant aujourd’hui 30 % de la population de cette région (World Bank, 2014). Celle-ci a vite adopté des habitudes de consommation semblables à celles des pays développés. Par contre, le niveau de sensibilisation quant au danger des rejets de déchet et à l’importance de la réutilisation et du recyclage reste faible (Dufour, 2014). On dénote donc un retard au niveau de la culture du développement durable par rapport aux pays plus développés.
Puisque les gouvernements et les entreprises ont généralement peu de moyens financiers, leurs investissements en R&D sont également limités. Ainsi, leurs méthodes de production et d’acquisition de capital technologique reposent principalement sur la reproduction de technologies dites « matures » dans les pays industrialisés, qui sont souvent intensives en utilisation des ressources et reposent sur une logique linéaire (Dufour, 2014).
Étant donné la grande diversité des pays qui composent l’Amérique du Sud, nous avons choisi de focaliser sur trois pays : le Brésil, l’Argentine et le Chili. Le choix de ces pays est basé sur la taille de leur économie, leur population ainsi que les caractéristiques qui les différencient les uns des autres, telles que la structure de l’économie, le taux de pauvreté, etc. Voici quelques données socioéconomiques de ces trois pays :
Brésil Argentine Chili Population (estimation 2014) 202 656 788 43 024 374 17 363 894 PIB en parité du pouvoir d’achat (2013)
2 416 G$ 771 G$ 335 G$
PIB/habitant 12 100 $ 18 600 $ 19 100 $ Taux de croissance du PIB (2013) 2.3 % 3.5 % 4,4 % Population vivant sous le seuil de pauvreté
21,4 % 30 % 15,1 %
Source : The World Factbook, Central Intelligence Agency (U.S.)

1.1 Brésil
Avec une vaste exploitation de ses ressources naturelles et un important bassin de main-d'œuvre, le Brésil est le leader économique de l’Amérique du Sud ainsi qu’un des principaux pays émergents. À l’heure actuelle, le Brésil est la 7e puissance mondiale en termes de GDP (World Bank, 2013), et est, selon le World Economic Forum (WEF, 2013), un pays au 2e stade de développement, la dernière marche avant d’être considéré comme un pays pleinement développé. Son économie est dominée par l’agriculture, l’exploitation minière, le secteur manufacturier et les services. Les exportations de produits et services représentent 12,6 % du PIB et augmentent à un taux de 5,9 % annuellement (prévision 2012-16), ce qui en fait la principale source de croissance (World Bank, 2014). Les principaux produits exportés par le Brésil sont : les produits agricoles (35,6 %), les produits manufacturés (33,8 %) ainsi que le pétrole et les produits miniers (27,0 %) (MDEIE, 2014).
Le pays fait face à de nombreux problèmes au niveau environnemental, dont celui de la déforestation en Amazonie, mettant en péril plusieurs espèces végétales et animales. À cela s’ajoute la pollution de l’air dans les grandes villes, la dégradation des terres, la pollution de l’eau causée par des activités minières inappropriées et la détérioration des milieux humides (CIA, 2014). En termes de développement écologique, le Brésil se classe au 77e rang mondial, selon le classement de l’Environmental Performance Index (2013), sur 178 pays. Le pays a réussi à améliorer son indicateur de 3,72 % en 10 ans. Selon cet indice, qui évalue plusieurs éléments, les principaux problèmes du Brésil se situent au niveau de la déforestation, de l’épuisement des réserves d’eau potable et du traitement des eaux usées.
1.2 Argentine
L’Argentine est caractérisée par une grande quantité de richesses naturelles, un secteur agricole très développé et orienté vers l’exportation, et une base industrielle diversifiée. Les exportations de produits et services représentent 19,7 % du PIB (2012), ce qui représentait une baisse de 6,6 % par rapport à 2011. Cela est attribuable à la décélération de l’économie de l’Argentine ayant conduit à son entrée en récession au début 2014 (Coface, 2014). Les produits agricoles (bruts et manufacturés) représentent 56 % des exportations totales. La reprise économique repose donc en partie sur les exportations de produits agricoles (Université de Sherbrooke, 2014). Le pays est touché par des problèmes environnementaux typiques aux pays en phase d’industrialisation, tels que la déforestation, la dégradation des sols, la désertification ainsi que la pollution de l’air et l’eau. Cependant, l’Argentine est perçue comme un leader mondial dans l’établissement volontaire de cible d’émission de gaz à effet de serre (CIA, 2014). Toujours selon l’Environmental Performance Index, l’Argentine se place au 93e rang sur 178 pays. Ses principales faiblesses résident au niveau de la gestion des ressources d’eau potable, de la déforestation, du climat et de l’énergie.
1.3 Chili
Concernant le Chili, il s’agit de l’un des pays les plus stables et les plus prospères d’Amérique du Sud. Quatrième économie sud-américaine derrière le Brésil, l’Argentine et la Colombie, son PIB par habitant est le plus élevé de la région. L’économie chilienne est fortement orientée vers l’exportation de matière première. Le Chili est aussi un leader mondial dans l’extraction et l’exportation du cuivre.

Les exportations de produits et services représentent 32,7 % du PIB (2013) et sont composées en grande partie de pétrole et de produits miniers (60,4 %) et de produits agricoles (24,2 %) (MDEIE, 2014). L’économie du Chili est donc fortement dépendante de l’extraction de ses ressources minières. Au niveau écologique, les ressources naturelles du Chili sont menacées par la déforestation et l’extraction minière intensive. Le pays fait aussi face à un problème de pollution de l’air causé par l’activité industrielle et l’émission par les véhicules, et de pollution par les eaux usées (CIA, 2014). L’Environmental Performance Index place tout de même le Chili au 29e rang, ce qui en fait de loin le pays sud-américain le plus performant en termes d’écologie.
Les exemples du Brésil, de l’Argentine et du Chili nous montrent à quel point les pays d’Amérique du Sud dépendent de leurs ressources naturelles pour le maintien et la croissance de leur économie. Il apparaît aussi évident que cette croissance comporte un prix. En plus de mettre en péril leur propre environnement, les pays d’Amérique du Sud risquent de contribuer de plus en plus aux changements climatiques à l’échelle mondiale, dû à leurs émissions de gaz à effet de serre.
1.4 Mesuresincitativespubliques‐privéesenAmériqueduSud:lemodèledesPSE
Pour structurer et donner plus de consistance aux multiples initiatives (somme toute éparses), de conciliation entre écologie et croissance, des partenariats public-privé ont donné naissance au modèle des PSE (Paiements pour Services Environnementaux).
Tout, en fait, est parti du constat que les réalisations écologiques n’étaient pas évaluées monétairement et que par conséquent, elles ne donnaient lieu à aucune motivation durable pour être poursuivies. C’était là, un élément inhibiteur pour tout développement d’un nouveau modèle écologique régional. La condition sine qua non de réussite de ce modèle passait indéniablement par le fait qu’il ne devait n’être ni imposé, ni calqué sur les modèles occidentaux et encore moins conditionné par des prêts financiers internationaux.
Les PSE sont donc des transactions volontaires et contractuelles entre au moins un acheteur et un vendeur d’un service environnemental bien défini (ou bien d’une pratique agricole ou foncière bien définie) qui débouchent sur un paiement (monétaire ou non) conditionné au respect des termes du contrat sur une période déterminée (1).
En fait, la logique qui sous-tend ce concept est que grâce à une disposition institutionnelle ou une transaction financière, il est possible de s’attaquer plus efficacement aux externalités environnementales négatives. Le champ d’application s’est plus particulièrement concentré sur la protection des ressources en eau, la conservation de la biodiversité et la séquestration du carbone.
Par ailleurs, il n’est pas anodin de signaler que l’Amérique du Sud joue un rôle précurseur dans le domaine des PSE : selon Natasha Landell-Mills and Ina Porras de l’International Institute for Environment and Development (IIED) de Londres, la plupart des 300 initiatives PSE au niveau mondial en 2012 ont été prises en Amérique latine grâce à une présence d’institutions opérationnelles et à un mécanisme de financement efficient. Les sources de financement répertoriées sont multiples : dons, subventions des organismes nationaux et internationaux, fonds gouvernementaux, paiements des bénéficiaires, mécanismes du marché…

Aujourd’hui, un premier bilan d’étape se profile et peut se résumer de la sorte :
Même si les coûts sont conséquents (coûts de transactions, coûts d’opportunités et coûts de développement), le « bottom line » (résultat net) des PSE reste globalement positif.
Les PSE ne sont pas la panacée, mais peuvent devenir des outils plus efficaces si l’on dépasse la logique de la compensation du seul coût d’opportunité (manque à gagner causé par la réalisation écologique).
2 EXEMPLESDE«SUCCESSSTORIES»
2.1 Expérienced’uneentrepriseargentine:OilFoxS.A.
Enjeuxécologiquesdel’industrie?Focussurnosparticularitésenvironnementales
Présentation de l’industrie
Le Brésil et l’Argentine sont deux producteurs significatifs de biocarburant. L’Argentine est depuis 2000 un producteur important d’huile brute de soja, principalement prévue pour l’exportation, et le principal fournisseur mondial de la demande grandissante de biodiesel. En 2011, la production mondiale de biodiesel s’élevait à environ 24 milliards de litres, et était projetée pour 2014 à plafonner à un peu moins de 30 milliards de litres (OCDE, 2011). En 2011, l’Argentine a produit 2.4 millions de tonnes de biodiesel, desquelles 1.5 million de tonnes ont été exportées. Le marché national ne consommant environ qu’un quart de la production totale de biodiesel argentine (Guibert & Carrizo, 2012).
Point économique
La volonté du gouvernement d’accentuer la production de biocarburants s’articule particulièrement sur des objectifs économiques de réduction des coûts de l’énergie, notamment l’importation de gazole, mais aussi autour de politiques de création d’emplois et de développement économique des régions pas encore assez compétitives à l’échelle nationale. La situation économique est encore fortement influencée et contrôlée par le gouvernement argentin qui est à l’initiative du cadre réglementaire établi pour réguler le marché des biocarburants. Les avantages qui ont pu en être tirés concernent la promotion des économies régionales, des petits et moyens producteurs et des PME liées à la filière. Il existe aussi des incitatifs fiscaux, tels que l’exonération d’impôts sur les investissements réalisés par les producteurs. Enfin, le cadre réglementaire fixe la répartition entre les producteurs des différentes régions et des volumes de biocarburants nécessaires à l’industrie pétrolière qui se charge de faire les mélanges avec le carburant fossile avant utilisation. Le pouvoir en place s’efforce donc de faire de l’industrie du biocarburant, une industrie forte et influente qui à long terme sera bénéfique pour l’Argentine tant sur le voile économique, social, mais également environnemental.
Point écologique
L’enjeu principal qui s’illustre à l’échelle mondiale est l’augmentation de la population. Elle pousse au renforcement des capacités de productions en énergie tout en respectant l’environnement;

La politique environnementale du gouvernement argentin a été dynamisée depuis 2002 par l’implémentation de la loi générale sur l’environnement. Cette dernière vise à améliorer la qualité de l’eau (particulièrement dans les zones urbaines) et à résoudre les problèmes inhérents à l’environnement (POLLUTEC, 2012);
Les objectifs fixés sont énergétiques et environnementaux. Le gouvernement mise beaucoup sur l’incorporation de nouvelles sources locales pour la production de biocarburants et d’électricité, et par la même action, contribue à la réduction d’émission de gaz à effet de serre;
Cependant, l’Argentine a été au cœur de débats sur les effets négatifs de la culture de soja transgénique, ainsi que de la fabrication de biodiesel à base de soja. La croissance et l’expansion des productions de soja causent la dégradation des sols, la déforestation (car il faut trouver de nouvelles terres exploitables) et l’utilisation croissante d’OGM pour accroître les rendements. Également, le fait d’utiliser des terres cultivables qui pourraient être destinées à l’alimentation des hommes, pour en faire du biocarburant, entache l’éthique de communautés qui se penchent sur le sujet (Alvarado,2007).
Ces questions écologiques inhérentes à l’alternative qu’est le biocarburant, tentent d’être prises en comptes par des acteurs locaux tels que Oil Fox, qui a décidé de basculer à terme sur la culture d’algues qui pourraient remplacer le soja, ou encore l’utilisation d’huiles usées pour fournir une solution au problème de déforestation et d’usure agressive des sols. Néanmoins, le projet est en cours de lancement et ne prendra de l’importance que dans quelques années.
Exempled’entrepriseayantconciliésuccèséconomiqueetenvironnemental:OilFoxS
Présentation de l’entreprise
Oil Fox part de l’initiative d’un groupe de professionnels concernés par les problèmes environnementaux et énergétiques. Étant convaincues que des solutions pouvaient être apportées en mettant en avant leurs savoirs technique et commercial et leurs expériences dans le domaine, ces personnes ont décidé de mettre en place un projet de développement de biocarburant en Argentine. C’est dans ce sens qu’Oil Fox est née (OIL FOX, 2014). L’entreprise est aujourd’hui une force conductrice dans la création de biodiesel, cependant, elle se limite principalement au marché national (environ 50 000 tonnes par an). Elle apporte une contribution plus écologique aux activités de transports (urbains, cargo/fret et autres) et aux activités agricoles.
Pourquoi cet exemple? En quoi répond-il aux problèmes écologiques et économiques de cette industrie?
Oil Fox est un acteur encore relativement petit, mais qui a déjà compris les rebondissements qu’il faut considérer pour se persévérer dans cette industrie. Les problèmes liés à la production de soja (dégradation des sols, déforestation, et utilisation d’OGM) vont se perpétuer et devenir un obstacle grandissant à la production de biocarburant à base de soja.

La mission et la vision de l’entreprise s’articulent particulièrement dans la mise en place d’usine capable de produire un biodiesel fait à base d’algues (pour l’instant, cela reste une petite proportion) et de soja plus majoritairement. À terme, l’entreprise souhaite inverser la tendance. Oil Fox s’intègre également dans la politique mise en place par le gouvernement, qui vise à réduire le coût des importations de gazole et à augmenter l’utilisation de biocarburant sur le territoire national pour limiter la dépendance.
Mesuresprises:sacrificesetbénéfices(Oilfox,2014)
Problèmes Mesures entreprises Avantage Désavantages
Déforestation croissante
Basculer à terme sur l’utilisation d’algues afin de remplacer le soja comme source de production de biodiesel.
- Présente une alternative à la culture massive de soja
- Engendre de nouveaux coûts pour tous ceux qui veulent utiliser cette méthode.
Usure des sols
La culture de l’algue sera notamment entreprise dans des espaces maritimes. Une fois l’huile extraite de l’algue, le reste peut être utilisé pour la consommation animale après analyse.
- Réduit/élimine l’utilisation des sols - Libère les sols de l’utilisation de pesticides et autres agents toxiques - Exploite une opportunité
- Pas d’idée de l’impact de la culture d’algue dans les eaux - Le coût attribué à la mise en place de nouvelles zones de culture en eau.
Utilisation accrue
d’OGM
L’utilisation de l’algue sera plus bénéfique à l’entreprise, car elle se développe très vite
- Gain de temps dans la réalisation du biodiesel, car les algues mettent moins de temps à se développer que les pousses de soja - Une production plus performante
- Une réévaluation du système de production - Ajustements matériels, techniques et financier pour être opérationnel
Effets négatifs sur
les populations
rurales environnantes
Une attention spéciale sera portée aux populations environnantes, des initiatives telles que la création d’écoles.
- Si les politiques mises en place par l’entreprise fonctionnent, une résistance réduite à ses opérations de la part des populations environnantes
- L’entreprise va devoir être très méticuleuse et rigoureuse dans le cadre de la production de son biodiesel afin de ne pas causer de dégâts écologiques

Le gaspillage de ressources et le manque
d’énergie pour la
population
L’entreprise produit du biogaz à base de matière organique anaérobique digérée pour s’autoalimenter en électricité. Cette matière permet de nourrir également les algues. De plus, l’entreprise utilise la lumière artificielle à LED pour faire croître les algues durant la nuit.
- Dans ce sens, Oil Fox est indépendante et se fournit sa propre énergie - Peut à l’avenir produire de l’électricité pour les communautés environnantes - Conforte sa place d’acteur respectant l’environnement argentin
- Limite l’entreprise sur un plan de productivité. Pour penser à exporter, Oil fox va devoir sacrifier son autosuffisance pour satisfaire sa demande croissante d’énergie, proportionnelle avec son volume croissant de production
Les problèmes liés à l’eau
Oil Fox n’utilise pas d’eau pour laver et purifier le biocarburant. L’eau de pluie est réutilisée pour l’arrosage des parcs de culture. Après la culture d’algues, l’eau est potable et donc réutilisable.
- L’entreprise réduit ses coûts en eau et électricité en procédant de la sorte - Le gaspillage est réduit
- Capacité de production réduite, une hausse de la demande impliquera une hausse du besoin d’eau pour cultiver les algues
Conclusion:quemontrecetexemple?Quefaut‐ilenretenir?
L’exemple d’Oil Fox illustre la volonté de plusieurs personnes de répondre aux questions environnementales du contexte local et d’aider leur pays à être plus respectueux de son environnement. Initié par le gouvernement, la dynamique de changement pour une économie plus saine et bénéficiant au plus grand nombre s’inscrit comme un enjeu principal chez Oil Fox. Comment répondre aux besoins croissants en énergie de l’Argentine, tout en réduisant son empreinte CO2, tel est le challenge que s’est fixé Oil Fox.
En prenant en compte tous les facteurs cités plus haut, Oil Fox a su coupler intérêts économiques et respect de l’environnement à ses activités. L’entreprise s’inscrit sur une démarche de long terme, pour devenir encore plus performante dans la production de biocarburants tout en étant un modèle de bonnes pratiques utilisées pour réaliser son produit.
2.2 Expériencesd’uneentreprisebrésilienne:Agropalma
Enjeuxécologiquesdel’industrie?Focussurnosparticularitésenvironnementales
Présentation de l’industrie
L’industrie brésilienne de l’huile de palme, en 2013, produit environ 340,000 tonnes, ce qui classe le pays 11e producteur mondial (IndexMundi, 2014). Cela représente 0,53 % de la production mondiale, loin derrière l’Indonésie et la Malaisie qui représentent 86 % de la production mondiale. La croissance de la production brésilienne est très forte, en effet, entre 1998 et 2013, elle progresse de 265 %.

L’exportation de l’huile de palme représente 12 % de la production ce qui est peu. De plus, le cours de l’huile de palme sur les marchés tend à baisser et est très volatile, mais est globalement croissant passant de 467 dollars US en janvier 2004 à 769 dollars US dollars en janvier 2014 (IndexMundi.com, 2014). Une des particularités de la production Brésilienne est le fait que plus d’un quart de sa production est certifiée Roundtable on Sustainable Palm Oil. Cette partie de la production ne nuit pas à l’environnement (IIDS, 2014).
Point économique
La culture de la palme permet des rendements élevés, mais reste difficile à cultiver pour deux raisons : son cycle de production est long et la palme nécessite beaucoup d’attention afin de se développer au mieux (FAO, 2010). Avec un rendement de 4 tonnes par hectare, contre 200 kg de viande par hectare pour la production bovine (Butler, 2011), l’huile de palme reste la céréale la plus rentable du monde. Elle permettrait aux producteurs d’autres céréales de la région de quintupler leurs revenus selon le gouvernement brésilien (Butler, 2011). De plus, la production d’huile de palme emploie plus de personnes que l’agriculture traditionnelle. Cela représente 1 personne employée pour 8 hectares de terre, contre 200 hectares de terre pour la culture du soja.
Le potentiel de développement de la palme au Brésil est très important puisque les estimations de terres permettant sa culture, 2,2 millions km2, alors que les deux plus grands producteurs du monde n’en cultivent à eux deux que 1,3 million de km2 (Butler, 2011).
Enfin, l’attrait de plus en plus grand des entreprises pétrolières pour les biocarburants démontre bien que la production de biocarburants venant de l’huile de palme semble être une alternative crédible aux énergies fossiles (Butler, 2011), qui plus est avec un prix du baril passé de 4,31 dollars US en 1973 (Rfi, 2008) à plus de 75 dollars US aujourd’hui (Bloomberg, 2014).
Point écologique
Le gouvernement brésilien souhaite développer le secteur de l’huile de palme de façon durable (Butler, 2010). La forêt amazonienne ayant à la fois toutes les caractéristiques pour accueillir cette production tout en permettant au Brésil d’être le pays à la plus grande biodiversité au monde (Butler, 2011 & CBD, 2014). Le plan lancé en 2010 par le gouvernement de Lula, le « Program for Sustainable Production of Palm oil », prévoit de subventionner, à hauteur de 60 millions de dollars US, les projets de culture de palme dans les régions agricoles abandonnées et dégradés (Butler, 2010). Il existerait, selon le gouvernement brésilien, 500 000 kilomètres carrés de ces terres. Ce plan a pour but de ne pas continuer de prendre des terres sur la forêt amazonienne. En plus d’avoir un impact économique, la plantation de palme sur ces parcelles qui ne sont plus utilisables pour d’autres cultures moins rentables. Elle permettrait aux agriculteurs locaux d’arrêter la déforestation dont le but est de trouver de nouvelles terres fertiles, et de planter sur des parcelles sans forêt, à la place, de la palme. L’avantage de la palme est d’être un arbre et non une plante, ce qui lui donnerait le même rôle de recycleur des émissions de CO2 que la forêt amazonienne et recréerait de la biodiversité (Butler, 2010). Enfin, cela permettrait au Brésil d’envoyer un message fort aux deux pays leaders de la production de palme, l’Indonésie et la Malaisie, qu’il est possible d’avoir une gestion durable de la production (Butler, 2011). Nous avons pu voir, après l’action de Greenpeace en 2008, que les consommateurs ont commencé à boycotter l’huile de palme, poussant Unilever à n’utiliser que de l’huile de palme certifiée RSOP (The economist, 2010). L’exemple d’Unilever sera rapidement suivi par 20 multinationales, fortement concernées par le problème de déforestation lié à la culture de la palme.

2.3 Exempled’entrepriseayantconciliéesuccèséconomiqueetenvironnemental:Agropalma
Nous allons évoquer le cas de l’entreprise Agropalma, détenue par un groupe d’investissement de São Paulo, et qui opère dans l’état du Para, une région qui comporte une forte diversité biologique (Drouvot & Magalhães, 2009). Cet exemple est intéressant, car il permet de comprendre comment une entreprise privée a su se développer économiquement dans le secteur de l’huile de palme tout en considérant la protection de l’environnement comme la clé de son modèle d’affaires.
Présentation de l’entreprise
Agropalma est une société brésilienne créée en 1982 sous l’impulsion du gouvernement à subventionner les projets d’investissements dans la région amazonienne. L’entreprise produit principalement de l’huile de palme et se pose comme le leader du marché. L’entreprise produit, à partir de ses récoltes, du biodiesel, des produits destinés à l’industrie alimentaire, et des produits destinés à l’industrie des cosmétiques. Le reste de sa production est revendu à de grands groupes agroalimentaires. Son développement s’est effectué via diverses acquisitions. On distingue deux types d’acquisitions, les intégrations verticales afin d’améliorer ses marges au sein de la chaîne de valeur de l’industrie (Compagnie de Raffinage d’Amazonie en 1997 et création de Vitapolina en 2002), soit via l’intégration horizontale visant à créer des synergies et à réaliser des économies d’échelles (Agromendes en 1989 et Coacara en 2000). L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 250 millions de dollars US en 2013 et compte 5000 employées (Agropalma, 2013).
Pourquoi cet exemple? En quoi répond-il aux problèmes écologiques et économiques de cette industrie?
Agropalma est le leader de la production d’huile de palme au Brésil (Butler, 2011) et possède l’accréditation RSPO, ce qui prouve que sa production est soutenable. De plus, l’entreprise, de par sa stratégie, cherche à améliorer ses marges sans faire aucune concession environnementale, l’entreprise ayant par exemple 60 000 hectares non exploités afin de préserver la biodiversité du site. La recherche de profit est axée sur l’intégration verticale et le développement de nouvelles technologies, plus que sur l’expansion massive de sa production. Cela permet à l’entreprise d’écouler sa production chez des clients qui souhaitent utiliser une huile de palme issue de l’agriculture soutenable tout en consolidant sa position de leader sur le marché. Cela en fait donc un bon exemple de succès économique d’une entreprise qui base son modèle économique sur la protection de son environnement.

Mesuresprises:sacrificesetbénéfices
Problèmes Mesures entreprises Avantages Désavantages
Déforestation de la forêt amazonienne.
Protéger 60 % des parcelles de forêts attribuées. Arrêt de la déforestation de la parcelle en 2001 et reforestation des zones dégradées
- Permet une sauvegarde de la biodiversité. - Permet une meilleure gestion de la fertilité des terres - Impact en CO2 négatif
- Une partie potentielle de la production ne peut être exploitée.
Décrédibilisation de l’industrie palmière à cause de son impact sur l’environnement
Obtention de l’accréditation RSOP Classement du meilleur producteur d’huile de palme dans le monde selon Greenpeace
- Permet de montrer aux clients potentiels d’Agropalma la pérennité de son modèle d’affaires - Donne une plus grande visibilité sur le marché
- Demande de mettre en place une stratégie totalement intégrée en matière de protection environnementale.
Baisse de la rentabilité à cause des considérations environnementales
Création de valeur par une intégration en aval de produits finis (margarine, biodiesel...).
-Permet d’utiliser les contraintes environnementales en atouts économiques
- Demande une stratégie à long terme
Utilisation de pesticides
- Mise en place de plantations biologiques (10,5 % de la production) - Utilisation d’insectes pour protéger naturellement les plants de palmes - Utilisation d’outils mécaniques pour l’épandage de pesticides
- Production plus saine. - Baisse des coûts liés à l’achat de pesticides.
Demande un investissement initial conséquent.
Utilisation de l’eau - Monitoring de la consommation des usines de transformation de la palme - Mise en place d’un système d’assainissement de l’eau - Réutilisation des eaux usées comme engrais.
- Moins d’eau prélevée dans les nappes phréatiques. - Pas de pollution des nappes phréatiques locales
- Investissement initial conséquent.

Augmentation des prix du pétrole
Développement de carburant diesel à base d’huile de palme.
- Augmentation des revenus de l’entreprise
- Demande des connaissances technologiques - Demande un fort investissement initial
Faible revenu des agriculteurs locaux
Mise en place d’un programme pour intégrer la production des agriculteurs locaux
- Augmentation des revenus de ces agriculteurs par rapport à la moyenne nationale - Augmentation de la production
- Augmentation des salaires et donc baisse des revenus de l’entreprise
Mise en danger d’espèces animales dans la forêt amazonienne
Mise en place d’un plan de recensement des espèces et de leur protection
- Sauvegarde de la biodiversité - Permet de rétablir l’équilibre initial de la forêt
- Aucun impact économique direct
Source : (Agropalma, 2013)
Avant de détailler la stratégie d’Agropalma, il nous faut revenir sur une définition de Elkington (1998), citée dans l’étude de cas (Drouvot & Magalhães, 2009). Cette définition souligne l’importance de trois points pour rendre la stratégie des entreprises durable, « l’économique, le social et l’écologique ». Prendre en compte ces trois aspects permettra, sur le long terme, d’obtenir un avantage sur les entreprises qui insistent seulement sur le profit.
Agropalma intègre toutes ses composantes dans son modèle d’affaires comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. D'un côté, les opérations d’intégration verticale permettent à Agropalma de dégager de plus fortes marges. De l’autre, l’intégration horizontale génère des économies d’échelles. Enfin, la semi-automatisation des récoltes baisse les coûts de production et la production augmente. Le bénéfice économique est clairement établi et la position dominante d’Agropalma sur le marché de la palme tend à prouver cette réussite. Du côté écologique, on note la présence de production d’huile de palme biologique, de biodiesel ainsi que la mise en place d’un plan de préservation de la biodiversité, puisque 60 000 hectares du site ne sont pas exploités et toute activité humaine y est interdite. Le biodiesel permet non seulement de produire du carburant à partir d’une source renouvelable, mais son bilan énergétique global est encore plus intéressant puisque la culture de l’huile de palme est plus pérenne que celle du soja et ne nécessite pas un usage lourd de pesticides. Enfin, la culture de l’huile de palme s’intègre très bien dans un climat tropical, puisque les palmiers n’ont pas leurs feuilles superposées, recréant ainsi un environnement favorable à la biodiversité.

Économique Social Écologique • Productivité :
semi-automatisation des récoltes.
• Économie d’échelles : augmentation des quantités de production avec l’intégration des familles (de petits agriculteurs locaux).
• Création de valeur par une intégration en aval de produits finis (margarine, biodiesel...).
• Possibilité d’obtention de crédits carbones.
• Fixation de la population locale en zone rurale.
• Amélioration des conditions de vie des travailleurs.
• Offre d’emplois salariés garantissant une protection sociale.
• Participation à la création d’infrastructure (agroville).
• Culture biologique ou cultures qui évitent les produits chimiques (engrais organiques, prévention évitant les insecticides).
• Vastes zones de forêts préservées.
• Reforestation des espaces dégradés.
• Production de biodiesel.
Source : (Drouvot & Magalhães, 2009)
À l’heure où l’huile de palme est de plus en plus décriée, la société Agropalma a réussi à crédibiliser sa démarche, en prouvant que la préservation des intérêts écologiques peut être en ligne avec l’aspect économique de la gestion d’une entreprise. De plus, l’entreprise a obtenu de nombreuses accréditations qui démontrent qu’écologie et économie ne sont pas incompatibles.
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 et FSSC 22000 : elles couvrent la qualité de la production, la qualité du management environnemental et la sécurité des employés et des produits.
Première entreprise brésilienne à obtenir la certification Roundtable on Sustainable Palm Oil et qui indique que toute la production est soutenable et pleinement renouvelable.
Enfin, l’entreprise possède 4000 hectares d’huile de palme certifiés commerce équitable et pleinement biologique.
Conclusion:quemontrecetexemple?Quefaut‐ilenretenir?
Ce cas nous permet de déterminer une typologie des actions à réaliser afin d’obtenir des résultats similaires dans d’autres parties du monde ainsi que dans d’autres secteurs. Drouvot et Magalhães (2009), après une analyse des forces qui entourent le contexte socio-institutionnel de l’entreprise Agropalma, ont déterminé les facteurs qui ont fait le succès de cette organisation. Ces forces sont les suivantes :
« Forces juridiques : la réglementation sur les cultures en Amazonie pour préserver en partie la forêt native. »;
« Forces sociales : l’influence de l’opinion publique et des médias sur le respect de la biodiversité en Amazonie. »;
« Forces du marché : la pression des clients auprès des fournisseurs d’huile de palme en termes de développement durable. »;
« Forces organisationnelles : la politique de RSE de la maison mère. » Source : (Drouvot & Magalhães, 2009)

Trois éléments importants ressortent de ce cas pour pouvoir reproduire cet exemple à d’autres couples d’industries pays, selon certaines solutions évoquées par les auteurs du cas. Le premier, découle de la volonté d’une entreprise de s’associer avec des petits producteurs locaux, via des associations pour développer sa responsabilité sociale (Drouvot & Magalhães, 2009). Le second est de trouver une activité qui est viable économiquement, et ne pas devoir subventionner de manière importante, pour favoriser l’innovation et la conquête de nouveaux marchés. Bénéficier de l’aide du gouvernement ou des institutions internationales, afin d’avoir des conditions aussi favorables que le reste des entreprises qui ne se soucient pas ou peu des répercussions écologiques. Enfin, il faut impliquer des spécialistes de la filière, comme c’est le cas d’Agropalma qui a reçu l’aide de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro qui a permis le développement du biodiesel.
Au-delà de cet exemple, il nous faut comprendre que le miracle de l’agriculture brésilienne est dû à un développement technologique des méthodes d’agricultures. Comme ce fut le cas pour Agropalma, qui a développé des produits innovants et intégré verticalement de nouvelles activités lui permettant de dégager de plus fortes marges et ainsi de créer un modèle de développement plus soutenable, il faut être prêt à aider au mieux les filaires qui sont susceptibles de créer des dommages à l’environnement. Cela permettrait de créer des conditions économiques plus favorables au développement d’entreprises plaçant de l’importance dans le développement durable, et inciterait le reste de la filaire à suivre ces exemples. De plus, la coopération avec le monde universitaire ainsi qu’avec d’autres entreprises du secteur permettrait de mettre en place des actions qui seraient viables dans d’autres situations. Le développement de la savante brésilienne dans la région du Cerrado pourrait très bien servir de plan d’action à des pays africains possédant le même climat. Cette transformation a commencé grâce à la société Embrapa, qui est partie du postulat plutôt que de rechercher des sols fertiles dans la forêt amazonienne qui impliquait une forte déforestation. Il fallait rendre viables des zones considérées comme non exploitables. L’entreprise a donc investi dans l’amélioration de la terre dans des zones peu propices à l’agriculture, améliorant sensiblement les rendements productifs (The economist, 2010b).
2.4 Expérienced’uneentreprisechilienne:MiguelTorres
Enjeuxécologiquesdel’industrie?Focussurnosparticularitésenvironnementales
Présentation de l’industrie
L’industrie viticole au Chili est en pleine croissance. La superficie des cépages a plus que doublé dans les années 1990 (Müller, 2014) et augmente de manière régulière tirée par les exportations pour un total de $1,790 million USD en 2012, avec un objectif de 3 milliards USD en 2020 (ProChile, 2014). Le pays est le 4e exportateur mondial de vin derrière la France, l’Italie et l’Espagne.
Point économique
Les producteurs chiliens se sont fixés à la fois des objectifs qualitatifs et quantitatifs : pour répondre à la forte demande extérieur, le pays augmente ses capacités de production, cependant cette augmentation de l’offre ne doit pas déboucher sur une diminution des prix de vente pour les producteurs. L’objectif qualitatif des producteurs chilien veut permettre une montée en gamme de ses produits et donc une hausse de ses prix et de ses marges.

Pour l’instant, le Chili « s’est construit une réputation de vins bons et peu chers, il faut changer cette perception » comme l’explique Aurelio Montes lui-même producteur de vin premium chilien (Business Chile, 2014).
Point écologique
La consommation énergétique, principalement en climatisation, et les coûts qu’elle entraîne sont considérables pour les producteurs de vin. Les prix de l’électricité dans le pays sont très élevés et il existe une vraie nécessité de faire des économies pour ces entreprises.
La consommation d’eau pour les vignes est modérée en comparaison à d’autres types d’agriculture. Cependant, son extraction des nappes phréatiques est consommatrice d’énergie. De plus, les variations climatiques entraînent des usages irréguliers des ressources. Cette ressource est donc précieuse et il faut pouvoir la gérer au mieux.
L’usage de produits chimiques et pesticides dégrade la qualité de l’environnement et les conditions de travail, elle peut avoir des répercussions indirectes sur la santé. Une augmentation globale de la qualité des produits passe par une amélioration des pratiques qui préservent la biodiversité.
À la fin de l’année 2012, vingt-neuf grands producteurs de vins chiliens ont signé le Code National de Développement durable. À l’initiative de divers syndicats, ce code impose aux producteurs de prouver leurs bons usages de l’eau, des sols et de l’énergie, en se soumettant aux contrôles d’organisme indépendants (Sustentavid.org, 2014). L’objectif de ce regroupement est de montrer que la précaution environnementale est maintenant au cœur de l’industrie viticole chilienne.
Exempled’entrepriseayantconciliéesuccèséconomiqueetenvironnemental: MiguelTorres
Présentation de l’entreprise
L’entreprise viticole espagnole Miguel Torres (Migueltorres.cl, 2014) possède environ 400 hectares de vignes au Chili. Leur approche supporte la production de vin biologique et le commerce équitable. Leur production s’élève à 6 millions de litres, leur chiffre d’affaires est de 22 millions $ CA en 2012 et l’entreprise regroupe 193 employés. Une telle production, en recherche d’une efficacité maximale et d’une excellence environnementale, doit relever de nombreux défis. L’ensemble de sa chaîne de valeur est étudié pour y répondre en déployant les solutions adaptées et disponibles sur le marché.
Pourquoi cet exemple? En quoi répond-il aux problèmes écologiques et économiques de cette industrie?
Miguel Torres est un producteur de taille intermédiaire au Chili, il se retrouve donc confronté à un certain nombre de challenges environnementaux, telles la production à grande échelle de multiples variétés de vins et l’exportation à l’international. Avec les objectifs d’améliorer la qualité de ses produits, d’améliorer son image et de monter en gamme, Miguel Torres Chili a choisi de signer le Code National de Développement durable et d’être un des pionniers dans son pays. Cette différenciation écologique lui permet aussi d’en retirer un avantage économique indéniable.

Mesuresprises:sacrificesetbénéfices(Migueltorres.cl,2014)
Problèmes Mesures prises Avantages Désavantages Consommation d’énergie élevée et polluante
Utilisation de chaudières biomasse pour contrôler la température de ses cuves
- Utilise un combustible renouvelable. - 20 % d’économies - Faibles rejets de CO2
- Coût d’installation plus élevé. Environ deux fois supérieur.
Déforestation pour planter les vignes
Plan de reboisement, soit 300 hectares de forêt dans ce cas.
- Impact sur la nature limité - Protège la biodiversité et limite le dessèchement des sols - Production de bois
- Coût des plantations : 2 $ par arbre. - Résultats sur le long terme.
Utilisation de produits chimiques, engrais, etc.
- Réduction de leur utilisation - Travail des sols et apports de compléments naturels
- Produits plus sains - Amélioration des sols - Produits Bio, au prix de vente plus élevé
L’exposition aux risques de maladies augmente. Coût financier limité dans le cas de l’industrie viticole
Usage de packaging
Utilisation de carton recyclé, d’encres à l’eau, de colles naturelles, etc.
Beaucoup moins polluant à fabriquer. (2x moins d’énergie, 20x moins d’eau)
20 % plus cher que le papier standard.
Consommation élevée de verre et production de déchets
Utilisation de bouteille « ecoglass » fabriquée au Pérou.
15 % plus légères Baisse de 6 % des émissions de CO2 liées au transport. Réduis les déchets
Réduction de la consommation d’énergie par de simples mesures de bon sens :
Élargissement des réglages des températures minimales et maximales à partir desquelles se déclenchent les systèmes de climatisation et chauffage dans les zones de stockage de matières premières sèches et de processus. Résultat : Réduction de 29 % de la facture énergétique dans ces locaux.
Coupure des installations de climatisation et chauffage dès que la température extérieure correspond à la température intérieure souhaitée. Résultat : Réduction de 35 % de la facture énergétique dans ces locaux.
Construction des caves sous terre. Réduit de manière considérable les besoins en climatisation, la température y est naturellement plus fraîche et stable.
Autres initiatives : l’installation d’ampoules basse consommation à haute efficacité et la mise en place prochaine de panneaux solaires.

L’utilisation de bouteilles « ecoglass », plus fines, légères et 100 % recyclables, a permis avec une meilleure gestion de la production de diviser par 5 les déchets de verre entre 2010 et 2012.
Mesure de l'empreinte carbone : l’entreprise a mis en place des indicateurs pour mesurer son empreinte carbone. Ces informations sont communiquées à la presse et aux clients. Études expérimentales : en collaboration avec la fondation pour l’innovation agricole, le projet utilise le CO2 généré dans la fermentation du vin, qui est utilisé pour stimuler la culture de la spiruline, une microalgue avec haute teneur nutritionnelle, qui pourra être utilisée comme engrais à l’avenir.
Conclusion:quemontrecetexemple?Quefaut‐ilenretenir?
L’exemple de Miguel Torres illustre comment une industrie peut décider de manière unie de changer ses méthodes de production pour se spécialiser dans une approche plus respectueuses de l’environnement et à forte valeur ajoutée. De plus avec des mesures de bon sens, il est possible de concilier réussite économique et écologique. La collaboration avec des partenaires, tels que les universités ou agences environnementales est un facteur clé de succès.
3 CONCLUSION
Les pays de l’Amérique du Sud ont adopté plusieurs mesures afin de promouvoir leur économie et mettre en place les notions de développement durable dans les pratiques industrielles. Le but de l’industrialisation n’est pas de détruire, mais d’améliorer la vie bien que cela exige des matières premières issues de l’environnement, il est possible d’envisager une expansion industrielle dans les pays d’Amérique du Sud sans détruire la faune et/ou la flore comme nous avons pu le remarquer à travers les exemples ci-dessus. Par exemple avec la production du biocarburant dans l’entreprise « Oil Fox » en Argentine qui utilise les algues comme substitut au soja afin de préserver certaines habitudes alimentaires dans les pays de l’Amérique du Sud qui utilise cette plante comme aliment de base afin de permettre à la population de trouver de la nourriture.
La production d’huile de palme représente un enjeu majeur dans le développement économique et écologique du Brésil qui est en partie financé à près de 60 millions de dollars par le gouvernement. Agropalma produit de l’huile certifiée développement durable et développe une vaste gamme de produits innovants incluant dans sa stratégie à long terme une combinaison profit et développement durable, via l’intégration verticale et horizontale ainsi que le développement de technologies.
L’exemple de Miguel Torres au Chili s’inscrit dans une tendance mondiale de conversion à la viticulture biologique. Cette expérience montre une mobilisation d’une industrie à grande échelle qui s’engage de manière coordonnée dans des actions plus respectueuses de l’environnement. D’autres pays, souhaitant eux aussi monter en gamme dans leurs productions agricoles, peuvent s’inspirer du code national de développement durable chilien comme base mobilisatrice de leur industrie.

Ces exemples de réussite en Amérique du Sud peuvent être utilisés dans les pays présentant les mêmes caractéristiques climatiques notamment les pays en développement, cela leur permettrait d’assurer la préservation de la biodiversité, de consommer à un rythme inférieur du taux de reproduction naturel et de réduire l’empreinte écologique en changeant les comportements des industries. Toutefois, il est annoté que les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. (Anatole France), mais cela ne signifie pourtant pas que cela représente un obstacle vers le développement durable afin de chercher à concilier l’écologie et l’économie pour mettre en exergue les tendances de consommation verte.
4 BIBLIOGRAPHIE
DéfisécologiquesenAmériqueduSud
ArticlesInternet
Central Intelligence Agency. (2014). The Word Factbook. Dufour, A (2014), L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE PEUT-ELLE RÉPONDRE À
L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES, Institut de relations internationales et Stratégiques, France
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du Québec (2014), Note sur l’économie et le commerce/Le Brésil
Sabbatella, I (2010), Latin America Faces the Global Ecological Crisis, Climate ans capitalism, consulté le 20 novembre 2014 à : [http://climateandcapitalism.com/2010/08/19/latin-america-faces-the-global-ecological-crisis/]
The World Bank (2014), Latin America: Middle Class hits Historic High. Disponible à: . [http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/11/13/crecimiento-clase-media-america-latina]
Université de Sherbrooke (2014), Perspectives Monde/Argentine Yale Center for environmental law &policy (2014), Environmental Performance Index,
[http://epi.yale.edu/]
Mesuresincitativespubliques‐privéesenAmériqueduSud:lemodèledesPSE
Chapitredelivre
Wunder S., 2005, « Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts », CIFOR Occasional Paper, 42, pp 217-231
Expérienced’uneentrepriseargentine
ArticlesInternet
OCDE. (2011). Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020. Chapitre 3 : Biocarburants [http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/48202145.pdf] / OCDE.

Guibert, M., & Carrizo, S. C. (2012). Les biocarburants en Argentine : facteurs et enjeux de la production de biodiesel de soja. [http://www.agrifirme.fr/IMG/pdf/2012%20Guibert%20Carrizo%20OCL.pdf] / OCL.
Pollutec., (2012). Environnement et développement durable en Argentine. [http://blog.pollutec.com/environnement-et-developpement-durable-en-argentine.html] / Blog Pollutec .
OIL FOX. (2014). Mission et Vision. [http://www.oilfox.com.ar/index_english.html]. OIL FOX. (2014). Our progress. [http://www.oilfox.com.ar/index_english.html]. OIL FOX. (2014). Who we are ?. [http://www.oilfox.com.ar/index_english.html]. OIL FOX. (2014). Technology. [http://www.oilfox.com.ar/index_english.html]. Cardoret, J. P., & Bernard, O. (2008) La production de biocarburant lipidique avec des
microalgues : promesses et défis [http://www-sop.inria.fr/comore/shamash/Cadoret_Bernard_BiodieselMicroalgues_2008.pdf] / Journal de la Société de Biologie, 3, 201-211.
Alvarado, P. (2007). Biodiesel from algae and the biofuels discussion in Argentina [http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/biodiesel-from-algae-and-the-biofuels-discussion-in-argentina.html] /Treehugger.
USDA Foreign agricultural service. (2014) GAIN Report: Argentina – Biofuels annual 2014[http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Buenos%20Aires_Argentina_7-1-2014.pdf] / USDA.
Expérienced’uneentreprisebrésilienne
ArticlesInternet
FAO, (2010). the oil palm. [En ligne] Available at: http://www.fao.org/docrep/006/T0309E/T0309E01.htm
Agropalma, (2013). Sustainability report. [En ligne] http://www.agropalma.com.br/media/relatorios_sustentabilidade/2013%20-%20Relatorio%20de%20Sustentabilidade%20-%20Ingles%20-%20final.pdf
Bloomberg, (2014). Energy & Oil Prices: Natural Gas, Gasoline and Crude Oil. [En ligne] http://www.bloomberg.com/energy/.
Butler, R. (2010). Brazil launches major push for sustainable palm oil in the Amazon. [En ligne] Mongabay. http://news.mongabay.com/2010/0507-amazon_palm_oil.html#sthash.kUmNydd8.dpbs
Butler, R. (2011). In Brazil, Palm Oil Plantations Could Help Preserve the Amazon by Rhett Butler: Yale Environment 360. [En ligne] E360.yale.edu. http://e360.yale.edu/feature/in_brazil_palm_oil_plantations_could_help_preserve_amazon/2415/
Elkington, J. (1998). Partnerships fromcannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century business. Environ. Qual. Manage., 8(1), 37-51. doi:10.1002/tqem.3310080106
Indexmundi.com, (2014). Palm Oil Production by Country in 1000 MT - Country Rankings. [En ligne] http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&
Institut international du développement durable, (2014). SSI review 2014. [En ligne] https://www.iisd.org/pdf/2014/ssi_2014_chapter_11.pdf

Magalhães, C., & Drouvot, H. (2009). Agropalma : un exemple de politique de responsabilité sociale et environnementale associant des familles de petits agriculteurs. [En ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00528732
Rfi, (2014). RFI - L'évolution des cours du pétrole depuis 1970. [En ligne] http://www1.rfi.fr/actufr/articles/102/article_67012.asp
The Economist, (2010a). The other oil spill. [En ligne] http://www.economist.com/node/16423833?story_id=16423833
The economist, (2010b). The miracle of the cerrado. [En ligne] http://www.economist.com/node/16886442
Expérienced’uneentreprisechilienne
ArticlesInternet
Business Chile, (2014). La Industria Vitivinícola de Chile: Calidad Premium. [En ligne] http://www.businesschile.cl/es/noticia/special-report/la-industria-vitivinicola-de-chile-calidad-premium Migueltorres.cl, (2014). Miguel Torres. [En ligne] http://migueltorres.cl/rse.php
Müller, K., (2014). Chile vitivinícola en pocas palabras. [En ligne] http://www.gie.uchile.cl/pdf/Katrina%20Muller/Chile%20Vitivin%EDcola%20en%20pocas%20palabras.pdf
ProChile, (2014). Chile potencia su oferta vitivinícola en Prowein 2013 [En ligne] http://www.prochile.gob.cl/noticias/chile-potencia-su-oferta-vitivinicola-en-prowein-2013/ Sustentavid.org, (2014). Sustentavid [En ligne] http://www.sustentavid.org

EXPÉRIENCES DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES ET CANADIENNES
Alexis Corradi, [email protected] Louis-Thomas Drapeau, [email protected]
Sanaa Hadri, [email protected] Ghizlane Lahrougui, [email protected]
Mohamed Nabil Mihamou, [email protected]
Résumé
Face aux constantes pressions qui les entourent, les organisations d’aujourd’hui doivent effectuer les choix adéquats afin de pouvoir se distinguer. Pour renforcer leur compétitivité, elles doivent travailler de concert avec les parties prenantes de leur environnement. Considérant les différents champs d’actions du développement durable et le contexte de globalisation dans lequel ces organisations évoluent, reste à savoir comment au sein même d’une nation en particulier il est possible de performer. Le travail de recherche suivant tentera de démontrer comment les entreprises canadiennes et québécoises peuvent réussir à concilier économie et écologie.
PRÉAMBULE : L’ÉTYMOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La conférence menée par l’Organisation des Nations Unies sur l’environnement humain a eu lieu à Stockholm en 1972. Cette conférence a marqué le début des efforts mondiaux afin de faire face aux différents problèmes environnementaux qui deviendront par la suite de réels enjeux écologiques. Il est important, avant de commencer notre recherche, de définir ce terme devenu si commun, le développement durable. Selon le gouvernement canadien, comme déterminé sur son site officiel, « le développement durable vise à répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations à venir. Il s'agit de relever le niveau de vie tout en protégeant la santé humaine, en préservant l'environnement, en exploitant judicieusement les ressources et en faisant progresser la compétitivité économique à long terme. Il nécessite l'intégration des priorités environnementales, économiques et sociales dans les politiques et programmes nécessitant une action à tous les niveaux - les citoyens, l'industrie et les gouvernements » (Environnement Canada, 2014).
Les éléments centraux du développement durable ont émergé dans les années 80, notamment en ce qui concerne l'interdépendance des êtres humains et l'environnement naturel; les liens entre le développement économique, social et la protection de l'environnement; et enfin, la nécessité d'avoir une vision globale et des principes communs. Notons, en particulier, le principe 2 qui dit que « conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale » (Organisation des Nations Unies, 1992).

L’INTRODUCTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CANADA
L'éthique du développement durable au Canada est principalement liée à la Commission canadienne de conservation. Fondée en 1909, elle a pour but de soutenir et conseiller le gouvernement canadien sur la conservation des ressources naturelles et humaines. Celle-ci affirme que les générations futures se doivent aussi de prospérer à leur tour et qu’il est important de protéger le capital naturel pour qu’il soit transmis intact. En 1971, le Canada est devenu le deuxième pays après la France à reconnaître l'importance de l'environnement par la création d'un ministère distinct - Environnement Canada.
L'engagement du Canada envers le développement durable s’est officialisé avec la création en 1988 de la Table Ronde Nationale sur l'Environnement et l'Économie (TRNEE). Bien que la TRNEE ne soit plus en fonction depuis mars 2013, elle était un organisme indépendant, mandatée par le Parlement du Canada et relevant directement du premier ministre. Son rôle était d'identifier, expliquer et promouvoir dans tous les secteurs de la société canadienne, et dans toutes les régions du Canada, les principes et les pratiques du développement durable.
En 1994, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a été créée rentrant dans le cadre de la surveillance du processus national qui vise à assurer le projet de décision fédérale et prend en compte les considérations environnementales dans le contexte du développement durable. Le gouvernement a également publié un guide pour un « écogouvernement » qui vise à fournir des conseils aux ministères fédéraux dans l'élaboration de stratégies de développement durable, et affirme fermement sa conviction que la santé économique du Canada dépend de sa santé environnementale. De plus, certains plans et programmes ont été mis en place afin de développer cette stratégie qui était, à l’époque, innovante. Basé sur un large processus de consultation nationale, le Plan vert, par exemple (doté d’un financement de 3 milliards de dollars), comprenait des initiatives et des programmes visant à couvrir la protection de la couche d'ozone et de la recherche sur le réchauffement climatique, la gestion durable des forêts, la protection des écosystèmes de l'Arctique, la création de nouveaux parcs et espaces protégés, le nettoyage des sites toxiques, et l'aide aux pays en développement dans leurs efforts de développement durable.
Le gouvernement fédéral du Canada s’est ainsi démarqué par sa démarche proactive envers la sauvegarde de son environnement. Nous parlons ainsi de l’environnement d’un point de vue écologique, mais également de l’environnement comprenant toutes les parties prenantes sur le sol canadien ou ayant un impact direct sur les activités économiques canadiennes. Cette vision inclut donc à la fois les citoyens, mais également et surtout les entreprises. La poursuite du développement durable nécessite à la fois une coordination entre les agences gouvernementales et le gouvernement, mais également la société civile et le secteur privé. Cependant, depuis de nombreuses années, certains secteurs industriels sont pointés du doigt par les professionnels de l’écologie mondiale à cause de leur impact négatif sur l’écosystème. Ces secteurs d’activités, dits polluants, se retrouvent ainsi dans des pays ayant une abondance de ressources.
Malgré ce constat dramatique, le but primaire de toute entreprise à but lucratif reste d’assurer sa pérennité. De ce fait, il est logique de se demander comment ces entreprises canadiennes et québécoises peuvent réussir à concilier l’économie et l’écologie.

Pour répondre à cette question existentielle pour l’avenir des entreprises canadiennes et québécoises, nous orienterons nos recherches dans un premier temps vers le lien immuable qui réside entre l’abondance de ressources et les politiques mises en place à différentes échelles par les principales instances décisionnelles. Cette partie, nous permettra d’ainsi dégager des indicateurs de performance écologique intra-pays pertinents malgré leur quantité tout en s’interrogeant sur leur efficacité et donc sur la réussite gouvernementale. Puis dans un second temps, nous verrons comment ces entreprises ont relevé ce défi en structurant leur modèle d’affaires de telle sorte que la prospérité de l’entreprise soit véritablement conciliée avec les enjeux écologiques d’un environnement qui nous concerne tous en tant que citoyen du monde.
1 LECANADA:PRÉCURSEUR,MOTEUROUSUIVEUR?
Dans l’optique de comprendre comment des entreprises canadiennes concilient économie et écologie, il est primordial de nous situer par rapport aux autres pays en matière de développement durable. Comme cet aspect implique une réelle proactivité, nous tenterons de déterminer si le contexte canadien fait de lui un précurseur, un moteur ou un suiveur en la matière. La section qui suit nous dressera le portrait d’un pays dans lequel règnent certaines abondances. Par la suite, selon les comportements adoptés par les instances gouvernementales ainsi que des indicateurs de performance écologique, nous tenterons de classifier le Canada dans un contexte international.
1.1 Unpaysenabondancederessources
En observant le pays du froid et de la neige d’un œil extérieur, ce grand pays qu’est le Canada se démarque par une abondance flagrante sur certains aspects. Cette abondance, qui se définit par une « aisance procurée par des ressources importantes » (Larousse, 2014), se traduit selon différents aspects qui affectent directement l’approche gouvernementale, mais également des entreprises face au développement durable. Cette abondance de ressources se manifeste notamment à travers la superficie du territoire et au niveau des ressources naturelles.
Territoire
Classé deuxième pays au monde en ce qui concerne sa superficie, le Canada se démarque d’un simple coup d’œil sur une mappemonde par cette abondance de territoire flagrante. Avec près de 9,9 millions de km² la superficie du territoire canadien vient derrière celle de la Russie qui a près du double, soit environ 17 millions de km². Au-delà de se démarquer sur la scène mondiale de par sa large étendue, la réalité canadienne met de l’avant un premier point de singularité à ne pas négliger. En effet, de par une population d’environ 33,4 millions d’habitants en date du recensement 2011, le Canada fait partie des pays les moins denses du monde avec uniquement 3,7 habitants au km². Ceci vient davantage mettre à l’avant-plan cette abondance de territoire. Si l’on poursuit la comparaison avec la Russie du haut de ses 142,5 millions d’habitants, on parle ici plutôt d’une densité d’environ 8,4 habitants au km² ce qui tranche radicalement du Canada.
Au niveau provincial, le Québec présente une réalité similaire au pays dans lequel il évolue. Avec une superficie de 1,35 million de km² et une population de 7,9 millions de km²

cette province canadienne se démarque aussi par une densité relativement faible avec environ 5,8 habitants au km².
Finalement, cette faible densité de population en présence au Canada ou au Québec témoigne à l’opposé d’une plus forte urbanisation dans les poumons économiques. Malgré un territoire plus que suffisant, nous verrons donc maintenant comment cet excès se traduit dans l’exploitation des différentes ressources qui y sont présentes. Cependant, certaines questions naturelles en découlent : est-ce légitime d’utiliser les ressources qui nous entourent de cette manière? Sommes-nous en mesure de faire plus, avec moins? Si oui, quels sont les leviers qui nous le permettront? La section suivante mettra de l’avant la question de l’abondance des ressources naturelles tout en analysant le comportement du Canada vis-à-vis de cette richesse.
Ressourcesnaturelles
Le pétrole et les sables bitumineux canadiens sont des ressources énergétiques importantes pour la société actuelle. Malgré une production mondiale de pétrole qui tend à ralentir et une demande toujours plus élevée, les débats autour des formes d’extractions restent permanents et en particulier autour des sables bitumineux. Outre cette ressource pétrolière importante, le Canada se démarque aussi par ses ressources d’eau et par le fait même, de par son potentiel hydroélectrique et sa réflexion environnementale. Finalement, sa grande superficie met aussi à l’avant-plan une abondance de forêt et donc un très grand accès à l’industrie forestière.
Lepétroleetlessablesbitumineux
La consommation du pétrole au Canada
Le pétrole est une source énergétique très prisée pour les consommateurs canadiens. En effet, en 2006, 41 % de la demande d’énergie finale du Canada a été satisfaite par des produits pétroliers raffinés dont les ventes se sont élevées à 100 milliards de litres durant la même année. Cette augmentation des ventes s’explique par la croissance de l’économie et de la population.
Tel que le montre la figure 1, la consommation des produits pétroliers a augmenté en flèche depuis les années 1960 :
Figure 1 – La consommation d’énergie au Canada

Le secteur des transports consomme à lui seul plus des deux tiers des produits pétroliers raffinés. La demande croissante de ces produits est responsable dans une large mesure de l’augmentation du total des ventes de produits pétroliers raffinés depuis 1990. Aussi, les produits pétroliers servent à satisfaire d’autres besoins non énergétiques (les lubrifiants ou encore l’asphalte). Aussi, la consommation de combustibles à base de produits dérivés du pétrole varie selon les changements de température. À titre d’exemple, la consommation du mazout domestique varie en fonction des conditions météorologiques hivernales, alors que les ventes d’essence augmentent durant les mois de l’été, période où les déplacements en voiture sont les plus nombreux. Par ailleurs, la consommation des dérivés du pétrole dépend aussi de la demande d’autres types de combustibles considérés comme étant des produits de substitution. En effet, pendant les années 1990, la demande de mazout a chuté à cause de la plus grande disponibilité de gaz naturel.
Les exportations et les importations de pétrole au Canada
Le Canada est un pays réputé dans le secteur pétrolier. Par exemple, la province du Québec importe à elle seule la totalité de son pétrole brut, puis procède à son raffinement en différents produits pétroliers, tels que l’essence, le carburant diesel, le mazout, etc.
Il faut aussi rappeler que les approvisionnements de pétrole brut au Québec ont augmenté en 2012 de 6 %, et ceci après quatre années de baisses consécutives, se chiffrant à 128 millions de barils. De plus, en 2011, le reste des échanges de produits pétroliers énergétiques du Québec avec l’extérieur était excédentaire. Cadrant avec la hausse générale de la production et de la capacité, les pipelines canadiens ont acheminé 31,9 millions de mètres cubes en mai, en hausse de 2,4 % par rapport à avril et de 13,4 % par rapport à mai 2013. Les exportations totales par pipeline aux États-Unis ont constitué la principale activité au chapitre des livraisons, atteignant 12 millions de mètres cubes, en hausse de 14,9 % par rapport à mai 2013 :
Source : Statistique Canada

L’industrie des sables bitumineux du Canada offre une source d’énergie sûre, qui réduit son impact sur l’environnement et fournit des retombées économiques à la société tout en exploitant une importante ressource mondiale. En effet, le débat autour de cette forme d’extraction est très alimenté par certains écologistes. Or, cette méthode est directement polluante notamment par l’utilisation massive d’eau potable, mais elle est rapide et sans autres risques. Lorsque nous souhaitons extraire le pétrole, ce n’est pas sans conséquences écologiques directes, mais également indirectes par exemple à travers les machines et la quantité d’énergie utilisées. L’avantage que présente cette forme d’extraction est donc clairement sa transparence quant à ses répercussions écologiques.
Au Canada, les réserves pétrolières (174 milliards de barils, dont 169 milliards provenant des sables bitumineux) placent ainsi ce pays à la troisième place mondiale en quantité. En effet, 80 % des réserves de sables bitumineux, qui se trouvent sous environ 97 % de la surface de la région de sables bitumineux, peuvent être récupérés par forage, ce qui perturbe peu la surface du sol. De plus, 20 % des réserves sont assez proches de la surface (moins de 70 mètres) ce qui facilite fortement l’extraction de la ressource. Cependant, ce n’est pas sans conséquence puisque l’industrie des sables bitumineux génère 6,9 % des émissions de gaz à effet de serre produites au Canada et 0,16 % des émissions produites à l’échelle planétaire.
Pendant les années 90, les sables bitumineux de la région d'Alberta représentaient à peine 19 milliards de dollars ce qui équivalait à 13 % des ressources énergétiques du pays. Selon la figure 3, on constate que près de vingt ans plus tard, la valeur de cette réserve destinée à l’exploitation s'élevait à près de 441 milliards de dollars. Il est aussi important de rappeler que depuis 2006, la valeur de cette ressource naturelle surpasse celle des autres ressources énergétiques, en raison surtout d'un nombre accru de réserve.
Figure 3 – Valeur des stocks de ressources énergétiques au Canada

L’eau etlepotentielhydroélectrique
Le Canada possède environ 7 % des ressources renouvelables en eau de la planète. Bordé sur trois côtés par les océans Pacifique, Arctique et Atlantique, il possède plus de 243 000 km de littoral. Environ 12 % de la superficie totale du territoire canadien est couverte par des lacs, rivières et fleuves. Comptant 563 lacs de plus de 100 kilomètres carrés, le Canada possède la plus grande superficie de lacs au monde et possède aussi plus de 8 500 fleuves et rivières. On compte parmi ceux-ci le fleuve Saint-Laurent, une des plus importantes voies de navigation au Canada et en Amérique du Nord, coulant sur 3 058 km avant de se jeter dans le golfe du Saint-Laurent. Notons finalement que les glaciers couvrent une superficie d’environ 200 000 km2 et que près des trois quarts de ceux-ci se trouvent dans les îles de l’Arctique.
Quant au Québec, il est l'une des régions les plus riches en eau du monde et compte plus de 130 000 cours d'eau et 1 000 000 de lacs. Plus de 40 % des ressources hydrauliques du Canada se trouvent au Québec. De toute l'électricité produite au Canada, près de 60 % (372 térawattheures en 2011) provient d'aménagements hydroélectriques de grande ampleur. Le reste de l'électricité est produit à partir du charbon, du nucléaire, du gaz naturel, du pétrole et de sources d'énergie renouvelables autres que l'hydroélectricité. L'exploitation de l'énergie hydroélectrique et sa contribution à la production canadienne totale d'électricité varient d'une province à l'autre. Le Québec, la Colombie-Britannique et la Terre-Neuve-et-Labrador génèrent la majorité de l'hydroélectricité au Canada.
Figure 4 – Production d'hydroélectricité au Canada — Tendance depuis 2000 (TWh)
Source : Statistique Canada
Autosuffisant en matière d’électricité, Le Canada est l’un des rares exportateurs nets du monde dans ce domaine. Sur le plan économique, les exportations d’hydroélectricité représentent une importante source de revenus pour le Québec. Hydro-Québec fournit de l’électricité à la Nouvelle-Angleterre depuis les années 1980, elle qui achète environ la moitié des exportations de l'entreprise, ainsi qu’à l’état de New York à hauteur de 1 200 MW.

En 2013, les exportations nettes d’électricité ont augmenté de 254 M$ pour atteindre 1 353 M$ en 2013, comparativement à 1 099 M$ en 2012.
Tableau 1 – Classement des producteurs mondiaux d’hydroélectricité, 2011
#1) Chine 20 % #2) Brésil 12 % #3) Canada 11 % #4) États-Unis 9 % #5) Russie 5 % Total
3 491 (TWh)
Source: Agence internationale de l'énergie
Selon une étude dirigée par l’Association canadienne de l’hydroélectricité, le potentiel hydroélectrique non exploité au Canada est évalué à 163 173 MW, ce qui représente plus que le double de la capacité installée courante. L’étude entreprise en 2011 par HEC Montréal a expliqué que de 2011 à 2030, il y aurait un potentiel au Canada pour 158 projets hydroélectriques qui représentent 29 000 MW de nouvelle capacité installée.
Figure 5 – Le potentiel de l’hydroélectricité au Canada
Source : Le potentiel hydroélectrique du Canada, ÉEM, 2006
L’industrieforestière
En 2014, le Canada possède 348 millions d’hectares de terres forestières, soit 9 % des forêts mondiales et 24 % des forêts boréales de la planète. Les forêts dominent ainsi le paysage du Canada dans sa quasi-totalité sauf près du pôle Nord, dans la région Arctique et les grandes étendues de prairies. Avec cette importante quantité de forêts, le Canada se classe au troisième rang mondial derrière la Fédération de Russie et le Brésil par le couvert forestier, mais également obtient une superficie par habitant parmi les plus élevées du monde. L’abondance en matière de faune et de flore au Canada est donc clairement établie. Cependant pour assurer une forme de pérennité, l’état canadien a su réagir.

Figure 6 – Les régions boisées du Canada
Les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral travaillent en étroite relation afin de surveiller l’intégralité de la zone forestière tout en régulant le volume de bois sur le pays. Afin de gérer ses forêts, le Canada s’est doté d’équipements sophistiqués à la pointe de la technologie ainsi que d’une très bonne main d’œuvre reconnue mondialement afin d’effectuer la surveillance au sol, dans les airs et dans l’espace. Les mesures et les observations forestières sont faites de manière continue pour que le gouvernement soit en perpétuelle connaissance du domaine pour prendre des décisions relatives à l’aménagement forestier durable, mais également l’élaboration des politiques publiques (90 % des forêts sont publics).
La croissance des forêts au Canada est disparate. En effet, certaines forêts sont plus productives que d’autres, mais ne sont pas pour autant inutiles dans un contexte de développement durable. Leurs rôles sont multiples : purification de l’eau, habitat essentiel pour le développement de la flore et de la biodiversité animale. Les forêts commerciales, quant à elles productives, jouent un rôle primordial dans l’économie forestière canadienne, mais elles sont contrôlées. Le gouvernement fédéral met l’accent sur la production de la fibre de bois récoltée à des rythmes durables tout en répondant aux besoins sociaux et économiques de création de richesse pour le pays.
Afin d’effectuer des comparaisons objectives et concrètes, le gouvernement fédéral a mis en place depuis les années 2000 et la prise de conscience environnementale 43 indicateurs de performance dont : zone forestière, zone de récolte, régénération, volume récolté par rapport à l’approvisionnement en bois durable, volume de bois, déboisement et boisement, etc. Il reste cependant important de souligner que cette richesse naturelle détenue par le Canada reste durable et pérenne. Pour l’illustrer, le volume de bois devrait stagner alors que les récoltes et les perturbations naturelles quant à elles sont en augmentation (143 millions de mètres cubes de bois ronds récoltés en 2012, soit 0,3 % du volume total des bois sur pieds au Canada). Le volume total de bois par groupes d’espèces est illustré dans la figure 7. Ceci est effectivement compensé par la régénération, mais également la croissance des forêts.

Figure 7 – Le volume total de bois au Canada par groupe d’espèces
De plus, les facteurs socioéconomiques locaux et mondiaux auront des répercussions sur le déboisement et le boisement. Cependant, le taux de déboisement au Canada devrait diminuer avec le temps. On peut retrouver certains de ces chiffres sur le déboisement canadien en figure 8. Malheureusement, les causes de déboisement restent inchangées, c'est-à-dire à la transformation de forêts en terre agricole, mais la plus grande proportion reste la plus grave, soit liée aux activités du secteur pétrolier et de gaz dans l’Ouest canadien qui ne cesse d’accroître.
Figure 8 – Superficie estimée de déboisement au Canada par secteur industriel

1.2 Mesuredelaperformancecanadienneetquébécoise
Face à cette abondance marquée de ressources ainsi qu’aux diverses pressions du monde qui l’entoure, le Canada se voit dans l’obligation d’établir un cadre précis s’il veut se distinguer en matière de développement durable. En effet, nous avons vu précédemment l’évolution chronologique de ce pays en la matière. Cependant, quelle est sa position actuelle? Nous chercherons dans la section qui suit à mesurer la performance canadienne. Nous passerons en revue certaines politiques gouvernementales canadiennes puis, dans une perspective provinciale, certaines politiques québécoises en matière de développement durable. Finalement, pour compléter la première partie de cet essai nous déterminerons des indicateurs pertinents qu’il est primordial de mettre de l’avant pour analyser statistiquement la cohérence de la stratégie verte mise en place.
Lecomportementdugouvernement canadienenmatièred’écologie
Afin de faire preuve d’un maximum de transparence en la matière, le gouvernement canadien doit, conformément à la Loi fédérale sur le développement durable, s’acquitter tous les trois ans d’une Stratégie fédérale sur le développement durable (SFDD). Cette loi stipule les choses suivantes :
Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques. L’approche du gouvernement envers le développement durable reflète par conséquent un engagement à diminuer les impacts environnementaux de ses politiques et opérations, ainsi qu’à optimiser l’usage efficace des ressources naturelles et d’autres biens et services. (Environnement Canada, octobre 2013)
Dans le cycle actuel, qui couvre les années 2013 à 2016, la stratégie couvre quatre thèmes prioritaires : I. Relever les défis des changements climatiques et de la qualité de l’air; II. Maintenir la qualité et la disponibilité de l’eau; III. Protéger la nature et les Canadiens; IV. Réduire l’empreinte environnementale – en commençant par le gouvernement.
Figure 9 – Structure des thèmes : objectifs, cibles et stratégies de mise en oeuvre
Source : Environnement Canada

Suivant ces thèmes, le gouvernement canadien fait preuve d’une volonté, du moins d’une intention, structurellement parlant d’atteinte d’objectifs concrets. On peut voir la logique entourant ces thèmes en ce qui concerne l’élaboration d’objectifs et l’évaluation de l’atteinte de ces cibles à la figure 9. En prenant exemple sur le thème 1, qui concerne les changements climatiques et la qualité de l’air, on constate entre autres que la réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue une de ces cibles. Dans la théorie, on constate que le Canada met de l’avant un plan, mais essayons maintenant de définir comment il s’engage en ce sens et quels sont les réels résultats notamment en matière de gaz à effet de serre.
Le ministère de l’Environnement affirme que le Canada s’est engagé lors de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à 17 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2020. Aussi d’après la même source, en 2009, les émissions de gaz à effet de serre du Canada ont atteint 690 mégatonnes, soit une augmentation de 17 % par rapport à 1990. Le Canada détient, à lui seul, 2 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone dues à la combustion de combustibles. Ce pourcentage reste relativement faible par rapport à des pays comme la Chine ou encore les États-Unis qui occupent les 2 premières places mondiales avec respectivement 24 % et 18 % respectivement. Nous retrouvons à ce sujet la répartition des émissions de dioxyde de carbone dues à la combustion de combustibles à l’échelle mondiale en 2010.
Figure 10 – La répartition mondiale des émissions de dioxyde de carbone dues à la combustion de combustibles

Cependant si l’on cherche à être plus objectif en considérant ces pourcentages, il pourrait être bon de ramener le tout sur une même base, par exemple la proportion de ces émissions en fonction du pourcentage de la population mondiale. Pour les biens du calcul, notons que les États-Unis et la Chine regroupent respectivement environ 4,47 % et 19,86 % de la population mondiale. Comme mentionné préalablement dans cet essai, le Canada quant à lui ne détient pas plus de 0,48 % des habitants de la planète. La conclusion à cet effet est que le Canada produit 4,16 fois plus de gaz à effet de serre que son pourcentage d’habitants en proportion mondiale. Malgré une plus faible proportion d’émissions que les États-Unis et la Chine, ces derniers en produisant respectivement 4,02 fois et 1,21 fois leur population, le Canada performe donc moins bien que ces deux pays en la matière.
Par ailleurs, nous faisons aussi face à une contradiction entre la stratégie gouvernementale et ce qui est réellement accompli. Un problème subsiste, car, fin 2014, ces deux pays, qui sont du même coup les deux plus gros partenaires commerciaux du Canada, ont passé une entente sur la réduction de ces émissions. En effet, alors qu’ils prévoient réduire massivement ces émissions d’ici 2030, le Canada se veut encore en retard à l’échelle mondiale à ce sujet. Par exemple, les États-Unis veulent réduire de 26 % à 28 % ces émissions de carbone d’ici 2025 déjà et la Chine de son côté cherchera à tirer 20 % de sa consommation d’énergie totale à partir de sources d’énergies propres.
Figure 11 – Projection des émissions de gaz à effet de serre du Canada
Source : Environnement Canada
De son côté, le Canada excédera de près de 220 tonnes l’objectif originalement établi pour 2020, tel qu’on le voit en figure 10, et ne semble pas avoir mis de l’avant les structures nécessaires pour arriver à ce but. Le problème dans une situation comme celle-ci, où deux partenaires prennent les devants pour mieux faire, est qu’en changeant drastiquement leurs habitudes, ils affectent donc les parties prenantes. Le Canada se voit donc face à une nécessité de mieux prévoir l’exploitation de ses ressources énergétiques sachant que la demande pourrait être moins élevée qu’en prévision initiale.

Dans une optique d’apprentissage et de développement environnemental continue, la coopération reste la clé. En effet, l’effort qu’entreprend le Canada à l’international reste le principal moyen par lequel le pays pourrait progresser.
Le Canada se classe parmi les 10 premiers pays au monde en matière de développement des entreprises durables, qui utilisent des technologies propres. Selon le rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF) et la firme de recherche multinationale Cleantech Group LLC, ils ont évalué 38 pays par leur capacité à commercialiser des startup-technologiques-vertes. Le Danemark et Israël mènent le classement, les États-Unis se positionnent à la cinquième place, et le Canada vient seulement au septième rang. Cette étude avance que les innovations technologies propres s’intensifieront rapidement dans les 10 à 30 prochaines années, ceci est lié à la transition progressive à l’utilisation d'hydrocarbures par l'énergie renouvelable.
Le rapport du WWF a déclaré que le Danemark a obtenu la première place du podium et ceci en raison d'un environnement très favorable en matière de recherche et développement qui est supporté par le gouvernement moralement, mais aussi financièrement, et aussi d’une réputation mérité de bien commercialiser ses produits sur le marché international. Le Canada a aussi un grand potentiel de production de technologies propres, en bénéficiant notamment des ressources naturelles abondantes comme les ressources en eau (pour l'énergie hydroélectrique), la grandeur du territoire qui peut accueillir de grands projets d'énergie solaire et éolienne, et d'énormes réserves de biomasse. La transition vers une société plus durable au 21e siècle ne sera pas atteinte par un ministère ou un niveau de gouvernement seul. Une société plus durable exigera l'engagement de toutes les parties prenantes à tous les niveaux dans une perspective à plus long terme.
Avec l’épuisement des réserves de pétrole au niveau mondial, la production pétrolière reste toujours considérée comme très lucrative même en tenant compte des difficultés liées à son exploitation. C’est le cas pour le sable bitumineux qui est en présence abondante au Canada, notamment en Alberta. L'exploitation des sables bitumineux libère une quantité excessive de gaz à effet de serre dans le climat et cause le réchauffement dans l'atmosphère. Enfin, le sable extrait est mélangé avec une quantité importante d’eau chaude qui est ensuite décantée pour en extraire le pétrole. Ce processus complexe est aussi très polluant.
Lecomportementdugouvernement québécoisenmatièred’écologie
La démarche québécoise en termes de développement durable est l’aboutissement d’une féroce volonté et de nombreuses réflexions débutées dans les années 80. Alors que cette province souhaitait développer les comportements compatibles de toutes les parties prenantes avec l’écologie. Depuis les années 90, le Québec a su mettre en place des actions afin de s’engager durablement dans cette voie notamment en développant ou en accueillant sur ses terres des éléments faisant avancer la réflexion mondiale.
Pour cadrer le développement durable et l’écologie en général, le gouvernement du Québec a mis en place, sur la période 2008-2014, un plan de développement durable. Ce plan est régi par un encadrement législatif avec comme base, les lois sur le développement durable instauré depuis plusieurs années sur le territoire québécois au niveau des citoyens, mais aussi et surtout au niveau des entreprises.

Le cadre de référence de mise en œuvre est ainsi appuyé par une stratégie gouvernementale ayant la vision suivante : « Une société où la qualité de vie du citoyen est et demeurera une réalité. Une société responsable, innovatrice et capable d’excellence dans toutes ses réalisations. Une société misant sur l’harmonie entre le dynamisme économique, la qualité de l’environnement et l’équité sociale. Une société inspirée par un État dont le leadership d’animation et d’action la mobilise vers l’atteinte de cette vision. » (Environnement Canada, 2014)
De cette stratégie, 3 enjeux majeurs ont été relevés : développer la connaissance, promouvoir l’action responsable et favoriser l’engagement. Pour mener à bien cette mission, le gouvernement du Québec a accompagné ces enjeux de neuf orientations stratégiques (et de 19 axes d’interventions) dont les trois prioritaires sont les suivantes :
Informer, sensibiliser, éduquer et innover
Cette orientation prévoit d’établir un plan d’éducation, de formation clé en main ainsi que de sensibilisation visant les citoyens et le personnel de l’administration publique. Cette orientation sera réalisable grâce au soutien à la recherche et l’innovation du développement durable et aussi la favorisation du partage de ces principes.
Produire et consommer de façon responsable
L’application de mesures de gestions environnementales et de pratiques écoresponsables seront adoptées par les ministères et les organismes à l’égard de cette orientation et ceci pour produire et consommer de façon efficace.
Aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée
Aligner les stratégies gouvernementales en intégrant les impératifs du développement durable et ceci en dressant un plan d’action gouvernementale qui soutient les acteurs publics et les entreprises qui supportent cette vision.
Afin d’atteindre les 29 objectifs fixés par le gouvernement québécois et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, des plans d’action ont été menés auprès de tous les ministères et organismes de l’administration publique. Le gouvernement a ainsi compris que le Développement durable n’était pas la question d’un seul ministère, mais de l’intégralité de la province, mais également de toutes les parties prenantes. Cet aspect écologique a donc été compris et intégré par cette province consommant pourtant énormément d’électricité et de pétrole (potentiel pétrolier s’estimant à plus de 46 milliards de barils, issus principalement des gisements de l’Île d’Anticosti) et pourtant 50 % de l’énergie consommée au Québec provient d’énergie renouvelable.

Figure 12 – Les tendances québécoises en matière de consommation d’énergie
La figure 12 représente les tendances québécoises en matière de consommation d’énergie. Ceci est donc le résultat d’une méthode de suivi appliquée et intéressante avec des commissaires en développement durable et des rapports annuels, voire trimestriels. De plus, le Québec a su se baser sur des indicateurs de performances permettant d’effectuer le suivi nécessaire à la réussite de l’aspect écologique dans cette province de l’Est canadien.
Desindicateursdeperformanceécologiqueàpondérer
L’indicedeperformanceenvironnementale
L’indice de performance environnementale, connu sous l’abréviation « IPE » est un indicateur permettant d’évaluer et d’améliorer les politiques écologiques et environnementales d’un pays. Ainsi, quatorze indicateurs sont utilisés pour évaluer la performance environnementale à travers six dimensions qui sont les suivantes :
La qualité de l'air; Les déchets; La quantité et la qualité de l'eau; La biodiversité et sa conservation; La gestion des ressources naturelles; Le changement climatique et l'efficacité énergétique.
D’après le classement fait en 2010, le Canada est mondialement classé 46e en matière de performance environnementale. Ainsi, le rapport qui découle de ce classement expose des faiblesses dans plusieurs domaines, incluant le changement climatique, l’intensité énergétique, smog, et génération de déchets ; ce qui amoindrit sa performance.
Déchetsurbains:est‐cequeleCanadaestune«sociétédujetable»?
Le Canada gagne un « D » pour les déchets municipaux produits par personne et se classe parmi les derniers de ses pairs. En 2008, le Canada a produit 777 kilogrammes de déchets municipaux par personne, bien au-dessus de la moyenne de 17 pays de 578 kg par personne.

En comparaison avec le Japon, le pays le plus performant pour cet indicateur, le Canada a produit plus que le double des déchets par personne.
Figure 13 – Productions de déchets municipaux au Japon
Source : OECD StatExtracts
Presque 34 millions de tonnes de déchets produites au Canada en 2008, 26 millions de tonnes sont dirigés vers des décharges ou des incinérateurs. Le reste a été détourné par le recyclage ou le compostage. Au fait, la mise en décharge est la façon la plus commune pour se débarrasser des déchets au Canada. Cependant, les décharges émettent le méthane (un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique) et le lixiviat de décharge cause la contamination d'eau, des surfaces et de l'eau souterraine. En conséquence, la réduction de ces dégâts causés par les déchets exige la minimisation de ces derniers, ainsi qu’un recyclage croissant et l’élimination des déchets restant d’une façon respectueuse à l’environnement.
LaproductivitéduCO2 auCanadaliéeauxchangementsclimatiquesetàlaqualitédel’air
Le Canada obtient « B » pour l'indicateur d'oxydes de soufre, ses émissions par personne sont 26 fois ceux du pays performant, la Suisse. C’est seulement par rapport à l'Australie que le Canada a de bons résultats. Si le pire interprète, l'Australie, a été écarté du groupe, le Canada recevrait un score de « D ». Le Canada a reçu un score « D » sur des émissions d'oxydes d'azote.
Le Canada est le pire interprète pour les émissions COV (composés organiques volatils). Les COV proviennent d'émissions de véhicules et des usines industrielles, et qui combinent avec des oxydes d'azote pour produire le smog et l'ozone troposphérique, menant à de graves impacts sur la santé.
Le défi principal du Canada est de réduire encore les polluants aériens urbains et régionaux par le contrôle de la pollution, le progrès technologique, les économies d'énergie et le transport durable limitant ainsi l’émission de certains gaz nocifs tels que le CO2.
Le taux d’émission du Dioxyde de Carbone fait référence à la contribution canadienne aux émissions mondiales de CO2 engendrées par la production et la consommation massive d'énergie issue de la combustion des produits combustibles. Ainsi, cet indice ne prend pas en considération les émissions de dioxyde de Carbone venant de sources non énergétiques qui ne nécessitent pas de combustion, à savoir le torchage de gaz ainsi que les émissions des autres gaz à effet de serre tels que l’oxyde de diazote (N2O), le méthane (CH4), les perfluorocarbones (PFC), l'hexafluorure de soufre (SF6) et enfin les hydrofluorocarbones (HFC).

Figure 14 – Le taux d'émissions de CO2 (Kg Par $ De PIB en Parité du Pouvoir d'Achat de 1990-2010)
Ainsi, selon le graphique, le taux d’émission du CO2 pour l'ensemble de la période 1990-2010, on enregistre une moyenne de 0,5. En effet, selon le graphique, ce taux atteint sa plus grande valeur en 1992 avec un taux d’émission de 0,55 qui va drastiquement chuter en 2010 pour atteindre la valeur de 0.4. Ainsi, on remarque que sur cette période, le taux d’émission du dioxyde de carbone a connu une chute de 31 % en 20 ans.
Se basant sur la tendance donnée par les variations du taux d’émission de CO2 sur la période 1990-2010, des estimations ont été faites pour 2015 stipulant que ce taux devrait se tenir à une valeur de 0,3. Il faut aussi mentionner le fait que ces prévisions ont été faites en se basant sur des statistiques garantissant une certaine fiabilité. En effet, les variations qu’a connues cet indicateur suivent une tendance relativement linéaire.
Au-delà de 2010, nous remarquons une chute graduelle du taux d’émission de CO2 pour arriver à une valeur de 0,31 en 2013 ce qui prouve que le Canada fournit des efforts pour faire face aux changements climatiques et pour atteindre les prévisions faites pour 2015.
Tableau 2 – Les émissions du dioxyde de carbone (kg par $ de PIB à parité de pouvoir d'achat de 2010-2013)
I. Émissions de CO2 (kg par $ de PIB à parité de pouvoir d'achat de 2010-2013)
II. 2010 III. 0.36
IV. 2011 V. 0.34
VI. 2012 VII. 0.33
VIII. 2013 IX. 0.31

L’efficacité énergétiqueauCanada
Favoriser l’utilisation de l'énergie renouvelable comme une partie de la consommation d'énergie totale devrait être un objectif politique majeur pour l’atténuation du changement climatique au Canada. Au fait, les sources renouvelables d'énergies (éolienne, marémotrice, solaire, verte, hydroélectrique et géothermique) produisent de faibles quantités d'émissions de gaz à effet de serre.
Figure 15 – Production d’électricité au Canada par source
Source: The Conference Board of Canada
En 2011, presque 78 pour cent d'électricité au Canada a été produit à partir de sources à faibles émissions (renouvelables et nucléaires); et grâce à ses ressources hydrauliques expansives, le Canada a reçu un « A » pour cet indicateur. Cependant, le Canada pourrait faire mieux afin d’augmenter sa part de production d'électricité à faibles émissions. À titre d’exemple, presque toute l'électricité de la Norvège est produite de sources hydroélectriques renouvelables.
La consommation d'énergie totale par unité de PIB (mesurée en millions de tonnes d'équivalent pétrolier (tep)) peut être utilisée comme un indicateur d’efficacité énergétique. Le Canada reçoit un « D » pour son intensité d'énergie en 2009, se classant en dernière place sur les 17 des pays. En 2011, Canada a utilisé 0.25 tep par 1,000 $ US de PIB, plus que la moyenne d'OCDE qui est de 0.15 tep par 1,000 $ US de PIB. L'Irlande est le pays le plus performant pour cet indicateur, suivi par la Suisse et l'Italie.
LacomparaisondelaperformanceenvironnementaleentreleCanadaetlespays«verts»
Pour pouvoir mieux apprécier ses efforts en matière d’écologie, nous avons procédé à une comparaison entre le Canada et certains pays reconnus pour leurs performances écologiques :

Figure 16 – La performance environnementale du Canada comparée aux pays de référence écologique
Si l’on se réfère au graphique, nous remarquons que le Canada est classé en cinquième position selon l’indice de performance environnementale. En effet, le pays est dépassé par l’Australie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Norvège. De plus, le Canada est de loin dépassé par le Japon, les États-Unis d’Amérique et les autres pays cités précédemment en matière de productivités des ressources.
Aussi, nous remarquons les efforts fournis par le Canada concernant la réduction d’émission du dioxyde de carbone. Le Canada est classé comme étant l’un des rares pays à faire attention à la présence du CO2 dans l’air.
L’indiceduprogrèsvéritable
L’indice de progrès véritable (Genuine Progress Indicator - IPV), proposé par Harvey Mead a pour objectif de mesurer le bien-être économique réel d’un pays ou d’une société pour pouvoir mieux apprécier l’évolution du bien-être et de la qualité de vie d’une population sans se baser sur le PIB. En effet, cet indice vise à corriger les lacunes et les limites du PIB et ceci en intégrant des variables sociales et écologiques du mode de vie de la population concernée.
Figure 17 – PIB et IPV du Québec par habitant
Source : HarveyMead.org

Selon le graphique ci-dessus, la valeur de l’IPV par habitant sur toute la période 1970-2009 passe de 10 017 $ à 17 355 $ en 2009, soit une évolution de 73 % sur une période de près de 40 ans. Ainsi, sur la même période, le PIB/habitant, quant à lui, a connu une importante augmentation de 95 % passant ainsi de 17 233 $ à une somme de 33 589 $. Ainsi, nous assistons à une comparaison illustrant une différence flagrante entre les deux indicateurs ce qui nous mène à remettre en cause les efforts du Québec à garantir un bien-être social.
Au terme de cette première partie, nous pouvons comprendre le lien qui existe entre l’abondance de ressources présente au Canada et les politiques gouvernementales mises en place à différents niveaux institutionnels (fédéral, provinciaux). Tant les contrastes sont nombreux, il est impossible de qualifier le Canada comme un pays moteur contrairement aux pays scandinaves qui sont en tête du classement depuis de nombreuses années. En effet, il est maintenant ancré dans leur culture que l’aspect écologique est essentiel à la survie, mais surtout au développement et à la prospérité de l’état. À l’heure actuelle, le fait de performer écologiquement devient donc primordial pour enclencher de la croissance au niveau économique. Nous pouvons clairement établir ce lien direct ou indirect (selon le point de vue adopté) entre l’aspect environnemental et la croissance du pays. Suivant cette même logique (selon J.Gadrey et A. Lipietz, 2013), il existe un « découplage » entre la croissance du Produit Intérieur Brut et la réduction de l’empreinte écologique et plus largement donc entre la croissance du P.I.B. et la performance de l’état d’un point de vue de développement durable.
Le Canada, malgré son abondance de ressources, tente de réguler et de limiter l’impact de ses activités économiques sur l’environnement depuis maintenant plus de 30 ans. Rares sont les pays qui dès les années 80 avaient déjà adopté certaines réformes, certaines lois ou certains plans afin d’introduire cette notion de développement durable. Cependant, force est de constater que le Canada n’est pas un modèle puisque les décisions restent encore trop dispersées et que la force et l’intérêt des réformes et plans c’est qu’ils soient appliqués de la même manière partout. Mais via nos indicateurs de performance écologique, nous avons pu renforcer l’idée de dire que certaines provinces sont beaucoup plus impliquées que d’autres dans cette démarche impérative. À ce niveau-ci de réflexion, nous sommes capables de reconnaître la qualité du Canada qui fût un précurseur, mais qui tarde à devenir un réel moteur et un exemple pour le reste de la planète. Il reste toutefois une nuance à soulever. Malgré l’abondance de ces ressources diverses et variées, le Canada cherche à implémenter davantage de règles et de conformités afin de réduire les répercussions écologiques de ses activités économiques.
2 QUELLESSONTCESENTREPRISESCANADIENNESQUICONCILIENTÉCONOMIEETÉCOLOGIEÀLEURMODÈLED’AFFAIRES?
Avant de débuter cette seconde partie de notre recherche, il est important de définir et de comprendre ce qu’est une entreprise intégrante économie et écologie dans son modèle d’affaires. En effet, l’objectif de cette démarche de conciliation au sein d’une organisation est de créer de la valeur additionnelle à l’aide d’un élément écologique. Cet élément ne vient pas se greffer sur le modèle d’affaires existant, mais il est une composante à part entière dans le modèle d’affaires de celle-ci. Cette notion de conciliation est extrêmement importante puisqu’un grand nombre d’entreprises pensent que d’ajouter une touche écologique dans leurs activités leur permet d’être qualifiées comme des sociétés écologiques et soucieuses de l’environnement dans lequel elles évoluent.

Dans cette section, l’intérêt est de démontrer qu’outre le simple fait de créer de la valeur supplémentaire via un aspect écologique, ces entreprises canadiennes ont su se démarquer par des démarches singulières et innovantes afin qu’elles se développent davantage toujours dans le souci d’améliorer leur compétitivité à l’échelle nationale ou internationale. Cependant, une question réside : est-ce que ces innovations poussent à l’émulation? C’est ce que nous allons démontrer à l’aide de cette partie et de ces exemples qui ont su se démarquer.
2.1 Desentreprisescanadiennesfaisantunrecentragesurleurscompétencesclés
Solegear,Vancouver
Une entreprise de l’Ouest canadien a su concilier développement durable et s’imposer sur le marché mondial, c’est Solegear bioplastiques. Solegear est l’une des premières entreprises à développer des matériaux et emballages plastiques faits à base de plantes, biodégradables et non toxiques pour des marques mondiales. L’entreprise commercialise ses bioplastiques performants faits à base de Polysole et Traverse.
Le Polysole fabriqué à partir de plantes, et qui est non toxique et biodégradable peut être utilisé pour la fabrication d’emballage de produits de beauté ou de jouets. Le Traverse, fait de plastique récemment recyclé et combiné avec des fibres naturelles telles que le bois, la balle (céréale), le chanvre ou encore le bambou, peut être utilisé pour la fabrication de produits moulés par injection tels que des chaises longues, des pièces automobiles et aussi des composantes électroniques.
Contrairement à beaucoup d'autres fabricants de bioplastiques, Solegear utilise de « la chimie verte » comme base de développement de ces produits. Cela signifie qu’il veille à ce que les matières premières utilisées pour créer le bioplastique soient les plus naturelles et biologiques possibles sans ajout d’aucune substance toxique que ce soit.
Cette innovation durable a permis à Solegear Bioplastique de remporter le titre de « Meilleur biocarburants/bioénergie » pour la compétition Global Cleantech Cluster Association (GCCA) en 2013. Solegear a maintenant des bons de commande et des expressions d'intérêt d'une valeur estimé à 6 millions de dollars.
Enerkem,Montréal
Du côté du Québec, une autre entreprise a su se démarquer durablement et écologiquement, il s’agit d’Enerkem. L’entreprise crée des biocarburants et produits chimiques renouvelables à partir de déchets. Enerkem transforme les déchets et résidus en un gaz de synthèse pur qui est ensuite utilisé pour la production de biocarburants et de produits chimiques à l’aide de catalyseurs disponibles sur le marché. Cette dernière est en mesure de recycler chimiquement les molécules de carbone à partir de déchets non recyclables et de les transformer en différents produits verts, comme l’éthanol cellulosique.

La plate-forme technologique d'Enerkem est un procédé thermochimique de 4 étapes qui consiste à :
1. une préparation de la matière première 2. une gazéification 3. un nettoyage et un conditionnement du gaz de synthèse 4. une synthèse catalytique
Figure 18 – Technologie thermochimique exclusive d’Enerkem
Source : Enerkem
Enerkem et Éthanol GreenField ont l'intention de construire la première usine d'éthanol cellulosique à grande échelle du Québec. Cette installation sera construite et exploitée par Éthanol Cellulosique Varennes, une coentreprise formée par Enerkem Inc. et Ethanol GreenField Inc et sera située à Varennes, près de Montréal (à côté de la première usine Ethanol GreenField Inc).
L'usine de Varennes utilisera la technologie exclusive d'Enerkem pour produire de l'éthanol cellulosique à partir de déchets non recyclables des secteurs institutionnels, commerciaux et industriels ainsi que des débris de construction et de démolition. La capacité de production de l’usine est estimée à 38 millions de litres par an.
D’autant plus que le gouvernement du Québec prévoit injecter 27 millions de dollars à ce projet pour qu’il voie le jour et ceci avec le support du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et d’Investissement Québec.
La chimie verte d'Enerkem devient alors une source d'énergie propre et se présente aussi comme une solution durable et écologique à l'enfouissement et l'incinération.
2.2 Desentreprisescanadiennesréinventantl’essencemêmedeleurmodèled’affaires
Energold,Vancouver
Energold, est une entreprise opérant dans le domaine de forage minier dans l’Ouest canadien ayant su concilier sa croissance économique et le développement durable.

Les risques environnementaux associés aux puits de pétrole et à l’extraction pétrolière par les mines ou à ciel ouvert laissent souvent des cicatrices environnementales importantes. Il est important de notifier que la cause inhérente de ces séquelles n’est pas seulement due à l'activité d'exploration directement. En effet, l’élément qui cause le plus de dégâts environnementaux est le transport nécessaire de tous les équipements lourds du lieu de stockage jusqu’au point d’extraction (souvent situé dans des endroits éloignés et difficiles d’accès), mais également le rapatriement du pétrole jusqu’au point de stockage.
L’entreprise Energold Drilling Corp. a développé une solution plus propre pour accéder à ces zones-là plutôt que de détruire des étendues de faune et de flore. À la suite de la modification du modèle d’affaires, Energold s’axe sur une stratégie de développement durable combinée à ses activités économiques. Le système de forage utilisé par Energold est composé de matériaux portables ne dépassant pas les 160Kg, peut être déplacé avec plus d’aisance et monté une fois sur place. Contrairement aux projets de forage prévu dans les régions densément boisées ou dans les régions éloignées (où l’approche habituelle est de procéder à la déforestation de la zone afin d’y accéder par voie routière), Energold utilise des plateformes mobiles et modulaires. Avec cette adaptation, les sentiers tracés par l’entreprise ne dépassent pas un mètre de largeur pour se rendre sur place. Ces initiatives et cette conciliation écologie-économie au sein de l'entreprise sont axées sur la promotion des activités de forages durables, c’est-à-dire en ayant le minimum de répercussions négatives sur l’environnement tout en jouant incluant la dimension sociale à ces changements.
Energold compte parmi ses grands clients des géants de l'industrie pétrolière tels que BHP Billiton PLC, Goldcorp Inc. et Barrick Gold Corp. En 2011, Energold a enregistré un bénéfice de 26,4 M$ sur des revenus de 133,5 M$ et depuis cette instauration a augmenté son chiffre d’affaires de près de 30 %. Pure coïncidence ou réelle répercussion?
BionestTechnologieInc.
La contamination de l'eau devient un enjeu important. L’entreprise québécoise, Bionest Technologies Inc. a développé un système de traitement avancé des eaux usées qui est remarquablement efficace. Depuis 1997, Bionest veille sur le développement de systèmes de traitement des eaux usées efficaces pour résoudre deux problèmes importants liés à nos ressources en eau : l'utilisation abusive de l'eau traitée et la contamination des eaux souterraines, mais aussi des bassins d'eaux.
Le système de traitement Bionest utilise un procédé de filtration biologique sur la base d'une culture microbienne fixée à un support non biodégradable, combiné avec une alternance de traitements aérobies et anaérobies. Cette technologie se particularise grâce à ses procédés brevetés uniques qui permettent aux bactéries du biofilm de se fixer efficacement et procurer une plus grande surface active pour les réactions de nitrification et de dénitrification. En tant que société de technologie, Bionest, fabrique et commercialise des solutions de traitement des eaux usées de pointe qui ont fait leurs preuves en augmentant la purification de l'eau à un niveau nettement au-dessus des normes mondiales. Avec plus de 25 000 systèmes disposés partout dans le monde, Bionest à une grande notoriété auprès du Canada, des États-Unis, des Caraïbes, du Costa Rica, de la France ainsi que des Émirats Arabes Unis et du Qatar. La qualité exceptionnelle de l'eau traitée par le système BIONEST lui permet d'être réutilisée, déversée dans le sol ou dans les cours d'eau, sans effet négatif sur la flore et la faune.

2.3 Desentreprisescanadiennesfaisantappelàdestechnologiesinnovantesvertes
Afin de dégager la spécificité de ces entreprises, il a fallu connaître les sociétés qui ont supporté ces changements de modèle d’affaires. Au Québec, nous comptons dans nos rangs Rackam, une entreprise hébergée à Sherbrooke et spécialisée dans la construction du monde de demain en développant et en implantant des procédés thermiques et solaires qui sont à la fois rentables et efficaces. Cette jeune structure a mis au point depuis quelques années deux outils extrêmement efficaces permettant de capter l’énergie solaire afin de la traduire dans des industries de différents secteurs.
CascadesdeKingseyFalls,Québec
Tout d’abord, l’entreprise Rackam a implanté chez Cascades (fabricant de pâtes et papiers) une centrale thermosolaire visant à remplacer une partie de la consommation de gaz via une énergie solaire beaucoup moins polluante et soucieuse de l’environnement. Cette innovation appelée S20 par Rackam fut la première installation de capteurs à concentration solaire paraboliques d’une telle ampleur sur le sol québécois. Tel qu’on le voit dans la figure 19, le produit installé au sol peut à la fois résister aux intempéries et aux conditions climatiques telles que la pluie, la neige et les vents forts. Équipée d’une sonde météorologique, cette installation peut également appréhender les tempêtes afin de se mettre en position telle que celle-ci n’est pas menacée en cas de très mauvaises conditions atmosphériques.
Figure 19 – Installation solaire 3D Rackam implantée chez Cascades
Source : Rackam.com
Cet outil à la pointe de la technologie installée dans l’Est québécois a permis à Cascades de réaliser la bagatelle énergétique de 4400 GJ par an en remplaçant l’apport en énergie au gaz d’une bouilloire industrielle. D’un point de vue environnemental, cet investissement pour demain a permis la réduction des gaz à effet de serre de 265 tonnes de CO2 annuel, mais également de propulser l’image d’une entreprise verte, innovatrice et rentable.

LaiterieChagnondeWaterloo,Québec
L’exemple de Laiterie Chagnon (fabricant de produits laitiers) est également une prouesse liée à la technologie de Rackam. Dans le secteur agroalimentaire, l’apport énergétique en chaleur est extrêmement important à différents stades de la création des produits (chauffage, lavage, pasteurisation).
En effet, afin d’avoir l’énergie en assez grande quantité, les industriels du secteur ont recours à des chaudières au gaz naturel. Dans ce cas précis, c’est une facture de 120 000 $ (250 000 m3 de gaz) que devait s’acquitter annuellement la Laiterie Chagnon. À l’aide des technologies Hicarus Heat et d’une thermopompe adaptée plus généralement à des toits plats, cette entreprise a pu basculer vers un système d’énergie solaire lui permettant une optimisation de l’utilisation d’énergie. La répartition de l’utilisation de chaleur de la laiterie est illustrée ci-dessous.
Figure 20 – Répartition de la consommation de chaleur à la Laiterie Chagnon
Source : Rackam
Après le développement et l’installation de ces nouveaux procédés, cette laiterie a pu réaliser des économies de coûts de près de 70 % avec un délai de récupération de 6 ans avant subvention de l’état fédéral et de la province. Ceci n’a quand même pas pu intégralement se substituer à l’énergie de base, mais a permis la réduction de 60 000 m3 de gaz naturel annuel en obtenant une baisse des coûts énergétiques ainsi qu’une optimisation des éléments internes à l’entreprise. Ces chiffres sont présentés dans la figure ci-dessous :

Figure 21 – Projet thermosolaire installé à la Laiterie Chagnon
Source : Rackam
2.4 Lecasparticulierdelasphèresocio‐éducative
Si une société cherche à devenir un précurseur en matière de développement durable, elle doit considérer les 3 sphères abordées précédemment soit l’aspect économique social et écologique. En d’autres mots si l’on veut veiller à concilier les aspects économie et écologie, l’humain demeure la clé afin de créer cette synergie de manière innovante. En ce sens, s’attarder sur leur éducation devient primordial, puisqu’elle façonne les valeurs de tout un chacun. Cette réflexion a donc pu éclairer notre choix pour l’entreprise suivante.
L’OIECEC
L’Organisation Internationale des Écoles Communautaires Entrepreneuriales Conscientes, l’OIECEC pour le bien de cet essai, a vu le jour en 2011 au Québec. Cependant, l’initiative des Écoles Communautaires Entrepreneuriales Conscientes, ou simplement ECEC, a fait ses premiers pas comme modèle d’affaires dans la province en 1999. Il met à l’avant-plan une vision innovante de l’éducation en ayant pour principale mission que l’école soit « au service de chaque élève, en prenant appui sur une culture entrepreneuriale durable et des partenariats avec les communautés » (OIECEC, 2014). Selon Jean-Sébastien Reid, directeur pédagogie et innovation à l’OIECEC, l’élève devient le cœur de différentes formes d’entrepreneuriat, notamment l’entrepreneuriat de soi, afin qu’il se conscientise lui-même de l’impact de ses choix. Dans ce modèle novateur se distinguant du modèle classique de l’éducation québécoise, le jeune développe entre autres des projets à saveur écologique afin d’en faire bénéficier son école, sa communauté et lui-même. Par exemple, l’école Cœur-Vaillant à Québec, dont monsieur Reid était auparavant directeur, a développé sa propre usine de pâtes et papiers afin que l’école soit autosuffisante à ce niveau. D’autres projets liés à la gestion de l’eau potable notamment ont aussi pris forme au sein de cette école pilote de l’OIECEC.
Au sens propre, le principe de « culture » peut prendre plusieurs formes. Globalement, ce qu’il faut retenir c’est que cette culture comprend l’ensemble complexe de comportements et courant de pensée de savoirs qui sont partagés par des individus. Par-dessus tout, la notion la plus importante de cette théorie d’Edward Burnett Tylor réside dans le caractère acquis, et non inné de la culture.

Sachant que cette culture est acquise, l’éducation devient donc une ressource inestimable pour la forger. En intégrant donc au quotidien des valeurs de développement durable, nous parviendrons peut-être à créer ce levier qui pourrait différencier le Canada sur la scène internationale.
3 CONCLUSION
Au terme de notre étude, nous pouvons nous apercevoir que la situation canadienne laisse bien évidemment transparaître des doutes quant à son efficacité et son efficience d’un point de vue environnemental. En 1973, le Canada fût précurseur et a su durant de nombreuses années se démarquer des autres pays pour ses stratégies et ses initiatives écologiques. Depuis le début des années 2000, il réside un décalage entre les volontés et les actions concrètes pour mener à bien les objectifs. À l’aide de notre première partie, nous avons donc pu dresser un portrait et découvrir un Canada désormais suiveur en la matière, mais qui laisse entrevoir des possibilités de redressement grâce tout de même à une province qui a pris conscience de l’enjeu environnemental : le Québec. Cette province de l’Est canadien jouit de ressources naturelles importantes (bois, eau, pétrole…), mais tente tout de même de mettre en place une réglementation afin d’inciter des démarches responsables. Ces efforts se concentrent à trois niveaux pour des publics différents : gouvernement, industries, citoyens.
Le cœur de la présente recherche portait sur les impératifs écologiques et économiques du point de vue des industries et nous avons pu identifier, malgré la singularité de leurs actes, que des entreprises ont su concilier écologie et économie au sein de leur modèle d’affaires. Selon leur démarche, il était important de regrouper ces entreprises canadiennes selon leur spécificité. Premièrement, nous avons mis de l’avant des entreprises ayant joué sur leurs compétences clés; deuxièmement, ce fut des entreprises ayant réinventé l’essence même du modèle d’affaires; quant à d’autres, elles ont fait le choix d’opter pour des technologies innovantes vertes en les incluant dans leur procédé industriel. Il est ainsi nécessaire de comprendre que concilier écologie et économie est un processus d’apprentissage long et complexe si l’entreprise n’est pas née de cette manière. Il nous semble donc important de rappeler que c’est grâce à l’implication de tous que cette conciliation est réalisable même post-création. Cependant, un dernier élément reste à considérer, une implication de tous uniquement interne à l’entreprise n’est pas suffisante; c’est une implication et une intégration de toutes les parties prenantes dans ce processus qui sont nécessaires afin de mettre en place une conciliation efficace et efficiente sur le long terme.

4 RÉFÉRENCESBIBLIOGRAPHIQUES
Livres
TYLOR, E. B. The origins of culture, Harper Torchbooks, New-York, 1958, 416 pages.
Publications
Bowley, P. M. (1997). The committee on lands of the conservation commission, Canada, 1909-1921: Romantic agrarianism in Ontario in an age of agricultural realism. Scientia Canadensis, vol. 21, 67-87
Chad, N. Sustainable Development: Evolution of the Canadian Approach, Décembre 2003
Chassin, Y. La réalité énergétique du Québec, Institut économique de Montréal, 2013 Dictionnaire Larousse, Abondance, en ligne http://www.larousse.fr/ , page consultée le 9
novembre 2014 Environnement Canada, page consultée le 21 novembre 2014, en ligne :
https://ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=C2844D2D-1 Le Monde, Chine et États-Unis concluent un accord inédit sur le climat, 12 novembre
2014, en ligne : http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/12/chine-et-etats-unis-concluent-un-accord-inedit-sur-le-climat_4522109_3244.html
MarketLine, Country Profile Series - Canada: In-depth PESTLE insights, novembre 2013 disponible sur www.marketline.com
MarketLine, Country Profile Series - Russia: In-depth PESTLE insights, juin 2013 disponible sur www.marketline.com
National Round Table on the Environment and the Economy (2013). Building a sustainable future: The legacy of Canada’s National Round Table on the Environment and the Economy, 32 p.
Organisation des Nations Unies, Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement – Principes de gestion des forêts, 1992, en ligne : http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm
Rapport Annuel, L’état des forêts au Canada, Gouvernement du Canada, 2014 Rapport Annuel « Indicateurs québécois de développement durable », Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Août 2010 Statistiques Canada, Recensement 2011, http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/index-fra.cfm Stratégie Gouvernementale de développement durable 2008-2013 « Un projet de société
pour le Québec », Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008 World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Brundtland
Commission Report, Oxford University Press, Oxford, 1987. Disponible en ligne: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

SitesInternet
L’Association Canadienne des Producteurs Pétroliers, Sables Bitumineux maintenant, page consultée le 21 novembre 2014, en ligne : http://www.sablesbitumineuxmaintenant.ca
BCBUSINESS, page consultée le 9 novembre 2014, en ligne : http://www.bcbusiness.ca/manufacturing-transport/solegear-bioplastics-inc
BioNest, page consultée le 21 novembre 2014, en ligne : http://www.bionest-tech.com/QC-en/about-bionest.html
Business Vancouver, page consultée le 9 novembre 2014, en ligne : http://www.biv.com/article/2014/11/us-china-climate-deal-puts-canada-under-gun/
Energold, page consultée le 21 novembre 2014, en ligne : http://www.energold.com Environnement Canada, page consultée le 14 octobre 2014, en ligne :
https://www.ec.gc.ca/ OIECEC, page consultée le 21 novembre 2014, en ligne : http://www.oiecec.org Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Les forêts et le
secteur forestier, page consultée le 8 novembre 2014, en ligne : http://www.fao.org/forestry/country/57478/fr/can/
Rackam, page consultée le 21 novembre 2014, en ligne : http://www.rackam.com Solegear, page consultée le 21 novembre 2014, en ligne : http://www.solegear.ca Université Alberta, page consultée le 9 novembre 2014, en ligne :
http://www.expressnews.ualberta.ca/article.cfm?id=10656 WWF, page consultée le 21 novembre 2014, en ligne : http://www.wwf.ca

EXPÉRIENCES DES ENTREPRISES JAPONAISES
Maïté Bernard, [email protected] Maïlys Carlesso, [email protected]
Jean-Romain Cordier, [email protected] Charles Desbrosses, [email protected]
Olivier Devinck, [email protected]
Résumé
Les classements montrent que les entreprises japonaises sont écologiquement responsables et économiquement rentables. Elles ont su développer des modèles organisationnels et industriels (Toyotisme, 5S et 3R) faisant de l’écologie une composante clé de la productivité, notamment par la lutte contre le gaspillage. L’utilisation de ces modèles est très répandue au sein des entreprises japonaises, tous secteurs confondus. Les entreprises adaptent également leur offre en proposant des produits écologiques et à la pointe de la technologie. Cependant, nous allons voir que l’histoire du Japon a tendance à remettre en cause la bonne foi des entreprises japonaises. Après la 2e Guerre mondiale, le Japon est entré dans une période de forte croissance économique ayant eu des effets très négatifs sur l’environnement. Le rôle des institutions publiques a été crucial dans la mise en place d’une croissance verte. Les modèles organisationnels et industriels japonais n’ont pas été créés ex nihilo, mais grâce à un interventionnisme étatique fort. En outre, le respect de la nature fait partie intégrante de la culture japonaise. L’État a donc eu plus de facilité à éduquer et sensibiliser les citoyens (consommateurs) au respect de l’environnement. Aujourd’hui, on note des prises d’engagement au niveau mondial témoignant de la volonté des États de relever les défis écologiques. Le Japon étant en avance sur la gestion des défis environnementaux, il est aujourd’hui considéré comme un exemple à suivre en la matière.
INTRODUCTION
Ces 20 dernières années, la croissance économique a sorti plus de 660 millions de personnes de la pauvreté et accru les revenus de millions d'hommes et de femmes. Entre 1992 et 2010, le PIB mondial a progressé de près de 75 % et le PIB par habitant de 40 %, améliorant ainsi le niveau de vie global, et permettant à des centaines de millions de personnes de sortir de l’extrême pauvreté (source : travaux de l’OCDE, juin 2012), une croissance verte incluse pour l’avenir que nous voulons).
Or cette croissance se réalise souvent au détriment de l'environnement. Les données de la Banque Mondiale montrent que de 2005 à 2010, la quantité d’émission de CO2 n’a cessé d’augmenter (d’environ 4,6 à presque 5 tonnes par habitant), et a même crû plus rapidement que la croissance mondiale qui n’a pas dépassé 4 % sur la période. En effet, après la prise de conscience des défis environnementaux par les institutions publiques mondiales, il semble qu’un certain attentisme sur fond d'inquiétude diffuse (augmentation des prix du pétrole, la perspective d'épuisement des hydrocarbures dans les 30 ou 40 prochaines années) règne désormais. Nos besoins, en tant que terriens, sont de plus en plus importants. Deux facteurs principaux en sont la cause : la croissance démographique (la population passera de 6,2 milliards d'habitants en 2000, à 9,2 milliards en 2050) et le niveau de vie global de la population augmentant, la consommation des ressources ne pourra qu'accélérer. Il faut donc agir!
Dans son rapport sur L’économie du changement climatique en 2006, Nicholas Stern évaluait à 1 % du PIB le coût des efforts à entreprendre pour éviter un trop fort réchauffement climatique, et à 5 % le coût de l’inaction. L’écologie serait donc un facteur de croissance? C’est en tout cas une idée loin d’être saugrenue selon les consommateurs.

L’étude Greening Household Behaviour : Overview from the 2011 Survey, réalisée dans 11 pays, et publiée par l’OCDE en 2014, constate que 70 % des individus interrogés pensent que l’écologie est un moyen de relancer la croissance économique.
Nous verrons dans ce dossier que cette idée est totalement applicable, et appliquée, dans la réalité. L’exemple des entreprises japonaises nous permettra d’illustrer cette affirmation. Tout au long de ce dossier, nous étudierons donc comment les entreprises peuvent concilier impératifs économiques et écologiques, en nous concentrant sur les exemples de réussite d’entreprises japonaises.
Dans un premier temps, il conviendra de faire un état des lieux de la performance des entreprises japonaises sur les scènes économiques et écologiques mondiales. Dans un second temps, nous expliquerons les raisons de ces réussites en détaillant trois modèles organisationnels typiquement japonais que sont le Toyotisme, les 3R et les 5S et leurs applications concrètes dans l’entreprise japonaise. Cependant, nous nous demanderons dans une troisième partie si ces modèles peuvent être réellement une source d’inspiration pour les entreprises de culture différente. Ce sera l’occasion de prendre du recul sur l’exemplarité des entreprises japonaises qui n’ont pas toujours été des modèles de vertu écologique. Elles sont avant tout des acteurs économiques, que l’État a eu besoin d’éduquer afin de les mener vers une croissance à long terme, fondées sur le respect de l’environnement.
1 LEADERSHIPDESENTREPRISESJAPONAISES
1.1 Liensentrepratiquesécologiquesetperformanceséconomiques
Tableau 1 – Classement des plus grandes entreprises japonaises au niveau écologique et économique en 2013

Dans le classement publié par le magazine Fortunes en 2013, les entreprises japonaises Toyota, Honda, Panasonic, Nissan, Sony, et Canon font partie des 500 entreprises les plus performantes du monde. Parallèlement, le classement des Best Green Global Brands publié la même année par le cabinet Interbrand souligne que, parmi les 15 sociétés les plus respectueuses de l’environnement au niveau mondial, cinq sont japonaises. Ces dernières confirment donc qu’être performant économiquement et écologiquement, c’est possible!
1.2 Desexemplesdeleadership
Nous allons analyser ci-dessous d’autres entreprises japonaises représentant des succès économiques, notamment grâce à leur gestion des défis écologiques. Toutes les entreprises citées dans cette partie sont certifiées ISO 14001 pour l’ensemble de leurs sites de production.
Pour différentes raisons que nous détaillerons dans les parties suivantes, le Japon se positionne comme un précurseur en matière de technologie verte. Toyota a, par exemple, été le premier constructeur automobile mondial à lancer une voiture hybride en 1997. Aujourd’hui, ce modèle est un succès pour la marque nippone. En 2013, 1,28 million de véhicules hybrides de Toyota ont été vendus dans le monde, et les prévisions pour 2014 sont de 1,30 million de ventes. La marque a d’ailleurs étendu cette gamme de produits. Ses modèles hybrides représentent 30 % de ses ventes totales en Europe occidentale, d’après Didier Leroy, patron des activités du Groupe sur le continent.
L’entrevue avec Jean-Yves Jault, Senior General Manager chez Toyota Motor Europe, nous a confirmé la place prépondérante du respect de l’environnement dans les valeurs et la culture de l’entreprise. À partir des années 1990, l’entreprise a développé dans ses installations des plans environnementaux visant à développer, dans l’ensemble de leurs sites de production, des méthodes de lutte contre le gaspillage des ressources, le non-enfouissement des déchets, et la limitation de la consommation d’eau.
L’entreprise Panasonic a su également mettre à profit des principes environnementaux au service de sa stratégie d’internationalisation, afin de conserver un avantage compétitif. Un des objectifs environnementaux à long terme fixés par la communauté internationale est de réduire les émissions de CO2, et autres gaz à effet de serre, de 50 % par rapport au niveau de 2005, d'ici à 2050. Pour cela, Panasonic a mis en place un « outil de mesure de la contribution à la réduction des émissions de CO2 » qui permet d'accélérer la réduction des émissions, ciblant à la fois les produits (pour les économies d'énergie et la création d'énergie), et les activités de production. Par ailleurs, la marque a créé en 2010 le « Plan Vert 2018 ». Elle y indique les domaines sur lesquels elle se concentrera dans le cadre de son engagement pour la protection de l’environnement : la réduction des émissions de CO2 et de l’utilisation de substances chimiques, et le recyclage des matières premières et de l'eau. La politique environnementale annuelle est commune à toutes les filiales internationales à travers le « Global Manufacturing Division Operation Policy Meeting », édité par le directeur général responsable de la gestion de l'environnement.
Le Nissan Green Program 2016 (NGP2016) est le nouveau plan d'action environnemental lancé par Nissan sur six ans. Ce programme fixe des objectifs chiffrés, et prévoit la mise en place de plans d'actions écologiques dans tous les domaines d’activités de l’entreprise (production, innovation, fabrication, marketing, et les ventes à d'autres divisions). Le Département de la planification de l'environnement, qui fait partie de la Division du Développement des Affaires et la Planification d'entreprise, fut créé en 2007.

La diminution des gaz à effet de serre est l’un des objectifs majeurs de Nissan. L’entreprise souhaite également augmenter de 25 % l’utilisation de matériaux recyclés, et réutiliser l’eau au sein de sa chaîne de production. Elle s’efforce de sensibiliser ses employés aux problèmes environnementaux et, dans une certaine mesure, de sélectionner des fournisseurs s’engageant à respecter l’environnement.
Quant à Sony, cette entreprise cherche à obtenir une empreinte écologique zéro tout au long du cycle de vie du produit. C’est le projet « Road to Zero ». Un des leviers d’action choisis par l’entreprise pour protéger l’environnement est donc le développement des technologies vertes. La mise en pratique de ces stratégies environnementales est insufflée à toutes les filiales du groupe. Un bureau dédié essentiellement à la question écologique leur donne les directives en fonction des contraintes qu’elles rencontrent dans leurs régions respectives. L’entreprise mise sur la R&D pour réduire ses émissions de CO2, ainsi que sur l’utilisation d’énergies vertes (panneaux solaires ou éoliens).
Ces exemples de pratiques environnementales des entreprises japonaises témoignent de leur capacité à intégrer de bonnes pratiques écologiques à leur business model. Cependant, être écologique est souvent vu par les entreprises comme une contrainte, car cela nécessite des investissements financiers. Introduire des pratiques plus vertes au sein des entreprises est donc synonyme de coûts supplémentaires, de temps, de l’énergie, et ne semble pas apporter de vraie valeur ajoutée (économiquement parlant) au système organisationnel ou au produit en lui-même. Les entreprises ont donc deux solutions : reporter cette augmentation des coûts sur le prix de vente, et risquer de perdre leurs consommateurs et des parts de marché, ou réduire leur marge. Or si les entreprises japonaises sont si performantes aujourd’hui, c’est justement parce qu’elles ont su développer des modèles industriels et organisationnels faisant de l’écologie un avantage concurrentiel, tant au niveau des procédés internes qu’au niveau des produits finaux, et non un coût de production supplémentaire. Concilier impératifs écologiques et économiques, c’est donc faire de l’écologie un atout et non une contrainte.
2 MODÈLESDESENTREPRISESJAPONAISES
2.1 Différentsmodèlesjaponaisdeconciliationdesimpératifséconomiquesetécologiques
Les entreprises japonaises ont développé des modèles organisationnels, et ont adapté des modèles industriels existant dans d’autres pays, afin de maximiser leur réactivité (juste-à-temps, réduction des cycles de production, changements rapides de production), leur flexibilité (travail en équipe, progrès permanents), et leur efficience (lutte contre le gaspillage, notion de plan de production).
LamaisonToyotaetletoyotisme
La maison Toyota est probablement la référence la plus répandue dans le monde en terme de méthodologie et d’organisation. Elle possède des fondations (valeurs de l’entreprise), des piliers (axes d’organisation), et un toit (objectifs principaux). Les valeurs de l’entreprise telles que le respect du personnel, l’amélioration continue, et la suppression du gaspillage sont à la base de l’ensemble de la construction des fondations supérieures (axes d’organisation et

objectifs). Les piliers de la maison sont composés du « Jidoka » (organisation) et du juste-à-temps. Enfin, la satisfaction des clients, des employés, et la propriété de Toyota font partie intégrante du toit. L’organisation de l’entreprise, au service des impératifs économiques de production de valeur, est fondée sur un impératif écologique majeur : la suppression du gaspillage.
Comme nous l’avons remarqué dans le Tableau 1, Toyota est classée, en 2013, comme étant l’entreprise la plus écologique au monde. Cela s’explique par son système organisationnel développé par l'ingénieur T. Ohno, ancien dirigeant de Toyota. Ce dernier est d’ailleurs considéré comme le « père spirituel » (Source : Yvon Pesqueux, Jean-Pierre Tyberghein, 2009, ‘L’école japonaise d’organisation’) de « l’école japonaise » d’organisation représentée dans la Figure 2.
Après la récession, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon envoie de nombreux ingénieurs aux États-Unis afin qu’ils apprennent et intègrent les méthodes américaines de production (fordisme chez General Motors) dans les entreprises japonaises. Cependant, ces ingénieurs japonais, dont T. Ohno, considèrent que, bien que le fordisme soit une méthode efficiente, elle pourrait l’être davantage si elle n’augmentait pas les stocks de manière si importante. En effet, stocker coûte cher : il faut des entrepôts, il faut faire des commandes aux fournisseurs de produits pour les utiliser finalement plus tard, engendrant une avance de capital. Toutefois, ne pas avoir de stock peut poser un problème de délais importants entre la commande et la fabrication du produit fini. De plus, le fordisme n’offre aucune solution concernant les défauts de fabrication, car il n’existe aucun contrôle qualité. Cette analyse permet à T.Ohno de développer le Toyotisme en 1962. Ce modèle peut être considéré comme une sorte de fordisme (standardisation, chaîne de production) amélioré, visant à réduire les coûts de production par la suppression des stocks et des défauts de production (contrôle-qualité), ainsi que des délais entre commande et production.
Les5Setlelean management
Plusieurs auteurs (dont Kobayashi, Fisher, et Gapp 2008) soulignent que la culture et le mode de vie japonais sont à l’origine du concept de la méthode des 5S. Par conséquent, cette méthode est assez générale et possède de nombreuses applications. Les valeurs japonaises de coopération, de respect, de confiance, et d’harmonie ont contribué à l’assimilation des 5S dans les pratiques opérationnelles japonaises.
La méthode des 5S peut être considérée comme une méthode de développement organisationnel, d’apprentissage ou de changement, orientée vers l’amélioration de la productivité et des conditions de travail. Cette méthode est un outil servant à éliminer les déchets et lutter contre le gaspillage.
Les principes sous-jacents à la méthode des 5S sont enracinés dans la société japonaise grâce à l’influence du bouddhisme, du shintoïsme et du confucianisme, comme le soulignent Yvon Pesqueux et Jean-Pierre Tyberghein dans leur ouvrage « L’école japonaise d’organisation ». La coopération, la confiance en soi, l’harmonie, et la loyauté dans l’environnement de travail sont donc soulignées grâce à cette méthode; tous étant des caractéristiques de la société japonaise. Par ailleurs, on retrouve aussi au cœur des 5S deux éléments essentiels de cette culture, à savoir l’ordre et la propreté. Cette méthode

organisationnelle appliquée dans les entreprises japonaises peut se traduire par : « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ».
Le terme « Seiri » (ranger) concerne majoritairement l’organisation. Il s’agit d’organiser les choses de façon à différencier le nécessaire du non nécessaire, afin de supprimer l’inutile. L’organisation est un moyen de réduire les mouvements des employés, l’espace utilisé, et la consommation de ressources. La planification de la production, évitant la surproduction, est l’une des applications de Seiri, et est présente dans la majorité des entreprises japonaises.
« Seiton » (ordre) est un principe lié à la propreté. Il s’agit de ranger les choses, de les classer dans un ordre précis, afin de les trouver facilement et d’éviter des recherches inutiles.
Seiton est la conséquence de Seiri. Les entreprises utilisent des règles pour que l’ordre devienne une habitude des employés dans les environnements de travail. Ces entreprises japonaises utilisent toutes des outils TPS (Toyota Production System), comme les Kanban. Une application de ce principe est le management visuel, permettant de maintenir l’ordre en rendant l’ensemble des processus visibles.
« Seiso » (nettoyage) indique la nécessité du nettoyage et de l’inspection de soi, afin de créer un bon environnement de travail. Il peut s’agir également de gagner le respect et l’estime de ses collègues et supérieurs. Le nettoyage est constant dans l’ensemble des usines japonaises. Les employés nettoient leur espace de travail tous les jours avant de commencer à travailler. Cela fait partie de leur bien-être en tant que travailleur, et c’est une condition nécessaire pour assurer la qualité de leur travail. Les rouages des machines dans les usines sont par exemple visibles, afin de savoir rapidement lorsqu’il faut les nettoyer ou lorsqu’ils sont endommagés.
« Seiketsu » (propre, état de propreté) est un principe de standardisation continue. C’est un cycle de standardisation nécessaire à la mise en place des 3 premiers ‘S’, mais cette standardisation est également rendue possible grâce à la réalisation de ces 3S. Il s’agit d’un cercle vertueux. Ce principe permet de détecter des anomalies dans le processus de production par exemple.
« Shitsuke » (éducation, rigueur) est un terme lié à l’entraînement et la discipline. Il introduit le principe d’apprentissage et d’amélioration continue. C’est le plus important critère des 5S pour les entreprises japonaises.
La méthode des 5S n’est pas une méthode de nettoyage, de tri, ou d’organisation, mais plutôt un outil d’amélioration continue de l’environnement de travail en tant que soutien à l’avancée de la production et de l’organisation. Cette méthode établit des principes de base à d’autres méthodes de « lean management » et d’amélioration de systèmes tels que la TPM (Total Productive Maintenance), l’EOM (Ecology Oriented Manufacturing) ou le TPS (Total Productive Services) (cf Ablanedo-Rosas et al. 2010; Suárez-Barraza, Bou, and Cataldo 2008). La TPM (Total Productive Maintenance) est en effet l’un des principaux modèles japonais en matière de lean management. Cette méthodologie est orientée sur la vie active des équipements, la gestion des déchets et l’augmentation de la durée de vie des équipements. Une autre méthode japonaise essentielle est l’Hoshin planning, c’est-à-dire la lutte contre le gaspillage, la surproduction, et les opérations inutiles, afin de réduire au maximum les coûts de production, et donc dégager la plus grande valeur ajoutée possible.
Par ailleurs, la méthodologie des 5S est étroitement liée aux activités Kaizen, très répandues dans les entreprises japonaises. Elles visent à améliorer quotidiennement la

productivité : garantir la sécurité au travail, réduire la production des déchets, et faciliter la résolution des problèmes de production. Elles permettent également d’accroître les compétences des employés. Cette méthode favorise le « Muda » (méthode contre le gaspillage), qui lui-même favorise le « Poka-yoke » (système anti erreur), qui favorise à son tour la méthode des 5S. Ces modèles sont donc interdépendants. Leur cohérence améliore la productivité, la lutte contre le gaspillage, et la réduction de déchets. Toyota est, bien sûr, l’une des entreprises japonaises accordant le plus d’importance à ces modèles. Tous les matériaux des usines Toyota sont rangés, structurés par taille, il y a des alarmes visuelles dans les chaînes de production que chaque employé peut lui-même déclencher, etc.
Les3R:l’économiecirculaire
Réduire. Il est en effet plus simple de ne pas produire trop, plutôt que de chercher à réutiliser ou recycler le surplus de production. La réduction des ressources consiste à diminuer la quantité de matière première utilisée pour la fabrication du produit. S’il reste de la matière première, celle-ci devra être réutilisée ou recyclée. On retrouve la notion de diminution des coûts de production (coût de la main-d’œuvre, coûts fixes). Une des principales applications de cette théorie par les entreprises japonaises concerne la rationalisation de l’utilisation du papier. Certaines entreprises comme Toyota mettent ce principe au cœur de leurs procédés de fabrication, notamment concernant l’enfouissement des déchets et la limitation de la consommation d’eau. L’usine Toyota à Valencienne (France), par exemple, n’utilise que de l’eau de pluie pour alimenter son circuit de production en eau.
Réutiliser. Il s’agit de réutiliser les matières premières afin de réduire les coûts de production tout en diminuant la quantité de ressources utilisées. Les entreprises pourront aussi économiser de l’énergie et réduire leurs coûts fixes. Cette méthode est plus rentable que celle du recyclage. Toyota l’a bien compris et, comme nous l’a confié Jean-Yves Jault, Senior General Manager chez Toyota Motor Europe, les concessionnaires japonais utilisent les batteries de vieux modèles de voitures rapportés par les clients pour stocker de l’énergie et réduire leur consommation d’électricité.
Recycler. Cette méthode peut représenter un gain d’argent pour certains magasins spécialisés dans la revente de pièces détachées par exemple. Cette pratique est excellente pour l’image de marque de l’entreprise. C’est une pratique qui touche tous les acteurs économiques, des fournisseurs aux consommateurs. C’est donc la pratique environnementale la plus visible par les consommateurs, celle sur laquelle la marque a intérêt de communiquer. Pour les consommateurs, c’est un moyen simple et efficace de réduire leurs déchets, et pour les entreprises, c’est un moyen de réduire leur consommation de matières premières. Dans le secteur de l’automobile, les constructeurs mettent un point d’honneur à fabriquer les voitures les plus « recyclables » possible. 96 % des voitures Toyota sont recyclées par exemple. Les matériaux de construction privilégiés sur tous les modèles sont recyclés et recyclables.
Les 5S et 3R sont donc des modèles visant à intégrer l’écologie au processus de production de façon à optimiser et réduire les coûts des entreprises japonaises. Comme le mentionne Hitachi, dans l’entreprise japonaise d’électronique, « la réduction des coûts est obtenue en interne par l’élimination du gaspillage dans l’usage des différents facteurs de production : main-d’oeuvre, matière, énergie, outillage, investissement » (source : http://eu.hitachi-solutions.com/fr/about/environment.php).

L’intégration de l’écologie dans le modèle organisationnel de l’entreprise japonaise lui permet donc de gagner ou de conserver sa position dominante sur le marché, par la réduction des coûts de production et l’amélioration de son image de marque.
Les modèles développés ci-dessus (Toyotisme, 5S, 3R) concilient les impératifs écologiques et économiques des entreprises japonaises, et portent essentiellement sur le secteur industriel. En effet, l’industrie représente 44 % de la consommation d’énergie finale du Japon (source : Ministry of International Affairs and Communications, 2007). Historiquement, elle est donc le principal investisseur dans les technologies vertes, notamment au niveau du produit fini.
Cependant, les préoccupations environnementales se généralisent à l’ensemble de l’économie japonaise d’aujourd’hui, incitant les entreprises non industrielles à faire à leur tour, de l’écologie un avantage concurrentiel. Les entreprises japonaises du secteur des technologies de l'information (TIC), par exemple, ont annoncé la mise en place d'une commission dans le but de rédiger un « guide des bonnes pratiques écologiques » pour ce secteur dont l'État exige des efforts pour préserver l'environnement. Les opérateurs de télécommunications, industriels de l'informatique, et fournisseurs de services internet japonais, cofondateurs de cette commission, ont mentionné qu’ « en tant qu'acteurs du monde des technologies et télécommunications, nous devons aussi renforcer les mesures que nous prenons pour réduire la consommation d'énergie et les rejets de dioxyde de carbone (CO2) ». Ces actions sont par ailleurs encouragées par l'État, qui insiste sur la nécessité d'une meilleure récupération et d'un plus important recyclage des appareils usagés, notamment des téléphones portables contenant des métaux rares. (Stratégies, juin 2014. Japon : un guide des bonnes pratiques écologiques pour le secteur des TIC). D’autres secteurs économiques essaient également de concilier les impératifs écologiques et économiques au sein de leur organisation.
2.2 Applicationsdesbonnespratiquesdesentreprisesjaponaisesauniveauduproduitfini
Non seulement les entreprises japonaises mettent en place de bonnes pratiques de conciliation des impératifs écologiques et économiques au niveau organisationnel, mais elles tendent de plus en plus à concilier ces impératifs dans leurs produits finis, afin de répondre aux consommateurs désirant de plus en plus acheter des produits respectant l’environnement.
Prenons l’exemple du constructeur automobile japonais Mazda et son concept de Madza Kiyora. Son toit transparent dispose de cellules photovoltaïques qui alimentent en électricité les équipements intérieurs de la voiture. Son système SISS (Smart Idle Stop System) arrête et redémarre le moteur quand le véhicule est à l’arrêt. De plus, lorsque le véhicule roule, l'eau de pluie est captée, filtrée, et canalisée vers une bouteille de purification d'eau, rendue potable pour les passagers (« Lifesaver Bottle Citi »). Les bonnes pratiques des 3R sont ainsi condensées dans ce produit, qui permet également à Mazda de véhiculer une image de marque innovante et responsable. Ainsi, Mazda réussit à réduire son impact sur l’environnement grâce à ce produit.
Au-delà du secteur automobile, les fabricants d’emballage japonais ont déployé de grands efforts pour intégrer la méthode des 3R à leurs systèmes de production. Les emballages verts ont l’avantage d’être facilement recyclables après utilisation. L’entreprise peut donc les réutiliser comme matière première.

Enfin, c’est un produit intéressant pour les consommateurs souhaitant modifier leur mode de consommation pour un mode plus écologique, et réduire leur quantité de déchets. Par ailleurs, la flexibilité de ces emballages permet de diminuer l’espace de stockage et de transport, ce qui bénéficie aux fabricants et aux consommateurs.
Par exemple, Kao Corporation est une entreprise japonaise de cosmétiques et de chimie qui appartient au TOPIX 100 (bourse de Tokyo). L’un de ses produits phares possède un packaging écologique et innovant. Lancé en 2013, il s’agit d’un détergent en poudre pour nettoyer le linge. Ce produit est rechargeable facilement, et donc plus respectueux de l’environnement. Cet emballage a permis à l’entreprise de réduire de 60 % ses émissions de CO2, et de 90 % sa quantité totale de déchets issus du système de fabrication des packaging de ses produits (http://www.kao.com/jp/en/corp_rd/development_02_05.html). Par ailleurs, Kao Corporation a publié son Rapport Environnemental en 2009, dans le but d’informer ses parties prenantes sur les engagements de l’entreprise en matière de réduction de son empreinte écologique. Elle a également développé un logo « eco together » qu’elle place sur ses produits avec des détails expliquant en quoi le produit est écologique. Ainsi les consommateurs savent en un coup d’œil que ce produit est respectueux de l’environnement.
3 UNCAPITALISMED’ÉTATETUNECONSCIENCECOLLECTIVEAUSERVICEDEL’ÉCOLOGIE
Nous venons de voir que les entreprises japonaises ont su développer des modèles centrés sur des pratiques écologiques, et ainsi devenir leader sur certains marchés. L’écologie est donc au service des performances économiques pour la majorité des entreprises japonaises. Cependant, le modèle de croissance économique japonais dans le passé, et ses conséquences néfastes sur l’environnement, n’a-t-il pas prouvé que les entreprises japonaises n’ont pas toujours su concilier les impératifs économiques et écologiques? N’y a-t-il pas d’autres facteurs qui ont favorisé la mise en place de ces modèles? Nous montrerons ainsi que le rôle de l’État japonais a été primordial dans le développement de bonnes pratiques écologiques des acteurs économiques. L’État japonais a en effet mis en place une conscience collective écologique, en s’appuyant notamment sur l’éducation et la tradition écologique inhérente à la culture japonaise.
3.1 Le«miraclejaponais»etsesconséquencesécologiquesdésastreuses
Après la 2e Guerre mondiale et le traumatisme des bombes nucléaires de Hiroshima et Nagasaki, le Japon entre dans une période de forte croissance économique, même supérieure aux pays industrialisés de l’époque, reposant sur son marché intérieur. C’est le « miracle japonais » qui commencera en 1955 et finira au début des années 19, à la suite de la crise pétrolière. Le Japon observe une croissance du PIB de 5 % par an en moyenne sur la période, et de 11.5 % de 1960 à 1965. Cependant, cette croissance ne fût pas sans effets négatifs, puisqu’elle fût entre autres, source de grande pollution, dont le gouvernement s’est tardivement préoccupé. En effet, les industries lourdes (énormes usines et vastes complexes industriels), et les populations se sont considérablement concentrées dans les mégalopoles, notamment à Tokyo (on parle même d’hypermégalopole), où la concentration des activités a entraîné des pics de pollution, suivies de crises sanitaires. Cette concentration a, de plus, été accélérée par la géographie très montagneuse de l’archipel, et l’urbanisation anarchique inégalement répartie dans les plaines et sur le littoral.

En 1968, le pays est la deuxième puissance économique mondiale, mais également l’un des plus pollués de la planète. Ainsi, les concentrations de dioxyde de soufre dans l'atmosphère passent de 0,15 ppm en 1960, à 0,60 ppm de 1960 à 1965 (la norme mondiale étant de 0.5ppm), favorisant l'asthme et les maladies respiratoires (http://www.japonline.com/jfra/hist/hist.asp?ID=114).
La fin des années 1960 est d’ailleurs marquée par une prise de conscience nationale à la suite des « Quatre Grands Procès de Nuisance ». Les scandales se multiplient et sont hautement relayés par les médias. Parmi ces procès figurent de nombreux cas de pollution environnementale, liés à la suractivité industrielle concentrée, et au manque de mesures et de limitations. On recense de nouvelles maladies telles que la maladie de Yokkaichi - asthme provoqué par la pollution atmosphérique -, les maladies de Minamata et Niigata - contamination des eaux japonaises au mercure - qui feront plus de 33 000 victimes, et enfin la maladie itai-itai (littéralement « j’ai mal j’ai mal ») - intoxication au cadmium à la baie de Toyama - qui fera 184 victimes, sans compter l’explosion des cancers du poumon et de l’œsophage (source : J.Lagane, Catastrophes au Japon et complexité des relations homme/nature. De l’apport de la médiance…). Les manifestations commencent, l’opinion publique devient de plus en plus sensibilisée aux questions environnementales, ou du moins juge que les entreprises sont les acteurs à blâmer et doivent réparer les dégâts causés. La victoire des plaignants fit symboliquement basculer ces mouvements citoyens vers la légitimité. Cela va contraindre le gouvernement japonais à prendre des mesures drastiques.
En 1967, le parlement promulgue une série de lois sur le contrôle de la pollution. Cet arsenal sera renforcé au fil des années, faisant du Japon un modèle de lutte contre la pollution environnementale.
3.2 Lerôledel’Étatdansl’établissementd’impératifsécologiques
Après l’établissement de l’Agence Environnementale en 1971, et pendant 20 ans, la situation environnementale au niveau national a évolué de manière conséquente. Des lois sont adoptées dans les années 1970, afin d’obliger les entreprises industrielles à développer un système de prévention contre la pollution au niveau interne, et de contrôle de la qualité environnementale. Cette nouvelle législation a eu beaucoup d’impact sur les entreprises japonaises dans le secteur de l’acier, des équipements et de la pétrochimie.
Par exemple, la loi de 1979 obligeant les industries à augmenter leur efficacité énergétique de 1 % chaque année, montre l’engagement continu de l’État dans son combat contre la dépendance énergétique. Parallèlement, des préoccupations mondiales sont apparues au sujet du réchauffement climatique, de la détérioration de la couche d’ozone, de la déforestation, des pluies acides transnationales, et de l’enfouissement de déchets nocifs. Les années qui ont suivi le Sommet de la Terre à Rio en 1992 ont vu de nombreux pays adopter des actions et des mesures concrètes en faveur du développement durable. Ces sommets et accords internationaux ont joué un rôle important dans l’essor des bonnes pratiques japonaises, en incitant l’État japonais à continuer ses efforts de sensibilisation et de réglementation.
Dans les années 1980-90, les entreprises japonaises n’ont plus le choix : l’opinion publique et les dispositions prises par le gouvernement les obligent à prendre leurs responsabilités, à réparer les dégâts environnementaux causés, et à améliorer leurs pratiques futures en matière d’écologie.

L’usine Chisso a par exemple reconnu en 1988 sa part de responsabilité dans la pollution au mercure de la baie de Minamata à la suite du déversement de produits mercuriels dans la mer.
Par ailleurs, la croissance ralentit, et l’économie entre en crise en 1991 à la suite du choc pétrolier. Le Japon étant très dépendant des importations énergétiques, ce choc a eu de nombreuses conséquences économiques sur les entreprises japonaises, parmi lesquelles une augmentation du coût de production et donc une baisse de compétitivité. Le choc pétrolier, révélant le degré important de dépendance énergétique des entreprises japonaises, accentuera la prise de conscience écologique nationale, et la nécessité d’investir dans la R&D, afin de trouver de nouvelles sources énergétiques moins coûteuses. L’État japonais a d’ailleurs fortement augmenté le budget alloué au développement de technologies vertes à partir du début des années 1980, comme le montre la figure 1. Cette évolution constante à la hausse des ressources publiques dédiées à ce développement a atteint en 2006 une dépense totale de 3,6 milliards de dollars, dont 448 millions de dollars pour le développement de technologies vertes. Cela positionne le Japon comme l’un des pays les plus importants en terme d’investissement en R&D pour le développement énergétique.
Figure 1 – Budget public pour l’énergie R&D par pays, 1974-2006 (IEA, 2008)
Source : Osamu Kimura. (Octobre 2010). Public R&D and commercialization of energy efficient technology: A case study of Japanese projects.
Energy Policy 38 (2010) 7358–7369
Les années 1990 sont marquées par une prise d’engagements environnementaux des États au niveau mondial (Sommet de la Terre à Rio en 1992, Protocole de Kyoto en 1997).
Le sommet de la Terre à Rio en 1992 a permis l’adoption au Japon de la « Loi de Base pour l’Environnement », tentant d’impliquer les citoyens, entrepreneurs, et autres associations dans les actions gouvernementales.
La même année, le « Plan d’Action National pour l’Agenda 21 » a été soumis aux Nations Unies.

En décembre 1994, un plan d’action appelé le « Plan de Base Environnemental Basic » a été adopté. Ce plan a clarifié les mesures à prendre au niveau national et au niveau local, ainsi que les actions à mettre en œuvre par les citoyens japonais, les entreprises et les organisations privées. Le plan a également défini les rôles de chaque acteur économique et les manières de poursuivre les politiques environnementales.
Le protocole de Kyoto de 1997, visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, a également eu un impact important sur l’évolution des mentalités quant à l’intégration de l’écologie au sein des entreprises japonaises. Le principe d’économie circulaire, consistant à minimiser les pertes en réutilisant les déchets, a été largement étudié, et d’autres labels et normes standards internationales, comme les fameuses normes ISO, ont vu le jour, dont la norme ISO 14001 sur la gestion de l’environnement, et les responsabilités humaines dans les activités d’extraction de ressources naturelles.
Par effet domino, l’opinion publique mondiale est progressivement sensibilisée aux défis environnementaux. Les États éduquent leurs citoyens en faveur de l’adoption d’un nouveau mode de consommation écologiquement responsable. Les entreprises commencent donc à investir dans les technologies vertes. Au Japon, les dirigeants des entreprises sont déjà sensibilisés à ces problématiques. Ils s’impliquent dans les groupes environnementaux et de développement durable tels que le World Business Council for Sustainable Development. Parallèlement, en 1991, la Japan Federation of Economic Organizations (maintenant appelée la Japan Business Federation) publie sa charte environnementale indiquant que « les entreprises doivent contribuer au développement d’une société saine d’un point de vue environnemental ». Grâce à cette charte, 80 % des 140 plus grandes entreprises japonaises ont développé un département spécialisé pour gérer les problématiques environnementales.
Des politiques plus nationales continuent d’être mises en place par le gouvernement japonais comme la loi « Top Runner » de 1998. Elle instaure que tout nouveau modèle de produit créé par une industrie doit au moins égaler, sinon surpasser, les performances du modèle le plus économe du marché. Cela garantit des innovations constantes en matière d’efficacité énergétique.
Dans les années 1990, le gouvernement japonais a donc réalisé la nécessité de gérer les défis liés au traitement des déchets (réduction des déchets et recyclage). Ces lois incluent : une augmentation de la responsabilité des producteurs de déchets, l’introduction des principes de l’EPR (Extended Producers Responsibility), programmes incitant les clusters d’industries au recyclage et établissant des principes de recyclage spécifiques pour certains produits.
Le 3e Plan pour l’Environnement de 2006 instaura des mesures pour soutenir la protection environnementale, et fixa des objectifs concrets sur le long terme, dont la réduction des émissions de CO2 de 25 % en 2020, l’augmentation de l’efficacité énergétique de 35 % en 2030, la réduction de la dépendance au pétrole de 40 % en 2030. L’objectif en 2050 était d’atteindre 70 % d’énergie « propre ». Ces mesures ont eu un impact extrêmement positif, avec de bons résultats tels que la baisse de consommation des ressources naturelles, un rendement supérieur de l’utilisation de ces ressources, ou encore un meilleur recyclage de l’eau et des déchets.

En 2007, le gouvernement japonais a publié sa « Stratégie pour une Nation Environnementale au XXIe siècle » dans lequel il établit ses objectifs d’intégration d’activités à faible émission de CO2, la gestion des déchets et le développement d’une société en harmonie avec la nature. On retrouve dans ces objectifs des traits majeurs de la culture japonaise, accordant une place prépondérante à la bonne relation entre l’Homme et la Nature. De plus, le Japon a annoncé qu'il avait pour objectif d'étendre le marché du « commerce écologique » et de créer jusqu'à 1 million de nouveaux emplois, avec des mesures comme des prêts à taux zéro pour les entreprises respectueuses de l'environnement. Les entreprises japonaises se sont fortement impliquées dans ce processus d’instauration de bonnes pratiques écologiques, s’efforçant de suivre les règles, et apportant leur contribution afin de les faire évoluer. Le gouvernement japonais a favorisé la création d’une société à faible taux d’émission de carbone alliant économie et écologie.
Depuis la fin des années 1960, on a donc assisté au développement d’un capitalisme d’État orienté vers le développement durable et l’environnement, conséquence de la forte dépendance du Japon face à l’importation de ressources naturelles, et aux difficultés de traiter les déchets. Pour ce dernier point, on parle « d’intégration » des matières et déchets, avec une des premières mises en application du principe des 3R (Réduire, Recycler, Réutiliser) dans les entreprises japonaises. C’est d’ailleurs avec cette politique que le Japon fit l’objet d’une étude menée par le Commissariat Général au Développement Durable, dans le cadre de la conférence environnementale de 2013, de par son statut de pays précurseur en la matière. L’écologie, les énergies renouvelables, et l’économie circulaire apparaissent donc comme des clés de développement économique à long terme pour les entreprises japonaises. La prise de conscience et d’engagement des consommateurs, sur la même période, dans la lutte pour la protection de l’environnement offre un nouveau marché dans lequel les entreprises japonaises ont été les premières à s’engouffrer. Comme on l’a vu avec Toyota par exemple, elles seront les premières à adapter leur offre et changer leur système organisationnel.
L’État a donc été un acteur majeur dans le développement d’impératifs écologiques à respecter pour les entreprises japonaises. Les modèles japonais de conciliation des impératifs écologiques et économiques n’ont pas été créés ex nihilo, mais grâce à un interventionnisme étatique fort. Par ailleurs, le mot de contribution à la nation se trouve dans un grand nombre de credo des entreprises japonaises. Les impératifs économiques des entreprises japonaises ont notamment pour objectif la prospérité de la nation, incluant le respect de l’environnement japonais. Les entreprises s’adaptent donc aux directives étatiques le plus rapidement possible (pas de lobbies antiécologiques par exemple).

Figure 2 – Cadre réglementaire japonais pour la bonne gestion des défis écologiques des entreprises japonaises
Source : Y. Moriguchi (2006), “Establishing a Sound Material-Cycle Society in Asia” a presentation at Asia 3R Conference, October 30th –
November 1st, 2006, Tokyo, Japan.
3.3 Lerôledel’Étatdansl’établissementd’uneconscienceécologiquecollective
L’écologie, la relation entre l’homme et la nature, et le respect de la nature sont présents depuis toujours dans les croyances et la culture japonaise. Selon Augustin Berque, les rapports entre l’homme et la nature au Japon sont multiples : ils sont écologiques (l'air que l'on respire), mais aussi techniques (l'exploitation et l'aménagement par l'agriculture), esthétiques (l'espace et la nature sont perçus, représentés), axiologiques (ils inspirent des valeurs), etc. La conception d’une vie en symbiose avec la nature est influencée par le shintoïsme (plus ancienne et pratiquée religion au Japon) et le bouddhisme, croyances fortement présentes au Japon.
Le shintoïsme regroupe en réalité un ensemble de croyances et de superstitions populaires liées à la nature, et est fortement présent dans toutes les traditions japonaises. La mentalité shintoïste s'adapte bien à la société moderne, qu'elle contribue à modeler et développer : le goût de la nature favorise les mouvements écologiques, le besoin de renouveau perpétuel encourage la société de consommation, et développe l’économie en influençant les modèles de développement des entreprises au Japon. Quant au taoïsme, l’homme n’est pas étranger au monde « puisqu’il en est issu comme l’eau émane d’un ruisseau bouillonnant ». Il ne peut être séparé de la nature puisqu’il est la nature.
Ces doctrines constituent la base de la culture japonaise et ont une influence forte sur le modèle économique des entreprises nationales. Elles prônent un homme en harmonie avec son environnement, où toute vie est l’égale d’une autre. Elles développent le concept moderne d’interdépendance des êtres : chaque individu est responsable de ses actions devant les autres.

La culture japonaise permet aux employés d’intégrer plus facilement l’ensemble des défis écologiques actuels, et ainsi de s’y adapter rapidement. Ces valeurs écologiques inhérentes à la culture japonaise nécessitent tout de même d’être exploitées pour développer une plus grande conscience écologique collective.
Pour mettre en place cette conscience écologique, les citoyens et organisations japonais doivent prendre conscience de la nécessité d’instaurer des pratiques de développement durable. Cette éducation passe par la politique du gouvernement japonais d’ESD (Education for Sustainable Development). Au sommet mondial du développement durable en 2002, le Japon a proposé que la période de 2005 à 2014 soit caractérisée par l’éducation au développement durable, proposition qui a été acceptée. Le Japon est donc à l’initiative de l’éducation aux impératifs écologiques actuels. Le ministère de l’environnement japonais a mis en place toute une réflexion à ce sujet au niveau national. L’objectif est de relier l’éducation sociale, économique, la compréhension internationale des défis écologiques à l’éducation des défis environnementaux.
Figure 3 – Le programme ESD (Education for Sustainable Development) du ministère de l’Environnement japonais
Source : Ministère de l’Environnement Japonais (2014). Annual Report on the Environment, the Sound Material-Cycle Society, and Biodiversity
in Japan 2014. Environmental Education—a foundation for sustainable society.
Par ailleurs, des campagnes d’éducation à l’écologie et à l’étude des sciences environnementales sont menées par le gouvernement dans les écoles, les centres régionaux, les lieux de travail, les foyers, etc.
La communication publique du « Livre Blanc de l’Écologie », informant chaque année les Japonais sur les politiques de sauvegarde de l’environnement et l’état environnemental, a joué un rôle essentiel dans la diffusion des bonnes pratiques en matière d’écologie. « De cette éducation, et de l’esprit traditionnel japonais, résulte le fait que les individus se sentent très concernés par l’environnement », souligne Hiroshi Ōta, « Un exemple en est le recyclage; le tri entre les cinq conteneurs est systématique chez les Japonais ». (Nicolas D. Le Journal La Souris Verte. Novembre 2014). Guidé par la « Vision For Environmental Leadership Initiatives For Asian Sustainibility in Higher Education », le ministère de l’environnement japonais a mis en place des initiatives telles que le développement de programmes scolaires spécifiquement liés au

développement durable dans les universités. Il favorise également les cursus d’ingénieurs en technologies vertes, ainsi que des MBA spécialisés dans les responsabilités environnementales.
Au niveau régional, des organisations telles que des comités éducatifs, des musées, des lieux éducatifs, les gouvernements locaux, ou des organismes sans but lucratif gèrent les activités reliées à l’ESD via une compréhension et une éducation aux nouveaux défis écologiques. Les RCE (Regional Centres of Expertise) sont également des acteurs clés pour le développement des projets éducatifs concernant le développement durable. Il en existe six à l’heure actuelle dans les villes de Sendai, Yokohama, Chubu, Hyogo-Kobe, Okayama, et Kitakyushu. Parmi les récentes initiatives favorisant l’éducation environnementale se trouvent les efforts pour transférer la connaissance traditionnelle du temps où les Japonais cohabitaient avec la nature, aux expériences quotidiennes.
Les pouvoirs publics japonais ont donc un impact considérable sur le développement des modèles de conciliation des impératifs économiques et écologiques au sein des entreprises japonaises, aussi bien par une réglementation stricte que par une politique d’éducation des consommateurs.
Ainsi, plusieurs facteurs sont liés au développement des pratiques écologiques au sein des entreprises japonaises. Les composantes externes et internes pour l’établissement d’une stratégie environnementale au sein des entreprises japonaises sont résumées dans la figure 4.
Figure 4 – Modèle de formation d’une stratégie environnementale au sein des entreprises japonaises
Source : Yukio Takagaki. (2009). Japanese firms’ environmental strategy: Examples from electronics related industries. 2010 Macmillan
Publishers Ltd. 1472-4782 Asian Business & Management Vol. 9, 2, 245–264

Les facteurs externes tels que l’intervention de l’État, les normes environnementales, la culture et les tendances sociales plus écologiques, associés aux facteurs internes de développement de pratiques plus écologiques (grâce à certains modèles que nous avons examinés dans la partie II) permettent aux entreprises japonaises de concilier de plus en plus les impératifs écologiques et économiques afin de conserver leur avantage compétitif.
4 CONCLUSION:LEMODÈLEJAPONAIS,UNMODÈLEINSPIRANT?
Les entreprises japonaises ont en effet réussi à concilier les impératifs écologiques et économiques, en utilisant l’écologie comme un moyen pour gagner en compétitivité. Toutefois, l’Histoire japonaise durant la seconde moitié du XXe siècle montre que les entreprises japonaises n’ont pas toujours allié écologie et performances économiques. Elles restent des acteurs économiques dont la priorité est la rentabilité financière, l’augmentation des parts des marchés, du bénéfice, etc.
Par conséquent, il ne faut pas négliger les facteurs externes à cette réussite : la culture japonaise, le rôle de l’État favorisant le développement d’une législation verte, et favorisant le développement d’une conscience collective des consommateurs, tournée vers l’écologie et le développement durable. On peut donc parler d’un modèle japonais puisqu’un très grand nombre d’entreprises japonaises disposent des mêmes caractéristiques : des modèles organisationnels écologiques fondés sur des politiques de réduction des coûts de production, d’antigaspillage des ressources, et d’amélioration continue de la productivité à long terme.
Les entreprises japonaises sont donc une source d’inspiration en terme de modèle organisationnel pour les autres entreprises dans le monde. Cependant, il ne s’agit pas de répliquer le modèle sans prendre en compte les facteurs externes liés à la réussite des entreprises japonaises. Le rôle de l’État, à travers la mise en place d’une législation en faveur de l’écologie et de campagnes de sensibilisation des consommateurs à ces problématiques, a été crucial pour la bonne conciliation des impératifs écologiques et économiques, et ne doit pas être négligé.
C’est pourquoi la prise de conscience et d’engagement des États, à travers des sommets, réunions, protocoles et normes mondiaux, et des consommateurs, à travers la nécessité de relever l’ensemble des défis écologiques actuels, est une condition première à la propagation des bonnes pratiques japonaises dans les entreprises.

5 RÉFÉRENCES
Ablanedo-Rosas, J., B. Alidaee, J. C. Moreno, and J. Urbina. (2010). Quality Improvement Supported by the 5S, an Empirical Case Study of Mexican Organisations. International Journal of Production Research 48 (23) 7063–7087.
Augustin Berque. (1976). Le Japon, gestion de l'espace et changement social. Flammarion Bolle de Bal. (janv-fev 1988). Fondements culturels de l’efficacité japonaise. Revues Française
de gestion. Carmen Jacaa, Elisabeth Vilesa, Luis Paipa-Galeanob, Javier Santosa and Ricardo
MateocLearning. (2012). Learning 5S principles from Japanese best practitioners: case studies of five manufacturing companies. International Journal of Production Research.
Chihiro Watanabe, Kayano Fukuda (2006). National Innovation Ecosystems : The similarity and disparity of Japan-US Technology Policy Systems toward a Service Oriented Economy. Journal of Services Research, Volume 6, Number 1.
Classement Fortunes Global 500 (2014) Commissariat Général du Développement Durable. (Janvier 2014). Comparaison internationale
des politiques publiques en matière d’économie circulaire. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED101.pdf
Euromonitor (2014). Japan Energy & Environment, Visible shift in energy consumption mix and increased reliance on fuel imports.
Euromonitor. (Juillet 2014). Packaging Industry in Japan, Industry Overview. Fukuda Law Firm (2014). Japan Environmental Laws.
http://www.fukudalaw.com/Japan%20Environmental%20Laws.html Hari Srinavas. Green Practices in Japan. http://www.gdrc.org/sustbiz/ebiz/all-biz.html Hideto Yoshida, Kazuyuki Shimamura, Hirofumi Aizawa. (2007). 3R strategies for the
establishment of an international sound material-cycle society. J Mater Cycles Waste Manag (2007) 9:101–111
Hitachi. http://eu.hitachi-solutions.com/fr/about/environment.php Holweg, M. (2007). The Genealogy of Lean Production. Journal of Operations Management 25
(2) 420–437. Honda CSR Report. (June 2014). http://world.honda.com/CSR/report/pdf/2014/2014_en_all.pdf http://fortune.com/global500/ http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e45_environment.pdf Interbrand's Best Global Brands (2013). http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/ Jacob Park. (2008). Strategy, Climate Change, and the Japanese Firm: Rethinking the Global
Competitive Landscape of a Warming Planet. Palgrave Macmillan Journal. Kao Corporation. http://www.kao.com/jp/en/corp_rd/development_02_05.html Kobayashi, K., R. Fisher, and R. Gapp (2008). Business Improvement Strategy or Useful Tool?
Analysis of the Application of the 5S. Concept in Japan, the UK and the US. Total Quality Management & Business Excellence 19 (3) 245–262.
Kuniko Fujita & Richard Child Hill. (2007). The zero waste city: Tokyo's quest for a sustainable environment. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice.
Kyoko Fukukawa, Yoshiya Teramoto. (2009). Understanding Japanese CSR: The Reflections of Managers in the Field of Global Operation. Journal of Business Ethics (2009) 85:133–146.
Masayoshi Namiki. Ministère de l’Environnement Japonais (Avril 2008). Promotion of Sound Material-Cycle Society in Japan and 3R Initiative.

METI Ministry of Economy, Trade and Industry. Energy and Environment Policy. http://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/index.html
Ministère de l’Environnement Japonais (2014). Annual Report on the Environment, the Sound Material-Cycle Society, and Biodiversity in Japan 2014. Environmental Education—a foundation for sustainable society.
Ministère de l’Environnement Japonais (Avril 2014). Strategic Energy Plan Ministère de l’Environnement Japonais (Mai 2004). Vision for a Virtuous Circle for
Environment and Economy in Japan. Ministère de l’Environnement Japonais. (2003). OverseasEnvironmental measures of Japanese
Companies. http://www.env.go.jp/earth/coop/oemjc/ Ministère de l’Environnement Japonais. (2009). UNDESD Japan Report, Establishing Enriched Learning through Participation and Partnership among Diverse Actors. http://www.env.go.jp/en/policy/edu/undesd/report.pdf Ministère de l’Environnement Japonais. Environmental Protection Policy in Japan.
http://www.env.go.jp/en/policy/plan/intro.html Nicolas D. Le Journal La Souris Verte. (Novembre 2014). L’écologie du Soleil-Levant: Les
pratiques environnementales au Japon. http://www.journal-la-souris-verte.eu/?p=1300 Nissan Motor Corporation Sustainibility Report (2014). http://www.nissan-
global.com/EN/DOCUMENT/PDF/SR/2014/SR14_E_P014.pdf Osamu Kimura. (Octobre 2010). Public R&D and commercialization of energy-efficient
technology: A case study of Japanese projects. Energy Policy 38 (2010) 7358–7369 Panasonic Sustainibility Report (2014).
http://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability.html Sony & The Environment (2014). http://www.sony.net/SonyInfo/csr/SonyEnvironment/products/ Stratégies. (Juin 2014). Japon : un guide des bonnes pratiques écologiques pour le secteur des
TIC. http://www.strategies.fr/afp/20090624094500/japon-un-guide-des-bonnes-pratiques-ecologiques-pour-le-secteur-des-tic.html
Web Japan. Japan Fact Sheet. Environmental Issues. Yasuhiko Hotta (2011). Sapiens Revue. Is Resource Efficiency a Solution for Sustainability
Challenges? Japan’s Sustainable Strategy and Resource Productivity Policy in the 21st Century. http://sapiens.revues.org/1161
Yingyan Wang. (2008). Examination on Philosophy-Based Management of Contemporary Japanese Corporations: Philosophy, Value Orientation and Performance. Journal of Business Ethics (2009) 85:1–12
Yukio Takagaki. (2009). Japanese firms’ environmental strategy: Examples from electronics-related industries. 2010 Macmillan Publishers Ltd. 1472-4782 Asian Business & Management Vol. 9, 2, 245–264
Yuriko Saito (1985). The Japanese appreciation of nature. British Journal of Aesthetics, Vol.25, No.3.
Yvon Pesqueux, Jean-Pierre Tyberghein. (2009). L’école japonaise d’organisation. Afnor editions.

6 REMERCIEMENTS
Nous souhaitons vivement remercier les personnes qui nous ont apporté leurs connaissances et expertises afin d’approfondir notre recherche : Monsieur Jean-Yves Jault, Senior General Manager chez Toyota Motor Europe, Monsieur Hari Srinavas ([email protected]), Global Development Research Center, auteur de Green Practices in Japan et Monsieur M.Tsunoda, JETRO Montréal

OPPORTUNITÉS, DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS SUR LES MARCHÉS DE TECHNOLOGIES VERTES AUX ÉTATS-UNIS
Flavie Cohu, [email protected] Mathilde Lainé, [email protected]
Morgane Lottmann, [email protected] Constance Roncayolo, [email protected]
Résumé
Les États-Unis font partie des marchés les plus importants en termes de technologies propres. C’est un marché très lucratif, mais aussi très concurrentiel. Nous avons mené une étude afin de déterminer dans quelle mesure les technologies propres canadiennes et québécoises peuvent être valorisées sur ce marché porteur.
Nous avons d’abord contextualisé le marché mondial des technologies vertes puis avons réalisé une étude sur les forces des technologies propres canadiennes et québécoises. Nous avons ensuite étudié le marché des technologies vertes aux États-Unis. Ce travail nous a permis de déceler les différentes opportunités d’affaires offertes par ce marché pour les entreprises canadiennes et québécoises. Nous avons ensuite identifié pour chaque segment de marché les défis et les barrières mises en place par l’État, qui seraient susceptibles d’entraver le processus d’installation, d’investissement ou d’exportation des entreprises. Nos recommandations pour les entreprises canadiennes et québécoises souhaitant faire affaire aux États-Unis portent sur les stratégies qu’elles pourront adopter et les réglementations auxquelles elles doivent porter attention avant leur installation. Les secteurs dans lesquels investissent les entreprises canadiennes et québécoises doivent être méticuleusement choisis ainsi que les régions dans lesquelles les entreprises décident d’étendre leur activité. Aux États-Unis, le réseau est un aspect à privilégier pour développer un projet d’implantation, les entreprises canadiennes et québécoises doivent nouer des liens étroits et établir des alliances stratégiques avec des partenaires influents et pertinents. Certains programmes d’aide à l’installation proposés par l’État seraient également intéressants pour les entreprises. Nos recommandations sont destinées à notre auditoire, afin de les aiguiller dans leurs recherches et de répondre à leurs interrogations.
INTRODUCTION
Les technologies propres peuvent êtres délimitées par la définition du TDDC (Technologies du Développement Durable Canada) comme « les entreprises qui sont engagées dans le développement et la commercialisation d’une technologie brevetée pour livrer des biens et services qui réduisent ou éliminent des impacts environnementaux négatifs, répondent à des besoins d’ordre social, tout en livrant une performance compétitive et/ou en utilisant moins de ressources que la technologie ou les services conventionnels ». Elles poursuivent trois finalités : fournir de meilleures performances à coût moindre; réduire significativement ou éliminer l’impact nocif sur l’environnement et développer et optimiser l’utilisation responsable des ressources naturelles. Il existe de nombreuses catégories de technologies propres et celles-ci recoupent différents secteurs d’activités. Les principales catégories de technologies propres sont les suivantes : hydrogène, géothermie, air, solaire, chimie verte, sols, éolien, eau, transport, efficacité énergétique, biomasse, matières résiduelles, hydro-électricité. Certains segments de technologies propres comme l'hydro-électricité arrivent déjà à un stade de maturité tandis que d’autres comme la biomasse sont relativement émergents.

Le secteur des technologies propres connaît une croissance mondiale et offre un fort potentiel de développement. Selon l’IRÉC (Institut de Recherche en Économie Contemporaine), les principales raisons expliquant ce dynamisme sont : la capacité du secteur à soutenir le développement économique grâce à l’innovation et sa capacité à contribuer à une reconversion vers une économie à faible émission de carbone, plus respectueuse de l’environnement. De plus, de nombreux facteurs macro-économiques tels que la demande croissante en énergie, la sécurité mondiale et les enjeux environnementaux tendent à accentuer le développement de ces technologies. En 2010, le secteur mondial des technologies propres représentait un marché de 1 000 milliards de dollars dont 40 % furent générés par les États-Unis (Rapport sur l’industrie canadienne des technologies propres, 2011). D’après le cabinet Deloitte, pour 2016 le chiffre d’affaires mondial du secteur atteindra 4 000 milliards de dollars, dont 1,57 billion, pour les seuls États-Unis. Aussi, une étude du Fonds mondial pour la nature (WWF) révèle que les technologies propres se hisseront au rang de 3e secteur industriel mondial en terme d’importance d’ici 2020 (après l’automobile et l’électronique). Selon l’agence internationale de l’énergie, 20 billions de dollars seront investis dans l’infrastructure énergétique mondiale afin de satisfaire la demande qui devrait augmenter de 60 % d’ici 2030.
Les aides à l’énergie propre totalisent 180 à 195 milliards de dollars et résultent principalement de trois pays : États-Unis (65 mds), Chine (46 mds) et Corée (32 mds). Le marché américain qui représente l’un des plus grands marchés de technologies propres arrive en 3e position du classement « Global Cleantech Innovation Index 2014 » du Cleantech Group, qui mesure le potentiel d’innovation des pays en matière de technologies propres. Les États-Unis figurent parmi les leaders sur le marché des installations d’énergie éolienne. La contribution du solaire et de l’éolien dans la production d’électricité en 2012 a doublé. Selon le US Department of Energy, les installations solaires ont été multipliées par 13 depuis 2008.
La forte dotation en ressources naturelles dont bénéficie le Canada et sa capacité d’innovation dans les domaines des technologies et de l’énergie en font l’un des acteurs majeurs du marché. Le Canada arrive ainsi en 7e position du classement « Global Cleantech Innovation Index 2014 » du Cleantech Group. Les revenus générés par le secteur des technologies propres canadiennes sont estimés à près de 11 milliards de dollars par an, dont 10 % sont réinvestis en recherche et développement (Coalition canadienne des technologies propres). En 2010, le Canada détenait 4,5 % du marché mondial du recyclage et de la transformation et 2,7 % du secteur du transport. Selon le Rapport sur l’industrie canadienne des technologies propres 2013 de BioTech, l’industrie canadienne représentera 60 milliards de dollars en 2020, soit 3 % du marché mondial pour cette année.
Le marché canadien des technologies propres bénéficie d’une culture entrepreneuriale développée, d’importants investissements en R&D, d’une grande diversité et complémentarité des PME agissant sur ce marché, ainsi que d’un modèle de développement solide basé sur les énergies renouvelables. « Les technologies propres du Canada, qui jouissent d’une réputation mondiale et dont bon nombre ont été commercialisées grâce à l'appui de TDDC, attirent les investissements industriels étrangers au Canada. La décision de Daimler d’implanter son unité de production au Canada plutôt qu’ailleurs à l’étranger, notamment en Allemagne, démontre une grande confiance en la qualité, l’étendue et la diversité du secteur des technologies propres au Canada. » Dr Herbert Kolher, Daimler AG.

En 2013, six entreprises canadiennes figuraient dans le palmarès Global CleanTech 100 du CleanTech Group qui dresse une liste des idées les plus innovantes et porteuses dans le domaine des technologies propres. Le classement recense les entreprises étant le plus à même d’influencer le secteur dans les prochaines années.
Le Québec est très bien positionné en termes de technologies propres et occupe le second rang des provinces canadiennes du fait du grand nombre d’établissements ayant des revenus générés par des technologies propres ou services environnementaux. La province se distingue notamment sur la scène internationale par la qualité, l’adaptabilité, la pertinence ainsi que le fort caractère innovateur de son offre.
Le rapport Les technologies propres aux Québec : Étude et étalonnage, réalisé par la firme Deloitte à la demande d’Écotech Québec, révèle les forces notables du secteur des technologies propres québécoises. Québec se positionne favorablement à l’international au niveau des secteurs suivants : la biomasse, l’efficacité énergétique, les matières résiduelles et l’hydroélectricité. La région possède une expertise soutenue sur certaines niches, l’hydroélectricité présentant un fort potentiel de développement (mini et micro centrales hydroélectriques, hydroliennes). De plus, Québec détient des entreprises majeures dans les technologies de bioénergie comme la cogénération, la biométhanisation et les biocarburants. La province est par ailleurs très bien positionnée dans la gestion des matières résiduelles.
Le secteur québécois démontre aussi des forces pour saisir les opportunités de développement international concernant notamment les technologies du traitement de l’eau, de la réhabilitation des sols, du transport, l’éolien, le solaire et la chimie verte.
Enerkem (entreprise québécoise opérant dans les technologies propres) figure pour la quatrième année consécutive au palmarès « Global Cleantech 100 » du Cleantech Group. Le classement recense les idées les plus innovantes et porteuses en matière de technologies propres et dresse une liste des entreprises étant le plus à même d’influencer le marché des technologies propres. La technologie développée par Enerkem permet d’utiliser et transformer des déchets résidentiels non recyclables en produits chimiques verts et biocarburants de deuxième génération (cellulosiques).
1 LEMARCHÉDESTECHNOLOGIESVERTESAUXÉTATS‐UNIS
1.1 Étudedemarché
Les États-Unis représentent l’un des acteurs majeurs du marché mondial des technologies vertes. En effet, le pays est le plus large producteur et consommateur de produits et services environnementaux dans le monde et détient 40 % des parts de marché mondiales du secteur en 2010. En 2008, les investissements en énergies renouvelables ont atteint 24 millions de dollars américains soit 20 % des investissements mondiaux. Selon CleanTech Group, les États-Unis sont l’acteur qui investit le plus dans les secteurs de la production de biodiesel, d’éthanol, d’énergie éolienne et d’énergie solaire photovoltaïque. Selon un article de Capenergie, le gouvernement américain projetterait d’investir 22 milliards de dollars d’ici 2050 dans l’énergie et les technologies vertes afin d’atteindre l’objectif de diminution de 80 % des émissions de gaz à effet de serre.

Aussi, l’article précise que la majorité des investissements sera consacrée aux segments suivants : la production d’énergie (1,5 milliard), produits et services de l’industrie (1 milliard), le stockage d’énergie (936,2 millions) et l’efficacité énergétique (646 millions). Une étude réalisée par Environnemental Business International (San Diego) révèle que le marché des technologies vertes aux États-Unis regroupe trois secteurs d’activité principaux : les services liés à l’environnement, les équipements environnementaux et les ressources environnementales. Ces trois secteurs se déclinent en 14 segments d’activité (voir le Tableau 1). Les technologies vertes clés aux États-Unis sont les énergies renouvelables avec les éoliennes, l’énergie solaire, la biomasse et la géothermie, la construction verte, le traitement des eaux, de l’air, du sol et des déchets et l’efficacité énergétique. Le centre-ouest des États-Unis concentre les activités liées à la biomasse et aux énergies de l’éolien et du solaire photovoltaïque. Le sud-ouest des États-Unis, avec son centre incroyable de la Silicon Valley, est très réputé pour le développement de l’énergie solaire. Aussi, la Californie domine l’investissement national du secteur avec 2,8 milliards de dollars investis en 2012. L’ouest des États-Unis se concentre davantage sur la géothermie tandis que l’énergie éolienne occupe une grande partie de l’est des États-Unis. Les PME génèrent 22 % des revenus de l’industrie des technologies vertes, les grandes entreprises 47 % et le secteur public 31 %.
Tableau 1 – Les segments d’activité du marché des technologies vertes aux États-Unis

1.2 Marchédesénergiesrenouvelables
Le marché de l’énergie éolienne est le marché principal des énergies renouvelables aux États-Unis. Le Texas est l’état leader de ce marché avec 7 118 MW de capacité en 2008, suivi de l’Iowa et de la Californie (voir Tableau 2). Les principaux acteurs produisant l’énergie sur ce marché sont au nombre de 120 aux États-Unis. Le leader du marché est General Electric, basé à Atlanta, qui fabrique les turbines en Californie, Floride, Caroline du Sud, Pennsylvanie et Virginie. En 2008, General Electric a installé plus de 3757 éoliennes. Vestas Wind System est le deuxième acteur, basé à Portland, avec 1120 éoliennes installées en 2008. Il possède des centres de R&D au Texas, au Massachusetts et en Illinois. Siemens Energy and Automation Inc. est également un acteur important sur le marché, avec deux bases en Illinois, un centre de R&D au Colorado et 791 éoliennes en 2008 (voir Tableau 3).
Tableau 2 – Classement 2008 des 20 états générant le plus d’énergie grâce aux éoliennes aux États-Unis

Tableau 3 – Classement des fabricants de turbines aux États-Unis en 2008
Même si le marché de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique occupe une place plus réduite du marché, il connaît en ce moment une très forte croissance aux États-Unis. En 2008, ce marché a augmenté de 16 % et les installations de panneaux photovoltaïques de 63 %. En 2012, la production d’énergie solaire aux États-Unis représentait 14,3 % du marché mondial pour ce secteur. Le sud-ouest des États-Unis dispose d’un excellent potentiel solaire avec 7 KW/m2/jour dont les régions phares sont la Californie, Hawaï, le New Jersey, le Colorado, l’Arizona et le Nevada. First Solar et SunPower sont les acteurs majeurs sur le marché américain de l’énergie solaire. First Solar, créée en 1999 et dont le siège est en Arizona, possède ses usines de fabrication aux États-Unis, en Allemagne et en Malaisie. SunPower est une entreprise californienne basée dans la baie de San Francisco et créée en 1985. Elle fabrique les panneaux solaires les plus performants au monde grâce à sa technologie de pointe (200 brevets).
Le marché de la biomasse regroupe la production de biogaz, bioéthanol et biodiesel, les gaz de synthèse, les algues, le biocharbon, les fournisseurs de matières premières destinées à la biomasse et le compost. Le marché des biogaz n’est pas encore commercialisé aux États-Unis, il est pour le moment au stade de recherche et développement. Le marché du bioéthanol et biodiesel est lui très limité. De nombreuses entreprises comme Vera Sun Energy ont connu la faillite et se sont fait racheter par d’autres entreprises. Malgré un fort potentiel, le marché des gaz synthétisés est sous-développé aux États-Unis. Le marché des algues est quant à lui très prometteur, de nombreux acteurs comme Shell et Chevron s’intéressent à cette filière. Le marché du biocharbon a émergé très récemment aux États-Unis, et s’avère très attractif. L’une des entreprises bien établies dans ce domaine est l’entreprise Eprida of Athens en Géorgie. La plupart des villes aux États-Unis offrent un service de recyclage des matières compostables. L’État de Californie par exemple a adopté une politique de « zéro déchet ». Ce marché est très intéressant, car la demande pour les services est supérieure à l’offre. Les fournisseurs spécialisés en équipements de compostage sont bien établis sur le marché, mais les aspects technologiques et de savoir-faire sont bien moins développés qu’en Europe. Les principaux acteurs sur le marché du compostage sont Wildcat, Siemens, Peterson, Screen USA, Komptech, Airlift Separators, SCARAB, Rotochopper, Roto Mix, Doppstadt et McCloskey.

1.3 Marchésdutraitementdel’eau,del’airetdesdéchets
Le marché de l’eau aux États-Unis est un marché très porteur. En 2007, celui-ci générait 119 milliards de dollars de revenus (Rapport ECG Consulting Group, 2010). Le secteur public détient la majorité des infrastructures liées à l’eau. Ce marché est en pleine croissance puisque la majorité des installations deviennent obsolètes et peuvent représenter un danger pour la population. Le gouvernement est donc à la recherche de nouvelles solutions qui pourront améliorer le traitement de l’eau. Les acteurs présents sur le marché sont Adi Systems, Badger Engineers et Biotecs pour les industries et Biogas Nord et ENTEC pour le secteur agricole. L’installation de ces systèmes est en plein développement aux États-Unis (voir Tableau 4) et est particulièrement présente dans les états du Wisconsin, New York, Illinois, Nebraska, Pennsylvanie et Californie. Les entreprises américaines dominant le marché sont Shaw Environmental & Infrastructure Inc., Siemens Water Technologies et Pall Corporation.
Le principal intervenant du marché de la qualité de l’air est le groupe leader Corning Inc. Il crée et produit des composants de pointe et de haute technologie. De nombreuses associations et organismes gouvernementaux favorisent le développement de ce marché, comme la Division des Ressources de l’Air (New York) ou le Bureau de la qualité de l’air du département de la protection environnementale (New Jersey).
Le marché des déchets est quant à lui dominé par les entreprises United Technologies, Waste Management et Republic Services.
Tableau 4 – Installations des systèmes de traitement d’eau par anaérobique aux États-Unis en 2008

1.4 Marchédel’efficacitéénergétique
Ce marché sous-entend la promotion des comportements organisationnels et des processus de production et de transport consommant la plus faible quantité d’énergie possible à rendement égal. Les attentes des clients sont le développement de projets touchant aux systèmes de chauffage et d’électricité, la construction de bâtiments écologiques et l’utilisation efficace et modérée de l’énergie. Le principal acteur du marché est Encoler USA, entreprise leader basée à Washington et spécialisée dans l’efficacité énergétique. Weston Solutions Inc. avec 218,1 millions de chiffre d’affaires est situé dans l’est des États-Unis et est spécialisé dans les solutions de développement durable, dans la conception de bâtiments écologiques et d’énergies propres. L’organisme d’État American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) joue un rôle important sur ce marché et met en place des politiques d’amélioration de l’efficacité énergétique.
1.5 Marchédesconstructionsécologiques
Le marché des constructions dites « vertes », lié au marché de l’efficacité énergétique, est en pleine expansion aux États-Unis. Le principal objectif de ce secteur est de réduire tous les impacts liés aux activités du transport, de la construction et de la démolition sur la santé et sur l’environnement, tout en s’efforçant de consommer le moins d’énergie possible. Ce marché représente 57 milliards de dollars américains en 2008 et 80 milliards de dollars en 2013. Le gouvernement, par ses initiatives, représente l’un des principaux moteurs de développement de ce secteur, notamment avec la création d’associations, telles que United States Green Building Council (USGBC) et du Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), chargées de délivrer des niveaux de certification ainsi que des standards à atteindre pour chaque projet. Le marché des constructions vertes connaît un fort développement dans les États tels que la Californie, la Floride et plus généralement dans les États de l’ouest et de l’est des États-Unis (voir Tableau 5).
Tableau 5 – Programmes de construction verte dans des villes dont la population est supérieure à 50,000 habitants

2 OPPORTUNITÉSD’AFFAIRESAUXÉTATS‐UNIS
2.1 LesÉtats‐Unis:unenvironnementattractif
Le marché des technologies vertes aux États-Unis représente un potentiel d’affaires important pour les entreprises canadiennes et québécoises. Un des premiers facteurs à prendre en considération concerne sa proximité géographique qui permet aux entreprises canadiennes de limiter leur frais d’exploitation (moins élevés que sur des marchés étrangers plus éloignés géographiquement nécessitant donc des investissements plus conséquents). La taille du marché américain est aussi un élément important. En 2013, le PIB des États-Unis était de 16,8 billions de dollars américains ce qui représente un fort potentiel de marché. De plus, la réussite des entreprises québécoises aux États-Unis peut être un tremplin et offrir de nouvelles opportunités de développement sur d’autres marchés internationaux.
Il est important de souligner le rôle de l’État dans le potentiel d’évolution des entreprises québécoises aux États-Unis. En effet, le marché des technologies vertes connaît un fort développement aux États-Unis en raison d’une réglementation plus sévère au niveau de l’environnement (exemple de « La Clean Air Act et Renewable Portfolio Standard »). Un des objectifs principaux des États-Unis est de réduire leur dépendance énergétique et améliorer la sécurité nationale (sensibilisation aux questions environnementales). Ces objectifs gouvernementaux expliquent en partie la croissance de plus de 10 % au niveau des secteurs des technologies propres et de l’environnement marqués par une intensification de la recherche et du développement en 2010.
Par ailleurs, l’accord de 2010 en matière de réglementation sur les marchés publics des technologies vertes entre les États-Unis et le Canada favorisent le développement des entreprises canadiennes aux États-Unis. Cet accord inclut une « clause de renonciation » permettant aux États et entreprises américaines de faire appel à des entreprises autres que nationales en ce qui concerne les projets associés à la production d’électricité. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises canadiennes leur permettant ainsi de prendre part à des projets aux États-Unis selon l’« Americain Recovery and Reinvestment Act ».
Ainsi, le marché des technologies vertes américain apparaît comme une opportunité de développement que ce soit pour le secteur privé ou public canadien. Les débouchés concernant le secteur privé ne sont pas à négliger. En effet, selon le rapport d’ECG Consulting Group, le marché des technologies vertes aux États-Unis reste un marché ouvert aux entreprises et nouvelles technologies novatrices (que ce soit au niveau des services ou produits).
2.2 Opportunitésd’affairesdesentreprisesquébécoisesauxÉtats‐Unis
Un article du journal Les Affaires (2010) souligne quatre tendances favorables aux entreprises québécoises. La première tendance porte sur la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, principalement en ce qui concerne les véhicules de transport (passant par une amélioration de l’efficacité des moteurs). Cela représente une opportunité d’affaires dans les secteurs des matériaux légers et de l’aluminium. La seconde tendance concerne également la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais cette fois au niveau des centrales utilisant des carburants fossiles.

Cet objectif implique le développement de technologies capturant le gaz carbonique, ce qui rentre dans les compétences des entreprises canadiennes ayant déjà une certaine expérience de ce type de technologie. Une autre tendance concerne l’utilisation croissante de technologies vertes, notamment dans le secteur énergétique, au niveau domestique. Cette tendance est favorable pour des entreprises d’éoliennes ou de centrales hydroélectriques par exemple. La quatrième tendance concerne l’amélioration des réseaux électriques dont les besoins d’investissement d’ici 2017 sont estimés à près de 30 milliards de dollars canadiens.
2.3 Opportunitésd’affairesdanslenord‐estdesÉtats‐Unis
Le rapport de l’ECG Consulting Group indique qu’il existe d’importantes opportunités d’affaires dans le nord-est des États-Unis (notamment dans les États de New York; de la Pennsylvanie, du Massachusetts, du New Jersey et l’État du Connecticut).
Lesecteurdel’air
Selon le rapport de l’ECG Consulting Group, au niveau du secteur de l’air, ces cinq États représentent à eux seuls 9,4 % des émissions de CO2 des États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis ont instauré en 2009 la « Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) », qui est l’une des premières mesures restrictives en ce qui concerne l’émission de gaz à effet de serre. Les quatre États, excluant l’État de Pennsylvanie qui a toutefois adopté une loi en matière d’émission de gaz à effet de serre, sont dans l’obligation de fixer un seuil pour leurs émissions de CO2 ainsi que de réduire de 10 %, d’ici 2018, leurs émissions de dioxyde de carbone produites par le secteur de l’électricité. Ces réglementations offrent de nouveaux marchés potentiels pour les entreprises québécoises aux vues de leurs expertises. Selon l’ECG Consulting Group, l’essentiel des besoins dans ce secteur concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des technologies permettant d’instaurer un meilleur contrôle au niveau de la pollution de l’air. Il faut toutefois tenir compte des types ou sources de pollution qui varient selon les États. On note également un besoin au niveau de la diminution des émissions de dioxyde de carbone dans l’industrie. Les entreprises québécoises bénéficient d’importantes connaissances dans ces deux domaines. Il existe aussi un besoin d’équipements plus sophistiqués permettant de contrôler le niveau de pollution de l’air et de filtrer et traiter une « gamme d’émissions complexes ». Les États-Unis ont également besoin de technologies plus avancées en ce qui concerne la capture et la séquestration du dioxyde de carbone. La Pennsylvanie est l’état dans lequel le niveau d’émissions de gaz à effet de serre est le plus important et présente donc un potentiel de croissance élevée.
Lesecteurdel’eau
Le secteur de l’eau est aussi un secteur regroupant de nombreuses opportunités d’affaires pour les entreprises québécoises. Ce marché peut être divisé en deux sections: les eaux usées et les eaux potables. Les besoins se situent au niveau des infrastructures hydriques vieillissantes. En effet, le gouvernement fédéral a tendance à réduire les investissements dans ce secteur et les autorités municipales ont besoin d’entreprises innovantes apportant les solutions nécessaires aux problèmes associés à l’eau.

Selon l’ECG Consulting group, les cinq états ont établi un besoin de financement de 45,6 milliards de dollars pour l’entretien des infrastructures d’eau potable au cours des vingt prochaines années. On note également un besoin important à l’accès à l’eau potable qui se fait de plus en plus rare associé à une préoccupation grandissante des effets des polluants sur la santé. Ce secteur en pleine croissance offre des opportunités pour le développement des entreprises québécoises aux États-Unis; celles-ci ayant la capacité d’offrir de nombreux services et produits répondant à ces besoins. Les deux états dans lesquels les débouchés sont les plus importants sont les états de New York et de Pennsylvanie. Selon l’ECG Consulting Group, les principaux besoins auxquels les entreprises québécoises sont à même de répondre se situent au niveau de la réparation, la réfection, du diagnostic, et de l’entretien des réseaux d’eaux usées et d’eaux potables vieillissants. Ces états ont aussi besoin de nouveaux pipelines plus faciles d’entretien (essentiellement au niveau des coûts d’entretiens) et plus durables ainsi que de nouvelles technologies permettant une décontamination plus efficace et rapide des eaux polluées.
Les entreprises québécoises peuvent répondre à ces besoins en raison de leurs connaissances avancées en ce qui concerne les réseaux d’alimentation en eau et les réseaux d’aqueduc. Les entreprises québécoises ont également de larges connaissances dans des équipements tels que « des conduits de polyéthylène ondulés de haute densité » permettant l’amélioration de ces réseaux. Celles-ci offrent aussi une large gamme de services et produits dans la conception, la fabrication ainsi que la mise en place, de systèmes sur mesure pour le traitement de l’eau. Les entreprises québécoises peuvent aussi apporter des solutions en ce qui concerne le traitement des eaux usées.
Qualitédessols
Un des autres marchés dans lequel il existe des opportunités d’affaires pour les entreprises québécoises concerne la qualité des sols en lien avec la gestion des déchets et la pollution de l’eau. Selon ECG Consulting Group, un des enjeux majeurs pour les états concerne la décontamination des friches industrielles pour laquelle les états investissent beaucoup. Ces dernières années, le réaménagement des friches industrielles a généré plus de 190 000 nouveaux emplois représentant une recette de près de 400 millions de dollars au niveau des municipalités. Dans ce secteur, les financements de l’état fédéral ont diminué, mais l’« American Recovery and Reinvestment Act » qui comprend le secteur de la qualité des sols permet l’apport de subventions importantes favorisant ainsi le développement de ce marché. Les entreprises québécoises peuvent, en raison de leur savoir-faire, répondre à ces besoins. En effet, celles-ci jouissent d’une variété de services et technologies permettant de concurrencer les entreprises américaines. Les débouchés les plus importants pour les entreprises québécoises se situent dans les états du Massachusetts et du New Jersey. Selon ECG Consulting group, les principaux besoins dans ce marché sont essentiellement au niveau de la caractérisation des sols contaminés ainsi que de leur restauration et décontamination. Les eaux souterraines ont également besoin d’être décontaminées.

Selon l’ECG Consulting group, les entreprises québécoises qui ont développé de nombreuses technologies de décontamination et restauration des sols peuvent répondre à ces besoins. Par ailleurs, leurs connaissances au niveau de la caractérisation des sols (par l’utilisation de nombreuses méthodes notamment) et leurs différents services proposés (évaluation, évaluation des risques, surveillance et protection au niveau de la pollution) dans le domaine de la restauration des sols et des eaux souterraines sont des atouts supplémentaires pour apporter des solutions à ces besoins.
Lemarchédesdéchets
Le marché des déchets présente également certains attraits pour les entreprises québécoises. Ce marché compte des entreprises américaines similaires aux entreprises québécoises notamment dans le domaine du traitement, de la collecte et de l’élimination des déchets. Selon ECG consulting group, le marché des services des déchets représente près de 6.4 milliards et continue de se développer (mai 2010). Les États dans lesquels les perspectives de croissance sont les plus importantes sont : l’état de New York (représentait 2 milliards de dollars en 2010), le Massachusetts dont la croissance est la plus rapide (4,6 % TCAC) ainsi que l’état de Pennsylvanie qui a le taux le plus élevé au niveau de la production de déchets industriels. Selon le rapport ECG Consulting group, les besoins les plus importants concernent essentiellement la capacité de stockage des déchets dont « les déchets radioactifs de faible activité » qui nécessitent des technologies plus spécifiques pour leur entreposage. Ces États ont également besoin de technologies qui permettraient de limiter la pollution lors de déversements de pétrole et de technologies permettant un meilleur nettoyage des déchets qui en résultent. Les États-Unis ont aussi besoin de services de transport, de tri, d’élimination ou de stockage de déchets; incluant les déchets dangereux et organiques et les matériaux résiduels qui proviennent de la production. Toutefois, il est à noter que la demande concernant le marché de la gestion des déchets reste très différente par rapport à la demande québécoise, en conséquence, la pénétration de ce marché s’en trouve plus compliquée. Les entreprises québécoises doivent donc fournir des solutions novatrices afin d’améliorer leur compétitivité. Les atouts des entreprises québécoises concernent essentiellement la production et la mise en place d’équipements de tri. Les entreprises peuvent aussi apporter leur expertise au niveau de la gestion, du traitement et de la conversion des matériaux résiduels. Les entreprises québécoises ont aussi développé des systèmes permettant la revalorisation des déchets. Ces différentes techniques, services et produits peuvent répondre à ces besoins.
Lemarchédesénergiesrenouvelables
Concernant le marché des énergies renouvelables, celui-ci connaît une croissance régulière et représente l’un des secteurs les plus dynamiques en ce qui concerne l'industrie de l’énergie. Ce marché inclut les énergies photovoltaïques (PV) et solaires, les éoliennes, la biomasse, les énergies hydrauliques et géothermiques. Ce marché est évalué à plus de 173 milliards de dollars en 2010 (soit 16,6 % du marché étasunien) au niveau des cinq États étudiés par l’ECG Consulting Group. Les perspectives de croissance sont importantes et devraient atteindre 326 milliards de dollars américains d’ici 2030 selon ECG Consulting Group.
Cette croissance est synonyme d’opportunités pour les entreprises québécoises, particulièrement dans le secteur des énergies éoliennes. Toutefois, ce marché reste un des marchés les plus concurrentiels dans lequel l’innovation joue un rôle très important.

Certains états présentent plus d’opportunités que d’autres, dont l’État du Massachusetts pour lequel de nombreux projets sont en cours de développement (cet État connaît des difficultés à s’adapter aux normes et réglementations). Les principaux besoins des États-Unis auxquels les entreprises québécoises pourraient répondre, selon le rapport de ECG Consulting Group, concernent la production d’électricité dans des projets d’énergies éoliennes avec la mise au point d’aérogénérateurs, le développement de technologies de piles à combustible ainsi que l’amélioration et l’installation de centres de production solaire photovoltaïque.
Les entreprises québécoises ont certains avantages notamment dans l’industrie éolienne qui est fortement développée; mais aussi au niveau de solutions et technologies différenciées dans la « conversion de l’énergie des biogaz et des solutions de gaz d’enfouissement ». Les entreprises ont par ailleurs développé des technologies permettant la production de biocarburants de deuxième génération.
L’efficacité énergétique
L’efficacité énergétique constitue un autre marché potentiel pour les entreprises québécoises aux États-Unis. Ce marché représentait en 2010, pour ces cinq États, 173 milliards de dollars, soit 16,6 % du marché américain (selon le rapport de l’ECG Consulting Group). D’ici 2030, les perspectives de croissance s’établissent à près de 326 milliards de dollars. Ce marché, bien que très concurrentiel, présente des opportunités de développement pour les entreprises canadiennes et québécoises qui ont des produits et services répondant à ces besoins. L’État du Connecticut, avec les tarifs les plus élevés au niveau de l’électricité, offre des opportunités de croissance. Les principaux besoins auxquels les entreprises québécoises sont à même de répondre concernent, selon le rapport de l’ECG Consulting Group, le développement de projets combinant l’électricité et le chauffage, et la conception et la mise en place de bâtiments plus écologiques. Les États ont également besoin de développer des solutions plus efficaces pour préserver l’énergie et l’utiliser de façon plus efficace.
Les principaux atouts des entreprises québécoises se situent essentiellement au niveau du service de conseil, de gestion et de formation en ce qui concerne l’efficacité énergétique et dans la production d’énergie plus propre. Les entreprises québécoises peuvent aussi apporter des solutions en matière d’optimisation énergétique et de construction de bâtiments à haut rendement.
Ces cinq États présentent donc des opportunités d’affaires pour les entreprises québécoises et canadiennes. Il est cependant nécessaire de considérer également les autres états porteurs en matière de technologies propres, le principal étant la Californie. La région regroupe un gigantesque complexe d’énergie solaire composé de « quatre centrales de 250 mégawatts » destiné à devenir l’une des « plus grandes centrales solaires dans le monde » selon M. Salazar, ministre des Affaires intérieures américaines. Il s’agit d’un des projets solaires les plus importants dans le monde. Par ailleurs, la Californie a pour objectif d’ici 2020 de produire 33 % de sa production d’énergie de sources renouvelables, ce qui constitue un potentiel de marché considérable pour les entreprises québécoises ayant déjà une certaine expertise dans ce domaine.
D’autres initiatives peuvent être observées dans les États-Unis en ce qui concerne le secteur des technologies vertes. En 2010, le ministre des Affaires intérieures a annoncé le lancement du premier des cinq projets d’énergies renouvelables (quatre sont en Californie et un au Nevada).

Les entreprises américaines cherchent donc de plus en plus à utiliser les technologies vertes dans le but de réduire leurs empreintes énergétiques et répondre à certaines normes nationales et mondiales. L’objectif étant aussi de devenir le premier acteur majeur dans ce secteur en pleine croissance. Au niveau de la consommation domestique, on peut noter que la population américaine est de plus en plus encline à utiliser les technologies vertes, ce qui engendre également des opportunités de croissance pour les entreprises québécoises. Le gouvernement californien supporte ce type d’initiatives, en conséquence ce secteur devrait se développer davantage au cours des prochaines années. Selon Cleantech 100, palmarès de l’innovation, près des deux tiers « des sociétés prometteuses dans le domaine du solaire et des énergies renouvelables » sont établies en Californie.
La Silicon Valley regroupe de nombreuses entreprises de recherche dans le domaine des technologies vertes. Ainsi, l’implantation dans une telle zone, favorisée par l’établissement de partenariats stratégiques, pourrait constituer une opportunité unique d’innovation, mais aussi faciliter l’accès à ce marché très compétitif. Un récent rapport d’Ernst & Young souligne qu’un nombre croissant d’investissements est fait dans les technologies vertes, soit une contribution de près de 1,5 milliard de dollars en 2014.
3 DÉFISDUMARCHÉAMÉRICAIN
Malgré des opportunités d’affaires évidentes aux États-Unis, des barrières existent qui pourraient constituer un frein au développement des entreprises canadiennes et québécoises sur ce marché.
3.1 Uncadreréglementairecomplexe
Il convient d’observer dans un premier temps la diminution des allocations du budget américain aux énergies renouvelables. En effet, le budget pour l’Office of Energy Efficiency and Renewable Energy est mitigé pour 2014. Globalement, le budget alloué est plus élevé de 1,7 milliard de dollars en comparaison à 2013. En revanche, la majorité des programmes focalisés sur les énergies renouvelables ont reçu moins de financement que prévu dans le budget initial proposé par le président. Les principales énergies concernées sont les technologies de construction (-40 %), automobiles (-50 %), éoliennes (-39 %) et solaires (-28 %). Cette nouvelle allocation du budget risque de créer des freins à l’appel à la sous-traitance, notamment internationale, et constitue un désavantage pour les entreprises de technologies vertes sur le territoire. Au contraire, les énergies nucléaire et fossile ont reçu davantage de financement avec respectivement 889 millions de dollars au lieu de 735, et 562 au lieu de 429 millions de dollars. Le lobbying peut être à l’origine de ce changement d’orientation qui ne dessert pas les entreprises de technologies vertes américaines et canadiennes. (Flavin, 2014)
D’autre part, le système réglementaire environnemental américain est un système complexe. Il est géré par des organisations administrées à différents niveaux du gouvernement. Les réglementations sont à l’origine de solutions de support, mais aussi de restriction. Elles peuvent donc soutenir ou poser des limites sur certains aspects du développement des technologies vertes et ainsi impacter directement les activités des entreprises étrangères du secteur.

Par conséquent, il est important de comprendre et de prendre en considération l’environnement réglementaire pour s’implanter aux États-Unis. La vue d’ensemble du système est visible dans le tableau 6. (OSEC, 2009).
Tableau 6 – Le Système réglementaire environnemental américain
Le rapport de l’OSEC de 2009 stipule aussi que les agences fédérales constituent la plus haute autorité et leurs réglementations s’appliquent dans tout le pays. Ce sont donc les premières réglementations à prendre en considération. Néanmoins, les États ont le droit de choisir des réglementations plus strictes que les lois fédérales avec l’accord de l’Environmental Protection Agency. La Californie, par exemple, a promulgué sa propre loi en matière de qualité de l’air, bien plus stricte que la loi fédérale du Clean Air Act. De même, dans le cadre du Resource Conservation and Recovery Act, les États de Californie, du Kentucky, du Michigan, du New Hampshire et de Washington sont connus pour leurs réglementations plus strictes. Il existe donc une certaine hétérogénéité parmi les États. Aussi, il est important de noter que la responsabilité d’entreprise varie d’un État à l’autre. Même si l’entreprise n’est que le producteur apparent et non le réel producteur de la technologie, elle peut être tenue pour responsable. Dès lors, le choix d’un État devient primordial pour les entreprises québécoises et canadiennes, la sélection par dynamisme de l’activité seul est insuffisante.
De plus, l’Environmental Protection Agency a établi l’Environmental Technology Verification afin de permettre la vérification des données de performance des nouvelles technologies basée sur des critères de standardisation et de protocole. L’entrée des acteurs sur le marché est donc contrôlée et cela constitue également une barrière pour les entreprises canadiennes (OSEC, 2009).
Enfin, le soutien financier gouvernemental va en priorité aux entreprises américaines. En effet, de nombreux financements et subventions du gouvernement américain existent. Cependant, ces derniers sont alloués en priorité aux entreprises locales. Comme toute économie, l’économie américaine soutient en premier lieu ses entreprises nationales. Selon l’ECG Consulting Group (2010), des barrières protectionnistes sont donc présentes indirectement, par exemple Recycling Industries Reimbursement Credit au Massachusetts qui promeut les technologies de recyclage.

Ce programme de subventions a été développé pour soutenir les entreprises de technologies vertes, mais pour y être admissible l’entreprise doit posséder un bureau implanté dans le Massachusetts et plus de 50 % de l’effectif total doit y travailler. L’exportation n’est donc plus ici une option pour les entreprises canadiennes. La présence d’une filiale locale et la démonstration de son engagement sur le marché américain sont des prérequis à l’obtention d’un quelconque financement. Les entreprises canadiennes sont ainsi ici désavantagées.
3.2 Laforteconcurrenceentraîneunbesoinendifférenciation
Comme vu précédemment, le marché des technologies vertes aux États-Unis est très concurrentiel. En tant qu’entreprise canadienne, il est difficile d’y développer son activité bien que des accords publics aient été conclus. De plus, le réseau américain de l’énergie démontre un manque d’interconnexion qui peut restreindre le développement et l’intégration des différentes sources d’énergie (Commissariat général du développement durable, 2013). C’est notamment le cas pour les énergies de l’éolien et du solaire. Cependant, le projet The race to the top for energy efficiency and grid modernization, qui avait notamment pour but la modernisation de ce réseau, n’a reçu aucun financement malgré le soutien du président (Flavin, 2014). Bien que les entreprises américaines profitent de soutiens financiers gouvernementaux, des faillites ont été observées. L’entreprise d’énergie solaire Solyndra est tristement connue pour cette raison. Cette dernière n’a pu s’acquitter de sa dette fédérale à hauteur de 535 millions de dollars à la suite de la baisse des prix des panneaux solaires à base de silicone. Solyndra utilisait en effet une technologie alternative et n’a pu rester concurrentielle, ce qui a entraîné sa faillite et son insolvabilité. Le gouvernement américain prévoit néanmoins de réinvestir afin de « ressusciter » l’entreprise même si le marché semble sceptique face à cette manœuvre. (Grunwald, 2014)
La concurrence et le soutien qu’elle obtient de l’État constituent donc des menaces pour les entreprises étrangères désireuses de pénétrer le marché des États-Unis. De ce fait, il est nécessaire de se différencier de la concurrence à l’aide de technologies singulières. Afin de contourner toute mesure protectionniste, il est primordial de proposer des technologies différenciées qui répondent aux besoins de la clientèle, mais dont les prix restent concurrentiels. (ECG Consulting Group, 2010).
3.3 Barrièresetdéfisspécifiquesdecertainestechnologies
Des défis spécifiques à chaque secteur sur le marché américain existent également et sont présentés dans le rapport de l’OSEC de 2010.
Le secteur éolien souffre d’un manque d’interconnexion du réseau, comme vu précédemment, qui ne facilite pas la mise en place de lignes de transmission. Il présente donc de nombreux défis liés notamment au développement de prévisions réalistes des investissements nécessaires à la production selon le lieu d’établissement. Ces dernières sont aussi compliquées du fait d’imprévus courants et dépendent des conditions locales du marché telles que le prix des énergies, l’utilisation de combustibles et les préventions d’émission. Encore une fois, l’implantation des entreprises canadiennes dans un certain état doit être judicieusement analysée.
En ce qui concerne l’énergie solaire, les producteurs canadiens se doivent d’améliorer l’efficience de leurs systèmes pour rester concurrentiels. En effet, le secteur dépend fortement de la production du silicone pour la construction de panneaux solaires. Néanmoins, la sécurisation de l’approvisionnement de ce composant est délicate du fait de l’importante demande mondiale.

Le développement de nouvelles technologies avec l’utilisation de matériaux alternatifs est donc ici recherché. Les systèmes solaires ont un énorme potentiel en tant que produit de consommation, mais le secteur souffre également d’un manque d’éducation du consommateur. Très peu de standards ont été développés pour supporter la facturation nette par exemple (accord qui permet à un petit producteur d’énergie souvent privé de se raccorder au réseau pour compenser l’électricité achetée par l’électricité produite). Dans ce sens, les entreprises canadiennes et américaines se heurtent aux mêmes défis.
Les barrières à l’entrée sur le marché américain sont très importantes dans le secteur de la biomasse. L’industrie est encore jeune et la production d’énergie de manière commerciale est encore relativement réduite. Il y a un besoin latent en logistique et infrastructures. De même, la stabilité et la transparence du marché restent encore à développer. Par conséquent, le marché est moins accueillant pour les entreprises canadiennes. La volonté politique joue un rôle primordial dans la vitesse d’adoption de ces technologies et même un effort concerté pour une transition vers une économie d’énergie renouvelable prendrait énormément de ressources et de temps.
Au contraire, la construction de bâtiments écologiques, ou Green Building, est fortement réglementée par l’existence de standards. Dans le cadre du Leadership in Energy and Environmental Design créé par l’US Green Building Council, les constructeurs sont évalués pour vérifier la validation de ces standards. Ces derniers constituent donc d’une certaine manière une barrière à l’entrée sur le territoire américain pour les entreprises québécoises/canadiennes. Afin de recevoir la certification LEED, plusieurs aspects des systèmes de construction sont étudiés : la sélection d’un site durable, l’efficience du système de l’eau, l’efficience de l’énergie, le choix de matériaux, la qualité de l’environnement intérieur et le design. En cas de non-respect de ces standards, l’entreprise canadienne risque une situation de litige avec l’US Federal Trade Commission, ce qui entraverait gravement ses opportunités d’affaires aux États-Unis.
Enfin, le secteur de production des technologies vertes est très concurrentiel et protégé par des processus brevetés. Les enjeux sont d’ordre général : qualité, coûts, flexibilité de la production, degré d’automatisation, sélection de matériaux et proximité avec la clientèle. Ces enjeux sont d’autant plus délicats à gérer lorsque l’entreprise n’a pas d’implantation locale. Un autre enjeu principal est la relation producteur – fournisseur. À la suite de l’augmentation de la demande américaine, plusieurs segments de composants se sont développés et les barrières à l’entrée par rapport aux investissements et à la vitesse de démarrage sont élevées. Ces barrières sont de plus amplifiées pour toute entreprise étrangère. Le processus de qualification des produits peut être très long (de 2 à 15 mois) et entrave aussi l’implantation d’entreprises canadiennes sur le territoire. Il existe donc une certaine incertitude quant à l’internalisation ou l’externalisation de la production des composants. Dans le cas de la deuxième solution, des problèmes de sécurisation de l’approvisionnement et de confidentialité du contrôle de qualité se posent également.

4 RECOMMANDATIONS
Du fait de sa proximité géographique et de son dynamisme, le marché américain présente de nombreuses opportunités d’affaires pour les entreprises canadiennes et québécoises. Un nombre croissant d’entreprises américaines est sensible aux questions environnementales et les nouvelles orientations politiques prônent « l’objectif de sécurité nationale des États-Unis d’autosuffisance énergétique » (Rapport ECG Consulting Group). Cependant, des défis sont également à prendre en considération. L’insertion dans le marché américain peut donc se faire au travers de différentes stratégies. Aussi, ces stratégies s’accompagnent de plusieurs facteurs clés de succès.
4.1 Principalesopportunitésd’affaires
Selon Boris Valensi, Business Developper chez Sunpower, les entreprises désirant investir dans le marché du solaire devraient se concentrer sur le secteur des « distributed generations », consistant en la location de panneaux solaires aux particuliers. La région la plus intéressante pour ce type de développement est sans aucun doute la Californie. Si les entreprises souhaitent s’orienter vers le marché des biocarburants, il est fortement recommandé d’investir dans la création chimique de molécules rares, faites à partir des molécules permettant de fabriquer les biocarburants. Ces molécules rares sont très valorisées sur le marché et sont destinées aux groupes de cosmétique, agroalimentaire et clinique. Le marché des biocarburants étant toujours au stade de recherche et développement, cette alternative est donc très intéressante, commercialement parlant.
4.2 Lacollectedel’information
Les entreprises canadiennes et québécoises se doivent de collecter de nombreuses informations relatives au marché américain : la demande, la structure concurrentielle et les réglementations en vigueur dans chaque État. Le marché américain est un marché très lucratif, mais aussi très concurrentiel, notamment dans le secteur des énergies solaires et éoliennes qui est largement développé dans certains États, comme la Californie qui se positionne très bien sur ces deux catégories. Aussi, ce marché présente des opportunités uniques de développement pour les technologies de la biomasse. Il est donc nécessaire de bien comprendre ce marché, ses spécificités, les opportunités qu’il comprend et les risques qui lui sont inhérents. De cette façon, les entreprises canadiennes et québécoises seront en mesure de faire les choix les mieux adaptés à leur situation et la pénétration du marché en sera optimisée.
Pour bien comprendre le marché américain et déceler les principales opportunités d’affaires, l’étude doit porter sur les différents segments de marché, la croissance et la taille de ces segments, ainsi que leurs perspectives d’évolution. Il est aussi nécessaire d’avoir une vision générale de l’industrie et de son « état de santé » en identifiant ses principales perspectives de croissance.
La concurrence doit aussi être étudiée de manière rigoureuse afin de comprendre la structure concurrentielle du marché des technologies vertes et cerner les principaux acteurs pour chaque segment de technologie.

Aussi, il est nécessaire de mener une étude de la réglementation générale du marché américain des technologies propres en considérant aussi les réglementations relatives à chaque État. La réglementation peut se montrer déterminante dans le choix des États d’implantation. Il est aussi important de prendre en considération les tendances et évolutions probables de ces réglementations. Il s’agit ici de voir les répercussions possibles sur l’entreprise puisque la réglementation peut favoriser le développement des entreprises canadiennes et québécoises ou au contraire restreindre leur accès au marché américain. Par exemple, la technologie de l’entreprise québécoise Enerkem a fortement été valorisée aux États-Unis grâce à la réglementation fédérale qui oblige les raffineurs à mélanger un contenu minimum de biocarburants dans la production de carburants conventionnels (bioéthanol pour l’essence et biodiesel pour le diesel).
4.3 Développerdestechnologiesdifférenciées
En raison de la forte concurrence sur ce marché, il est primordial que les entreprises canadiennes et québécoises développent des technologies différenciées de leurs concurrents, et ce de manière durable afin d’apporter une valeur ajoutée permanente à leurs produits. Les entreprises canadiennes et québécoises doivent donc offrir des « solutions uniques » proposées à des prix concurrentiels par rapport aux prix courants. Afin de s’assurer d’une meilleure réussite, il s’avère judicieux de mettre à l’essai les services ou produits au travers d’un projet pilote.
Les institutions en place constituent des contacts clés pour les entreprises canadiennes et québécoises. Il est important de leur communiquer les caractéristiques des technologies, leur état d’avancement et les impacts environnementaux comme le souligne l’entretien réalisé auprès d’Enerkem. Il s’agit d’établir une relation privilégiée avec les pouvoirs décisionnels en place afin de faciliter l’intégration des technologies vertes sur le marché américain. Il est nécessaire de s’entourer d’acteurs ayant un haut niveau d’expertise dans les domaines recherchés. Cette démarche ne se limite pas uniquement aux institutions politiques et publiques en place, mais peut aussi concerner des acteurs locaux (comme les entreprises locales spécialisées dans un domaine spécifique). Pour favoriser et faciliter leur développement aux États-Unis, il est fondamental pour les entreprises d’établir un réseau de clients et d’intervenants et d’évaluer rapidement les débouchés potentiels.
4.4 Privilégierle«faireensemble»
Afin d’accéder plus rapidement au marché en contournant les éventuelles barrières à l’entrée, les entreprises canadiennes et québécoises peuvent notamment mettre en place des coentreprises, former des alliances stratégiques, développer des partenariats ou bien procéder à des acquisitions. De cette manière, les entreprises seront en position favorable pour accéder à des financements (cas de Enerkem), développer un niveau d’expertise supérieur et affirmer davantage leur position sur le marché américain. Ces stratégies permettent de réduire les obstacles au financement, principalement alloué aux entreprises locales.
Les alliances constituent notamment une solution pertinente dans le sens où l’implantation de l’entreprise s’en trouve renforcée et l’accès à la clientèle facilitée. Par une alliance stratégique, les entreprises canadiennes et québécoises sont capables de contourner les restrictions freinant leur développement. À terme, elles peuvent ainsi renforcer leur compétitivité en offrant une gamme plus étendue de produits et services.

Néanmoins, il est à noter que l’évaluation préalable des forces et faiblesses des deux entreprises est primordiale pour le choix d’un partenaire.
Afin de soutenir cette stratégie, les entreprises québécoises ont la possibilité d’utiliser les programmes offerts par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MDEIE).
5 BIBLIOGRAPHIE
Calderon,O. & Bourque,G. (2013). Les technologies propres : un choix stratégique [Electronic version] / Note d’intervention de l’IRÉC, p.1-6.
Capénergie. (2012). Plaquette Cleantech USA 2012. [Electronic version] / UBIFRANCE Commissariat Général du Développement Durable. (2013). Les filières industrielles stratégiques
de l’économie verte : enjeux et perspectives. [Electronic version] Copenhagen cleantech cluster. (2012). The global cleantech report 2012. [Electronic version]. p.1-
471. Développement économique, Innovation et Exportation (2012). Répertoire des entreprises et des
centres de recherche en énergie du Québec. Développement économique, Innovation et Exportation. [Electronic version]
Direction Générale des communications et des services à la clientèle (2008). Pour un Québec Vert et prospère. Stratégie de développement de l’industrie québécoise de l’environnement et des technologies vertes. [Electronic version]
De Brito, C. (2014). Ten good reasons to invest in a clean tech fund. [Electronic version] / Responsible investor.
ECG Consulting Group Inc. (2010). Réalisation d’une étude sur les occasions d’affaires dans le nord-est des États-Unis pour les entreprises québécoises des secteurs de l’environnement et des technologies propres. [Electronic version]
ÉCOTECH QUÉBEC (2012). Les technologies propres au Québec : Étude et étalonnage [Electronic version] / Étude Écotech Québec, p.4-24.
Écotech Québec. (2014). Livre blanc pour une économie verte par les technologies propres. [Electronic version] / Écotech Québec, p.1-17.
Écotech Québec. (2014). Matière grise pour une économie verte. [Electronic version] / Brochure Écotech Québec
Enerkem. (2014). Proposition en vue de la préparation du budget fédéral 2015. [Electronic version] / Enerkem.
Eyraud,L. & Clements,B. (2012). L’investissement se met au vert. [Electronic version] / Finances & Développement , p.24-37.
Flavin, R. (2014). The US Department of Energy’s 2014 Budget Request: Implications for Renewable Energy Funding. [Electronic version]
Grunwald, M. (2014). Obama Restarts Solyndra Program, But Solyndraphobia Could Ruin It. [Electronic version].
IPP DIGITAL (2014). Énergie: les technologies propres en progrès aux États-Unis. [Electronic version]
Johnson, B. (2014). Silicon Valley's new field of dreams. [Electronic version] / The Guardian.

Le Luch, H. (2010). ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE L’ÉNERGIE AUX ÉTATS-UNIS ET LEURS CONSÉQUENCES GÉOSTRATÉGIQUES. [Electronic version] Géostratégiques N°29 p.225-239.
Le Monde. (2009). Les technologies vertes, bientôt troisième secteur industriel mondial ? [Electronic version]
Mars Cleantech. (2014). Sommaire canadien sur l’énergie et l’innovation. [Electronic version] / Advanced energy centre Mars Cleantech.
OSEC Business Network Switzerland. (2009). The U.S. Market for Green Technologies Opportunities and Challenges for Swiss Companies. [Electronic version]
Rainwater, B. (2009). Local Leaders in Sustainability—Green Building Policy in a Changing Economic Environment. The American Institute of Architects. Bruno Séguin (2011). Le Marché des Technologies vertes aux États-Unis [Electronic Verion] /
Centre des affaires internationales Laval Technopole. Bulletin d’information internationale Sequovia (2014). Les États-Unis prennent une longueur d’avance dans les technologies vertes
[Electronic Version]. Sequovia. Technologies du développement durable Canada. (2010). Rapport TDDC 2010 sur la
commercialisation des technologies propres. [Electronic version] p.39-139. Von Walterskirchen, M. (2010). Optimiser les chances d’exportation des technologies propres
vers les États-Unis. [Electronic version] / La Vie économique. Revue de politique économique. p.57-58.

OPPORTUNITÉS, DÉFIS ET FACTEURS DE SUCCÈS SUR LE MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES EN CHINE
Wesley Acolatse, [email protected] Leila Gaizi Louriagli, [email protected]
Jie Zhao, [email protected]
Résumé
Dans notre conjoncture actuelle où le maintien d’un équilibre écologique devient un enjeu capital, différentes actions sont mises en place afin de pallier et de réduire les effets néfastes que l’Homme a sur l’environnement. C’est dans cette optique, et pour faire face à ce nouveau défi, que le Québec tente de se positionner, aussi bien sur le marché local que sur le marché international en tant que leader pour des raisons tant environnementales, sociales qu’économiques. C’est ainsi que les institutions gouvernementales et non gouvernementales œuvrent afin de promouvoir et d’encourager l’innovation et l’internationalisation de leurs entreprises pour une croissance durable au travers d’une économie verte. C’est dans cette perspective que le colloque prend tout son sens. Tout au long de ce travail, nous allons nous concentrer sur les opportunités que pourrait saisir le Québec sur le marché chinois. Ces occasions tirent leur essence de la forte croissance qu’a connue ce pays lors des dernières décennies, croissance qui s’est faite au détriment de l’environnement. Actuellement, la Chine se voit contrainte de faire face à cette nouvelle réalité. Les questions abordées sont les suivantes:1. Le gouvernement central chinois a-t-il les ressources suffisantes pour endiguer un tel problème écologique? 2. Le marché des technologies propres, en Chine, est-il à la portée du Québec? 3. Quelles sont les clés permettant d’ouvrir les portes de ce marché et qui permettront de créer des occasions d’affaires?
1 LESBESOINSDELACHINEENTECHNOLOGIESPROPRES
1.1 LagravitédelasituationenvironnementaleenChine
Avec plus de 30 années de développement extrêmement rapide depuis la réforme et l'ouverture des marchés, la Chine est entrée dans la phase intermédiaire de l'industrialisation. En 2014, la Chine est devenue officiellement la première économie mondiale en dépassant les États-Unis en parité de pouvoir d’achat (PPA). Cependant, avec 20 % de la population mondiale, la Chine est confrontée à des défis environnementaux titanesques. Il est considéré comme étant le pays le plus pollué au niveau mondial. Selon le département de la protection de l'environnement chinois en 2010, la pollution de l'environnement coûte à l’économie chinoise 1,1 milliard de yuans (environ 200 milliards de dollars canadiens), soit 3,5 % du PIB. Les effets néfastes dus à l’émergence de la Chine apparaissent dans une multitude de domaines :
Pollutiondel’air
Selon le rapport annuel de 2013 sur l’environnement chinois seulement 4,1 % des villes répondaient alors aux normes de qualité de l’air. Une grande partie du pays est désormais affectée par un smog toxique, qui nuit à la santé sur le long terme. Le nombre en moyenne des journées de smog par an est de 35,9 jours, cependant, dans certaines régions, les jours de smog ont dépassé 100 par an.

La Chine est maintenant devenue le plus grand émetteur mondial de dioxyde de carbone (CO2) en volume, ce qui représente 29 % du CO2 émit en 2012 au niveau international. En outre, la zone de pluie acide occupe 10,6 % du territoire chinois. Conséquence première de la mauvaise qualité de l’environnement, l’accroissement des maladies respiratoires et cardiaques liées à la pollution de l'air qui figurent maintenant parmi les causes principales de décès en Chine.
Pollutiondel’eau
Les données officielles indiquent qu'en 2011, 39 % des grands fleuves et 57,7 % des lacs sont pollués. L'eau contaminée utilisée pour l'irrigation a également suscité des questions sur la sécurité alimentaire et les préoccupations de santé publique. Une étude du Ministère de la Terre et des Ressources (MTR) a démontré que 70 % des eaux souterraines dans le Nord sont impropres à la consommation pour l’homme. Conséquence immédiate de cette pollution, 298 millions de personnes n’ont désormais plus accès à une eau potable et saine.
Déforestationetpollutiondelaterre
Les terres cultivables connaissent une réduction annuelle atteignant 80,2 mha. L’érosion des sols chinois touche aujourd’hui 30,7 % des terrains alors que la couverture forestière est de seulement 21,6 %.
Face à un tel constat, l’opinion publique chinoise tend de plus en plus à manifester son mécontentement. En effet, les préoccupations des citoyens concernant les enjeux liés à l’environnement et à la sécurité alimentaires sont en forte hausse depuis 2013. Le pouvoir est conscient de la gravité de ces problèmes.
Les causes de ces problèmes environnementaux sont nombreuses. Dans un premier temps, le modèle de développement de la Chine est encore traditionnel, 75 % de la production est dépendante du charbon. Les ressources d’énergie ne sont pas renouvelables, particulièrement avec l’urbanisation croissante des villes et l’augmentation exponentielle de la mise en circulation de véhicules. Deuxièmement, les chinois, bien que conscients de la détérioration de l’environnement, seulement une minorité est prête à changer ses habitudes quotidiennes au prix d’un environnement plus sain. Malgré la mise en place d’une nouvelle réglementation, les gouvernements locaux ont priorisé la croissance économique au détriment de l’environnement. En illustration de cette réalité, nous proposons ici un exemple criant, en 2012, environ 75 milliards de tonnes d’eaux usées ont été déversées dans les rivières chinoises.
1.2 Actionsvertesdupouvoirrouge
« Le développement de la Chine ne doit pas se faire au détriment de l'environnement écologique dans la poursuite de la croissance économique. »
- Premier ministre Li Keqiang, 16 mars 2013
Au cours des dernières années, L’État chinois a finalement semblé adopter une position encourageante par rapport à l’environnement. Depuis la première. « Loi de la Protection de l’Environnement » en 1989, le gouvernement chinois a promulgué une centaine de lois et de règlements officiels concernant la responsabilité écologique.

Entre 2005 et 2010, 2 000 milliards de yuans (environ 300 milliards de dollars) ont été investis dans des projets d’économie d’énergie et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, dont 10 % ont été directement engagés par le gouvernement central. De la même manière, le gouvernement a alloué 338,3 milliards de yuans (60 milliards CAD) en 2013 pour la réalisation d'économies d'énergie et la protection de l'environnement, soit une hausse annuelle de 14,2 %. En outre, certaines dispositions du 11e plan quinquennal (2006-2010) avaient pour objectif d’améliorer l’intensité énergétique de 20 %. Le régime de l’impôt sur les bénéfices des sociétés comporte aussi des mesures favorables aux investissements dans les projets écologiques et les économies d’énergie.
Pour atteindre la meilleure adéquation possible entre croissance et exigences environnementales, la Chine a fait du développement du secteur des énergies renouvelables un objectif industriel prioritaire. Ainsi, elle fait désormais recours à plusieurs méthodes pour tenter d’assurer sa domination et faire évoluer son économie vers un modèle de développement vert à basse intensité en carbone. Les objectifs et les domaines principaux sont entre autres : la diversification des moyens pour réduire les émissions, le développement de villes plus écologiques (smart city), le développement des véhicules électroniques, la reproduction industrielle à bas coût (solaire), la protection du marché́ intérieur (éolien), une augmentation des subventions croissantes à des technologies nationales et, en dernière instance, l’espionnage industriel.
La Chine envisage que, pour l’année 2015, les émissions de dioxyde de carbone soient en baisse de 17 % par rapport à 2010. La part des énergies non fossiles dans la production d’énergie primaire est, dès lors, supposée passer de 8,3 % en 2010 à 11,4 % en 2015. La consommation du gaz naturel va représenter une proportion de 8 % en 2015. De 2011 à 2020, le gouvernement central prévoit d’investir 100 milliards de yuans (environ 15 milliards CAD). Au cours des 10 prochaines années, le gouvernement va également mettre en place une politique fiscale afin de promouvoir les véhicules économes en énergie. Par exemple, une exemption de taxes de consommation à l'achat d'un véhicule électrique et une réduction de la moitié de taxe à l'achat d’un véhicule hybride. En ce qui concerne la transition progressive de l'industrie lourde à l’industrie des services (tels que les transports, le tourisme, les services aux entreprises et les soins de santé), la Chine a d’ores et déjà enregistré des résultats positifs. Le secteur des services est monté de 43 % en 2010 à 45 % en 2012. D'ici à 2015, il représentera 47 % du PIB et, éventuellement, remplacera l'industrie et deviendra dominant.
1.3 Lespotentielsendéveloppementd’affaires
Le pouvoir rouge a entrepris des actions vertes. Une circulaire sur la gestion des affaires étrangères a investi les chantiers de construction. Le but est d'intensifier la gestion de la protection de l'environnement par de nouveaux projets de construction plus écologiques, en attirant des investissements étrangers, et aussi en passant par la prévention de la pollution de l'environnement. Il se concentre également sur l’introduction de technologies vertes issues des pays étrangers.

L’espoir d’un avenir « plus vert » n’est pas du domaine de l’utopie. Pendant la période des réunions de l’APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique 2014-11-10), les Chinois ont vu les effets positifs de la réduction des émissions en imposant des restrictions temporaires, puisque la plupart des usines polluantes avaient suspendu l'utilisation de leurs machines pour assurer un air propre pendant les réunions. Le « bleu de l'APEC » (le ciel bleu de la région de Beijing) a donc été la conséquence directe de ces restrictions.
M. Harper, le premier ministre canadien, a effectué une visite officielle de cinq jours en Chine (2014-11-09). Les deux pays ont étudié les nouveaux moyens de renforcer le commerce énergétique, et un mémorandum d'entente élargi sur la coopération nucléaire a été signé.
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique du sommet du G20 de Brisbane (2014-11-12), la Chine et les États-Unis ont mis l'accent sur un récent pacte de réduction des émissions.
« Vendre vert » est un défi en R&D et en performance pour lequel la Chine cherche à se placer à niveau supérieur, exigeant non seulement les versions les plus avancées des produits et équipements, mais aussi un acquérant un véritable savoir-faire. La perspective de vastes marchés pour les technologies propres pourrait alors contribuer au verdissement de l’économie. La prise de conscience au sujet de l’environnement, le développement de technologies moins polluantes, la réorganisation de la construction progressive d’une société civile en Chine peut relever de grands potentiels commerciaux pour les entreprises dans le monde entier.
En conclusion, la dégradation dramatique des conditions de vie de nombreux Chinois due à la pollution pourrait accélérer le mouvement d’investissement dans l’écologie. Les autorités chinoises ont mis en place des politiques ainsi que des investissements pour soutenir son développement. Comme le souligne le caractère chinois « Crise », composé de deux éléments. Le premier est le mot « Danger » qui se combine au deuxième qui est « Opportunité ». Il y a non seulement de grands potentiels commerciaux en technologie verte en Chine, mais la culture chinoise montre en un mot que c’est une culture optimiste.
2 LACHINEPOURRA‐T‐ELLERELEVERLESDÉFISDESTECHNOLOGIESPROPRES?
2.1 LaChinepourra‐t‐ellereleverledéfidestechnologiespropres?
Le Congrès National Populaire de Chine a adopté en mars 2011 le plan de développement stratégique quinquennal (2011-2015), un plan d’une ambition aux allures pharaoniques dans lequel les questions de l’énergie et du climat sont intégrées (Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China, 2011). En 2005, le président de l’époque Hu Jintao avait introduit le concept de « société harmonieuse » conforme aux réalités du pays, ce concept prenait déjà en considération les défis de la pollution sur l’environnement (Zhujun Jiang, 2014). Ces dégâts liés à la fulgurante croissance de l’empire du Milieu ont bel et bien laissé des séquelles et continuent d’inquiéter la population et sa santé. De plus, les besoins énergétiques aussi bien au niveau industriel qu’au niveau de la consommation domestique hors industrie ne cessent de croître, le gouvernement veut donc réduire sa dépendance énergétique (importation de ressources naturelles) en se tournant vers des alternatives efficaces et écologiques.

Face à cette pression sociopolitique et internationale, la réaction du gouvernement ne s’est pas fait attendre et c’est en analysant ce plan stratégique qu’on peut témoigner de sa prise de conscience grâce à des investissements soutenus auprès des pôles de recherche, des investisseurs et entrepreneurs aussi bien locaux qu’internationaux.
Les ambitions du gouvernement sont donc judicieuses, mais sont-ils réalistes? Les objectifs fixés du douzième plan quinquennal sont représentatifs de l’urgence de la situation décrite plus haut, mais sont-ils applicables dans un environnement aussi complexe que celui de la Chine? Sachant que la transition vers un développement durable implique un comportement que l’on peut qualifier de « propre » et responsable, est-ce que les chinois, en particulier les producteurs locaux sont prêts à prendre ce virage? La prise de conscience s’est-elle répartie à tous les niveaux de la société?
Les technologies propres sont les vecteurs du progrès économique vers un développement durable. Ce marché dégage des potentiels de revenus et d’opportunités très lucratifs et la Chine tente, à travers son souci de combler ses besoins urgents environnementaux, de développer un leadership mondiale en se positionnant sur ces marchés (éolien, les panneaux solaires, l’hydroélectricité) avec raison.
Dans un premier temps nous démontrerons la prise de conscience du gouvernement central en exposant les cibles de cet ambitieux plan stratégique sur l’énergie.
Ensuite, nous exposerons les défis et les obstacles que concentre la mise en application de cette incontournable réforme inscrite au plan d’action quinquennal.
2.2 Pland’actionambitieuxversundéveloppementdurable
Le douzième plan quinquennal est un plan d’investissement qui couvre sept dimensions dont trois sont associées à l’énergie et l’environnement. On parle de l’énergie renouvelable, de la protection de l’environnement/conservation de l’énergie et des véhicules fonctionnant au moyen de sources d’énergies renouvelables).
En ce qui concerne la consommation énergétique sur toute l’étendue du territoire, le gouvernement a fixé une cible de réduction de l’intensité de consommation à 16 % par unité du Produit Intérieur Brut (année de base 2010) en limitant la consommation totale à 4 milliards de tonnes en équivalence de charbon (The China Greentech, 2013). L’objectif que défend cette approche est de maximiser l’utilisation énergétique provenant de toutes les sources d’énergie confondues tout en utilisant le moins possible ce qui demande un effort très important sur toute la chaîne en passant par la production, la distribution et la consommation d’énergie; on parle alors d’efficacité énergétique. Un plan de consolidation des compagnies de charbon sera aussi mis en place afin de poursuivre l’objectif de l’efficacité productive. Il est à noter que dans cette même veine, le gouvernement encourage fortement l’utilisation des énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles puisqu’il a tablé pour une hausse d’utilisation des énergies renouvelables à 11,4 % pour l’année 2015 et 15 % pour 2020 (KPMG CHINA, 2011).
Afin de réduire sa facture environnementale, le problème des émissions de gaz à effet de serre causés par le dioxyde de carbone est aussi pris en compte. Ainsi, en prenant toujours l’année 2010 comme année de référence, le gouvernement tente de réduire les émissions de 17 % par unité du PIB.

Les autorités fiscales ont déjà mis sur place des projets pilotes de marchés d’échanges de CO2 (taxe carbone) entre les villes de Shanghaï, Pékin, Tianjin, Shenzhen ainsi que les provinces de Hubei et Guangdong. En 2010 déjà la ville de Shanghai est considérée comme la figure de proue du pays en matière de prévention contre les changements climatiques. On comprend bien que sans avoir ratifié le protocole de Kyoto la Chine ait entrepris des actions concrètes qui vont dans le sens de la protection de l’environnement.
Au niveau de l’hydroélectricité, qui en terme de capacité est la deuxième source d’énergie du pays après le charbon, le gouvernement a envoyé un message très clair. Concernant l’usage du nucléaire, le gouvernement planifiait l’installation de dix nouvelles centrales, mais la catastrophe survenue au Japon en mars 2011 a contraint les autorités à mettre le projet en suspens.
Enfin, des investissements massifs de prêt de 11,1 trillions RMB dans la seule industrie de l’électricité (incluant la construction de réseaux et de centrales électriques basées sur le modèle innovant des réseaux intelligents), ce qui positionne la Chine en première position en termes d’investissement dans ce domaine. Cette action particulièrement significative se justifie par le fait que la demande d’énergie devrait doubler dans les dix prochaines années.
En marge de cet ambitieux plan quinquennal, le gouvernement avait déjà entrepris d’investir massivement dans les énergies non fossiles hors hydroélectricité à hauteur de 710 milliards RMB (CCBC, 2009).
Force est de constater que les actions du gouvernement central en terme de réforme touchant les technologies propres sont orientées par une volonté d’atteindre un équilibre environnemental le plus rapidement possible, c’est une question de sécurité aussi bien environnementale que nationale.
Malgré toutes ces actions positives, on est en marge de se demander quels sont les défis, les obstacles qui auront tendance à ralentir les intentions du gouvernement.
2.3 Lesdéfisetlesobstacles
Lecharbon,unincontournablepourlacroissance
Selon l’agence internationale de l’énergie, les plans d’action qu’entreprend le gouvernement central auront des effets très limités sur la réduction de la dépendance au charbon comme source primaire d’énergie. Ils prédisent que cette source d’énergie hautement polluante quittera la pole position seulement après deux décennies (International Energy Agency, 2010) à condition bien sûr que le gouvernement maintienne sa politique du virage écologique.
La force de la demande d’énergie chinoise est la raison principale pour laquelle l’utilisation du charbon ne décroît pas pour l’instant et presque toute la production chinoise est consommée à l’intérieur des frontières. Cette demande énergétique croît 1,4 fois plus rapidement que l’offre énergétique (la production définie par le PIB) ce qui crée un déséquilibre important (CCBC, 2009). Selon un rapport de l’organisme international Green Peace, la Chine aurait vu ses importations de charbon dépasser ses exportations en devenant en 2011 le premier importateur mondial de charbon devant le Japon (Greenpeace, 2013). La Chine est donc victime de son propre succès.

En effet, la croissance économique du pays s’est beaucoup concentrée sur la composante de l’exportation (composante de l’agrégat du PIB) amenant ainsi le secteur industriel à fonctionner à des régimes élevés pour satisfaire une demande extérieure fortement dépendante des productions chinoises. Dans le même temps, la Chine est le premier producteur mondial de charbon avec un peu moins de 4 milliards de tonnes produites en 2012 et dispose de la deuxième plus grande réserve de charbon derrière les États-Unis (19 % des réserves mondiales) selon le ministère chinois de la Terre et des Ressources (KPMG CHINA 2011). Au vu de cette abondance énergétique, il est tout à fait normal que la logique de minimisation des coûts se soit imposée lorsque la Chine s’est engagée dans cette course à la croissance. Aujourd’hui, il est vrai que les énergies renouvelables constituent une alternative de meilleure qualité en termes d’intrant de production, mais le coût de renonciation du charbon reste encore élevé à court terme.
Ensuite, les énergies renouvelables ne jouissent pas encore d’une parfaite substituabilité à cause de leurs faibles capacités de production. En effet, en 2008, la combinaison de l’hydroélectricité, du nucléaire et de l’éolien a compté pour 253 millions de tonnes équivalent de charbon contre 1953 millions de tonnes (sachant que 90 % de l’énergie provenait des ressources non renouvelables comme le gaz naturel, le pétrole et le charbon) (KPMG CHINA 2011).
Malgré cette forte dépendance, le gouvernement chinois maintient sa politique de diversification des sources d’énergie en continuant d’investir aussi bien dans les énergies renouvelables que les non renouvelables à cause de la forte demande.
L’environnement
Le gouvernement fait face aux défis importants de la pollution atmosphérique liée aux véhicules. Le défi à ce niveau se situe au niveau du consommateur chinois donc de la demande d’automobile qui représente le plus grand marché du monde (14 % de croissance des ventes en 2013 pour 22 millions d’unités vendues contre 4 millions en 2004) (Le Figaro, 2014). Les gouvernements locaux tentent de développer des moyens de dissuasion afin de contrôler le taux de circulation sur les routes en limitant l’octroi annuel d’immatriculation ou en imposant des périodes de circulation alternée. Mais ces restrictions ont des effets limités face à ce besoin d’affirmation sociale des jeunes Chinois qui sont la cible des grandes marques de luxes occidentales. Ainsi, le gouvernement central investit de façon considérable dans le secteur des véhicules électriques et hybrides en soutenant ouvertement les entreprises étatiques à faire des alliances entre elles et renforcer leurs positionnements sur ce marché d’avenir (The New York Times, 2010). Ce soutien constitue donc une forme de barrière à l’entrée pour les entreprises étrangères.
Enfin, le taux d’urbanisation chinois est sans précédent. Le gouvernement chinois espère que ce taux atteigne 60 % d’ici 2018 contre 54 % actuellement (Le Figaro, 2014). Cette volonté s’explique encore une fois pour des raisons économiques pour le soutien de la croissance et satisfaire la continuité des activités du secteur industriel. L’effet pervers de cette approche d’un point de vue environnemental est le défi au niveau de la sphère immobilière.

En effet, les promoteurs immobiliers font face à une demande de propriété élevée, dans cette précipitation le gouvernement essaie de modifier les normes de constructions immobilières afin de rendre les futures habitations plus écoénergétiques. On pourrait donc entrevoir une difficulté d’application de ces nouvelles mesures par souci de profit de la part des promoteurs immobiliers qui pourtant est un incontournable pour non seulement une urbanisation écoresponsable, mais aussi l’atteinte des réductions de consommation d’énergie.
Peut‐onparlerd’uneprisedeconsciencedesautoritéslocales?
La prise de conscience du gouvernement central face à la crise écologique que doit combattre le pays ne fait plus aucun doute. Le défi réel se situe au niveau des autorités locales qui malheureusement, de façon générale, ne donnent pas l’impression de vouloir s’engager de façon absolue dans ce processus de modernisation socioéconomique. Les raisons peuvent être multiples, mais il ne fait aucun doute que l’appât du gain à très court terme vient altérer cette priorité d’une mutation économique.
Les cibles que le gouvernement central impose sont pour l’instant quantitatives. Ainsi, les administrateurs locaux opèrent dans l’optique de remplir cette obligation. Malheureusement, il y a un défaut dans l’approche de l’atteinte de ces objectifs qui peut être soit caractérisée par un manque de volonté des autorités locales, soit par un manque d’assistance technique de la part du gouvernement central qui viendrait développer les méthodes d’opération en matière d’efficacité énergétique. À titre d’illustration, en 2010 le magazine BBC paru le 9 septembre 2010 annoncé que la ville d’AnPing, située dans la région de Hebei, a procédé à une coupure générale de l’électricité pendant plusieurs jours afin d’atteindre ses objectifs énergétiques. Ce type de pratique contre-productive d’un point de vue qualitatif n’est pas une spécificité propre à la province de Hebei, mais bien une méthode que l’on retrouve dans plusieurs régions de la Chine.
Il est donc important que le gouvernement central accentue ses efforts de contrôle et de discipline des administrateurs locaux afin qu’ils comprennent que la question de l’efficience énergétique est avant tout une question de sécurité environnementale et de sauvegarde d’une société où les générations futures pourront s’épanouir. Il est primordial que le gouvernement central mobilise des efforts en terme d’innovations technologiques (mieux adapter aux réalités locales) pour ensuite procéder à l’intégration de ces solutions dans les modèles d’affaires, dans les opérations, dans toute la chaîne de valeur, car seule la possibilité d’avoir des résultats efficaces en terme de coût pourra faciliter les entreprises locales et les administrateurs locaux à faire des concessions et à enfin adopter de nouvelles stratégies (projets pilotes au niveau industriels) pour aboutir dans une situation « gagnant gagnant ». Ainsi, par leurs actions, cette prise de conscience pourra être mieux véhiculée par des programmes de sensibilisation envers la population, car l’écologie est avant tout une question de comportement.
« Rome ne s’est pas fait en un jour ». Cet adage met bien en relief le niveau de patience avec lequel il faudra s’armer pour voir la Chine devenir un environnement avec une faible pollution.
Le gouvernement chinois ne pourra donc pas réaliser cette tâche tout seul, c’est pour cette raison que le rôle d’investisseurs étrangers devient capital. En effet, tant bien même que la Chine dispose d’un avantage compétitif important en terme de technologie propre, elle n’a pas la capacité de dominer tous les champs de ce domaine dans la mesure où il est pluridisciplinaire. Le besoin de capitaux étrangers est inéluctable.

C’est ainsi que l’on peut affirmer avec la plus grande des convictions que ce marché représente une opportunité inouïe en l’occurrence pour les entrepreneurs québécois qui peuvent exploiter des niches et faire des alliances stratégiques avec des acteurs locaux. On prévoit que le marché des technologies propres pourrait dégager des revenus de près de 4 milliards de RMB d’ici 2020.
3 ANALYSESTRATÉGIQUEDESENTREPRISESQUÉBÉCOISESSURLEMARCHÉCHINOIS
« La dégradation de la stabilité du climat et la diminution de la résilience des écosystèmes, deux phénomènes mondiaux dont les impacts commencent déjà à se faire cruellement sentir. » SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec, 2013
Dans notre conjoncture actuelle où le maintien d’un équilibre écologique devient un enjeu capital, différentes actions sont mises en place afin de pallier et de réduire les effets néfastes que l’Homme a sur l’environnement. C’est dans cette optique, et pour faire face à ce nouveau défi, que le Québec tente de se positionner, aussi bien sur le marché local que sur le marché international en tant que leader pour des raisons tant environnementales, sociales qu’économiques. C’est ainsi que les institutions gouvernementales et non gouvernementales œuvrent afin de promouvoir et d’encourager l’innovation et l’internationalisation de leurs entreprises pour une croissance durable au travers d’une économie verte.
3.1 LavalorisationdesentreprisesvertesquébécoisesauQuébecetauCanada
Conscient des enjeux liés à ces nouveaux défis, le Québec tente de s’en emparer et vise à les transformer en opportunités. D’importants moyens ont été attribués en ce sens à la recherche-développement ainsi qu’au secteur scientifique. Cela a eu pour conséquence première de faire éclore et d’étendre le secteur des technologies propres afin de répondre au mieux à leurs politiques et autres objectifs écologiques tels que la réduction de 25 % d’émission de GES d’ici 2020, et cela tout en restant compétitif au niveau international. Ce secteur est mis en avant de manière à être considéré comme étant un acteur incontournable pour le développement durable du Québec ainsi qu’à son expansion à l’international tout en sensibilisant la population à adopter des habitudes « écolo ». En outre, le marché québécois/canadien reste d’une taille modeste par rapport à l’échelle mondiale. De plus, le marché est assez limité, il est donc important d’avoir une présence internationale afin d’asseoir sa croissance. Selon le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, 81 % des entreprises en technologies propres exportent et, de ces exportations sont issus 53 % de leurs revenus en plus d’être 9 fois plus susceptibles d’exporter qu’une simple PME. Le Québec possède un environnement propice à l’exploration et à l’exploitation du domaine des technologies propres notamment grâce à sa situation géographique qui lui procure un avantage de propriétés en ressources naturelles non négligeables ainsi qu’en main-d’œuvre qualifiée et par ses hautes technologies. Ce secteur se divise en un certain nombre de sous-secteurs. Nous pouvons citer ici, à titre d’exemple, l’énergie renouvelable, la chimie, l’écomobilité, l’air, les matières résiduelles.

Afin de favoriser l’ouverture de l’industrie, il existe des acteurs incontournables à la valorisation des entreprises québécoises. Ces acteurs sont présents afin d’appuyer différents projets en plus d’appuyer les entrepreneurs et les scientifiques dans l’internationalisation de leurs produits ou de leurs procédés.
Dans un premier lieu, le cadre institutionnel présent au Québec est propice à l’émergence, à la croissance et à l’internationalisation des entreprises en matière de Clean Tech. Ceci est principalement le résultat d’une volonté soutenue de la part du gouvernement de promouvoir les qualités et les forces québécoises sur la sphère mondiale. Une fois ce postulat admis, nous souhaitons établir ici une perspective d’étude avec le cas de la Chine et des relations bilatérales entretenues entre ces deux parties. En ce sens, plusieurs ministères, comme le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et le ministère des Relations internationales et de la francophonie, font preuve d’une activité certaine. Ils disposent notamment de spécialistes prêts à épauler et soutenir tous types de démarches tout en ayant de profondes connaissances aussi bien du marché local que du marché chinois. L’intérêt porté à la collaboration entre ces deux partenaires peut en outre se matérialiser par les récurrents déplacements du premier ministre Philippe Couillard et de son équipe en Chine. Le récent déplacement au mois d’octobre 2014 a abouti en ce sens à la conclusion d’un certain nombre d’ententes et de partenariats entre institutions et entreprises québécoises et chinoises en développement durable. Ce pays continent étant particulièrement attrayant, un comité mixte bilatéral a été mis en place, le « Groupe de travail pour la protection de l’environnement et la conservation de l’énergie » qui est spécialement bien renseigné sur les relations régissant ces deux territoires et des opportunités pouvant en émerger. À titre d’exemple, l’entreprise TM4 a considérablement bénéficié du support des autorités québécoises dans la recherche de leur partenaire et dans leur étude du marché chinois. Les services offerts ont ainsi facilité leur participation à des missions commerciales, des congrès, des expositions, etc.
L’organisation Écotech est une organisation qui, tout en publiant une multitude de rapports, représente et rassemble un grand nombre d’acteurs de tous genres du secteur des Clean Tech tels que des entreprises, des institutions financières, des centres de recherches, d’enseignements et de transfert de technologies. Elle prétend donc constituer une vitrine nationale et internationale dans le domaine de l’économie circulaire. C’est ainsi qu’elle joue un rôle d’intermédiaire en mettant en relation directe différents organismes et entreprises qui œuvrent dans la même perspective pour ainsi créer des relations permettant de travailler main dans la main pour une relation gagnant-gagnant. Cette entité prend non seulement une importance exponentielle en s’imposant comme un atout de plus en plus indispensable pour ceux qui éprouvent le désir de développer, d’exploiter ou d’internationaliser des produits innovants verts, mais elle sait également saisir les opportunités s’offrant à elle. C’est en ce sens qu’elle a profité du déplacement de M. Couillard en Chine afin de signer deux accords-cadres de collaboration. De plus, Écotech travaille en collaboration directe avec « Yixing Industry Park for Environmental Science and Technology » et « Qingdao City Construction Investment Group » ce qui permet dès lors de conclure des partenariats d’affaires et la mise en place de projets en Chine de façon considérablement simplifiée. Nous pouvons aisément en conclure que ces arguments sont en faveur de l’existence d’un partenariat privilégié entre le Québec et la Chine. Néanmoins, avant d’envisager des liens véritablement concrets avec le marché chinois, il est nécessaire d’effectuer au préalable une étude visant à identifier les secteurs clés pour lesquels le Québec a un avenir porteur sur le marché partenaire.

La Chine est particulièrement avancée en matière d’hydroélectricité, de traitement des déchets, de traitement des eaux usées et en moteurs électriques. Ces secteurs en particulier ont bénéficié d’un large investissement financier visant à développer les centres de recherche, d’enseignement et ceci dans des industries de hautes technologies d’explorations, d’exploitation.
3.2 Lemarchéchinoisest‐ilabordable?Quelestl’étatdelaconcurrence?
Le premier ministre chinois Li Keqiang annonçait le 4 mars 2014, lors de la réunion de l'Assemblée nationale populaire, que « le pays allait désormais mener une guerre contre la pollution ».
La Chine compte actuellement quelque 12 000 entreprises, instituts et organisations dans le secteur de l’écologie. Ce pays est considéré comme étant l’un des leaders en économie circulaire à côté de l’Union européenne (33 %) et des États-Unis (21 %) en détenant 17 % du marché international. Il rayonne d’un point de vue économique et se place en tant que pôle d’excellence, et ce, particulièrement dans la fabrication de systèmes photovoltaïques qui permettent la création d’énergies électriques renouvelables par l’absorption de l’énergie véhiculée par le rayonnement solaire.
Il constitue le deuxième plus gros consommateur en énergie éolienne et est récemment passé à la vitesse supérieure dans la construction de barrages hydroélectriques. Notons ici que parmi les 15 plus gros barrages mondiaux 5 se situent en Chine dont le plus important est à Yangzi Jiang. Les autorités chinoises déploient aujourd’hui des moyens considérables afin de satisfaire les besoins de leur société et de combler les lacunes qu’elle connaît tout en réduisant les effets néfastes endogènes à la production massive de ses industries et ceci en augmentant notamment les fonds alloués à la protection de l’environnement. Ce pays s’active également dans le traitement des eaux usées, des centrales d’incinération des déchets et des centrales thermiques dotées d’installations de désulfuration des gaz de combustion (procédé chimique visant à diminuer le SO2, dioxyde de souffre) provenant principalement de la combustion du charbon, la Chine étant le plus gros consommateur mondial de cette ressource. En outre, la Chine offre une gamme très diversifiée de produits et de services allant de la mise en place d’un projet à l’exploitation pour répondre aux attentes nationales et internationales.
Or, selon le dernier rapport de Greentech Chine, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes malgré les efforts déployés. Les barrières à l’entrée de ce secteur sont moins contraignantes que pour les autres industries du fait que le Gouvernement cherche activement à guérir les plaies environnementales tout en faisant la promotion de l’économie circulaire. Néanmoins, il reste relativement difficile d’entrer sur le marché en raison des importants obstacles tarifaires et non tarifaires qui subsistent surtout en utilisant la voix des exportations. Étant donné qu’il s’agit d’une industrie en développement et qui bénéficie du support des différents gouvernements, les entreprises locales sont souvent favorisées, c’est pour cette raison que souvent est privilégiée l’implantation via une coentreprise. Mais l’une des barrières les plus contraignantes, que ce soit à l’entrée, mais aussi tout au long du cycle de vie de l’entreprise, est l’environnement opaque dont font preuve les institutions gouvernementales en plus du contrôle qu’elles peuvent avoir sur la gouvernance des entreprises. La mise en place de relations privilégiées avec les autorités locales est une condition sine qua non pour offrir un terrain fertile à l’épanouissement des entreprises. La Chine connaît encore à ce jour un manque important en nouvelles technologies.

Bien qu’il y ait une forte concurrence locale, la production chinoise reste de mauvaise qualité et non durable. C’est dans la perspective de combler ces lacunes que le gouvernement chinois a fait appel aux pays étrangers afin de pouvoir profiter de leur expertise et de leur technologie. Il reste néanmoins difficile de se faire connaître et accepter dans un tel emplacement vu la vaste étendue du territoire et l’atomicité du marché. Le choix de la localisation est également un élément essentiel. Une étude stratégique quant à la localisation visant à toucher une importante base de clients doit se faire de manière minutieuse. Il existe des rivalités internes entre les différentes régions en Chine de ce fait, être présent dans une région ne garantit pas un accès facile à tout le marché chinois. En outre, il nous semble important de préciser à ce moment de notre raisonnement que les canaux de distribution en Chine restent à ce jour très défaillants. De nombreux problèmes de logistiques perdurent et la qualité et les échéances ne sont pas souvent respectées. Les entreprises du domaine qui nous préoccupe sont principalement des compagnies gérées et contrôlées par le gouvernement. La difficulté de choisir un bon partenaire pour l’acheminement des produits reste à ce jour importante pour des entreprises étrangères souhaitant s’implanter en Chine.
3.3 Quellesstratégiesemployéespours’implanterdanslemarchéchinois?Casdel’entrepriseTM4
Afin de mieux illustrer la situation, le cas de l’entreprise TM4, ayant comme seul actionnaire Hydro-Québec, sera présenté ici. Des informations pertinentes, quant au marché chinois et aux stratégies entreprises par cette compagnie pour s’y implanter, ont été recueillies à la suite d’une entrevue avec un membre de l’organisation. TM4 a pour objectif principal de devenir un chef de file mondial en matière de motorisation électrique dans le secteur de l’automobile ainsi que dans la conception de générateurs à aimant permanent pour le secteur éolien et hydro-éolien. L’entreprise a vu le marché chinois comme une opportunité certaine de croissance. C’est dans cette perspective qu’une coentreprise a été formée avec l’entreprise chinoise Prestolite Electric Beijing.
TM4, par leur engagement à développer une collaboration étroite avec leurs clients, vise à réduire leur temps de mise en marché et à maximiser le retour sur investissement. Afin de se distinguer, il leur est fourni une densité de puissance la plus élevée au plus bas prix pour l’industrie du transport et la meilleure densité de puissance volumétrique pour les éoliennes. Autrement dit, il est déployé une technologie plus avancée que celle déjà présente. La stratégie mise en place passe par le développement d’une gamme de produits complète afin de permettre d’électrifier le plus grand nombre de plateformes de véhicules. Nonobstant cette diversité de production, le marché de l’autobus chinois n’en reste pas moins leur cible privilégiée. De manière plus générale, il reste donc opportun et judicieux d’un point de vue économique de cibler un marché de taille. Les besoins de la Chine en matière de technologies propres étant très étendus, que ce soit par la forte demande locale, mais aussi par une concurrence qui connaît encore une multitude de lacunes pour répondre de manière satisfaisante aux attentes de qualité, est donc un marché regorgeant d’opportunités. Mais un problème subsiste. Celui de la protection intellectuelle. Le brevetage est le principal outil. Présentement, leur coentreprise fabrique sous licence les produits qui sont développés au Québec, cependant, leur stratégie ultime qui se voit être la meilleure pour protéger leur positionnement sur le marché est de continuer à innover constamment afin de toujours être en avance sur la compétition.

Bien que les gestionnaires de la compagnie soient conscients que les risques d’espionnage et de plagiat sont bien réels, particulièrement lorsqu’ils introduisent un nouveau produit sur le marché, les travaux de développement de la génération suivante sont déjà considérablement entamés. La stratégie gagnante serait donc de ne pas se reposer sur ses acquis, mais plutôt, de toujours avoir un pas d’avance. C’est en ce sens qu’il est prévu que leur centre de développement, de validation, de prototypage et de production en petite série reste au Québec. Mais d’autres interrogations perdurent, est-ce suffisant pour s’implanter et survivre en Chine? Comment doivent-ils procéder afin d’approcher de potentiels clients? Qu’en est-il des relations avec le Gouvernement? En guise de réponse à ces enjeux, TM4 a donc décidé d’approcher un partenaire local qui dispose d’une position dominante sur son marché et dont les produits sont perçus comme étant de qualité, ce qui leur a permis d’atteindre rapidement des clients de grande envergure qui pourront ainsi tester leurs produits. La clé du succès pour eux était donc d’avoir un partenaire qui était déjà un fournisseur approuvé chez de grands constructeurs de véhicules et qui offrait des produits complémentaires aux leurs. Le gouvernement chinois, en forçant l’électrification des transports, oblige les constructeurs à produire des véhicules électriques, ce qui implique de facto que leur industrie est en forte croissance sur ce marché. Bien souvent, les moteurs locaux ne répondent pas aux critères de qualité de cette industrie, d’où la forte demande pour que des technologies étrangères soient fabriquées en sol chinois ce qui permet par la même occasion de contourner un certain nombre de barrières à l’entrée. Le fait de rentrer sur ce marché par le biais d’une coentreprise avec une compagnie locale bien connue des autorités leur a permis de faire preuve de notoriété dès leur arrivée. De plus, leur partenaire connaissant bien le milieu réglementaire leur a permis de braver avec succès une multitude de difficultés. La production et la mise en marché se font par l’intermédiaire de leur coentreprise tout en profitant du réseau de vente et de service déjà mis en place par l’entreprise partenaire. Le choix du partenaire local est donc un élément inhérent et capital à la réussite de la politique d’expansion. Le choix de la localisation s’est tourné vers Beijing, la capitale de la Chine, qui est une des villes où le transport en commun par autobus est le plus répandu, ce qui permet donc d’avoir une proximité avec le client en plus d’être le centre décisionnel le plus important.
4 CONCLUSION
En conclusion, lorsqu’une entreprise québécoise souhaite s’implanter dans le marché chinois, il lui est avant toute chose essentiel de s’informer et de saisir au préalable les services offerts par le gouvernement et les différentes institutions québécoises. Un panel considérable de ressources est mis à disposition telle que d’importantes bases de données, une aide aux études de marché, des missions commerciales, des congrès, les expositions. Somme toute, les entreprises peuvent avoir accès à des opportunités logistiques considérables ainsi qu’à une mise en visibilité non négligeable. Une fois l’étude de marché réalisée et une fois que les opportunités d’affaires commencent à se dessiner, il est nécessaire d’envisager une façon efficace d’accéder et de s’implanter sur le marché visé. Il s’avère alors opportun de penser à déléguer l’ensemble du processus de production, au travers de la mise en place de licences ou de franchises, à partir du moment où les compagnies ne sont pas encore en mesure d’explorer directement ce marché et que le potentiel du marché chinois semble être une opportunité de croissance.

Néanmoins, les entreprises possédant déjà une connaissance certaine du marché ainsi que les appuis nécessaires au bon développement de leur projet peuvent également utiliser une tout autre stratégie ne nécessitant pas une délégation, notamment lorsque celles-ci sont désireuses de garder un contrôle parfait de leurs procédés de production et leurs innovations. En dernière instance, une dernière possibilité s’offre aux gestionnaires qui portent un intérêt pour les marchés étrangers, à savoir, la mise en place d’une coentreprise. Cette stratégie reste à ce jour la plus répandue et avec raison, notamment grâce aux nombreux avantages logistiques et économiques qu’elle comporte. En effet, étant donnée la complexité du marché chinois et de son opacité, le « travailler ensemble », demeure la stratégie la plus adéquate. L’utilisation de licences est également très en vogue dans cette façon de pénétrer le marché chinois. En outre, une « joint-venture » avec une entreprise locale permet de profiter des réseaux déjà mis en place par le partenaire, tels que les réseaux de distribution ou encore d’user des liens privilégiés qui ont au préalable déjà été tissés avec les autorités gouvernementales, qui sont sans dire, des éléments sans lesquels une compagnie ne peut évoluer et croître dans un tel environnement. Notons ici que, nonobstant ces avantages considérables, la propriété intellectuelle est souvent une source de conflits non négligeable. C’est un risque à prendre afin de profiter de ce territoire. Il est donc nécessaire de mettre en place une stratégie pour la protéger tout en anticipant le comportement à avoir dans le cas où le produit ou le procédé est dérobé. Continuer à innover est un atout majeur pour l’entreprise qui souhaite poursuivre son évolution sur ce pays continent au demeurant ultra compétitif. Penser à l’intérêt de l’entreprise devient donc l’une des missions sine qua non des gestionnaires qui doivent malgré tout garder en tête l’importance des intérêts de la Chine. C’est dans une vision convergente qu’il sera alors possible d’évoluer dans le même sens que cette terre d’accueil entrepreneuriale et ainsi d’assurer la pérennité de la compagnie.
5 BIBLIOGRAPHIE
Articlesdejournaux
Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État « Les progrès dans la cause des droits de l'homme en Chine en 2013 »
Patrick Saint-Paul (2014). La Chine, eldorado de l’automobile. Journal Le Figaro Patrick Saint-Paul (2014). La marche forcée des Chinois vers les villes. Journal Le Figaro David Barboza (2010). China to invest billions in Electric and Hybrid Cars. The New York
Times Entretien avec A.Delbosc de la CDC Climat (2013). La Chine teste le marché carbone. Et alors?
Magazine Terraeco.net Chiraz Saidani, Zhan Su, Vers une extension du rôle des filiales de multinationales occidentales
implantées dans un PED, Centor, 2006 Le Service des délégués commerciaux du Canada, 10 choses que vous devez savoir pour faire
des affaires en Chine, Magazine commercial du forum Canada-Chine, 2011 automnes
Livres
Études économiques de l’OCDE : Chine 2010, Éditions OCDE, p. 27

ArticlesInternet
South China Morning Post, “1.1 trillion Yuan in Economic Losses in 2010, China Report says”, April 3, 2013, www.scmp.com
Ministry of Environmental Protection, « Annual report of environment of China in 2013 » www.zhb.gov.cn
Ministry of Environmental Protection, “Freshwater Environment”, June 6, 2012, www.mep.gov.cn
North China Plain Groundwater: > 70% Unfit for Human Touch, China Water Risk, February 26, 2013, www.chinawaterrisk.org
« Plan de développement de l'industrie automobile économique et d’énergies nouvelles (2011-2020) » http://auto.ifeng.com/news/special/xinnengyuanxize/20101129/476560.shtml
« Résultat de l’APEC : qu’est-ce que les Chinois peuvent profiter? » http://www.gov.cn/xinwen/2014-11/14/content_2778707.htm
KPMG CHINA, China’s 12th Five-year Plan: Energy, Avril 2011 Thomas BOUTONNET, « Traitement moral de la question sociale dans la société harmonieuse
de Hu Jintao », Transtext(e)s Transcultures 跨文本跨文化 [En ligne], 5 | 2009 The China GreenTech Report, 2013 Zhujun Jiang (2014) Distributional effects of a carbon tax on Chinese households: A case of
Shanghai [Electronic version] 10.1016/j.enpol.2014.06.005 Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China (2011), The 12th Five-
Year Plan for the environmental, Health work of National Environmenal Protection International Energy Agency, World Energy Outlook (2010) Lifeng Fang (2013) The Myth of China’s Endless Coal Demand: A Missing Market For US
Exports, Greenpeace Canada China Business Council report CleanTech sector Andrée-Lise Méthot, Denis Leclerc Consultation de la Commission sur les enjeux énergétiques
du Québec 2013-10-8 EcoTech Québec, Les technologies propres au Québec, 2012-03 EcoTech Québec, Matière grise pour une économie verte, www.ecotechquebec.com SWICTH, L’ÉCONOMIE QUE NOUS VOULONS, 2013-03 Claude Dumas,TM4 estime avoir fait une percée en Chine, 2014-09-18,
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201409/18/01-4801346-tm4-estime-avoir-fait-une-percee-en-chine.php
Affaires étrangères, commerce et développement Canada, Étude sur les complémentarités économiques du Canada et de la Chine, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/china-chine/study-comp-etude.aspx?lang=fr
Canada China Business Council, Secteur de l’énergie propre, http://www.ccbc.com/fr/rapports-et-recherche/recherche-sectorielle/secteur-de-energie-propre/
Taracido, PrimeEnergy Cleantech : Force et faiblesse du photovoltaïque, 2011-11-28, http://www.prime-energy-cleantech.ch/wordpress/2011/11/
Portail Québec, « Le Québec, un partenaire de choix » - Philippe Couillard, http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2210271468

CARACTÉRISTIQUES DES MARCHÉS DE TECHNOLOGIES VERTES EN AFRIQUE DANS LE CONTEXTE DE L’INDUSTRIALISATION
Maryse Ducharme, [email protected] Caroline Favier, [email protected]
Vanessa Gallant, [email protected] Valentin Goczol, [email protected]
Alexandre Raffin, [email protected]
Résumé
Sous les effets de la mondialisation, l’Afrique s’industrialise de plus en plus. Continent hautement dépendant financièrement de ses ressources naturelles, la fragilité de l’écosystème africain représente un défi de taille pour les prochaines années, amplifié par la pauvreté et la croissance démographique. En effet, l’Afrique doit réussir à pallier ses problèmes environnementaux tout en s’industrialisant davantage. Les pays africains sont alors devant une situation complexe où la solution proposée l’est tout autant. Quoi qu’il en soit, la clé du succès se trouve dans une collaboration régionale et nationale entre les différents acteurs du continent. Ce faisant, les États parviendront à une conscientisation globale à l’égard de l’environnement et pourront adopter des politiques similaires à cet effet. On remarque que déjà plusieurs initiatives ont été prises, ce qui démontre que les dirigeants sont conscients de l’importance d’intégrer les principes de développement durable dans leur croissance économique. Les entreprises québécoises et canadiennes ont ainsi des opportunités concrètes notamment dans les secteurs de l’éolien, de l’hydro-électricité et de l’énergie solaire. Les partenariats doivent être gagnants-gagnants afin de permettre aux pays africains non seulement un développement économique soutenu par l’utilisation de technologies vertes, mais également une meilleure efficience énergétique. Également, l’enjeu des déchets étant actuellement alarmant en Afrique, des opportunités s’offrent aussi dans ce domaine. Finalement, afin de faciliter le développement d’affaires en Afrique, il est nécessaire pour les entreprises canadiennes et québécoises d’être conscientes de la réalité de ce continent qui offre de nombreuses opportunités, mais également une multitude de défis.
L’histoire montre que les politiques industrielles, commerciales et technologiques des pays développés ont été́ les principaux instruments ayant rendu possibles leur transformation structurelle réussie (Lin & Monga, 2010) et leur croissance stable. D’autres éléments de preuve empiriques fournis par des pays développés, nouvellement industrialisés ou émergents ont montré que le développement durable ne peut être atteint sur la base d’une industrie faible (Lall, 1999). Cependant, on ne peut pas ignorer les conséquences environnementales, sociales et économiques néfastes d’une industrialisation trop intense.
Les technologies propres s’inscrivent dans la perspective du développement durable, car elles englobent de nouveaux produits, services, technologies et processus qui sont écologiquement efficaces - en réduisant l’impact négatif sur l’environnement -, économiquement avantageux - en offrant à son utilisateur des performances supérieures à moindre coût - et socialement responsables - en contribuant à une meilleure qualité de vie en optimisant l’utilisation des ressources (Ecotech Québec, 2014).
Le Canada et le Québec ont de nombreux atouts pour devenir leader dans ce domaine. En effet, ils possèdent un immense territoire riche en ressources naturelles, ils ont déjà eu un fort leadership dans la lutte des changements climatiques, une R&D dynamique et des choix énergétiques propres et verts (Ecotech Québec, 2014).

Dans quelle mesure les technologies propres des entreprises canadiennes et québécoises peuvent-elles valoriser la croissance industrielle en Afrique et quelles opportunités offre le défi environnemental africain pour celles-ci?
Nous dresserons un bref portrait des problèmes environnementaux en Afrique, des politiques mises en place pour lutter contre ceux-ci ainsi que de différents défis auxquels font face les États africains. Nous analyserons ensuite la présence des entreprises canadiennes et québécoises en Afrique. Enfin, nous aborderons les nombreuses opportunités qui s’offrent à ces entreprises dans le cadre du développement de l’Afrique.
1 LEDÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUEENAFRIQUE
L’Afrique n’est pas un continent uniforme : il couvre 30 millions de kilomètres carrés (10 fois l’Europe, 10 fois l’Inde, 4 fois les États-Unis, 3 fois la Chine) et est divisé en 53 États de taille variable, possédant chacun des ressources et des économies différentes (Lundsgaarde & Roch, 2011 : 36). À titre d’exemple, l’Afrique subsaharienne a un PIB moyen par habitant de 653 $ en 2010, l’Afrique du Nord de 2,313 $. Au sein même de ces zones, le PIB par habitant est très diversifié. Le PIB par habitant en Guinée équatoriale est de 8,537 $ en 2010 alors qu’il n’était que de 138 $ au Burundi. Cependant, certains pays affichent de belles performances en termes de croissance. Par exemple en Afrique de l'Est, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie devraient voir leur PIB progresser de 6,5 % à 7,5 % au cours des deux années à venir (IBRD & World Bank, 2013, p.8). Cependant, la croissance de chaque pays varie souvent en fonction des ressources naturelles que le territoire possède. Par exemple, l’économie ghanéenne a une croissance annuelle moyenne de près de 6.0 % sur les six dernières années grâce à son exploitation de pétrole et de gaz (PEA, 2014). Toutefois, l’Afrique a encore d’énormes défis à relever, notamment le sous-développement, l’accès limité à l’eau, à l’électricité et à l’éducation, la corruption, la difficulté d’accès aux financements pour les PME, la sécurité, la pauvreté, l’économie informelle, la fiscalité abusive, l’industrialisation de l’Afrique et la compétence des entrepreneurs (OCDE, 2012).
Le continent africain regorge de nombreuses ressources sur son territoire bien que de nombreux États aient du mal à les exploiter, et ce, encore plus de façon rentable. À titre d’exemple, l’Afrique possède 75 % des phosphates mondiaux, 85 % du platine, 80 % du chrome, 60 % du cobalt, 30 % du titane, 75 % du diamant et près de 40 % de l’or. Elle possède également 22 % des terres cultivables mondiales (Ministère des Affaires Étrangères Français, 2011, p.8). La croissance des exportations africaines repose principalement sur la demande de marchandises, mais surtout sur les ressources minières et les combustibles (70 % des exportations). En dépit de ressources naturelles abondantes et de la bonne croissance économique enregistrée cette dernière décennie (en moyenne plus de 5 % par an), l’Afrique peine toujours à exploiter de façon efficace et durable le potentiel économique dont elle dispose. Des ressources halieutiques aux ressources énergétiques non renouvelables, on assiste à une exploitation à la fois anarchique, non valorisante, et ce parfois à l’échelle artisanale. Avec un faible taux d’industrialisation, le continent reste aussi dépendant de l’extérieur surtout en ce qui concerne les produits alimentaires (ICTSD, 2012). Globalement, la croissance soutenue sur le continent n’a pas entraîné de relèvement significatif du niveau de vie des Africains. La Banque mondiale estime que 48,5 % de la population d’Afrique subsaharienne sont toujours condamnés à survivre avec moins de 1,25 dollar par jour.

La création d’emplois ne parvient pas à suivre le rythme de l’explosion démographique : le continent a dépassé le cap du 1 milliard d’habitants (soit 15 % de la population mondiale) et l’on prévoit 2 milliards d’Hommes d’ici 2050 dont 60 % de jeunes de moins de 30 ans (NU, 2014).
Depuis la dernière décennie, l’Afrique attire de plus en plus les investissements étrangers; en 2012, la part des investissements directs étrangers mondiaux accueillis par le continent africain est passée de 3,2 % en 2007 à 5,6 % (Jeune Afrique, 2013). Même si l’investissement des pays développés en Afrique a diminué (notamment de la France et des États-Unis), cette baisse est compensée par les investissements des marchés émergents (qui ont augmenté de 21 % depuis 2007). En effet, les pays en développement, en raison de leur propre situation, semblent mieux comprendre la réalité africaine et peuvent ainsi tenter de trouver ce dont les États émergents africains ont besoin : ceux-ci y voient une solution gagnante-gagnante. L’Afrique représente un réservoir stratégique pour la fourniture d'hydrocarbures et de matières premières et constitue également un débouché commercial pour les BRICS. Il ressort des statistiques du FMI que le total des échanges entre l'Afrique et les pays BRICS a été multiplié par plus de huit en valeur sur la période 2001-2010, passant de 22,9 milliards de dollars à 190,4 milliards. La part des exportations africaines vers les pays BRICS est passée de 8,5 % à 23,4 % sur la période 2001-2010. La proportion des exportations du continent destinée aux pays de l’Union européenne a été́ ramenée de 43,5 % à 29,7 % dans le même temps (Saliou Toré, 2013, p.60). Selon la Banque d’Affaires Rand de l’Afrique du Sud, les pays où il est intéressant d’investir sont l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigéria qui sont les trois géants du continent (étude réalisée en fonction de la taille du marché, du PIB, de la croissance du marché et de l’environnement d’exploitation). L’île Maurice, le Botswana, le Rwanda, la Namibie, la Tunisie et le Ghana présentent les meilleurs environnements d’exploitation (CNUCED, 2014).
2 LESENJEUXENVIRONNEMENTAUXDEL’AFRIQUE:DÉFISETPERSPECTIVES
La présente section détaillera les différents défis auxquels doit faire face l’Afrique puis abordera les différentes initiatives qui ont déjà été mises en place ainsi que les différentes pistes de solutions que devraient envisager les États africains afin de surmonter les obstacles posés par le paradigme de développement économique et de préservation de l’environnement.
2.1 Lesproblèmesenvironnementauxdel’Afrique
Pour identifier les besoins en technologie verte en Afrique, il convient tout d’abord de s’interroger sur la façon dont se posent les problèmes environnementaux sur le continent. En effet, l’Afrique étant extrêmement hétérogène, les besoins et défis ne sont pas les mêmes pour tous les États. Certes, un facteur commun est celui des ressources naturelles. Tel qu’il vient d’être démontré, les ressources naturelles sont le moteur économique commun et principal du continent. De ce fait, la préservation de l’environnement s’avère cruciale pour son avenir, raison pour laquelle une conscience environnementale s’éveille tranquillement. Bien que l’Afrique doive définitivement s’industrialiser davantage afin de réduire sa dépendance économique à l’égard de celles-ci, les ressources naturelles demeurent essentielles à la survie économique des pays africains.

D’un point de vue politique, le défi consiste à associer la croissance à l’environnement (PNUE, 2006, p.9). Dans un de ses rapports, la Banque africaine de développement identifie plusieurs problèmes environnementaux comme :
la destruction des ressources et des écosystèmes naturels (ressources forestières, en eau, marines et côtières), l’érosion des sols et la pollution atmosphérique. [De plus,] l’Afrique perd environ 1,3 million d’hectares de forêts chaque année. Quelque 500 millions d’hectares ont été affectés par la dégradation des sols depuis 1950, y compris 65 % des terres agricoles du continent (Banque africaine de développement, 2014, p.13).
Les défis environnementaux en Afrique sont d’ailleurs amplifiés par la croissance démographique fulgurante du continent. Cette population croissante accentue ainsi les problèmes environnementaux et donc la nécessité à agir par le biais de politiques de développement durable (PNUE, 2006, p.11). Par exemple, « ce facteur a causé une plus grande demande de terres pour l’agriculture, ce qui contribue à la déforestation et à la disparition des habitats. Cette dernière, fruit de la destruction, de la conversion et de la fragmentation est la principale cause de la perte de la biodiversité » (PNUE, 2006, p.110). L’agriculture accuse aussi une baisse en termes de productivité et d’efficacité (Banque africaine de développement, 2014, p.13). Également, la défaillance au niveau des infrastructures et la pauvreté généralisée contribuent à augmenter les problèmes environnementaux, comme la pollution.
Comme il a été mentionné, l’Afrique est un continent très hétérogène. Ainsi, pour illustrer les problèmes environnementaux il convient de dresser un portrait d’une région spécifique, soit de l’Afrique centrale. Dans cette région, l’agriculture occupe une place importante d’un point de vue économique. Cependant, elle est caractérisée par des pratiques jugées inefficaces et « non durables », ce qui contribue à augmenter le niveau de pollution dans la région et les émissions de gaz à effet de serre (UNECA, 2013, p.23). Par exemple, « […] partout la forêt recule sous les coups de l’agriculture itinérante et d’une urbanisation anarchique à l’origine entre autres d’une forte production de déchets mal gérés pour lesquels la population n’a pas souvent d’autre choix que l’incinération, ce qui accentue la pollution » (UNECA, 2013, p.23). Également, plusieurs compagnies opérant en Afrique adoptent des pratiques insouciantes et dévastatrices à l’égard de l’environnement. Les États auraient ainsi intérêt à promouvoir et adopter des pratiques vertes. « De par sa situation géographique, l’Afrique Centrale présente une diversité d’écosystèmes qui sont des atouts indéniables pour son développement (climat, sols, végétation, régimes hydrologiques, etc.) » (UNECA, 2013, p.23). Effectivement, « la sous-région offre un potentiel important pour le développement des énergies renouvelables tous secteurs confondus » (UNECA, 2013, p.24). Par exemple, au niveau de l’hydro-électricité, la région présente « 60 % du potentiel du continent » (UNECA, 2013, p.24). Il s’avère donc primordial pour cette région de mettre à profit cet avantage et de joindre l’utilisation de technologies vertes à son développement économique qui se doit d’être plus diversifié.
Dans l’ensemble,
en Afrique, la protection de l’environnement n’est pas un luxe. Elle est au contraire une nécessité vitale. L’avancée du désert, la déforestation, la rareté des pluies, les inondations, l’élévation du niveau des océans, les perturbations cycloniques […] sont autant de facteurs qui interpellent une prise de conscience et l’importance de la protection de l’environnement en Afrique […]. L’environnement en Afrique est le seul rempart pour la survie et les populations en sont conscientes (Chouaïbou Mfenjou, 2002, p.22).

La fragilité de l’environnement représente ainsi un défi supplémentaire qui explique pourquoi le problème de l’environnement est d’autant plus préoccupant en Afrique. Il a en effet d’énormes implications qui ne sont pas seulement environnementales, mais également économiques, politiques et sociales. Le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) identifie alors certains enjeux environnementaux que les États doivent prioriser :
Lutter contre la dégradation des terres, la sécheresse et la désertification; préserver les zones humides d’Afrique; prévenir, contrôler et gérer les espèces exotiques envahissantes; conserver et veiller à l’utilisation durable des ressources marines, côtières et en eau douce; lutter contre les changements climatiques; [et finalement,] conserver ou gérer les ressources naturelles transfrontalières (PNUE, 2006, p.9).
Ainsi, de par l’inefficacité actuelle des activités économiques et des lacunes au niveau des infrastructures, l’éveil écologique de l’Afrique, qui a débuté depuis déjà plusieurs années, représente des opportunités pour lesquelles les entreprises québécoises et canadiennes ayant une valeur ajoutée à proposer pourront bénéficier.
2.2 Laconciliationdudéveloppementéconomiqueetdel’environnementenAfrique
Comme nous l’avons vu, les ressources naturelles en Afrique représentent un potentiel économique énorme (UNECA, 2013, p.21). « L’Afrique demeure et se figure parmi les continents qui détiennent la majeure partie des réserves de matières premières » (Abodohoui et al., 2013, p.9). Paradoxalement, l’Afrique se trouve aussi à être le continent le plus pauvre (Banque africaine de développement, 2004, p.13). De par cette richesse, l’Afrique tente de suivre le rythme effréné des pays du BRIC, notamment, qui exploitent ses ressources (Abodohoui et al., 2013, p.11). Alors que l’Afrique voit cela d’un bon œil du fait qu’elle y anticipe un accroissement potentiel de son bien-être, une utilisation optimale de ces dernières est requise afin d’en éviter leurs épuisements et de maximiser les revenus qui en découlent (Abodohoui et al., 2013, p.11). Depuis les dernières années, de nombreux pays africains ont compris qu’afin de s’assurer d’une autosuffisance, d’une croissance durable et d’une réduction de la dépendance des pays avancés, il est nécessaire de développer l’économie industrielle. Celle-ci apporte effectivement une valeur ajoutée supérieure en plus de créer de l’emploi, d’améliorer les revenus, les niveaux de vie et de réduire la vulnérabilité d’une trop forte dépendance à l’exportation de produits primaires. Ainsi, en 2001, les dirigeants africains ont adopté un Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) qui affirme que l’industrialisation est une stratégie essentielle pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans la région (ONUDI, 2011). Cette croissance industrielle semble toutefois antagoniste à l’objectif de préservation de l’environnement. Dans l’ensemble, les États africains se retrouvent alors confrontés au défi où la génération des revenus doit s’accompagner d’un processus durable respectant l’environnement pour assurer sur le long terme le maintien des revenus et de l’exploitation des ressources naturelles (ICTSD, 2012).

Pour ce faire, l’Afrique a besoin d’une coordination entre les acteurs qui perçoivent la nécessité d’aller vers cette voie pour optimiser l’exploitation des ressources naturelles en Afrique (AFDB, 2012). « Il est nécessaire de renforcer les structures et les cadres institutionnels de gestion du développement durable, de mettre en place un leadership politique particulièrement solide et engagé, ainsi que les capacités techniques et managériales de coordination et d'élaboration de stratégies basées sur une vision pragmatique partagée sur le long terme » (AFDB, 2012). Certaines initiatives ont déjà été mises en place. Par exemple, en Afrique de l’Ouest, un projet a été mis sur pied afin d’accroître une utilisation optimale et verte du secteur énergétique appelé ECOWREX (CEREEC, 2013, p.3). L’objectif de ce projet est de faciliter l’élaboration de politiques régionales. Les États africains de l’Afrique de l’Ouest conscientisés aux vertus qu’amène le développement durable se réunissent régulièrement pour participer à la création de différents projets, au développement de partenariats et à l’avancement de la R&D (CEREEC, 2013, p.14). Des ateliers de formation sont également donnés aux employés gouvernementaux et au personnel de compagnies énergétiques afin de les instruire aux bienfaits des technologies vertes (CEREEC, 2013, p.14). Dans l’ensemble, en plus de la formulation de politiques, il est nécessaire pour l’Afrique de continuer à développer des efforts concertés et de continuer à sensibiliser le public de l’importance du développement durable, et ce, dans le but de s’assurer de l’implantation effective des politiques : ce qui constitue toujours un défi important (Lundsgaarde, 2011). Or, dans l’ensemble, on remarque un éveil et un intérêt des dirigeants africains face à la nécessité de s’assurer d’un développement durable.
L’objectif global recherché est d’ainsi susciter une conscientisation à la fois régionale et nationale en Afrique, puis d’élaborer des mécanismes communs qui convergent dans ce sens. À cet effet, la tenue d’un forum au Sénégal organisée en 2012 en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD) et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour « la promotion de l’investissement et des affaires dans les énergies renouvelables » témoignent de la volonté d’acteurs régionaux d’adopter de telles pratiques en Afrique (CEREEC, 2013, p.9). De la même façon, en 2014, le Forum sur le financement des énergies propres en Afrique de l’Ouest (WAFCEF) a lancé un concours à l’intention des entrepreneurs afin que ceux-ci soumettent des business plans concernant des projets prometteurs dans les énergies propres. À l’issue de ce concours, un financement et un encadrement seront disponibles pour les dix entrepreneurs sélectionnés. Cet exemple illustre qu’il y a un intérêt des décideurs africains pour offrir des opportunités de développement des entreprises œuvrant dans les énergies vertes. Dans l’ensemble, plusieurs partenariats africains visent l’adoption de technologies vertes (ICTSD, 2011). En somme, la clé du succès du développement durable en Afrique se trouve réellement dans la coordination entre les gouvernements africains au sein d’un cadre global afin de développer des politiques cohérentes et structurées faisant la promotion du développent durable (ICTSD, 2011). L’accent doit notamment être mis sur les mécanismes de financement afin d’atteindre l’objectif désiré et diminuer les impacts découlant des changements climatiques qui pourraient avoir des conséquences énormes sur l’avenir économique du continent si aucune mesure n’est prise en ce sens (AFDB, 2012). Les programmes de financement et les politiques incitant l’adoption de comportements verts offrent des opportunités intéressantes pour les entreprises œuvrant dans les énergies vertes.
Toutefois, malgré les intentions louables de protection de l’environnement par les États africains, certains obstacles viennent limiter leurs possibilités de se développer durablement. En effet, des estimations ont indiqué qu’entre 9 et 12 milliards de dollars US par an seraient nécessaires afin d’effectuer un virage de l’Afrique vers une économie verte.

La mobilisation d’un tel financement représente un obstacle important pour les économies africaines : il semble donc que la participation des pays développés est une composante essentielle d’un développement africain durable (ICTSD, 2012). Comme un nombre important de pays émergents, les États africains considèrent que le respect de normes environnementales menace leur développement économique et qu’ils n’ont pas à vivre un « sous-développement durable » alors que les pays développés se sont industrialisés rapidement et sans tenir compte de l’impact sur l’environnement. À ce titre, des mesures ont déjà été prises par la communauté internationale pour permettre de financer, en partie, les initiatives des pays en voie de développement. On peut penser ici au Fonds vert pour le climat mis en place lors de la conférence de Cancún sur le climat en 2010. C’est une première étape dans la mise en place d’un mécanisme de financement international. Ainsi, bien que la situation budgétaire nationale des pays d’Afrique soit limitée, les mécanismes internationaux et les banques multilatérales de développement offrent un espoir important d’atteindre le financement nécessaire à une mutation vers une économie verte en Afrique. Bien entendu, il est cependant nécessaire que les États développés fassent les efforts nécessaires afin de respecter leurs engagements : ce qui constitue une limite importante du financement international en Afrique (PNUE, 2011). Ainsi, « l’Afrique adhère au développement durable sans en avoir les moyens, en espérant que la Communauté internationale se chargera de la péréquation des richesses » (Chouaïbou Mfenjou, 2002, p.16).
Également, la présence de pays développés dans les discussions des différents forums économiques faisant la promotion du développement durable démontre que les États africains sont réceptifs aux investissements d’États étrangers dans les énergies vertes. De plus, comme l’Afrique bénéficie déjà d’un taux d’investissement étranger important, elle a intérêt à profiter de cet engouement pour diriger une partie de ces investissements dans les secteurs qui lui assurent un développement qui soit durable :
La présence sur le continent africain des grandes entreprises chinoises (China business Network, le Herald Tribune, Huawei), indiennes (Bharti Airtel) françaises (Bolloré Africa Logistics) et américaines constitue autant d’enjeux dont l’Afrique doit se servir comme facteur de croissance et d’élévation de son bien-être. Les données économiques présument que dans les années 2030, l’Afrique est potentiellement le continent le plus prometteur. Pendant les cinq dernières années passées, les investissements directs étrangers en direction du continent ont presque doublé (Abodohoui et al., 2013, p.9).
Les investissements doivent ainsi viser « […] les domaines de l’agriculture durable, la pêche et la gestion de la biodiversité, […] la technologie, l’éducation et les infrastructures » (ICTSD, 2011). De plus, le secteur énergétique représente lui aussi un domaine prometteur et essentiel pour l’amélioration des conditions de vie du continent africain. En effet, « l’exploitation du potentiel énergique renouvelable (solaire, de la biomasse et des ressources éoliennes) dont dispose l’Afrique pourrait aussi contribuer à l’efficacité énergique et garantir ainsi l’électricité en milieu rural » (ICTSD, 2011). Ainsi, bien que la majorité des IDE actuelles soient orientées vers l’exploitation de matières premières, l’Afrique semble être de plus en plus consciente de son intérêt à réorienter ces investissements vers des secteurs ayant une plus grande valeur ajoutée pour sa croissance économique, mais surtout pour s’assurer que celle-ci soit durable.
Également, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent pour le continent africain une place stratégique très importante dans le processus de développement économique.

Grâce à leur flexibilité et à leurs capacités d’innovation, elles contribuent à la création de nouvelles richesses et à la compétitivité de leurs pays. Grâce, enfin, à leurs capacités d’adaptation aux changements climatiques et aux défis environnementaux, elles peuvent contribuer utilement à faire de l’environnement non pas une simple contrainte, mais aussi un atout et un vecteur de croissance (UNCEA, 2012).
Comme le démontre un récent rapport du Bureau pour l’Afrique du Nord de la CE, le défi écologique procure des niches de croissance économique non négligeable prometteuses pour les PME. Ainsi, conscients du fait que celles-ci encouragent la croissance économique et que leurs particularités leur permettent de s’adapter aux défis environnementaux, mais aussi de la fragilité des PME devant les chocs économiques importants, les pouvoirs publics africains ont créé des structures et des politiques dédiées au soutien des PME (UNCEA, 2012). La BAD a également collaboré avec les différents États africains en mettant en place de nombreux fonds visant à financer les initiatives privées en matière de développement durable. La possibilité pour les PME œuvrant dans des secteurs environnementaux d’obtenir du financement constitue un incitatif intéressant de s’intéresser aux États africains.
De plus, il est possible de croire que l’Afrique ne devrait pas envisager les principes de développement économique et d’économie verte comme étant opposés, mais plutôt y voir un potentiel de croissance durable. En effet, des modèles macroéconomiques ont permis de voir que « le verdissement non seulement entraîne une augmentation de la richesse, en particulier un gain de biens environnementaux communs ou de capital naturel, mais génère aussi (sur une période de six ans) un taux plus élevé de croissance du PIB » (PNUE, 2011, p.5). La promotion des énergies renouvelables illustre cette idée. Le système énergique actuel basé sur les combustibles fossiles a un impact majeur sur les changements climatiques, et les coûts des impacts sont évalués de 50 à 170 milliards de dollars d’ici 2030. La moitié de ceux-ci pourraient devoir être absorbés par les pays en développement (PNUE, 2011, p.14). Également, un grand nombre d’entre eux sont des importateurs nets de pétrole et sont donc grandement touchés par la hausse et l’instabilité des prix. Également, « de nombreuses opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique s’autofinancent, tandis que les investissements dans les technologies basées sur les énergies renouvelables augmentent déjà aujourd’hui, à mesure qu’elles gagnent en compétitivité (33 % taux de croissance annuel composé entre 2002 et 2009) » (PNUE, 2011, p.14).
De la même façon, une utilisation plus rationnelle des ressources, principe encouragé par le principe de l’économie circulaire, permet également de retirer de nombreux bénéfices économiques. En ce sens, on peut ici penser à l’efficacité du recyclage qui permet d’utiliser les produits dérivés des procédés de production. Par exemple, le recyclage de matériaux tels que l’aluminium ne demande que 5 % de l’énergie nécessaire à sa production initiale (PNUE, 2011, p.16). L’économie africaine aurait tout avantage à exploiter les occasions de produire de la richesse avec le moins de matières premières possible en augmentant son efficience à ce niveau. Il serait également avantageux pour l’Afrique de rendre possible une augmentation de la récupération des déchets par la formulation de politiques publiques en ce sens. Dans l’ensemble, on observe que le recyclage et la valorisation énergétique des déchets se rentabilisent et que cette tendance tend à se confirmer. En effet, « il est possible de transformer les déchets en produits commercialisables, comme le montre le marché de leur valorisation énergétique, estimé à 20 milliards de dollars en 2008 et auquel on prédit une croissance de 30 % dès 2014 ». Par exemple, les 140 milliards de tonnes de résidus agricoles dans les régions rurales du monde représentent un potentiel énergétique équivalent à 50 milliards de tonnes de pétrole (PNUE, 2011, p.18).

De la même façon, certaines estimations prévoient qu’« un investissement global de 90 milliards de dollars dans l’efficacité énergétique des pays en développement pourrait permettre de faire des économies nettes de 600 milliards de dollars » (Sperling, Grano et Vyas, 2012, p.8). Ainsi, malgré ses difficultés économiques, les dirigeants africains ouvrent de plus en plus la porte aux principes du développement économique environnemental. Les entrepreneurs étrangers œuvrant dans des secteurs verts qui souhaitent profiter des opportunités économiques de l’Afrique ont toutefois besoin de démontrer que leurs actions seront profitables économiquement pour les deux partis, mais qu’ils assureront en plus un développement qui sera durable.
Dans le même ordre d’idée, il est important de considérer la place de l’éducation dans le projet du développement durable en Afrique. En effet, sans une amélioration du système éducatif, la mise en place des politiques publiques est grandement freinée. Ainsi, s’il ne manque pas de ressources humaines pour participer au développement de l’Afrique, celle-ci se doit d’obtenir les connaissances et les compétences qui lui permettront de participer au développement économique durable du continent. « Les opérateurs du développement ont compris qu’il ne suffit plus de mobiliser les ressources financières pour garantir la pérennité du projet » (Chouaïbou Mfenjou, 2002, p.252). Ainsi, dans l’ensemble, il est primordial que les efforts des politiques publiques africaines en matière de développement économique et de conservation de l’environnement ne soient pas annulés par un manque d’investissement dans le capital humain africain. En ce sens, les entreprises des pays développés offrent une source importante de transfert de connaissances potentielles.
En somme, outre une mobilisation financière nécessaire, les gouvernements africains se doivent de mettre en place des politiques publiques concertées qui encouragent le développement selon des pratiques écoresponsables. Il semble toutefois évident qu’une collaboration extérieure soit nécessaire afin de financer ces initiatives, mais également un transfert de connaissances provenant des pays développés. Il est primordial que cette collaboration s’effectue dans une logique de gagnant-gagnant pour éviter à l’Afrique de supporter à elle seule les coûts de la protection de l’environnement et de la plonger dans un sous-développement durable. De plus, les investissements en ce sens doivent impérativement s’accompagner d’une mobilisation de la population africaine qui leur permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires. Leur participation étant fondamentale, les dirigeants africains doivent s’assurer de la compréhension des enjeux par la population. Or, pour ce faire, il faut d’autant plus que les dirigeants africains ne perçoivent pas les concepts d’économie verte et de développement économique comme étant fondamentalement opposés. « En définitive, le développement durable en Afrique ouvre la voie à une réconciliation des sphères environnementales et économiques pour une meilleure harmonisation des processus de préservation de l’évolution naturelle et du progrès économique, et ce de façon intemporelle » (Chouaïbadou Mfenjou, 2002, p.15). Or, comme nous le verrons dans la suite de ce rapport, le défi environnemental ouvre la porte à de nombreuses opportunités de développement pour les entreprises extérieures.

3 LESDÉFISENVIRONNEMENTAUXAFRICAINS:QUELLEPLACEPOURLESENTREPRISESQUÉBÉCOISES
L’ensemble des technologies propres québécoises peut être représenté en distinguant 8 segments spécifiques (Ecotech Québec, 2012) : la chimie verte, les transports, l’eau, l’air, les sols, les matières résiduelles, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
L’Europe impose une réglementation beaucoup plus stricte que le Canada et le Québec en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l’air. Par conséquent, les entreprises canadiennes et québécoises accusent un certain retard dans ce domaine si on les compare aux firmes européennes. On note cependant que pour l’éolien, plusieurs entreprises québécoises sont en train de développer des parties spécifiques du système de turbine et de l’interface de contrôle électronique, et la propriété industrielle liée à ces développements est de plus en plus reconnue et vendue à l’international. Il est important de souligner que le Québec possède le meilleur potentiel éolien de toute l’Amérique du Nord (Ecotech Québec, 2012).
Dans la gestion de l’eau, les entreprises québécoises assurent essentiellement des services locaux bien qu’il existe tout de même quelques PME et grandes entreprises qui sont présentes à l’échelle internationale. C’est plutôt dans le domaine de l’hydroélectricité, en utilisant la force motrice de l’eau pour produire l’électricité, que le Québec dispose d’un avantage compétitif très important à l’échelle mondiale. Hydro-Québec et son institut de recherche sont des valeurs sûres pour le Québec et permettent au secteur manufacturier d’optimiser en partie ses coûts d’énergie (Ecotech Québec, 2012).
Dans le domaine des transports intelligents, de petits projets de smart grids, représentant un réseau intelligent de distribution d’électricité utilisant les technologies informatiques afin d’optimiser la gestion du réseau d’électricité qui va de tous les producteurs à tous les consommateurs et donc d’améliorer l’efficacité énergétique dans son ensemble sont en développement dans quelques villes québécoises, mais il n’existe à l’heure actuelle aucun projet à l’échelle d’une métropole dans cette région du Canada. En ce qui concerne les véhicules électriques, on note tout de même un projet d’autobus électriques (avec un investissement de 60 millions d’euros sur une période de 3 ans).
Le secteur de la chimie verte n’est pas encore très développé au Québec, mais on peut tout de même parler ici d’un domaine émergent. Il existe désormais quelques entreprises présentes à l’international dans le secteur des nanotechnologies. Le secteur de l’hydrogène est lui aussi en pleine expansion (Ecotech Québec, 2012).
3.1 L’éolien
Le marché mondial de l’éolien est en pleine croissance. Celui-ci représentait une valeur de 96 milliards de dollars US en 2010 (Ecotech Québec, 2012). De plus, entre 2005 et 2013, le nombre d’emplois en lien direct avec ce secteur a triplé, passant de 20 000 à 60 000 emplois. Tous les états sont désormais engagés dans des démarches de développement durable puisqu’il s’agit d’une nécessité pour assurer l’avenir de notre planète et des générations futures. L’éolien fait partie de ces énergies renouvelables qui favorisent la mise en place d’un vrai développement durable. D’ici 2020, on estime que « plus de 40 % de la capacité mondiale d’éolien devrait provenir de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen-Orient » (Ecotech Québec, 2012).

Le potentiel de croissance de l’éolien en Afrique est donc gigantesque. Prenons l’exemple du projet d’énergie éolienne du lac Turkana (Kenya) démarré en juin 2014 et qui aura une puissance totale de 300 mégawatts. Il s’agira là du « plus important parc éolien en Afrique » (Jeune Afrique, 2014). L’objectif de ce projet est de « réduire la dépendance du pays à la production d’électricité issue des générateurs alimentés au pétrole et au diesel ». Le gouvernement kenyan pourrait ainsi économiser « jusqu’à 150 millions de dollars sur sa facture d’importation de carburant ». Notons qu’actuellement le Kenya produit principalement son électricité à partir de sources hydroélectriques (52 %), thermiques et géothermiques et que l’éolien « représente pour l’instant moins de 6 mégawatts ».
Ce projet kenyan est rejoint par celui lancé en 2014 à Tarfaya au sud-ouest du Maroc. Ce parc aura également à terme une puissance de 300 mégawatts. Le parc « comprend 131 éoliennes de 81 mètres de haut ». L’objectif du projet marocain est de « couvrir, d’ici à 2020, 42 % des besoins du Maroc à l’aide des énergies renouvelables ». Le coût total des installations est de « 500 millions de dollars ».
Possédant le meilleur potentiel éolien de toute l’Amérique du Nord, le Québec aurait tout intérêt à tenir compte de ce type de projets de grande envergure qui se multiplient sur le continent africain. L’objectif du Québec est d’avoir « 4000 mégawatts d’énergie éolienne en 2015 » afin de « combler plus de 10 % de sa demande grâce à l’énergie éolienne » (AQPER, 2014). L’éolien est complémentaire à l’hydroélectrique. C’est Hydro-Québec qui « déterminera le pourcentage du potentiel éolien qui pourra être exploité » en vue d’atteindre l’objectif énoncé ci-dessus. Plusieurs centres experts dans le domaine éolien sont très actifs au Québec. On peut notamment mettre en avant le TechnoCentre éolien ainsi que la Chaire de recherche en aérodynamisme en milieu nordique, ou encore le laboratoire de recherche en énergie éolienne de l’UQAR (Université du Québec à Rimouski). Notons que l’industrie éolienne au Québec représente « plus de 150 entreprises qui emploient près de 5 000 personnes » (Secord KPMG, 2013). Cette filière comprend des « équipementiers et entreprises de service de classe mondiales tels que : Enercon, Repower, Marmen, Gurit… ». Le savoir-faire québécois dans ce domaine est très reconnu et fortement recherché à l’échelle internationale. Par exemple, « le Groupe Collegia offre depuis 2004 une formation en maintenance d’éoliennes ». Son centre de formation à Gaspé dispose d’équipements de pointe avec, notamment, trois éoliennes de 750 kW et une tour d’entraînement de 32 mètres de hauteur.
Cependant, si elles veulent profiter d’opportunités de développement en Afrique, les entreprises québécoises de l’éolien ne doivent plus attendre pour se développer sur ce continent. La concurrence internationale est très forte et la Chine est très compétente dans l’éolien. En effet, « la Chine est devenue, en 2010, le marché le plus important, alors que cette place est détenue traditionnellement par l’Europe » (Ecotech Québec, 2012). À l’inverse du Canada et du Québec, la Chine investit déjà énormément en Afrique. « Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique a ainsi été multiplié par vingt depuis 2000, atteignant près de 200 milliards de dollars en 2013, soit près du double de ceux avec les États-Unis (110 milliards) » (Hontang, 2014). Il est donc nécessaire que le Québec se tourne dès maintenant vers l’Afrique, et ne pas attendre plus longtemps sous peine de se voir privé de marchés très lucratifs par des pays qui auront été plus en avance dans leurs investissements. Il est évident que de nombreux projets éoliens, à l’image de ceux de Turkana et Tarfaya, vont voir le jour en Afrique dans les prochaines années et décennies puisque le besoin en électricité est énorme.

La région de l’Afrique subsaharienne, comprenant 47 pays, a un taux d’accès à l’électricité de seulement 31 % (La Banque Mondiale, 2014). Il s’agit du « plus faible taux d’accès à l’électricité de la planète » (Saucier, 2013). Ces 47 pays produisent au total environ 30 gigawatts actuellement. À titre de comparaison, ceci équivaut à la production de l’Argentine à elle seule. Si l’on se concentre uniquement sur les zones rurales de cette région du monde, le taux d’accès à l’électricité « chute à 8 % ». « Plus globalement, le continent africain qui abrite 15 % de la population mondiale ne consomme que 3 % de l’énergie mondiale ». Les entreprises québécoises doivent être attentives et réactives à la vue de ses données, notamment parce qu’on estime que « pour soutenir la demande, le développement et la croissance économique, l’Afrique a besoin de générer 7 gigawatts (7000 MW) supplémentaires chaque année ».
Notons que « les meilleurs vents se trouvent dans les régions côtières ». Ainsi, des pays tels que le Cap-Vert, le Kenya, Madagascar, la Mauritanie et le Tchad représentent un potentiel très intéressant pour les entreprises québécoises. Surtout si l’on met en avant le fait que « 97 % des infrastructures se trouvent en Afrique du Nord » (Saucier, 2013).
3.2 Hydroélectricité
Comme l’affirme la banque mondiale, « l’Afrique subsaharienne souffre d’un déficit durable et chronique d’énergie électrique. Seulement 31 % de la population ont accès à l’électricité, ce qui laisse près de 600 millions de personnes sans accès à l’électricité » (La Banque Mondiale, 2014). Actuellement, le coût de l’électricité est très élevé en Afrique subsaharienne (« 0,12 dollar/kWh », ce qui est « deux fois plus élevé que dans les autres pays en développement »). Or, le coût de production de l’hydroélectricité est très faible (« environ 0,05-0,07 dollar/kWh […] permet de concurrencer d’autres technologies, notamment l’énergie thermique, éolienne et solaire »).
Si l’on prend l’exemple du Congo, on observe que dans ce secteur-là aussi les opportunités sont gigantesques. Le potentiel hydroélectrique de ce pays est « estimé à 100 gigawatts, le troisième plus grand au monde derrière la Chine et la Russie ». C’est pour cette raison que vient d’être mis en place un projet hydroélectrique au Congo, nommé Inga III (Inga I et II ont été mis en place précédemment). « Avec une capacité de 40 gigawatts, Inga est le plus grand site hydroélectrique du monde et potentiellement la source d’énergie la moins chère du continent africain (son coût de production est estimé à 0,03 dollar/kWh) ». Cette centrale Inga III permettra de fournir l’accès à l’électricité à « sept millions d’habitants de la région métropolitaine de Kinshasa ». Alors que Inga I « a été mis en service en 1973 et Inga II en 1981 » (Coquet, 2013), « la première pierre d’Inga III est désormais prévue pour octobre 2015 ». Ces trois premières étapes font partie du projet Grand Inga. Pour mener ce projet à bout, il faudra encore construire cinq barrages. L’objectif annoncé est donc que le Congo devienne « la centrale électrique de tout le continent ». Ces cinq derniers barrages n’en sont qu’à l’état de projet et l’opportunité pour les entreprises québécoises peut être immense.

Avec ses 500 000 lacs et 4 500 rivières qui recouvrent 12 % de son territoire, le Québec possède d’importantes ressources hydrauliques (Hydro-Québec, 2014). Hydro-Québec, la société d’État qui produit et distribue l’électricité de la région, dispose d’un savoir-faire d’un demi-siècle unique au monde dans son domaine. « À la fin 2013, l’entreprise gérait un parc de 36 068 mégawatts, et plus de 99 % de sa production était d’origine hydraulique. Hydro-Québec est non seulement l’un des plus grands producteurs d’électricité d’Amérique du Nord, mais compte également parmi les premiers producteurs d’hydroélectricité du monde ». Comme l’a annoncé Jean-François Lisée (ministre des Relations Internationales, de la Francophonie et du Commerce Extérieur) en juin 2013, le Québec va ouvrir « un ou deux » nouveaux bureaux en Afrique dans le cadre du programme « Expansion Québec » (Bergeron, 2013) qui « offre un soutien logistique aux PME québécoises qui souhaitent tenter leur chance à l’étranger ». Lors de cette annonce, le ministre a également affirmé avoir demandé « au nouveau président du conseil d’Hydro-Québec de revoir la présence internationale d’Hydro, qui avait été abandonnée il y a quelques années ». Effectivement, le savoir-faire reconnu de cette société d’État québécoise pourrait être très prisé par divers pays africains.
L’Afrique de l’Ouest regroupe un quart des cours d’eau du continent (Madou, s.d.) et « dispose d’un potentiel de 25 000 mégawatts dont environ un quart se trouve en Guinée ». Le potentiel hydroélectrique encore inexploité est immense. Prenons l’exemple du Cameroun, où le potentiel hydroélectrique est gigantesque soit de 12 000 mégawatts (La Banque Mondiale, 2014), mais où « les coupures d’électricité et le coût élevé de l’énergie électrique entraînent un retard de croissance de 1 à 2 % par an » selon les estimations de la Banque mondiale. C’est pour cette raison que le projet de construction du barrage hydraulique de Lom Pangar a été mis sur pied en 2014. Ceci « augmentera la capacité hydroélectrique du fleuve Sanaga d’environ 40 % par an ». Ce projet camerounais illustre bien le fait qu’il existe des opportunités de croissance incroyable dans cette région de l’Afrique et le Québec devrait en tenir compte. Surtout que si l’on prend le cas précis du Cameroun, ce pays est très intéressé par le savoir-faire québécois dans divers domaines. Comme l’a affirmé la PDG d’Afrique Expansion, Amina Gerba, lors des journées économiques du 19 septembre 2014 à Montréal (sous le thème faire des affaires au Cameroun, le temps d’investir), « Dans l'optique de son émergence en 2035, le Cameroun est particulièrement intéressé par le savoir-faire du Canada et du Québec dans les filières prioritaires, et c’est pour cette raison que les autorités de Yaoundé ont envoyé la plus importante délégation multisectorielle de leur histoire au Canada, pour prendre part à ces Journées économiques » (BRM, 2014). Le savoir-faire canadien et québécois qui intéresse particulièrement le Cameroun concerne « les secteurs clés que le pays entend développer au cours des prochaines années, notamment les infrastructures ferroviaires et routières, les énergies renouvelables, les industries agroalimentaires et de la transformation du bois, de même que l’aménagement urbain et la construction de centres commerciaux ». À l’heure actuelle, le Canada n’est pas un des grands partenaires commerciaux du Cameroun, cependant « les échanges commerciaux entre les deux pays sont passés de 18 à 25,5 milliards de francs CFA entre 2010 et 2012, soit une hausse de 41,6 % ». On note d’ailleurs que le 3 mars 2014, le ministre camerounais de l’Économie et le ministre canadien du Commerce International ont signé un accord « de promotion et de protection réciproque des investisseurs camerounais et canadiens » (Investir au Cameroun, 2014). Il existe donc des possibilités d’investissement très intéressantes dans ce pays pour les entreprises canadiennes et québécoises.

L’hydroélectricité et l’éolien représentent donc deux secteurs à fort potentiel pour les entreprises québécoises qui désireraient investir en Afrique. Bien qu’un rapport récent de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec affirme que « le Québec devrait réduire le développement de l’hydroélectricité et de l’éolien, car […] les surplus en électricité d’Hydro-Québec ne justifient pas la poursuite des investissements dans ces deux secteurs » (Bertrand, 2014), il est essentiel que le Québec reste un acteur mondial reconnu dans ces activités, et qu’il puisse faire valoir son savoir-faire en Afrique pour d’une part générer des sources de profits importants, et d’autre part permettre au continent africain de poursuivre son développement et sa modernisation de manière durable.
3.3 LesinvestissementscanadiensenAfrique
Si l’on observe les investissements directs à l’étranger (IDE) canadiens par régions, on constate très vite que les relations avec l’Afrique, principalement subsaharienne, ne sont pas très développées. En effet, en 2012, seulement 0,54 % des IDE canadiens étaient dirigés vers l’Afrique subsaharienne (Canadian International Development Platform, 2013). En valeur, ceci équivaut à 3 681 millions de dollars canadiens. Ceci est bien loin des 301 200 millions de dollars canadiens investis en Amérique du Nord (44,16 %) ou encore des 184 205 millions de dollars canadiens investis en Europe et Asie centrale (27,01 %). L’Amérique latine intéresse aussi les investisseurs canadiens puisque les IDE s’élevaient à 137 192 millions de dollars canadiens en 2012 (20,11 %).
Ces chiffres montrent que l’Afrique n’est pas encore un continent très prisé des investisseurs canadiens. Cependant, une étude publiée en 2013 par Ernst & Young (Ernst & Young, 2013) montre qu’entre 2007 et 2012, 86 nouveaux projets canadiens ont vu le jour en Afrique. Ceci correspond à un taux de croissance annuel moyen de 13,2 %. Ainsi, le Canada occupe la 15e place du classement mettant en avant le TOP 20 des IDE pour de nouveaux projets en Afrique entre 2007 et 2012. Notons que dans ce classement la première position est occupée par les États-Unis (516 nouveaux projets sur cette période de cinq ans, avec taux de croissance annuel moyen de 11,2 %). La Chine, quant à elle, la 9e place de ce TOP 20 avec 152 nouveaux projets entre 2007 et 2012, correspondant à un taux de croissance annuel moyen de 15,5 % sur cette période.
Si l’on prend une période plus large, entre 2003 et 2012, on note que 181 projets canadiens ont été développés en Afrique et que ceci correspond à 3,1 % de l’ensemble des nouveaux projets étrangers en Afrique. Le Canada est donc en 10e position de ce classement. Toujours à titre de comparaison, entre 2003 et 2012, les États-Unis occupent la première place du classement avec 754 projets (12,6 %) et la Chine occupe la 9e place avec 196 projets (3,3 %).
Nous pouvons donc en conclure que même si la présence du Canada est relativement limitée en Afrique, celle-ci tend à s’accentuer dans les prochaines années avec un développement des projets canadiens sur le sol africain. Notons d’ailleurs que le Québec représente déjà une partie intéressante des investissements canadiens sur ce continent. Par exemple, « si nous prenons les échanges entre le Canada et l’Afrique du Sud, 41 % sont réalisés avec le Québec, alors qu’avec l’Algérie on parle d’environ 40 % » (Entreprise - Le magazine des gens qui ont l'esprit d'entreprise. s.d.).

3.4 Lamaîtrisedufrançais
Les entreprises québécoises ont un énorme avantage comparé à bon nombre de pays étrangers investissant en Afrique : la maîtrise du français. Faire des affaires en français dans les pays francophones africains est un avantage non négligeable, notamment pour la compréhension des intérêts et objectifs entre l’investisseur étranger et le pays qui reçoit ces investissements. Il existe en effet 25 pays francophones en Afrique. Notons qu’un pays francophone est un pays « ayant le français comme langue officielle ou d’usage » (BAD, 2011). La plupart de ces pays francophones appartiennent soit à l’UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, incluant la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo), soit à la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique centrale, incluant le Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon). Notons que ces deux unions monétaires « regroupent quelque 148 millions d’individus et un produit intérieur brut nominal cumulé de 167 milliards de dollars » (African Press Organization, 2014). On note également le franc CFA est garanti par le Trésor public français et que « les devises en cours dans les deux unions monétaires, à savoir les francs CFA d’Afrique de l’Ouest et Centrale, sont adossés à l’euro ».
L’Afrique francophone est un terrain d’investissement très intéressant pour tout ce qui concerne la production d’énergie électrique puisqu’il y a énormément de fleuves avec un fort débit dans la région. Mais là encore, si le Canada, et plus particulièrement le Québec, souhaite y investir vu le potentiel présent, il va falloir aller de l’avant dès maintenant. Si l’on reprend l’exemple de la Chine, on voit que ce pays est déjà très actif là-bas. En reprenant l’exemple de la production d’énergie électrique, la Guinée a « entamé des négociations avec la China International Waterand Electric Corporation en août 2011 pour la construction d’une usine électrique […] le coût de ce projet est estimé à 526 millions de dollars ». Autre exemple, la Côte d’Ivoire qui a conclu un emprunt 20 500 millions de dollars auprès de la banque d’import-export chinoise Exim « en vue de financer la construction d’une centrale hydroélectrique ».
4 FACTEURSDERÉUSSITEPOURLESENTREPRISESCANADIENNESETQUÉBÉCOISESENAFRIQUE
Selon le président de Club des entrepreneurs et professionnels africains au Québec, M. Yaovi Bouka, il existe trois facteurs essentiels pour envisager un succès à long terme du partenariat Canada-Afrique (Entreprise - Le magazine des gens qui ont l'esprit d'entreprise. 2014) :
1) « mettre en place de nouvelles structures de financement de type capital de risque […] capable de mobiliser et de rassurer les investisseurs canadiens et africains dans le cadre d’une réelle expansion du commerce et de l’investissement privé en Afrique ».
Si l’on prend l’exemple de la France, à travers l’Agence française, « celle-ci finance des entreprises françaises pour l’achat d’actions dans les compagnies africaines, ce qui leur permet de siéger aux conseils d’administration et d’octroyer des contrats au siège social. 80 % des exportations françaises en Afrique sont le fait de leurs filiales africaines ».

Abdoulaye Rokaya Wane (président du Groupe Scorpion, éditant la revue Stratégies et s’occupant de conseil en communication sur les marchés internationaux dont l’Afrique) insiste d’ailleurs en disant qu’il est « urgent que les Canadiens mettent en place des outils financiers plus compétitifs » (Entreprise - Le magazine des gens qui ont l'esprit d'entreprise, 2014). Il surenchérit d’ailleurs en affirmant que « bien au-delà des données macroéconomiques, il faut une information sur les occasions commerciales, car les statistiques n’informent pas sur la capacité d’approvisionnement des entreprises locales, leur crédibilité auprès des bailleurs de fonds ou le volume de leurs ventes ».
2) « il est impératif d’ouvrir les marchés canadiens aux produits africains en vue d’équilibrer les flux d’échanges économiques et commerciaux ». Notons qu’en 2012, les échanges étaient pour le moins disproportionnés puisque le Canada exportait en Afrique pour une valeur de 13 milliards de dollars. Dans le même temps, le Canada importait d’Afrique pour un montant total estimé à 3 milliards de dollars (Tchaha, 2012). En vue d’une relation gagnant-gagnant entre le partenaire canadien et le partenaire québécois, il est important que les échanges et bénéfices soient mutuels et réciproques. Soulignons qu’en grande majorité, les pays occidentaux ont historiquement toujours été plus intéressés par le fait d’arriver en Afrique avec une solution toute faite, sans tenir compte des besoins réels de l’Afrique en matière de développement. Il est nécessaire que les deux pays partenaires retirent un bénéfice d’une éventuelle coopération.
3) « une implication directe et effective des gens d’affaires et professionnels afro-canadiens et africains s’impose pour la mise en œuvre d’un partenariat efficace ». D’ailleurs, les entrepreneurs québécois installés en Afrique sont tous d’accord sur le fait qu’avoir une présence locale est un facteur de réussite important.
De plus, Jean-Claude Simard, qui est directeur général de la société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec, détenue à 34 % par le consortium canado-français Hydro-Québec-Elyo), dispose d’une expérience africaine très poussée et il indique trois grandes zones pour orienter les entreprises québécoises et canadiennes encore mal informées (Entreprise - Le magazine des gens qui ont l'esprit d'entreprise, 2014) :
« l’Afrique du Nord qui est un marché très sophistiqué où l’on peut vendre toutes sortes de biens »
« l’Afrique du Sud qui en plus des biens et services courants offre des possibilités pour les projets d’infrastructures »
« l’Afrique subsaharienne constituée d’une multitude de petits marchés où il faut travailler des distributeurs locaux, car on ne peut pas distribuer d’un point vers l’autre ».
Monsieur Simard conseille d’ailleurs « aux entreprises québécoises qui débutent de se concentrer sur les pays à monnaie forte de l’UEMOA à cause de la langue française, d’une faible concurrence et d’une certaine uniformité macroéconomique ».
Enfin, notons que le Canada n’a pas de passé colonisateur en Afrique. Certes, ceci explique en partie pourquoi ses relations avec l’Afrique ne sont pas aussi poussées que la France par exemple. Historiquement, il y a eu moins de liens et d’échanges entre le Canada et l’Afrique. Cependant, il y a là une opportunité unique de créer une relation gagnant-gagnant avec le partenaire africain. En effet, le temps de l’exploitation unilatérale par le colonisateur est révolu

désormais, il faut penser autrement et construire des relations de travail et d’échanges plus sains pour voir à terme la partie canadienne et la partie africaine en retirer une vraie valeur ajoutée. Le potentiel et les opportunités sont réels en Afrique, cependant il ne faut plus attendre pour s’y engager. Bien que les menaces et problèmes y soient encore nombreux (manque d’infrastructures, manque de stabilité politique, milliers d’ethnies et de langues, guerres et terrorisme…), il ne faut pas attendre que tout soit réglé pour s’y aventurer sous peine de voir d’autres pays plus visionnaires, mais pas nécessairement plus compétents s’y installer durablement et bénéficier des énormes opportunités d’affaires africaines au profit des entreprises canadiennes et québécoises. On sait qu’entre 2005 et 2010, « les exportations québécoises en Afrique ont bondi de 88 % […] puis encore de 10 % par année, pour atteindre 1 milliard de dollars en 2012 (Nadeau, 2014). Cependant, le Québec peut et doit faire mieux puisque l’Afrique ne représente « que 0,6 % de toutes ses exportations ». La phrase suivante de l’ancien ministre des Relations Internationales, Jean-François Lisée, doit être bien entendue par l’ensemble des entreprises canadiennes et québécoises : « il y a deux dangers avec l’Afrique : être trop optimiste et ignorer ses promesses » (Nadeau, 2014).
5 CONCLUSION
Enfin, conclure notre propos en donnant seulement des opportunités d’affaires, mais sans donner les clés pour transformer les essais en réussites rendrait notre travail incomplet. De fait, comme nous l’avons dit l’Afrique est un continent hétérogène composé par 53 pays qui présentent autant d’économies différentes. Outre la relative instabilité politique de la zone et de la situation économique précaire, concrétiser des affaires en Afrique n’est pas une chose aisée. Or, comme nous l’avons vu, le défi environnemental africain ouvre la porte à des opportunités d’affaires intéressantes pour les entreprises étrangères compte tenu notamment de la prise de conscience des dirigeants africains en faveur d’une utilisation accrue des énergies renouvelables.
Toutefois, en plus de l’analyse de la pertinence de s’intéresser à l’Afrique pour les entreprises œuvrant dans les énergies vertes, il est nécessaire de prendre conscience de la réalité africaine. En ce sens, le modèle de Geert Hofstede permet de distinguer les 5 dimensions culturelles qui doivent être analysées si vous envisagez de vous implanter sur le marché africain. Si nous ne voulons pas tomber dans une analyse ethnocentrique, nous nous devons de ne pas énumérer ici les 5 dimensions culturelles avec leurs « caractéristiques africaines », il serait en effet peu judicieux de faire cela, car dans ce cas nous oublierions indéniablement les disparités entre les différents territoires. L’Afrique qui est composée de 54 États différents ne peut être analysée comme un tout, comme nous l’avons expliqué précédemment des zones réunissant plusieurs États peuvent toutefois être envisagées (Afrique de l’Ouest par exemple). Nonobstant, il est possible de donner des conseils généraux afin de faire des affaires et de nouer des partenariats en Afrique.
La liste que nous allons dresser ici ne représente pas une liste exhaustive des conseils formulables à propos de la manière de faire des affaires en Afrique et des comportements à adopter, ce n’est pas pour autant que cette liste ne mérite pas toute notre attention. Le premier conseil, c’est 1/ patience et ténacité. Faire des affaires en Afrique n’est pas une chose aisée du fait d’une distance culturelle certaine et de différences de pratiques, le manque d’infrastructures ou bien des gouvernements peu scrupuleux sont autant de freins qui rendent les cycles d’affaires

longs et pénibles. Parfois, même si le cycle d’affaires semble être arrivé à son terme (après plusieurs années bien souvent) nous ne sommes pas sûrs d’avoir le paiement.
Le deuxième conseil vient donc naturellement, 2/ connaissance du marché et des clients. Le copier-coller de stratégies adoptées sur d’autres territoires n’est certainement pas une bonne stratégie à mettre en œuvre. La connaissance du marché et des clients nous amène à notre troisième conseil, 3/ avoir des contacts solides. Le choix des partenaires locaux est crucial, faire des affaires en Afrique n’est pas envisageable sans partenaire local qui lui a la connaissance du marché. Construire une relation de confiance et d’intimité n’est pas une chose aisée, mais cela demeure primordial. Les cadeaux et les invitations par exemple sont les bienvenus. Malgré cela vous n’êtes pas sûr d’arriver à concrétiser vos affaires, alors, 4/ capitaliser sur les événements majeurs est également à ne pas laisser en marge. Le climat d’affaires n’est pas uniforme et pas aussi stable qu’il ne l’est dans les économies occidentales (ou bien même dans celles des pays en développement), il est nécessaire profiter des unions monétaires par exemple, ou encore d’événement tel que le « printemps arabe ». Nos deux derniers conseils sont plus pragmatiques que les précédents, mais tout aussi nécessaires. 5/ Ne pas prendre un engagement comme un acquis, la manière de faire des affaires en Afrique est parfois bien différente de la nôtre. Ainsi, les engagements doivent autant que possible être formalisés, de plus ils ne doivent pas être pris comme des acquis, car une tendance à la non-réalisation des engagements est existante. Les termes des contrats doivent être clairs (IESE, 2014).
Enfin, notre dernier conseil serait, 6/ se méfier des attentes implicites, outre les engagements faits à votre égard (dans la manière de délivrer le travail, « timing ») les partenaires locaux peuvent avoir des attentes implicites. Il est très important d’avoir une capacité à les identifier (par le biais de contacts de confiance intimistes par exemple), car cela vous permettra de pérenniser la relation.
Enfin, malgré le fait qu’il ne soit pas aisé de faire des affaires en Afrique, les opportunités sont réelles et croissantes. Il ne faut donc pas baisser les bras, arriver armé (au sens figuré) est capital et cela vous permettra d’assurer vos relations. Malgré le temps que cela demande, c’est une zone très intéressante à travailler et qui en plus des opportunités d’enrichissement économique (grâce aux relations gagnantes-gagnantes) présente des opportunités d’enrichissement personnel. L’expérience est souvent qualifiée comme remarquable, la terre de contrastes, le sentiment de risque n’enlèveront rien aux relations humaines intimistes de confiance, qui sont sans pareil.

6 RÉFÉRENCES
Abodohoui, A., Su, Z. et I. Aurore Da-Silva. (2013). Capitalisme d’État et le rôle des institutions dans la politique industrielle des pays africains [Version électronique].
AFDB - Groupe de la Banque africaine de développement-. (2012). En route vers Rio +20 : défis et opportunités pour l'Afrique. [Version électronique]/ Actualités.
AFDB - Groupe de la Banque africaine de développement-. (2012). Transfert de technologies pour une croissance verte en Afrique. [Version électronique]/ Rapport sur le développement en Afrique – Chapitre 6.
African Press Organization. (2014). L'Afrique francophone, nouvel eldorado pour l'expansion de Standard Bank. [Version électronique].
AQPER - Association québécoise de la production d’énergie renouvelable-. (s.d.). Potentiel éolien du Québec. [Version électronique].
BAD - Banque Africaine de Développement-. (2011). Aperçus sur l’Afrique francophone. Forum économique mondial pour l'Afrique.
BAD - Banque africaine de développement -. (2004). Politique environnementale du groupe de la banque africaine de développement (PSDU).
Bergeron, M. (2013). Québec étendra ses tentacules en Afrique. [Version électronique]/ La Presse.
Bertrand, M. (2014). Diminuer le développement de l'hydroélectricité et de l'éolien? [Version électronique]. Société de Radio-Canada.
BM - Banque Mondiale-. (2014). Au Cameroun, le projet de Lom Pangar vise à exploiter le potentiel hydroélectrique de la Sanaga pour accroître la production d’électricité.
BM - Banque Mondiale-. (2014). Projet d’assistance technique au développement du projet INGA 3 basse chute et de centrales hydroélectriques de moyenne puissance. [Version électronique].
BRM. (2014). Le Cameroun fait les yeux doux aux investisseurs canadiens et québécois. [Version électronique].
CEREEC - Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDAO-. (2013). Le CEDAO s’engage à soutenir l’initiative énergie durable pour tous en Afrique de l’Ouest, [Version électronique]/ Numéro 6.
Chouaïbou Mfenjou, M. (2002). L’Afrique à l’épreuve du développement durable. Collection Administration et Aménagement du territoire, L’Harmattan, Paris, 297.
CIDP - Canadian International Development Platform. (2013). Canadian Foreign Direct Investment Abroad. [Version électronique].
Coquet, D. (2013). Projet Grand Inga en RDC : le revers de la médaille. TV5 monde. CNUCED. (2014). Le développement économique en Afrique, catalyser l’investissement pour
une croissance transformatrice en Afrique. [Version électronique]. Ecotech Québec. (2012). Les technologies propres au Québec. [Version électronique]. Ecotech Québec. (2014). La grappe des technologies propres. [Version électronique]. Entreprise - Le magazine des gens qui ont l'esprit d'entreprise. (s.d.). L’Afrique au rendez-vous.
[Version électronique]. Ernst & Young. (2013). Africa 2013: Getting down to business. [Version électronique]/ Growing
beyond. Gouvernement du Québec (2013). S'informer/éolien. [Version électronique].

Hontang, A. (2014, août 4). La Chine mène la course aux investissements en Afrique. [Version électronique]/ Les Echos.
Hydro-Québec. (2014). L’hydro-électricité québécoise, source d’avenir. [Version électronique]. IBRD/ WB - International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank -.
(2013) Africa development indicators 2012/2013. [Version électronique]. ICTSD - International Centre for Trade and Sustainable Development -. (2012). Quelle stratégie
de croissance verte pour un développement durable en Afrique? [Version électronique]. ICTSD - International Centre for Trade and Substainable Development -. (2011).
Développement industriel de l'Afrique dans le nouvel environnement mondial : les politiques à adopter. [Version électronique].
IESE Business School. (2014) Doing Business In Sub-Saharan Africa: Six Aspects To Consider, Forbes, [Version électronique].
Investir au Cameroun. (2014). Le Cameroun et le Canada signent un accord de promotion et de protection réciproque des investisseurs. [Version électronique].
JEUNE AFRIQUE. (2013) L’Afrique attire de plus en plus d’investissements étrangers. [Version électronique].
JEUNE AFRIQUE. (2014). Kenya : le plus grand projet éolien en Afrique sur les rails. [Version électronique].
Lundsgaarde, E. (2011). African toward 2030 : Challenges for development Policy. Rethinking international development series.
Ministère des Affaires Etrangères Français. (2011) Ressources minérales et développement en Afrique. [Version électronique].
Madou, S. (s.d.). L’énergie hydraulique en Afrique subsaharienne. [Version électronique]/ L’Afrique des idées.
Nadeau, J.-B. (2014). Les eldorados africains. [Version électronique]/ L’Actualité. NUAEC – Nations Unies Affaires Economiques et Sociale-. (2014) Situation de la population
mondiale en 2014. [Version électronique]. NU/CUA – Nations Unies/Commission de l’Union africaine. (2013). L’industrialisation au
service de l’émergence de l’Afrique. [Version électronique]. OCDE/BAD – Organisation de Coopération pour le Développement Économique/Banque
Africaine de Développement -. (2012). Perspectives économiques en Afrique. [Version électronique].
ONUDI - Organisation des Nations unies pour le développement industriel -. (2011). Le développement économique en Afrique. [Version électronique]. Rapport spécial.
PEA - Perspective Économique en Afrique -. (2014) Ghana. [Version électronique]. PNUE - Programme des Nations Unies pour l’Environnement -. (2006). L’avenir de
l’environnement en Afrique – Notre environnement, notre richesse. Rapport AEO-2, Synthèse.
PNUE - Programme des Nations Unies pour l’Environnement -. (2011). Vers une économie verte : Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté –Synthèse à l’intention des décideurs. [Version électronique]
Saliou Toure, F. (2013). La coopération de l’Afrique avec les pays « Brics », une troisième voie pour le développement de l’Afrique ? [Version électronique]/Université du Québec à Montréal
Saucier, J.-N. (2013). Énergies renouvelables: L’énorme potentiel africain. [Version électronique]/ Afrique expression.

Sperling, F. (2012) Promouvoir la croissance verte en Afrique : perspectives de la Banque africaine de développement. Document de Discussion, Banque Africaine de Développement
Sperling, F. Grano, I. & Vyas, Y. (2012). Promouvoir la croissance verte en Afrique: Perspectives de la Banque Africaine de Développement.
Tchaha, S. (2012). Quelles perspectives pour le Canada et le Québec façe à une Afrique émergente. [Version électronique].
UNECA - Nations Unies Commission économique pour l’Afrique -. (2013). Enjeux et défis de l’économie verte en Afrique centrale. [Version électronique]/ Vingt-neuvième session du comité intergouvernemental d’experts de l’Afrique centrale – Rapport final.
UNECA - Nations Unies Commission économique pour l’Afrique -. (2012) Les PME acteurs du développement durable en Afrique du Nord.
Yifu, J. & Monga, L. (2010). Growth Identification and Facilitation: The Role of the State in the Dynamics of Structural Change. Policy research working paper. World Bank.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES EN INDE
Aurore Martano, [email protected] Flavio Molendini, [email protected]
Yassine Ouchraa, [email protected] Marie Sailly, [email protected]
Audrey Texier, [email protected]
Résumé
L’Inde fait face à de nombreux défis. Le pays connaît en effet une forte croissance et est, déjà depuis quelques années, en plein essor. Cependant, cet essor n’est pas sans danger pour l’environnement, et il est très urgent de trouver des solutions pour lutter contre la pollution et réduire l’empreinte que le pays laisse sur la planète. Notre analyse s’est concentrée sur les moyens verts de produire de l’énergie, et comment les entreprises québécoises peuvent tirer avantage de leurs forces dans ce domaine pour ensuite aller s’implanter en Inde. Nous avons repéré plusieurs niches possibles (solaire, éolien, hydraulique et biomasse), mais une forte demande existe dans trois états en particulier pour de l’énergie. En effet, 90 % des villages de ces trois états n’ont pas accès à l’électricité et regorgent de petites rivières, ce qui en fait des lieux idéaux pour installer des microcentrales hydrauliques. Le Québec, grâce à des entreprises comme Hydro-Québec ou encore Innergex, possède une grande connaissance dans ce domaine et est l’un des producteurs principaux d’énergie hydraulique au monde. Nous conseillons donc une « joint-venture » avec un partenaire local afin de s’installer en Inde, et ce afin de réduire les risques culturels, de corruption, et tous les autres dangers qui peuvent se présenter lors de l’arrivée pour entreprise dans un nouveau territoire. Néanmoins, il faut évidemment rester conscient que cette alliance peut présenter des dangers, notamment au niveau de la propriété intellectuelle, mais aussi culturellement parlant.
INTRODUCTION
Avec un territoire extrêmement vaste et la deuxième population la plus nombreuse au monde, l’Inde regorge de diversité. En effet, la culture indienne comprend un large éventail de religions, de langues et de systèmes sociaux. Quant à son environnement, sa géographie est un échantillon de presque toutes les zones climatiques de la planète. Bien que sa croissance économique soit extrêmement rapide, le pays fait face à de nombreuses difficultés de développement. Ainsi, l’essor rapide de l’industrie couplé à une pauvreté alarmante conduit à une des dégradations de l’environnement les plus graves au monde. Dans les prochaines décennies, l’Inde continuera à connaître un développement démographique, économique et social. Dès lors, « tout ce qui pourra être appris de son expérience sera précieux pour la mise en œuvre dans le monde d’un développement plus respectueux de la nature ». Dans ce contexte, l’une des priorités du pays est le défi énergétique. En effet, la croissance économique et les besoins de modernisation du pays créent une demande croissante en énergie. Or, l’Inde répond aujourd’hui à ses besoins énergétiques par l’utilisation d’énergies fossiles (essentiellement le charbon et le pétrole) qui provoquent une pollution catastrophique. Ce manque de ressources énergétiques entrave aujourd’hui la croissance du pays et il devient urgent d’intégrer une dimension verte au développement économique.

Ainsi, il existe un réel marché vert qui a comme objectif de réduire les conséquences de la pollution; par exemple, le traitement de l’eau ou des déchets présente des opportunités pour les entreprises. Mais au-delà de la lutte contre la pollution existante, où se situent les perspectives d’affaires? Comment intégrer la protection de l’environnement dans le développement économique? En effet, il devient impératif d’intégrer dans les projets d’affaires en Inde une dimension verte et de mettre en place des installations qui répondent aux besoins en énergie sans polluer davantage.
Dans cette optique, quels sont les secteurs énergétiques maîtrisés par les entreprises québécoises? Quels types de projets les entreprises québécoises sont-elles capables de mener à bien en Inde? Quels seraient alors les facteurs clés de succès pour que les entreprises québécoises réussissent en Inde?
1 L’INDE,UNECROISSANCEMENACÉEPARLEDÉFIÉNERGÉTIQUE
1.1 L’Inde,unpartenariatéconomiquenonnégligeable
Aujourd’hui, les acteurs mondiaux ont pris conscience que l’Inde prend de l’ampleur sur la scène internationale. Ce nouveau statut de puissance est notamment lié à l’ouverture de l’Inde sur les marchés depuis les années 90 ainsi qu’aux facteurs de croissance économique et démographique considérables. Ces atouts font de l’Inde un partenaire économique non négligeable.
Ouverturedel’Indesurlesmarchés
La libéralisation économique opérée dans les années 1990 et l’ouverture du droit à l’accès aux investissements étrangers ont permis à l’Inde de s’impliquer sur le marché international. De nouveaux secteurs d’activités apparaissent, on peut citer entre autres les secteurs de pointe comme les services informatiques. En 2005, le secteur tertiaire contribuait à 60 % de la croissance et représentait 55 % du PNB contre 20 % pour l’industrie et 25 % pour l’agriculture. L’Inde est un pays dont l’économie est passée directement de la phase d’agriculture à la phase post-industrielle en évitant la phase industrielle de développement. L’ouverture de ses frontières et de son commerce extérieur est facilitée par la diminution des mesures protectionnistes comme l’abaissement des barrières douanières. La privatisation d’entreprises d’État a laissé place à un marché à fort potentiel pour les entreprises depuis cette période.
Croissanceforteetdéveloppementrapide
L’Inde a vécu une croissance de son économie très forte dans les années 2000. Son taux de croissance était de 8,4 % en 2004, 9,6 % en 2007 et 8,6 % en 2009 contre 3 % dans les années 1970. Cette croissance a été permise par l’ouverture du pays sur les marchés extérieurs. En effet, les réformes plus libérales mises en place par le gouvernement qui contrastent avec la politique socialiste auparavant en place ont conduit à cette performance. Son intégration dans l’économie mondiale a augmenté sa compétitivité et lui permet d’être leader dans certains secteurs comme les biotechnologies et plus précisément les médicaments génériques.

Populationenfortecroissance
Avec 1, 236 milliards d’habitants en 2014 soit 17 % de la population mondiale, l’Inde a la deuxième plus grande population du monde. Selon le Global Agenda Council, celle-ci devrait dépasser celle de la Chine d’ici 2030. En 2013, la moitié de la population indienne était âgée de moins de 25 ans. Cette abondance de main-d’œuvre active sera donc disponible dans les années à venir. Selon l’Organisation Internationale du Travail, « au cours des dix prochaines années, un nouvel actif sur quatre dans le monde sera Indien ».
Ce dynamisme démographique accompagné de la croissance rapide de l’Inde a permis une élévation du niveau de vie et une augmentation de la qualification d’une certaine partie de la population. En effet, le système éducatif s’est fortement développé. En 2009, une loi sur le droit à l’éducation a rendu obligatoire l’école élémentaire et gratuite pour tous. Les dépenses publiques ont permis le développement d’infrastructures scolaires. L’Inde offre maintenant un enseignement universitaire de qualité.
Une croissance démographique de cette ampleur permet à l’Inde d’être un vaste marché en raison de la main-d’œuvre qualifiée disponible. Cela offre également de nombreuses opportunités pour les marchés extérieurs. Les classes moyennes et hautes situées dans les zones urbaines, soit 380 millions de personnes actuellement devraient voir leur nombre multiplié par deux en 2030. Cette partie de la population ayant accès à davantage de revenus et de moyens est celle qui consomme et entraîne la croissance du pays. Le dynamisme démographique de l‘Inde est donc un atout pour l’avenir.
1.2 Maislepaysfaitfaceàdenombreusesdifficultés
Malgré son potentiel, l’Inde rencontre des difficultés qui ne lui permettent pas de profiter au mieux de ses avantages. Ce pays reste pauvre, et les inégalités ont été davantage creusées par le développement économique rapide de ces dernières années. Le pays reste sous-développé et inégalitaire, ce qui est à l’origine du ralentissement de sa croissance.
Unpayspauvre
En 2010, selon le Commissariat au Plan Indien, un tiers de la population en Inde vit sous le seuil de pauvreté. En 2014, l’Inde compte environ 363 millions de personnes pauvres ce qui représente 29,5 % de la population indienne totale. Ces dernières années, on peut donc constater que la pauvreté recule dans les villes, mais augmente fortement sur d’autres parties plus rurales du territoire. Les populations de ces zones connaissent une aggravation de leurs conditions de vie notamment due aux difficultés d’accès à l’eau potable, à l’électricité et à la nourriture. Un des grands enjeux pour l’Inde est de nourrir une population qui croît de plus en plus. Par ailleurs, le système indien basé sur les castes contribue à l’augmentation des inégalités au sein de la population. Ce sont les castes les plus basses et également la communauté musulmane qui souffrent le plus de la pauvreté. Les classes moyennes, quant à elles, voient leur niveau de vie augmenter. Il y a donc un système à deux vitesses où les inégalités se creusent de plus en plus.

Unemodernisationdupaysessentielle
Malgré le progrès effectué dans l’éducation ou les soins, une part trop importante de la population n’a pas accès à ces améliorations. Par exemple, l’accès aux soins et à l’éducation est difficile pour 53,7 % de la population selon l’Indice de pauvreté multidimensionnel (IPM) du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). La mortalité infantile en Inde est la plus élevée au monde (44 % en 2012). Le taux d’alphabétisation entre 2008 et 2012 est de 62,8 %, ce qui signifie que plus d’un tiers de la population ne sait pas lire. Les politiques menées par l’État ne sont donc pas suffisantes pour améliorer ces circonstances. L’Inde connaît également des problèmes assez importants au niveau structurel. Le manque d’infrastructures concernant le transport et l’électricité est un obstacle à sa croissance. Selon les économistes de la Banque Mondiale, un quart des routes est surchargé, et 70 % de la population des zones rurales n’a pas accès aux routes toute l’année. Le gouvernement prend conscience de ces difficultés et a alloué 1000 milliards de dollars pour un plan quinquennal destiné à améliorer le réseau de transports indien. Il reste cependant encore de nombreux obstacles institutionnels.
Unralentissementdelacroissanceindienne
L’essor des BRICS permet notamment à l’Inde de montrer son statut de nouvelle puissance mondiale. Sa présence sur la scène internationale prend de l’ampleur suite à son poids économique, démographique et son potentiel qui en découle. Cependant, sa croissance économique ne fait que ralentir depuis quelques années. Après plusieurs années où son taux de croissance était autour de 9 %, celui-ci se situe à environ à 4-5 % en 2013 soit le plus bas taux enregistré depuis 2009. Ce ralentissement de la croissance indienne s’explique par la baisse des exportations vers les pays dont les économies ont subi la crise de 2008 et qui ont limité leur consommation externe pour renforcer leurs économies. En effet, l’Inde importe plus que ce qu’elle exporte. Cela conduit à une dépréciation de la monnaie locale qui a une forte incidence sur l’inflation dans le pays. Par exemple, l’oignon, étant l’un des ingrédients majeurs de la cuisine indienne, a vu son prix quadrupler en une année. Cet évènement, appelé « crise de l’oignon », montre de manière concrète cette situation d’inflation. Par ailleurs, les investissements des pays occidentaux ont fortement diminué en Inde. Cela s’explique par des facteurs externes (la politique monétaire des autres pays), mais également internes. On peut citer la corruption, le manque d’infrastructure, et la pauvreté du pays qui freinent la volonté des investisseurs à placer en Inde. Une politique incitant aux investissements dans les secteurs secondaire et tertiaire est récemment mise en place pour attirer les investissements étrangers. Les élections récentes ont permis de mettre en place des programmes visant à relancer les dépenses publiques et accroître leur efficacité. Malgré ce ralentissement actuel, une accélération de la croissance de l’économie indienne est prévue (6,4 % pour 2015/2016) par les économistes de Reuters. L’Inde reste donc un acteur majeur auquel il faut accorder de l’importance.

1.3 Ledéfiénergétiquedel’Inde
Au-delà de toutes ces difficultés structurelles, l’Inde fait face à un défi majeur : la dégradation de son environnement. En effet, le pays est considéré comme étant le plus pollué au monde et rencontre de multiples difficultés écologiques. Ainsi, de nombreux défis sont à relever en termes de dégradation des sols, de mauvaise gestion des déchets, de déforestation ou encore de protection de la biodiversité. Toutefois, nous avons décidé de nous concentrer sur un sujet majeur sur lequel l’Inde doit concentrer aujourd’hui ses efforts : le manque de ressources énergétiques.
L’énergie, unproblèmemajeur
Dans un contexte de développement économique très rapide, les besoins en énergie ne cessent de croître. L’Inde est le 5e plus grand pays consommateur d’énergie, après les États-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne. En effet, les transports et les entreprises demandent une quantité croissante d’énergie, sans parler de la demande des particuliers. Cependant, il est intéressant de noter que la consommation d’énergie par habitant est l’une des plus faibles du monde (cinq fois plus basse que la moyenne mondiale). Ceci s’explique d’une part par l’ampleur de la population indienne qui s’élève à 1,52 milliard d’habitants en 2013. D’autre part, le territoire est très inégalement couvert par le réseau électrique. Les coupures électriques sont fréquentes, pénalisant entre autres les chaînes de production et de nombreux villages qui ne sont pas raccordés au réseau électrique.
Pour répondre à ses besoins énergétiques, l’Inde utilise aujourd’hui majoritairement des énergies fossiles qui sont extrêmement polluantes. Ainsi, 53 % de la production d’électricité provient du charbon et 29 % du pétrole. Les autres sources d’énergie (hydroélectricité, nucléaire, énergies renouvelables) ne représentent qu’une partie infime de cette production. Cette répartition s’explique surtout par le fait que l’Inde détient ses propres ressources en charbon à l’est du pays. Mais cette utilisation massive des énergies fossiles a pour conséquence une pollution de l’air très forte, due aux émissions de gaz à effet de serre. L’Inde est ainsi le pays où l’air est le plus pollué au monde et où l’on enregistre le plus grand nombre de décès liés aux maladies respiratoires, en particulier dans les grandes villes comme New Delhi. Ainsi, que ce soit pour faciliter l’accès à l’énergie même dans les zones rurales reculées ou pour réduire l’émission de gaz à effet de serre, il existe des opportunités pour les énergies renouvelables en Inde. Par ailleurs, le territoire indien regorge de champs d’exploitation. D’abord, l’électricité hydraulique est déjà bien installée au nord du pays puisque l’Inde est le 7e producteur d’hydroélectricité dans le monde. Par ailleurs, les moussons qui traversent le pays offrent un important potentiel pour les ressources éoliennes, tandis que le fort taux d’ensoleillement favorise la production d’énergie solaire. Enfin, l’agriculture étant la principale activité économique, on peut y voir de nombreuses possibilités pour l’utilisation des déchets dans des unités de biomasse.
Une compatibilité possible entre croissance économique et protection de l’environnement?

Finalement, comme on l’a vu, le développement économique en Inde pose de nombreux problèmes environnementaux qui viennent eux-mêmes menacer la croissance du pays. Pour autant, la Banque Mondiale estime que le développement économique de l’Inde n’est pas incompatible avec la protection de l’environnement. Ainsi, elle évalue à 80 milliards de dollars annuels la détérioration écologique de l’Inde, provenant essentiellement des conséquences sur la santé humaine de la pollution causée par la consommation d’énergies fossiles. Selon ce rapport, le pays pourrait néanmoins mettre en place des stratégies de réduction de cette dégradation de l’environnement qui coûteraient entre 0,02 % et 0,04 % de la croissance annuelle moyenne du PIB. En d’autres termes, il suffirait d’investir un léger pourcentage du PIB annuel pour accéder à une croissance plus verte.
Le pays connaît donc un développement économique et social qui demande des ressources énergétiques plus importantes. La situation environnementale étant déjà catastrophique, il devient urgent de considérer d’autres sources d’énergies plus vertes. Il existe donc bien un marché pour les énergies renouvelables en Inde.
2 LESOPPORTUNITÉSPOURLESENTREPRISESQUÉBÉCOISES
2.1 Lessecteursmaîtrisésparlesentreprisesquébécoises
Québec est l’un des acteurs principaux de production d’énergie renouvelable au Canada. La région, possédant un grand nombre de rivières, peut compter sur l’énergie hydraulique pour produire de l’électricité à bon marché et très proprement. Mais ce n’est pas tout, Québec peut également compter sur les secteurs éolien, solaire et la biomasse pour se doter d’énergies propres. L’énergie solaire est l’un des secteurs qui pèsent le plus sur la scène internationale avec 1,5 % de la production totale d’électricité et 6 % de la puissance. Malheureusement, en raison du manque d’investissements publics, le Québec tarde à avancer dans ce secteur. Il convient aussi de noter que le prix au kWh du solaire est plus élevé que les autres formes d’énergies. Néanmoins, Québec profite d’une durée d’exposition plus élevée que Montréal et Toronto et possède deux chaires de recherche (Concordia et Polytechnique) lui permettant d’être présent sur des niches bien spécifiques. En plus de fabriquer du polysilicium, élément utile à la fabrication de panneaux photovoltaïques, des entreprises québécoises comme Volts se spécialisent dans les systèmes d’énergies hybrides en combinant énergie solaire, thermique, éolienne, génératrice, ainsi que d’autres formes d’énergie. On peut également citer Solart, qui pose des panneaux solaires pour les entreprises et particuliers et qui permet la prévisualisation 3D des installations.
L’énergie éolienne, quant à elle, s’est vue stimulée par deux importants appels d’offres émis par Hydro-Québec souhaitant acheter 3000MW d’énergie produite par le vent en 2003 et 2005, et promettant d’arriver à 4000MW d’ici 2015. Plusieurs entreprises comme Marmen, Composite VCI ou encore LM Glassfiber aident le Québec à dépendre de moins en moins des propriétés intellectuelles étrangères et même à se spécialiser dans la fabrication de certains composants électroniques.
L’énergie hydraulique, secteur qui produit largement la plus grande partie de l’électricité au Québec, est contrôlée en quasi-monopole par Hydro-Québec, entreprise produisant 94,8 % de l’électricité consommée au Québec. Cette énergie propre, au coût de kWh très faible, est la spécialité du Québec qui excelle dans ce domaine à l’international.

Un grand nombre de projets sont lancés chaque année, par exemple le projet Eastmain (918 MW) ou le projet Romaine (1550 MW) qui offrent de belles perspectives énergétiques. En 2011, l’entreprise d’État Hydro-Québec est parmi les plus grands producteurs d’électricité au monde, avec plus de 35 000 MW de puissance disponible. De plus, le Québec s’est doté de centres de recherche comme l’IREQ, le LTE, le GRANIT ou encore CRNSG/Hydro-Québec pour s’assurer d’être compétitif dans le secteur. D’après une étude d’Ecotech sur les technologies propres au Québec, certains marchés de niche comme les mini-centrales hydroélectriques ou les micro-centrales en bordure de rivières pourraient constituer des marchés intéressants à exploiter.
Enfin, avec des entreprises comme Biothermica, Biofour Inc. ou encore Enerkem, la biomasse au Québec occupe une place raisonnable dans le classement des énergies renouvelables. Des marchés de niches comme les biocombustibles ou les biogaz sont très bien exploités par les entreprises québécoises et attirent toujours de nouveaux investisseurs. Possédant d’énormes étendues forestières et une électricité peu chère, Québec a un avantage certain sur le marché de la biomasse. En 2009, le gouvernement a lancé un plan nommé « Vers la valorisation de la biomasse forestière », ce qui a incité certaines entreprises à se développer. De plus, Hydro-Québec a lancé en 2013 un appel d’offres pour une puissance totale de 300 MW produite par la biomasse. Néanmoins, l’obstacle majeur pour une internationalisation de la biomasse au Québec est l’absence de normes de qualité québécoises ou canadiennes. « Cette filière est nouvelle et résisterait mal aux problèmes de qualité. […] Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) pourrait très bien adapter les normes internationales ou nationales aux besoins provinciaux » (MNRF et CRQ).
En conclusion, en matière d’énergies renouvelables, le Québec se positionne très bien sur plusieurs niches. Même si le secteur dans lequel Québec se démarque le plus est l’hydroélectricité, Québec possède d’excellentes compétences dans la fabrication de polysilicium, fabrique des composants électroniques de pointe pour les éoliennes et pourrait bien être un acteur de poids sur la scène internationale en matière de biogaz, par exemple.
2.2 L’hydroélectricité:desopportunitéssurdepetitsprojets
On a donc vu que les entreprises québécoises avaient une carte à jouer dans le secteur hydroélectrique. Celui-ci est déjà développé en Inde puisqu’un important programme de construction de barrages a été mis en place dans le cadre de la révolution verte. En effet, au cours du gouvernement Nerhu, des plans quinquennaux ont été instaurés afin de lancer la croissance économique du pays. Dans ce contexte, la construction de barrages a été encouragée afin d’augmenter les capacités d’irrigation et d’accéder à une sécurité alimentaire. Ce fut notamment le cas dans le bassin de la Narmada, où les projets se sont accélérés depuis les années 1980 avec comme objectif d’aménager 30 barrages « majeurs », 125 barrages moyens et 3000 petits projets d’irrigation. Ces chantiers colossaux ont fait l’objet de nombreuses polémiques à cause des conséquences désastreuses qu’ils ont provoquées sur l’environnement et sur les populations autour de ces installations. Ainsi, on dénombre aujourd’hui 4000 barrages en Inde qui représentent un quart de l’électricité produite. Le pays compte ainsi les plus importants barrages du monde comme le barrage de Tehri qui est le plus gros barrage d’Inde et le huitième du monde ou encore le barrage de Nagarjuna Sagar, le plus grand barrage de béton du monde qui irrigue 1,4 million d’acres de terres exposées à la sécheresse.

Il existe encore des projets en cours aujourd’hui, mais le secteur est dominé par les entreprises publiques comme National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Northeast Electric Power Company (NEEPCO), Satluj jal vidyut nigam (SJVNL), Tehri Hydro Development Corporation, et NTPC-Hydro qui représentent 97 % du secteur. Dès lors, au vu de la prédominance de ces organismes publics et des investissements colossaux que nécessitent de tels chantiers, le secteur des grands projets hydroélectriques est accessible pour de très grosses entreprises. C’est le cas d’ALSTOM, par exemple, qui vient de décrocher un contrat de 265 millions d’euros pour l’équipement hydroélectrique du barrage de Subansiri, le plus grand projet hydroélectrique jamais réalisé en Inde.
C’est la raison pour laquelle les entreprises québécoises ont intérêt à se tourner vers des projets hydroélectriques de petites tailles. Ce segment peut être subdivisé en deux sous-segments : la mini hydroélectricité (moins de 1000 kW) et la micro hydroélectricité (moins de 100kW). Selon la CII (Confederation of Indian Industry), il existe plusieurs arguments en faveur des petits projets d’hydroélectricité. D’abord, ce sont des projets plus respectueux de l’environnement par rapport aux grands barrages évoqués précédemment. Ensuite, ces projets répondent de manière pertinente aux besoins des régions rurales reculées et non raccordées au réseau électrique. Il s’agit également d’une technologie accessible, efficace et bien maîtrisée. Par ailleurs, le temps nécessaire à la mise en place de ce type de projet est bien moins long que pour les gros projets hydroélectriques. Enfin, les investissements sont de bien moins grande ampleur, ce qui rend ces petits projets accessibles à des entreprises de plus petite taille, comme des PME par exemple.
Les micro-centrales hydroélectriques représentent donc une des possibilités pour répondre au besoin en énergie de l’Inde, de façon ciblée, tout en étant en accord avec les compétences clés et les points forts des entreprises québécoises.
3 LESFACTEURSCLÉSDESUCCÈSPOURINVESTIRENINDE
3.1 Prendreencomptelesspécificitésdel’environnementd’affairesindien
Pour réussir son investissement en Inde, une entreprise étrangère doit prendre en considération plusieurs éléments. Tout d’abord, s’agissant d’un projet se situant dans le secteur des technologies vertes, il est nécessaire d’analyser à la fois les variables liées aux spécificités indiennes dans ce secteur en question, mais aussi les éléments plus globaux. Ainsi, nous pouvons observer le fait que l’Inde met en place de nombreuses mesures qui encouragent les entreprises étrangères à investir dans le secteur des technologies vertes. Cependant, il y a certains facteurs institutionnels pouvant entraver les investissements, qu’une entreprise ne doit pas omettre.
Uncontexte favorableauxinvestissements
Inde et Canada : une relation commerciale privilégiée
Depuis de nombreuses années, ces deux pays entretiennent des relations d’affaires étroites. En effet, les échanges commerciaux entre l’Inde et le Canada ont augmenté de 22 % entre 2009 et 2010. Durant cette même période, les exportations de marchandises canadiennes vers l’Inde ont augmenté de 34 % tandis que les importations ont augmenté de 12,4 %.

Selon le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, il semble que les relations avec l’Inde sont sous-exploitées compte tenu de ses ressources et des possibilités commerciales et d’investissements entre les deux pays. De grandes entreprises comme Bombardier sont déjà présentes en Inde, ainsi que plus de 1200 entreprises canadiennes. Le potentiel de croissance de pays constitue une perspective intéressante pour le Canada. De plus, le contexte économique depuis 2008 ainsi que la volonté de diversifier ses partenaires économiques ont fait que le Canada a ciblé l’Inde comme pays principal avec qui conclure un accord. Ainsi, en 2010, des négociations sont abordées afin de signer un Accord de Partenariat Economique Global entre ces deux pays (APEG). Cet accord a pour but de faciliter les échanges, favoriser les investissements de façon réciproque et améliorer l’accès au marché indien pour les entreprises canadiennes.
Un risque pays faible
Selon Credimundi, l’Inde présente un risque politique faible, évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Le risque politique est calculé en tenant compte de trois indicateurs : la dette extérieure à court terme, les réserves de devises et le solde courant de la balance de paiements. Cela s’accompagne d’une évaluation du risque par les marchés financiers. Le risque commercial quant à lui se situe dans la catégorie B sur une échelle de A à C. Ce modèle comprend trois groupes d’indicateurs : un groupe d’indicateurs économiques et financiers, un groupe d’indicateurs de capacité de paiement du pays, et un groupe d’indicateurs reflétant le contexte institutionnel. L’Inde présente un risque commercial considéré comme « normal ». Ainsi de façon générale le risque pays est faible pour les investissements étrangers. Parallèlement à cela, l’indicateur de liberté économique montre que l’économie de l’Inde est fortement administrée, puisqu’elle obtient une note de 55,7/100. Parmi les dix indicateurs le composant, seulement trois sont évalués au-delà de 70/100. Tous ces éléments nous permettent de conclure que l’Inde représente un environnement favorable pour les investissements des entreprises québécoises. Parallèlement à cela, lorsqu’on met l’accent sur le secteur des technologies vertes, on constate une réelle volonté du gouvernement de promouvoir ce secteur.
Des actions gouvernementales incitatives
L’Inde a développé depuis plusieurs années un contexte promouvant les investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Cette stratégie se traduit par l’élaboration d’institutions spécifiques, le lancement de politiques et programmes spéciaux, ainsi que des mesures incitatives pour soutenir les investissements et la recherche.
C’est l’un des premiers pays à s’être doté d’un Département Fédéral des sources d’énergie non classiques dans les années 80, qui s’est transformé en un ministère uniquement dédié aux énergies vertes en 2006 : il s’agit du MNRE (Ministry of New and Renewable Energy). Cela prouve une volonté étatique d’améliorer la situation environnementale. Par exemple, en 2003 est instauré l’Energy Act par lequel les autorités de régulation d’énergie ont mis en place un système de rachat d’énergie renouvelable. Cela consiste à établir un pourcentage d’énergies renouvelables devant être rachetées par les distributeurs d’électricité, et ce dans chaque État.

Le gouvernement fédéral a également instauré de nombreux autres programmes énergétiques. Ainsi, la Politique Energétique Intégrée (Integrated Energy Policy) adoptée en 2008 énonce des objectifs d’efficacité énergétique à l’horizon 2030. Ensuite, l’État a lancé diverses politiques plus spécifiques comme la National Solar Mission, le Programme national de Biogaz, le Programme Intégré d’Energie Rurale (Integrated Rural Energy Programme), ou encore le Programme d’Electrification des Villages Eloignés (Remote Village Electrification Programme). Ce dernier est lancé en 2001 et a pour but principal d’équiper les villages se trouvant dans les zones rurales non raccordées au réseau électrique et « en offrant des raccordements gratuits aux ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté et en subventionnant 90 % des coûts de capital via des subventions du gouvernement indien » (Government of India, 2009).
Ces programmes s’accompagnent donc de mesures accordées aux projets liés aux technologies renouvelables. Elles se traduisent par des avantages fiscaux, des réglementations d’application, des obligations d’achat d’énergie renouvelable, des incitations financières : soutien lié aux infrastructures, bonification d’intérêts, exonérations sur la taxe d’électricité… Des organismes tels que l’IREDA (Indian Renewable Energy Department Agency), dépendants du MNRE, soutiennent financièrement les projets d’affaires dans le secteur énergétique.
Grâce au soutien politique et aux mesures juridiques et réglementaires, il existe bel et bien un environnement favorable en Inde pour les investissements dans les énergies renouvelables.
Lesdifficultésinstitutionnellesglobalesdel’Inde
Une économie très protégée
L’Inde est un État protectionniste et présente de nombreuses barrières aux investissements. C’est l’une des conséquences de la colonisation. Selon les secteurs, les barrières tarifaires sont élevées, mais il existe aussi de nombreuses barrières non tarifaires (limitations aux importations par exemple). De plus, les formalités sont souvent fastidieuses. En effet, la lourde bureaucratie est de notoriété publique. L’administration indienne se caractérise par sa lenteur ainsi que ses délais anormalement longs. L’environnement réglementaire est restrictif, et les entreprises, étrangères ou indiennes, doivent prendre en compte tous ces obstacles au moment d’investir.
Corruption
La corruption en Inde demeure une problématique récurrente. C’est un fléau qui ronge toutes les sphères de la société. Selon l’ONG Transparency International, consacrée à la lutte contre la corruption, l’indice de corruption attribué à l’Inde est de 36 sur une échelle allant de 0 à 100, 0 étant perçu comme le plus haut degré de corruption. Cette même ONG a réalisé une enquête en 2013 où 54 % des Indiens interrogés disent avoir déjà payé un pot-de-vin.
La classe politique à tous les niveaux est également concernée. La corruption est un fléau qui fait perdre des millions à l’État, à cause de pots-de-vin divers, ou de détournements sur des contrats publics ou des partenariats. En 2012, un militant, Arvind Kejriwal, a créé un parti politique et lancé une campagne anticorruption dans le but de dénoncer les personnalités politiques ainsi que l’inactivité du Parlement et de la justice pour combattre ces dérives.

La démission, début 2014, de cet ancien ministre militant suite au blocage d’une loi luttant contre la corruption montre la difficulté de l’abolition de ce système bien ancré dans la tradition et présent à grande échelle.
Des obstacles institutionnels
Un point majeur concerne la complexité du territoire indien. En effet, l’Inde est une fédération composée de 29 états, 7 territoires, plus de 200 ethnies et l’on y recense plus de 1600 langues. C’est donc un pays très hétérogène présentant de nombreux clivages. Cela donne souvent lieu à des différends et des obstacles entre les provinces ou les différentes populations, notamment concernant la gestion de l’eau. Il existe effectivement des cas de détournement de rivières, et des conflits entre les provinces en amont et en aval des cours d’eau.
L’hétérogénéité de l’Inde fait face également à des obstacles dans l’application de sa politique. Le pays a prouvé à de nombreuses reprises sa volonté de mettre en œuvre de nombreux programmes liés au développement durable. Cependant, leur concrétisation est remise en question par la complexité de l’organisation institutionnelle du pays. Les politiques énergétiques relèvent de l’échelle centrale de façon globale, mais chaque État possède un cadre juridique et réglementaire spécifique et chacun doit approuver l’application de la politique. Le principal obstacle est le manque de coordination entre les États et les divergences des priorités selon les régions. Cela bloque souvent les décisions, d’autant plus que la coopération n’est pas toujours présente. Il faut ajouter à cela la faiblesse des infrastructures pour accompagner l’implémentation des projets, ainsi que le manque de sécurité existant dans certaines régions.
Des spécificités culturelles
Pour faire affaire en Inde, les entrepreneurs doivent intégrer les spécificités culturelles et comportementales de leurs partenaires dans leur style managérial. Ainsi, le rapport au temps en Inde est différent de l’Occident : lors de rendez-vous, les retards sont fréquents, mais considérés comme normaux. Les Indiens sont également réticents à refuser quelque chose, même si la requête leur est impossible à satisfaire. L’investisseur occidental devra également adapter son management en fonction des habitudes religieuses, de la vision de la hiérarchie et des castes, des habitudes de travail basées sur la collaboration…
Pour conclure, l’Inde présente donc des opportunités dans le secteur des énergies renouvelables. Malgré cela, il s’agit d’un environnement dans lequel il est ardu de faire des affaires sans en maîtriser les subtilités et les risques. Une entreprise étrangère seule évolue difficilement et risque de rencontrer certains écueils.
3.2 Analysedumarchédel’hydroélectricitéenInde
En ce qui concerne le déficit énergétique actuel et les enjeux environnementaux en Inde, la voix de l’hydroélectricité à petite échelle se manifeste aujourd’hui comme une alternative réelle pour garantir une indépendance énergétique propre, renouvelable et durable. Si cette alternative offre plusieurs opportunités aux entreprises québécoises agissant dans le marché des industries vertes (une très grande demande, des programmes d’accompagnement gouvernementaux, des coûts d’investissement abordables et surtout des marges confortables), il n’en reste pas moins que le poids des états indiens sur ce secteur ne tarde pas à se faire sentir.

Unmarchéprometteur,maisinexploité
En Inde, sont considérés comme des projets d’hydroélectricité à petite échelle (Small Hydro Projects, SMH) tous les projets hydroélectriques dont la capacité est située entre 2 et 25 Mw. Estimé, selon le ministère des énergies renouvelables indien, à 20 000 Mw sur 6 474 sites éparpillés sur les différents États du pays, le potentiel des SMHs est loin d’être pleinement exploité. En effet, seuls 3 800 Mw sont produits sur uniquement 997 sites, ceci équivaut à 20 % de la capacité globale potentielle. Il en découle que ce marché reste quasiment inexploité.
Dans ce secteur, notons aussi qu’il y a des États indiens plus aptes que d’autres à accueillir ce type de projets, car les barrages ont été pendant longtemps synonymes de délocalisation des populations et de maladies endémiques.
Himachal Pradesh, par exemple, représente un État très enclin à accueillir des projets d’hydroélectricité à petite échelle. En effet, il dispose d’un potentiel hydroélectrique énorme (2 397 Mw). Il a également accueilli deux grands barrages (Pandoh et Karcham Wangtoo). Ceci reflète une opinion favorable de sa population sur ce type de projets, contrairement aux cultures répandues dans plusieurs États et qui ont été à l’origine de plusieurs blocages, tel est le cas de l’État Uttarakand, avec son énorme barrage Tehri dam, dont la construction est toujours inachevée depuis 1978.
Analysestratégiquedeladynamiquedumarchédel’hydroélectricité
Indispensable pour analyser toute industrie, l’étude des cinq forces de Michael Porter permet d’avoir une vue d’ensemble sur la dynamique du marché de l’hydroélectricité. Ainsi nous allons étudier dans un premier temps les pouvoirs de négociation des clients et des fournisseurs, puis les menaces provenant des nouveaux entrants et des produits de substitution. Finalement, nous nous intéresserons à l’état de la concurrence entre les entreprises du secteur.
Pouvoir de négociation des clients
D’emblée, il faut préciser que le développement de l’hydroélectricité en Inde relève de l’autorité des États et du gouvernement fédéral (Himanshu, S.K., Varun, & Aashish, 2011). La plupart du temps, l’énergie produite est systématiquement rachetée par les États dans lesquels se trouvent les projets. Cependant, elle peut parfois être vendue à d’autres entités si les lois en vigueur dans les États concernés le permettent. Une structure monopsone est donc avérée sur ce marché. Cette structure affère un pouvoir de négociation assez considérable aux clients étant donné leur nombre très réduit.
Parallèlement, ce pouvoir de négociation des États est à relativiser vu l’énormité des besoins énergétiques en Inde qui impliquent, en filigrane, une grande dépendance à l’égard des opérateurs privés pour investir et développer des projets de cette sorte. Ce même pouvoir s’estompe davantage dans les États nordiques vu le taux élevé (90 %) des villages non électrifiés dans cette région.

Pouvoir de négociations des fournisseurs
L’un des avantages des projets hydroélectriques serait certainement leur dépendance aux inputs naturels, et qui sont de facto renouvelables (dans ce cas le débit de l’eau provenant des rivières).
La seule dépendance à l’égard des fournisseurs concerne donc uniquement les équipements et les matériaux de construction ainsi que les services de maintenance et d’ingénierie civile. Ces services ne requièrent pas de licence ou de savoir-faire particulier, d’autant plus que le nombre des fournisseurs sur ces segments reste assez important en Inde (Flovel, ABB, Greenko, HPP, Pentaflo,…). Ainsi, le pouvoir de négociation des fournisseurs reste assez faible, compte tenu des inputs dont dépendent les SHP.
La menace des produits de substitution
L’énergie électrique, étant un produit homogène, ne peut être remplacée directement par d’autres produits. Néanmoins, il est tout à fait plausible que l’apparition de sources d’énergie moins coûteuses vienne concurrencer l’énergie hydroélectrique. Or, sur le moyen terme, l’énergie hydroélectrique reste compétitive sur les plans écologique et financier (ICRA Rating Feature, 2012).
Cela va sans dire que les besoins énergétiques de plus en plus grandissants sont tout à fait capables d’absorber l’offre générée par les progrès technologiques en matière d’énergies renouvelables.
La menace des nouveaux entrants
Étant donné qu’il n’y a pas de sérieuses « barrières à l’entrée » entravant l’accès au marché des SHP en Inde, la menace des nouveaux entrants reste tout de même assez faible. En effet, les montants des investissements dans ces projets sont quasiment identiques pour toutes les entreprises. La structure des dépenses ne peut être réduite, ce qui empêche toutes économies d’échelle et ainsi une baisse des prix. De plus, seuls 20 % du potentiel hydroélectrique en Inde est exploité pour le moment (Ministry of New and Renewable Energy, 2014). Ce marché est donc capable d’absorber de nouveaux offreurs sans avoir de réels impacts sur les marges ou la profitabilité de ces projets.
En ce qui concerne la concurrence entre les entreprises du secteur, la capacité produite et les tarifs de vente aux différents États du géant asiatique, fixés par le « Central Electricity Regulatory Commission » selon la localisation géographique, ne sont pas réductibles (Tagare, 2011). Cela empêche ainsi toute concurrence par les prix qui pourrait impacter éventuellement la profitabilité de ces projets. Ceci étant, la concurrence sur le marché de l’hydroélectricité reste relativement embryonnaire vu l’ampleur du marché potentiel et son degré de fragmentation.

Analysedelastructured’investissementd’unecentralehydroélectriqueàpetiteéchelle
Selon M. Jain Vikram, conférencier et expert du secteur de l’hydroélectricité de petite taille en Inde, le coût final moyen d’une centrale hydroélectrique à petite échelle (avec une puissance de 3 MW et une durée de vie de 35 ans) s’élèverait à 1 900 lakh roupies, c’est-à-dire environ l’équivalent de 3,4 millions $ CA. Il faut noter que le coût relatif à un tel investissement reste très avantageux en Inde par rapport à de nombreux pays. Il serait en effet plus élevé de 112 % au sein des pays de l’Union Européenne, de 79 % en Australie et de 35 % aux États-Unis (S.K., R.P., & C.S., 2010). Analysons à présent la répartition des coûts.
Les coûts des équipements et matériaux accaparent une partie importante du montant total de l’investissement avec une portion de 54 %, suivi du coût des constructions et des études (géologiques et techniques) qui représente quant à lui une part de 34 %. La partie restante du montant de l’investissement sera sous forme de dépenses diverses comme les taxes et les dépenses de fonctionnement (Tagare, 2011).
Il faudrait préciser, par ailleurs, que les projets hydroélectriques à petite échelle ont une double vocation. La première est d’ordre écologique dans la mesure où ceux-ci offrent une source d’énergie renouvelable. La deuxième est d’ordre économique dans le sens où ces mêmes projets à faible coût promettent une rentabilité brute assez importante qui va de l’ordre de 20 % (ICRA Rating Feature, 2012).
Ainsi, bien que les États indiens et le gouvernement fédéral disposent d’un pouvoir non négligeable sur le marché de l’hydroélectricité à petite échelle en Inde, celui-ci demeure un marché très prometteur, car rentable et très peu exploité. Il représente donc, sans nul doute, une opportunité à saisir pour les entreprises hydroélectriques québécoises afin de développer leurs activités et affirmer leur savoir-faire.
3.3 Notrerecommandation:une«joint‐venture»avecunpartenairelocal
Après avoir étudié les différentes possibilités d’implantations en Inde, nous avons conclu que la coentreprise internationale était la stratégie la plus adaptée. En effet, une entreprise québécoise seule ne pourrait pas, ou du moins rencontrerait énormément de difficultés pour s’implanter en Inde malgré la disponibilité du marché pour les projets de mini et micro hydroélectricité. Le gouvernement travaille énormément sur le déploiement des énergies renouvelables en Inde et sur ses stratégies d’appui pour encourager le développement de ces marchés. Cependant, malgré les efforts effectués en la matière, les entreprises de plus petite taille qui souhaitent se concentrer sur des projets hydroélectriques à petite échelle demeurent mises à l’écart et ne peuvent profiter autant de ces avantages que les compagnies multinationales par exemple.
Ainsi, la création d’une coentreprise locale peut permettre à une entreprise québécoise de prendre position sur le marché. Une coentreprise est une collaboration entre des partenaires qui choisissent de faire ensemble. Il s’agit de créer une nouvelle entreprise où chaque partenaire apporte des compétences et des ressources avec des objectifs stratégiques communs. La relation avec le bon partenaire doit se construire sur l’échange de compétences et d’informations. Une coentreprise locale permet ainsi aux partenaires de partager certes les profits, mais aussi et surtout les risques qu’ils soient liés à la concurrence, ou aux investissements apportés par chacun.

Le partenaire local peut également protéger la coentreprise de l’influence du gouvernement indien qui connaît une forte corruption. Lorsqu’une coentreprise est réussie, les partenaires peuvent créer une synergie et une complémentarité de leurs compétences clés voire même, en cas de succès, apprendre des compétences de chacun. En revanche, les partenaires d’une coentreprise doivent prendre conscience qu’ils doivent avoir des objectifs stratégiques communs et des compétences clés complémentaires de façon à pouvoir construire une relation durable et aboutir à la concrétisation du projet. L’entreprise québécoise doit comprendre que malgré les avantages, créer une coentreprise est une stratégie délicate qui a de forts taux d’échecs. De nombreux facteurs sont la cause de ces échecs : style de management et culture différents, relation de confiance non atteinte (incompréhension entre les partenaires, rapports personnels délicats, etc.). Chaque partenaire doit avoir la volonté de s’engager l’un par rapport à l’autre et coopérer. Par ailleurs, l’expérience dans ce type de partenariat permet de limiter certaines des difficultés évoquées ci-dessus. Le choix du bon partenaire est donc un élément indispensable pour favoriser le succès d’une coentreprise.
C’est pour cela qu’une entreprise québécoise qui souhaite développer un projet de micro ou mini hydroélectricité en Inde doit avant tout connaître et s’adapter aux différences culturelles, économiques, politiques et autres auxquelles elle sera confrontée. Elle doit savoir s’entourer d’experts, de partenaires financiers et de conseillers dans la recherche du bon partenaire local. On peut citer à titre d’exemple la CII (Confederation of Indian Industry), cabinet de consultants travaillant en collaboration avec le gouvernement qui s’emploie à promouvoir les partenariats ou à faciliter les investissements. Selon l’étude « CII Godrej Green Business Centre », certains cabinets sont également engagés spécifiquement dans les projets d’hydroélectricité comme Alternate Hydro Energy Centre ou National Hydroelectric Power Corp Ltd.
4 CONCLUSION
On réalise que l’Inde présente de vraies perspectives d’affaires et un réel marché des technologies vertes pour les entreprises québécoises. Au-delà de la lutte contre la pollution, nous avons vu que ces possibilités résidaient également dans la résolution du défi énergétique. De quelle manière les entreprises québécoises peuvent-elles saisir ces opportunités? Concrètement, à travers la mise en place de projets directement situés sur le marché des ressources énergétiques.
Ainsi, au vu des compétences des entreprises québécoises, nous recommandons les projets hydroélectriques de petite taille. En effet, cette option répond d’une part aux besoins en énergie sans polluer davantage, et d’autre part représente une alternative à l’utilisation des énergies fossiles.

5 RÉFÉRENCES
http://mitigationpartnership.net/sites/default/files/india_gpa_fr.pdf http://www.cii.in/Index.aspx Zhan Su, Chapitre : Alliance stratégique internationale et coentreprise internationale. http://www.ecotechquebec.com/technologies-propres/secteurs/energie-renouvelable/ Francoeur, L-G. (2004). Le solaire, énergie méconnue [Electronic version] / Le Devoir. www.volts.ca www.solartgroup.com Francoeur, L-G. (2008) Un chantier éolien de quatre milliards [Electronic version] / Le Devoir. Gagne, J-P. (2011) L’hydroélectricité, clé d’une économie québécoise verte [Electronic version] / Les affaires. http://www.hydroquebec.com/developpementdurable/energieenvironnement/hydroelectricite.htm http://www.hydroquebec.com/publications/fr/rapport_annuel/pdf/rapport-annuel-2011.pdf http://www.oifq.com/pdf/communiques/2012/rapport-oifq_analyse_constats_biomasse_mars_2012.pdf http://www.canbio.ca/events/quebec/presentations/gauthier_f.pdf http://www.mern.gouv.qc.ca/accueil.jsp http://alainjoly1.pagesperso-orange.fr/ecologie12.htm Baudry, C., Mazzorato, S. (2013) L’Inde, l’autre géant asiatique [electronic version]/ Le Monde. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/presentation-de-l-inde/ http://www.statistiques-mondiales.com/inde.htm http://exportateursavertis.ca/la-prochaine-vague-de-croissance-en-inde/ Bouissou, J. (2013). L’Inde est en passe de gagner la bataille démographique [Electronic version] / Le Monde. http://www.oecd.org/fr/eco/48125444.pdf page 13 Bouissou, J. (2012). Près d’un indien sur trois vit sous le seuil de pauvreté [Electronic version] / Le Monde. (2014). L’Inde compte plus de 363 millions de pauvres [Electonic version] / La Tribune AFP. (2012) Moins de pauvres en Inde [Electronic version] / Le Figaro http://ccfd-terresolidaire.org/fdm/2013/277-novembre-2013/inde-une-croissance-4502 http://www.unicef.org/french/infobycountry/india_statistics.html http://www.asiedusud.info/la-deficience-des-infrastructures-plombe-la-croissance-indienne/ AFP. (2013). Inde : 27 milliards dans les infrastructures pour relancer l’économie [Electronic version] / La Presse Farcis, S. (2014). Lutte anti-corruption en Inde : une démission qui fait du bruit [Electronic version] / RFI. Fournier, A. (2013) L’inde connaît sa plus faible croissance depuis 10 ans [Electronic version] / Le Monde. http://omer.sciences-po.fr/?q=ateliers/la-corruption-en-inde-un-mal-li%C3%A9-%C3%A0-la- d%C3%A9mocratisation Belhoste, N. (2014). L’Inde a-t-elle les moyens de ses ambitions ? [Electronic version] / Les Echos. Swan, A. (2014). L’avantage démographique de l’Inde [Electronic version] / Les Echos.

Reuters. (2014). Enquête : ralentissement en Chine et au Japon, accélération en Inde [Electronic version] / Les Echos Bourse http://www.maxisciences.com/pollution/en-inde-la-pollution-urbaine-preoccupe-de-plus-en- plus_art29734.html http://www.cartografareilpresente.org/article108.html http://energie.sia-partners.com/20130408/panorama-du-paysage-energetique-de-linde/ http://www.maxisciences.com/pollution-atmosph%E9rique/l-039-inde-possede-l-039-air-le-plus- pollue- au-monde_art21370.html Bouissou, J. (2014) L’Inde détient le record mondial de décès liés aux maladies respiratoires [Electronic version] / Le Monde. Taillefer, G. (2013). Environnement en Inde – La « croissance verte » à prix abordable ? [Electronic version] / Le Devoir. http://geocarrefour.revues.org/7252 http://eau-fait-en-inde.over-blog.com/article-5263441.html http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8665.html http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Inde http://en.wikipedia.org/wiki/Small_hydro http://blog.enova-tech.net/2011/08/negocier-en-inde-ou-comment-gerer-les-differences-culturelles/ http://www.transparency.org/country#IND Derville, E. (2012). Inde : un nouveau parti qui veut en finir avec la corruption [Electronic version] / La Presse. http://www.credimundi.fr/fr/risques- pays/#focusCountry=IN&focusContinent=&filter=StRating&min=0&max=7&tab=0 http://mitigationpartnership.net/sites/default/files/india_gpa_fr.pdf http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/conformer/accords-commerciaux/page/accords- commerciaux14719/ Himanshu, N., S.K., S., Varun, & Aashish, S. (2011). Small hydropower for sustainable energy development in India. Energy for Sustainable Development, pp. 2021-2027. ICRA Rating Feature. (2012, May). Steady growth in small hydro power; however significant challenges remain... Ministry of New and Renewable Energy. (2014). State wise numbers and aggregate capacity of SHP projects (upto 25 mw). S.K., S., R.P., S., & C.S., R. (2010). Analysis for cost estimation of low head run-of-river small hydropower schemes. Energy for Sustainable Development, pp. 117–126. Tagare, D. M. ( 2011). Electric Power Generation: The Changing Dimensions. Wiley. Vikram, J. (2014, March). Small Hydro Power in India.

LES SOMMETS ET LES TRAITÉS INTERNATIONAUX SUR L’ENVIRONNEMENT : BILAN ET DÉFIS
Guillaume Bourdeau, [email protected] Adama Diallo, [email protected]
Marie-Pier Morin, [email protected] Sara Bennis Nechba, [email protected]
Romuald Somda, [email protected]
Résumé
Depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm en 1972, mais plus particulièrement depuis la mise en place de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en 1992, on dénote une volonté grandissante de la part des États d’inscrire la question environnementale à l’agenda international. Or, malgré la mise en place du Protocole de Kyoto en 1997, ces négociations sont aujourd’hui dans une impasse. Aucun plan clair n’a été formulé pour l’avenir depuis l’échec des négociations à Copenhague en 2009. Toutefois, une lueur d’espoir persiste pour Paris en 2015. Dans cette optique, ce papier dresse un bilan des divers traités environnementaux d’importance puis en analyse quelqu’un plus en profondeur. En s’attardant d’abord à la CCNUCC, à Kyoto et à Marrakech, il fait ressortir les points positifs ayant permis au Protocole de Kyoto de s’imposer comme le premier document juridique international reconnaissant le besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de retourner à un niveau de pollution antérieur à son application. Par la suite, il s’attarde aux discussions entamées entre 2005 et 2014 et constate l’échec du processus de renouvellement d’un tel traité. En relevant les divers échecs et en les comparant avec les succès passés, il est alors possible de faire diverses recommandations sur l’orientation que devraient prendre les discussions à Paris et les perspectives à venir. Celles-ci mettent en lumière le rôle important que pourraient et devraient jouer les entreprises, étant les principales sources d’émissions au sein des États.
L’environnement représente une problématique de plus en plus importante au niveau international. C’est dans ce contexte que le Colloque : « Économie circulaire : Nouvel avantage concurrentiel pour le développement économique et des régions » fut mis en place le 24 et 25 novembre 2014 à l’Université Laval. Le point principal lorsque l’on aborde l’économie circulaire est la relation directe entre le facteur économique et le facteur écologique. Il faut dorénavant s’attarder aux questions de développement durable, et plus globalement, d’économie durable. Cette première publication aborde donc, afin de permettre une entrée en la matière, les bilans et les défis des différents sommets et traités internationaux portant sur l’environnement. Dans un premier temps, une recension non exhaustive des traités importants, portant sur les questions environnementales, sera faite. En deuxième partie, certains traités seront étudiés plus en détail tels que la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) ainsi que le Protocole de Kyoto. Cet exercice permettra, dans un troisième temps, de faire un bilan global de la situation internationale actuelle sur l’environnement, puis de mettre en lumière les défis futurs. Ainsi, dans une optique de nouveaux défis écologiques et éthiques dans le commerce international, il sera plus aisé de comprendre les mécanismes juridiques mis en place par les États afin de réduire l’impact de ceux-ci sur l’environnement. Toutefois, les dialogues multilatéraux se révèlent souvent très complexes et peu enclins à fournir des résultats appréciables et c’est pourquoi des recommandations seront mises de l’avant. Dans le but principalement d’établir des objectifs réalistes pour le Sommet de Paris en 2015, les principaux défis pour les États seront exposés. Cela permettra finalement d’obtenir un regard nouveau sur la relation entre les contraintes environnementales sur les États et le rapport à l’environnement des entreprises au sein de leurs territoires.

CONTEXTUALISATION
Constat et perspectives sur l’environnement et les changements climatiques
La question des changements climatiques est aujourd’hui préoccupante pour les États et les populations qui y vivent. En effet, dans un rapport publié en 2013, le GIEC (Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat) démontre que le réchauffement moyen de la température terrestre a été de 0,9 °C pendant la période 1880-2012, que la banquise arctique s’est réduite d’environ 4 % par décennie depuis les années 1970, que l’augmentation du niveau de la mer est évaluée à 3 mm par année et que la concentration des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère dépasse de 150 % les niveaux préindustrielsi. En considérant que ces données alarmantes sont dues aux conséquences des activités humaines pour plus de 50 % (dont deux tiers de la hausse moyenne de la température)ii, il faut prendre les mesures nécessaires dès maintenant pour éviter les pires scénarios. Ceux-ci pourraient aller jusqu’à 0,7 °C d’augmentation de la température moyenne entre 2016 et 2035 avec une augmentation totale de 4,8 °C d’ici 2100. Certaines régions pourraient même voir une hausse de la température moyenne de 11 °C et 50 % de précipitations supplémentaires. Le niveau de la mer pourrait, lui, atteindre jusqu’à 1 mètre 20 supplémentaireiii! Le GIEC constate donc finalement que : « Une grande partie du réchauffement climatique d’origine anthropique lié aux émissions de CO2 est irréversible sur des périodes de plusieurs siècles à plusieurs millénaires, sauf dans le cas d’une élimination nette considérable de CO2 atmosphérique sur une longue période »iv. Cela laisse peu de marge de manœuvre et met bien l’emphase sur la nécessité d’une action rapide et concertée au niveau mondial. À cet effet, la première étape consiste à recenser les traités internationaux existants.
Recensement non-exhaustif des traités internationaux environnementaux
Une étude portant sur les bilans internationaux nécessite une mise en contexte historique des divers traités et conventions existantes sur le plan international. Toutefois, puisque dans le contexte de l’économie circulaire, ils ne se révèlent pas tous pertinents, une sélection non exhaustive est présentée dans l’analyse suivante. Ceux ainsi représentés mettent de l’avant divers domaines environnementaux et permettent de démontrer les principaux enjeux sur lesquels se sont concentrés les États.
Dans un premier temps, il est important de s’attarder à la période qui débute après la Deuxième Guerre mondiale avec la formation de l’ONU, plateforme multilatérale pour la collaboration entre États, jusqu’à la mise en place de la CCNUCC. Pendant cette période, on constate de prime abord que les traités mis en place jusqu’en 1972 n’étaient pas d’une grande importance au niveau environnemental, si ce n’est que pour la mise en place de système d’échanges d’information ou d’institutionnalisation de mécanismes. Même la Convention civile relative à l’aviation internationale (dite Convention de Chicago) de 1947 n’intégrera son annexe sur la pollution sonore et atmosphérique que dans les années 1970v. Toutefois, avec le premier Sommet de la terre en 1972, une première prise de conscience internationale de l’environnement est affirmée par les Étatsvi. Par la suite, les traités aborderont dorénavant ces questions de façon plus directe en visant entre autres les activités commerciales et industrielles. Pensons à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1975, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance de 1983 ou la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone pour

ne nommer que celles-làvii. Malgré tout, ces actions ne seront pas suffisantes et c’est en 1992 au Sommet de la terre de Rio que la prochaine étape sera mise de l’avant. Elle sera concrétisée avec la création de la CCNUCCviii. Pendant les années suivantes, les États travailleront de concert jusqu’à l’aboutissement du Protocole de Kyoto en 2005ix, marquant leurs intérêts communs pour la lutte aux changements climatiques. Durant ces années, il est possible de voir que les enjeux transfrontières et territoriaux sont de plus en plus mis de l’avant. On assiste, entre autres, à la création de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1994, à la création de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels en 1998 et à la création de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) en 2004.x Les problèmes abordés sont donc de plus en plus internationaux. Au niveau multilatéral cependant, deux accords en particulier nous semblent fondamentaux pour la mise en relation entre l’économie et l’écologie : la CCNUCC et le Protocole de Kyoto. Ceux-ci exercent dorénavant plus de pression sur les États et sur le contrôle de leurs niveaux de pollution. Ainsi, la relation entre les États et leurs entreprises, principales sources de polluants, nécessitera de nouveaux mécanismes afin que les États puissent respecter leurs objectifs. Afin de bien comprendre les enjeux de ces deux traités, ils seront étudiés plus en profondeur dans la section suivante.
1 ÉVALUATIONDESSOMMETSETCONVENTIONSSURLECLIMAT
1.1 Sommetdelaterre
Afin de réduire les effets néfastes des changements climatiques, la communauté internationale s’est mobilisée pour discuter des solutions possibles. Nous considérons les Sommets de la terre, dont le premier a eu lieu à Stockholm en 1972, comme point de départ de cette mobilisation. Ce sont des rencontres multilatérales organisées par les Nations Unies tous les dix ans. Dès ce premier sommet, les grandes questions problématiques de l’environnement étaient abordées telles que la pollution, les changements climatiques, l'amincissement de la couche d'ozone, etc.xi Il est déjà reconnu à cette époque que les problèmes environnementaux sont sans frontières et qu’ils affectent tous êtres humains de la planète. Il faut donc agir ensemble. Des conséquences néfastes détériorent les bases économiques des États plus démunies, ce qui entraîne des tensions entre les populations du globe.xii C’est vingt ans plus tard, en 1992, que l’on fit certains constats. Premièrement, la réduction des GES était primordiale. La solution pour y parvenir mène au deuxième constat, soit le lien qu’il existe entre l’écologie et l’économie. Les États s’aperçoivent que sans changement des activités humaines, la réduction des GES ne se produirait pas. Dernière constatation, les États désiraient négocier sur une base plus fréquente que ne le permettaient les Sommets de la terre. C’est au cours de l’un des plus grands sommets jusqu’à ce jour, le Sommet de Rio, qu’une réponse à ce dernier constat a été mise en place.
SommetdelaterredeRioJaneiro1992
Ce sommet a un grand impact encore à ce jour sur la question des changements climatiques. Ce fut à ce moment que la CCNUCC a été négociée. 178 états étaient présentsxiii. L’importance en nombre des parties était l’un des premiers défis de la convention. Il fallait réussir à plaire à tous. On a réalisé que sans changements des facteurs socio-économiques, la situation de l’environnement ne pouvait pas s’améliorer.

Donc pour avoir du succès, il faut avoir des actions dans les deux secteurs puisqu’ils sont interdépendantsxiv. C’est à cet objectif qu’a tenté de répondre la CCNUCC.
Convention‐cadredesNationsUniessurleschangements climatiques
À la suite du Sommet de Rio, la période des signatures est ouverte aux États pour signer la CCNUCC. C’est en 1994 que la convention est entrée en vigueurxv. Elle compte aujourd’hui 195 ratificationsxvi. Elle est donc universelle, mais quel bilan peut-on lui accorder? Une avancée positive est qu’elle met sur pied des rencontres annuelles entre toutes les parties afin de poursuivre les négociations. Ces conférences sont nommées Conference of Parties (COP)xvii. Aussi, la convention demande la participation des États pour réduire les GES. Par contre, côté plus négatif, ce document juridique n’a pas pour but d’établir les actions concrètes que doivent prendre les différentes nations. Il comprend plutôt des obligations générales dans un cadre non bien définixviii. Ce sont davantage les protocoles qui détermineront des objectifs précis comme nous le verrons plus loin. Son objectif principal se trouve à son article II : « stabiliser […] les concentrations de GES dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant… »xix. Par contre, cet objectif est très vague. On parle de « niveau qui empêche toute perturbation », mais il n’est pas précisé ce qu’est ce niveau. Il n’y a pas de délai fixe non plus. D’un autre côté, si la convention avait été trop contraignante, nous serions peut-être encore en train d’attendre le niveau minimal de signature requis pour que la convention entre en vigueurxx.
Autres avancées positives, la convention fait naître deux principes encore importants aujourd’hui. Premièrement, elle crée la notion de développement durable puisqu’elle souhaite : « préserver le système climatique pour les générations présentes et futures »xxi. Celui-ci transparaît dans les articles de la convention. Deuxièmement, elle fait référence au fait qu’il est de la responsabilité de tous les États d’agir pour réduire les GES, mais que chacun possède une implication différente. Elle fait une dichotomie entre la responsabilité des pays du Nord et celle des pays du Sud. Dès le préambule, il est constaté que les pays du Nord sont les grands responsables de la situation actuellexxii. Les pays en développement trouvent injuste le fait que les pays industrialisés ont pu se développer sans se soucier de l’environnement alors qu’on leur demande de le faire. Rappelons que plus de 80 % des pays présents lors des négociations de la convention sont des pays en voie de développementxxiii. Comme les États industrialisés sont reconnus comme étant les grands responsables, on peut déjà penser que les entreprises de ces derniers auront des objectifs plus colossaux à atteindre dans le cadre des futures négociations. En effet, la CCNUCC représente une étape importante dans la détermination de la responsabilité non seulement des États, mais également des entreprises. Perçu comme les principales sources de pollution au sein des États, le traité de la CCNUCC les concerne donc directement. De façon plus concrète, cette convention appelait les États à réglementer le secteur privé et leurs émissions. Il s’agissait de la première fois où les entreprises pouvaient se sentir visées au travers d’un traité international sur l’environnement. À plus ou moins long terme, il devenait évident que les entreprises auraient un rôle à jouer dans la réduction de la pollution au niveau international et c’est dans le traité de Kyoto, en 2005, que ces contraintes deviennent réelles. C’était nécessaire puisqu’entre la CCNUCC et Kyoto, une hausse des GES fut constatée chez la plupart des pays développés qui sont Parties à la conventionxxiv. C’est le cas des États-Unis qui ont vu leur GES augmenté de 11,4 % entre l’entrée en vigueur de la convention et le Protocole de Kyotoxxv.

Ce n’est pas plus positif au niveau mondial puisque les émissions de GES étaient de 39,4 Gt équiv-CO2/an en 1990 pour augmenter à 49 en 2004xxvi. Le fait que les objectifs de la CCNUCC sont très vastes, il est possible de conclure que : « les engagements qu’ont pris les Parties lors de la convention sur les changements climatiques n’ont pas reçu l’attention nécessaire permettant une évolution adéquate de celle-ci »xxvii. Son bilan en est donc assez négatif. Il faut donc attendre le Protocole de Kyoto pour avoir des résultats plus concrets.
ProtocoledeKyoto
Après avoir fait le constat que les attentes face à la CCNUCC n’étaient pas rencontrées, le défi était de trouver une solution. C’est après deux ans et demi de grandes négociations qu’une extension substantielle de la CCNUCC a été adoptée à Kyoto (Japon) en décembre 1997xxviii lors de la COP3. Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 18 novembre 2005xxix et compte aujourd’hui 192 partiesxxx. Il épouse la même vision que la CCNUCC, de même que ses principes et institutions, mais renforce de manière déterminante cette dernière en engageant les Parties à des objectifs individuels, légalement contraignants, de réduction ou de limitation de leurs émissions de GES. Les objectifs globaux du protocole sont de réduire de manière significative les émissions de GES d’au moins 5 % par rapport aux niveaux de 1990 durant la période d’engagement 2008-2012xxxi, mais chaque État possède des objectifs distincts pour y parvenir. La distinction faite au cours des négociations de CCNUCC entre les responsabilités du Nord et du Sud transparaissent également dans le Protocole de Kyoto puisque les pays en développement sont exemptés d’engagements chiffrés afin que leur développement ne soit pas remis en causexxxii. Ceci aura un impact négatif sur le Protocole de Kyoto. Étant un pays en voie de développement, la Chine, deuxième plus grand pollueur à l’époque, a connu une croissance de ses GES de 10,6 % annuellement de 2002-2011xxxiii.
Seules les Parties à la Convention qui sont également devenues Parties au Protocole (par ratification, acceptation, approbation ou accession) sont tenues par les engagements du Protocolexxxiv. Il s’agit là d’une distinction importante. En effet, la création d’un deuxième groupe de discussion, dont son parti uniquement les États membres du Protocole de Kyoto, vient dédoubler les processus de négociations. Puisque tous les membres de la CCNUCC ne sont pas membres de Kyoto, les négociations tenues dans le cadre du Protocole, appelées COP-MOP, deviennent distinctes de celles tenues dans le cadre de la CCNUCC, nommées COP. Par exemple, les États-Unis sont partis aux négociations au niveau du COP, mais non du COP-MOP. Ce dédoublement entraîne alors de sérieux problèmes au niveau des engagements des États et un ralentissement considérable des négociations au niveau international. Il s’agit là d’un problème persistant puisque ces deux voies de négociation sont toujours en parallèle en 2014. Le Canada a ratifié l’accord en décembre 2002, devenant le 99e pays signataire, mais il s’est retiré à la fin 2012xxxv. Donc, à la suite de ce retrait, les entreprises canadiennes ne sont plus tenues aujourd’hui de suivre les résultats des négociations des COP-MOP. Elles ne sont liées qu’aux objectifs, plus modestes, des négociations liées à la CCNUCC.
En 2001, la communauté internationale a prévu la 7e COP qui s’est tenue à la ville rouge Marrakech, et ce, afin de revoir les objectifs fixés par le Protocole de Kyoto qui ne sont toujours pas traduits en résultats concretsxxxvi. Des mécanismes à mettre en place et des règles à tracer ont été à l’ordre du jourxxxvii. La COP7 permet de traduire en textes juridiques toutes les règles nécessaires à la ratification et à la mise en œuvre effective du Protocole.

Afin d’assurer l’efficacité environnementale du protocole, les accords de Marrakech ont défini un régime d’observance, c’est-à-dire un système de contrôle du respect des engagements pris par les pays de l’Annexe 1, qui sera mis en place immédiatement après l’entrée en vigueur du protocolexxxviii. Ils fixent dans l’ordre du jour le traitement de trois mécanismes à mettre en place à savoir le marché du carbone, le Mécanisme de Développement Propre (MDP) et la Mise en Œuvre Conjointe (MOC)xxxix.
Marchéducarbone
Les limites sur les émissions de GES imposées par le Protocole de Kyoto sont une manière d’octroyer une valeur monétaire à l’atmosphère terrestre. Comme mentionné précédemment, « les nations qui ont le plus contribué au réchauffement global en ont en général le plus directement profité. Elles en ont retiré un important bénéfice commercial, atteignant ainsi des niveaux de vie élevés, alors qu’elles n’ont pas été proportionnellement tenues responsables des dommages causés par leurs émissions »xl. Les conséquences des changements climatiques seront perçues, partout sur le globe terrestre. De plus, les effets de ces changements s’empirent pour les pays en voie de développement qui n’ont généré que très peu d’émissionsxli. Le Protocole de Kyoto pose une limite aux grandes économies mondiales sur les unités d’émission. Les pays industrialisés ont une obligation d’attendre leurs objectifs d’émissions. En revanche, on peut s’attendre à ce que certains feront mieux que prévu, en allant en deçà des limites qui leur sont assignéesxlii. L’article 17 du Protocole permet aux entreprises des pays ayant épargné des unités d’émissions, c’est-à-dire des émissions non utilisées, de vendre cet excès aux entreprises ayant dépassé leurs objectifs d’émissions. Ce marché se nomme le marché du carbone, car le CO2 est le GES le plus largement produit et aussi parce que les émissions des autres GES sont enregistrées et comptabilisées en termes d’équivalent carbone. Ce marché est flexible et réaliste. Les pays ne remplissant pas leurs engagements ont la possibilité d’acheter le respect de ceux des autres. Le prix peut en être prohibitif. Plus le coût est élevé, plus ils sentent la pression d’utiliser l’énergie de manière plus efficace, de faire des recherches et promouvoir le développement de sources alternatives d’énergie qui ont peu ou pas d’émissions. La conception d’un marché global où les unités d’émissions sont achetées et vendues semble simple. Par contre, en pratique, le système de marché du carbone dans le cadre du Protocole a été complexe à mettre en place. On ressentait une chute du prix des unités d’émissions, car celles-ci étaient émises en excès aux entreprises ce qui a créé un déséquilibre entre l’offre et la demandexliii. C’est pourquoi des négociations additionnelles ont eu lieu lors des Accords de Marrakech en 2001xliv. Le problème posé est clair. Les émissions réelles des pays annoncées ne peuvent être vérifiées, car il n’y a aucun mécanisme de contrôle contraignant. Des comptes précis sont tenus sur les échanges commerciaux effectués. Par conséquent, un relevé international des transactions a été mis en place pour suivre les registres. Des équipes composées d’experts surveillent le respect des engagementsxlv.
Néanmoins, il est important de souligner qu’un effort a été consenti de la part des États pour développer des marchés du carbone. En effet, huit nouveaux marchés du carbone ont vu le jour en 2013, à savoir : « le Programme de Plafonnement et échange de Californie, Québec Système de plafonnement et d'échange, Systèmes d'échange de quotas d'émission de Kazakhstan et cinq systèmes d'échange de quotas d'émission pilotes chinois (Shenzhen, Shanghai, Pékin, Guangdong et Tianjin) »xlvi.

La création de ces nouveaux marchés a engendré environ 30 milliards de dollars US, permettant à l’UE d’être le premier grand marché du carbone avec 2,084 de mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (MtCO2) et la Chine en deuxième position avec 1,115 MtCO2
xlvii. Le phénomène de taxation du carbone croit aussi depuis 2013. En effet, certains États (Mexique et la France) ont mis en place de nouvelles taxes carbone, par contre, en Amérique du Nord, l'Oregon et Washington voudraient rejoindre la Californie, Québec et la Colombie-Britannique en ajoutant juste des options tarifaires au carbonexlviii.
Mécanismesdedéveloppementpropre
Les pays en voie de développement n’ont pas la contrainte de respecter les limitations d’émissions de GES imposées par le Protocole. Par conséquent, les émissions de ceux-ci sont en croissance, surtout dans le cas des pays à forte démographie tels que la Chine et l’Inde qui connaissent une rapide expansion de leur production industriellexlix. Le Protocole comprend des dispositions pour encourager les réductions dans les pays non tenus par des objectifs précis. Visé par l’article 12 du Protocole, le MDP est un instrument proposé pour soutenir et encourager ces pays en transition. Le MDP propose que les pays industrialisés payent pour des projets qui diminuent ou évitent des émissions dans des nations moins fortunées et, en échange, ils sont récompensés de crédits pouvant être utilisés pour atteindre leurs propres objectifs d’émissions. « Les pays receveurs bénéficient gratuitement de technologies avancées qui permettent à leurs usines ou leurs installations générant de l’électricité d’opérer de manière plus efficace. Tout ceci à bas coût et générant des profits élevés »l. L’atmosphère y est d’autant plus épargnée, car les futures émissions sont plus faibles que prévuli. Il est particulièrement lucratif et offre un degré d’élasticité aux pays développés essayant d'arriver à leurs objectifs. Il peut être plus rentable pour ces pays de faire un travail utile sur le plan environnemental dans les pays en voie de développement que chez eux localement où, la terre, la technologie et le travail sont généralement plus coûteux. Les bénéfices pour le climat restent les mêmeslii. Le MDP est tout aussi intéressant pour les entreprises privées que pour les investisseurs. Le système est censé fonctionner de manière ascendante à commencer par des propositions individuelles jusqu’à l’approbation du donateur et des gouvernements receveurs de l’allocation des crédits d’unités certifiées de réduction d’émissionsliii. Les pays qui bénéficient des crédits pourraient les utiliser pour respecter leurs objectifs d’émissions, les épargner pour un usage futur ou les vendre à d’autres pays industrialisés dans le système du commerce d’émissions du Protocoleliv. Le MDP est bénéfique pour les compagnies ou investisseurs privés, car il leur permet d’engendrer des profits. Les entreprises effectuent le travail utile en se dotant de nouvelles technologies plus vertes, ce qui leur permet de nouvelles ventes d’unités d’émissions. Pour préserver la santé de l’atmosphère, les entreprises devraient du mieux possible réinvestir leurs profits dans des technologies toujours plus utiles et propreslv. Les pays obtiennent des crédits, appelés unités d’absorption, en réduisant leurs émissions de GES par la plantation ou l’extension de forêts. Ils peuvent réaliser des projets d’application conjointe avec d’autres pays développés, mais il est plus avantageux de le faire avec des pays en économies de transition. Ils impliquent le financement d’activités de réduction d’émissions dans les pays en voie de développement et ainsi développent des projets au titre du MDP. Les crédits obtenus de cette manière peuvent être achetés et vendus sur le marché des émissions ou épargnés pour une utilisation futurelvi.

Enfin, le MDP est supervisé par un Conseil Exécutif qui approuve une série de méthodologies pour mettre en place des projets de grande et petite taillelvii. Pour être certifié, un projet doit être approuvé par toutes les parties impliquées, démontrer une aptitude mesurable à long terme de réduction des émissions et promettre que ces réductions soient additionnées à celles déjà produiteslviii.
1.2 Miseenœuvreconjointe
La MOC consiste en l’investissement d’une Partie de l’Annexe I du protocole dans des projets mis en œuvre dans d’autres pays de l’Annexe I. Le but est soit de réduire les émissions de GES dans le pays hôte ou d’augmenter leurs absorptions. Pour chaque tonne de CO2 réduite ou absorbée dans le pays hôte, il la convertit en une unité de réduction des émissions (URE). Cette URE est transférée dans le pays investisseurlix. Le marché international de droits d'émissions est entré en vigueur depuis 2008. Ses règles doivent garantir l'intégrité environnementale du Protocole de Kyoto. Il existe une limite à la participation au commerce d’émissions destinée à contrer le risque de vente excessive des permis d’émissions. Selon l’article 6 du protocole, chaque partie de l’Annexe I a l’obligation de retenir du marché 90 % de sa quantité attribuée, le 10 % restant ainsi que les droits d’émissions acquis par les autres mécanismes peuvent être échangéslx. Le Protocole de Kyoto est novateur dans la mesure où il inclut dorénavant le secteur privé dans la lutte aux changements climatiques. Ses trois mécanismes, le marché du carbone, le MDP et la MOC ont un impact sur les entreprises. Elles ont désormais des quotas à respecter et elles doivent utiliser le marché du carbone afin de se conformer à leurs cibles. Dans le cas du Canada toutefois, son retrait en 2012 signifie que les entreprises canadiennes n’y sont plus soumises. Malgré tout, le Québec a lancé son propre marché du carbone en 2013 puis il l’a lié avec celui de l’État de Californie au début de 2014. Les entreprises québécoises ont donc les moyens afin de réduire leurs émissions et les entreprises plus performantes pourront même trouver une opportunité de vendre des crédits d’émissions qui leur rapporteront un profit substantiel. Elles ont donc intérêt à s’y soumettre rapidement afin de ne pas être prises à la gorge par de nouvelles contraintes qui pourraient émerger dès 2020. Les engagements de Kyoto devaient prendre fin au début de 2013. Un accord international de lutte contre le réchauffement climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009 dans la capitale danoiselxi. Donc, en 2005, Kyoto entre en vigueur l’année même où le processus de négociation pour l’après-Kyoto doit commencer. Malheureusement, on a constaté que le bilan général du protocole est négatif, surtout attribuable au fait que le protocole n’émettait aucun objectif précis pour les pays en voie de développement. Il n’a donc pas résolu la situation du climat tout comme la CCNUCC.
2 L’APRÈS‐KYOTO
À la suite de ces différents constats, il est clair que malgré l’avancement de la question environnementale au plan international, les progrès engendrés par le protocole de Kyoto sont mitigés et insuffisants. Toutefois, les États ont tenté de mettre en place des mécanismes supplémentaires et plus contraignants. Dès 2007, à la conférence de Bali, on parle de mettre en place un plan pour succéder au Protocole de Kyoto pour 2009 à Copenhaguelxii. Or, cela n’a toujours pas abouti. Les difficultés et les défis rencontrés sont exposés ci-dessous.

2.1 ConférencedeBali
En 2007, la COP13 à Bali établie un groupe de discussion (nommé AWG-LCA) qui se fixe deux ans pour atteindre un accord international sur le renouvellement du Protocole de Kyoto pour l’après 2012. Cependant, comme il y a déjà des négociations entreprises dans le cadre du Protocole de Kyoto (entre les membres uniquement, nommées COP-MOP), il y a donc à partir de ce moment un dédoublement du processus de négociation. Toutefois, ce nouveau processus (AWG-LCA) vise surtout à inclure des acteurs non membres du Protocole tel que les États-Unis afin de les réunir au sein d’un même groupe. Ainsi l’objectif est de s’entendre entre les deux groupes afin de les rassembler dans un seul et même groupe d’État négociant. L’aboutissement de ce processus est établi pour 2009, à Copenhaguelxiii.
2.2 ConférencedeCopenhague
La COP15, à Copenhague en 2009, a regroupé les 193 nations membres, plus d’une soixantaine de chefs d’État, 700 patrons de multinationales et plusieurs institutions internationales et organisations non gouvernementales. Cette conférence tentait de trouver un accord et de nouveaux objectifs pour remplacer Kyoto dès 2013. La finalité était à la fois la quantification de la réduction des GES et l’incitation des pays riches à déployer plus d’efforts pour aider les pays pauvres à faire face aux conséquences du réchauffement climatiquelxiv. À Copenhague, la communauté internationale a également plafonné la barre maximale de température à deux degrés Celsius à horizon 2020lxv. L’accord conclu à Copenhague demeure mitigé dans la mesure où les objectifs fixés par les pays industrialisés n’étaient pas très ambitieux. En effet, Copenhague n’aboutit à aucun engagement commun chiffré sur les réductions des GES et les États n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur des mécanismes de contrôle efficaces. Selon une analyse de CCNUCC « les engagements de réductions d'émission actuels sont insuffisants et mèneront vers un réchauffement climatique d'au moins 3 degrés »lxvi. Copenhague est un échec pour la feuille de route conclue à Bali. Rappelons qu'en 2007, les États s'étaient mis d'accord pour négocier pendant deux ans puis conclure à Copenhague un nouveau protocole devant entrer en vigueur après l'expiration en 2012 du Protocole de Kyotolxvii. La seule réelle avancée concerne l’aide financière aux pays démunis pour l’adaptabilité au changement climatique qui devrait atteindre 100 milliards de dollars par an en 2020lxviii. Par contre, les COP et COP-MOP n’ont pas réussi à s’entendre sur des objectifs communs ce qui prolonge le dédoublement des négociations.
Les enjeux de ce sommet n’étaient pas les mêmes pour tous les pays. Les pays en développement souhaitaient maintenir l’architecture binaire de Kyoto. En 2009, les pays émergents ne souhaitaient toujours pas avoir d’objectifs contraignants pour eux-mêmes avant 2020. Ces derniers demandaient en revanche des réductions de pollution comprises entre 25 et 40 % pour les pays industrialisés en raison de leur responsabilité historique dans l’augmentation des émissions de GES. La formule des quotas généralisés ne leur paraît pas intéressantelxix.
À la suite de cette conférence, le processus semblait bloqué et, malgré quelques avancées, ce n’est qu’en 2014 qu’une lueur d’espoir émerge du processus de négociation de l’après-Kyoto.

3 STATUTACTUELETPERSPECTIVEFUTURE
3.1 ConférencedeNewYork
Le nombre de conventions et de sommets sur le climat s’amplifie, mais les engagements déchus semblent prépondérants. Des solutions partagées et promesses respectées par tous les acteurs mondiaux paraissent trop complexes à atteindre. Finalement, un pessimiste s’installe petit à petit chez les populations qui subissent l’ardeur des conséquences du réchauffement climatique. Depuis la conférence de Copenhague en 2009, les essais avortent l’un après l’autre pendant que le rechaussement continue sa course en ayant des conséquences néfastes dans toutes les régions du monde. Devant l’énormité des enjeux, le Secrétaire général des Nations-Unies, Ban Ki-Moon, a pris l’initiative d’alerter tous les acteurs qui sont liés à ce phénomène. Cette rencontre fut soldée par la présence de 120 chefs d’États et chefs de gouvernements, plus de 800 personnes de la communauté des affaires, une coalition de régions et villes et des sociétés civileslxx. C’est ainsi que la COP20 s’est tenue à New York le 23 septembre 2014. L’objectif principal de cette conférence était de mesurer le « pouls » des politiques afin de sonder leurs engagements à donner un nouvel élan à la lutte contre les changements climatiques. Pour galvaniser les participants, Ban Ki-Moon rappela que chaque génération a sa mission et, libre à elle seule de l’accomplir ou de la trahir. Pour éviter d’être coupable devant l’histoire, il faudrait que chacun, dans son domaine, essaie de lutter contre ce phénomène. Alors, il leur a été demandé d’y annoncer des mesures audacieuses visant à réduire les émissions, à renforcer la résistance aux changements climatiques et à mobiliser les volontés politiques en vue de parvenir à un accord juridique significatif lors de la prochaine conférencelxxi. Au cours de cette rencontre, la tendance semblait avoir pris une orientation positive, les acteurs ont démontré une grande détermination. Les principaux pollueurs ont marqué leur présence par des positions claires qui laissent espérer qu’ils ne réitéreront pas Copenhague. Les dirigeants d’entreprises ont aussi été conviés à ce sommet et ont pris également des dispositions. Le secrétaire général de l’ONU est convaincu que leur implication dans la « décarbonisation » de l’économie est indispensable. Ban Ki Moon reste persuadé que leur complicité ne ferait que faciliter la mission aux gouvernements. Ils ont aussi annoncé leurs engagements en faveur d’initiatives qui contribueront à réduire les émissions de GES et à renforcer la résilience face aux changements climatiques. On a noté la participation de grands magnats de l’industrie tels qu’Apple, EDF, Ikea, Nestlé, etc. Toutefois, il est prudent de rester mesuré dans notre optimisme. Jusque-là, les promesses sont la base de tout notre espoir.
3.2 ConférencedeParis,2015:commentdébloquerleprocessus?
La prochaine étape sera la COP21 à Paris en 2015. Il est important que nous sortions de l’immobilisme qui est présent depuis plusieurs années. Il doit se passer quelque chose à Paris l’an prochain et cette action doit affecter tous les États. Donc ce doit être au niveau universel. Le dédoublement des négociations actuel entre les COP et les COP-MOP doit être éliminé. C’est ce qui a été discuté à la COP17 à Durban, en novembre 2011. Durant cette conférence, les 183 pays représentés se sont accordés sur plusieurs décisions, dont la création de la plate-forme de Durban pour une action renforcée qui est très importante pour les négociations sur le climat. Elle marque le commencement d’actions combinées entre les COP et les COP-MOP à caractère contraignant. Cette plateforme a pour mission de mettre sur pied un « protocole, d’un autre instrument juridique ou d’un texte convenu d’un commun accord ayant valeur juridique »lxxii.

Cet accord devrait être adopté en 2015 et son entrée est fixée pour 2020. Cette décision à caractère juridique est pleine d’ambitions. Dans sa mise en œuvre, elle stipule une obligation de la part de tous les potentiels pollueurs de réduire leurs émissions de GES. Les pays développés et en développement seront tous contraints de se filer à cette disposition à partir de 2020. La particularité de cette plate-forme se manifeste dans sa volonté d’aller au-delà du concept d’action volontaire pour se lancer vers le cadre juridique s’appliquant à tous les pays.
Pour ce qui est de trouver une solution au problème du marché du carbone mis en place par Kyoto, il est recommandé aux États de créer, dans un premier temps, des mécanismes d’uniformisation régionaux des normes d’émission. Cette standardisation permettrait aux États de se mettre en groupe pour adopter les mêmes normes et cela va faciliter l’achat et la vente d’unités d’émissions non utilisées par les entreprises. Ce système sera moins complexe à gérer. Dans un deuxième temps, lorsque ces ententes régionales seront uniformisées, il sera possible de les fusionner pour les intégrer dans un marché à vocation globale. Des questions clés sont encore sans réponse sur la contribution de chaque pays à l’effort mondial pour se détourner des énergies fossiles et bâtir des économies moins énergivores. L’éradication de l’utilisation des ressources non renouvelables, comme le pétrole et le nucléaire, soulève des questions stratégiques qui peuvent bouleverser le système économique de plusieurs pays. Par exemple, pour la baisse des émissions de GES, quelle année de référence doit être prise en compte? Comment gérer l’intermittence entre ressources non renouvelables et renouvelables? Les gouvernements pourront-ils motiver les agents économiques à réorienter leurs politiques? La réponse à ces questions est complexe. Les États ont tous leurs contraintes par rapport à leur situation. L’Inde et la Chine ont leurs priorités liées à leur croissance économique, aux États-Unis, le manque de consensus politique au sein même de l’État rend difficile l’engagement concret. Pour avoir l’accord de tous, la solution sera peut-être de laisser chaque État trouver son niveau de réduction à atteindre tout en essayant d’impliquer au maximum les entrepriseslxxiii.
Celles-ci ont une grande influence dans le débat. Elles ont une responsabilité sociale et elles n’ont pas à attendre une décision étatique pour agir. Elles doivent s’engager et en faire la promotion à leurs clients. Les consommateurs sont de plus en plus concernés par les décisions des entreprises et ils privilégient ainsi certains biens et services en fonction du degré de responsabilité respecté par l’entreprise. Chaque entreprise doit consigner un plan d’action qui recense ses efforts accomplis. Cela leur permettra, le temps venu, de démontrer qu’elles ont déjà entamé les réductions qui leur seront demandées dans le futurlxxiv.
4 CONCLUSION
Après avoir étudié et fait un bilan des divers sommets et traités internationaux sur l’environnement, il nous apparaît évident, au vu des recommandations faites précédemment, que les entreprises auront un rôle à jouer au cours des années à venir. La lutte aux changements climatiques devra passer par la conscientisation et la responsabilisation des entreprises. Celles-ci doivent se rendre compte des conséquences engendrées et de leurs responsabilités futures si des mesures sont mises en place. À cet égard, ils devraient chercher à réduire dès maintenant leurs impacts sur l’environnement. Elles doivent cesser de réfléchir en termes de ressources sur le court terme comme l’exploitation et l’utilisation des gaz de schistes à bas prix et se concentrer sur d’autres investissements.

En effet, les entreprises qui seront gagnantes sur le long terme sont, selon cette étude, celles qui sauront investir dans les technologies vertes au point de réduire leurs émissions et de développer des capacités techniques dans le domaine des énergies propres. Cela leur rapportera des bénéfices considérables au niveau de la réputation de l’entreprise ainsi qu’au niveau des opportunités. Elle sera en mesure de vendre non seulement sa technologie et son expertise, mais également ses quotas d’émission dont elle ne se servira pas. Ainsi, les premières devraient pouvoir suffisamment se financer pour rentabiliser leurs investissements. Pour elles, il s’agira d’une situation « gagnant-gagnant ». Toutefois, afin de ne pas amorcer ce processus sans en retirer de bénéfices, celles-ci devront mettre sur un pied un registre des actions réalisées afin que, advenant une demande contraignante de la part d’un État, cette entreprise soit en mesure de démontrer qu’elle a déjà réalisé l’objectif, plutôt que d’être forcé de réduire de nouveau ses émissions (ce qui pourrait s’avérer impossible dans certains cas). Par de telles démarches, les entreprises respecteraient leurs responsabilités sociales.
De telles démarches de la part des entreprises sont nécessaires. Les diverses négociations internationales ont prouvé que les États ne sont peut-être pas les meilleurs acteurs lorsque vient le temps de s’attaquer aux problèmes environnementaux. En effet, même si ceux-ci abritent les entreprises, ce sont ces dernières qui constituent la principale source de pollution des États. Il est d’ailleurs pertinent de rappeler qu’en droit international, aucune instance supérieure ne peut forcer un État à respecter ses engagements. Dans un tel contexte, il est peu probable que les cibles en place soient respectées par tous. Or, si certains États imposent des contraintes sur leurs entreprises afin de respecter leurs cibles alors que d’autres ne le font pas, les progrès réalisés resteront marginaux. Cela confirme que les entreprises ne doivent pas attendre les décisions internationales et commencer dès maintenant leurs mises en œuvre des processus permettant, à terme, de mettre en place une économie circulaire ou l’économie et l’écologie s’entrecroisent. D’un autre côté, les entreprises qui attendront les décisions internationales pourront se voir imposer subitement des cibles drastiques, ce qui pourrait être fortement nuisible à leur croissance, voir à leur survie. La CO21 à Paris en 2015 laisse d’ailleurs présagé un accord international sur la question environnementale fixant des objectifs pour 2020. i GIEC, « Changements climatiques 2013 : les éléments scientifiques », Résumé à l’intention des
décideurs, Résumé technique et Foire aux questions, Groupe de Travail I, Site officiel du GIEC, [En ligne], 2013, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf, P.5-12, (page consultée le 23 novembre 2014).
ii Ibid., p.17. iii Ibid., p.19-27. iv Ibid., p.28. v France, Diplomatie.(2005). Listes des accords multilatéraux dans le domaine de
l’environnement.Gouvernement de France, [Electronic version] http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ratifications.pdf(consulté le 23 novembre 2014).
vi Gouvernement Français, « 1972-1992. L’Odysée du développement durable », [En ligne], http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/ (page consultée le 9 décembre 2014).

vii France, Diplomatie.(2005). Listes des accords multilatéraux dans le domaine de
l’environnement.Gouvernement de France, [Electronic version] http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ratifications.pdf(consulté le 23 novembre 2014).
viii Gouvernement Français, « 1972-1992. L’Odysée du développement durable », [En ligne], http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/ (page consultée le 9 décembre 2014).
ix France, Diplomatie.(2005). Listes des accords multilatéraux dans le domaine de l’environnement.Gouvernement de France, [Electronic version] /http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ratifications.pdf(consulté le 18 novembre 2014).
x Ibid. xiORGANISATION DES NATIONS UNIES « Sommet de Johannersbourg 2002 », Site officiel
des Nations Unies sur le Sommet de Johannesbourg, [En ligne], 2002, http://www.un.org/french/events/wssd/pages/cnued.html (Consultée le 5 novembre 2014).
xiiIbid. xiiiThireau, Raymonde. (1999). Analyse de la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques : du protocole de Kyoto et des implications des changements climatiques en droit international, Mémoire de maîtrise, Université Laval, 28.
xivORGANISATION DES NATIONS UNIES « Sommet de Johannersbourg 2002 », Site officiel des Nations Unies sur le Sommet de Johannesbourg, [En ligne], 2002, http://www.un.org/french/events/wssd/pages/cnued.html (Consultée le 5 novembre 2014).
xvORGANISATION DES NATIONS UNIES « État des ratifications », United Nations Framework Convention on Climate Change, [En ligne], 2014, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/status_of_ratification/items/3271.php (Consultée le 5 novembre 2014).
xviIbid. xviiFrance, Diplomatie.(2005). Listes des accords multilatéraux dans le domaine de l’environnement.Gouvernement
de France, [Electronic version] /http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ratifications.pdf(consulté le 18 novembre 2014).
xviiiThireau, Raymonde. (1999). Analyse de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques : du protocole de Kyoto et des implications des changements climatiques en droit international, Mémoire de maîtrise, Université Laval, p.47.
xixArticle 2 de la CCNUCC. xxThireau, Raymonde. (1999). Analyse de la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques : du protocole de Kyoto et des implications des changements climatiques en droit international, Mémoire de maîtrise, Université Laval, 61.
xxiPréambule de la CCNUCC. xxiiIbid. xxiiiThireau, Raymonde. (1999). Analyse de la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques : du protocole de Kyoto et des implications des changements climatiques en droit international, Mémoire de maîtrise, Université Laval, 47.
xxiv Ibid., p.84. xxvGREENHOUSE GAS INVENTORY DATA EXPLORER, « U.S. GreenhouseGasemissions
By EconomicSector, 1994-2005 », United States Environmental Protection Agency, [En ligne],

http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/inventoryexplorer/#allsectors/allgas/econsect/all , (Consulté le 1 décembre 2014).
xxvi RAPPORT DE SYNTHÈSE, « Émissions mondiales de gaz à effet de serre anthropiques», Intergovernmental Panel on Climate Change, [En ligne], http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/fr/figure-2-1.html, (Consulté le 1 décembre 2014).
xxvii Ibid., p.84. xxviiiORGANISATION DES NATIONS UNIES, «La Convention-cadre et le Protocole de
Kyoto», Organisation des nations unies, [En ligne], http://www.un.org/fr/climatechange/kyoto.shtml,(Consulté le 13 novembre 2014).
xxix Ibid. xxxUNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Status of Ratification of the
Kyoto Protocol», United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php , (Consulté le 19 novembre 2014).
xxxi Ibid. xxxiiACTU-ENVIRONNEMENT, «Protocole de Kyoto : définition», Dictionnaire environnement, [En ligne], 2014,
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/protocole_de_kyoto.php4, (Consulté le 14 novembre 2014).
xxxiiiJos, G.J., Olivier &Marilena, Muntean. (2013). «Trends in global CO2 emissions: 2013 Report», PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, [En ligne], [http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/pbl-2013-trends-in-global-co2-emissions-2013-report-1148.pdf] p.12.
xxxivUNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Le Protocole de Kyoto », United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/items/3274.php, (Consulté le 13 novembre 2014).
xxxv MCKAY, Scott et CLOUTIER, Alexandre, «Retrait du Canada du Protocole de Kyoto- une réelle menace à la réputation et aux intérêt du Québec», Le devoir, [En ligne], 2012, http://www.ledevoir.com/politique/quebec/341887/retrait-du-canada-du-protocole-de-kyoto-une-reelle-menace-a-la-reputation-et-aux-interets-du-quebec, (Consulté le 13 novembre 2014).
xxxviLUSSIS, Benoit, « Accords de Marrakech et mécanismes de flexibilité », Institut pour un développement durable, [En ligne], 2001, http://users.skynet.be/idd/documents/MDP/MDPn002.pdf (Consultée le 19 novembre 2014).
xxxviiIbid. xxxviii ORGANISATION DES NATIONS UNIES « Convention-Cadre sur les changements
climatiques», Site officiel des Nations Unie sur la conférence des parties sur les travaux de la septième session, tenue à Marrakech, [En ligne], 2002, http://unfccc.int/resource/docs/french/cop7/cp713a02f.pdf (Consultée le 19 novembre 2014).
xxxixIbid. xlUNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Le Commerce d’émissions»,
United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3295.php,
(Consulté le 13 novembre 2014). xliIbid. xliiIbid.

xliii DE LASSUS ST-GENIÈS, Géraud, discussion sur l’historique des changements climatique, Faculté de droit,
Université Laval, 18 novembre 2014. xlivUNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Le Commerce d’émissions»,
United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3295.php, (Consulté le 13 novembre 2014).
xlvIbid. xlviBANQUE MONDIALE, «Le rapport sur l’état et les tendances de la tarification du carbone
en 2014», ECOFYS, 2014, p. 15. xlviiIbid. xlviiiIbid. xlix UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Le mécanisme de
développement propre», United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3297.php, (Consulté le 13 novembre 2014).
lIbid. liIbid. lii Ibid. liiiIbid. livDE LASSUS ST-GENIÈS, Géraud, discussion sur l’historique des changements climatique,
Faculté de droit, Université Laval, 18 novembre 2014. lvUNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Le
mécanisme de développement propre», United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3297.php, (Consulté le 13 novembre 2014).
lviIbid. lviiIbid. lviiiIbid. lixLUSSIS, Benoit, « Accords de Marrakech et mécanismes de flexibilité », Institut pour un
développement durable, [En ligne], 2001, http://users.skynet.be/idd/documents/MDP/MDPn002.pdf (Consultée le 19 novembre 2014).
lxIbid. lxi VERDURA,«Sommet de Copenhague sur le climat » , [En ligne],
http://www.vedura.fr/environnement/climat/sommet-copenhague-changement-climatique, (Consulté le 15 novembre 2014).
lxii UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE,United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/bodies/body/6431.php (Consulté le 16 novembre 2014).
lxiii UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE,United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/bodies/body/6431.php (Consulté le 16 novembre 2014).
lxivLE MONDE DIPLOMATIQUE, «changements climatiques: le grand tournant» ,[En ligne],2009, http://blog.mondediplo.net/2009-12-04-Changements-climatiques-le-grand-tournant (consulté le 15 novembre) .
lxv UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE,United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/bodies/body/6431.php (Consulté le 16 novembre 2014).

lxvinotre-planete.info, « La conférence de Copenhague sur le climat est un échec catastrophique », web de
réinformation en environnement,écologie,nature et sciences de la terre ,[En ligne], 2009, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2220_Copenhague_climat_echec.php (consulté le 15 novembre).
lxviiIbid. lxviii LE MONDE.FR, « Le Fonds vert pour le climat récolte 9,3 milliards de dollars», [En ligne],
2014,http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/20/le-fonds-vert-pour-le-climat-recolte-9-3-milliards-de-dollars_4526723_3244.html , (consulté le 15 novembre).
1 lxixCAIRN.INFO,«L’APRESCOPENHAGUE»,[ENLIGNE],2010HTTP://WWW.CAIRN.INFO/REVUE‐IDEES‐ECONOMIQUES‐ET‐SOCIALES‐2010‐2‐PAGE‐6.HTM(CONSULTÉLE16NOVEMBRE).
lxxLE MONDE.FR, « Le Fonds vert pour le climat récolte 9,3 milliards de dollars», [En ligne], 2014 http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/20/le-fonds-vert-pour-le-climat-recolte-9-3-milliards-de-dollars_4526723_3244.html ,(consulté le 15 novembre).
lxxiOrganisation des Nations-Unis «Sommet 2014 sur le climat », [en ligne], 2014 http://www.un.org/climatechange/summit/fr/ (consulté le 07 novembre 2014).
lxxiii DE LASSUS ST-GENIÈS, Géraud, discussion sur l’historique des changements climatique,
Faculté de droit, Université Laval, 18 novembre 2014. lxxiv HALLEY, Paule, discussion sur les perspectives d’avenir, professeur de la Faculté de droit,
Université Laval, 20 novembre 2014.
5 BIBLIOGRAPHIE
ArticlesInternet
Chad CARPENTER(2012). Point sur la conférence de Durban, [Electronic version] http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/UNDP_DURBAN_FR_22_5.pdf (consulté le 19 novembre 2014).
France, Diplomatie.(2005). Listes des accords multilatéraux dans le domaine de l’environnement.Gouvernement de France, [Electronic version] /http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ratifications.pdf (consulté le 18 novembre 2014).
Demaze, Moïse Tsayem.(2009). Les conventions internationales sur l’environnement : état des ratifications et des engagements des pays développés et des pays en développement.L'espace géographique.[Electronic version] / Université du Maine, volume. 73 (3). 84-99.
Demaze, Moïse Tsayem. (2009). Le protocole de Kyoto, le clivage Nord-Sud et le défi du développement durable», L'espace géographique. [Electronic version] / éditeur Belin, volume. 38. 98. Céline BADA -- Danilo COMBA -- Michel DJIMGOU DJOMENI -- Armelle GOURITIN -- Marion LEMOINE -- Dorothée LOBRY -- Abdoulaye MOUSSA -- Anne RAINAUD., «Sommet de Copenhague, 7-18 Décembre 2009 : Défi climatique ,Défi diplomatique », Dossier Sentinelle.

Banque Mondiale. (2014). Le rapport sur l’état et les tendances de la tarification du carbone en 2014. ECOFYS. p. 135.
Consultation
DE LASSUS ST-GENIÈS, Géraud, discussion sur l’historique des changements climatique, chargé de cours à la Faculté de droit, Université Laval, 18 novembre 2014. HALLEY, Paule, discussion sur les perspectives d’avenir, professeur de la Faculté de droit, Université Laval, 20 novembre 2014.
Conventions
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62221 (F) 180705 260705, (entrée en vigueur le 21 mars 1994) [En ligne], [http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf] (consulté le 5 novembre 2014).
Livres
Thireau, Raymonde. (1999). Analyse de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques : du protocole de Kyoto et des implications des changements climatiques en droit international, Mémoire de maîtrise, Université Laval.P.118.
Rapport
Jos, G.J., Olivier & Marilena, Muntean. (2013). «Trends in global CO2 emissions: 2013 Report», PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, [En ligne], [http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/pbl-2013-trends-in-global-co2-emissions-2013-report-1148.pdf]
SitesInternet
ORGANISATION DES NATIONS UNIES « Sommet de Johannersbourg 2002 », Site officiel des Nations Unies sur le Sommet de Johannesbourg, [En ligne], 2002, http://www.un.org/french/events/wssd/pages/cnued.html (Consultée le 5 novembre 2014).
ORGANISATION DES NATIONS UNIES « État des ratifications », United Nations Framework Convention on Climate Change, [En ligne], 2014, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/status_of_ratification/items/3271.php (Consultée le 5 novembre 2014). ORGANISATION DES NATIONS UNIES, «La Convention-cadre et le Protocole de Kyoto», Organisation des nations unies, [En ligne], http://www.un.org/fr/climatechange/kyoto.shtml, (Consulté le 13 novembre 2014). ACTU-ENVIRONNEMENT, «Protocole de Kyoto : définition», Dictionnaire environnement, [En ligne], 2014, http://www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/protocole_de_kyoto.php4, (Consulté le 14 novembre 2014). MCKAY, Scott et CLOUTIER, Alexandre, «Retrait du Canada du Protocole de Kyoto- une réelle menace à la réputation et aux intérêt du Québec», Le devoir, [En ligne], 2012, http://www.ledevoir.com/politique/quebec/341887/retrait-du-canada-du-protocole-de-kyoto-une-reelle-menace-a-la-reputation-et-aux-interets-du-quebec, (Consulté le 13 novembre 2014). UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Le Protocole de Kyoto », United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/items/3274.php, (Consulté le 13 novembre 2014). UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Le Commerce d’émissions», United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3295.php, (Consulté le 13 novembre 2014).
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Le mécanisme de développement propre», United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3297.php, (Consulté le 13 novembre 2014). ORGANISATION DES NATIONS UNIES «Sommet 2014 sur le climat », United Nations,[en ligne], 2014, http://www.un.org/climatechange/summit/fr/, (consulté le 07 novembre 2014) CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, « Sommet du Copenhague sur le climat », vedura.fr, [en ligne], 2014,http://www.vedura.fr/environnement/climat/sommet-copenhague-changement-climatique,(consulté le 07 novembre 2014) BÉGIN, Martin, «Obama veut un accord ambitieux sur les changements climatiques », radio-canada, [en ligne], 2014 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/23/001-sommet-onu-climat.shtml,(consulté le 07 novembre 2014) LEMONDE, « Climat : un accord européen exemplaire ? », Touteleurope.eu, [En ligne], 2014, http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-climat-un-accord-europeen-exemplaire.html,(consulté 10 novembre 2014) THE ROCKEFELLER FOUNDATION, «Climate Change Resilience », [En ligne], 2014 http://www.rockefellerfoundation.org/ (consulté le 07 novembre 2014) GOUVERNEMENT FRANÇAIS, « LISTE DES ACCORDS MULTILATERAUX DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT », Janvier 2005, [En ligne], http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ratifications.pdf, (page consultée le 17 novembre 2014)

NATIONS UNIES, « Collection des traités », [En ligne], https://treaties.un.org/Home.aspx?lang=fr , (page consultée le 17 novembre 2014) VERDURA, «Sommet de Copenhague sur le climat», United Nations, [En ligne], http://www.vedura.fr/environnement/climat/sommet-copenhague-changement-climatique , (Consulté le 15 novembre 2014). LE MONDE DIPLOMATIQUE, «Le changement climatique :le grand tournant », [En ligne], http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3295.php , (Consulté le 15 novembre 2014). ACTU-ENVIRONNEMENT , «Les enjeux de l’adaptation à Copenhague», [En ligne], http://www.actu-environnement.com/ae/news/conference_climat_enjeu_adaptation_9094.php4 , (Consulté le 15 novembre 2014). L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE (ADEME), «Le changement climatique : les conférences mondiales pour le climat», ta M Terre, [En ligne], http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/474/Les-conferences-mondiales-sur-le-climat , (Consulté le 15 novembre 2014). CONSOGLOBE , «quels sont les objectifs et les enjeux du sommet de Copenhague sur le climat? Comment essayer d’influencer le résultat des négociations», Consommation Durable, [En ligne], http://www.consommerdurable.com/2009/09/quel-sont-les-objectifs-et-les-enjeux-du-sommet-de-copenhague-sur-le-climat-comment-essayer-dinfluencer-le-resultats-des-negociations/ , (Consulté le 15 novembre 2014). UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, «Status of Ratification of the Kyoto Protocol», United Nations, [En ligne], http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php , (Consulté le 19 novembre 2014). GREENHOUSE GAS INVENTORY DATA EXPLORER, « U.S. Greenhouse Gas emissions By Economic Sector, 1994-2005 », United States Environmental Protection Agency, [En ligne], http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/inventoryexplorer/#allsectors/allgas/econsect/all, (Consulté le 1 décembre 2014). RAPPORT DE SYNTHÈSE, « Émissions mondiales de gaz à effet de serre anthropiques», Intergovernmental Panel on Climate Change, [En ligne], http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/fr/figure-2-1.html, (Consulté le 1 décembre 2014). GIEC, « Changements climatiques 2013 : les éléments scientifiques », Résumé à l’intention des décideurs, Résumé technique et Foire aux questions, Groupe de Travail I, Site officiel du GIEC, [En ligne], 2013, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf, P.5-12, (page consultée le 23 novembre 2014).

GOUVERNEMENT FRANÇAIS, « 1972-1992. L’Odysée du développement durable », [En ligne], http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/ (page consultée le 9 décembre 2014).