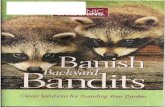Bandits a Pondichery 1730 in French
-
Upload
sandeep-badoni -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Bandits a Pondichery 1730 in French
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
1/14
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
2/14
NAION E POLIIQUES DE LA FAMILLE
2
de « crimes » les dés à l’ordre établi 4. Une seconde conception, quelquepeu différente de celle de Hobsbawm, cadre mieux avec l’Inde du sud :elle considère que les bandits et l’État (ou plus particulièrement les rois) sesituent les uns par rapport aux autres non pas simplement en opposition,mais dans un continuum. Un « bandit » est souvent un homme qui n’estpas encore devenu roi, ou qui n’atteindra peut-être jamais tout à fait cestatut. Des bandits, dans l’Inde du sud des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, sontfréquemment des hommes issus des basses castes qui imposent leur protec-tion (en tamoul : kāval ) à des communautés sédentaires et leurs villages.Si leurs efforts sont couronnés de succès, ils parviennent à accumuler assezd’argent et de partisans pour s’établir dans un fort, voire dans un petitroyaume. La gure du bandit est donc complexe, et là aussi elle est associéeà des ballades, des récits épiques transmis oralement, et à toute une séried’autres genres littéraires ou semi-littéraires. On notera que ces productionsmettent souvent l’accent sur le processus inverse, à savoir le roi exilé oule prétendant malheureux au trône qui prend le maquis et reçoit le titrepopulaire semi-ironique de « roi des forêts » (kāttu rājā).
Des gures aussi ambiguës surgissent encore parfois dans l’Inde de ladécolonisation. Citons le cas célèbre de Koose Munniswamy Veerappan(env. 1952-2004), un braconnier et contrebandier de bois de santal quia sévi pendant de longues décennies dans les vastes zones de collines etforêts des états du amilnadu, du Kerala et du Karnataka en Inde du sud,avant d’être tué par la police 5. Autour de sa vie s’est constitué un imposantcorpus de matériaux populaires, comprenant des chansons et d’autrestextes imprimés en livrets de colportage bon marché. Outre le braconnaged’éléphants et la contrebande de santal, des kidnappings spectaculaires ontvalu à Veerappan sa célébrité, celui, spécialement, d’une vedette du cinémapopulaire de Karnataka, Rajkumar, lequel sortit en 2000 d’une captivitéde près de cent jours affl igé d’un syndrome de Stockholm aigu, ce quine manqua pas d’accroître le prestige du bandit 6. On a ici affaire à unpersonnage que ses origines pastorales n’empêchaient pas d’être parfaite-ment conscient de son image, qu’il sut adroitement manipuler : une grossemoustache agressivement macho, des uniformes de style militaire portéspar lui et certains de ses adeptes, et des relations complexes avec les médiasimprimés ou électroniques, au point que même le New York imes publiales 26 décembre 2004 sa notice nécrologique comme celle d’un « hors-la-loide cambrousse ». Aussi, bien qu’on ait pu attribuer à Veerappan entre uneet deux centaines de morts, le fait que la plupart de ses victimes étaient des
4. Voir par exemple B ARKEY K., Bandits and Bureaucrats : Te Ottoman route to state centralization,Ithaca, Cornell University Press, 1994, p. 176-88.
5. B ANERJEE S., « Te popular politics of crime », Economic and Political Weekly , 30 Octobre 2004,p. 4767-68.
6. M ADHAVA PRASAD M., « Where does the forest begin ? », Economic and Political Weekly ,18 Novembre 2000, p. 4138-40.
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
3/14
BANDIS À PONDICHÉRY, 1730
3
employés de l’État – membres de l’administration des forêts ou policiers – apu susciter dans d’autres milieux assez d’admiration pour que ses activitéssoient suivies avec une très grande attention dans une vaste partie de l’Inde.Certains suggérèrent même que s’il avait été grâcié il aurait pu se lancer dansune fructueuse carrière politique comme une autre célèbre femme-bandit,Phoolan Devi, dont les activités se déroulèrent plus au nord. Notre banditaurait pu devenir non pas roi, mais certainement un leader, un netā .
outefois, si les ballades, les récits oraux et les livrets magnient lebandit, ce qu’on rencontre dans les archives tend à les remettre à leur place 7.Cela est souvent dû à la nature des archives elles-mêmes et à leur proseadministrative terne et sans relief, mais ce peut être aussi pour des raisonsd’un tout autre ordre. Comme Shulman et divers auteurs l’ont noté, mêmesi le bandit du sud de l’Inde est rarement un personnage exemplaire, il estquand même un personnage qui sort de l’ordinaire. Or, c’est cet aspect dubandit que la recherche en archives corrobore diffi cilement parce qu’elletend à en diminuer la fascination et le potentiel romantique. Les banditsdes archives sont ainsi bien souvent de pauvres types, en particulier lorsqu’illeur faut affronter la menace d’une peine capitale. Et parfois, pire encore,on ne voit pas clairement qu’ils soient des bandits. C’est l’État qui souhaitesouvent les élever pour mieux les abaisser, grossir leur importance pourrendre plus exemplaires leur châtiment et leur rencontre avec le bras de laloi. Si l’on a pu qualier l’Inquisition des temps modernes de machine àproduire des marranes et des crypto-juifs, l’État modernisateur s’est parfoiscomplu à produire ses propres bandits et voleurs de grand chemin. Maisils sont en fait de piètres personnages, avec une toute petite voix, une voixparfois à peine audible.
En bref, l’histoire qui suit est une histoire insigniante, et elle concerne
un coin du pays passablement réduit. Le 19 décembre 1730, au terme d’unprocès mené deux mois et demi durant, trois hommes parlant tamoul etd’humble statut comparurent devant un tribunal français du territoire dePondichéry, dans le sud-est de l’Inde, pour entendre leur sentence. Ils furentcondamnés à être pendus et, si nécessaire, proprement étranglés, leurs corpsdevant rester un jour suspendus au gibet en « place publique », puis portésaux limites du territoire de Pondichéry pour y être exposés et dévorés par les« oiseaux de proye ». Ces hommes avaient pour nom Pandari, Kannaiyan etMunnaiyan ; les pages qui suivent vont nous faire suivre leurs trajectoires.Un quatrième personnage, du nom de Kuruvan, échappa au jugement. Les
7. Pour une confrontation intéressante et novatrice des perspectives, voir R ICHARDS J.-F. etN ARAYANA R AO V., « Banditry in Mughal India : Historical and Folk Perceptions », in A LAM M.et SUBRAHMANYAM S. (dir.), Te Mughal State, 1526-1750 , Calcutta, Chennai et Mumbai, OxfordUniversity press , 1998, p. 491-519.
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
4/14
NAION E POLIIQUES DE LA FAMILLE
4
débats offi ciels de la cour se menèrent dans une large mesure en français,langue qu’à vrai dire aucun des condamnés ne comprenait. Leurs jugesétaient sept agents français de la Compagnie royale des Indes orientales : legouverneur Pierre-Christophe Lenoir, Nicolas Delorme, Alexandre Legou,
Joseph Dupleix, Jacques Vincens, Jacques du Laurens et Jacques Banel.Le crime dont ils étaient accusés et pour lequel ils furent condamnés étaitd’être des « voleurs de grand chemin ».
Vu la complexité linguistique de la situation, un intermédiaire du nomde Lazare joua un rôle clé dans les débats. Les documents le présententcomme « interprete de la chaudrie de cette ville qui entend et parle la ditelangue malabare [tamoul] qu’il nous a interpretté en langue portugaise queluy et nous entendons ». À un endroit, vers la n des actes du procès, ilsigne de son nom en tamoul, Lācar . Les autres acteurs tamouls, les accusésen l’occurrence, n’ont laissé aucune trace écrite, et ne savaient probable-ment pas écrire. Comment, et pourquoi, cette affaire est-elle arrivée jusqu’ànous ? Il ne semble pas qu’elle le doive à son contenu. Cette documen-tation appartient à un petit fonds du Centre des archives d’outre-mer(CAOM) aujoud’hui conservé à Aix-en-Provence ; il s’agit d’un fonds plutôtlacunaire et généralement décevant intitulé Procès criminels 8. La raison desa préservation ne semble tenir ni à la nature du crime ni à l’identité descriminels, mais plutôt à celle de l’un des juges, Joseph-François Dupleix(1697-1763) 9. Dupleix n’était pas encore, à l’époque du procès, le célèbrebâtisseur d’empire qu’il devait être par la suite, mais sa célébrité – pour nepas dire notoriété – ultérieure a sans doute valu aux papiers concernantnotre affaire d’être conservés avec toute une série d’actes traitant d’autresaspects de son administration de Pondichéry – certains prêtant à litige etd’autres beaucoup moins. Au moment du procès, Dupleix s’apprêtait àquitter la ville pour rejoindre Chandernagor, au Bengale, d’où il devaitrevenir à Pondichéry pour y assumer les fonctions de gouverneur généraldes Indes françaises en 1742 ; poste qu’il occupa jusqu’à sa disgrâce et sonretour en France, en 1754, après que sa tentative de créer un empire terri-torial français dans la péninsule indienne eut échoué.
L’époque où se place le procès de nos prétendus « voleurs de grandchemin » n’a guère retenu l’attention des historiens antérieurs. L’un d’eux,un administrateur des colonies, historien à ses heures et éminent biographede Dupleix et de Charles de Bussy, Alfred Martineau, écrivit même, dansun article de 1919, à propos des années 1726-1730 : « L’histoire mêmede la ville de Pondichéry et de son territoire est dénuée de tout intérêt
8. Centre d’archives d’outre-mer, Aix-en-Provence (désormais CAOM), Inde, M, Procès Criminels,Boîte 26-36, n° 31, « Procès criminel contre les nommés Canneyen, Monneyen et Pandary, voleurs degrand chemin » (1730). Voir aussi CAOM, Inde, M 35, « Information sur la mort de Mourtiamma,femme de Moutirichen, gentil, à la suite d’un avortement », autre dossier similaire.
9. Sur Dupleix, voir la biographie de V IGIÉ M., Dupleix , Paris, Fayard, 1993.
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
5/14
BANDIS À PONDICHÉRY, 1730
5
pendant cette période de quatre ans : on y trouve peu d’événements quiméritent d’être signalés 10 ». Il remarque cependant que les conditionsmatérielles étaient plutôt dures ces années-là et leurs répercussions sur lestisserands et paysans terribles. Il y eut d’abord une longue sécheresse suiviede pluies provoquant débordements et inondations : « La sécheresse seprolongea jusqu’à l’automne de 1729 ; alors il tomba de grandes pluies.Leur abondance eut un grand inconvénient ; elle causa beaucoup de èvres,sans développer cependant une grande mortalité ». Ces diffi cultés n’affectè-rent pas seulement le territoire de Pondichéry. Des historiens ont identiédurant ces mêmes années une crise qui toucha l’agriculture et le systèmed’irrigation dans toute la partie centre sud de la côte de Coromandel, ausud-est de l’Inde 11. Aux diffi cultés économiques répondaient les diffi cultésscales du régime des Nawabs d’Arcot, liés à l’empire mogol, qui tentaitde contrôler la région et qui traversait lui-même une phase complexe detransition, cause de beaucoup de sang versé et de compétition dans les élites.Si des historiens se sont intéressés à cette période, c’est essentiellement pources questions de haute politique, autrement dit pour comprendre commentla dynastie dite Nawayat fondée par le notable mogol Sa‘adatullah Khant place au régime des Walajah qui devait dominer la seconde moitié du
XVIIIe siècle 12. C’est donc en marge de ces grandes transformations que setint le procès de nos bandits.
Nous ne disposons pas de statistiques sociales adéquates ou crédibles surla Pondichéry du début du XVIIIe siècle. On sait que le territoire consistaitalors en près de 6 900 hectares cédés aux Français en 1672. Par la suite, en1749, deux zones, Villenour et Bahour, vinrent s’ajouter à ce noyau centraldu territoire à la suite de diverses cessions et négociations. Les donnéesstatistiques, à partir des années 1770, concernent les propriétés bâties de laville proprement dite, certes intéressantes en elles-mêmes, mais tout à faitlimitées dans ce qu’elles disent du tissu social et de son contexte matériel 13.Des informations à partir des années 1820 indiquent que près de la moitiédu territoire central était cultivée et un sixième couvert de forêts (« en boisdebout »). Il est tout aussi diffi cile de deviner la taille de la population en1730, et l’estimation d’une centaine de milliers d’habitants avancée parun visiteur, Simon de la Farelle, paraît aussi forcée que son opinion surPondichéry, laquelle ressemblerait à une « bonne ville d’Europe aux chaleurs
10. M ARINEAU A., « Quatre ans d’histoire de l’Inde française, 1726-1730 », Revue de l’histoire descolonies françaises , t. 8, n° 27, 1919, p. 5-72, cit. p. 38.
11. J YOI B ASU B., « Te trading world of the southern Coromandel and the crisis of the 1730s »,Proceedings of the Indian History Congress , 42e Session, Bodh Gaya, 1981, p. 333-39.
12. A LAM M. et SUBRAHMANYAM S., « Exploring the Hinterland : rade and Politics in the ArcotNizâmat (1700-1732) », in MUKHERJEE R. et SUBRAMANIAN L. (dir.), Politics and rade in theIndian Ocean World. Essays in Honour of Ashin Das Gupta , Delhi, Oxford University Press, 1998,p. 113-64.
13. DELOCHE J. (dir.), Le papier terrier de la ville blanche de Pondichéry (1777) , Pondichéry, Institutfrançais de Pondichéry, 2002.
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
6/14
NAION E POLIIQUES DE LA FAMILLE
6
près 14 ». Les statistiques du siècle suivant donnent une idée de la popula-tion ainsi que de sa complexité en termes de genre et de castes. Voici cequ’Achille Bédier en rapportait pour 1823 15.
Groupe d’âges
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
7/14
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
8/14
NAION E POLIIQUES DE LA FAMILLE
8
Général », qui établit à larges traits l’affaire et ouvre très vite sur l’interroga-toire de Munnaiyan, Kannaiyan et Pandari. Le texte de la requête indiqueque le Procureur Général du Roy « a eu avis qu’il se soit commis sur leschemins aux environs de cette ville plusieurs vols par gens inconnus, quiont dépouillé et maltraité les passants ». Ce qui a nalement conduit l’offi cedu Nayinār , un magistrat indien chargé des affaires criminelles, à appréhen-der « cinq vagabonds, gens sans aveu, lesquels sont actuellement dans lesprisons de la Chaudry ». Le texte insiste sur l’urgence d’engager une actioncontre eux : « il est de la dernière conséquence pour la sûreté des habitansde cette ville que ces crimes ne restent pas impunis 18 ».
Quatre jours après, le 3 octobre, trois des cinq prisonniers – Pandari,Kannaiyan et Munnaiyan – furent séparés et interrogés, et très vite un récitstylisé des événements en question se t jour, nourri ensuite par l’auditionde témoins supplémentaires à la n d’octobre et au début de novembre. Lerécit paraît de prime abord se fonder sur les affi rmations de Pandari, qui futdès le début tout à fait enclin à coopérer avec les autorités, avant de s’enfer-mer durant le procès dans un silence quelque peu maussade et méant 19.Pandari avait alors trente ans, il appartenait comme ses deux camaradesà la caste « villy » et vivait dans une localité qu’il appelle Ayrampacam(ou Airampakkam) ; il était, selon ses dires, « laboureur de son métier ».L’histoire qui se dessina s’était déroulée plus ou moins comme suit. Lestrois prisonniers prétendaient que leur « chef » était en réalité un quatrièmepersonnage, un certain Kuruvan. C’était lui qui aurait entraîné les troisautres dans les agressions, menées avec de simples « batons » brandis parPandari et Kuruvan tandis que, semble-t-il, les deux autres n’étaient pasmême armés. La majeure partie de leurs actions avait eu lieu à une haltepour voyageurs, la « chaudrie de Morotamy ». C’est là que les quatrehommes surgissaient de leur cachette pour attaquer les passants, s’emparerde leurs biens et les mettre en fuite, ne leur ayant en n de compte portéque quelques coups. Pas de sang versé, pas de violence extrême.
Le mot « chaudrie » est indubitablement assez déroutant et possèdeune double signication. Il dérive du mot cāvadi et était parfois rendupar « choultry » ; on l’utilisait pour désigner les relais et hôtelleries pourvoyageurs un peu analogues aux caravansérails du monde indo-musulman.
À Pondichéry, le terme était aussi employé pour nommer une sorte de courindigène ou « tribunal spécial » qui jugeait en première instance les conitscivils entre Indiens 20. Comme dans le cas des bandits il s’agissait d’une
18. CAOM, Inde, M 31, § 1, « La requête de plainte du Procureur Général ».19. CAOM, Inde, M 31, § 3, « Interrogatoire du nommé Pandary ».20. Voir la discussion dans BONNAN J.-C., Jugements du tribunal de la chaudrie de Pondichéry,
1766-1817 , Pondichéry, Insitut français de Pondichéry, 1999, 2 vols ; ainsi que S UBASH C.-J.,French legal system in Pondicherry , Pondichéry, 1987.
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
9/14
BANDIS À PONDICHÉRY, 1730
9
affaire criminelle, on comprend qu’on n’ait pas recouru à la chaudrie, maisqu’on l’ait portée devant une instance toute différente.
Que peut-on plus particulièrement dire de la caste ou du statut socialde nos bandits ? On l’a vu, ils appartenaient à la caste Villi, et un ouvrageclassique de l’époque coloniale sur l’ethnographie des castes indique que« Villi [arc] ou Villiyan [archers] sont mentionnés comme des synonymesdes Irulas de Chingleput » 21. Ce qui semble une identication plus plausibleque l’autre solution, pour qui ce serait « une subdivision de Vettuvan, castede chasseurs du pays tamoul », qu’on trouve pour une grande part à Salem,Coimbatore et Madurai, autrement dit pas dans le proche voisinage dePondichéry. Les ethnographes coloniaux britanniques ne pouvaient cacherleur mépris pour la caste Irula-Villi (ou comme ils disaient, pour cette« tribu ») lorsqu’ils la décrivaient « de peau très foncée, la poitrine étroite,le corps menu, et les muscles mous ». Ils notaient qu’ils travaillaient souventau décorticage du paddy, ce qui s’accorde à leur description comme « labou-reurs ». Dans son célèbre Gazetteer of the South Arcot District (1906), W.Francis émet des commentaires sarcastiques et peu atteurs sur eux. « Dansles taluks de Villupuram et irukkoyilur, ainsi qu’autour de Gingee, ilscommettent des cambriolages bénins et menés de façon peu scientique sila saison a été mauvaise et s’ils sont pressés par le besoin, mais, si la récoltede cacahuètes est bonne, ils se tiennent bien. Ils sont probablement lacommunauté la plus pauvre et misérable du district 22. »
Les activités des quatre bandits que décrivit Pandari incluaient une sériede vols modestes qu’on aurait du mal à qualier de « scientiques ». Prèsd’une localité appelée « Calapet » (peut-être Kaikalapattu), ils semblentqu’ils aient surpris et dévalisé deux marchands Chetti et qu’en d’autrescirconstances ils aient dépouillé quatre ou cinq femmes. Ils n’avaient pas prisde joyaux au cours de ces agressions, bien qu’une fois ils aient trouvé cinqpetites pièces d’or (fanoms) noués dans une écharpe. Pandari insista égale-ment sur le fait qu’après cette brève explosion ni lui ni les autres n’avaient
jamais eu l’intention de continuer à mener une vie de bandit. Au contraire,ils avaient jeté leurs bâtons et s’étaient cachés un temps dans la forêt de peurd’être capturés. Pandari chercha aussi à minimiser le niveau de violenceemployée en affi rmant qu’il n’avait jamais réellement frappé une femme.Pour nir, il suggéra de façon assez énigmatique que toutes ces actionsavaient leur raison d’être dans le grand absent, Kuruvan, lequel désiraitrendre visite à sa lle dans le port voisin de Kunjimedu (« Conjimere »),hors du territoire de Pondichéry.
Les réponses de Kannaiyan à ses interrogateurs tendirent à conrmerbeaucoup de ces détails. À l’âge de vingt-cinq ans, il était un peu plus jeune
21. HURSON E. et R ANGACHARI K., Castes and ribes of Southern India , Madras, Government Press,1909, t. 7, p. 405.
22. Ibid., t. 2, p. 389.
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
10/14
NAION E POLIIQUES DE LA FAMILLE
10
que Pandari et se qualiait lui-même de « laboureur et faiseur de maison ».Son récit suggérait que lui et Munnaiyan (qui à vingt ans était le plus
jeune des quatre et se disait lui aussi « laboureur ») avaient été en quelquesorte trompés par leurs deux aînés. Il décrivit de façon insistante le sinistrepersonnage de Kuruvan comme celui qui donnait des ordres aux autres etcombinait les voleries. C’était nalement à l’instigation de Kuruvan qu’ilss’étaient cachés dans la forêt de « Ontomboaly » où « ils vivoient de racineset de feuilles 23 ». out en conrmant le nombre d’hommes et de femmesqu’ils avaient volés, il protesta que lui et Munnaiyan avaient à peine pris unepart active dans ces vols. Il fut pourtant capable de rapporter un nombrede détails cruciaux sur la manière dont ils avaient disposé des biens volés etsur les motifs profonds du mystérieux Kuruvan.
D’autres détails sur les vols mêmes et sur la manière de procéder de nosquatre bandits ressortent de l’interrogatoire d’une série de témoins, on l’adit. ous ces témoins furent identiés non seulement par leur nom maispar une désignation sociale, généralement formulée en termes de caste. Ona ainsi les témoins 1) Kannappan, simplement désigné comme « GentilMalabar », mais qui se révèle appartenir à la caste Chetti ; 2) Krishna (ou« Quichenay »), de la « caste Satany », c’est-à-dire de la caste cāttāni de servi-teurs des temples vichnouites ; 3) Amatchi (ou « Amadchie »), une femmede la « caste Angambouly » ; 4) Alamelu (ou « Lamesle »), une femme de lacaste Reddi ; 5) Mukundamma, une jeune femme de la « caste de corallier »,peut-être la caste kuravar ; 6) Muttanna, un homme de cinquante ans dela caste des bergers (« pasteur ») ; 7) Venkati (« Vinguety »), une femmede trente ans de la caste Reddi ; et 8) Venkatamma (ou « Vinguetama »),une femme de la « caste de Vesnoda » ou « Veschenova », soit Vaishnava 24.L’intérêt porté à la caste de ces individus, si vague qu’ait été l’emploi duterme, n’était pas dénué de sens quant à leur crédibilité ; de tous ceuxci-dessus mentionnés, les Chettis et les Reddis auront été considérés commede statut supérieur. La majorité de ces témoins étaient des victimes présu-mées des activités de Kuruvan et de ses trois complices, ce qu’aucun de cesderniers ne niait. La discussion tourna essentiellement autour du degré deviolence utilisée, un sujet qui fut davantage développé lorsque le procèsentra dans la phase suivante, la confrontation des accusés et des témoins.
Prenons par exemple le témoignage de Kannappan qui met en lumièrele traitement des accusations. Ce témoin commence par se décrire comme« demeurant à Pondichery rue des Chettis âgé de seize ans ». Le texte conti-nue comme suit :
« Depose sur les faits mentionnés en la ditte requete dont luy avonsfait faire lecture par ledit interprette en langue Malabar, qu’il y a environ
23. CAOM, Inde, M 31, § 10, « Interrogatoire du nommé Canneyenne ».24. CAOM, Inde, M 31, § 14, « Ordonnance et assignation pour récoler et confronter les témoins ».
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
11/14
BANDIS À PONDICHÉRY, 1730
11
trois mois que revenant de Calapet avec son pere nommé Charavana ilstrouverent dans un bois entre Calapet et la chaudrie de irouvangadontrois hommes dont il ignore le nom, qu’un de ces trois hommes vint à euxet leur demanda ou ils alloient a quoy son Pere repondit qu’ils alloient àPondichery, qu’en suitte cet homme donna plusieurs coups de baton à luyet à son pere et prit à son pere sa toque et la toille qui le couvroit et qu’undes deux autres vint à luy comparent et luy tira sa toque, et qu’en suite cestrois hommes s’en furent dans le bois qui est tout ce qu’il a dit sçavoir 25. »
Le modus operandi paraît simple : les voyageurs ne sont pas armés etils engagent volontiers la conversation avec des étrangers, mais c’est pourêtre rudement frappés à coups de bâton. Le point crucial est toutefois que
le jeune Chetti ne mentionne que trois agresseurs et non pas quatre. Ilen va de même avec bon nombre des autres témoins, qui en fait faisaientpartie d’un groupe attaqué tout soudain. Krishna, un homme de trente ans,témoigne par exemple qu’il revenait de « Polichapanam » quand lui-mêmeet son groupe de trois hommes et cinq ou six femmes furent attaqués prèsde la « chaudrie de Morotany » par trois individus. Lorsqu’un bâton l’attei-gnit, il laissa tomber le paquet qu’il portrait sur la tête et qui contenait desustensiles de cuivre, dont les voleurs s’emparèrent. Amatchi, une lle dequinze ans qui faisait partie de ce groupe, prétendit que ses boucles d’oreillelui furent volées par deux de ces hommes. Quant à Amalelu, une femmeReddi de vingt ans, elle déclara que les trois hommes lui avaient pris sesboucles d’oreille et ses bracelets. ous ces récits ne parlent donc que de deuxou trois agresseurs.
Les réponses de Pandari à ces accusations sont fort variées. Confrontéau jeune Chetti Kannappan, il chercha à renvoyer le gros de la respon-sabilité sur Kuruvan, alors absent, en revendiquant pour tout rôle celuide complice. « Et l’accusé a dit par ledit Interprette que c’est le nomméCourouvenne qui les a battus et que luy accusé [Pandari] avoit ramassé latoque de la toille qui couvroit le pere du dit Canapenne et avoit emportéle tout dans le bois 26 ». Dans d’autres cas, celui de Krishna par exemple,il nia l’avoir frappé et devant Amatchi aussi il affi rma catégoriquementne jamais lui avoir volé ses bijoux. Quant à Venkati, la femme Reddi, leséchanges qu’il eut avec elle tournèrent à la guerre ouverte. Pandari affi rmaune fois de plus que c’était Kuruvan qui lui avait dit de lui prendre sonécharpe mais qu’il l’avait fait sans violence. « Le temoin a repliqué que cethomme nommé Pandary l’a battu et aussi bien que les deux autres hommesqui etoient avec elle, et a été repliqué par l’accusé qu’il n’a point battu ladite Vinguety ny les deux hommes de sa compagnie. » Venkati se montraplus indulgente envers Kannaiyan, qui de son côté prétendait qu’il s’étaitcontenté de ramasser un paquet tombé par terre sans se livrer au moindre
25. CAOM, Inde, M 31, § 6, « Information des témoins ».26. CAOM, Inde, M 31, § 17, « Confrontation du nommé Pandary et les témoins ».
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
12/14
NAION E POLIIQUES DE LA FAMILLE
12
geste violent ; elle conrma que c’était vrai. Ainsi, en dépit des divergencesd’opinion, il apparut clairement que les trois voleurs au cœur de l’actionétaient Kuruvan, Pandari et, dans une moindre mesure, Kannaiyan. Le rôledu benjamin, Munnaiyan, fut mal éclairci.
Au moment où les trois bandits furent interrogés pour la seconde fois,le 18 novembre, par Dupleix cette fois, une autre trame commençait à sedessiner. La version des événements donnée par Pandari s’écartait désormaisassez de celles de Kannaiyan et Munnaiyan. Le premier, dans ses réponsesà Dupleix, insista par exemple sur la responsabilité entière de Kuruvan etPandari, alors que lui-même et Munnaiyan devaient en quelque sorte êtreconsidérées comme leurs victimes. Lui et ses complices se mirent aussi àrévéler des détails assez embarrassants sur deux personnages : le chef (ou« neynar ») d’Airampakkam, leur village, et un certain Chetti du nom deMurugan (ou Murugaiyan), qui habitait le village nommé « Cherapom »et avait reçu le produit de leurs vols.
En ce qui concerne le « neynar », le tableau est clair : il avait manifes-tement l’œil sur les quatre compères qui durent acheter son silence par des« présents ». Mais il semble qu’ils aient acheté plus que son silence, car lafemme du « neynar », une certaine « Chelambaye », accompagna par lasuite les quatre voleurs chez un Chetti de sa connaissance pour qu’ils sedébarrassent des biens qu’ils avaient en leur possession. Les récits diver-gent ici : Pandari affi rme que ce Chetti savait parfaitement qu’il recevaitdes biens volés, tandis que Kannaiyan suggère le contraire. Cependant,après les avoir ainsi aidés (et après avoir accepté leur pot-de-vin), il sembleque le « neynar » ait eu des remords de conscience et ait trahi les quatrehommes, en envoyant un message aux autorités de Pondichéry en vertuduquel nos voleurs furent arrêtés et jetés en prison. outefois, ni le Chetti nile « neynar » n’apparaissent autrement dans l’affaire et on ne requit pas leurtémoignage. La justice tenait ses bandits et ne voulait pas en savoir plus.
out de même, qu’est-ce qui avait bien pu pousser nos quatre « labou-reurs » à se faire voleurs ? La question plongea assurément le système
judiciaire de Pondichéry dans la perplexité. On posa à un certain moment laquestion suivante à Munnaiyan : « S’il n’est pas vray qu’ils sont partis dans ledessein de rencontrer quelques bonnes fortunes pour se tirer de la misere oùils étoient » ? Et telle fut la réponse : « A repondu que ce n’étoient pas leursintentions 27. » Mais une autre version se fait jour si on lit attentivement lesréponses, et celle-là nous ramène au mystérieux personnage de Kuruvan.Lors de son interrogatoire par Dupleix, Pandari avait répondu que Kuruvanvoulait se faire accompagner à Kunjimedu parce qu’« il voulait voir sonenfant », ce qui pourtant ne se réalisa jamais. Ce fut cependant Kannaiyanqui alla le plus loin en affi rmant que le vrai motif de leur association à lui
27. CAOM, Inde, M 31, § 9, « Interrogatoire du nommé Monneyenne ».
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
13/14
BANDIS À PONDICHÉRY, 1730
13
et Kuruvan était « pour enlever la lle dudit Courouvenne qui étoit esclavea Conyimare 28 ». D’autres détails apparaissent ensuite, en particulier quecette lle de Kuruvan était esclave domestique chez un marchand Chettide Kunjimedu. Comment était-elle devenue esclave ? Ce n’est pas tout àfait clair, mais nous savons que les enfants de paysans et de travailleursindépendants étaient parfois vendus par leurs parents dans les temps decrise, de famine ou d’inondation 29. Peut-être cet objectif avait-il transpiré.Mais la justice française ne se laissa pas divertir par ce plan. Dupleix le ditcarrément à Kannaiyan : « … ils alloient donc voler puis que c’est un volque de voler un esclave ». Et reçut pour réponse : « A repondu qu’il n’a paspensé de meme ».
Des trois accusés, seul Pandari semble nalement avoir mesuré la gravité
de la situation. Certes, tous nièrent avoir recouru à une violence excessive,sur les femmes en particulier, et tous cherchèrent également à rejeter dansla mesure du possible la responsabilité sur l’absent, Kuruvan. Mais il fautsouligner que même lorsque une certaine dissension apparut dans leursrangs, Pandari à qui l’on demandait, le 21 novembre, s’il avait quelquechose à dire contre Munnaiyan, répondit « qu’il n’a aucun reproche afournir contre ledit Monneyenne » 30. Dans le mois qui suivit et avant lesinterrogatoires naux qui conduisirent à la sentence, Pandari tira évidem-ment ses propres conclusions. Lors de la dernière session, le 19 décembre,il refusa de répondre quoi que ce fût, refusant même de préciser ses nom,âge, caste et résidence. Pour les besoins de la sentence, on le traita donc de« muet volontaire ». À chacune des questions qu’on lui posa, on trouve lamention « n’a voulu repondre », sauf au dernier moment où il refusa ausside signer le texte de l’interrogatoire 31. Kannaiyan se montra plus coopératif,reconnaissant la réalité des vols tout en niant avoir tué ou même frappéquiconque. Il précisa aussi que Kuruvan résidait actuellement dans sonvillage, qu’il désigna du terme générique de « Paleam » (village fortié), cequi n’apportait aucune information utile. Des réponses en gros semblablesfurent données par Munnaiyan.
Le problème, cependant, était que les trois hommes n’étaient pas traitéscomme de simples voleurs, mais que, aux yeux de la justice française dePondichéry, ils n’étaient rien moins que des « voleurs de grand chemin »,méritant par conséquent une justice exemplaire. Il est intéressant de noterqu’à divers moments du procès, ils soutinrent, chacun de son côté, n’avoir
28. CAOM, Inde, M 31, § 10, « Interrogatoire du nommé Canneyenne ».29. A RASARANAM S., « Slave trade in the Indian Ocean in the seventeenth century », in M AHEW K.-S.
(dir.), Mariners, Merchants and Oceans : Studies in Maritime History , New Delhi,, Manohar 1995,p. 195-208.
30. CAOM, Inde, M 31, § 20, « Confrontation des accusés les uns aux autres ».31. CAOM, Inde, M 31, § 25, « Interrogatoire du nommé Pandary sur la sellette ».
-
8/16/2019 Bandits a Pondichery 1730 in French
14/14
NAION E POLIIQUES DE LA FAMILLE
14
pas su que leurs actes étaient commis en territoire français. Comme pourdire que, dans les gouvernements voisins, on savait distinguer entre desimples voleries à coups de crosses et de bâtons et des types de crimes plussérieux. Il semble clair, toutefois, que l’on ne suivit pas leur raisonnement,et pas davantage l’opinion selon laquelle le kidnapping de sa propre lletombée en esclavage – si telle avait bien été l’intention nale de Kuruvan –était tout autre chose qu’un crime contre la propriété privée. En tout cas, onpeut admettre sans risque d’erreur que le sommeil de Dupleix (lequel fut laraison, à vrai dire, de la préservation des documents) ne fut en rien troublépar la sentence capitale rendue contre Pandari, Kannaiyan et Munnaiyan,minables larrons à nos yeux, mais rien moins que bandits et voleurs degrand chemin à ceux des administrateurs de la Compagnie française desIndes Orientales.