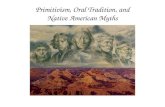Violence, Primitivism and Animality: The Limits of Human Nature as
Transcript of Violence, Primitivism and Animality: The Limits of Human Nature as
University of MiamiScholarly Repository
Open Access Dissertations Electronic Theses and Dissertations
2013-06-21
Violence, Primitivism and Animality: The Limits ofHuman Nature as Depicted in French World War INarrativesAnna Lea M. VincentUniversity of Miami, [email protected]
Follow this and additional works at: https://scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations
This Open access is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at Scholarly Repository. It has been accepted forinclusion in Open Access Dissertations by an authorized administrator of Scholarly Repository. For more information, please [email protected].
Recommended CitationVincent, Anna Lea M., "Violence, Primitivism and Animality: The Limits of Human Nature as Depicted in French World War INarratives" (2013). Open Access Dissertations. 1040.https://scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/1040
!
! !
UNIVERSITY OF MIAMI
VIOLENCE, PRIMITIVISM AND ANIMALITY: THE LIMITS OF HUMAN NATURE AS DEPICTED IN FRENCH WORLD WAR I NARRATIVES
By
Annaléa M. Vincent
A DISSERTATION
Submitted to the Faculty of the University of Miami
in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy
Coral Gables, Florida
June 2013
!
! !
UNIVERSITY OF MIAMI
A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of
Doctor of Philosophy
VIOLENCE, PRIMITIVISM AND ANIMALITY: THE LIMITS OF HUMAN NATURE AS DEPICTED IN FRENCH WORLD WAR I NARRATIVES
Annaléa M. Vincent Approved: ________________ _________________ David Ellison, Ph.D. M. Brian Blake, Ph.D. Professor of French Dean of the Graduate School ________________ _________________ Ralph Heyndels, Ph.D. Michael Miller, Ph.D. Professor of French Professor of History ________________ _________________ Elena Grau-Lleveria, Ph.D. Anne Simon, Ph.D. Professor of Spanish Professor of French
Centre National de la Recherche Scientifique / École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)
!
! !
VINCENT, ANNALÉA, M. (Ph.D., Romance Studies, French) Violence, Primitivism and Animality: (June 2013) The Limits of Human Nature as Depicted in French World War I Narratives. Abstract of a dissertation at the University of Miami. Dissertation supervised by Professor David Ellison. No. of pages in text. (212) Statement of Topic
My study is entitled “Violence, Primitivism and Animality: The Limits of
Human Nature as depicted in French World War I Narratives". My research is
interdisciplinary in nature, bringing literature and history together as well as other fields
of study. It will contribute to the field of literary representation of World War I in
French narratives. I will consider more precisely the questions and themes of
primitivism and animality/bestiality in narration and how these themes are interrelated
and represented.
Aims of the dissertation
The objective of this dissertation is to contribute to the literary field by the
interpretation of texts that reveal specific aspects of writing in/during/about war. Indeed,
how do people write in a traumatic milieu? How and what do they testify about when at
war? I will focus on the questions of violence, primitivism and bestiality in the texts of
my corpus. It will then be interesting to see how texts evolve along the lines of these
themes. I will attempt to see if there is a pattern that emerges among those themes
present in narratives, i.e., the role and occurrences of primitivism and animality in war
narration. I will try to connect the themes of violence, primitivism, and animality and
!
! !
the ways they are represented in narratives to the animalistic and/or primitive part of
human beings. I will then show how the analysis of primitivism and animality
contribute to the literary field, and more precisely to an understanding of the imagery of
war. Primitivism and animality as human manifestations when related to war have been
studied in history but the literary aspect of these texts has often been overlooked. My
research seeks to fill this gap and to offer a new perspective on the literary
representations of war.
The dissertation also aims to broaden and contribute to the field of research
connected to the representation of humans’ limits when the representation of human
beings’ behavior tends to be assimilated to animalistic and/or primitive comportments.
Indeed, literature has often tried to put together - in order to delimit or to compare –
human beings and animal behaviors. The study of these behaviors has been pursued in
several ways (among them, for example, that of the metamorphosis), from Plato to La
Fontaine and Montaigne and from Rousseau to Kafka or Romain Gary. As far as the
question of primitivism goes, 19th-century literature has offered some primitive
representations of human characters (I mainly think about Zola’s work La Bête
Humaine). The fundamental question of what it is to be human gets raised again with
the First World War. But beyond this questioning, what really matters in the end is to
determine what is conceived of as “human;” in other words, what are specific human
abilities when confronted with extreme circumstances? Were the soldiers animalistic,
when they killed? Did they go back to a primitive stage when performing violent acts?
Or were they “just” human? In each under consideration work written by “soldiers
!
! !
writers”1, a profound change occurs within the main characters and within the narrator
throughout the narratives. The one who experiences war, experiences a deep
questioning of human nature that most of the time is materialized by a confrontation
with an animalistic/primitive and abject world. It is the transition from the state of
human beings to animality that I want to question in the present work.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 In French, they are called “les écrivains soldats”, as they are writers that actually experienced war.
!
! ! iii!
Acknowledgment
I owe many thanks to my committee members, family, and friends, without
whom this dissertation would not have been possible.
I would like first and foremost to thank my dissertation director, Dr. David
Ellison, for having been a dedicated mentor and advisor throughout my years at the
University of Miami. His careful readings, timely feedback, and his intellectual guidance
have been invaluable to the completion of this work.
I would like to thank Dr. Ralph Heyndels for his support and his contribution.
His intellectual rigor and curiosity have challenged me and always pushed me to think
outside of the box.
My most sincere thanks to Dr. Elena Grau-Lleveria and to her careful readings,
her generosity and human qualities, which have been a great help for me throughout my
Ph.D. years. I am also extremely grateful to Dr. Michael Miller whose historical input,
knowledge, and intellectual rigor have been fundamental to the success of the present
work.
My sincere thanks also to all faculty and staff members of the Department of
Modern Languages & Literature at University of Miami and especially to Keyla Medina.
I would also like to thank my French advisor, Dr. Anne Simon, without whom
my dissertation would have never existed. Her support and encouragement gave me the
confidence I needed to write and her brilliant and essential contribution to the field of
animal studies has been a model of inspiration to me.
I would also like to thank my spiritual mentor Dr. Alan Farrell, with whom this
difficult yet great adventure in the United States wouldn’t have been the same; both as a
!
! ! iv!
father figure as well as a Vietnam veteran and war writer, Dr. Farrell is intimately linked
to my research topic and to its genesis. I want to thank also Dr. Sabrina Wengier for her
patient readings and her precious help and advices throughout the Ph.D.
I want to thank Melyssa Haffaf, Oriane Laromiguière, Fidjie Tacine and Patrick
L.: because it was them, because it was I.
Enfin et surtout, mes pensées les plus tendres et les plus profondes vont à mes
parents qui m’ont toujours soutenue et sans qui je ne serais pas là. Merci à Maman de
m’avoir toujours tenu la main dans le noir, de m’avoir considérablement aidée et guidée
dans ce travail. Merci à Papa de m’avoir donné le goût des livres et la soif de vivre.
This dissertation is dedicated to my great grand fathers who fought in the
trenches and to all those who never came back.
!
! ! v!
TABLE OF CONTENTS
Page
INTRODUCTION…………………………………………..…………………….…..…2 PART I - PRIMITIVISMES – LA GUERRE, DE ROBINSON À CRO-MAGNON, DE L’UTOPIE À LA DYSTOPIE..……………...…...…………………….………………30 CHAPTER I - L’homme en guerre : du jeu à l’isolement……………..…….….…..….31 CHAPTER II - Retour vers des temps immémoriaux…………...………..…….……...61 PART II – DÉSHUMANISATION.…….…………………………………...…….…...92
CHAPTER III – Violences……….……………………………………..……..….….…96 CHAPTER IV - Une « instabilité désordonnée du monde »…...……...…….......….…114 PART III – Bestiaire guerrier – De l’animal symbolique au « je » des bêtes : préludes littéraires à la mort de l’Homme………………………………………..……..…….…142 CHAPTER V – Cohabitations : l’animal dans la guerre entre exploitation matérielle et exploitation symbolique………………………...……………………………………..146 CHAPTER VI – Dominations : le « je » des bêtes….…………………………..…….162 EPILOGUE……………………………………………………………….......……….186
CONCLUSION……………………………………………………………...………...198
BIBLIOGRAPHIE………………………………………………………………..…...205
!
! ! 1!
À y regarder de près, toute littérature est probablement une version de cette apocalypse qui me paraît s’enraciner, quelles qu’en soient les conditions socio-historiques, dans la frontière fragile (« borderline ») où les identités (sujet/objet, etc.) ne sont pas ou ne sont qu’à peine – doubles, floues, hétérogènes, animales, métamorphosées, altérées, abjectes.
Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, Paris, Seuil, 1980.
!
!
2!
Introduction
La présente thèse intitulée Violence, primitivisme et animalité : les limites de
l’humain – Étude de représentations littéraires de la Première Guerre mondiale, se veut
interdisciplinaire : le corpus étudié est un corpus littéraire, qui s’ancre dans une période
historique donnée. J’entreprends d’analyser ce corpus avec des outils que j’emprunte
aussi bien à l’analyse littéraire proprement dite qu’à l’histoire et dans une moindre
mesure, à la philosophie et à la psychanalyse. J’entends ainsi contribuer au champ des
représentations littéraires de la Première Guerre mondiale dans le roman français, roman
dit « de tranchées ».
L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand en juin 1914 à Sarajevo est
souvent retenu comme l’événement déclencheur qui entraîne la Triple Entente et la
Triple Alliance dans une guerre totale2. Les raisons qui poussent les pays dans la guerre
sont cependant plus complexes ; l’on retient entre autres, la cristallisation des
nationalismes, l’expression de volontés impérialistes et de rivalités coloniales ainsi que
les antagonismes franco-allemands accrus depuis la guerre franco-prussienne de 1871.
Autres raisons invoquées pour expliquer dans une moindre mesure le déclenchement du
conflit, les revendications irrédentistes en Europe centrale et les tensions économiques
du début du siècle qui opposent notamment l’Allemagne, la France et la Russie3.
Parallèlement, s’ajoute la montée du militarisme, thèse néanmoins réfutée notamment
par Niall Ferguson qui la considère comme un mythe4. Pour lui, la plupart des opinions
publiques européennes étaient contre la guerre. Du côté des responsables politiques et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2 En 1914, la Triple Entente regroupait la France, le Royaume-Uni et la Russie. La Triple Alliance (ou Triplice, troisième du nom renouvelée en 1896) regroupait l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie. 3 À ce sujet, voir Jean-Baptiste Durosselle, La Grande Guerre des Français, 1914-1918, Paris, Perrin, 1994. 4 Niall Ferguson, The Pity of War: Explaining World War I, New-York, Basic Books, 1999.
!
!
3!
militaires, il semble que bien avant août 1914, la doctrine militaire ait déjà été
clairement formulée et définie par les États-Majors respectifs5.
Fin juillet 1914, le mécanisme des alliances se met en place et le 30 du même
mois, la Russie ordonne la mobilisation générale contre l’Allemagne, qui répond le 1er
août par une mobilisation générale et une déclaration de guerre à l’encontre de la Russie.
Le 1er août toujours, c’est au tour de la France de décréter la mobilisation générale. Le 2
août, les troupes allemandes entrent au Luxembourg et réclament un droit de passage à
la Belgique, pays alors tous deux neutres. Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la
France. Le 4 août, Raymond Poincaré en appelle à l’Union Sacrée : le Sénat et la
chambre des députés finissent par voter les crédits de guerre à l’unanimité.
Sur le terrain, dès le 6 août, a lieu l’une des premières offensives françaises en
Alsace. Cependant, la formidable avancée des troupes allemandes surprend les Alliés ;
après seulement quatre jours de conflit, l’Allemagne a atteint la capitale belge. Cette
fulgurante percée des troupes allemandes est cependant fortement ralentie par les Alliés
lors de la première bataille de la Marne (6 -12 septembre 1914)6. C’est alors que
commence une guerre d’attrition qui contre toute attente, durera cinquante et un mois.
La Première Guerre mondiale est principalement restée dans les mémoires
comme étant, sur le sol français7, la première guerre de tranchées. C’est sans compter les
premiers jours de guerre qui ont été ceux d’une guerre plus classique, de mouvement.
Ces « trente-cinq premiers jours» ont été particulièrement meurtriers et ont vu tomber un !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5 Les stratégies sur le champ de bataille ont cependant dues être redéfinies au fur et à mesure et en fonction de la réalité des combats. 6 À distinguer de la seconde bataille de la Marne qui a lieu du 15 au 20 juillet 1918. C’est à la veille de la première bataille de la Marne, le 5 août 1914, à Villeroy, qu’est tué Charles Péguy. Sur ce sujet, voir le récent ouvrage de Michel Laval, Tué à l’ennemi, La Dernière guerre de Charles Péguy, Paris, Calmann-Lévy, 2013. 7 En effet, la première guerre Maori, connue aussi sous le nom de Flagstaff War (1845-46), ou encore la guerre des Boers (1899-1902) puis plus tard, la guerre Russo-Japonaise (1904-1905) connaissent déjà l’emploi de systèmes de tranchées.
!
!
4!
grand nombre d’officiers, ce qui a permis de promouvoir des hommes du rang8. À la fin
de l’année 1914, l’on dénombre 340 000 morts du côté français. Lors de la seule date du
22 août 1914, ce sont 27 000 soldats qui tombent au front, toujours du côté français9.
Courant septembre 1914, à la suite de la première bataille de la Marne, la guerre
s’enlise. Un formidable système de tranchées est mis en place, de la Mer du Nord à la
Suisse, long de 700 kilomètres10. Commence alors une interminable guerre de position.
C’est depuis ces tranchées, isolés, soumis à la pression constante de la peur, de
l’imminence des combats, des longues heures voire des journées d’attente sans que rien
ne se passe, que des soldats vont écrire. Ils vont retranscrire leur expérience de la guerre,
de la violence, des blessures, de la mort de leurs camarades, de celle des soldats
ennemis. À la fin du conflit, le nombre total de victimes parmi les belligérants atteint
presque les 10 millions. « Près de neuf cents Français et treize cents Allemands sont
morts chaque jour entre 1914 et 191811 » affirment Annette Becker et Stéphane Audoin-
Rouzeau. Comment alors évoquer, témoigner du poids du nombre inouï de morts ?
La première Guerre Mondiale apparaît comme la tragédie fondatrice du XXème
siècle, fondatrice non seulement à l’échelle européenne mais aussi mondiale, fondatrice
aussi en ce qu’elle est considérée comme à « l’origine » des tragédies ultérieures du
siècle. Le développement d’une formidable puissance de feu, les conséquences
dramatiques d’une violence qui frappe sans distinction, saisissent profondément les
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8 Au sujet des trente-cinq premiers jours de guerre et des « trente-cinq derniers jours de Charles Péguy », cf. l’émission d’Alain Finkielkraut, Répliques, et plus particulièrement l’émission du 23 mars 2013, intitulée « Les Français de 1914 », France Culture, http://www.franceculture.fr/emission-repliques-les-francais-de-1914-2013-03-23, dernière consultation le 8 avril 2013. Les invités étaient l’avocat et essayiste Michel Laval et l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau. 9 Ibid. 10 Leonard V. Smith, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, France and the Great War, 1914-1918, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 77. 11 Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, 14-18, retrouver la Guerre, Paris, Gallimard, 2000, p. 40.
!
!
5!
contemporains. Il s’agit alors de témoigner et c’est d’une partie de ces témoignages qu’il
est question dans ce travail.
La présente thèse s’interroge sur des modalités d’écriture de l’expérience de
guerre. Plus précisément, elle examine comment l’expérience de guerre est restituée au
travers de trois thématiques majeures qui traversent le roman de guerre français de 1915
à 1938 : violence, primitivisme12 et animalité13.
Mon travail est né d’un constat : les thématiques de mon étude semblaient peu
présentes dans le champ de l’analyse littéraire. En effet, bien que la littérature de la
Première Guerre mondiale ait été étudiée en profondeur et ce, dès la fin du conflit14,
aucune des publications disponibles n’avait envisagé une analyse en fonction de la
problématique proposée ici. Aussi ma démarche adopte une nouvelle perspective quant
à l’analyse du roman de guerre français à la lumière des thématiques considérées, non
pas isolément mais de manière relative dans leurs convergences.
Les questions de « primitivisme » et d’« animalité » m’étaient initialement
venues à l’esprit à l’occasion d’une analyse de La Bête Humaine d’Émile Zola. L’un des
personnages principaux, Jacques Lantier est porteur de ce que Deleuze15 nommera une
« fêlure héréditaire », responsable de ses élans d’animalité, produit et résultat d’une
cellule germinale, héréditaire, par laquelle ses ancêtres avant lui ont été affectés. La
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12 Les vocables primitif et primitivisme peuvent porter à controverse. J’en définis l’acception dans la première partie de cette thèse, « Primitivismes – la guerre, de Robinson à Cro-Magnon ». 13 Du latin, animal, animalis, « être vivant », formé sur anima, « souffle de vie ». Nous retiendrons plusieurs définitions sous un même vocable. S’il s’agit d’un part d’analyser le bestiaire présent dans le corpus, nous retiendrons également une des définitions du CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) qui définit de manière péjorative l’animalité qui désigne « l’état de l’homme dégradé ». http://www.cnrtl.fr/definition/animalité ; dernière consultation le 20 mai 2013. 14 Je pense notamment au travail remarquable de Jean Norton Cru, Témoins. Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928, Paris, Édition Les Étincelles, 1929. 15 Gilles Deleuze, « Zola et la fêlure », op. cit.
!
!
6!
persistance de « comportements préhistoriques », palimpsestes d’un passé primitif
dont l’origine se perd dans le temps, laisse Lantier hors du monde « normal ». Lorsque
j’ai entrepris mes lectures de romans de tranchées, il m’est apparu que les soldats étaient
eux-mêmes parfois représentés comme des êtres primitifs, vivant dans des trous et se
battant comme des bêtes. Il s’agissait alors de voir si la question du primitivisme telle
qu’elle est exprimée chez Zola et telle qu’elle s’inscrit dans le panorama culturel du
XIXème siècle trouvait un écho dans le roman de guerre.
Au fil de mes lectures, il s’est avéré impossible d’envisager une étude sur des
modalités d’écriture de guerre sans prendre en considération ce que certains des auteurs
voyaient eux-mêmes comme une retour à un stade « primitif ». Et quand j’écris « stade
primitif », je souhaite que le lecteur rattache cette notion à ce moment précis de
l’histoire. En effet, le début du XXème siècle apportait avec lui des promesses de
modernité à l’Europe occidentale en général et à la France en particulier. De fait, depuis
1830 (et même depuis 1815 selon certains historiens), la France bénéficiait de l’essor
industriel. Bien qu’une récession économique ait frappé le pays de 1860 à 1905, en 1905
l’économie française connaissait un regain de croissance : modernisation des zones
rurales, expansion du réseau ferré, progrès des lois sociales et de l’enseignement, loi de
séparation de l’Église et de l´État… Par conséquent, la guerre et ses explosions de
violence surgissaient comme une remise en cause du processus de modernisation en
cours à une époque où la confiance dans le sens de l’histoire n’était pas contestée. Le
progrès représentait le seul horizon possible.
Je démontrerai comment mes perspectives d’analyse – à savoir considérer les
œuvres étudiées d’un point de vue théorique sur les questions du primitivisme, de la
!
!
7!
violence et de l’animalité – contribuent au champ de l’analyse littéraire et à la
compréhension de l’imagerie de guerre. Sans avancer de conclusions prématurées à ma
problématique, je peux déjà suggérer une première hypothèse. Dans chaque œuvre
considérée, un processus de changement profond s’opère chez le narrateur au fil du
texte. Qu’il s’agisse d’œuvres de fiction pure, ou encore d’écrits revendiqués comme
autobiographiques, chez celui qui a vécu la guerre et qui la retranscrit s’exprime un
questionnement profond quant à la nature de l’humain. Ce questionnement s’exprime le
plus souvent au sein de l’espace de la guerre, monde en soi, sous forme d’un va-et-vient
entre des modèles de représentation opposant tour à tour l’homme et l’animal, l’homme
moderne et l’homme primitif.
C’est précisément cette transition et avec elle la crainte d’une transgression, cette
confrontation, proximité, iso ou hétérotopie de deux représentations, de deux mondes,
humain, moderne, pensant d’un côté, instinctif, primitif d’une part ou bestial, animal
d’autre part, de l’autre que j’entends mettre en lumière. Il ne s’agit pas de penser que
nous avons là une dualité nécessairement figée, constante, consistante, de deux pôles qui
s’affrontent mais de voir en quoi ces représentations s’inscrivent dans un rapport
dialectique, où l’écriture établit un pont de l’une à l’autre. Certes, la narration traduit un
isolement de ces pôles, de manière ponctuelle – notamment quand il s’agit de mettre loin
de soi la violence, la souffrance, l’abject – mais pas toujours.
L’ambition de cette thèse est de contribuer à la réflexion sur la représentation des
limites de l’humain quand la représentation du comportement humain tend à emprunter à
des registres primitifs et/ou animaux. En effet, le champ de la littérature a souvent tenté
de mettre en parallèle – dans le but de délimiter ou de comparer – les comportements
!
!
8!
humains et les comportements animaux. D’Aristote à La Fontaine, de Montaigne à
Rousseau, de Kafka à Romain Gary16, la question des frontières humain/animal, de leur
porosité ou de leur franchissement sous plusieurs formes, notamment par la
métamorphose, a souvent été posée. Quelle part d’humain en l’homme reste-t-il pendant
et après les violences de guerre ? La violence nous coupe-t-elle de notre part
d’humanité ? Si oui, quel processus prend le relai pour assumer cette part de violence ?
Sont-ce des restes ataviques ? Est-ce notre part animale ? Avons-nous une part animale ?
Bien que les thèmes du « primitivisme » et de « l’animalité » puissent, sous la
plume de certains auteurs, se substituer l’un à l’autre, je les examinerai séparément. Lors
de ce travail je m’interrogerai sur un glissement progressif ou sur d’éventuelles
convergences entre ces notions comme une des formes d’écriture de la Grande Guerre.
L’historiographie s’est penchée sur les questions du primitivisme et de
l’animalité en guerre mais l’analyse de ces notions n’a été, pour l’instant, que
partiellement entreprise si l’on considère les travaux effectués dans le champ de la
littérature17. Le résultat de mes recherches tend à combler en partie ce vide théorique et à
offrir une perspective nouvelle sur une forme spécifique de représentations de la
littérature de guerre.
Ma thèse propose une perspective nouvelle dans la manière de saisir l’expérience
de guerre. Elle explore une nouvelle dimension du vocable « primitivisme » au-delà de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16 Voir notamment : Aristote, dont Histoire des animaux (Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι), Jean de La Fontaine, Fables, (1668-1694), Montaigne, Essais, notamment Livre II et Livre III, Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), Kafka, La Métamorphose, (1915), Joséphine la Cantatrice ou le peuple des souris (1924), Le Terrier (1931), Romain Gary, Chien Blanc (1970). 17 La question de l’animal en guerre a été traitée entre autres, mais pas seulement, chez Damien Baldin : « De la contiguïté anthropologique entre le combattant et le cheval », Revue historique des armées, 249 | 2007: « Le cheval dans l'histoire militaire », pp. 75-87.!
!
!
9!
son acception anthropologique. Cette notion n’a jamais été appliquée comme je le fais
ici c’est-à-dire pour désigner un nouvel état de l’homme en guerre : c’est grâce à son
héritage ancestral que le soldat peut monter au front et éventuellement survivre. La
question du primitivisme, que j’analyse dans le corps du texte, soulève des problèmes
d’interprétation. Il est en effet difficile de ne pas tomber dans le piège d’un emploi
idéologiquement orienté qui rappellerait trop le mythe du « bon sauvage ». En effet,
j’écarte de facto le concept tel qu’il est défini et usité en anthropologie sociale : il n’est
question ici ni de société primitive, ni d’arts premiers. Il ne s’agit pas non plus de
caractériser les poilus selon les normes des ethnologues, comme une communauté
humaine ignorant l’écriture et dépourvue d’une organisation étatique.
Une fois délimités mes présupposés épistémologiques, je pense qu’il est
intéressant d’analyser les œuvres en question à l’aune de ce concept.
Ce n’est pas uniquement en raison de ce patrimoine génétique, jouant alors le
rôle d’auxiliaire, que des comportements « primitifs » interviennent. Exposés à une
violence absolue, les soldats se transforment en êtres autres. Alors, dans la narration,
apparaît une nouvelle représentation du soi : les soldats en tant qu’hommes primitifs. Je
ne soutiens pas l’hypothèse selon laquelle les poilus, une fois au front, perdent
totalement leur identité humaine : cela reviendrait à affirmer l’existence d’une
opposition radicale entre homme et animal, ou homme et « homme primitif ». Au
contraire, il s’agit de voir comment l’homme soumis de manière constante à des
phénomènes violents, physiques comme psychologiques, explore les confins de ce qu’il
définit lui-même comme étant humain. La limite ou les limites, dans le cadre de cette
étude, sont définies par la limite du verbe. La transformation intervient au sein de limites
propres à chaque auteur, témoin de la guerre. L’écriture est alors infléchie par un jeu des
!
!
10!
représentations autour de ces limites, dans ces limites et parfois dans la transgression de
ces limites. Redéfinis en fonction de chaque situation expérimentée et évoquée –
mobilisation, attente au front, bombardements, sous le feu, sont autant de moments de la
guerre ayant chacun une scénographie différente – certaines de ces expériences
constituent pour certains une rupture profonde. Cette rupture, que l’on peut considérer
comme un point de frottement, de passage d’un monde (connu, familier) à un autre
(étrange, violent, imprévisible), constitue le moteur narratif essentiel des œuvres
considérées. Elle ouvre la voie vers un « ailleurs », nouvel espace-temps où la violence
renvoie tour à tour à l’animalité et au primitivisme, références qui en réalité se
confondent plus souvent qu’elles ne s’opposent.
La représentation du soi dans certains des romans étudiés va parfois bien au-delà
de l’image d’un homme « troglodyte » ou d’un « homme-animal ». L’être résultant
d’une possible transformation engendrée par le passage au front est parfois flou, sans
contours charnels ni psychiques nets. Prisonniers de la boue, les poilus deviennent cette
même terre, matière par laquelle ils sont peu à peu absorbés. Pour évoquer cette relation
du soldat à la terre qui l’absorbe, à la guerre qui démembre morts et vivants, la littérature
de guerre utilise un champ lexical emprunté à la tératologie : êtres aux contours altérés,
aux corps morcelés, hybrides, à la limite du vivant …
Mon étude porte ainsi, pour partie, sur la question d’une éventuelle mutation du
soldat au front et de la nature de cette mutation, tantôt circonscrite à la temporalité de la
guerre, tantôt permanente dans le cas des défigurations physiques. Il s’agirait de savoir
s’il existe des modes spécifiques à l’expression de tels changements dans les œuvres
étudiées : recours fréquent au registre du sensoriel, champs lexicaux propres, tension
entre volonté réaliste et usage extensif de l’allégorie, choix spécifiques de narrateur (qui
!
!
11!
de l’homme ou de l’animal narrera le mieux la guerre ?), expression de nouvelles
dimensions spatio-temporelles…
Considérons tout d’abord cet « ailleurs » dans sa dimension spatiale. Les romans
pris en compte font appel à un lieu extérieur aux tranchées et loin d’elles, ce qui pourrait
se justifier par l’intention ou tout du moins le souhait d’échapper à cet univers violent.
Cependant les écrivains de guerre n’imaginent pas un monde rêvé qui serait fait
d’images naïves et innocentes, qui compenseraient la désolation et la souffrance vécue
dans les tranchées. Ils recréent plutôt un monde partageant un terrain commun de
représentation avec les tranchées dans la mesure où il est isolé, loin de la civilisation et
où les hommes sont abandonnés à leur propre sort. En d’autres termes, une île déserte où
les hommes ont échoué et où ils doivent se battre pour leur survie. De fait, de nombreux
soldats ont eu, à différents moments de la guerre, le sentiment d’être abandonnés par les
États-Majors.
C’est ce que j’analyse dans le chapitre intitulé « Robinsonnade ». Si le thème de
l’île déserte dans l’œuvre fondatrice de William Defoe renvoie à un topos en partie
imaginaire, dans le cas qui nous concerne, l’espace des tranchées constitue le fondement
d’un nouvel espace narratif, sous-tendu par une assimilation des soldats à des « hommes
primitifs ». Espace hybride, qui emprunte à l’hétérotopie foucaldienne18, c’est le lieu de
l’altérité, qui n’est ni ici, ni là. Dans les romans proposés, l’hétérotopie est ce que
Foucault appelle une hétérotopie de compensation, c’est-à-dire, la re-création mentale
d’un espace, qui dans ce cas intervient comme la projection salutaire indispensable à la
survie psychique. La manière dont les tranchées en tant que lieu en soi sont perçues
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18 In Dits et écrits (1984), T. IV, « Des espaces autres », n° 360, pp. 752 - 762, Gallimard, Paris, 1994. Au même titre que les vieux, les fous, les condamnés à mort, les morts des cimetières auxquels Foucault fait référence, les poilus sont à la marge du monde.
!
!
12!
reflète un besoin de compréhension et d’acceptation de l’environnement auquel les
soldats sont assujettis. Ce qui est redouté, ultimement la mort, est converti, transformé
en un lieu imaginaire où la vie serait plus supportable.
Mais l’hétérotopie est brouillée par le passage du temps ; un lieu n’existe que de
manière éphémère et le temps qui passe a rendu vaine toute tentative d’ancrage
physique. C’est le cas dans La Comédie de Charleroi de Pierre Drieu La Rochelle alors
que la mère d’un ami défunt du personnage principal cherche le lieu exact où est tombé
son fils. Ce lieu n’existe plus de la manière dont le narrateur croyait se le rappeler : « Ce
qui m’avait paru grand, infini, était tout petit comme pour un homme qui revient aux
lieux où il a joué enfant19 ». L’hétérotopie perd de sa matérialité alors que s’ajoutent les
années. En 1919 (c’est la date évoquée par le narrateur de La Comédie), le temps a déjà
perverti le souvenir d’un espace bouleversé par la violence. L’on pourrait alors établir un
parallèle entre d’une part le souvenir déformé par le temps, où se brouillent expériences
de guerre réelles et expériences imaginées, et d’autre part des lieux où le combat s’est
déroulé et qui en raison de bombardements répétés ont perdu leur identité physique. Le
narrateur de La Comédie est incapable de retrouver le lieu où son camarade est tombé
car l’hétérotopie que constituent les tranchées n’existe qu’en guerre, voire parfois que
l’instant d’une bataille.
Le même processus narratif de déplacement est à l’œuvre quand on considère la
question du primitivisme et du temps. Bien qu’il soit difficile de séparer espace et temps,
il existe une forme d’hétérotopie temporelle, l’hétérochronie. Les romans de tranchées
mettent en scène le récit dans une ère autre que celle du présent de la guerre (qui
constitue pour la plupart des ouvrages le temps de la narration). Après plusieurs mois au
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 32.
!
!
13!
front, alors que les écrivains combattants étaient confrontés à des conditions de vie
inédites et extrêmes, une nouvelle conception de l’humanité s’est imposée à eux :
l’homme était susceptible de retourner à un stade d’évolution qu’ils croyaient révolu.
Cependant ce « retour » ne revêt pas nécessairement une connotation péjorative. Comme
nous l’avons décrit, la référence au primitivisme aurait alors pour but de déplacer la
narration d’un espace d’écriture à un espace imaginaire. Par conséquent, un stade plus
primitif ne désignerait pas nécessairement un état non-civilisé mais plutôt un paradis
perdu, au sens rousseauiste du terme, coïncidant parfaitement avec la définition de l’île
déserte telle qu’elle parcourt le genre de la robinsonnade. Enfin, la comparaison des
soldats avec des hommes primitifs permettrait de nier la barbarie des actes de guerre
comme une production inhérente à la contemporanéité du témoin. Par cette mise à
distance, les acteurs du conflit seraient en partie déresponsabilisés.
Quelles spécificités président à l’écriture de guerre ? En effet, comment écrit-on
et révèle-t-on l’expérience de guerre ? Comment écrit-on depuis (au sens de la
perspective) un milieu traumatisant ? Comment et de quoi sommes-nous les témoins
quand nous sommes en guerre ? Mon étude se base sur des romans retenus
spécifiquement pour répondre aux problématiques précitées ; il s’agit de voir la manière
dont ces thématiques s’articulent au sein de la narration de guerre. Comment la violence
de guerre est en effet associée, dans la narration, aux questions d’une hypothétique
régression de l’humain à un stade antérieur et/ou animal.
Dans mon approche des questions du primitivisme et de la violence, j’adopte une
!
!
14!
perspective théorique qui s’appuie principalement sur les travaux de Joanna Bourke20,
historienne australienne et Wolfgang Sofsky 21 , sociologue allemand, tous deux
spécialistes de la violence et plus particulièrement de la violence de guerre. La question
de l’abjection est elle aussi abordée chez Bourke et Sofsky quoique mon argumentation
à ce sujet se base principalement sur les œuvres de Julia Kristeva et de Georges Bataille.
L’immense historiographie qui entoure l’étude de la Première Guerre mondiale
s’accorde sur l’extrême violence des batailles, non pas tant dans les corps à corps mais
sur l’écrasement de l’homme par la machine. Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette
Becker affirment que la violence extrême a fini par tuer la guerre elle-même : « Elle [la
guerre] est morte en quelque sorte de sa propre violence, de ses propres paroxysmes22 ».
Il s’agit d’affirmer qu’en raison d’une telle amplification de la violence, c’est en effet
toute une esthétique de guerre qui disparaît. Ainsi pour Audoin-Rouzeau et Becker
toujours, on ne peut plus parler au XXème siècle de « champ de gloire23 ». Or si
l’esthétique proprement militaire a disparu du champ de bataille, s’est-elle totalement
évaporée sur le plan symbolique et sur le plan des représentations ? Dans le champ
épistémologique qui nous concerne, littéraire, n’existe-t-il pas une nouvelle esthétisation
de la guerre, de la violence, de ses acteurs ? Comment les assauts mémoriels des témoins
de la guerre ont-ils été traités, en l’occurrence, mis en mots ? Si les réponses
institutionnelles données par une politique gouvernementale propre à chaque nation
belligérante24 ont tenté de canaliser la mémoire collective, comment, arallèlement, cette
même mémoire s’est-elle retranscrite à l’échelle individuelle ?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20 Joanna Bourke, An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth Century Warfare, London, Granta, 1999. 21 Voir en particulier Wolfgang Sofsky, Traité de la Violence, Paris, Gallimard, 1998. 22 Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, op. cit., p. 49. 23 Ibid. 24 Gestion de la mémoire différente en France et en Allemagne par exemple.
!
!
15!
Avec la Première Guerre mondiale, la question de l’ontologie humaine devient
primordiale, en ce qu’elle cherche à déterminer, à déceler ce qu’il reste d’humain chez
l’homme, dans toutes ses spécificités, lorsqu’il est confronté à des circonstances de
violence extrême. Qu’est-ce que tuer, être tué ? Qu’en est-il de voir et d’expérimenter la
mort au quotidien ? Un phénomène sur lequel s’accordent la plupart des historiens est la
déshumanisation née de la guerre, créée notamment par le progrès de la puissance de
feu, par la disproportion entre les moyens de tuer et ceux de se protéger et par
l’allongement temporel spectaculaire de la violence durant un affrontement. À cela
s’ajoute également l’arrivée tardive de secours sur un champ de bataille rendu
impraticable par les impacts des bombardements.
Pour Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, in 14-18, retrouver la
Guerre, la violence est avant tout la confrontation des corps, « qui se heurtent, qui
souffrent, qui infligent la souffrance25 ». Par ce premier postulat, les auteurs annoncent
dès le départ la question d’une épistémologie historiographique jusque-là partiellement
lacunaire. Parce qu’il est entouré d’un halo de pudeur, le corps est difficilement
analysable pour les historiens de la guerre. Néanmoins, Audoin-Rouzeau et Becker
expliquent que sur un champ de bataille, la violence « est dévoilement, révélation26 ».
En effet, elle s’impose aux soldats. Par ailleurs, Antoine Prost et Jay Winter27 affirment
que la violence intervient comme une rupture profonde dans les activités quotidiennes
vécues par les soldats : étaient-ils en train d’écrire une lettre ou de manger, les pluies
d’obus s’abattaient inopinément, rompant l’occupation en cours. La violence surgit
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25 Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, op. cit., p. 30. 26 Ibid. p. 32. 27 Antoine Prost et Jay Winter, Penser la Grande Guerre. Un essai d’historiographie, Paris, Seuil, 2004
!
!
16!
constamment, comme une disjonction imprévisible, ajoutant aux violences et blessures
physiques.
Autre point important qui n’est que peu développé tant dans les ouvrages
d’histoire que dans les œuvres littéraires, c’est celui de la violence infligée. En effet – et
cela est visible en littérature dans les œuvres autobiographiques qui narrent l’expérience
personnelle de la guerre – peu de soldats dans leurs mémoires avouent avoir tué. Il est
plus facile de penser la violence comme un phénomène subi qu’imposé. Se pose alors la
question de l’aveu de violence – ou de l’absence d’aveux justement ; qu’est-ce qui
empêche de dire cette violence ? Est-ce une transgression en soi trop forte, trop étrange,
remontant trop loin dans les tréfonds de l’inconscient qui engendre une réaction de
pudeur ? En effet, les soldats étaient-ils bestiaux lorsqu’ils tuaient ? Retournaient-ils à
un stade « primitif » en accomplissant des actions violentes ? Ou bien étaient-ils tout
simplement – si simplement ? – humains ?
De son côté, l’historien George Moss a démontré que, dans un contexte de
tueries à grande échelle, la Première Guerre mondiale a ouvert la voie à un phénomène
de « brutalisation28 » des sociétés européennes. S’il considère la brutalisation comme
phénomène collectif, cette terminologie s’applique-t-elle à l’échelle individuelle ? Car
en effet, où se situe la limite entre la violence collective nécessaire au combat et celle,
individuelle, qui associerait les actes de son auteur à des actes de cruauté ?
La présente thèse ne discute pas tant les causes et raisons de la violence en
l’homme mais bien la façon dont cette violence est représentée dans la littérature de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28 In George Moss, Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, New York & Londres, Oxford University Press, 1990.
!
!
17!
guerre. Si mes observations puisent dans des ouvrages théoriques sur la violence, elles
se fondent néanmoins plus particulièrement sur les conclusions auxquelles m’a conduite
la lecture des romans du corpus.
Lorsqu’il analyse les différentes formes de violence, Sofsky définit ce qu’il
nomme la « violence absolue » :
La violence absolue n’a pas besoin de justification. Elle ne serait pas absolue si elle était liée à des raisons. Elle ne vise que la poursuite et l’accroissement d’elle-même. Elle a bien une direction, mais elle n’est pas soumise à une fin qui lui fixerait un terme. Elle a jeté par-dessus bord le lest des fins, elle a réduit la rationalité en esclavage29. Cet horizon, qui pèse sur les soldats comme une crainte, se réalise parfois. Cette
barrière facilement franchissable n’est jamais loin, d’autant plus lorsque les soldats sont
laissés dans l’attente et l’incertitude d’une bataille, sans ordres formels, dans un vide
moral, hiérarchique, un vide de sens. C’est cette violence absolue qui réduirait les poilus
au rang d’hommes primitifs ou d’animaux.
Les soldats usent néanmoins de violence afin d’atteindre un but, celui de prendre
l’avantage sur leur ennemi ; auquel cas, cette violence absolue n’exclut pas l’exercice
d’une violence « instrumentale tant qu’elle est un moyen pour parvenir à une fin30 ». De
leur côté, les œuvres littéraires de notre corpus insistent plutôt sur l’incapacité du
cerveau à rationaliser les excès d’une violence illimitée. Les ouvrages nous engagent
alors dans la lecture, comme si, au même titre que la voix narrative, le lecteur était pris
au piège dans un seul et même espace – les tranchées -, dans une seule et même
temporalité – celle imposée par la violence. Alors que la narration s’enferme de manière
graduelle dans un environnement de brutalité, l’écriture évolue vers un nouveau champ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29 Wolfgang Sofsky, Traité, op. cit., p. 49. 30 Sofsky, Traité, éd. cit. p. 49.
!
!
18!
de représentations des images, de l’homme en guerre, le transformant progressivement
en quelque chose de différent : hommes d’un autre temps, hommes qui observent un
double affranchi de ses responsabilités. Ce quelque chose de différent allant même
jusqu’à emprunter certains traits propres au règne animal ; à terme, la transgression des
frontières d’un règne à l’autre pourrait engendrer l’extinction du Verbe humain, ce qui
selon le philosophe Giorgio Agamben signifie la mort de l’humain31.
L’hypothèse d’une telle transformation (ou régression suivant le stade considéré
comme premier) de l’homme en guerre représenté dans les œuvres, renvoie à la violence
en tant que thématique globale mais aussi aux propositions causales qu’elle a suscitées
dans l’histoire de la pensée et que je ne peux qu’évoquer ici de manière schématique.
Selon certains analystes, la violence adviendrait dans des conditions spécifiques ; la
guerre serait un élément déclencheur des assauts de violence chez l’homme. L’homme
n’est pas naturellement violent et lorsqu’il le devient, la responsabilité en incombe aux
circonstances socio-historiques. Une position intermédiaire soutient le principe selon
lequel des conditions spécifiques permettraient a une violence présente à l’état latent de
se manifester.
D`autres auteurs entendent montrer que la violence serait une disposition
naturelle, inhérente à l’homme32. Dès les années 1960, un changement radical a lieu
dans le traitement de la violence en termes épistémologiques. En effet, après la Seconde
Guerre mondiale et la Shoah, la façon dont la violence a été examinée d’un point de vue
théorique a considérablement évolué. Présente au procès d’Eichman en 1961, Hanna
Arendt soutient que ce dernier, tout comme d’autres dirigeants nazis, était un homme
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31 Giorgio Agamben, Le Langage et la mort, Paris, Christian Bourgois, 1997. 32 On pense bien sûr à la position sadienne développée dès le 18ème siècle.
!
!
19!
ordinaire. « It could have been you or me33 » affirme de son côté Jack David Eller.
Soutenant l’observation de Arendt, de nombreux comportementalistes tels que Eller font
référence à une expérience troublante menée en 1963 par un groupe de chercheurs en
psychologie aux Etats-Unis ; des volontaires placés dans un pseudo laboratoire
scientifique, avaient pour mission de poser des questions à un autre groupe de
personnes. Ces dernières devaient répondre de façon correcte sinon, à défaut, elles
recevaient une décharge électrique, le voltage étant amplifié à chaque réponse erronée ;
Milgram, le scientifique à l’initiative de l’étude, arriva à la conclusion que 65% des
volontaires recouraient au voltage le plus élevé. Il en a déduisit que des gens
« normaux » étaient à même de commettre consciemment des actes de violence
susceptibles d’entraîner la mort34.
Confrontée à la nécessité de sélectionner un nombre limité de romans dans un
domaine qui offre un éventail très large d’œuvres, j’ai retenu dix auteurs. Tous sont
considérés par Nicolas Beaupré comme étant des « écrivains combattants » tels qu’il les
définit dans son étude Écrire la guerre, écrire en guerre. France, Allemagne 1914-1920.
Ces auteurs doivent selon lui satisfaire « au moins l’une des caractéristiques
suivantes : avoir écrit sur la guerre, avoir porté l’uniforme et avoir combattu, avoir été
tué au combat, avoir été officier, avoir été engagé volontaire, avoir publié entre 1914 et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33 Jack David Eller, Violence And Culture: A Cross-Cultural And Interdisciplinary Approach, University of Michigan, Wadsworth, 2005, p. 7 34 Cité in Eller, op. cit., p. 8 : « perfectly normal and ‘good’ people could be made to perform acts of violence, even to commit potentially fatal violence. ». L’on peut aussi citer, dans un tout autre registre, la performance Rhythm 0, 1974, de l’artiste serbe Marina Abramović, au cours de laquelle elle a laissé le public disposer de son corps avec l’auxiliaire de 72 objets. Son constat après plus de 6 heures de représentation, est que laissés libres d’agir, les gens auraient tout aussi bien pu finir par la tuer. Il s’agissait pour l’artiste de réveiller les consciences sur le potentiel délibérément violent de l’être humain.
!
!
20!
192035 ». Puisque tous les auteurs retenus ont été soldats, il me paraît légitime de parler
de « romans de tranchées ». Retranscrivant l’expérience, le roman de tranchées est une
mise en mots du vécu dont il s’agit d’examiner les contraintes. Cela passe par l’analyse
de l’écriture de l’intime, du rapport intime de l’auteur à la violence dans l’écriture, aux
conditions extrêmes au front, à la vision qu’il a de lui-même, à sa capacité à se qualifier
en tant qu’humain et au rapport qu’il entretient dans l’écriture avec un potentiel
rival/allié animal.
Comment expliquer mon choix d’auteurs et d’œuvres ? Il se trouve que celles-ci
contenaient les matériaux dont j’avais besoin pour étayer ma perspective d’analyse.
Chacune offrait un mode de représentation et/ou des outils littéraires susceptibles
d’éclairer les thèmes abordés : primitivisme, violence et animalité. Certes, soulignons
que se trouvent réunies des œuvres disparates en termes de format et dont la valeur
littéraire peut être considérée comme variable. En effet, il serait difficile de mettre sur le
même plan les textes de Drieu La Rochelle ou de Genevoix et ceux de Jules Romains ou
Gabriel Chevallier. Je suis consciente d’avoir ainsi laissé de côté d’autres témoignages
de guerre, probablement plus connus tant de la critique littéraire que du grand public.
Citons par exemple Le Feu d’Henri Barbusse, Voyage au bout de la nuit de Ferdinand
Céline, Les Croix de bois de Roland Dorgelès ou encore Le Grand troupeau de Jean
Giono.
Pratique inédite dans l’histoire des guerres de l’époque moderne, le roman de
tranchées ne saurait être réduit à sa seule dimension de témoignage. Aussi, œuvre
d’ hommes ayant combattu – en 1914-1918, le roman de tranchées se décline en des
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35 Ou « écrivains soldats ». Cf. Nicolas Beaupré, Écrire la guerre, écrire en guerre. France, Allemagne 1914-1920 Paris, CNRS, 2006, p. 12. À la différence de Beaupré, je ne me limite pas à la période 1914 – 1920.
!
!
21!
styles d’écriture et de récits polymorphes, liés tant à la personnalité de l’écrivain, qu’à
ses prises de position face à la guerre, qu’aux raisons du pourquoi écrire, pourquoi
retranscrire et témoigner. L’apparition et la floraison des romans de tranchée vont de
paire d’une part, avec une proportion importante dans chaque camp de soldats du rang et
d’officiers lettrés, et d’autre part avec la nature de la guerre, guerre principalement
d’attrition après septembre 1914, qui donne le sens aigu de l’isolement, de la coupure
d’avec l’arrière. L’attente et l’inaction ouvrent la porte à la réflexion et à l’écriture. Le
roman de tranchées se distingue d’autres formes d’écriture, qu’il s’agisse de courriers,
de journaux intimes, de carnets, bien qu’il en découle parfois. Prosaïquement, la pratique
de l’écriture au front n’a pas seulement pour vocation d’informer l’arrière-front mais
commence comme une occupation parmi d’autres pour « tuer le temps », contribuant à
combattre les incertitudes et à apaiser les inquiétudes.
La particularité, et donc l’intérêt m’a-t-il semblé, des romans de tranchées est
d’être « au plus près du vécu » de la guerre, en prise directe sur l’ordinaire – ou non – du
combat, du point de vue des combattants. Ils sont aussi une tentative pour lancer des
ponts avec l’arrière, avec lequel le contact se distend au fur et à mesure des mois de
guerre. Majoritairement écrits à la première « personne », ils relatent l’expérience des
tranchées en « temps réel » alors que la guerre se poursuit, ou en différé, après la fin des
combats.
Mon corpus inclut les titres suivants : Élie Faure, La Sainte Face (1917),
Raymond Escholier, Le sel de la Terre (1925), Gabriel Chevallier, La Peur (1930),
Pierre Drieu La Rochelle, La Comédie de Charleroi (1934), Jules Romains, Prélude à
Verdun et Verdun in Les Hommes de bonne volonté (1938) ainsi que Maurice Genevoix,
!
!
22!
Ceux de 14 (195036). Je considère séparément Pierre Chaine, Mémoires d’un rat (1917)
et Pierre Mac Orlan, Les Poissons-Morts (1917), en raison de leur connivence
thématique.
L’œuvre d’Élie Faure, La Sainte Face, au style d’écriture complexe, multiple, se
divise en trois parties : « Près du feu », « Loin du feu » et « Sous le feu ». La première et
la troisième partie ont été écrites au front alors que « Loin du feu » a été rédigée quand
Élie Faure était en convalescence à la suite de troubles neurologiques importants37.
Faure dédicace son livre « Aux soldats qui ont vécu sous le fer, respiré le feu, marché
dans le sang, dormi dans l’eau, je donne ce livre cruel, pour qu’ils le brûlent38 »,
annonçant ainsi l’ambivalence qui imprègne toute l’œuvre, les mouvements de va-et-
vient entre l’horreur et les rires, la terreur et le soulagement d’être en vie ; s’agit-il de se
souvenir pour aussitôt oublier ?
Raymond Escholier dans Le Sel de la Terre, écrit quelques années après-guerre,
le narrateur et personnage principal Buissière, qui n’est autre que l’auteur lui-même,
exprime son sentiment de tiraillement entre les horreurs de la guerre et un patriotisme
ardent, fortement lié au sol comme essence matérialisée par la terre des tranchées,
porteuse d’une patrie, d’une communauté unie sous le même drapeau39. Le lien
patriotique qu’entretient le narrateur à la terre explique peut–être partiellement sa
réticence à faire usage de descriptions crues. Si Escholier reste dans la litote, en même
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36 Le recueil Ceux de 14 est paru en 1950 chez Flammarion mais regroupe quatre textes publiés pendant et juste après guerre : Sous Verdun (1916), Nuits de guerre (1916), La Boue (1921) et Les Éparges (1921). J’utilise ici : Maurice Genevoix, Ceux de 14, Paris, Flammarion, 2007. 37 Pour les aspects autobiographiques et les conditions d’écriture de l’œuvre, voir la préface de Carine Trévisan in Élie Faure, La Sainte Face suivi de Lettres de la Première Guerre mondiale, Paris, Bartillat, 2005. C’est cette édition que je cite et utilise au long de ma thèse. 38 Élie Faure, op. cit., p. 27. 39 L’œuvre de Charles Péguy (cf. note 7) offre un parallèle intéressant. Dans son poème Ève, in Cahiers de la Quinzaine, Quatrième cahier de la quinzième série, 1914 (p. 395), Péguy proclame : « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle ». J’aborde justement cette question de la mort et de la terre dans mon chapitre intitulé « Une instabilité désordonnée du monde ».
!
!
23!
temps cela ne l’empêche pas de percevoir le conflit comme un événement apocalyptique.
La parabole biblique qui parcourt le texte est à son apogée lorsque les poilus sont
comparés au sel de la terre, reprenant l’évangile selon Saint Matthieu : le poilu est cette
« matière » sacrificielle, qui fait don de soi dans le but d’obtenir le salut de la France.
En 1930, Gabriel Chevallier, auteur resté dans les mémoires pour son écriture de
Clochemerle (1934), publie La Peur, roman qui sera retiré des ventes car jugé trop
« défaitiste ». Le titre même de l’ouvrage atteste de l’angle d’approche de l’auteur qui
s’attaque de front aux émotions assaillant les soldats, et en particulier à la peur qui les
poursuit tout au long du conflit. Jean Dartemont, le narrateur, y évoque avec force
l’angoisse qui précède les combats, l’effroi, les cadavres en décomposition, leur
pestilence et l’absurdité de la mort à la guerre, se distinguant de l’idéologie officielle,
qui valorise le courage et la bravoure. Ce n’est qu’en 1951 que le livre est à nouveau
publié mais sans réel succès. La distance temporelle séparant la publication des
expériences évoquées les dédramatise, d’autant plus que la catastrophe de la Seconde
Guerre mondiale semble avoir estompé momentanément le souvenir de la première.
La Comédie de Charleroi, de Pierre Drieu La Rochelle, paraît en 1934. Le récit
s’ouvre sur l’année 1919, alors que le narrateur accompagne la mère d’un de ses
camarades tué au front dans un « pèlerinage » dans les ruines des tranchées. Mme
Pragen souhaite connaître l’endroit précis où est tombé son fils. Si l’ouvrage débute sur
l’incapacité du narrateur à parler à cette mère en quête de détails sur la mort du fils,
soulignant ainsi que le clivage séparant le front de l’arrière au moment de la narration a
perduré au-delà du conflit, la suite du récit consiste en un témoignage de guerre transmis
aux lecteurs comme un journal intime insistant sur l’ambivalence des positions de Drieu
La Rochelle. Tantôt la guerre y est présentée comme un art, production ultime de la
!
!
24!
civilisation, tantôt l’auteur y dénonce la faiblesse des hommes qui « ont supporté d’être
inhumains40 », acceptant tel un troupeau docile leur route vers la mort.
Les deux textes de Jules Romains, Prélude à Verdun et Verdun (tous deux
publiés en 1938), correspondent respectivement aux volumes XV et XVI des vingt-sept
qui composent la grande fresque romanesque Les Hommes de bonne volonté41. La
narration déroule les événements de la guerre, de la mobilisation en août 1914, à la
guerre d’usure et se termine le 9 avril 1916, pendant la bataille de Verdun (février –
décembre 1916) : l’on suit cette progression au travers des expériences et réflexions des
deux personnages principaux, Pierre Jallez et Jean Jerphanion. Jules Romains entame
son récit par des descriptions très précises sur les préparations de batailles. Proposant
tout d’abord une vision englobante du conflit, l’auteur progressivement réduit la focale
en exposant les points de vue des protagonistes. Omniscient, le narrateur insiste de
manière subjective sur les conditions de vie des poilus au front : primitive, animale, la
Grande Guerre laisse derrière elle « l’humanité42 ».
Enfin, tout comme pour La Peur, l’œuvre de Maurice Genevoix Ceux de 14 est
rééditée bien des années après la guerre. C’est en effet en 1950 que paraît ce recueil qui
regroupe quatre récits écrits au front, présenté chacun sous forme de journal, daté. Dans
l’avant-propos de la version définitive, Maurice Genevoix explique sa volonté de faire
revivre les souvenirs du conflit chez ceux qui ont combattu et de témoigner au plus près
de ce qu’était la guerre : « Je souhaite que d’anciens combattants, à lire ces pages de
souvenirs, y retrouvent un peu d’eux-mêmes et de ceux qu’ils furent un jour ; et que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40 Pierre Drieu La Rochelle, La Comédie de Charleroi, Paris, Gallimard, 1982 [1934], p. 66. 41 Les volumes sont tous parus séparément entre 1932 et 1946 et de manière compilée chez Flammarion en 1958. J’utilise ici l’édition publiée chez Robert Laffont : Les Hommes de bonne volonté, Paris, Robert Laffont, 2003. 42 Jules Romains, Prélude à Verdun in Les Hommes de bonne volonté, op. cit, p. 4.
!
!
25!
d’autres peut-être, ayant achevé de lire, songent, ne serait-ce qu’un instant : “C’est vrai,
pourtant. Cela existait, pourtant” 43 ». Genevoix, désireux de retranscrire le plus
fidèlement possible les évènements vécus, répertorie consciencieusement chaque détail,
chaque nom de protagonistes, chaque lieu de bataille. Il excelle également dans
l’écriture de l’intime : la dimension sensorielle de son récit évoque avec puissance la
manière dont les soldats ont été marqués dans leur chair.
L’écriture de la guerre sous les formes auxquelles nous nous intéressons a
contribué à alimenter le discours sur l’animalité, et de fait, sur la condition humaine. À
l’exception de Mémoires d’un rat (et dans une moindre mesure de Les Poissons-Morts),
les narrateurs des romans sont des humains, des soldats qui évoquent leur expérience de
la guerre. Il m’a semblé donc intéressant de mettre en parallèle les romans de Chaine et
de Mac Orlan. Arrêtons-nous brièvement sur le texte de Chaine : la guerre y est racontée
du point de vue de Ferdinand, un rat. Un rat mais un rat particulier : « Je ne suis pas un
rat d’opéra44 » affirme-t-il. Adopté par un poilu, Ferdinand est intégré au corps de
l’armée française et c’est en tant que rat-soldat qu’il relate ses mémoires. L’analogie
entre le rat et le poilu est fondamentale dans la mesure où elle aborde parfaitement le
sujet que nous traitons, à savoir les limites de l’humain en guerre. Ce qui est
remarquable dans le roman de Chaine est la perspective philosophique choisie par le rat
au sujet des humains. Pour autant qu’il était craint dans les tranchées, le rat, objet de
répulsion, est celui qui propose au lecteur une analyse des comportements humains en
guerre et plus particulièrement de leurs craintes et peurs les plus profondes. Ferdinand
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!43 Maurice Genevoix, op. cit. p. 10. 44 Pierre Chaine, Mémoires d’un rat, Paris, Taillandier, 2008 [1917], p. 7.
!
!
26!
regarde de manière amusée et parfois ironique – mais jamais amère – l’espèce humaine
du haut de sa petite taille. Et interroge ainsi : qu’est-ce qu’être animal ? Et en
comparaison qu’est-ce qu’être humain ? Lequel des deux est le vrai « animal » ? Est-ce
celui capable de violence consciente ou celui qui mange les entrailles d’un cadavre sans
considération morale pour l’acte social qui est celui de l’enterrement ?
Nicolas Beaupré suggère que le travestissement des hommes en animaux dans
les récits de guerre pourrait signifier la prise de conscience que le véritable ennemi se
trouve en soi. En effet, pour Beaupré l’analogie homme / animal pourrait être le résultat
d’une peur de la part de l’homme / soldat / narrateur « celle de la contamination par
l’habitus meurtrier ennemi (…) et donc de l’apprentissage de la violence au contact avec
l’autre45 ». Cependant l’argument principal est que, au travers de la métamorphose, la
vraie question qui affleure est celle des effets de la violence sur l’espèce humaine. En
effet, par le biais de la littérature, ce sont des questions d’ordre éthique qui sont
soulevées : « Ce qui se dessine ici c’est bien ‘l’ensauvagement’ des soldats par leur
propre violence46 ».
Le texte de Chaine s’offre à lire en perspective avec celui de Mac Orlan, Les
Poissons-morts. Alors que le rat raconte ses mémoires à la première personne tout au
long du texte chez Chaine, chez Mac Orlan, au fur et à mesure que le texte progresse,
c’est un rat qui, pendant trois chapitres seulement, prend le rôle de narrateur. En effet,
Mac Orlan brouille les frontières de la narration en introduisant le rat au moyen d’un
procédé mimétique. Alors que la guerre des hommes commence par la mobilisation, il
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45 Beaupré, op. cit., p. 163. 46 Ibid.
!
!
27!
en va de même dans le camp des rats, accusés par le premier narrateur, humain, de
préparer une invasion méthodique des tranchées. Les rats sont ainsi mis sur un pied
d’égalité avec les hommes et cette technique narrative permet une critique mutuelle et
réciproque de la part des deux espèces en présence.
Dans l’ensemble des romans étudiés, en dehors des œuvres de Chaine et Mac
Orlan, la référence à l’animalité emprunte des voies plus indirectes : nulle
transformation ou métamorphose prolongée des hommes en animaux mais un rapport
des soldats avec leur environnement immédiat qui les transforme. Le moi humain
devient autre.
L’organisation de ma thèse part de la mobilisation et de la guerre vue comme un
jeu et se termine sur la question de la destruction de l’humanité. J’interroge tout au long
des chapitres cet espace liminaire – intellectuel, mental, individuel et parfois physique –
au sein duquel le soldat en guerre déambule et interroge sa propre existence sous le feu.
J’ai divisé mon travail en trois parties, chacune d’elles considérant tour à tour les
thématiques considérées.
La première partie expose la transition entre un état d’esprit, pour certains,
enjoué, tout du moins volontariste chez d’autres soldats, qui accompagne la mobilisation
en un départ au front « la fleur au fusil47 », et un état progressif d’isolement. La prise de
conscience que la guerre sera beaucoup plus longue que prévue amène les soldats
écrivains à représenter le front comme un espace autarcique, en opposition avec
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47 À ce sujet, John Horne écrit : « […] nous savons maintenant que les soldats ne partaient pas allégrement dans un esprit de nationalisme revanchard (comme le mythe l’a longtemps présenté), mais plutôt décidés à défendre la patrie contre ce que l’on voyait comme une agression injustifiée de la part de l’Allemagne. » in J. Horne, « Entre expérience et mémoire : les soldats français de la Grande Guerre », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2005/5, 60e année, p. 906. Justement, les textes auxquels je m’intéresse développent ce « mythe » d’un départ au front « la fleur au fusil ».
!
!
28!
l’arrière-front. Selon John Horne les tranchées sont une « grille de référence dans le
temps et l’espace qui définit l’horizon d’existence du soldat français pour le reste du
conflit48 ». Au sein de cet espace singulier se développe une démarche spécifique
d’écriture. Le soldat y apparaît comme un individu isolé, confronté à un espace hostile
qui impacte progressivement l’image qu’il a de lui-même et de ses semblables : d’un
statut d’homme civilisé, il passe à celui d’homme « primitif ». Conditions de vie parfois
misérables, violences ultimes, la guerre est ce point de friction entre modernité et
régression.
La deuxième partie de cette thèse porte sur la notion de déshumanisation.
Divisée en deux chapitres, elle s’oriente tout d’abord autour de la thématique de la
violence, plus précisément la manière dont la violence extrême ressentie contribue à
l’ensauvagement du soldat. Ce sentiment de déshumanisation contribue à bouleverser
l’environnement des soldats et insuffle à l’écriture une tonalité chaotique ; le soldat perd
de son humanité. Les corps épousent la boue qui les entoure, dans un processus double :
à la fois création d’un homme glébeux, personnage du roman de tranchées et anti-
création, modèle anti-biblique49 de destruction de l’homme qui retourne à la terre.
Enfin, la troisième partie porte sur la question de l’animalité et de sa symbolique
dans le roman de tranchées. Le bestiaire de la guerre se subdivise en deux modèles de
représentation ; d’un côté, le bestiaire « réellement animal » est celui de la présence du
genre animal aux côtés des soldats au front. D’un autre, il s’agit de la représentation de
l’animalité de l’homme, qui constitue alors l’une des dernières manifestations, l’un des
derniers stades d’un sujet animé, avant qu’il ne disparaisse totalement. Pourquoi orienter
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48 John Horn, op. cit., p. 907. 49 Je m’appuie sur la traduction de la Bible par André Chouraqui qui évoque « Adam le Glébeux ».
!
!
29!
la fin de ce travail sur l’animalité ? L’étude de l’animal porte sur et interroge le vivant.
Ainsi, dans un univers où dominent les tueries, la mort, le chaos, qu’est-ce que être
vivant versus être mort ? Il semble que l’homme en narrateur animal soit le dernier
souffle de vie qui peut survivre à la guerre.
! 30!
PART I - Primitivismes : la guerre, de Robinson à Cro-Magnon, de l’utopie à la dystopie
Au cours de cette première partie, et cette progression suivra toute ma thèse, je
suggère l’idée d’un retour en arrière chronologique à l’échelle de l’histoire de l’humain
ou tout du moins l’histoire vécue comme telle, dans l’agencement des thématiques
parcourant les œuvres que je considère. Alors que la guerre s’ouvre pour certains comme
un jeu, comme une comédie dont une multitude d’acteurs, très jeunes hommes pour la
plupart, n’en réchappera pas, progressivement cet acteur d’un « jeu » laissera la place à
un homme qui retourne à un état sauvage. Un état car il ne s’agit pas ici de figer le poilu
dans une image partielle et fausse, anachronique et contestable, d’homme primitif.
Cependant, il est impossible de proposer une analyse littéraire de la première Guerre
Mondiale sans prendre en compte la question de la « régression » à un stade « autre »
que celui où la supposée modernité du début du XXe siècle avait propulsé les soldats
d’avant la guerre. Les textes que je considère, quelles que soient leurs orientations, leur
prise de position face à la guerre, leur style, font tous état, sans exception, du
franchissement si ce n’est physique, du moins moral ou mental d’un stade qui était
inconnu aux auteurs. La vie dans les tranchées, les atrocités de la guerre, les actes de
violences vécus, vus, perpétrés ont profondément affecté la manière de concevoir et de
penser l’humain en ce début de siècle. Passer des mois dans des tranchées, dont
l’historien Jules Isaac, dès 1921 dans un livre d’histoire affirmera qu’elles sont faites de
« pâte humaine », ne peut qu’avoir pour effet de remettre en question la modernité
naissante.
!
! 31!
Chapter I - L’homme en guerre
Je choisis d’orienter ce chapitre suivant trois axes de lecture : la guerre observée
et restituée sous l’angle d’un jeu, d’un simulacre de bagarre entre garçons d’une part ; la
vie rudimentaire du front d’autre part ; et enfin l’espace du front vécu et perçu comme
un espace isolé en regard de l’arrière, espace en rupture avec les préoccupations
politiques et sociales et les réalités tactiques et stratégiques mises en place par l’État-
major.
Réparties en trois parties distinctes, ces thématiques se répondent pourtant. Les
personnages de romans dont il est question ont en commun une appartenance à un
groupe social et national français, certes non homogène, ainsi qu’à une communauté de
soldats, masculine, dont les membres aussi bien en tant que groupe qu’en tant
qu’individus expérimentent au fur et à mesure que la guerre dure, une vie vouée à
l’isolement. Évoquer le départ des soldats pour le front c’est déjà affirmer l’existence de
fait d’une subdivision du groupe social national entre ceux qui partent en guerre et ceux
qui restent. Puis au sein de ceux qui partent, il y aura les braves voire les fanfarons,
parfaitement incarnés par le personnage de Gaspard chez Benjamin, ironisés chez
Romains. Alors que l’on progresse dans les mois de guerre, la vie des soldats au front
devient de plus en plus précaire, la légèreté ressentie lors des premiers jours de
mobilisation laissant place à un sentiment de profonde solitude et de rupture d’avec la
communauté nationale des civils. Il s’agit pour le « soldat écrivain » en guerre ou
« l’écrivain combattant », d’identifier une nouvelle collectivité, la collectivité guerrière,
et au travers celle-ci, d’identifier un nouveau « moi », le « moi » expérimentant, pensant
et écrivant la guerre.
!
!
32!
1- La guerre, de « vraies vacances de garçons50 »
En septembre 1914 Roland Dorgelès, dans une lettre à sa mère, écrit : « Hier, je
l’ai dit en quelques mots dans une carte, nous avons fait du service en campagne,
autrement dit la guerre pour rire51 ». Dans Prélude à Verdun, treizième partie de la
fresque historico-romanesque de Jules Romains, Les Hommes de bonne volonté, le
narrateur évoque la mobilisation comme un départ pour « des vacances bruyantes52 ».
Gaspard, héros du roman éponyme de René Benjamin, part quant à lui à la guerre en
plaisantant et le cœur léger, « la fleur au fusil ». Le narrateur de La Sainte Face est plus
nuancé mais il en convient : « Sans le mystère suspendu, l’absence de journaux, de
lettres, toute zone de silence autour de nous, ça ressemblerait aux manœuvres ». Il
ajoute : « C’est une atmosphère de jeu. On rit, on cause, on marche53 ».
Qu’est-ce donc que ce début de guerre où l’on ne se bat pas, où les soldats
marchent vers le front en riant ? Croiser les champs sémantiques du rire, de la légèreté,
des vacances alors que l’on veut parler de la guerre peut surprendre mais cela n’est
pourtant pas une exception dans la façon de narrer l’entrée dans le conflit de 14-18.
Certes ces représentations ne constituent pas l’intégralité des œuvres évoquées et des
récits de guerre en général ; en effet, bien des représentations de la violence de guerre
trouvent un écho marquant dans les œuvres littéraires sur la première Guerre Mondiale,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!50 Jules Romains, « Prélude à Verdun », in Les Hommes de bonne volonté, p. 4. Sur ce sujet, lire l’excellent chapitre de George L. Moss in Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, New York, Oxford University Press, 1990, chap. IV « Youth and the War Experience », pp. 53-69. 51 Micheline Dupray (éd.) Roland Dorgelès, Je t’écris de la tranchée, Paris, Albin Michel, 2003, p. 79. 52 Jules Romains, op. cit., p. 4. 53 Élie Faure, La Sainte Face, Paris, Bartillat, 2005 [1918], p. 36 et 37.
!
!
33!
bien plus d’ailleurs que dans des ouvrages historiques ou historiographiques54 qui
couvrent la période donnée. Cependant, le rire, celui que Pierre Schoentjes appelle le
« rire joyeux55 » n’est pas absent du roman de guerre. Qu’il soit rire collectif ou rire
individuel, il met en lumière une façon de voir la guerre comme une crise qui n’en est
pas une, comme une simulation.
Quelle est donc la fonction du rire chez Dorgelès ou Benjamin ? Rire permet
d’éloigner le lecteur (notamment dans le cas de Benjamin d’une part et de Dorgelès et
Romains, d’autre part, mais pour des motifs d’écriture différents) d’une vision noire et
réaliste de la guerre. Le rire désacralise et/ou décrédibilise, renforce le travestissement
de la réalité et permet de substituer à l’imagerie guerrière celle plus apaisante (et
admissible, dans le cas des lettres de Dorgelès) de vacances champêtres. Bien sûr cette
stratégie narrative chez Jules Romains permet d’amorcer la narration sur une tonalité
ludique, afin de marquer plus fortement la transition vers un discours de l’horreur. Non
pas que le ton et la forme à proprement parler changent fondamentalement au fil des
textes dans « Sous Verdun » puis « Verdun », mais le contenu se modifie, passant du jeu
à la destruction du potentiel humain à grande échelle. Ainsi, si la narration va jusqu’à
substituer à l’imagerie de la guerre celle d’un grand jeu collectif, c’est pour souligner
l’aberration de ce grand jeu horrible. Il semblerait que la guerre ouvre une parenthèse
presque bienvenue dans la routine quotidienne, parenthèse qui libèrerait des contraintes.
Vacances de fin du mois d’août, vacances d’été après le dur labeur des moissons,
épreuve sportive entre deux grandes équipes, insouciance feinte (ou réelle ?) des
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!54 À ce sujet voir Wolfgang Sofsky qui affirme que l’historiographie refuse d’aborder la violence, beaucoup plus que ce n’est le cas dans les œuvres romanesques. Son propos est partagé notamment par Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker in 14-18, retrouver la Guerre, Paris, Gallimard, 2000. 55 Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre, Variations littéraires sur 14-18, Paris, Garnier, 2009, p. 54.
!
!
34!
participants : le lecteur rencontre ces métaphores que ce soit chez Romains, Faure,
Dorgelès ou Benjamin. Dans tous les cas de figure, la narration se distingue par un
ensemble d’images qui permettent de substituer une réalité d’énonciation à une fiction
narrative, soulignant l’incapacité des auteurs à dire réellement le conflit. Cette incapacité
ou ce refus d’écrire renvoient à la question de la censure, qu’elle soit officielle et réelle
dans le cas des envois de courriers depuis les tranchées vers l’arrière ou dans le cas de la
publication d’ouvrages littéraires56, ou encore qu’elle relève de l’autocensure. Même
dans ce dernier cas, il n’est pas dit que cette autocensure ne soit pas imposée de
l’extérieur par une norme communément admise selon laquelle les horreurs ne s’écrivent
pas57, pour des raisons complexes entremêlant les sphères du politique et de la tradition
littéraire.
Il convient ici de différencier les « rires » associés à la narration de la guerre. Je
ne reprendrai pas ici le travail fait par Pierre Schoentjes58 mais j’affirmerai que dans les
œuvres qui concernent le présent corpus, l’on peut distinguer principalement trois sortes
de rires. Il y a la guerre que l’on prend à la légère, que l’on expérimente avec gaîté,
bravoure et insouciance : c’est le cas du personnage de Gaspard dans l’œuvre de René
Benjamin. Il y a les prémices d’une guerre, qui n’est qu’une guerre « pour rire », celle
qui feint d’en être une, qu’évoquent Dorgelès ou Élie Faure. Il y a enfin le rire ironique,
qui parcourt l’œuvre de Jules Romains : il s’agit ici de dénoncer l’absurdité d’un
engagement consommateurs d’hommes. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56 La censure des œuvres littéraires ne commence à s’institutionnaliser qu’à partir du mois de janvier 1915. À ce sujet, voir Nicolas Beaupré in Écrire la guerre, écrire en guerre, op.cit., pp. 74-95. 57 Pourtant, la littérature de guerre a déjà décrit les violences de guerre si l’on regarde, notamment, le texte de Zola, L’Attaque du moulin (in Les Soirées de Médan, 1880). Mais il s’agit ici d’un texte purement romancé dans la mesure où l’auteur n’a pas pris part à la guerre franco-prussienne de 1870. Pour Martin Hurcombe, in Novelists in Conflict, op. cit., « The first French novel to deal exclusively with war was Émile Zola’s treatment of Franco-Prussian war, La Débâcle […] », p. 19. 58 Cf. infra in Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre, éd. cit.
!
!
35!
Les combattants qui ont la possibilité de nouer une liaison épistolaire avec ceux
restés à l’arrière-front – famille, ami(e)s, fiancées – s’imposent comme devoir de dire ce
qu’ils vivent, pour que ceux de l’arrière soient rassurés mais aussi pour qu’ils puissent
assouvir leur curiosité, leurs interrogations sur ce qu’est la guerre. Aussi, Roland
Dorgelès en écrivant ne répond pas uniquement à une volonté d’apaiser l’inquiétude du
destinataire. Il répond à cette attente, précédemment évoquée, d’une partie de ceux restés
à l’arrière-front : avoir des nouvelles des siens, sans pour autant que soient avouées les
horreurs du conflit afin de ne pas écorner la vision d’un soldat patriote. Entre volonté de
rassurer et obligation de taire pour se soustraire à la censure, les écrits, notamment dans
le cas des lettres, sont parfois épurés de mots crus et d’images choquantes. Il faut
attendre la fin du conflit pour que les récits de guerre se débarrassent des pudeurs
premières et que les auteurs évoquent enfin sans circonlocution leur expérience du front.
Cette absence d’un réalisme trop marqué à certains stades du récit de guerre ou
de la guerre elle-même expliquerait que l’on retrouve au cours de la lecture une forme
particulière de représentation de la guerre. Considérons la lettre de Dorgelès 59
précédemment citée. Elle fait partie de la correspondance de guerre que l’auteur a
entretenue entre 1914 et 1917 principalement avec sa mère et sa compagne de l’époque,
Madeleine. Dans cette correspondance, Dorgelès relate son expérience du front. Mais
comme le souligne Stéphane Audoin-Rouzeau dans la préface de Je t’écris de la
tranchée, Dorgelès « ment à sa mère », au moins par omission. Il ne dit rien, « rien en
tous cas qui puisse nourrir l’inquiétude60 ». En écrivant que pour l’instant, les soldats ne
sont contraints qu’à des manœuvres, Dorgelès transmet l’idée que la guerre n’est pas
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!59 De son vrai nom Roland Lécavelé. 60 Stéphane Audoin-Rouzeau in Micheline Dupray, op. cit., p. 25.
!
!
36!
tout à fait ni pas encore la guerre. L’exercice ne fait que contraindre le soldat qui s’y
soumet à la monotonie d’ordres exécutés de manière répétée et qui le tient hors de portée
des dangers réels. Progressivement le corpus des lettres se révèle plus descriptif mais
Dorgelès prendra toujours soin de dissimuler le plus d’éléments possible à sa mère.
Mado, en revanche, dont il va se séparer peu de temps après le début de la guerre
n’échappera pas à des descriptions plus crues. Le 4 janvier 1915, il lui écrit : « Tous sont
étonnés que je puisse, sinon écrire, du moins penser au milieu de cette existence
affreuse61 ». Le 1er juin 1915, il va plus loin dans les descriptions alors qu’il sent Mado
se détourner progressivement de lui : « Je ne te parlerai pas des 8 jours que nous venons
de passer, c’est trop dur. Je veux les oublier. Du sang partout, des capotes éclaboussées
de cervelle […]62 ». Dorgelès met en scène ici ce que Sylvie Decobert nomme une
« théâtralisation épistolaire63 », en ce qu’il se présente ou représente « à l’autre dans un
décor approprié64 » : il s’agit ici d’appeler la pitié ou tout du moins l’empathie de Mado
mais pas seulement. La sachant infidèle, Dorgelès cherche à faire naître chez elle un
sentiment de culpabilité.
Cette guerre qui serait une guerre « pour rire » ou où l’on peut rire, traverse non
seulement les lettres mais aussi les romans lorsqu’il est question de relater les premiers
mois du conflit. À ce sujet, Pierre Schoentjes, dans un chapitre intitulé « La guerre
joyeuse 65 », affirme que le public souhaitait voir dans le roman de guerre une
représentation gaie de la guerre. Il mentionne notamment le roman de René Benjamin,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61 Ibid., p. 170. 62 Ibid., p. 287. 63 Sylvie Decobert, Lettres du front et de l’arrière (1914-1918), Les Audois, 2000, p. 41. 64 Ibid. 65 Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires sur 14-18, Paris, Garnier, 2009, p. 53.
!
!
37!
Gaspard, publié en 1915, prix Goncourt de la même année, qui met en scène un héros
bon vivant et jovial, courageux, patriote et querelleur.
Le lecteur fait la connaissance du personnage de Gaspard alors qu’il apostrophe
un chef de gare : « (…) Nous, on va s’battre, nous on va s’tuer. Toi, avec ta cassiette, tu
continueras à faire des trous dans les billets. Tais-toi tiens, tais-toi !66». Et Gaspard
d’ajouter : « Berlin ? Tout droit, sans se r’tourner ! ». Gaspard ne craint pas la guerre.
C’est un bagarreur. Il est même enthousiaste à l’idée d’aller se battre. « Ah, les
Alboches, ils veulent la guerre ? Eh bien, on va la leur faire voir la guerre ! Et puis, bien
nippés, bien chaussés, bien armés ! Et allez donc, emplissez les voitures !67». Ici, le point
de vue narratif cherche à montrer le patriotisme des soldats, patriotisme probablement
partagé par l’auteur lui-même. Pour certains intellectuels, l’idée que l’Allemagne avait
attaqué la France justifiait une littérature « défensive » comme l’explique Nicolas
Beaupré68, ainsi que la prise de position d’un héros combattif, presque hargneux, prêt à
« en découdre ». Gaspard est viril et explicite son gout pour la bagarre : « On va enfin se
cogner, sans qu’les flics ils aient rien à voir !69 ». Ici, la bagarre se comprend comme une
métaphore à la guerre. Et en même temps, ce n’est pas vraiment la guerre. Bien qu’une
rixe puisse prendre plusieurs formes, et notamment violentes, elle amène rarement à la
mort. Le conflit est ici seulement suggéré, en retenue. Le deuxième chapitre du roman
relate le départ des soldats au front. Benjamin insiste sur l’élan de camaraderie et de
fraternité qui semble unir les hommes : « Puis, on cassait la croûte ; on se partageait des
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66 René Benjamin, Gaspard, Paris, Fayard, 1915, p. 11. 67 Ibid. p. 13. 68 Nicolas Beaupré, Écrire en guerre, écrire la guerre, France, Allemagne 1914-1920, Paris, CNRS éditions, 2006 69 René Benjamin, Gaspard, op. cit, p. 30.
!
!
38!
sardines, des œufs durs, du saucisson, du chocolat70 ». La guerre, une réunion de bons
vivants ?
À quoi correspond donc vraiment cette modalité de représentation ?
Certainement pas à une réalité guerrière nous dit Jean-Norton Cru : « Benjamin créa le
type du soldat pittoresque, Parigot hâbleur, débrouillard, qui parut aux yeux d’un public
ignorant incarner des vertus militaires remarquables dont la principale était la confiance,
celle du soldat et celle qu’il inspirait au lecteur71 ». La critique va plus loin : « Gaspard
fut le livre favori d’un public maintenu dans l’ignorance de la situation militaire par
cette censure du début, si stricte, si intransigeante. Paru un an plus tard, son succès eût
été douteux, deux ans plus tard il aurait passé inaperçu72 ». Si Gaspard n’évoque pas la
réalité selon Cru, l’œuvre correspond néanmoins à un mode de représentation attendu
par une partie de l’opinion publique et de la classe politique qui espérait sortir vainqueur
d’un conflit dont on était convaincu qu’il serait bref. En ce sens, Benjamin renforce le
pouvoir des stéréotypes et bâtit un personnage qui correspond à l’image que l’on
souhaite se faire du soldat. Il est gai parce que l’on ne peut concevoir de voir évoluer un
personnage au patriotisme dramatique et triste.
Confirmant le caractère du personnage et l’ambiance du début du récit, la
description qui est faite de l’environnement dans lequel évolue Gaspard tend à éluder les
souffrances des soldats et les horreurs guerrières. Comment sinon convaincre les
contemporains de la nécessité de la guerre ? Soutenant et relayant un propos qui cache la
réalité, René Benjamin minimise l’expérience de la mort : « D’ailleurs, la mort, parfois,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!70 Ibid., p. 24. 71 Jean-Norton Cru, Témoins [1930], Paris, Allia, 1997, p. 568. 72 Ibid. p. 569.
!
!
39!
tue d’un coup, sans souffrance73 (…) ». Néanmoins, le texte évolue et si les détails des
horreurs ne sont pas mentionnés, René Benjamin est obligé d’admettre que la guerre fait
des ravages. C’est cependant sans recourir à des images réalistes voire abjectes (à la
différence de Gionio par exemple74) ni un langage cru (à la différence de Céline
notamment75). Puisque Gaspard et ses compagnons d’arme sont les héros d’une guerre
patriotique et propre car glorieuse, les corps des tués ne peuvent être représentés et
souillés par un langage cru. Benjamin évoque la mort des soldats comme un geste
sacrificiel qui vise à défendre le sol français sans que le corps « individuel » ne souffre
ni que sa mort ne soit évoquée dans le détail. Il y a bien mention de la mort dans le texte
de Benjamin mais uniquement au moyen d’une représentation collective :
Ce champ retourné, meurtri par des épaules et des genoux en détresse, c’était l’image vivante et poignante de deux cents hommes devenus cadavres, qui, les premiers, s’étaient acharnés à défendre, motte par motte, la terre française. Mais il ne restait plus que le moule de leurs efforts, le dessin effrayant de leur expression dernière ; eux, ils avaient disparu, enfouis dans leur dernier sillon, boursoufflant la terre fraîche de leurs deux cents corps tassés, pour encombrer le moins possible les vivants76.
Cette dernière phrase révèle tout à fait l’idée soulignée par des critiques
littéraires tels que Nicolas Beaupré ou Carine Trévisan qui évoquent une incapacité,
pour certains auteurs, à dire la mort violente. René Benjamin fait « disparaître » les
cadavres afin qu’ils n’encombrent pas visuellement l’écriture et donc la mémoire du
lecteur contemporain. Cela permet en réalité de ne pas parler de l’horreur de la guerre,
de ne pas insister sur la notion d’individu. L’individu est cet indivisible dont on ne peut
supporter une vision éclatée. Voici un bon exemple duquel l’auteur écarte toute
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!73 René Benjamin, Gaspard, op. cit., p. 35. 74 Cf. Jean Giono, Le Grand troupeau, Paris, Gallimard, 1931. 75 Je pense notamment à Casse Pipe, publié pour la première fois chez Chambriand en 1941. 76 René Benjamin, Gaspard, op. cit., p. 55.
!
!
40!
possibilité d’une représentation détaillée et réaliste de la mort au combat. Ainsi, quand
l’explosion du premier obus est mentionnée dans Gaspard, l’auteur ne s’étend pas sur
les dégâts qu’il occasionne : « Tout à coup, le ciel fut déchiré par un de ces sifflements
que plusieurs générations garderont toute la vie dans l’oreille : un obus arrivait, le
premier de tous. Un obus tomba, tonna, flamba, éclata… écrabouilla le petit cuistot77. »
La redite de l’article indéfini « un » donne à l’obus un caractère très général et si le
cuisinier passe de cuistot à rien, c’est presque de manière fortuite. Ce qui est certes le
cas – il y a bien eu ce hasard dont tant de soldats ayant réchappé de la mort ont parlé –
mais le caractère indéterminé de l’objet meurtrier supprime la responsabilité de la mort.
Le passage de la vie à la mort est sous-entendu mais pas explicité. Il faut attendre
d’arriver quelques lignes plus loin pour que Benjamin traduise de manière plus précise
ce qu’est devenu le corps : « et leurs yeux terrifiés n’aperçurent plus que des lambeaux
de chair, à la place de celui qui veillait sur la marmite78. » C’est d’ailleurs ce qui
constitue l’ambiguïté du roman de Benjamin, auteur classé parmi les auteurs
patriotiques ; malgré une volonté de narrer la guerre de manière épurée, il lui est difficile
de dédramatiser absolument la restitution des faits.
Si toutefois la mort au combat, notamment la mort injuste, est difficilement
exprimable pour Benjamin, que reste-t-il donc à dire de la guerre ? Il s’agit pour l’auteur
d’orienter le lecteur vers une représentation particulière des affrontements et de
substituer aux images de désolation celle d’un héros valeureux et gai comme un enfant
qui partirait en colonies de vacances. La guerre serait-elle alors un jeu ? Probablement
qu’elle doit être restituée comme telle. Mais gardons nous de toute interprétation abusive
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!77 Ibid., p. 59. 78 Ibid.
!
!
41!
tout comme nous nous devons de reconsidérer la critique de Jean Norton Cru à l’égard
de Benjamin. Si Benjamin dans la première moitié du roman cherche à minimiser la
souffrance des corps, il n’en est pas de même au fur et à mesure que l’on progresse dans
le récit. Il semblerait que la critique ait été dure principalement car les textes produits
par la suite (publiés pour certains dès 1916), ont été plus descriptifs dans l’horreur,
souvent dans une optique pacifiste de dénonciation. La vision patriotique et donc
partiellement fausse que Benjamin a donné de la guerre a certainement gêné. Or, si l’on
reste près du texte, l’on s’aperçoit que l’auteur a tout de même exprimé à sa manière la
peur, celle qui se cache en Gaspard et trouve son expression dans un personnage
goguenard dont la verve, l’abus de paroles, pense-t-il, le sauvera de la mort. « Il ricanait.
Et nerveusement tous les autres, chez qui ce premier contact avec le feu provoquait une
énorme transpiration, se mirent aussi à ricaner. Ils transpiraient si fort que la sueur leur
coulait dans les yeux et leur brouillait la vue. Alors, allongés par terre, épaule contre
épaule, ils se regardaient disant : - Fait tiède, hein !... Ah ! c’te vie !79 ». Visiblement, le
« plaisir » lié au début de la mobilisation n’est plus aussi franc. Benjamin fait preuve ici
d’un patriotisme nuancé. Peut-être cette évolution s’explique-t-elle par le fait que
l’auteur ait été blessé et qu’au sortir de sa convalescence, la France n’était toujours pas
engagée vers la victoire.
Mais sa déconvenue ne suffit pas à ancrer définitivement l’œuvre de Gaspard
dans un courant plus critique d’œuvres de guerre. Il faut rappeler aussi que Gaspard a
été parmi les premiers romans publiés sur la guerre, pendant la guerre, ce qui
expliquerait aussi une certaine retenue dans les descriptions. À la suite de ce passage,
Benjamin raconte comment les hommes semblent s’habituer au bruit des obus qui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!79 René Benjamin, Gaspard, op. cit., p. 61.
!
!
42!
tombent et manquent leur cible. Et aussitôt, l’auteur inclut de nouveau un passage
champêtre sur la description des blés puis sur la vision d’un lapin qui court devant les
soldats. Comme si en effet, la guerre était trop difficile à raconter ou à lire et qu’il faille
entrecouper des scènes de « bataille » avec celles de visions bucoliques, plus
supportables que les corps déchiquetés. Il s’agit en réalité de créer au sein de la narration
une habitude, une répétition d’images supportables. La question de l’habitude intervient
alors comme pour donner corps à la nature même du temps de la guerre. En donnant au
lecteur des points de repères familiers, tels ces scènes bucoliques entre autres, René
Benjamin accroche la narration au domaine du connu afin que la rupture d’avec la réalité
n’ait pas totalement lieu. La vision d’une province symbole d’une France entière qui
réclame qu’on la sauve du joug allemand participe d’une même idée, celle de détourner
le lecteur de l'inconcevable en donnant à penser la guerre en termes de dialectique judéo-
chrétienne – domaine du connu donc -, qui dans ce cas supprime la responsabilité
humaine et donc politique et nationale d’une guerre : « On eût dit vraiment que cette
province lorraine voulait se montrer dans sa splendeur pour exciter les troupes : « Suis-je
assez belle ? Ah ! Sauvez-moi ! » Et c’était une journée d’été si rare, si puissante, si
infinie, qu’il semblait que Dieu fût quelque part, tout près, dans le paysage80 ». Si la
guerre est une folie, elle n’est pas purement folie humaine.
Alors que pour Benjamin, la représentation de la guerre comme un espace où le
héros peut se laisser aller à des pauses et réflexions ludiques correspond en partie aux
convictions de l’auteur et donne naissance à une image quelque peu figée, et donc non
contestable, de la guerre, pour Jules Romains en revanche, la guerre vue comme un jeu
répond à des fins narratives différentes. La thématique de la guerre comme un grand !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!80 Ibid., p. 63.
!
!
43!
divertissement chez Romains restituée dans une tonalité profondément ironique sert
d’accroche et permet de souligner l’abîme entre l’opinion de l’arrière et la réalité
effective du front. Alors que d’aucuns voulaient se convaincre que la guerre serait courte
et en la faveur de la France, rapidement, la guerre de mouvement faisant place à la
guerre de tranchée, force est d’admettre que la victoire ne sera ni rapide, ni une
évidence. Jules Romains, rétroactivement – le roman est écrit dans l’entre-deux-guerres -
, raille la naïveté du pouvoir politico-militaire en cette fin d’année 1914 mais aussi
dénonce un courant traditionnel d’avant-guerre qui voyait dans les activités guerrières
une cure de jouvence et un moyen de se débarrasser de sa paresse de jeune garçon. Rite
de passage s’il en est, il s’agissait d’entrer dans l’âge adulte par les armes.
Dans Prélude à Verdun, Jules Romains utilise l’image du jeu dans un processus
de distanciation, que l’on ne retrouve pas chez un Benjamin patriotique. Le discours de
Romains, dans une vision unanimiste et qui fait concourir une multitude de propos et de
réflexions pacifistes, affirme que la guerre est une chose horrible qu’il faut dénoncer. Ici,
l’association du départ au front à un départ en vacances dénote d’un procédé ironique,
qui vise à incriminer non pas tant l’esprit guilleret de certains soldats lors de la
mobilisation, mais la duperie insufflée aux troupes par les responsables militaires et
politiques. L’ironie de Romains n’attaque pas tant l’ignorance des soldats que le
discours de désinformation militaire qui cherche à occulter une sordide réalité tout en
jouant sur le terrain de la masculinité et de ses traditionnels et supposés attributs : force
physique en action, rudesse, insensibilité. « Mais chez les uns comme chez les autres il y
avait encore l’excitation de partir pour des vacances bruyantes, brutales, tumultueuses ;
de vraies vacances de garçons (…). On allait se reposer de la paix. (…) On allait s’offrir
!
!
44!
une période d’insouciance et de sans-gêne, une orgie de mouvements brusques, sans
aucun égard pour les choses fragiles, une cure de grossièreté primitive, de tout à fait
mauvaises manières, d’impolitesse radicale81 ». La partie enfantine et par essence
masculine du soldat insouciant qui part en guerre est celle qui sera satisfaite par « la cure
de grossièreté primitive ».
Par un procédé de retournement, Romains montre comment les idées pacifistes
sont contestées par ceux qui soutiennent l’entrée en guerre, arguant que la mobilisation
et les contacts avec la vie militaire seront une grande aventure. « Pour empêcher tous ces
civils en armes de flairer la paix défendue, pour maintenir l’état d’irritation et de
saignement le contact entre les deux peuples, il suffisait sans autre appel au zèle ni au
courage, d’utiliser ça et là chez les individus le besoin de distraction, la fierté d’être
adroit, le gout de la chasse, l’amusement de l’aventure, un rien de cruauté bon
enfant82 ». L’ironie de l’auteur augmente au fil du texte. Les « vacances » deviennent
bientôt « ludiques » et la guerre prend l’allure d’un tournoi sportif colossal :
L’évènement qui sortirait de tout cela participerait de la grande industrie du sport. (…) Un sport où les balles de jeu, faites d’acier et d’explosifs, pèseraient d’une demi-livre à une demi-tonne ; où les équipes seraient de trois cent mille hommes, où les chutes et les foulures seraient remplacées, à foison, par de la cervelle éclatée et des ventres ouverts ; où la ligne de poteaux qui formait le but, c’était à cent kilomètres de la ligne de départ, les clochers du Quesnoy, du Nouvion, de Sedan83. Les proportions d’un jeu d’équipe « classique » sont augmentées, à l’échelle de
l’engagement réel des forces en 1914, soulignant ainsi la consommation outrancière des
réserves humaines et matérielles. L’ironie qu’accentue le spectacle de la disproportion
rappelle que Romains n’était pas dupe de cet esprit festif qui accompagne la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!81 Jules Romains, op. cit., p. 4. 82 Jules Romains, op. cit., p. 33. 83 Ibid. p. 39.
!
!
45!
mobilisation. Il s’agit alors de dénoncer l’irresponsabilité de la hiérarchie militaire qui
oublie sciemment de considérer l’homme à l’échelle individuelle. En noyant le soldat
dans une masse, en jetant deux équipes l’une contre l’autre, il est plus facile d’évoquer à
l’issue de la guerre un gagnant et un perdant. Plus besoin donc de dénombrer les morts
et d’affirmer que la vraie perte réside dans la perte humaine. Le changement d’échelle
est à ce titre d’égale importance : en imaginant par la narration une guerre
macrocosmique, Jules Romains de façon ironique fait oublier l’individu et propose un
conflit aux proportions immenses qui peut-être, permettrait d’empêcher toute réflexion
morale sur le sens de la guerre.
Chez Élie Faure, la guerre est une création sous forme de jeu, intrinsèque au
cours de l’Histoire, qui permet à l’homme « de ne pas mourir de désespoir devant le
néant de la vie84 ». Un jeu forcé où les protagonistes deviennent mauvais perdants : « Le
Français joue à la guerre, et, dès qu’il est battu, accuse l’autre de tricher 85 ».
Probablement parce qu’au jeu de la guerre, et c’est là l’ambivalence soulignée par Faure,
l’homme prend difficilement goût. « Mais brave homme, si seulement on te forçait,
même quand tu ne l’aimes pas, de jouer à la manille pendant deux ans sans arrêt, ou au
football pendant huit jours, rien que huit jours, même si tu es pied-bot ? Qu’en dirais-
tu ?86 ».
Tout comme Jules Romains et René Benjamin, Gabriel Chevallier dans La
Peur87 choisit de faire commencer son récit au moment de la mobilisation. « Le feu
couvait déjà dans les bas-fonds de l’Europe, et la France insouciante, en toilettes claires,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!84 Elie Faure, op.cit., p. 75. 85 Élie Faure, op. cit., p. 61. 86 Ibid., p. 141. 87 Gabriel Chevallier, La Peur, Paris, Le Dilettante, 2008.
!
!
46!
en chapeaux de paille et pantalons de flanelle, bouclait ses bagages pour partir en
vacances88 ». La guerre arrive comme une rupture dans la monotonie du temps, temps de
travail pour la plupart des soldats qui partent en guerre. Les activités coutumières
s’arrêtent pour laisser place à autre chose qui, pour la plupart des appelés, est inconnu.
Peu nombreux sont les vétérans de 1870 qui repartent au front en 14 et les récits de
guerre véhiculés lors de la guerre franco-prussienne ne sont que des souvenirs relayés à
une sphère de l’inconnu. Le récit de Chevallier commence également sur une note
insouciante, renforcée un peu plus loin par « Ça commence comme une fête89 ». Là
aussi, le récit parle d’une grande aventure90, collective, où « […] un besoin de briser les
choses, de sauter les palissades et de violer les lois, rendirent, au début, la guerre
acceptable. […] Par-dessus tout régnait une atmosphère qui tenait de la fête foraine, de
l’émeute, de la catastrophe et du triomphe, un grand bouleversement qui grisait91 ». La
question du rire et du jeu se transforme quand le narrateur s’interroge sur le changement
de ressenti : « Le premier mois de service ressembla à une mascarade92 ». Qui donc rit
ou se rit de l’autre ? Pour Chevallier, les soldats sont les pantins d’un ordre militaire
incompétent, dangereux et dont il faudra sans cesse se méfier. D’autant que le soldat
n’est pas dupe affirme Drieu La Rochelle : « [il] ne hait rien tant que l’exercice qui
prépare la parade, ce piège pour son cœur d’homme93 Et bientôt, le « simulacre
inutile94 » symbole de l’inaction et l’ennui laissera la place au théâtre mais non moins
irréel de la guerre. Il faut attendre le troisième chapitre de La Peur pour que le jeu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!88 Ibid. p. 15. 89 Ibid. p. 17. 90 Ibid. p. 20. 91 Ibid. p. 21. 92 Ibid. p. 30. 93 Pierre Drieu La Rochelle, La Comédie de Charleroi, Paris, Gallimard, 2007 [1934], p. 103. 94 Ibid. p. 30.
!
!
47!
cesse : « Notre arrivée dans le cercle enchanté fut une désillusion95 ». Chez Chevallier,
le jeu est un préliminaire à la guerre et la « grande aventure » n’est qu’une projection de
l’arrière : « Les gens de l’arrière aiment à se représenter la guerre comme une fameuse
aventure, propre à distraire les jeunes hommes, une aventure qui comporte bien quelques
risques mais compensée par des joies : la gloire, des bonnes fortunes, l’absence de
soucis96 ».
Chez Jules Romains, le jeu prend une autre forme au cours du récit : c’est une
image qui a la possibilité de se substituer à la guerre. Ainsi Jerphanion, protagoniste
principal de Prélude à Verdun (puis de Verdun) aura besoin de se créer un espace de jeu
mental pour s’extraire temporairement de ce qui l’entoure, tout en incluant dans ce jeu
des éléments du réel. « Alors Jerphanion se mit à construire à tâtons une rêverie […].
Elle ressemblait au jeu qu’un enfant de pauvres installe dans l’arrière-cour puante d’une
caserne de pauvres : c’est-à-dire un jeu qui ne prétend pas supprimer les horreurs
d’alentour, qui consent à s’y enfermer, qui les utilise même comme décor ou matériaux
de sa fantaisie et, dans cette espace de désolation qu’il admet, réussit à loger une
consolation d’autant moins fragile97 ». Le constat est inévitable : la guerre sera longue et
au-delà d’un espace de liberté mentale, de rêveries, il faudra se construire un espace de
vie malgré les privations.
2- Précarités
Les fanfaronnades du début de guerre sont bien vites remplacées par l’amer
constat de l’échec d’une guerre de mouvement ainsi que d’un retard en matière tactique
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!95 Gabriel Chevallier, La Peur, op. cit., p. 39. 96 Ibid. p. 168. 97 Jules Romains, Prélude, op. cit., p. 57.
!
!
48!
et doctrinale. Amertume aussi face à ce qui est vu comme de l’incompétence de la part
de l’organisme décisionnel militaire. Dès septembre 191498, le conflit s’enlise et guerre
de siège et batailles d’attrition essoufflent considérablement les armées en présence. Le
développement d’une formidable puissance de feu n’est malheureusement que peu suivi
par une stratégie de mobilité des troupes. Dans l’incapacité de remporter une victoire
décisive à la suite d’une attaque de l’infanterie, les armées adverses adoptent une
stratégie défensive et n’ont plus d’autre choix que de mener une guerre de position. Un
ample réseau de tranchées est progressivement mis en place.
Ce passage de la guerre de mouvement à la guerre de tranchées impose aux
poilus de nouvelles conditions de vie. Il leur faut désormais s’installer et attendre et ceci
implique la mise en place d’un espace où les soldats devront désormais tour à tour
attendre, stocker les vivres et le matériel, veiller, dormir, se protéger tant bien que mal
du feu adverse, se laver, cuisiner, parfois se distraire, pour certains écrire. Ce qui compte
avant tout, c’est de bâtir un abri afin de ne plus être directement à la vue de l’ennemi.
Cependant, échafaudés dans un moment d’extrême nécessité, les abris des soldats - les
témoignages des œuvres littéraires comme historiographiques le confirment - sont
construits sur le même espace où ont lieu les combats le plus souvent (ou tout du moins
juste en arrière des premières lignes) et choisis dans l’espace de vie immédiat du soldat.
Les matériaux constituant les abris, qui sont souvent des matériaux de récupération, sont
précaires. Parfois, les abris sont directement construits à même la terre. Le CRID donne
de la cagna la définition suivante (synonymes : abri, gourbi, guitoune..) : « abri léger,
dans la terre ou fait de boisages, où peuvent se tenir les combattants en cas de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!98 À ce sujet, voir Robert Doughty, Pyrrhic Victory, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2005, p. 105-152.
!
!
49!
bombardements ou d’intempéries par exemple. Les abris de première ligne peuvent être
dénommés cagnas mais c’est relativement rare, le terme s’applique davantage aux
secondes lignes et en deçà99 ». Pour comprendre la précarité de la vie de soldats, il faut
s’attarder sur la description faite de leur environnement immédiat. Ces espaces de vie
sont souvent décrits dans les récits de guerre comme un espace dans l’espace, sphère
particulière au sein de la zone de front d’où se pressent l’exil. Il serait intéressant
d’évoquer un parallèle entre cet espace ainsi créé et la thématique de l’enveloppement
développée par Michel Tournier que j’aborde dans une partie suivante100. Bien qu’étant
proche voire face à la mort, l’écrivain combattant insiste sur cette nécessité qu’il a de
reproduire un espace psychique enveloppant, projection mentale d’une protection que le
corps et l’esprit soumis à une peur constante réclament.
Jean Dartemont, le narrateur de La Peur insiste sur la diversité du type d’abris
mais aussi sur le détournement d’objets à des fins de constructions : « les abris, de
dimensions et de formes variées, creusés dans les flancs de la terre, présentaient un
curieux spectacle. Ce qui frappait surtout dans ces installations de fortune, c’est que les
matériaux utilisés pour leur établissement étaient déjà des déchets et des rognures :
vieux bois, vieilles armes, vieux ustensiles de cuisine101 ». La construction de ces abris
de fortune n’est due qu’à l’ingéniosité de soldats totalement dépourvus de moyens selon
Chevallier.
Du fait des matériaux utilisés et de la consistance d’un terrain en permanence
fragilisé par les bombardements, ces abris n’ont que peu de valeur défensive. «L’obus
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99 Cette définition du mot « cagna » est celle du CRID (Collectif de Recherche Internationale et de Débat sur la Guerre de 1914-1918). http://crid1418.org/ La définition ajoute que « Le mot est d’origine indochinoise, sans doute transmis par des troupes coloniales ». 100 « Le poilu, homme des cavernes ? », p. AJOUTER PAGE À la dernière minute 101 Gabriel Chevallier, La Peur, op. cit., p. 57.
!
!
50!
est tombé juste sur la cagna ; tout a cédé : les poutres, les étais, les rondins sont en
poudre. La terre a comblé tout ça. Les malheureux ont un mètre de débris au dessus
d’eux ! » nous dit Raoul Pinat102. L’abri constitue donc un mince repli mais ce qui
prévaut dans la plupart des textes c’est l’aspect symbolique de ce lieu de repli possible.
C’est le « chez soi » des soldats, la création ex-nihilo ou plutôt ex-horreur d’un espace
familier en lieu hostile. « C’est dégueulasse de se pieuter comme ça dans la flotte.
Système D. Faut dénicher une guitoune un peu soi-soi103 » suggère le caporal Joze dans
Le Sel de la Terre. Cet espace c’est aussi un des espaces d’écriture pour l’écrivain
combattant. C’est la maison : « Légère et perméable au froid, notre guitoune. Deux
piquets fourchus supportant un rondin en guise de maîtresse poutre, d’autres rondins
coupés au hasard, tors, inégaux, s’appuyant du bout à cette maîtresse poutre, et cela fait
une maison104 ». Chez Dorgelès, la description de la guitoune varie en fonction, bien sûr
de ses déplacements sur le front mais aussi du destinataire de ses lettres. Ainsi à sa mère,
le 19 décembre 1914 il écrit : « Je suis sous ma cabane tapissée de paille105 ». Mais à
Mado il écrira : « Figure-toi une sorte de trou, ouvrant sur la tranchée. 1m50 de large,
1m50 de haut, 2m50 de profondeur. On ne peut se tenir ni debout ni couché106 ». La
cabane devient inhospitalière. Car ce fragile abri prend parfois l’allure d’une sépulture et
le soldat est bien conscient qu’il peut aussi y mourir : « La nuit, j’ai couché longtemps
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!102 Carnet de Raoul Pinat, in Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front, Paris, Radio France/Librio, 1998, p. 52. 103 Raymond Escholier, op. cit., p. 16. 104 Maurice Genevoix, Sous Verdun, in Ceux de 14, Paris, Flammarion, 2007 [1950], p. 129. 105 Micheline Dupray, op. cit., p. 144. 106 Ibid. p. 147. On peut ici penser également aux cellules de malconfort qui existaient au Moyen-Âge et que Clamence, personnage d’Albert Camus évoque dans La Chute : « C'est vrai vous ne connaissez pas cette cellule de basse-fosse qu'au Moyen-Age on appelait le "Malconfort".[…] Cette cellule se distinguait des autres par d'ingénieuses dimensions. Elle n'était pas assez haute pour qu'on s'y tînt debout, mais pas assez large pour qu'on pût s'y coucher. ».
!
!
51!
dans un tombeau neuf, puis on a changé de cantonnement et je suis maintenant dans un
trou que j’ai creusé après un talus107 ».
La tension permanente qui existe entre l’abri comme espace familier et l’abri
comme lieu de mort potentielle, se déploie dans la plupart des livres du corpus. C’est
l’imprévisibilité du milieu, avant tout, qui fait des abris tour à tour un lieu familier ou un
lieu dangereux : « Voûte de cave, en pays paisible, elle eût pu tenir comme cela
indéfiniment. Mais la guerre, il ne faudrait pas l’oublier, crée des conditions très
particulières. Un obus tombant juste au-dessus, qu’arrivera-t-il ?108 ». Le paradoxe entre
ce besoin de sécurité, parfois illusoire, et la crainte que ce même lieu soit celui de
l’ultime ensevelissement du fait de sa précaire solidité, est très bien exprimé par le
personnage de Jerphanion : « Ce qui lui rappelait qu’il avait souvent à mettre d’accord
deux sentiments contradictoires : un goût pour les cavités souterraines, pour la profonde
sourde sécurité qu’elles donnent et la peur, à tous ses degrés, de l’étouffement et de
l’écrasement109 ».
À cette précarité de l’habitat s’ajoute celle du quotidien. Les outils usuels sont
rares et surtout, leurs usages communs détournés et multiples. Les casques servent
d’assiettes, les couteaux de cuisines à nettoyer les tranchées adverses. « (…) les lacets de
souliers, les bretelles, les boutons de culotte, les ceintures, tout ce qui te sert à amarrer
tes fringues, c’est des ustensiles qu’il ne faut pas négliger !110 », raconte un soldat.
Cette précarité matérielle s’accompagne d’une grande insalubrité. L’humidité, la
boue, les rats, la présence des feuillets [latrines], les cadavres si proches des vivants, les
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!107 Brigadier Taupiac, Paroles de Poilus, op. cit., p. 90. 108 Jules Romains, Prélude, op. cit., p. 55. 109 Ibid. p. 55. 110 Gabriel Chevallier, La Peur, op. cit., p. 68.
!
!
52!
plaies purulentes : autant de conditions qui participent au développement des maladies et
accroissent le taux de décès dans le rang des soldats. Le manque de confort renforce le
sentiment de solitude et de marginalisation vis à vis de l’arrière.
Les tranchées, îles désertes ?
Quand même, la vie des soldats est plus calme qu’au début, quand on n’avait pas encore interdit l’alcool dans l’île. Élie Faure, La Comédie, p. 142.
Plus le temps passe, plus la vie au front ressemble à une vie d’exil. C’est sur ce
thème que Pierre Schoentjes aborde son chapitre sur les « Robinsonnades 111 ».
Progressivement, à la place du soldat fraîchement doté lors de la mobilisation, c’est un
homme hirsute que l’on voit apparaître dans les textes. En effet, l’on retrouve plusieurs
éléments dans le roman de guerre qui confèrent au poilu au front des allures de
Robinson : isolement, retour à un mode de vie rudimentaire et dépouillé, fabrication
d’objets à partir de matériaux trouvés sur place, tenue d’un journal mais aussi apparence
physique, aspect que je développerai dans un chapitre ultérieur.
Je souhaiterais établir ici un parallèle entre une vision qui émane de certains
personnages des ouvrages qui nous concernent et le thème littéraire des robinsonnades,
c’est-à-dire propre aux récits de survies insulaires qui ont émergé et se sont répandus au
XVIIIe siècle112 et dont on retrouve encore des traces au XXe siècle113. Si l’on ne peut
pas à proprement parler faire d’analogie exacte avec un mode de vie calqué sur celui de
Robinson, il est évident néanmoins que les tranchées constituent un espace en marge. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 Pierre Schoentjes, Fictions, op. cit., p. 141. 112 Ce thème provient notamment des discussions qui ont eu lieu, dès le XVIIIe siècle en Allemagne, en France et en Angleterre sur la valeur de la civilisation. Je pense évidemment à l’œuvre de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 1719 pour l’œuvre maîtresse mais aussi par exemple Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761, notamment le passage dans le jardin de Julie qui est de toute évidence une allusion à Robinson Crusoé. 113 Cf. Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, 1967
!
!
53!
Par ailleurs, la création d’un personnage qui ressemble étrangement à Robinson n’est
pas fortuite en ce qu’elle met en scène l’espace narratif comme théâtre d’une réflexion
profonde sur le monde, la modernité, le rapport des soldats à leurs semblables et leurs
questionnements sur l’idée d’altérité, la rupture du lien sociale occasionné par la guerre.
L’intertextualité me paraît en l’occurrence justifiable si l’on se souvient que c’est Pierre
Mac Orlan, auteur de Les Poissons-Morts, qui préfaça en 1926 La Vie et les aventures
étranges et surprenantes de Robinson Crusoé114. Cette littérature ne lui est donc pas
étrangère. Certes, les modalités de représentation, notamment celles que constitue
l’arrière-plan, décor narratologique, changent. L’île déserte devient la tranchée,
Robinson est démultiplié en autant de solitudes que d’hommes au front. Mais les
« objets-emblèmes115 » dont la littérature de guerre pare le soldat rappellent étrangement
la description que fait Defoe de son Robinson. Voici l’image qu’en donne Pierre Drieu
La Rochelle : « Avec sa peau de bique, sa barbe de huit jours, ses mains grises, ses yeux
hébétés de prisonnier, il me fit penser à Robinson. Oui, nous étions des Robinsons,
pauvres humains engloutis dans ce chaos déchaîné par nous-mêmes. Depuis des mois et
des années, nous survivions, dans une solitude inénarrable (…)116 ». La peau de bique
rappelle la peau de bête que porte Robinson, soulignant à la fois ce même refus de la
nudité et cette incapacité à abandonner totalement l’habit mais rappelant l’état de
sauvagerie dans lequel la guerre met les soldats ; « un homme vêtu de peaux de chèvres,
à la figure encore plus sauvage que ses vêtements » écrit Jules Vernes en 1879117 au
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!114 Cf. Lise Andries, « Les images et les choses dans Robinson et les robinsonnades », Études françaises, vol. 35, nº 1, 1999, p.95-122, p. 117. 115 Ibid, p 96. 116 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 114. 117 Jules Vernes, Les Grands navigateurs du XVIIIe siècle, Hetzel, Paris, 1879, p. 12.
!
!
54!
sujet d’Alexandre Selkirk, marin écossais qui a inspiré le roman originel de Defoe,
Robinson Crusoé.
L’usage du pluriel dans la citation de Drieu La Rochelle accentue l’idée que le
front crée un agglomérat de solitudes, celle d’hommes qui se tiennent parmi et en face
d’autres hommes tout en abandonnant progressivement, individuellement et
collectivement leur part d’humanité et de culture commune. C’est d’ailleurs en ce sens
que la robinsonnade classique diffère du roman de guerre : la solitude au front se vit
dans un environnement qui paradoxalement ne supporte pas l’unicité et implique une vie
de groupe qui s’oppose à un autre groupe, celui des « Robinsons voisins118 » écrit Drieu.
Néanmoins, l’hébètement des soldats tel que Drieu l’évoque renforce leur isolement et
c’est bien ce même début de folie qui guette le Robinson de Defoe.
Robinson n’est évidemment pas sur l’île dans les mêmes circonstances que les
poilus sont au front et le Robinson que nous connaissons tranche du poilu pour plusieurs
raisons. Alors que la majeure partie du temps du héros insulaire est occupée par
l’accumulation d’objets qui lui rappellent le monde civilisé, transformés mentalement
comme autant de décors oniriques, supports de la narration, le temps du poilu est scandé
au contraire par un processus de séparation forcée d’avec le monde matériel et
psychologique civilisé. Néanmoins, au même titre que Robinson, le poilu va tâcher de
garder des points de repère avec la civilisation, l’arrière-front, pour éviter la folie qui
prouve le décrochement total d’avec le monde réel119. De nombreux textes évoquent les
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!118 Ibid., p. 114. 119 Je pense à Conrad, dans Au cœur des ténèbres « I had to deal with a being to whom I could not appeal in the name of anything high or low… There was nothing either above or below him and I knew it. He had kicked himself loose of the earth », Joseph Conrad, Heart of Darkness, Boston and New York, St. Martin's Press, 1996, p. 83. La perte de l’habitude et du domaine du connu détache le soldat de toute prise avec le réel et le plonge dans la folie.
!
!
55!
soldats en train de bricoler, de concevoir ou détourner des ustensiles pour en créer de
nouveaux. Toute une collection d’objets fabriqués au front a ainsi pu être répertoriée, du
coupe-papier à la confection de pipes ou de bagues, notamment fabriqués avec des restes
d’obus. Cette création ressemble étrangement à la création d’objets qui occupe
Robinson, en ce qu’elle procède d’un nécessaire détournement de l’utilité première d’un
objet dans une optique de réappropriation. Par le moyen d’objets crées, appropriés,
nommés, auxquels ils donnent une fonction particulière, les poilus refaçonnent ainsi un
univers familier. Une fois encore, il s’agit de scander le monde qui les entoure, de le
jalonner de points de repères connus pour ne pas être totalement hors du monde culturel.
Lise Andries évoque elle, chez Robinson, le besoin de « quadriller l’espace, de
domestiquer le temps, de hiérarchiser les règnes, de classer et d’étiqueter l’univers120 ».
Mais si pour Robinson, cette accumulation d’objets répond à un besoin de « conjurer le
spectre de la solitude par la compagnie des choses121 », elle permet au soldat en
revanche de recréer un espace d’intimité, une sphère individuelle dans un monde où si la
solitude d’avec les êtres chers est pesante, la constante proximité avec d’autres hommes
peut être pénible.
L’étude du lieu de vie des soldats est à mon sens fondamentale dans la
comparaison d’avec le thème de la robinsonnade en ce que la tranchée participe à
l’isolement individuel et collectif (front versus arrière-front) de ceux qui y vivent. Tout
comme l’île de Robinson, l’espace même des tranchées est un espace à part et ce pour
plusieurs raisons. C’est tout d’abord un espace jusqu’alors non envisagé comme tel – un
espace en soi – dans l’imaginaire collectif puisque totalement nouveau dans ses
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!120 Lise Andries, « Les images et les choses dans Robinson et les robinsonnades », Études françaises, op. cit., p. 108. 121 Ibid, p. 112.
!
!
56!
modalités de construction, de vécu et de représentations ; c’est aussi un espace où les
moyens de communication sont particulièrement restreintes, ce qui accentue l’isolement
des poilus qui y passent parfois plusieurs mois. Peu à peu, le front se construit comme
un autre monde, un autre continent, la tranchée se déroulant comme métaphore du
gouffre qui va progressivement séparer « l’arrière » du front, les gens « civilisés » des
soldats.
La tranchée isole tout d’abord visuellement le soldat du monde qui l’entoure.
L’objectif est bien évidemment de cacher activités et positions à l’armée adverse mais
par conséquent, le soldat a le plus souvent accès, visuellement parlant, à un espace très
limité. Pour preuve, le peu de descriptions que nous possédons de l’apparence physique
du soldat allemand dans les textes étudiés, pour la simple et bonne raison que les
contacts directs avec l’ennemi étaient rares. Il était d’autant plus inhabituel de pouvoir
voir clairement l’ennemi debout, le regard ne portant pas plus loin que les parois des
tranchées. Il s’agit d’une guerre « contre un ennemi invisible122 ». Les seuls contacts qui
aient été suffisamment longs afin de permettre une description physique précise de
l’ennemi se sont faits soit pendant les brèves trêves, soit par le contact avec des
cadavres123.
La tranchée isole également car elle réduit la vitesse de déplacement des soldats.
Les marches d’un poste à un autre sont soit interrompues par des attaques de l’artillerie
adverse, soit du fait du peu de praticabilité des sols. Espaces restreints, les boyaux sont
tout simplement trop encombrés par le va et vient des hommes, des blessés, des
transports de vivres et d’équipement. Lors de pluies ou de bombardements, les allers et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!122 Maurice Genevoix, Sous Verdun, op. cit., p. 123. 123 Je reviendrai à l’une de ces descriptions donnée par Chevallier plus loin, dans une partie sur les rivalités mimétiques.
!
!
57!
venues dans les tranchées sont d’autant plus ralentis. Le courrier et les contacts avec
l’extérieur et l’arrière pâtissent eux aussi de cette lenteur de déplacement. Lenteur du
courrier, lettres qui se croisent et parfois n’arrivent pas à destinations, ordres militaires
incomplets, voici autant de difficultés matérielles qui contribuent à la progressive
désocialisation du soldat au front. Cette coupure se ressent aussi quant à la différence de
perception qu’ont le front et l’arrière de la guerre. Ainsi, le narrateur de La Peur alors
qu’il tente de faire valoir sa perception sur la guerre avec l’une des infirmières qui le
soigne alors qu’il est blessé, finira par conclure : « L’avant et l’arrière, je m’en rends
compte, ne peuvent pas se comprendre124 ». Ce même narrateur insiste beaucoup sur
cette incompréhension qui a parfois lieu entre un soldat et sa famille. Voici comment se
termine sa permission : « Nous sommes côte à côte, mais nos pensées sont très
éloignées. Un père et un fils ? Oui, sans doute. Mais surtout : un homme de l’avant et un
homme de l’arrière… Toute la guerre nous sépare, la guerre que je connais et qu’il
ignore125 ». Gaston Biron, dans une lettre à sa mère datée de juin 1916, exprime avec
amertume « l’égoïsme et l’indifférence126 » des proches qu’il a pu voir lors de sa
permission. Non seulement l’avant et l’arrière constituent deux espaces séparés,
physiquement, mais la rupture, progressive, est accentuée par une incompréhension
entre soldats et familles de soldats. Souffrant d’un isolement forcé, les soldats
s’affublent bientôt eux-mêmes du surnom de Robinson. C’est alors l’image du Robinson
de Defoe comme celle d’un homme seul face aux éléments qui trouve son écho dans le
roman de guerre. De la même façon que Robinson « héros insulaire », vit « entre pénurie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!124 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 136. 125 Ibid, p. 169. 126 Gaston Biron in Paroles de Poilus, op. cit., p. 104.
!
!
58!
et abondance ou accumulation127 », les personnages de La Peur ou de Prélude à Verdun,
alors qu’ils sont au front, alternent entre considérations sur une vie matérielle et pratique
rudimentaire d’un côté, et considérations intellectualisées sur l’expérience de la guerre et
ses conséquences morales et mentales de l’autre. La solitude y est à la fois celle
de l’intériorité des personnages, à la fois celle qui les exclut du monde social de
l’arrière. Elle est celle du moment de l’écriture, retranscrite dans le cadre des lettres, de
la tenue d’un carnet ou de la création romanesque.
Cependant, jusqu’où pousser cette coupure sociale, cet isolement ? Si la guerre
rompt le tissu social, séparant des familles, des couples, géographiquement puis à
termes, physiquement, dans la douleur de la perte et du deuil, il ne faut néanmoins pas
oublier que le social – en tant qu’interactions codifiées entre ses membres – n’est pas
absent du front. C’est ici donc que je reviendrai sur le propos de Pierre Schoentjes pour
qui « le soldat cherche à s’inscrire dans un lieu, à le faire sien128 ». Réduits à un mode de
vie frugal, les hommes ne doivent pas néanmoins oublier de maintenir les conditions
minimales à leur survie. La recherche de confort, d’un « chez soi », auquel je fais
allusion précédemment, se double d’une réappropriation et de la création d’une nouvelle
organisation sociale par les soldats, souvent sans la nécessité d’une validation
hiérarchique à haut niveau. Pour que leur lieu de repos – le marabout – reste un endroit
vivable – c’est-à-dire pourvu d’un confort primaire tel que procurer de la chaleur – un
poilu en a la charge : « Tu resteras, Cabirac, pour garder la guitoune et entretenir le
feu129 ». Ainsi la hiérarchie militaire se double d’une hiérarchie dans les tâches
quotidiennes à accomplir. Nous en revenons à ce besoin qu’a Robinson de « hiérarchiser
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!127 Jacques Dubois et Lise Gauvin, « Présentation », Études françaises, vol. 35, n° 1, 1999, p. 3. 128 Pierre Schoentjes, Fictions, op. cit., p. 143. 129 Raymond Escholier, Le Sel de la Terre, op.cit. p. 33.
!
!
59!
les règnes » afin de garder en lien les repères civilisationnels qui étaient les siens avant
l’entrée en guerre.
Il me semble qu’il faille comprendre l’isolement comme le résultat d’une rupture
ambiguë et non irrémédiable entre le front et l’arrière. Si le soldat est isolé, il faut bien
néanmoins que la communauté de soldats, elle-même dans une situation d’isolement
perçu, se sente rattachée à la communauté civile car sinon, comment et pourquoi
défendre le territoire national ? L’on ne peut affirmer que l’isolement ait été total et
complet dans la durée. Cependant, cette rupture a été suffisante pour qu’elle soit intégrée
dans une forme d’écriture de la guerre, mise en mots et conçue comme un sujet
d’inquiétude à part entière, suffisante aussi pour que soit remise en question la place et
la nature de l’humain, son lien et sa place avec/dans l’Histoire. Cette grande solitude
vécue par les poilus, accompagnée d’un mode de vie précaire, a probablement poussé
des auteurs à reconsidérer leur place et celle de leurs contemporains au sein de la
modernité naissante qu’offrait le XXème siècle d’avant-guerre.
Je dirais alors que la robinsonnade dans le roman de guerre peut être évaluée
comme le pendant « positiviste » du « primitivisme », le versant cultivé du retour à un
« état de nature ». Le glissement thématique que l’on peut opérer entre robinsonnade et
primitivisme passe par une perte progressive des repères moraux engendrés par
l’avènement de la modernité en ce début de siècle. L’apparente, tout d’abord innocente,
puis cruelle métaphore du jeu et des vacances pour exprimer la guerre, ainsi qu’une mise
à distance du monde des civils opérée par une analogie au moyen du thème de la
robinsonnade, permet un cheminement vers un temps passé, qui laisse progressivement
modernité et progrès de côté et fait place à un nouvel espace-temps. Le monde de la
!
!
60!
guerre, des tranchées, des interactions violentes au cœur des narrations proposent un
retour en arrière radical : l’homme en guerre ne porte plus en lui aucun espoir de progrès
et est propulsé dans les confins d’un espace mental originaire, aux premiers stades d’une
humanité privée de culture.
!
! 61!
Chapter II – Retour vers des temps immémoriaux
Partout où la violence fait irruption comme événement, elle détruit le temps, Wolfgang Sofsky130
Cet homme insouciant qui partait en guerre, tel le personnage de Benjamin dans
Gaspard, découvre rapidement une réalité qui l’emmène aux limites de l’imaginable et
du représentable. Ainsi, beaucoup d’auteurs sont dans l’incapacité de restituer leur
expérience au front ou alors s’y refusent. Carine Trévisan et Joanna Bourke affirment
toutes deux à leur manière qu’il existe chez certains écrivains combattants une
incapacité à dire la violence ou à penser le phénomène guerrier comme lié à des actions
meurtrières. Pourtant, la plupart des auteurs du corpus que nous considérons essaient de
proposer une représentation de la guerre qui correspond aux horreurs qu’ils y ont vécues,
en utilisant, nous le verrons, un processus qui désengage le sujet agissant du temps
présent.
La question de l’acte d’écriture est fondamentale car c’est l’existence même de la
guerre, événement mouvant qui bouleverse un ordre – celui de la paix – et qui fait réagir
le sujet, alors précipité dans une situation qui lui est a priori inconnue. Quelles sont les
formes littéraires possibles de cette réaction ? C’est au moment du « choix » de
l’écriture que se développe une situation dialogique entre une condition – être en guerre
ou avoir été en guerre – un milieu – le front, les tranchées – et le sujet pensant/écrivant.
Les modalités de représentations de l’homme en guerre se heurtent à une constante
tentative de redéfinition du genre humain, de description de ce qu’est l’homme
confronté à une telle expérience, dans tout ce qui le définit, tant sur le plan moral que
physique. Ce processus mental et intellectuel de redéfinition passe par le renvoi de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!130 Wolfgang Sofsky, L’Ère de l’épouvante, Paris, Gallimard, 2002, p. 102.
! ! !
!
62!
l’homme dans des temporalités éloignées de la contemporanéité vécue et qui pourtant se
côtoient dans un même espace-temps de narration.
Alors que le XXe siècle s’ouvrait sur des promesses de progrès social et moral,
lié notamment à un formidable essor technologique, la Grande Guerre remet en question
l’idée de modernité. Dans le sillage des Lumières prévaut une croyance dans un « sens
de l’Histoire » qui apporterait une amélioration continue de la vie en société et des
conditions de vie en société. Or la somme des violences vécues trouve difficilement de
place et de justification au cœur d’une civilisation qui se pense dans la modernité. La
question d’une probable régression civilisationnelle et morale se pose donc, pensée au
travers d’une thématique non négligeable qui parcourt les récits de guerre : c’est celle du
primitivisme dont je vais justifier l’emploi. L’appel à cette notion permet au témoin qui
retranscrit son expérience de la guerre de donner un cadre sémantique et un arrière-plan
narratif où se meuvent les éléments d’un sentiment de rupture profonde, temporelle,
mais aussi psychologique, d’avec le monde tel qu’il se présentait au début du siècle131.
Si la terminologie usitée peut surprendre dans le cadre d’une analyse littéraire du roman
de guerre, il faut néanmoins la comprendre dans un contexte particulier et surtout la
sortir de son champ d’application premier qui tend à établir une hiérarchie au cœur des
sociétés humaines. Il ne s’agit pas ici d’associer le cadre de l’écriture de la guerre et la
question de l’homme dans des sociétés dites primitives, mais plutôt d’analyser la
présence et l’emploi fréquent du mot même et de ses déclinaisons adoptées dans les
œuvres étudiées.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!131 Sans aller jusqu’à comparer cette rupture avec la révolution copernicienne, je m’accorde avec les analyses qui voient dans la Grande Guerre comme un événement ayant occasionné un bouleversement des représentations culturelles, sociales, artistiques ainsi que la façon de se penser dans le monde.
! ! !
!
63!
Du mot primitif, il existe plusieurs acceptions de la définition. Tout d'abord, est
primitif ce qui est « relatif aux groupes humains contemporains qui ignorent l'écriture,
dont l'organisation sociale et culturelle, le développement technologique n'ont pas subi
l'influence des sociétés dites évoluées132 ». Pour Anne-Christine Taylor, par ailleurs, la
définition acceptée au XIXe siècle permet de conférer au mot une proximité avec les
« états originaires de l’humanité, les sauvages n’[incarnant] qu’une métaphore appauvrie
de l’histoire passée des civilisés, puisqu’ils sont condamnés par la “malédiction
organique“ à la stagnation culturelle133 ». Nous n’écarterons pas totalement ici cette
définition ethno-sociologique mais il conviendra de l’utiliser avec prudence. En ce qui
concerne l’ignorance de l’écriture, il y aurait une remarque à faire dans la mesure où ce
qui point dans les textes c'est justement un face à face « lois écrites » d’un côté et
« liberté totale » de l’autre. La dimension civilisationnelle de cette définition entre en jeu
si l’on considère que le poilu au front effectue un retour à un état « pré-social » et si l’on
examine la guerre comme un phénomène mettant potentiellement en mouvement un
processus de « désocialisation ». Dans l’univers des tranchées, les lois du vivre
ensemble qui sont garantes de l’humanité et de l’intégrité de l’homme sont émoussées
par une confrontation continue avec une violence inouïe. Séparé du corps social, comme
nous l’avons vu, le soldat n’est plus soumis aux mêmes normes mais n’est plus non plus
protégé par elles : le cadre social se disloque, ne garantissant plus la sécurité et la
pérennité d’un espace-temps « civilisé ». La sauvagerie a alors tout le champ libre pour
s’exprimer.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!132 Définition proposée par le CNRTL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr/lexicographie/primitif. Dernière consultation le 4 août 2012. 133 Anne-Christine Taylor, « Primitif » in Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Pierre Bonté et Michel Izard (Dir.), Paris, Quadrige/Puf, 2004 [1991], p. 601.
! ! !
!
64!
Le terme de primitif par ailleurs s'applique, dans le domaine psychanalytique, à
« ce qui est considéré comme une survivance des mœurs ou de croyances des premiers
hommes dans l'inconscient individuel ou collectif134 ». Dans quelle mesure le récit de
guerre contient-il dans ses représentations une survivance d’un système de pensée
primitif ? Comment le passé à l’échelle de l’humanité resurgit-il en guerre ? Il me
semble que cette question s’inscrit dans une continuité du discours de Zola puis de
Deleuze sur la question de la fêlure135. Peut-être qu’ici il serait plus juste de parler de
rupture mais quoiqu’il en soit il existe bien, dans une forme de récit de guerre, une mise
en abyme temporelle du discours de l’humain sur lui-même : le poilu se regarde à l’aune
de son ancêtre « non civilisé ». La nécessité d’établir un lien intertextuel entre l’œuvre
zolienne et celles qui nous occupent ne s’impose pas à l’analyse du roman de guerre
mais il est à mon sens fondamental d’engager une réflexion sur cette bipolarité – ou
multiplicité – de nature(s) chez l’homme, ou tout du moins sur une pluralité des états
existentiels chez l’homme, telle qu’elle se joue notamment dans La Bête humaine, et qui
s’inscrit de manière plus général dans une réflexion dialogique nature / culture.
Cette deuxième définition introduit d’ailleurs la troisième que voici, et que nous
inclurons dans notre champ de recherche : dans le langage courant, est primitif « ce qui
est simple, primaire, qui est proche de l'état de nature, qui est en harmonie avec la nature
par simplicité, innocence ou à l'inverse, par sauvagerie136 ». De cette définition, l'idée de
la proximité avec la nature est je crois primordiale dans les textes qui nous occupent en
ce qu’elle contribue à ranimer une fois encore le débat nature/culture avec pour toile de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!134 CNRTL, op. cit. 135 Un travail sur La Bête Humaine a précédemment occupé mes recherches et il se trouve que certains textes qui nous occupent font parfaitement écho à la question du « retour atavique » chez Zola. Voir aussi Gille Deleuze, op. cit. 136 CNRTL, op. cit.
! ! !
!
65!
fond majeure les violences liées à la guerre. De fait, le contact quotidien avec la violence
au front interroge l’idée d’harmonie ou de disharmonie expérimentée par le soldat avec
le monde immédiat en temps de guerre. C’est de cette expérience en accord ou au
contraire, en désaccord, au sens de rupture, que surgira le système de représentation que
je me propose d’analyser. Le primitivisme en tant que représentation dans la narration de
guerre inclut, dans le présent travail, deux principaux aspects : le retour à un stade de
privations matérielles et à un mode de vie primitif d’une part et la présence d’un retour
du refoulé, d’autre part, qui se manifeste par un déploiement de violence primaire,
affectant l’homme de manière jusque dans sa physiologie. Par « primitivisme » il faut
donc entendre la survivance de comportements ataviques chez l’homme moderne en
guerre. Par conséquent, il s’agit de montrer comment ces comportements sont liés à la
description de l’environnement violent du front ; il existe des manières spécifiques de
représenter les paysages de guerre, l’environnement des soldats, leur perception de
l’ennemi qui conduisent toutes à une spécificité narrative orientée autour de cette notion
de primitivisme.
Pour étayer mon propos sur la question de ce que j’appelle le « primitivisme »
dans le récit de guerre, je voudrais citer Carine Trévisan qui dans Les Fables du deuil,
émet la remarque suivante :
(…) la Grande Guerre entraîne une perte de tous les repères symboliques. En elle coexistent en effet pour la première fois à ce point différentes attitudes et différentes temporalités : celles de la haute technicité et celles, immémoriales, de la sauvagerie. Elle est le lieu où se défont les frontières entre le moderne et l’archaïque, le civilisé et le barbare137. Cette thématique de l’homme barbare, cet autre mais semblable à soi qui fait
référence à une temporalité qui devrait être révolue a été marginalisée dans l’analyse des !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!137 Carine Trévisan, Les Fables du deuil, op. cit., p. 61.
! ! !
!
66!
œuvres littéraires sur la Grande Guerre, peut-être parce qu’il est malaisé de parler de soi
en portant sur le sujet « je » écrivant le regard que l’on porterait sur un autre. C’est toute
la contrainte d’écriture qu’impose une introspection entravée par la difficulté à dire la
violence.
1- La fin d’un monde – échec de la modernité
La guerre n’est pas seulement un divertissement pour jeunes garçons en mal
d’aventure. De manière évidente, et plus profonde, la guerre est aussi vécue comme un
échec, une erreur de parcours dans le cheminement espéré du progrès. C’est l’échec
d’une politique qui n’a plus d’autre choix que l’emploi de la force, l’échec d’une société
policée qui s’enfonce progressivement dans une ère de sauvagerie. Pour débuter cette
analyse, il s’agit avant tout de chercher à définir les limites temporelles du système de
représentation considéré. L’écrivain combattant se conçoit inévitablement dans une
temporalité qui déborde les quatre années de guerre à proprement parler. L’un des
moyens de dénoncer la guerre est donc de contextualiser dans un cadre historique plus
large cet élan de violence inouïe qui surgit en ce début de XXe siècle. Chez celui qui vit
la guerre dans sa contemporanéité, il existe la conviction d’assister à un évènement
historique qui marque et marquera le cours de l’histoire. Pour les textes où la voix
narrative choisit de positionner le récit au moment même du drame, c’est-à-dire au front,
la Grande Guerre apparaît comme une rupture de temporalité en marche ou tout du
moins comme un tournant radical dans la manière de se penser en tant qu’être humain
inscrit dans une histoire en mouvement.
À l’aube de la guerre, les améliorations techniques et technologiques advenues
en partie à la suite de la révolution industrielle ainsi qu’une relative stabilité politique à
! ! !
!
67!
l’échelle européenne, promettaient de beaux jours à une époque qui se pensait comme
une ère de paix et de progrès. Certes, il serait trop schématiser que de concevoir la
première Guerre Mondiale comme un événement qui engendre une rupture absolue entre
l’avant et l’après 14-18138. La guerre suspend le temps du quotidien, rompt avec une
conception linéaire de la ligne du temps. À la manière d’une apocalypse, l’irruption du
temps de guerre signifie la fin de quelque chose qu’il est malaisé pour les auteurs de
nommer mais qui annonce un chaos certain. Bussières, dans Le Sel de la Terre, évoque
un « ronflement homicide, souffle d’apocalypse, barrissement de monstre antédiluvien
[…]139 » ; laissant entrevoir l’apocalypse comme scénario d’un futur incertain et violent,
rattrapé par un passé monstrueux – celui où la violence, de manière mythifiée, faisait loi
– le présent est une zone où se bousculent deux temporalités antagonistes qui
s’affrontent et empêchent le présent d’exister en soi et pour soi, moderne. Le tiraillement
imposé par ces deux temporalités bride un présent stable, étouffe dans son processus la
possibilité d’existence du progrès.
Cette incapacité à imaginer l’avenir, Wolfgang Sofsky l’explique par le
développement d’un lien d’aliénation vécue par le soldat dans les tranchées, crée par une
violence ultime qui semble ne jamais prendre fin : « La violence absolue n’a pas besoin
de justification. Elle ne serait pas absolue si elle était liée à des raisons. […] elle a réduit
la rationalité en esclavage140 ». Il existe en effet la création d’un lien d’asservissement
entre le soldat et le champ de bataille dans la mesure où le soldat ne peut quitter sa
position et se retrouve incorporer contre son gré à un espace. Cette forme
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!138 À ce sujet voir notamment Modris Eksteins, Rites of Spring : The Great War and the Birth of the Modern Age, Toronto, Key Porter Books, 1989. Pour des questions d’ordre historiographique, voir Antoine Prost et Jay Winter, Penser la Grande Guerre, Paris, Seuil, 2004. 139 Raymond Escholier, Le Sel de la terre, éd. cit., p. 189. 140 Wolfgang Sofsky, Traité de la violence, Paris, Gallimard, 1998, p. 49.
! ! !
!
68!
d’assujettissement se manifeste dans les textes par la sensation d’un emprisonnement
spatial et temporel dans un espace pourtant ouvert, imposé par une loi martiale qui
condamne toute désertion mais aussi par le sens du devoir et la volonté de rester à se
battre « comme les autres ». Dans une situation de réclusion imposée, les écrivains
combattants ont démontré l’incapacité du cerveau humain à rationaliser une violence
excessive, illimitée et sans fin. Noyés dans le conflit, ce dernier lutte pour concevoir la
temporalité : les hommes sont hors du temps, vivant dans un présent perpétuel qui perd
de sa substance. C’est cette impossible rationalisation qui empêche d’apercevoir
l’existence d’un futur possible, moderne, progressiste, un état de paix. De plus, rien ne
permet véritablement d’avoir la notion exacte du passage du temps, si ce n’est la
dichotomie fondamentale jour / nuit. Le manque de sommeil, les stations prolongées
dans des endroits sombres, le bruit constant des bombardements, tout cela influe sur
l’état de fatigue des soldats et concourt à bouleverser la manière de se situer dans le
temps.
Alors que les récits insistent sur le besoin urgent que la guerre et les violences
prennent fin, le désespoir qui accompagne l’expérience d’actes barbares empêche la voix
narrative de percevoir une zone de sortie, une résolution au conflit, un terme, et donc de
discerner une temporalité déterminée. Le « je » du narrateur souffrant n’a nulle part où
se cacher de manière sure et nulle part où s’enfuir. Cette immobilisation forcée, violence
qui tétanise l’esprit, se traduit par un renoncement en une foi dans l’avenir et est vécue
comme une forme de régression, en ce qu’elle prive de libertés. Immobilisé dans un
présent difficilement supportable, le narrateur oscille entre avenir improbable et retour
en arrière impossible. L’homme moderne en quelque sorte cesse d’exister, et avec lui
! ! !
!
69!
l’ère de contemporanéité qui le porte. Bien évidemment, la guerre engendrera sa propre
réflexion sur la modernité ainsi qu’une nouvelle forme de modernité, mais à l’heure du
témoignage, l’observateur qui expérimente l’horreur en constate l’échec : la guerre
enlève à l’homme sa part d’humanité, sa part de culture humaine, sa capacité à se
projeter. Progrès et régression, voici donc deux mouvements contraires qui confluent et
prennent en étau l’homme en guerre.
Pierre Drieu La Rochelle résume cette conjoncture de forces opposées comme
une confrontation entre un état « naturel » et un état moderne. Pour lui, cette « immense
maladie de la guerre moderne141 », notion alors personnifiée, est la manifestation d’une
vengeance contre l’homme qui n’a pas su préserver les traditions guerrières : « La guerre
n’est plus la guerre. Vous le verrez un jour, fascistes de tous pays quand vous serez
planqués contre terre, plats, avec la chiasse dans votre pantalon. Alors il n’y aura plus de
plumets, d’or d’éperons (…) mais simplement une odeur industrielle qui vous mange les
poumons. La guerre moderne est une révolte maléfique de la matière asservie par
l’homme142 ». Chez un Drieu au positionnement politique complexe, la véritable erreur
de la part de l’homme est de s’être lancé dans la course au progrès, qui n’amène qu’une
perte de sens et une rupture dans les valeurs traditionnelles. La guerre arrive comme une
punition, une nouvelle apocalypse afin de faire payer l’homme de ses infidélités aux
traditions mais aussi comme une disjonction d’avec un âge d’or, celui, notamment, de
l’art de la guerre traditionnel qu’il relie à un passé mythifié : « Où était le drapeau ?
Mais où sont les drapeaux d’antan ? Et les clairons ? Et le colonel ? Et son cheval ?143 ».
Pour Drieu toujours, l’avènement de la modernité et des nouvelles techniques guerrières
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!141 Pierre Drieu La Rochelle, La Comédie de Charleroi, Paris, Gallimard, 2007 [1934], p. 223. 142 Ibid., p. 75. 143 Ibid., p. 70.
! ! !
!
70!
a empêché une guerre humaine et donc morale, a empêché une guerre juste, puisqu’elle
a permis d’en saper les fondements éthiques. « Et cette guerre est mauvaise, qui a
vaincu les hommes. Cette guerre moderne, cette guerre de fer et non de muscles. Cette
guerre de science et non d’art. Cette guerre d’industrie et de commerce144 ». Cette idée
d’une guerre dissymétrique se retrouve chez d’autres auteurs 145 et conforte les
détracteurs du conflit dans l’idée que 14-18 est une guerre injuste. Injuste parce que les
deux forces en présence impliquent un rapport de force inégal : c’est la bataille de l’acier
contre la chair, l’incontrôlable puissance de frappe annihilatrice contre la fragilité du
corps incapable de se protéger. Chez un Drieu nostalgique, ce n’est pas tant l’échec de la
modernité qui prime mais la modernité en tant qu’échec en soi, dont la preuve réside
dans l’incapacité des hommes à réussir une guerre, c’est à dire à sublimer l’art guerrier.
La machine et le matérialisme ont supplanté l’humain qu’il accuse d’avoir « vendu son
âme au diable146 » en échange de l’industrie, dont les résultats disproportionnés en
termes de morts humaines fait perdre au prix du sang sa valeur et sa légitimité.
D’ailleurs pour lui, la guerre de 14 mènera l’Europe à sa perte: « Qui n’a vu le vide d’un
champ de bataille moderne ne peut rien soupçonner du malheur perfide qui est tombé sur
les hommes et qui anéantira l’Europe147 ».
Convenir d’un échec de la modernité se traduit par un passéisme comparable
dans l’œuvre d’Escholier, où le héros Buissière, se laisse aller à une rêverie qui magnifie
l’élan sacrificiel. Toute la temporalité du passé se mélange, passé proche et passé plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!144 Ibid., p. 67. 145 Je pense notamment à Alfredo Bonadeo qui évoque lui aussi cette idée : « battles were won and lost not by opposing steel to steel, but by hurling human flesh against metal ». « Des batailles furent gagnées ou perdues non en confrontant l’acier à l’acier mais en précipitant de la chaire humaine contre du métal », ma traduction. Voir Mark of the Beast: Death and Degradation in the Literature of the Great War, Lexington, KY., University Press of Kentucky, 1989, p. vii. 146 Pierre Drieu La Rochelle, La Comédie, éd. cit., p. 186. 147 Ibid., p. 181.
! ! !
!
71!
lointain, pour insuffler au héros un zèle patriotique. Sous la plume de Buissières soldat,
Pascal et la Belle-au-Bois-Dormant, ciments culturels hétéroclites, se croisent,
« ranimant en lui toutes les traditions148 » et lui permettant de réaliser son vœu le plus
cher : « Il était lui aussi, de la chair à mitraille, de la poussière de gloire149 ». Le soldat
est ici le porte-voix et l’incarnation d’un passé culturel composite qu’il faut défendre au
prix de sa vie.
Pour Jerphanion, personnage principal de Sous Verdun et Verdun, la guerre
évoque un retour en arrière qui s’arrête à l’époque médiévale. Point de nostalgie pour un
certain passé mais au contraire une mise en parallèle avec une ère qui évoque, pour lui,
l’antithèse du progrès culturel et social : « Moi, je vois plutôt ça dans le style Moyen
Age. Nous sommes en train de retrouver des états d’esprit du Moyen Age : l’irrévérence
pour la carcasse humaine et pour la chair vivante ou morte150 (…) ». Passé qui vénérait
la gloire militaire, passé sombre de l’humanité (ou en tous cas imaginé comme tel),
passé proche ou antédiluvien où se cache l’homme d’avant l’homme, tout autant de
temporalités englobées sous une même dénomination qui permettent à la narration de
faire parler un « autrefois », afin de souligner par contraste les incohérences de
l’avènement de la modernité.
Cette manière de concevoir la temporalité en une opposition problématique
passé / présent est renforcée, toujours dans le cadre d’une dialectique historique, par une
désintégration de l’espace géographique qu’est le front. La représentation de l’espace
pour les témoins de la guerre se lit également au travers de l’échec de la modernité en ce
que la territorialisation physique et mentale des espaces est radicalement bouleversée ; et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!148 Escholier, Le Sel, éd. cit., p. 26. 149 Ibid., p. 27. 150 Jules Romains, Sous Verdun, op. cit., p. 106.
! ! !
!
72!
c’est ce bouleversement d’une cartographie mentale et culturelle des espaces qui doit
être souligné pour comprendre l’importance de la question du « retour en arrière » dans
la représentation littéraire de la guerre. Jusqu’à la guerre, une histoire des
représentations spatiales peut être tracée au travers de la littérature et des productions
culturelles collectives, symboliques et esthétiques, comme ayant abouti à des
représentations si ce n’est figées, du moins spécifiques. Le mouvement romantique,
entre autres, avait contribué à façonner et à représenter l’espace rural français ; or ce
même paysage se trouve considérablement modifié par les destructions et les
bombardements. Ces derniers n’affectent pas seulement les villages et les champs
cultivés. Ils détruisent également la « campagne » en tant qu’espace naturel (si tant est
que l’on puisse affirmer l’existence d’une « naturalité » de la campagne) qui, jusqu’à la
fin du siècle précédent, composait le terrain et terreau de rêveries et récits romanesques.
Le paysage français et ses modalités de représentations telles qu’elles sont
inscrites dans l’imaginaire collectif culturel, en partie liées au monopole de l’imaginaire
littéraire, sont profondément altérés par l’arrivée de la guerre. Ainsi dans le roman de
guerre le paysage qui change sous les yeux des soldats témoins, évolue de manière
performative au sein de la narration : « Le sol s’effondre autour d’eux, sur eux… Tout
n’est plus que crevasses, fondrières, cratères…151 ». Altitude et profondeurs s’inversent,
rien n’est stable, toute transformation passagère du paysage est suivie par une autre
transformation, imprévisible. Et plus encore, dans ce paysage de désolation, les limites
du réel changent : la nature n’est plus essentiellement « nature », elle devient
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!151 Raymond Escholier, Le Sel, op. cit., p. 184.
! ! !
!
73!
humaine152. « Pas une fleur, pas un oiseau, dans cette nature macabre d’où s’exhale,
seule, la puanteur du cadavre humain153 » témoigne Bussières, le narrateur du Sel de la
Terre. La modification et l’apparition d’un nouveau paysage engendrent une nouvelle
forme de stimulus pour l’imagination y compris chez les écrivains qui cherchent à
prendre de la distance vis-à-vis d’une représentation trop grossière du front – je pense
notamment à Maurice Genevoix ou encore à Pierre Chaine qui affirme ne pas vouloir
écrire l’abject afin de ne pas distordre la réalité. Le paysage n’échappe pas à une
transformation qui concorde avec le ressenti des soldats au front : espace indécis,
indéfini, mixte, détruit qui demande à être redéfini par rapport à ce qui était
précédemment connu, tout ceci concourt à une nouvelle forme de production
symbolique propre à la littérature de la première Guerre Mondiale. « Ces arbres
disloqués, mutilés, écorchés, décharnés, apparaissent à Buissières comme les ossements
épars d’un squelette de paysage où ne passe plus que la ronce artificielle154 » : le
paysage mortifère est repensé au travers de la propre mort de l’homme. Ce qui pouvait
être issu de sa production mentale ou de sa main – un aménagement culturel, si l’on peut
dire, du territoire – est détruit par cette même main allégorique, incontrôlable dans son
degré de violence, qui porte les armes.
La modification substantielle du paysage engendre alors nécessairement un
questionnement civilisationnel en ce qu’elle bouleverse les jalons d’une représentation
partiellement figée. Néanmoins, certains auteurs n’hésitent pas à donner du front des
descriptions picturales lyriques : « Dans la charpie crasseuse des nuées déchirées et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!152 Nous développerons cette idée de bouleversement et de désordre dans un chapitre ultérieur intitulé « Une “instabilité désordonnée du monde” ». J’emprunte la citation à Didier Manuel, « La figure du monstre », in Didier Manuel (dir.), La figure du monstre, Presse Universitaire de Nancy, 2009, p. 13. 153 Raymond Escholier, op. cit., p. 71. 154 Ibid., p. 71.
! ! !
!
74!
pâlissantes, le petit jour saignait comme une sale blessure155 ». La guerre peut donc
engendrer une poétique du beau156, ce qui nuancerait l’idée que la modernité qui apporte
une technicité à la guerre, paradoxalement sauvage, ne colporte pas uniquement de la
production mortifère. Mais là où la modernité échoue principalement c’est qu’elle n’est
plus garante d’une pérennité de représentations et surtout d’une immutabilité des
distinctions. Le brouillage des frontières de représentations, voilà ce qui renvoie à une
forme de primitivisme. Alors que le paysage s’était culturellement différencié de
l’humain - bien que dans une représentation culturelle humainement fabriquée - , et que
l’humain se différenciait du paysage sauvage, c’est-à-dire alors que nature et culture
étaient deux notions proprement distinctes l’une de l’autre, progressivement la barrière
entre ces deux pôles opposés se réduit : « Sur le glacis, un grand chêne à demi-calciné se
penche et gémit à chaque coup de vent, en agitant lugubrement sa dernière branche où
tremble un lambeau de chair pourrie 157 ». L’arbre gémit pour l’homme et c’est
l’humanité toute entière qui, de manière symbolique, pleure la fin des séparations
catégorisées des espèces. C’est ce que Modris Eksteins nomme l’ébranlement
de l’intégrité du réel :
As the war’s meaning began to be enveloped in a fog of existential questioning, the integrity of the « real » world, the visible and ordered world, was undermined. As the war called into question the rational connections of the prewar world – the nexus, that is, of cause and effect – the meaning of civilization as tangible achievement was assaulted, as was the neighteen-century view that all history represented progress.158
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!155 Ibid., p. 156. 156 Ernst Jünger dans Orages d’acier (In Stahlgewittern, 1920), ou Marcel Proust dans Le Temps retrouvé (1927), évoquent tous deux, chacun à leur manière, une poétique de la beauté guerrière : beauté des bombardements, beauté du paysage guerrier. 157 Ibid., p. 71. 158 Modris Eksteins, Rites of Spring, Boston, Houghton Mifflin, 1989, p. 211. « Alors que la signification de la guerre se parait progressivement dans le brouillard de questions existentielles, l’intégrité du monde « réel », visible et ordonné, était fragilisée. Tandis que la guerre remettait en question les connections rationnelles du monde d’avant guerre – c’est-à-dire le lien de cause à effet –, le sens même de la
! ! !
!
75!
Non seulement la vie au front entraîne un bouleversement de l’espace visuel et
perçu, immédiat, du soldat, qui plonge son quotidien dans un monde de terreur et
d’inquiétante étrangeté, mais le conflit de 14-18 modifie le rapport entre moralité et/ou
éthique et modernité. En effet, si la modernité se devait d’être garante d’une certaine
idée de la morale, alors l’infamie qui pare les actions violentes du poilu ne peut que
rejeter les faits et gestes de l’homme moderne en guerre vers un temps que l’on pensait
révolu. Le sujet agissant n’étant plus en phase avec les préceptes culturels, garde-fous
référents, il lui faut transposer ce qu’il voit et la façon dont il agit dans une période
historique qui devait connaître et a priori valider de tels comportements.
Ainsi la guerre est présentée comme un théâtre, une scène narrative et non moins
réelle sur laquelle se lance l’homme civilisé, sans être sûr de pouvoir en revenir. Il s’agit
d’une forme moderne du, Styx qui, s’il l’on en revient, transforme à jamais l’homme
moderne en autre chose : « En une semaine, vingt millions d’hommes civilisés, occupés
à vivre, à aimer, à gagner de l’argent, à préparer l’avenir, ont reçu la consigne de tout
interrompre pour aller tuer d’autres hommes159 ». Il s’agit donc bien d’une interruption,
d’une discontinuité à l’échelle humaine, d’une altération de l’homme moderne qui
produit du non-moderne, de la régression, de la sauvagerie. Il faut aller tuer son
semblable et, ne serait-ce trop aisé que de dire soi-même, il faut bien admettre que tout
ceci n’est pas humain, tout du moins « pas moderne ». Puisque l’homme moderne – tel
qu’il se pense avant l’entrée en guerre - ne peut décemment, c’est-à-dire pas
humainement se voir tel qu’il est, en train d’accomplir une telle guerre, puisque cette
guerre est en totale inadéquation avec la modernité dans la mesure où la modernité et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!civilisation en tant qu’aboutissement tangible était attaqué, tout comme l’était la vision du 19ème siècle selon laquelle l’histoire est synonyme de progrès », je traduis. 159 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 20.
! ! !
!
76!
l’éthique qui l’accompagnent se détournent, normalement, des tueries inutiles, du
massacre, de la sauvagerie, il faut bien néanmoins trouver un moyen de nommer et de
qualifier cette expérience de la guerre. Ainsi pour faire face au brouillage des frontières,
pour nommer l’innommable il faut opérer un mouvement contraire, à savoir dissocier,
différencier, fragmenter, opposer, polariser. C’est par une mise en face-à-face
barbare /civilisé, homme des cavernes / homme moderne, c’est en opposant à lui-même
un semblable différencié que l’auteur/acteur va pouvoir dérouler une narration de la
Grande Guerre.
Le poilu un « homme des cavernes » ? Représentations pré-modernes du front
Une des représentations du poilu au front est celle d’un homme que nous avons
connu, qui n’est plus et pourtant renaît sous la plume des auteurs. Les mots mêmes de
« primitivisme », « primitif », « primaire », sont souvent mentionnés que ce soit dans les
textes de Jules Romains, d’Élie Faure, de Drieu la Rochelle ou de Benjamin. Il s’agit
donc d’interroger ce champ lexical ainsi que ses différentes utilisations, analyse qui a
souvent été laissée de côté dans le champ d’étude littéraire. Récits défendant ou accusant
la guerre, ils évoquent bien souvent tous cette question d’un état et d’une ère révolus.
Dans l’œuvre de Raymond Escholier, la première fois que le mot paraît, l’idée
qui lui est associée est celle d’un espace reconstitué, primaire :
Le lit de feuilles sèches, le mât où brillent des clous à crochet, l’espèce de guéridon qui l’entoure, tout cela donne, au sein de la forêt funèbre, dans cette noire désolation des hommes et des choses, une impression de primitif confort qui raffermit le cœur160.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!160 Raymond Escholier, op. cit., p. 17.
! ! !
!
77!
Ici, le terme renvoie à un mode de vie spartiate bien que rassurant : un chez soi
primitif mais familier. Malgré la dureté de la vie au front, le poilu est dans la nécessité
de recréer un monde intime domestiqué. Il a encore la capacité de construire à partir de
peu – c’est le Robinson de notre chapitre précédent – et il a pu partiellement s’adapter à
son environnement : il recrée l’habitude, avec aisance, comme si s’éveillait en lui une
« seconde nature », auxiliaire précieux garantissant sa survie au front. Cependant le
vocable « primitif » évolue dans le roman d’Escholier. Plus l’on avance dans la lecture
du texte, plus le terme change de signification; il souligne cette fois que c’est le manque
continu de confort, cette même habitude qui maintenait un lien avec l’homme civilisé
qui, cette fois pourtant, entraîne la mutation progressive du soldat-homme-moderne en
soldat-homme-primitif : « Sous le marabout, une forme bouge ; un poilu se dresse
hirsute, sauvage, primitif, évoquant l’ancêtre, l’homme des cavernes et des bois161 ».
Cette idée se retrouve dans des propos similaires chez Gabriel Chevallier : « Les
combattants, entièrement dépourvus, en s’ingéniant, avaient abouti à cette industrie
barbare. Quelques instruments de fer suffisaient à tous leurs besoins, et la vie se trouvait
ramenée aux conditions les plus élémentaires, comme aux premiers âges du monde162 ».
Le soldat de 14 est fréquemment représenté dans les romans concernés sous les
traits d’un homme inconnu, que le poilu rencontre au détour d’une tranchée comme s’il
rencontrait son passé à grande échelle, sorte de stade du miroir en distorsion d’avec la
réalité, d’avec une temporalité normale. Le narrateur dans Les Poissons morts décrit des
artilleurs croisés un jour de relève par les troupes fraichement arrivées des
casernes : « Leurs uniformes défiaient toute description. Ils portaient des cheveux longs
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!161 Ibid., p. 55. 162 Gabriel Chevallier, op. cit,. p. 57.
! ! !
!
78!
et des barbes incultes. Toutes nos conceptions de civilisés sur le soldat s’évanouissaient
en les détaillant163 ». Mais ces soldats contenus dans le pronom « ils » distancié, ne sont-
ils pas de manière générique la symétrie intemporelle (et imparfaite ?), le double de
l’écrivain combattant, sorte de mimes partageant un seul et même temps d’énonciation ?
Symétrie intemporelle de soi certes, mais qu’il faut déguiser pour y apporter une
différence (on l’a vu, on ne peut se dire totalement tel que l’on est dans la guerre), qu’il
faut « habiller ». Il est intéressant de voir que l’utilisation du mot « poilu », qui s’étend
considérablement au moment de la Grande Guerre, se généralise après un an de conflit.
La dénomination n’est pas totalement fortuite, les soldats se laissant pousser barbe et
moustache, et revêtant progressivement une allure d’un autre âge, une parure qui
deviendra le symbole d’une guerre associée à un moment de régression de l’homme.
« Cheveux longs » et « barbes incultes » apparaissent alors comme une forme de
maquillage, d’habillage, qui cache – de honte ? – l’homme moderne sous des allures
d’homme des cavernes, d’homme non civilisé. Remonter le temps passerait alors par une
nécessité de se grimer, d’apparaître autre que soit, pour que l’individu ne se reconnaisse
pas lui-même. Se grimer aussi pour se distinguer de l’arrière, du civil qui lui ne se bat
pas, pour se différencier donc, mais aussi, paradoxalement pourtant, pour se donner un
signe d’appartenance commune avec ses « pairs » : les poilus.
Le retour en arrière qui parcourt le récit de guerre, saut dans un passé
antédiluvien, s’effectue également au moyen d’un renversement d’images. Le processus
de régression passe par l’inversion du procédé culturel de la construction traditionnelle,
nous l’avons mentionné : faute de pouvoir s’élever, on se terre. La tranchée, c’est-à-dire
une excavation, une entaille creusée dans la terre, est une image qui en soit inaugure la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!163 Pierre Mac Orlan, Les Poissons morts, Paris, Payot, 1917, p. 29.
! ! !
!
79!
thématique de la régression : le progrès technique contraint d’infliger une scarification à
la terre. Cette plongée dans un monde chtonien constitue alors un des fils directeurs
majeurs du roman de tranchées, recherche constante d’un abri. Le soldat creuse dans la
terre et le processus « moderne » de construction, à savoir, faire sortir un immeuble de
terre, se déroule dans une dialectique inverse qui astreint le soldat à construire et à
évoluer dans un monde souterrain. Retour symbolique dans la caverne ancestrale, il
s’agit encore une fois de créer un espace de sécurité, réel ou perçu, pour se protéger des
bombardements : « While being shelled the soldier either harbored in a dugout and
hoped for something other than a direct hit or made himself as small as possible in a
funk-hole164 ». Il serait intéressant de rapprocher ce besoin de se terrer avec la
thématique de l’enveloppement – bien qu’étant proche de la mort - développée par
Michel Tournier. La « caverne », la fosse du soldat serait en effet une sorte de deuxième
enveloppe, exosquelette protecteur matérialisé, mais aussi mentalement créé. Les
tranchées, souvent de simples trous creusés dans le sol, parfois suffisent à donner aux
poilus l’illusion que le corps est protégé de l’acier. « L’abri, suffisamment approfondi
pour qu’un poilu puisse l’habiter, Bussières s’y glisse et sur la toile de tente déroulée, se
recroqueville165 » : l’image de la position fœtale ravive une idée de désir de protection
tout en soulignant la fragilité du corps. Le retranchement répond donc à un besoin
primitif auquel l’homme « des cavernes » répondait en creusant son habitat plutôt qu’en
l’érigeant. Nonobstant ce re-tranchement, imposé, est un retranchement du monde,
spatial, mais aussi dans le temps. Car être au front c’est à la fois être absent de l’espace
civil et par extension civilisé, mais aussi du monde qui se déroule, du monde toujours en
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!164 Paul Fussell, op. cit. p. 46. « Quand il était bombardé, le soldat se retranchait dans un abri en espérant échapper à une frappe directe ou se faisait aussi petit que possible dans un trou. », je traduis. 165 Raymond Escholier, op cit., p. 72.
! ! !
!
80!
mouvement de l’arrière-front, et encore plus lorsque l’espace où le corps se tient isole le
soldat de et à la vue de l’horizon. On ne le voit pas mais il ne voit pas, ne se projette pas
non plus.
Le poilu absent du monde « normal » de la paix, monde qui autorise une
motricité dans la temporalité, une impulsion, se doit de se trouver et de se situer dans
une temporalité qui lui est propre. L’écrivain combattant crée donc au moyen de la
narration une temporalité dans laquelle il peut s’inventer ou tout du moins se
représenter. Il superpose deux temporalités du présent, moment de la guerre, et temps de
la représentation, où s’ancre la narration. Ce cadre narratif est celui d’une autre ère, pré-
moderne, pré-culturelle, dont il sera peut-être dur de revenir, comme le manifeste la
crainte de Jerphanion. Il redoute de ne jamais recouvrer les qualités que lui avait
conférées la modernité : « Est-ce que j’aurai jamais de nouveau de la délicatesse ? Je
serai peut-être nerveux, agacé, exaspéré par des riens. Mais la paisible délicatesse de
l’homme civilisé ?166 ». Il s’agit de franchir une sorte de miroir déformant, que nous
avons déjà évoqué, dont les altérations infligées, régressions et traits archaïques, ne
s’effaceront pas nécessairement. Alfredo Bonadeo dans Mark of the Beast évoque le cas
de l’auteur britannique T.E. Lawrence qui n’a jamais pu se débarrasser des marques que
la guerre lui avait infligées, et qui l’avaient relégué à un stade d’homme ancestral, lui
ayant laissé des traces dans la chair et l’esprit167.
L’absence de sépulture pour les cadavres des soldats tués au front est une autre
thématique fréquemment abordée dans les œuvres de tranchées qui renvoie elle aussi à
un temps antédiluvien. Nous aborderons cette notion plus en détail en soulignant les
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!166 Jules Romains, Verdun, éd. cit., p. 297. 167 T.E. Lawrence écrit : “tore apart flesh and spirit”, in Alfredo Bonadeo, op. cit., p. 2.
! ! !
!
81!
conséquences sur les représentations dans la narration d’une impossible inhumation mais
nous pouvons déjà nous arrêter sur cette idée : une mort qui ne fait pas l'objet de
sépulture par la collectivité est une manifestation de régression. Les paléontologues
retiennent comme marques d’un stade différent d’évolution dans l'humanité l'apparition
des sites d'inhumation. Or le champ de bataille « farci » de morceaux humains ne peut
donc obtenir le statut de nécropole, en l’absence d’inhumations à proprement parler.
L’absence d’inhumation au front emmène symboliquement le soldat vers une période
antérieure même à celle qui le représenterait comme un homme des cavernes puisque ce
dernier inhumait déjà ses morts. S’ouvre alors un temps nouveau, qui autoriserait le
franchissement d’interdits fondamentaux, dont celui du meurtre et par extension de la
proximité avec les cadavres.
Je conclurai cette partie en nuançant l’utilisation trop systématique de la
thématique pré-historique du soldat au front et insisterai sur son caractère mythifié. Il
faut en effet tempérer le propos qui consiste à invoquer de manière trop tranchée la
plongée des soldats dans un temps primitif comme justification de l’usage de la violence
et de l’habitude prise à être à son contact. Dire que l’homme en guerre est
nécessairement renvoyé à une temporalité antéhistorique serait un abus : en effet dès
qu’il y a existence d’un corps collectif, comme c’est le cas au front, il y a existence d’un
corps social et donc production culturelle et par conséquent historique. Aussi, il s’agit ici
de bien souligner que si l’homme des tranchées est effectivement loin dans le temps et
dans la représentation de son ancêtre antédiluvien, c’est néanmoins le travail de la
création littéraire que de dresser des similitudes entre l’un et l’autre. Le pont ainsi érigé
constituerait l’espace propre à et de la création. L’on assiste alors à une généralisation
! ! !
!
82!
dans les textes de l’image de « l’homme des cavernes » qui laisse parfois peu de place à
la nuance. D’un texte à l’autre, ce sont souvent les mêmes clichés qui sont repris.
Cependant cette généralisation de la thématique pourrait s’expliquer par la nécessité de
recréer une habitude, du familier dans l’écriture là où l’expérience in situ ne rencontre
que de l’horreur et de l’inconnu. Le roman de guerre crée alors une thématique, sorte
d’habitus narratif, fondateur d’une collectivité de représentations : il existe donc bien
une écriture du primitivisme dans le roman de guerre, l’intertextualité étant
suffisamment manifeste pour qu’il soit possible d’avancer un tel argument.
Il ressort de cette analyse que le primitivisme, tel qu’il est exprimé, s’offre
comme l’expression d’un paradoxe, révélateur d’une situation échappant souvent à tout
entendement ; le paradoxe majeur étant nous l’avons vu, que la violence annonciatrice
d’une forme de régression est due à la sophistication matérielle des sociétés où elle
advient. Nous soulignons donc une tension permanente dans les textes, une sorte
d’inconfort de l’écriture oscillant et vacillant d’un lieu « mental » à un autre, d’une
temporalité à une autre, entre familier et horreur, technicité et primitivisme. Ainsi,
Raymond Escholier rend parfaitement compte de cette aporie où se trouve la situation
d’énonciation, et évoque un « égorgement sauvage et savant de deux races
ennemies168 ». À la fois sauvage et savant : curieuse interprétation qui tente de relier
rationalité et instinct, modernité et archaïsme.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!168 Raymond Escholier, op. cit., p. 93.
! ! !
!
83!
« Morne sauvagerie169 »
« Je constate encore la sauvagerie, la morne sauvagerie, où cette vaste chose
nous a précipités, et nous fait croupir170 ». C’est par ces mots que Jules Romains
exprime son expérience de la guerre, innommable – cette vaste chose – comme un
processus qui a occasionné une régression. Cette « morne sauvagerie », c’est l’espace-
temps qui permet à la fêlure de s’exprimer. Ce que Deleuze considère comme l’hérédité
d’un instinct de mort chez les Rougon-Macquart s’exprime et est matérialisé dans le
roman de guerre comme une brèche, une incursion dans le réel qui puise sa source dans
l’origine de l’homme : ce dernier garde en lui un instinct ancestral qui le prédisposerait à
la guerre. Alors que chez Zola, le mouvement créé est un resurgissement du passé dans
le présent, pour nos écrivains combattants le mouvement est double. Il s’agit à la fois
d’une résurgence d’éléments du passé, à la fois d’une plongée du corps et de l’esprit vers
cette morne sauvagerie, espace-temps du passé, qui impose une immobilité : le soldat y
croupit.
Mais pas seulement : pour Escholier, « l’antique instinct de guerre carre les
mâchoires171 ». Il y a donc un rapport d’influence direct entre l’activité guerrière et
l’allure du guerrier et sa physionomie, idée que l’on trouve d’ailleurs chez Zola,
notamment chez le personnage de Cabuche dans La Bête Humaine172 qui embrasse les
caractères physiologiques si chers à l’écrivain. Pour Drieu, la sauvagerie est marquée par
des caractéristiques d’accoutrement fantasmés, évoquant un homme au passif belliqueux
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!169 Jules Romains, Prélude à Verdun, éd. cit. p. 100. 170 Ibid, p. 100. 171 Raymond Escholier, op. cit. p. 85. 172 « C’était un gaillard, au cou puissant, aux poings énormes […] La face massive, le front bas disaient la violence de l’être borné, tout à la sensation immédiate » nous dit le texte de Zola. La Bête Humaine : Les Rougon Macquart, préface de J-C Le Bond-Zola, Paris, Le Seuil, 1970, tome 5, p. 607.
! ! !
!
84!
chez qui subsistent des attributs martiaux, les tambours de peau d’âne et de cuivre,
derniers liens qui relient les hommes à une manière antique de faire la guerre :
Multipliés dans les bouches et les mains, sont portés devant les hommes la peau d’âne et le cuivre, aussi vieux ustensiles humains que le glaive, et qui ramènent du fond des âges la rumeur la plus sombre, la stridence la plus aigüe. Et voilà ce qui se tord au fond du ventre des hommes, ce vieux rut toujours ivre173. Ce qui existe au fond de l’homme et que la guerre réveille, c’est ce qui permet à
l’écrivain combattant de 14-18 de comprendre le phénomène guerrier, sauvage, auquel il
fait face et pour lequel il n’était pas préparé. Le personnage de Jallez chez Romains
conclut : « En somme, la guerre ressuscite des tas de choses très antiques174 ».
Le narrateur de Ceux de 14 fait part de sa réaction désabusée devant la lecture
d’une décision quotidienne : « J’y lis que « l’allure du régiment est lourde », qu’elle « se
ressent des séjours prolongés dans les régions boisées où l’homme a trop de tendances à
revenir à l’état de nature (…)175 ». Et de convenir qu’ « une saine ration de musique, pas
redoublés et valses lentes, a réendormi en nous l’ancestrale sauvagerie qu’y avait
réveillé la guerre176 ». Il semblerait que la hiérarchie militaire soit consciente des
bouleversements vécus par les hommes du rang. Il y a à la fois une satisfaction à exciter
la sauvagerie des soldats, afin qu’ils continuent de se battre, et à la fois une crainte de
cette sauvagerie qui pourrait être incontrôlable. Il s’agit alors, selon Romains, pour
l’encadrement militaire de réinjecter du rituel militaire, policé, au sein des troupes de
poilus ensauvagés. La discipline militaire semble compromise par l’assaut de pulsions
primaires qui expliqueraient que le soldat prenne plaisir à tuer, plaisir ancestral avant
tout. Ainsi Alfredo Bonadeo affirme : « Lord Julian Grenfell, the English captain who
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!173 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 102. 174 Jules Romains, Verdun, éd. cit., p. 313. 175 Maurice Genevoix, op. cit., p. 147. 176 Ibid, p. 147.
! ! !
!
85!
delighted in fighting in Flanders […] attributed his enjoyment neither to patriotism nor
to courage, but to physical strength and to the instinct of the barbarian177 […] ». Là
encore, le récit privilégie l’instinct prétendument propre au barbare, à l’autre en soi. Or
toute l’ambiguïté réside dans cette indécision littéraire, à savoir s’il faut affirmer que
c’est la guerre qui réveille des instincts ancestraux ou si ce sont de probables instincts
ancestraux qui conduisent l’homme en guerre et lui permettent de supporter les stations
prolongées au front. Romains nous dit : « Sur un flanc de colline boisée, on court peut-
être certains risques de plus. Mais on est soutenu par ses instincts d’homme sauvage, qui
approuve, qui comprend178 ». Ici, tout comme les actions de Grenfell mentionnées par
Bonadeo, ce qui reste d’ancestral en l’homme est un auxiliaire précieux : cela
permettrait de justifier le plaisir du sang. La réminiscence ancestrale surgit de façon
involontaire et inconsciente tout en étant le moteur de cette action guerrière, et devient
alors l’outil psychologique qui permet de tuer.
Or ce même reste ancestral entre en friction de manière profonde avec l’interdit
de meurtre qui s’est construit dans la période « historique » comme l’une des premières
lois écrites. Joanna Bourke nous explique que : « These men surrender to irrational
although sincere moral outrage, embrace the idea of agency, find relief in agonizing
guilt, and attempt to negociate pleasure within a landscape of extreme violence179 ».
Négocier le plaisir, c’est-à-dire négocier avec un interdit fondamental, comme l’homme
pré-historique, nous l’avons vu, pouvait négocier sa proximité d’avec les cadavres. Si
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!177 Alfredo Bonadeo, op. cit., p. 2., « Lord Julian Grenfell, le capitaine anglais qui se réjouissait de combattre dans les Flandres, attribuait son plaisir ni au patriotisme ni au courage mais à la force physique et à ses instincts barbares », je traduis. 178 Jules Romains, Sous Verdun, op. cit., p. 44. 179 Joanna Bourke, op. cit, p. xiii. « Ces hommes cèdent à une indignation morale irrationnelle bien que sincère, souscrivent à l’idée d’un libre-arbitre, trouvent un soulagement dans une culpabilité insoutenable et tentent de négocier le plaisir dans le cadre d’une extrême violence. », je traduis.
! ! !
!
86!
tuer c’est braver un interdit, c’est aussi un retour vers un plaisir atavique, ce qu’affirme
également Julia Kristeva dans Pouvoirs de l’horreur180. Kristeva construit son argument
autour d’une idée similaire lorsqu’elle évoque la question de la souillure et d’un retour à
soi par la purification : « Comme si le rite de purification (…) faisait retour vers une
expérience archaïque et en recueillait un objet partiel non pas en tant que tel mais
seulement comme trace d’un pré-objet (…)181 ». Tuer en « retournant en arrière », c’est
se purifier de toute morale de même que le rite de la purification de l’abject est un
retour. Ainsi, telle la souillure évoquée par Kristeva, qui « n’est pas une qualité en soi
mais ne s’applique qu’à ce qui se rapporte à une limite et représente plus
particulièrement, l’objet chu de cette limite, son autre côté, une marge182 », l’acte de tuer
n’est pas tant abjection en soi, mais c’est le produit du meurtre, le cadavre, qui lui
l’est183. Le texte de Jules Romains illustre le propos de Kristeva quand il affirme :
Il faudrait en tous cas bien mettre l’accent […] sur l’idée encore plus obscure qu’il est mauvais de toucher aux cadavres, ou aux morceaux de cadavre, pour les déloger d’une place qu’ils ont choisie. Car bien loin de l’idée de profanation, au sens large où nous l’entendons, puisse à elle seule agir comme frein, je suis sûr au contraire que dans beaucoup de cas elle agît comme excitant184
Romains ici lie l’absence d’inhumation à une excitation ancienne, qu’il
comprend comme un mécanisme étouffé par la morale et le progrès social à l’échelle de
l’humanité que la guerre aurait réactivé. Dans l’espace du front où tout est permis,
monde primitif c’est-à-dire sans lois sociales, ce qui nous paraît abject, n’est en réalité
que la reconstitution symbolisée dans le présent d’un temps passé. Le narrateur de la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!180 Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, Paris, Seuil, 1980 181 Ibid., p. 88. 182 Ibid., p. 84. 183 J’aborderai en détail la question des cadavres, de l’absence d’inhumation et de la mixité des corps avec la terre dans un chapitre ultérieur. 184 Jules Romains, Verdun, éd. cit., p. 106.
! ! !
!
87!
guerre s’arrange avec cette idée que la « souillure » est portée par « l’objet chu » ou par
l’ancestral plaisir de tuer. En réalité, cet ancestral plaisir est une sorte de désacralisation
du corps engendré par l’acte de tuer, tel qu’il est perçu dans guerre moderne comme le
dit Francis Rowley cité par Bourke : « Killing has dulled all sensitiveness to the
sacredness of life185 », la sensibilité ou la délicatesse de l’homme civilisé évoquée plus
haut par Jerphanion dans le texte de Jules Romains.
Toute l’ambivalence de cette thématique de l’existence d’un ancêtre atavique en
l’homme, lorsqu’elle est attribuée à la restitution de l’expérience de la guerre, réside
dans cette citation où Jules Romains évoque la « morne sauvagerie ». Considérer le
soldat dans une vision primitiviste imagée ou reconstituée si l’on peut dire, permet de
mettre à distance l’entendement de l’expérience par le sujet écrivant. En effet, le roman
de guerre n’avoue pas nécessairement cette fêlure et préfère dire que ce qui renvoie
l’homme à un état primal n’est pas manipulable ou contrôlable par un soi conscient et
moderne qui agit. C’est se fuir soi-même pour suggérer l’existence d’un autre, en soi,
responsable pour soi, soit de manière consciente, soit incontrôlée. L’écriture joue alors
sur un dédoublement de la temporalité et par conséquent de la voix narrative : « Je dois
redevenir homme des cavernes et contribuer à l’assouvissement des appétits de ma
horde186 » nous dit le narrateur de La Peur, en justifiant son propos par la nécessité de
répondre à un besoin collectif – prendre soin de sa horde - auquel il réplique
individuellement par un retour à ses origines sauvages.
Dédoublement mais aussi transgression. En effet, liée à cette idée de fêlure, ou
de restes, suivant que l’on considère une absence ou une présence, un vide ou un plein,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!185 Francis Rowley cité par Bourke, op. cit., p. 339. « L’acte de tuer a neutralisé toute sensibilité du caractère sacré de la vie », je traduis. 186 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 222.
! ! !
!
88!
la vision d’un soldat comme homme primitif correspond aussi à celle d’un état de
transposition, non seulement d’une époque à une autre mais d’un stade de comportement
à un autre. Le comportement renvoie à un lieu et à un espace autre car quand le soldat
transgresse, par la violence, il se tient hors de la civilisation. En transgressant, il « viole
l’interdit » comme dirait Bataille, et en violant l’interdit il se déplace sur le plan
civilisationnel, il change d’espace-temps. Il entre dans la sphère de la férocité, de la
morne sauvagerie. Il ne s’agit pas de Tristes Tropiques si l’on peut se permettre ce
parallèle anachronique, mais de triste brutalité. C’est dans cet espace-temps mouvant,
instable où « se défont les frontières187 » comme l’affirme si justement Carine Trévisan
que le poilu expérimente le retour atavique dans un mouvement double, celui de sa
propre plongée en arrière et celui du resurgissement en lui de la primitivité. C’est là où
le soldat se tient, en dehors de lui-même (moderne), comme par nostalgie d’une
sauvagerie perdue – nostalgie ou jouissance, parfois nous n’en sommes pas sûrs – et en
même temps tellement en lui-même (primitif). Il semble alors ne pas pouvoir échapper à
sa condition de sauvage, elle-même dépendante de la situation d’énonciation. Subissant
le désenchantement du monde qui entoure, le poilu effectue mentalement un retour en
arrière comme pour se sauver de l’état présent. Et cette chose innommable, la guerre
donc, c’est cet espace de nostalgie brutale, autre, où se tient et évolue l’autre humain que
soi-même ; un double barbare, étranger donc. Cet homme étranger à lui-même, c’est ce
sosie coupable d’ubiquité étrange, ce « doppelgänger ». Le poilu va jusqu’à apparaître
comme un être humain divisé entre deux identités, une identité moderne et un être
atavique. Mais il est difficile de blâmer ce double, qui d’ailleurs n’apparaît jamais dans
la narration. Alors comme il est difficile voire impossible d’amadouer le primitif en soi-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!187 Ibid., p. 61.
! ! !
!
89!
même, par indulgence pour cet étranger qui réside en soi, on cherche la sauvagerie
ailleurs, de l’autre côté, en face.
Pour le Français, c’est l’Allemand. Dans le texte de René Benjamin, Gaspard
tient, en parlant de l’ennemi d’outre Rhin, les propos suivants : « Ah ! les sales brutes !...
J’en rapporterai d’la peau, voui d’la peau !188 ». La brute comme signifiant se transfert
de l’un à l’autre. L’ennemi, la brute, c’est celui que l’on nomme comme tel alors que
l’on est soi-même brutal. Parce qu’il veut annihiler l’autre, le narrateur devient primaire
dans son besoin de tuer mais parce qu’il ne peut se l’expliquer, c’est l’autre qu’il
considère ironiquement comme primitif. Mise à distance, la sauvagerie permet de
désigner l’autre comme responsable de la situation. Cette dialectique performative
donne à penser le conflit en termes dichotomiques, nous civilisés versus eux, sauvages.
Chez Romains, au moment où la bataille est engagée, « l’homme d’en face » redevient
« le Boche ». L’ennemi est alors paré de nombreuses dénominations péjoratives et
devient « saucisse », « vache », « porc ». « Si Fritz vient me voir, je fais pas
kamarade189 » affirme le personnage d’Escholier. Car on ne peut pas comprendre,
pactiser avec / accepter le sauvage. L’Allemand, c’est l’étranger, étranger par la distance
géographique (il vient de l’autre côté du Rhin !) ; étranger par la langue, c’est le barbare,
littéralement celui dont on ne comprend pas la langue. Mais cette accusation de barbarie
chez l’autre ne dure pas longtemps, car elle n’est que peu justifiable ni honnête. Alors
finalement, Jerphanion résume en ces mots la sauvagerie née de la guerre, cette guerre
qui est « une dégradation misérable de tout ce que la civilisation a mis debout et des
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!188 René Benjamin, op. cit., p. 41. 189 Raymond Escholier, op. cit., p. 182.
! ! !
!
90!
mécanismes de l’activité humaine190 ». Pour lui, « c’est le 2 août 1914 que le vrai front a
été rompu : celui de la civilisation contre la sauvagerie191 ». La guerre rend sauvage
parce qu’elle enlève à l’homme ses outils civilisationnels, parce qu’elle lui enlève les
outils qui sont d’ordinaire la garantie de son humanité.
Ce procédé d’écriture, spécificité de l’énonciation narrative du roman de guerre
qui revient à reporter les actions guerrières violentes dans une sphère incontrôlable (hors
de soi, dans le temps, ou hors de soi, causalité transposée sur un autre que soi), a été
théorisé par Joanna Bourke, Wolfgang Sofsky ou Georges Bataille entre autres
théoriciens de la violence et de la guerre. Chacun à leur manière, ces auteurs évoquent
une persistance de traits archaïques chez l’homme. En se basant sur cette hypothèse, il
nous est donc bien plus facile d’analyser les œuvres littéraires qui nous concernent. Au
sujet du texte de Bourke, mon intérêt s’est considérablement aiguisé à la lecture du
chapitre « Training Men to Kill ». Dans la partie consacrée à l’influence de la
psychologie dans les techniques guerrières, l’auteur précise que dès le début du siècle,
on note l’apparition de traités théoriques d’entraînement qui mettent en avant la
nécessité d’exploiter les instincts primaires « présents » dans la nature humaine. Ainsi,
en 1905, Stopford A. Brooke écrit dans son Discourse on War que l’être humain dispose
de « passions héréditaires » brutales dont il ne peut se débarrasser : « It comes down to
us from the brutes ; and linked to it, I can’t tell why, is a sense of keen pleasure,
eagerness, and exaltation. We cannot get rid of this hereditary passion. It is universal ; as
acute in the civilized as in the savage192 ». De son côté, dans son ouvrage The Moral
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!190 Jules Romains, Verdun, éd. cit. p. 243. 191 Ibid., p. 108. 192 Stopford A. Brook, A discourse of War, 1905, cité par Bourke, op. cit., p. 85. « Cela nous vient des brutes ; et lié à cela, je ne sais pourquoi, est un sens de plaisir intense, d’enthousiasme et d’exaltation.
! ! !
!
91!
Equivalent of War (1910) le philosophe William James, toujours cité par Bourke, expose
les dires suivants : « Our ancestors have bred pugnacity into our bone and marrow, and
thousands of years of peace won’t breed it out of us193 ». Il existerait donc dans l’humain
des restes ataviques qui pourraient être exploités à des fins de stratégies guerrières. C’est
la brute en l’homme qui est recherchée et pourtant rejetée, comme l’affirme le texte de
Maurice Genevoix cité plus haut. Corroborant cette question de la crainte de la
hiérarchie militaire face au resurgissement d’un processus qui se soustrairait à toute
discipline, l’auteur de An Intimate History of Killing affirme que ces types
d’entraînements se sont arrêtés dans l’entre-deux guerre, car considérés comme
« ridicules » par certains psychologues et anthropologues. Néanmoins, ces techniques
n’ont pas été totalement abandonnées, et expliqueraient que le primitivisme ait pu
survivre en tant que catégorie explicative dans le domaine militaire. Ceci expliquerait
alors peut-être que le vocable correspondant à une telle particularité tactique ait pu
déborder sur le champ littéraire et artistique.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nous ne pouvons nous débarrasser de cette passion héréditaire. C’est universel et aussi aigu chez l’homme civilisé que chez le sauvage », je traduis. 193 Joanna Bourke, Aop. cit., p. 85. « « Nos ancêtres ont développé de la pugnacité au plus profond de notre chair et des milliers d’années de paix ne parviendront pas à l’effacer de notre patrimoine génétique ». Je traduis.
! ! !
! ! 92!
PART II – Déshumanisation
Aux martyrs de Vingré194, victimes de « cette guerre qui humilie la chair comme le vice195 ».
La narration de guerre dans les œuvres que nous considérons opère un retour en
arrière sur l’échelle du temps, comme nous l’avons vu. Cependant ce mouvement
rétrospectif semble influer sur la perception que les auteurs-narrateurs des romans de
tranchées ont d’eux-mêmes. Ils évoquent une sorte de dégradation de ce qui constitue
l’essence même de l’humanité dans l’homme, une dérive ou une rupture des éléments
moraux voire physiques, essentiels, qui permettent de définir l’humain et qui font que
l’homme est l’homme. Et si ce n’est pas une suppression, dans le récit, des éléments qui
constituent l’homme, il s’agit tout du moins d’une altération de ces mêmes éléments,
une altération de l’ontologie humaine : dans une vision antérieure à la Grande Guerre,
cette ontologie se définissait principalement par opposition à l’animalité. Or justement
c’est ce que la guerre de 14-18 remet en cause, à mon sens, et ce pourquoi elle constitue
un événement majeur dans la façon dont l’homme se perçoit avant et après-guerre.
Entres autres éléments constitutifs de l’ontologie humaine, la station debout et sa remise
en question revient régulièrement dans les textes que nous considérons : elle est la
représentation métaphorique du retour à un stade animal, d’une dégradation de stature,
tant sur le plan physique que symbolique. Mais pas seulement. Les frontières entre
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!194 Accusés d’abandon de poste devant l’ennemi, les martyrs de Vingré sont six soldats fusillés pour l’exemple le 4 décembre 1914. Dans les lettres particulièrement émouvantes qu’ils envoient à la veille de leur exécution, aucun d’entre eux ne comprend la raison de cette décision martiale. Leur mémoire sera réhabilitée en 1921. 195 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 180.
! ! !
! !
93!
l’humain et le monstrueux, l’humain et les éléments environnants (la boue notamment),
les vivants et les morts progressivement s’effritent et empêchent de formuler une
définition immuable de ce qu’est « l’humain ».
Cette modification intrinsèque du discours a lieu du fait de la porosité entre les
auteurs et leur narration, c’est-à-dire entre le discours retranscrit et l’histoire réellement
vécue. Dans le cadre du récit d’événements, comme c’est le cas ici, la voix narrative
retranscrit de façon réaliste, voire performative, l’altération subie par l’auteur-narrateur.
Aussi, les violences subies affectent l’auteur du discours et par conséquent son
environnement mental et de fait, ses écrits.
Déshumanisation donc, cette modification des caractères essentiels de l’humain ;
je me concentrerai principalement sur deux phénomènes qui concourent à cette
modification. Le premier consiste en une immersion permanente des soldats dans une
violence sans limite, qui affecte les dispositions psychiques ou pourrait-on dire, de l’âme
– non nécessairement en tant qu’élément spirituel mais moral. Au-delà d’occasionner
des pertes matérielles considérables, l’explosion d’une violence incontrôlée, soudaine,
qui se soustrait à toute possibilité de rationalisation, tue non seulement la matière –
suppression de la vie organique en soi – mais elle tue aussi l’idée d’être soi, elle
supprime la foi dans la morale, elle amoindrit l’acuité culturellement acquise des sens,
des ressentis, de la sensibilité face au monde immédiat, occasionnant un désordre
d’ordre cognitif. Elle a en outre pour conséquence de désengager le soldat de la
responsabilité de tuer en reportant la sauvagerie sur l’autre, humain ou non, individuel
ou collectif, visible ou invisible dans le récit.
! ! !
! !
94!
Le deuxième phénomène dérive de cette constante proximité avec la violence.
Les espaces connus, les choses habituelles perdent soudainement de leur sens premier,
tombent dans le domaine de l’inconnu, de l’étrangeté196. L’introduction de l’horreur
dans le quotidien, voici ce qui crée ce que Manuel Didier appelle une
« instabilité désordonnée du monde197 ». La narration suggère un enchevêtrement de
plusieurs éléments du monde physique et mental des soldats qui d’ordinaire ne
cohabitent pas dans un monde de paix. L’ordonnancement du monde est bouleversé par
l’arrivée d’un chaos qui ébranle les représentations mentales des poilus, et qui par
conséquent affecte le discours du récit. L’on assiste à une mise en parallèle dans les
textes entre le chaos et la destruction du macrocosme d’une part et le bouleversement
physique, affectif et mental du soldat. Parallèlement au bouleversement factuel de
l’environnement du soldat, s’opère un bouleversement du discours narratif, rapprochant
dans un même mouvement entité réelle et entité fictive.
À la représentation classique de l’humain, fait de chair et d’os, se substitue une
représentation littéraire hybride – et brouillée –, engendrée par la destruction physique
des corps, une perte d’intégrité, par l’amputation, les blessures, les chocs mentaux, et par
un bouleversement des espaces et des corps dans l’espace, nous l’avons vu – haut/bas,
familier/étrange, intime/sphère collective. Les corps éparpillés et morcelés reprennent
forme au contact de matières étrangères à la chair humaine : boue, objet brisés,
morceaux d’obus… Cette hybridité va jusqu’à renverser la notion d’élaboration
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!196 Il est intéressant de rappeler que les théories élaborées par Freud avant la première Guerre Mondiale se sont profondément modifiées à la suite des études conduites sur le traumatisme infligé à des soldats pendant le conflit. Voir notamment Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » et « Psychologie des foules et analyse du moi », Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981. (1re éd., 1921). Freud redéfinit entre autres son concept de pulsion de mort qu’il rapproche du processus d’auto-annihilation. 197 Manuel, Didier, « La figure du monstre », in Didier Manuel (dir.), op. cit., p. 13.
! ! !
! !
95!
organique du corps au profit d’une conception biblique, mais inversée, de la création de
l’homme – glèbe originelle mais ici souillée : la boue des tranchées. Cette glèbe est non
plus essence et source de la première humanité mais source d’une nouvelle construction
– littéraire –, non pas ex-nihilo mais ex-bello. Elle est aussi la matière allégorique du
tombeau de l’humain.
! ! ! !
! ! 96!
Chapter III – Violences
Joanna Bourke, Wolfgang Sofsky et René Girard entre autres théoriciens
soutiennent que la violence est un phénomène inhérent à l’homme. Sofsky affirme, idée
désagréable et contestable, que l’homme aime à se battre : « Visiblement l’espèce
humaine trouve plaisir à la guerre198 ». Pour lui, il y aurait une étroite imbrication entre
civilisation, barbarie et modernité et la violence serait le fruit même de la civilisation. La
barbarie n’a jamais quitté l’homme et la modernité, par les progrès techniques qu’elle
fournit, ne fait qu’accentuer les moyens que nous avons de détruire et d’agir en
barbares199. Sofsky affirme que « la libération de la violence hors de ses frontières ne
tient pas au caractère inachevé de la modernité, mais bien plutôt à son succès
irrésistible200 ».
Alors que la violence dans le discours narratif, est communément rejetée aux
confins de la civilisation (car considérée comme antithétique avec l’idée de progrès),
s’immisçant dans le territoire métaphoriquement barbare de l’incompréhension et
parfois même de l’impossibilité de nommer, Sofsky, qui s’interroge sur la violence
induite, propose lui, à l’inverse, une nouvelle théorie : nous sommes sciemment acteurs
de la violence car c’est un phénomène inhérent à l’humain. Pour Sofsky toujours, la
question de la brutalité est intimement liée à celle de la modernité et par conséquent, elle
n’est ni une production atavique de l’homme, ni une spécificité propre au monde animal
comme cherchent à le prouver certains textes littéraires qui témoignent de la Grande
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!198 Wolfgang Sofsky, L'Ère, éd. cit., p. 144. 199 Wolfgang Sofsky base sa démonstration sur l’étude de la violence et de ses manifestations dans l’histoire et aussi sur l’étude de l’holocauste. 200 Wolfgang Sofsky, L’Ère, éd. cit. p. 72.
! ! ! !
!
97!
Guerre. La violence appartient donc bien au monde moderne, et son irruption n’a rien
d’ancien : elle est consubstantielle à l’ère historique de l’homme qui en use.
Cependant, un hiatus apparaît, divisant la théorie et les textes. En effet, il n’est
quasiment jamais question de la violence telle qu’elle est occasionnée par le narrateur.
Au contraire, la violence est décrite comme le résultat d’un acte perpétré par « ceux d’en
face » et retranscrite le plus souvent comme un phénomène subi. Sur le plan stylistique,
sa narration échappe à la responsabilité du je en tant que sujet homodiégétique. À ce
sujet, Nicolas Beaupré s’interroge : « L’emploi de la première personne comprend-elle
le « je » de l’analyste d’un inconscient collectif dévoilé par la guerre et débarrassé de la
culpabilité ou le « je » de l’homme en guerre constatant les effets du conflit sur lui-
même avec honnêteté ?201 ». Il s’agit alors d’observer la distance qui existe, créée par le
processus narratif, entre hypothèses théoriques et récits de guerre.
Extériorisation de la violence
La question de la violence est évidemment omniprésente dans les textes de 14-
18, en ce que ses manifestations sont quasi permanentes : bombardements, attaques
d’infanterie, explosions de mines, attaques à la grenade... Paradoxalement, aussi bien
l’historiographie que la littérature qui ont produit un nombre considérable de textes
depuis la guerre et la fin de la guerre, et ce au moins jusque dans les années quatre-vingt,
font preuve d’une grande pudeur eu égard la violence infligée comme subie, pudeur qui
se traduit par un refus d’avouer à l’écrit. Annette Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau
affirment : « L’historiographie française de la guerre se désintéresse généralement de la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!201 Nicolas Beaupré, op. cit., p. 164.
! ! ! !
!
98!
violence développée sur les champs de bataille […]202 ». En effet, l’historiographie a
longtemps privilégié les approches tactiques et stratégiques du conflit. À partir des
années 80, ce refus d’admettre la brutalité est dénoncé par une partie des études
contemporaines en sciences humaines sur le sujet et la violence trouve alors
progressivement sa place dans le discours historiographique (Becker, Audoin-Rouzeau,
Beaupré, Moss..), privilégiant un discours fondé sur l’histoire des hommes et sur les
questions du corps 203 – blessé et souffrant – qui s’éloigne de l’historiographie
traditionnelle dominée pendant longtemps par l’école des Annales et sa focalisation sur
l’histoire sociale et l’histoire des idées.
La littérature quant à elle s’est également tue, en grande partie en ce qui concerne
les textes écrits peu après la Grande Guerre, en traitant la violence de manière inégale
d’un récit ou d’un roman à l’autre. Le narrateur de La Peur avoue ainsi : « Tuer ? C’est
l’inconnu, et je n’ai aucune envie de tuer204 ». Pourquoi le soldat tait-il le fait qu’il tue
son semblable ? Nicolas Beaupré affirme :
Les signes physiques du trauma psychique – notamment la perte de contrôle de ses propres fonctions corporelles – après la mort infligée ou de grandes peurs – sont […] rarement évoqués. Le roman, qui n’est pas le genre le plus répandu chez les écrivains combattants, peut parfois permettre cette évocation. La fiction et l’usage narratif de la troisième personne provoquent une mise à distance qui peut autoriser, en plus de l’usage des non-dits, la mise en forme des effets humiliants de la violence205 […]. Dans ce cas, il s’agit de la violence subie. Mais la fiction souffre des mêmes
lacunes dans les cas de violence induite. En effet, le texte littéraire, quand il parvient à
dire la violence, le fait de manière distanciée et ce par le biais de différents procédés
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!202 Sthéphane Audoin-Rouzeau & Annette Becker, op. cit., p. 31. 203 À ce sujet, cf. Jean-Jacques Courtine, « Troisième partie – Déviance et dangerosités » in Corbin, Alain, Courtine, Jean-Jacques et Georges Vigarello, (dir.), Histoire du corps, Tome 3, Les mutations du regard, Le XXe siècle, Paris, Seuil, 2006, pp. 201-280. 204 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 91. 205 Nicolas Beaupré, op. cit., p. 125.
! ! ! !
!
99!
d’énonciation. C’est ce que je considère ici comme l’extériorisation de la violence, c’est
à dire le transfert des causes de violence sur une altérité, matérialisée dans la narration
par l’existence d’un tiers, autre que le je qui lui, refuse l’individualisation de l’action, de
l’acte narratif performatif. Cette transposition s’effectue soit en utilisant une troisième
personne de narration, qui fait basculer l’acte de violence de la sphère individuelle à la
sphère collective et lui confère un caractère impersonnel, soit en désignant l’individu,
l’autre, comme coupable de violence, autre qui peut être l’ennemi d’en face comme le
compagnon de tranchée.
Le pronom d’énonciation fréquemment utilisé dans nos œuvres de tranchée est la
plupart du temps nous ou on quand il s’agit d’évoquer le « camp ami », pronoms
collectifs qui supplantent le je, et qui dans ce cas favorisent l’anonymisation. Le
narrateur s’efface et privilégie la référence au groupe afin de ne pas avouer que je est
acteur de violence. Dans le cas de Les Éparges, Maurice Genevoix privilégie l’emploi
du nous lorsqu’il décrit une des attaques de la tranchée de Calonne, du 17 au 21 février
1915 « C’est nous qui allons à Calonne206 ». La suite du récit de cette attaque favorise le
récit d’un point de vue technique, impersonnel et formel de la tactique militaire et
relègue au second plan l’action individuelle : « C’est notre bataillon qui donnera
l’assaut. Les mines sauteront à deux heures ; il y aura bombardement d’une heure,
allongement du tir pendant dix minutes ; nous sortirons des parallèles à trois heures
juste207 ». C’est toute la particularité du discours de guerre dans la mesure où un conflit
engage l’individu mais avant tout le groupe – état, armée, bataillon. Par essence, le
combat n’est pas un combat d’homme à homme à proprement parler, il s’engage à plus
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!206 Maurice Genevoix, Les Éparges, éd. cit., p. 626. 207 Ibid., p. 629.
! ! ! !
!
100!
grande échelle. Il est donc difficile – et commode peut-être dans une optique de
déculpabilisation – de privilégier le je dans la mesure où ce n’est pas le je qui décide de
l’heure de l’action, de la stratégie et de la tactique à employer et chaque je de
l’énonciation reporte la responsabilité du commandement à un échelon hiérarchique
supérieur. Ou à la providence, ce qui revient une nouvelle fois à désengager l’action
individuelle.
Le narrateur de Les Éparges peine à avouer ses actes de violence si ce n’est dans
le passage suivant : « J’ai tiré ; eh bien ! oui, j’ai tiré. Lorsque je m’élançais là-haut,
était-ce donc vers la joie de tuer, vers l’Allemand qui allait apparaître ? J’ai obéi208 ».
Cependant les aveux de cet ordre sont rares et ici, non seulement le texte est au passé,
engendrant une nouvelle mise à distance dans le temps et incitant pat conséquent le
lecteur à l’oubli. Le propos se termine sur la suppression du libre-arbitre que génère le
devoir d’obéissance ; ainsi, la responsabilité n’est pas sienne, elle est renvoyée à la
sphère d’un donneur d’ordre invisible dans le récit.
Cette idée de tiers matérialisé par la présence du verbe « obéir », qui implique
une dialectisation entre au moins deux protagonistes ou deux entités narratives se
rapproche de la notion de « désir mimétique » théorisée par René Girard209. Et si le désir
(inavoué) de tuer se cachait derrière le désir (exprimé tel un ordre) du vouloir, c’est-à-
dire désir en soi et pour soi ? Auquel cas, le donneur d’ordre dans Les Éparges prend la
place du médiateur externe et permet au narrateur qui lui a obéi de souscrire au
« mécanisme victimaire » auquel Girard fait allusion dans son œuvre La Violence et le
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!208 Maurice Genevoix, Les Éparges, éd. cit, p. 721. 209 René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, 1961
! ! ! !
!
101!
sacré210. Si ce n’est que dans le cas de Genevoix, la victime de la violence n’est plus
« autrui » (le « bouc-émissaire » de Girard), mais soi-même, le narrateur, qui, parce qu’il
est contraint de tuer, devient la victime arbitraire, sous les ordres donc, d’une violence
invisible. En extériorisant la violence, l’auteur-narrateur opère un renversement de
situation, distorsion probable de la réalité vécue, qui lui permet de s’effacer du récit.
Chez Genevoix notamment, la répétition constante du nous rend le je insignifiant.
Ainsi, peu après le « j’ai obéi », le texte passe au temps présent et décrit l’état
d’âme du narrateur : « Je suis las211 ». Le texte de guerre admet donc l’énonciation du
ressenti mais la narration est doublée d’un filtre de distanciation quand il s’agit d’avouer
que l’on a tué212. Pour reprendre les propos de Stéphane Audoin-Rouzeau « on est tué à
a guerre mais on ne tue pas 213 ». Le je ne blesse ni te tue, il est blessé et meurtri. Le je
est victime, il est objet de la violence d’autrui.
Dans La Sainte Face, Élie Faure évoque lui aussi un être invisible, responsable
des violences de guerre, qui interagit dans le discours comme un tiers au cœur d’un
mouvement triangulaire. Il est celui à qui le narrateur s’adresse, ce tu que l’on accuse
des maux infligés aux hommes. Méta-personnage ? Lecteur ? Peuple allemand ? Qui est
ce tu que le narrateur met en face de lui comme pour établir un nouveau niveau de
conflit, cette fois, à l’échelle individuelle ? « […] tu as fait monter le sang jusqu’à la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!210 René Girard, La Violence et le sacré, Paris, Hachette, 1998. 211 Maurice Genevoix, Les Éparges, éd. cit, p. 721. 212 Je ne fais pas mention dans ma thèse de Blaise Cendrars, l’un des rares écrivains combattants à avoir admis qu’il avait tué : « À nous deux maintenant. À coups de poing, à coups de couteau. Sans merci, je saute sur mon antagoniste. Je lui porte un coup terrible. La tête est presque décollée. J'ai tué le Boche. J'étais plus vif et plus rapide que lui. Plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi. J'ai tué. Comme celui qui veut vivre », Blaise Cendrars, J’ai tué, Paris, Ed. Georges Crès, 1919, p. 21. 213 Stéphane Audoin-Rouzeau & Annette Becker, op.cit. p. 64.
! ! ! !
!
102!
bouche de l’homme, et il le vomit214 » écrit Élie Faure. Entité dégagée de l’homme,
inconnue et responsable, qui vide l’homme de son sang, de sa matière vitale.
Notons que les aveux de violences qui pouvaient figurer dans certaines des
versions publiées pendant la guerre, se trouvaient supprimés dans les versions ultérieures
puis rétablis enfin tardivement. C’est le cas de Maurice Genevoix encore qui, dans une
nouvelle édition de Ceux de 14215 datant de 1950, restaure un passage où il avoue avoir
abattu quatre Allemands d’une balle dans la tête ou dans le dos. Si d’un côté la violence
est avouée, comme nous l’avons vu plus haut, la terminologie est révisée. Ainsi les
« Boches » deviennent des « Allemands » et ils ne sont plus quatre mais trois. Le résultat
– l’acte – est le même mais la perception que le lecteur en a est nuancée.
L’ « Allemand » est un ennemi historique légitime et tuer se fait dans le cadre d’une
guerre « juste ». Le nombre de morts est réduit, mais cela ne fait pas de grande
différence puisque, qu’ils soient quatre ou trois, ou dix, ils ont été tués dans le cadre
d’un conflit justifié.
Chez Jules Romains, dans Sous Verdun et Verdun, le narrateur /locuteur est peu
manifeste et l’énonciation historique prédomine. Le récit n’est jamais à la première
personne dans la mesure où c’est Jerphanion, le personnage principal qui est mis en
avant par le biais de la troisième personne. Les rares fois où il s’exprime en tant que
locuteur direct, il s’agit d’un rêve qu’il raconte ou d’une lettre qu’il envoie à sa
femme : dans les deux cas, la situation d’énonciation favorise la distance, qu’elle soit
physique (il est loin de sa femme) ou psychique (le rêve, qui plus est un rêve d’abri !).
Cette distance est créée dans Prélude à Verdun dès les trois premiers chapitres dans la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!214 Élie Faure, op. cit., p. 119. 215 La première édition datant de 1916.
! ! ! !
!
103!
mesure où la guerre est traitée d’un point de vue très général. Il faut attendre le
quatrième chapitre pour que le personnage de Jerphanion apparaisse, autorisant un
rétrécissement de la focale narrative. Le narrateur, alors omniscient, s’attache
essentiellement à décrire l’environnement du personnage et adopte un point de vue
interne : c’est la plus grande proximité textuelle que le lecteur rencontre au cours du
récit, sans jamais réussir à lire un aveu de violence de la part du personnage.
Dans le texte de Gabriel Chevallier, bien que le roman diffère des autres sur le
sujet en ce qu’il se consacre à une description très précise et crue du phénomène de peur
tel qu’il est ressenti par les soldats, l’auteur peine néanmoins à expliciter la violence
comme phénomène perpétré par le camp français. « L’inutile victoire qui consistait à
enlever un élément de tranchée allemande se payait d’un massacre des nôtres216 » - la
violence est considérée comme un retour des choses, un mouvement de va-et-vient, qui
n’est jamais explicité dans sa phase où elle « va » mais toujours dans la phase où elle
vient – et pas même « revient ». Comme si une fois encore, les soldats étaient les
victimes unilatérales du conflit et que la violence n’était que la manifestation d’un
phénomène exogène. Gabriel Chevallier constitue néanmoins une exception, car à un
moment du texte, alors que sa compagnie attaque une tranchée allemande, le narrateur
fait aveu de violence : « Mon corps lancé plonge […] avec une force irrésistible, dans le
ventre de l’homme gris qui tombe à la renverse. Sur ce ventre encore, je saute, talons
joints, de tout mon poids. Cela fléchit, cède sous moi, comme une bête qu’on écrase217 ».
La violence de la scène est relativement incongrue et son aveu, d’autant plus. Car en
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!216 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 88. 217 Ibid. p. 261.
! ! ! !
!
104!
effet, si l’on ne s’en réfère qu’aux textes, il semble presque que la guerre ait eu lieu
comme l’interaction de clans de victimes uniquement.
Nouveau procédé de distanciation, pour rétablir un combat valide, qui oppose
donc deux entités distinctes, la narration, dans les textes considérés, personnifie la
guerre par le biais d’autant d’agents qui la composent : les armes utilisées finissent par
agir en tant que sujets propres, dotés d’intentionnalité. Par le biais de la personnification,
on assiste à une perte de la spécificité des genres, des registres. Les limites définissant
chaque « genre, espèce », vivante ou non, deviennent poreuses au point de disparaître,
supplantant le sujet « humain » par un sujet-objet. Ainsi, dans le texte de Jules Romains,
« les obus fusent218 », chez Dorgelès « un seul obus qui tue 12 [sic] hommes219 » et chez
Gabriel Chevallier, « les obus s’écrasent près de nous220 » comme tout autant de sujets
personnifiés qui déresponsabilisent les artilleurs qui les tirent. Une fois encore, la
narration refuse de faire porter à l’homme l’irrationalité d’une violence aveugle et il est
supplanté par des sujets-objets qui s’animent. Chez Drieu La Rochelle, les hommes sont
également déchargés de la responsabilité de tuer et c’est l’action de Dieu qui se substitue
à celle humaine : « Ce ne sont pas les hommes, c’est le Bon Dieu, le Bon Dieu lui-
même, le Dur, le Brutal221 ! ».
Ceci reprend et complète une partie des analyses littéraires récentes222 qui
tendent à montrer de manière générale que bien souvent la violence a été plus absente du
discours qu’elle ne l’a été du champ de bataille. Il apparaît en outre que si violence il y a
eu dans l’expression littéraire, cela était à des fins de dénonciation pacifiste. Néanmoins,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!218 Jules Romains, Verdun, éd. cit., p. 678. (à verifier) 219 Micheline Dupray, op. cit., p. 287. 220 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 290. 221 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 202. 222 Je pense à l’œuvre de Nicolas Beaupré notamment ou à celle de Carine Trévisan.
! ! ! !
!
105!
il semble que certaines analyses du discours littéraire n’aient pas vu les subtilités de
certains paradoxes dans la narration de la violence comme l’a montré le travail de
Nicolas Beaupré. Son analyse des raisons de l’utilisation de la violence dans les textes
est particulièrement déterminante en ce qu’elle souligne l’ambivalence des
ressemblances narratives qui peuvent exister entre un texte fondamentalement pacifique
et un autre qui tend à légitimer la violence :
Pendant la guerre, ni même après, il n’y a pas d’équivalence nécessaire entre une vision réaliste et ultra-violente du conflit et le pacifisme. La description de la violence ou même sa simple évocation sert plus souvent à la légitimer qu’à la condamner. De fait, dans ces textes il n’est pas toujours facile de distinguer la victime de la guerre du martyr de la patrie. L’évocation par la littérature des souffrances vécues comme des conséquences des violences du combat porte également en elle cette ambivalence fondamentale223. La violence qui est donc la plus volontiers narrée est celle qui est vécue, subie.
Le mouvement violent est relaté comme venant du dehors pour confronter et menacer
l’intégrité physique et/ou morale du soldat. C’est d’ailleurs ce qui justifie en partie
l’écriture de La Peur de Chevallier. Le mouvement violent de la guerre est celui qui
impose la peur : « Je sens la peur qui afflue, j’entends ses gémissements, je sais qu’elle
va me poser sur la figure son masque livide, me faire haleter comme un gibier qui fuit
devant la meute…224 ». La peur est personnifiée et c’est d’ailleurs elle qui porte
l’écriture : une nouvelle fois, nous assistons à un processus de personnification, résultat
d’un transfert du sujet agissant sur une entité porteuse de métaphore.
Chez Raymond Escholier, l’énonciation joue sur l’ambiguïté des mots :
« Larnaude ! cria Servat. ‘‘Quand je t’ai dit qu’il fallait en tuer un gros ! ’’ Un
claquement sec. Deux ongles écrasant un pou ». Et plus loin : « Fameux ! Un vrai
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!223 Nicolas Beaupré, op. cit., p. 132. 224 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 291.
! ! ! !
!
106!
Boche !225 ». L’ambivalence porte sur le va-et-vient entre l’image du pou, considéré
comme un ennemi de tranchée, et celle du « boche », ennemi de la tranchée d’en face.
Qui est donc ce véritable ennemi que l’on tue ou que l’on aimerait tuer ? S’agit-il de
cacher l’acte de tuer en le déplaçant sur un animal qui nuit ? Probablement car le texte
d’Escholier fait preuve d’une grande retenue en la matière : « Fusils brisés, casques
troués, lambeaux de capotes, réseaux rompus, tout atteste la violence de la lutte226 ». Où
sont les blessés ? Les cadavres ? Est-ce seulement cela le résultat de la violence, une
description d’objets abîmés ? Au lieu de parler des morts, le discours évoque des objets
cassés : la réalité vécue se voit cachée par un décentrement du propos qui insiste sur une
description insignifiante. Quoique ; en effet, l’on peut considérer cette énumération
d’objets cassés comme celle de la destruction métaphorique d’objets culturels propres à
une culture, et donc, par analogie, la destruction de ladite culture.
Si la mort de l’homme est peu explicitée chez Escholier, elle l’est en revanche
par le biais de la métaphore filée, tout au long du texte, de la dégradation et des ravages
qu’endurent non seulement les objets mais aussi la nature. « Un vrai bois de magie, avec
ses arbres chancelants et gémissants, agitant les moignons de leurs branches coupées
[…]227 ». Aussi, la violence modifie la vision que le narrateur a de son environnement
immédiat : voici « l’ensauvagement », ou ce que George Moss appelle la
« brutalisation228 ». Je l’applique ici à l’écriture de guerre qui transforme l’esthétique
classique en une esthétique singulière, induite par l’expérience de la violence au front.
L’intériorisation de la violence, c’est à dire la prise en compte de la violence trouve un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!225 Raymond Escholier, op. cit., p. 28. 226 Raymond Escholier, op. cit., p. 50. 227 Raymond Escholier, op. cit., p. 65. 228 George Moss, op. cit.
! ! ! !
!
107!
exutoire dans l’acte d’écriture et la narration. Il s’agit de faire « choir » la violence de
l’autre côté de soi, qui une fois chue passe la barrière de l’abject. C’est ce que nous
jetons hors de nous (ab-jection, jeter hors de soi). Le paradoxe de l’abjection réside en
ce que cette « chose » est à la fois près de nous mais inassimilable, ce qui expliquerait
l’ambiguïté des textes à ce sujet. La violence est produite par le je narrant, bien que nous
la pensions et la percevions comme venant du dehors : « obscurs et violentes révoltes de
l’être contre ce qui le menace et qui lui paraît venir d’un dehors ou d’un dedans
exorbitant, jeté à côté du possible, du tolérable, du pensable229 » affirme Julia Kristeva.
En effet, la guerre est source de souffrances corporelles (blessures, amputations,
faim, maladies) mais aussi de souffrances morales : le deuil – ou s’agit-il de la perte qui
impose le processus de deuil – les pertes vécues à répétition quand quotidiennement les
compagnons de tranchée sont tués, avec pour conséquence un état de deuil permanent,
en sont un bon exemple. Les auteurs évoquent aussi ce découragement puis ce « cafard »
qui s’insinue progressivement dans leur vie quotidienne, cette violence sourde qui
contribue à amoindrir les capacités morales et mentales. Mais ce que la violence vécue
engendre, c’est qu’elle rend sauvage celui qui la subit.
Cette idée, reprise par Joanna Bourke, trouble le lecteur que nous sommes mais
aussi l’écrivain combattant qui divise alors son moi narratif en deux parties, celle
subissant et celle agissant qui ne lui appartient déjà plus en ce qu’elle est renvoyée à une
sphère incontrôlable, incontrôlée. Et la dualité étant difficilement supportable /
acceptable, la moitié humaine doit mourir.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!229 Julia Kristeva, op. cit, p. 9.
! ! ! !
!
108!
« Je sentais l’homme mourir en moi230 »
Pour Wolfgang Sofsky, « L’idée de civilisation fait aujourd’hui encore partie du
noyau central de notre conception du monde. Bien que la Première Guerre mondiale eût
laissé quelques lézardes dans cette fantasmagorie, c’est une idée qui s’obstina à
survivre231 ». Ainsi s’énonce une des conceptions de ce qu’est la civilisation à la suite de
deux conflits mondiaux et de l’holocauste. L’hypothèse d’une fêlure dans l’évolution de
l’humain est néanmoins bien présente. Comment cette idée de déshumanisation a été
vécue et verbalisée dans les textes de guerre ?
« Je sentais l’homme mourir en moi » : c’est par ces mots terriblement
anxiogènes que Drieu La Rochelle s’exprime sur son expérience de guerre. La guerre
porte en elle une rupture, une faille qui annihile ontologiquement l’homme en l’homme.
Suppression des caractères propres à l’humain, la fêlure semble arriver quand le soldat
ne peut plus supporter la violence et ses manifestations tant sur les hommes que sur
l’environnement immédiat des soldats. Le processus de déshumanisation affecte en effet
tant les êtres que les choses et les paysages, et se matérialise dans le récit par le biais de
deux images ; à l’amoindrissement physique succède l’amoindrissement moral. Alors
que les soldats progressent dans les mois de la guerre, ils laissent peu à peu derrière eux
le monde de la paix, espace civilisé. « Ils se déplaçaient à travers des régions encore
humaines – ce qui leur arrivait, il est vrai, assez peu232 » écrit Jules Romains. En
avançant plus en profondeur sur le champ de bataille, les poilus laissent l’arrière,
laissent les dernières traces d’humanité c’est-à-dire les dernières traces de repères liés à
un monde de paix. Pour Jerphanion, alors qu’il s’adresse à Fabre, la guerre « est aussi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!230 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 68 231 Wolfgang Sofsky, L'ère, éd. cit., p. 71. 232 Jules Romains, Verdun, éd. cit., p. 228.
! ! ! !
!
109!
une dégradation misérable de tout ce que la civilisation a mis debout et des mécanismes
de l’activité humaine233 ». Et plus loin : « Voilà, il me semble, la perte entre toutes
irréparable. Il avait fallu à la civilisation des siècles de tâtonnements, de patientes
redites, pour apprendre aux hommes que la vie, la leur, celles des autres, est quelque
chose de sacré. Tout ce travail est fichu. On ne s’en remettra pas, tu verras234 ».
L’ontologie humaine, mise à mal donc. La guerre : « a world that denies humanity235 »
comme l’affirme Alfredo Bonadeo. Comment s’opère cette fêlure cependant dans le
discours narratif ?
La perte d’humanité passe tout d’abord par un changement d’ordre physique.
Chez Drieu La Rochelle comme chez Élie Faure, la perte de la verticalité est un facteur
fondamentalement responsable de cette perte d’humanité. Après plusieurs semaines
passées au front, Pierre Drieu La Rochelle raconte comment inlassablement le soldat,
isolé, face au vide, à l’ennemi absent c’est-à-dire face à l’absence de semblables,
trébuche : « Dans cette guerre, on s’appelait, on ne se répondait pas. J’ai senti cela, au
bout d’un siècle de course. On a senti cela. Je ne faisais plus que gesticulailler, criailler.
Je n’avançais plus guère. Je trébuchais, je tombais. Ils trébuchaient, ils tombaient. Je
sentais cela236».
L’image de l’homme qui tombe rejoint métaphoriquement celle des hommes qui
trébuchent moralement. Il y a certes une souffrance à ramper mais il y a aussi un
asservissement consenti à refuser la posture debout selon Drieu : « Les hommes n’ont
pas été humains, ils n’ont pas voulu être humains. Ils ont supporté d’être inhumains. Ils
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!233 Ibid. p. 243. 234 Ibid. p. 107. 235 « Un monde qui rejette l’humanité », je traduis. Alfredo Bonadeo, Mark of the Beast, op. cit., p. 3. 236 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 68.
! ! ! !
!
110!
n’ont pas voulu dépasser cette guerre, rejoindre la guerre éternelle, la guerre
humaine237 ». La guerre de 14 serait ici une sorte de guerre misérable et sans éclat, -
c’est d’ailleurs ce que reprochent une partie des auteurs traditionnalistes à la Grande
Guerre, un manque de grandeur militaire -, qui dégrade et inocule à l’humain un
« virus » non-humain. Les soldats flanchent, écrasés par un sentiment d’abaissement,
harassés par une situation qui submerge leur capacité à toujours se tenir debout. La
chaîne de l’évolution fait marche arrière, la stature de l’homme rapetisse pour finalement
le mettre à genoux et sa spécificité humaine disparaît. En effet, la violence affecte avant
tout l’ordre du monde en ce que l’ordre serait le « propre de l’homme ». Par effet
contraire, le chaos bouleverserait ce « propre de l’homme ». D’ailleurs Drieu écrit :
« Naturellement, j’avance à quatre pattes : on est du XXe siècle ou on n’en est pas238 ».
Rejet évident d’une ère de progrès qui n’en est pas une mais aussi bouleversement de ce
qui est propre à l’homme, négation des évidences par le biais de l’ironie : je suis
naturellement ce que je ne suis pas. Car comment être humain dans une guerre qui ne
l’est pas ? « Nous y sommes encore dans ce trou, nous n’en sommes jamais repartis. Il y
a eu un élan dans cette guerre, mais il a tout de suite été brisé. Il n’a jamais abouti. Trop
inhumain cet élan, trop chargé d’acier et trop battu par l’acier, se heurtant à une
résistance trop inhumaine239 ». L’identification du moi opère un glissement progressif
vers une entité nouvelle, engendrée par une régression. La perte de la station debout, la
difficile progression dans les tranchées où les hommes rampent la plupart du temps, où
ils se tiennent accroupis pour se donner l’illusion qu’ils ne seront pas touchés, affecte la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!237 Ibid. p. 66. 238 Ibid. p. 161. 239 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 68.
! ! ! !
!
111!
perception qu’ont d’eux-mêmes les soldats de 14 et par extension, de l’humanité et de la
civilisation.
À l’amoindrissement physique s’ajoute l’amoindrissement moral, une mort de
l’âme. Ainsi, la « détresse morale accentue le dénuement physique… Crise tragique,
celle où une âme virile sent lui échapper son enveloppe, sa guenille humaine240 » écrit
Raymond Escholier. De l’âme virile, on passe à la guenille humaine : une dégradation
non seulement de la masculinité mais de l’homme. Cette idée de « guenille » sera reprise
plus tard par Primo Levi qui, au sujet du drame de l’Holocauste, témoignera de « pauvre
débris humain241 ». L’intériorité mentale et morale apparaît comme éclatée, fragmentée,
déchue de son humanité. L’homme est « décomposé » de ce qui le constitue, de ce qui
façonne sa morale et donc sa relation aux autres et au monde. La violence ultime,
difficile à surmonter, attaque le moral des soldats mais aussi l’idée de l’éthique au sens
de valeur morale. Car comment moralement supporter le meurtre, comment supporter de
tuer ? Joanna Bourke affirme :
Historians and other commentators have emphasized the way that combat brutalizes its participants: combatants pay an extremely high moral and psychic cost for their gruesome profession, which changes them into ‘inferior’ and degraded human beings, argued Alfredo Bonadeo in this aptly titled Mark of the Beast (1989)242.
C’est donc bien l’acte de guerre, pourtant porté au départ par les élans
patriotiques, qui dégrade l’homme. Martin Hurcombe lui affirme : « War as a subject
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!240 Raymond Escholier, op. cit., p. 48. 241 Primo Levi, op. cit., p. 179. 242 Joanna Bourke, op. cit., p. 338. « Les historiens et autres commentateurs ont insisté sur la façon dont les combats rendent ceux qui y participent plus brutaux : les combattants paient un prix moral et psychologique élevé pour leur épouvantable activité, ce qui les transforment en êtres humains « inférieurs » et dégradés, soutient Afredo Bonadeo dans son œuvre justement intitulée, Mark of the Beast ». (je traduis).
! ! ! !
!
112!
both appals and appeals. At its most abject, it reveals the horror and misery of the human
condition in the degradation that it enforces upon its victims243 ».
Mais ce qui semble le plus choquant et désarmant dans ce constat de perte
d’humanité, c’est aussi et surtout une sorte d’indifférence pour la sensation, pour le
ressenti humain, une absence d’empathie de la part de cette humanité pour ses
semblables qui – parce qu’elle côtoie trop l’horreur ? : « […] les morts étendus […]
spectacle déchirant qui n’émeut même plus244 » écrit Roland Dorgelès. Ce qui permet
d’expliquer que le contact permanent avec la mort et son produit, la chair inerte, soit
évoqué dans de nombreux textes.
En effet, la perte d’humanité passe aussi dans les textes par une proximité avec
les cadavres, nous élaborerons cette idée dans le chapitre qui suit, proximité qui continue
de « déranger » ces mêmes corps sans vie, en ce qu’elle constitue un refus d’accorder
aux dépouilles restées sans sépulture les égards qui leur sont dus :
Sur le Mont des Singes, on trouvait une quantité de cadavres allemands, violacés, gonflés, en état de décomposition avancée. […] Malgré l’odeur, les soldats les plus hardis, les plus âpres au gain les fouillaient encore, mais vainement. Ces malheureux avaient déjà été retournés par leurs vainqueurs [...]245. La déshumanisation passe par le non respect des morts, par la capacité à toucher
le corps défunt, celui qui est tombé pour reprendre le propos de Julia Kristeva. Ceci est
fondamental en ce que c’est emblématique de la régression morale et sociale que vivent
les soldats, de leur déshumanisation.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!243 Martin Hurcombe, Novelist in conflict: Ideology and the Absurd in the French Combat Novel of the Great War, New York, Rodopi, 2004, p. 19. « La guerre en tant que sujet d’étude à la fois horrifie et attire. Dans sa conception la plus abjecte, elle révèle l’horreur et la misère de la condition humaine dans la dégradation qu’elle fait subir à ses victimes ». (je traduis). 244 Rolland Dorgelès, Je t’écris, éd. cit., p. 272. 245 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 279.
! ! ! !
!
113!
Enfin, la déshumanisation correspond aussi à la substitution de l’homme par
quelque chose de mécanique – cette chose inexplicable et effrayante qui échappe à
l’entendement. Pierre Mac Orlan dans les Poissons-Morts corrobore l’idée d’une
disparition de l’homme en l’homme : « Les hommes n’avaient plus figure d’hommes.
Leurs yeux brillaient étrangement246 ». L’on voit alors pointer cette étrangeté jusqu’alors
majoritairement intégrée aux textes et récits fantastiques du XIXe siècle247, comme une
disparition de caractères humains au profit d’une nouvelle création, inconnue, automate.
C’est d’ailleurs ce que souligne longuement Pierre Drieu La Rochelle dans La Comédie
de Charleroi : la machine se substitue à l’homme, le monde moderne déshumanise :
Qu’est-ce que je fais là ? Je suis un homme. J’ai été promis à un monde d’hommes et d’animaux. Mes ancêtres n’ont pas travaillé à une civilisation pour que soudain nous n’y puissions plus rien et que le mouvement se perde machinal, aveugle, absurde ? Une machine, un canon qui tire sans arrêt, tout seul. Qu’est-ce que cela ? Ce n’est ni un homme, ni un animal, ni un dieu. C’est un calcul oublié qui poursuit seul sa trajectoire à travers le monde […]. Des mots absurdes deviennent vrais : mécanisme, matérialisme248. L’homme cesse d’intervenir en tant qu’exécutant propre, n’assume pas
narrativement de tuer (ou très peu, nous l’avons vu). La création littéraire propose alors
de lui substituer un nouvel agent. Ne pouvant accepter un vide littéraire quant à un
sujet/narrateur manifeste, il s’agit pour les auteurs de créer une nouvelle image, qui sera
substituée à cet humain défaillant, contrit de peur, transformé et sans plus aucune
volonté d’agir en nom propre.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!246 Pierre Mac Orlan, op. cit., p. 30. 247 Je pense notamment à l’importance des yeux et à la figure d’Olympia dans les contes d’Hoffmann. 248 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 186.
! ! ! !
! 114!
Chapter IV – Une « instabilité désordonnée du monde249 »
Nous avons vu comment la déshumanisation de l’homme, assujetti à un monde
de violence qu’il ne peut fuir, progressivement se trouve verbalisée dans les textes du
corpus qui nous concerne, subtilisant chez l’homme une partie des fondements éthiques
qui le caractérisent. Mais le corps, en tant que contenant de matière organique, est
également sujet à des chocs profonds et subit de grandes modifications que ce soit
psychiquement ou physiquement dans le cas des blessés. Le corps des défunts est lui
aussi malmené. Or quelles représentations de ces bouleversements – disparition,
amputation, blessures – la littérature de guerre offre-t-elle ? Il s’agit de voir où part la
matière rejetée, où se cache le cadavre, dans quel espace-temps, dans quels replis du
discours narratif, comment l’amputation est représentée, comment vivants, morts et
blessés apparaissent dans l’espace romanesque.
Le soldat au front, en tant que personnage qui parcourt l’espace de la narration,
apparaît au lecteur sous différents aspects. Il y a d’abord le soldat « maquillé », bardé de
boue, dont on ne reconnaît pas nécessairement ou directement les traits humains
distinctifs. C’est le personnage « maculé », cet homme dont l’uniforme même, qui le
qualifie en tant que soldat, n’est plus reconnaissable. Les conditions de sa spécificité
(c’est-à-dire être au front) lui enlèvent paradoxalement cette même singularité qui le
distingue du civil : il devient un individu, un personnage distinct. Puis il y a le soldat
mort. Son corps, à travers le roman de guerre, prend la forme de toutes sortes de
représentations : cadavre encore intègre, corps mort éclaté, morcelé ou amputé. Le
propre du corps du soldat défunt réside la plupart du temps dans ce que la sépulture, de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!249 Manuel, Didier, « La figure du monstre », in Didier Manuel (dir.), op. cit., p 13.
! ! ! !
!
115!
facto, lui est refusée250. En effet, bien que certains soldats soient inhumés au front, qu’un
service religieux ou civil leur soit brièvement dédié, les bombardements incessants ne
laissent pas longtemps les corps enterrés à leur place. Le caractère tragique de cette
répétition naît du fait que le deuil n’est jamais complet, le mort mourant plusieurs fois,
par processus de déplacement et / ou d’éparpillement. Par ailleurs, la chair mélangée,
hors de sa « boîte » - boîte qui est autant le cercueil que l’enveloppe charnelle d’ailleurs
-, éparpillée, nourrit l’imaginaire du lecteur d’images inconstantes, car mouvantes mais
aussi incomplètes. Cette expérience de la chair éparpillée d’un point de vue de l’écriture
semble être celle qui invite à l’imagerie de l’abject, rejetant le discours dans un ailleurs
narratif : il s’agit de pousser loin de soi, loin du je qui raconte l’expérience de guerre,
même dans le cadre d’un sujet homodiégétique, la vision terrible des chairs abîmées et
sans sépulture. Et puis enfin il y a le soldat blessé et défiguré qui viendra remplir les
rangs des « gueules cassées251 », dont les traits humains échappent à l’entendement de la
première reconnaissance visuelle et qui même s’ils sont toujours perceptibles,
engendrent néanmoins l’horreur, la crainte, l’incertitude qu’il ne s’agisse plus d’un
homme. En effet, le soldat mutilé dont les traits du visage ou le corps sont parfois
méconnaissables, tend plus vers l’aspect du monstre que vers celui de l’homme. Ainsi la
blessure qui modifie l’aspect physique va elle aussi concourir à la redéfinition de ce
qu’est l’humain et de sa représentation à travers le roman de guerre.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!250 Alors que le mythe grec tragique d’Antigone punit le délit de trahison de Polynice en lui refusant une sépulture, ici le tragique de situation réside dans le caractère répétitif de l’inhumation suivie de l’exhumation et ainsi de suite. 251 À ce sujet, voir le travail de Sophie Delaporte, Les Gueules Cassées. Les blessés de la face de la Grande Guerre, Paris, Noêsis, 1996
! ! ! !
!
116!
Le poilu, ce « glébeux » - les vivants
« Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. », Genèse 2 :7252
Le roman de tranchées évoque abondamment cette constante proximité des
soldats avec la boue. La boue est constitutive du quotidien du soldat, lors des pluies ou
aux fontes des neiges et gelées. Bien qu’élément du réel, la boue devient
progressivement un décor à part entière dans la narration, représentation figurée du lieu
dans lequel évoluent les poilus. À ce sujet, l’emploi métonymique du mot est fréquent.
Ainsi la relation logique qu’entretient le vocable avec son environnement supprime les
contraintes linguistiques de descriptions répétées et « la boue » devient une terminologie
qui renferme toutes les entraves quotidiennes qui lui sont associées : insalubrité,
inconfort, difficulté de déplacements.
Chargée de sens et d’une symbolique qui peu à peu renforce son signifié, la boue
est cet espace mouvant et changeant, sale la plupart du temps, dont on ne peut se
débarrasser ni s’extraire, dans laquelle les soldats s’embourbent. « Un sol de
tremblement de terre, des cratères d’obus à l’infini ; sur la glèbe à vif […] gouffres
mouvants qui happent l’homme, l’engloutissent ; tout cela boueux, visqueux, glissant.
Dans l’obscurité funèbre, retombée comme une trappe, il semble que l’on marche sur
des limaces 253 » écrit Raymond Escholier. Cet exemple renvoie l’idée d’un
environnement instable, d’un élément qui est hostile au soldat, tant sur le plan tactique
que dans son confort au quotidien. Le poilu est pris au piège, suffoque dans un milieu
dont il ne peut s’extraire et qui progressivement symbolise à la fois un espace et un stade
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!252 Bible de Jérusalem, Paris, Cerf, 1997. 253 Raymond Escholier, op. cit, p. 48.
! ! ! !
!
117!
au sein duquel s’opère une forme de régression. En effet, pour Roland Dorgelès, la boue
reste le symbole de la déchéance humaine. Le 14 décembre 1914, il envoie un courrier à
sa sœur Loulou et il écrit : « J’aimerais mieux avancer que de continuer à vivre dans nos
terriers boueux. Cette guerre de tranchée est ignominieuse […] les hommes ne sont plus
que de pauvres tas de boue […]254 ». Maurice Genevoix utilise la même expression :
« Maintenant je suis une masse boueuse […] 255 ». Il poursuit l’analogie comme
suit : « froid comme la terre des champs qui peu à peu se delaye et fond256 ». Il y a donc
un rapprochement voulu entre le personnage et la boue, les deux ne constituant plus
qu’une seule et même matière : le narrateur prend « racine » dans l’espace qui le porte,
comme par contagion d’une matière à une autre. Aussi, dans la citation d’Escholier, le
vocable glèbe est fondamental. On ne peut en effet échapper à la connotation biblique du
mot glèbe (la glaise), d’autant plus si l’on considère le choix du titre de l’œuvre de
Raymond Escholier ; en effet, Le sel de la Terre reprend le passage de la Bible en
Matthieu 5 :13 « Vous êtes le sel de la Terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la
lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes ».
La symbolique du sel, admise pour être celle de la substance qui accompagne l’offrande,
est ici utilisée comme une allégorie de l’essence humaine sacrifiée. Le rapport
d’offrande, autrement dit de sacrifice à Dieu, quand il s’agit d’ « offrande humaine »
prend alors tout son sens. À la guerre, les hommes sacrifient leur vie pour la patrie. Le
texte d’Escholier se poursuit d’ailleurs sur une réflexion d’un des poilus qui remarque
que c’est le Vendredi saint. Le narrateur s’interroge : « N’est-ce pas aujourd’hui le
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!254 In Micheline Dupray, op. cit., p. 139. 255 Maurice Gevenoix, op. cit., p. 85. 256 Ibid.
! ! ! !
!
118!
Vendredi-Saint, l’anniversaire du Grand Sacrifice257 ? » et compare chaque chute du
soldat exténué aux stations du chemin de Croix. Inscrit dans cette thématique, le vocable
glèbe peut donc être considéré du point de vue d’une analyse biblique. Dans l’Ancien
Testament, et plus particulièrement dans la Genèse il est dit que Dieu créa l’homme à
son image 258 . L’interprétation exégétique d’André Chouraqui traduit ce passage
par : « Nous ferons Adam le Glébeux à notre réplique ». La Genèse 2 :7 affirme que
Dieu a créé l’homme « Adam », le glébeux, avec de la poussière, qui est en réalité de la
terre, « Adama ». La proximité linguistique des deux vocables, « Adam » et « adama »
suggère une proximité par essence qui rend compte du processus créateur. Le glébeux,
c’est donc ce qui qualifie en substance l’homme biblique : en un mot, l’homme-Adam
est fait de boue (ou d’argile). Tout comme le poilu sous la plume d’Escholier.
Dans le passage sus-cité Raymond Escholier écrit que la glèbe est à vif. Or, dans
le langage courant, ce qui est normalement à vif, c’est la chair. Escholier reprend donc
ici à son compte la proximité originelle des deux termes en modifiant le sens de leur
interrelation259. Il effectue une superposition des deux vocables, glèbe et chair, en
permettant cette même substitution d’une image par l’autre mais cette fois-ci dans un
processus inverse à celui évoqué dans la Bible. L’équivoque tient en ce que la chair
devient glèbe par processus d’absorption, de consommation – la surabondance de boue
supplante la présence de l’image du corps humain –, alors qu’au commencement260, c’est
la glèbe qui devient chair. Il est intéressant de voir qu’une œuvre de tranchée propose
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!257 Raymond Escholier, op. cit. p. 51. 258 « Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance […] », Bible de Jérusalem, Paris, Cerf, 1997, Genèse 1:26. 259 Sur la question des rapprochements de champs sémiques, voir Paul Ricœur, La Métaphore Vive, Paris, Seuil, 1975. 260 Je traduis littéralement de l’hébreu, Béréchit, (בראשית) nom donné au premier livre du Pentateuque.
! ! ! !
!
119!
d’associer un phénomène biblique de création, qui lie toujours cette thématique de
l’homme et de la terre, de l’homme et de la boue, et que l’homme couvert de boue
devienne bientôt informe, ou tout du moins masqué, lorsqu’il est confronté
quotidiennement à la mort. Alors que l’œuvre de Dieu, dans le Pentateuque, consiste à
créer des formes et à leur donner vie, ici la boue travestit l’essence humaine – sa
reconnaissance a priori – par ce qui était initialement une matrice créatrice. La boue
créatrice devient en quelque sorte anthropophage et le poilu se pare alors d’un faciès
nouveau. Le visage humain est caché par la substance qui donne vie dans la Bible alors
qu’ici cette substance est synonyme de disparition ou tout du moins de dissimulation. Le
poilu est « baigné de boue261 » et devient méconnaissable. Chez Gabriel Chevallier, seul
le visage reste humain : « À terre sont affalés des malheureux, des blocs boueux
surmontés d’un visage hagard262 ». Ainsi, la boue des tranchées n’est plus une matière
sacrée mais symbole de souillure en ce qu’elle défie la création, tant elle est intimement
liée à des scènes de tueries. Elle maquille par un processus de destruction mais aussi,
nous l’abordons dans la partie qui suit, elle sera composite du corps mort et de la chair
éclatée.
Espace sombre, l’espace fangeux des tranchées s’oppose fortement à un espace
de liberté – c’est le décor de l’impossible départ, l’impossible extraction d’un lieu de
violence que nous avons mentionnée dans le premier chapitre. L’aliénation du poilu est
renforcée par cette matière grasse et lourde qui englue, qui fige. De la boue froide,
hivernale, Maurice Genevoix écrit : « Nous ne nous déshabillons plus pour délasser nos
corps et les délivrer de cette étreinte glacée […] est-ce que tout cela maintenant ne fait
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!261 Raymond Escholier, op. cit. p. 40. 262 Gabriel Chevallier, op, cit., p. 101.
! ! ! !
!
120!
pas partie de ma souffrance ? Cela colle à moi263 ». Il y a bien donc connivence entre la
boue et le corps, éléments indissociables l’un de l’autre.
La boue est donc par analogie le réceptacle des corps – et nous soulignons
l’expression mettre en terre : « Ils sont tombés deux fois. Leurs mains, leurs faces sont
trempées de boue. Comme pour s’habituer au dernier trou qui doit les recevoir, ils ont
déjà dans la bouche le goût de la terre264 ». Blessés, les soldats sont déjà pour partie
moitié-homme, moitié-boue chez Élie Faure, « raides de glaise jaune jusqu’au
ventre265 ». La boue qui bibliquement donne vie, ici fige les corps, les entraînant vers la
mort. Le soldat plein de boue c’est celui « fatigué, misérable […] où quand il veut
regarder une seconde l’éternel sentier du ciel pluvieux au-dessus de lui il tombe, le crâne
troué266 ». La boue (métaphoriquement, l’espace des tranchées) maintient donc pour
partie le soldat en vie car sitôt qu’il tente de s’extraire de cette matrice ambivalente,
c’est-à-dire seconde peau protectrice mais conjointement support d’un environnement
meurtrier, il court le risque de se mettre à nu et de mourir. La nudité du soldat
progressivement, n’est plus celle à laquelle nous pensons spontanément, à savoir le
dévoilement de la peau, interface entre le dedans, invisible, et le dehors, mais son
extraction de la boue comme enveloppe protectrice.
Suivant cette même idée, Élie Faure évoque les « troupes boueuses267 ». Mais
aussi détestable et inhospitalier à première vue que soit ce lieu fangeux,
progressivement, le lieu de vie des soldats, monde chtonien268 que nous avons évoqué
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!263 Maurice Genevoix, op. cit., p. 85. 264 Raymond Escholier, op. cit., p. 49. 265 Élie Faure, op. cit., p. 107. 266 Ibid. 267 Ibid. p. 194. 268 À ce sujet, voir Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, 1967, et la question de l’immersion de Robinson dans le ventre de la terre au cours de sa « période tellurique ».
! ! ! !
!
121!
précédemment comme étant un lieu de quasi-confort, est l’espace où le poilu se sent en
sécurité, beaucoup plus qu’il ne l’est sur le champ de bataille à découvert. D’ailleurs
Élie Faure n’évoque-t-il pas cet « épouvantable instant où il faut sortir de terre
[…]269 » ? Il renforce ici l’idée que la boue peut être un espace sécurisant et que de s’en
extraire, au moment de l’attaque, reste une expérience traumatisante. C’est cet instant
qui sera d’ailleurs redouté par tant de soldats puisqu’il annonce la confrontation proche,
le moment où il faut jaillir hors de son trou, hors de soi-même, par « bravoure
irraisonnée » ou par « passivité peureuse270 » et faire face au feu ennemi.
Ces constantes références à la boue comme cadre narratif, qui devient presque le
milieu endogène du poilu, mais aussi concret, préfigurent une réinterprétation du monde
des vivants tel qu’il est perçu dans la littérature du front. D’autant qu’une nouvelle
difficulté pointe à ce stade de l’expérience : du fait de la proximité constante d’avec la
mort, dans un espace sombre et inhospitalier, il est en effet mal aisé de réussir à
différencier le monde des vivants de celui des morts, tant les deux sont proches, souvent
inter-changés, voire narrativement interchangeables. Pour preuve, la capacité de certains
personnages de roman à distinguer les morts des vivants s’émousse. « J’ai d’abord cru
que c’était un mort », s’exprime le narrateur dans Les Éparges « mais lorsque mon
soulier l’a heurté, il s’est retourné en grognant271 ». Son compagnon de tranchées, Dast,
lui donne d’ailleurs raison :
« Vivant … Macchabe… Vivant… Macchabe… Macchabe… - Qu’est-ce qui te prend ? - C’est un jeu. - Tu gagnes ?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!269 Ibid., p. 141. 270 Ibid., p. 111. 271 Maurice Genevoix, Les Éparges, éd cit., p. 731.
! ! ! !
!
122!
- Je me goure presque à chaque coup272 ».
Au-delà de l’erreur qui s’offre à l’entendement, contrecarrant la prescience
donnée à l’humain de reconnaître a priori sans nul doute ses semblables et de distinguer
les morts des vivants, ce qui frappe, c’est la manière dont les morts s’imposent justement
dans l’espace des vivants. La frontière entre les uns et les autres semble franchie quand
il est impossible de les discerner. En effet, les vivants sont-ils tellement maquillés en
cadavres, paraissent-ils tellement inertes, la boue les fige-t-elle à ce point qu’ils
semblent ne plus appartenir au monde des êtres animés ? Et vice-versa ? Effectivement,
de nombreux auteurs mettent en scène un de leurs personnages qui, à un moment du
conflit, s’est trompé, parlant à un soldat et s’apercevant plus tard qu’il parlait à un mort.
Les morts, surtout s’ils sont tués dans une position qui les fait paraître vivants, semblent
animés : assis ou allongés, comme dormant calmement. Maurice Genevoix évoque à
plusieurs reprises cette curieuse impression qu’il ressent à la vue d’un homme mort
d’une mort violente et qui pourtant paraît calme : « À quelques pas de notre guitoune, un
mort est resté assis contre un tas de fagots, dans une attitude de détente et de paix. Cet
homme mangeait lorsqu’un obus l’a tué net ; il tient encore à la main une petite
fourchette d’étain, son visage cireux ne trahit aucune angoisse […]273 ». Un peu plus
loin, il raconte comment après avoir sauté dans un fossé, il aperçoit un homme : « Je lui
mets la main sur l’épaule : il ne bouge pas. Je le secoue, incline son visage, touche le
sien. Oh ! … Une peau visqueuse […] c’est un cadavre 274 ». Cette duperie de
l’impression, ce jeu sur des images inattendues, c’est ce qui brouille les frontières de ce
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!272 Ibid. 273 Maurice Genevoix, Verdun, éd. cit., p. 129. 274 Ibid., p. 134.
! ! ! !
!
123!
que y est et de ce qu’on croit être et en même temps donne rythme au discours narratif.
Cette même erreur d’impression, Gabriel Chevallier l’évoque ainsi : « J’aperçu de loin le
profil d’un petit homme barbu et chauve, assis sur la banquette de tir, qui semblait rire.
[…] En le dépassant, je découvris, avec un mouvement de recul, qu’il manquait la
moitié de ce visage hilare, l’autre profil. La tête était complètement vide275 ». Par le biais
de cette modification imagée, s’amorce progressivement un processus de
métamorphose : substitution de l’allure « humaine » par une autre composante, étrange,
mais aussi substitution de la matière organique en non-organique276. Car si certains
morts ont l’air bien vivants, d’autres en revanche ne sont même plus reconnaissables en
tant que morts : corps éclatés, morcelés, certains ne forment bientôt plus qu’une seule et
même matière avec la terre qui les reçoit.
Mixtion corps et terre, un « pudding de cadavres » - les morts
Cet espace boueux est un espace de ténèbres, sorte d’antichambre préfigurant les
enfers - si l’on s’en tient à une lecture eschatologique de l’événement qu’a été la guerre
de 14-18. Élie Faure dans La Sainte Face évoque des « forges souterraines277 » pour
parler du paysage cauchemardesque qui l’entoure ou encore du « seuil de l’enfer278 ». Si
ces descriptions renvoient littéralement à un espace de chaos, où tout brûle et se
désagrège, comme la représentation ordinaire que nous avons de l’enfer, elles renvoient
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!275 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 83. 276 À ce sujet, il semble évident de mentionner le texte d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, L’Homme au sable, 1817 et le personnage d’Olympia qui incarne parfaitement la question de la Unheimlichkeit. De même que face à Olympia, cet automate dont Nathanaël discerne mal si elle est femme ou poupée mécanique, face au mort qui a l’air d’un vivant, le soldat expérimente un profond malaise. En effet, le mort calme comme un vivant souligne la rupture et l’irruption de l’étrange dans le domaine du familier (bien que violent, l’environnement guerrier finit par devenir un espace familier). 277 Élie Faure, op. cit. p. 203. 278 Ibid. p. 195.
! ! ! !
!
124!
aussi à un espace symbolique, dont la représentation métaphorique suggère le
bouleversement des espaces tangibles et des représentations intelligibles du monde. Car
ce qui frappe tout particulièrement dans les textes que nous considérons, c’est le
renversement des notions communément admises à savoir la modification des points de
repères spatiaux habituels. En effet, le sol et son sous-sol sont des espaces souterrains,
chtoniens, assimilés à la mort par opposition à l’espace aérien, céleste, qui lui est
communément associé à la vie. Or les textes du présent corpus, et les textes
romanesques en général qui évoquent les paysages de bataille de la première Guerre
Mondiale, font référence à un renversement du cosmos naturellement ordonné. Dans les
tranchées, les vivants s’enterrent - « L’homme, volontairement, s’enterre pour
mourir279 » écrit Élie Faure - et les morts, a contrario, resurgissent à la surface de la
terre.
En effet, « […] les enfouissements d’hommes sont fréquents280 » témoigne le
narrateur de La Peur. C’est d’ailleurs semble-t-il une des expériences les plus
anxiogènes vécue par les poilus. Certes, quoi de pire que d’être enseveli vivant ?
Cependant, malgré la crainte et les tentatives des soldats pour échapper aux
ensevelissements, nombre de soldats périront étouffés sous terre. Dans ce cas, il est
difficile d’aller chercher les corps que des tonnes de ferraille ont enfoncé profondément
dans le sol, mais aussi de les identifier. Il est difficile de reconstituer les corps éclatés
dans leur intégrité, ce qui rend donc l’inhumation difficile voire impossible. En effet,
une fois mêlée à la terre, la chair ne peut plus en être dissociée : « Le sang, la cervelle,
les boyaux font, avec la terre éboulée, une boue rougeâtre et grisâtre où les survivants
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!279 Ibid. p. 203. 280 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 190.
! ! ! !
!
125!
pataugent, se cherchent pour ne pas mourir seuls281 ». Le sang donne à la terre sa couleur
(cette image sera souvent reprise pour témoigner du sacrifice des soldats pour la « terre-
nation282 ») et la séparation des deux matières, terre et chair, ne se fait plus. Or cette
agglomération, inhabituelle, dénote un « accouplement » symbolique contre-nature. Ou
tout du moins allant à contre-courant du processus créateur de vie. C’est cette « […]
mitraille [qui] enfonce dans sa chair de la terre liquide […]283 » qui participe à la
destruction de l’intégrité physique de l’humain en ce qu’elle fixe dans le corps une
substance étrangère.
Parallèlement, cette idée de partition du corps pose la question de l’intégrité
humaine entamée, en ce que la chair divisée et éclatée, bouleverse le concept établi de
l’unicité du couple corps / âme. L’enveloppe charnelle ainsi morcelée ne trouve d’une
part pas de repos, dans l’imaginaire collectif inscrit notamment dans une tradition à la
fois grecque et judéo-chrétienne, mais en outre, sur le plan narratif, elle peine à trouver
sa place : écrire le corps éclaté soulève la question de « où cacher les morceaux ? » ou
encore « desquels parler ? ». Bien que comme l’affirme Carine Trévisan, « Le spectacle
de la mort violente, du corps outragé, reste toujours quelque chose de sidérant (…) face
à quoi se défont, même si cela n’est que provisoire, la parole et la pensée284 », les
témoignages de l’expérience des corps éclatés ne manquent pourtant pas dans les textes
que nous considérons. La parole – en l’occurrence ici l’écriture – cherche à placer dans
l’espace narratif les morceaux des corps pulvérisés. Carine Trévisan toujours au sujet de
l’éclatement soutient :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!281 Élie Faure, op. cit., p. 203. 282 Cf. infra, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker. 283 Ibid., p. 107. 284 Carine Trévisan, op. cit., p. 44.
! ! ! !
!
126!
(…) le cadavre, déformé par la décomposition, démembré, éviscéré ou décapité, est exposé à la surface de la terre tandis que le vivant semble relégué dans le domaine souterrain, la tranchée. Réceptacle obscur de la décomposition des corps, la terre, qui habituellement enclôt le cadavre et le dissout secrètement, est ici saturée : elle ne peut ni absorber les corps, ni même les soustraire au regard285. Trévisan souligne cette inversion que je trouve importante de relever et qui
montre que les vivants sont enfouis, alors que les morts sont propulsés. La dynamique
vitale s’inverse, ce qui est en-dessous passe au-dessus et inversement. Les racines – liées
aux défunts, aux ancêtres, n’ont plus la vertu de socle et l’histoire semble inverser son
propre cours. Poussée à l’extrême, cette inversion renforce le mouvement que nous
avons considéré dans la première partie de la présente thèse : elle fait revenir l’homme
moderne au statut d’homme primitif.
Mais pas seulement. Car quand bien même l’inhumation au front est rendue
possible, les morts déjà enterrés ressurgiront du sol, déterrés et à nouveau malmenés par
les éclatements d’obus, les retournements de la terre, support qui ne reste jamais en
place. De la même façon que les textes rapprochent les soldats vivants de la matière
fangeuse, ils procèdent à un rapprochement organique entre les cadavres et la terre qui
normalement les contient.
Dans Prélude à Verdun, Jules Romains décrit les armées en présence comme
« deux espèces d’étirement visqueux, suscités l’un par l’autre, attirés et orientés l’un par
l’autre, chassant progressivement l’espace qu’ils pinçaient entre eux, et n’attendant que
d’être en contact pour se coaguler286 ». La coagulation des deux armées préfigure la mort
des soldats qui sont d’ailleurs déjà une autre matière, qui sont ces « étirements
visqueux ». Nouvelle référence à ce couple improbable du sang versé et de la boue, l’une !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!285 Ibid., p. 46. 286 Jules Romains, Prélude, éd. cit., p. 8.
! ! ! !
!
127!
et l’autre des substances ne formant bientôt plus qu’une seule et unique entité. Cette idée
de mixtion de chair et de terre n’est d’ailleurs pas le seul apanage de la littérature ;
l’historiographie évoque également cette symbolique de laquelle découle l’analyse de la
sacralisation du sol. Si l’on reprend en effet la question du sacrifice qui parcourt l’œuvre
de Raymond Escholier, l’on comprend mieux le rapport qui lie la terre (dont la
substance « terre » constitue par analogie la patrie) et le sang. À ce sujet, Stéphane
Audoin-Rouzeau et Annette Becker proposent l’analyse suivante : « La guerre a en effet
consisté à défendre le sol national sacralisé, ce sol que les tranchées – terre et sang des
morts mêlés – symbolisent287 ».
Aussi, l’on peut se demander si le travail de l’écriture, quand il décrit cette
proximité voire cette fusion entre les corps morts, le sang et la terre, ne participe pas au
travail de mémoire, collectif et national : décrire les corps sans les discerner de la terre
qui les contient – et donc qui les contiendra encore longtemps puisqu’on ne pourra plus
séparer les deux éléments – fera marcher celui qui, comme dans La Comédie de
Charleroi, se promène sur ce que furent les champs de bataille, sur les restes de ses
compagnons. Afin de ne pas oublier. Il s’agirait alors d’une stratégie créatrice qui
viserait à dépersonnaliser le corps individuel et singulier pour reconstruire un corps
global, englobant tous les corps et particules de corps défunts. Ce corps global, porteur
de l’union nationale, ressemble mentalement à un géant de terre, de chair et de sang,
sorte de Golem qui portera en son sein humanoïde un homme nouveau : celui de l’après-
guerre, dont le socle culturel s’est fondé sur un conflit sanglant. Et alors verser son sang
prend tout son sens.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!287 Stéphane Audoin-Rouzeau & Annette Becker, op. cit., p. 268.
! ! ! !
!
128!
Néanmoins cette image symbolique, ici sacralisée, ne l’est pas toujours. La
littérature reconstitue un espace, ce « pudding de cadavres », à partir de deux éléments
qui normalement cohabitent « en paix » si l’on peut dire. La sépulture, dans le cadre
d’un enterrement, est ordinairement la dernière demeure du corps. Non seulement, mais
la terre doit cacher le corps – cadavre – aux yeux des vivants, dans un souci de
compartimenter les deux mondes, de les maintenir en deux espaces distincts. Or dans le
cas des textes qui nous concernent, le corps ne « tient pas en place » si l’on peut dire. Sa
mise en terre n’est que temporaire et le cadavre, c’est-à-dire la nouvelle dénomination
identitaire du corps, se montre. Par conséquent, il faut trouver une nouvelle utilité à ce
corps présent et visible, dont la présence est pourtant incongrue. Ainsi dans les récits de
notre corpus, il est fréquent que les narrateurs mentionnent les cadavres comme servant
de points de repère sur la ligne de front. Une objectivation s’opère, comme pour
redonner une nécessité ou tout du moins une raison au corps d’être là alors qu’on le
voudrait ailleurs. D’être visible alors qu’on le souhaiterait caché. Puisqu’il est visible, il
faut détourner la pensée d’une vision abjecte en recréant un rôle, une utilité, une place
aux dépouilles dans le microcosme social que constitue le monde des tranchées.
« J’accepte de te voir mais seulement si j’opère ton changement de statut » semblent dire
les textes.
Car en effet, la particularité des textes qui nous concernent est qu’ils soulignent
ce franchissement de frontières mentales et visuelles entre les corps des défunts, sans
vie, sans motricité, d’une part et ceux des soldats vivants, d’autre part. Jules Romains
dans Prélude à Verdun, alors qu’il décrit une des tranchées occupée par son unité, admet
qu’il « est difficile de franchir avec la distraction d’esprit qu’il faudrait un certain
! ! ! !
!
129!
tournant où la paroi laisse apercevoir, dans une crevasse, un bras humain, une mince
gaine de chair gluante et noir […] où l’os apparaît […] ». D’ailleurs, il avoue que « ce
bras ne tient pas beaucoup de place » mais ce qui gêne par-dessus tout, c’est qu’il
« suggère beaucoup » : en effet, « c’est en somme dans une espèce d’énorme pudding
aux cadavres qu’on se promène288 ». C’est cette rencontre, du vivant avec le mort, qui
plus est le mort fragmenté, en morceaux, qui répugne. D’autant que cet effet de
répulsion est renforcé chez le lecteur par l’association de deux notions qui
s’entrechoquent : un pudding est normalement quelque chose qui se mange, et nous ne
pouvons, à moins d’anthropophagie, associer aisément le comestible à la chair humaine,
qui plus est, à la chair morte. De son côté, Élie Faure évoque l’inadéquation de cette
proximité terre – chair en soulignant le caractère illégitime de cette « union » imagée : il
affirme que cette union est en effet un « concubinage avec les cadavres 289 ».
Concubinage, anthropophagie, que ce soit par la symbolique d’une union sexuelle ou de
consommation, l’association littéraire des deux terminologies pose nécessairement la
question du rejet, de la barrière de l’acceptable et de sa verbalisation, de sa narration.
Gabriel Chevallier lui va parfois jusqu’à supprimer l’association des deux terminologies,
terre et chair, pour n’évoquer qu’une seule et même matière. Il fait dire à son narrateur,
alors que ce dernier converse avec un sous-officier qui lui demande des nouvelles du
front : « Il n’y a qu’une expression pour traduire : on marchait dans la viande…290 ».
Progressivement, au corps humain se substitue une matière qui n’a plus rien à voir avec
l’humanité, nous le verrons ultérieurement. Cette association à la viande est intéressante
pour ce chapitre car elle associe la question du comestible en proximité avec la mort.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!288 Jules Romains, op. cit., p. 63 289 Élie Faure, op. cit., p. 141. 290 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 233.
! ! ! !
!
130!
Gabriel Chevallier insiste à plusieurs reprises sur cette question du comestible qui
englobe matière vivante et matière putréfiée. Malgré la soif qui tiraille les soldats de son
unité, « quelques hommes pourtant burent de l’eau puisée dans les flaques où baignaient
les cadavres291 ». Le désarroi pousse les hommes à franchir les barrières du licite en
rentrant en contact avec les cadavres : il y a consommation de l’interdit, l’image ici nous
suggérant la possibilité d’une interprétation cannibalique. Car en effet, Jean Dartemont,
narrateur de La Peur, affirme que « le corps de l’homme mort est un objet de dégoût
insurmontable pour celui qui vit, et ce dégoût est bien la marque de l’anéantissement
complet292 ». Comment d’une part affirmer un tel ressenti, et d’autre part avouer
l’ingestion de l’eau – en toute connaissance de cause – dans laquelle ont trempé des
corps morts ? Les exemples que nous venons d’analyser soulignent l’introduction d’une
notion nouvelle, celle de l’abject.
En effet, Julia Kristeva dans son œuvre sur l’abjection, Pouvoirs de l’horreur,
associe la question de l’abject comme le « surgissement massif et abrupt d’une étrangeté
[qui] harcèle maintenant comme radicalement séparée, répugnante 293 », le dégoût
alimentaire étant la forme la plus archaïque de l’abjection. L’ « objet » humain, ce qui
nous est proche, une fois mort et non enterré, devient étranger dans un violent processus
de dégout (celui évoqué entre autres par Gabriel Chevallier). Kristeva poursuit en
affirmant que « le déchet comme le cadavre m’indique ce que j’écarte en permanence
pour vivre294 ». Si, comme l’indique Kristeva, le cadavre est « la mort infestant la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!291 Ibid., p. 82. 292 Ibid. 293 Julia Kristeva, op. cit., p. 10. 294 Ibid. p. 11.
! ! ! !
!
131!
vie295 », alors la perception que les poilus ont de leurs semblables défunts dans leur
espace de vie change. Elle affirme la dissemblance, liée à l’horreur du corps mort en
putréfaction, du corps abîmé, ou tout simplement à la présence physique et visuelle du
cadavre dans le monde des vivants. Et dans le cas des textes que nous considérons, c’est
la rencontre, autrement dit le franchissement des frontières entre morts et vivants, qui
crée le choc narratif. Kristeva à ce sujet suggère : « Le cadavre (cadere, tomber), ce qui
a irrémédiablement chuté, cloaque et mort, bouleverse plus violemment encore l’identité
de celui qui s’y confronte comme un hasard fragile et fallacieux296 ». La surprise est
créée par la rencontre de deux mondes qui normalement ne se rencontrent pas, ou alors
plus, une fois que le culte réservé aux morts a été effectué. Car ainsi mis à nus, les
cadavres bouleversent « une identité, un système, un ordre297 ». Georges Bataille lui,
écrit dans L’érotisme :
L’inhumation signifia sans doute dès les premiers temps, de la part de ceux qui ensevelirent, le désir qu’ils avaient de préserver les morts de la voracité des animaux. Mais ce désir eût-il été déterminant dans l’instauration de l’image, nous ne pouvons l’y associer principalement : longtemps l’horreur des morts a probablement dominé de loin les sentiments que développa la civilisation adoucie. La mort était le signe de la violence introduite dans un monde qu’elle pouvait ruiner. Immobile, le mort participait de la violence qui l’avait frappé : ce qui était dans sa « contagion » était menacé de la ruine à laquelle il avait succombé298.
Ainsi, les cadavres dont les membres dépassent dans le champ de bataille, parce
qu’ils n’ont pas pu être ensevelis rituellement parlant – c’est-à-dire par une action
sociale ou parce qu’ils ont été à nouveau dérangés – mais aussi parce qu’ils surgissent de
terre lors de nouveaux bombardements, amènent de l’abject dans la sphère familière. Et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!295 Ibid. p. 12. 296 Ibid. p. 11. 297 Ibid. p. 12. 298 Georges Bataille, « L’interdit lié à la mort », in L’érotisme, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1987, p. 43.
! ! ! !
!
132!
pire encore, alors que Bataille souligne la question de l’immobilité, l’image du corps des
défunts sur le champ de bataille prend vie lorsque un nouveau bombardement arrive et
que les parties des corps démembrées changent de place sous l’effet du souffle des
bombes, pour aller se reloger dans un autre endroit, recomposant à nouveau le sol ou les
parois de la tranchée.
Saisissant sa pelle-bêche, Sasco entama violemment la paroi visqueuse. Alors tous se turent, saisis d’horreur. La terre grasse suait le sang. A la lueur sépulcrale du bout de cierge glané par Servat à l’église de Brocourt, des choses innommables apparurent. Un pauvre bougre – Français ou Boche, on ne savait plus, - tombé lors des combats de 1914, était demeuré là dans ce coin de glèbe lorraine, l’humidité ralentissant l’affreux travail de la décomposition299. Le texte de Raymond Escholier outre l’abject de l’image qui s’en dégage –
littéralement et symboliquement – insiste sur l’indicible de la situation. Le narrateur est
face à une masse informe, puante, et c’est la terre qui sue le sang. Le corps du soldat
s’efface devant la terre, qui devient alors le corps en soi, suant le sang.
Jules Romains quant à lui exprime parfaitement cette nouvelle relation en ce
qu’elle n’est pas seulement le lien qui unit les vivants aux morts, dans son aspect
symbolique. Cette relation devient en effet celle des morts avec les vivants, relation
contrainte par une cohabitation imposée. Alors que Georges Bataille suggère la nécessité
d’inhumation pour cacher le monde des morts aux yeux des vivants, s’impose au front
une redéfinition du rapport à la mort. En effet, la guerre implique une modification et
par conséquent une redéfinition du rapport social à la mort, plus précisément au corps
trépassé, au cadavre, comme si se créaient des liens agissant en eux-mêmes et par eux-
mêmes, comme si les morts soudainement exprimaient involontairement un discours,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!299 Raymond Escholier, op. cit., p. 104.
! ! ! !
!
133!
silencieux et inaudible certes, mais bien visible, de par leur présence physique dans le
monde des vivants. C’est ce que suggère le texte de Romains. Je cite :
Plus généralement, la mort et tout ce qui s’y rapporte sont ici l’objet d’un changement de condition assez remarquable. On s’aperçoit tout à coup que, dans notre ancien monde du temps de paix, la civilisation multipliait un zèle discret mais très efficace pour préserver les vivants d’être obsédés par les morts, de se trouver en contact, nez à nez, avec les traces matérielles des morts. C’était de la police de nettoiement, très bien faite ; si bien faite que nous n’y pensions plus. Dans notre monde d’ici, cette police a été mise en échec par les circonstances, oui, littéralement débordée. On ne cherche pas à embêter les vivants avec les morts ou leurs résidus. Mais on ne peut empêcher les relations de voisinage, ou les rencontres300.
La référence au débordement s’inscrit tout à fait dans l’hypothèse d’une
restructuration, et avant cela, d’un grand bouleversement de la notion d’humanité, dans
la façon dont elle avait défini ses contours jusqu’à la guerre. Nous avons vu
précédemment que c’est l’inhumation301 qui constitue un des premiers pas de l’humanité
en tant que concept social et que l’impossible inhumation est ce qui perturbe l’ordre
préalablement établi. La rencontre fortuite, qui gêne et fait sursauter, qui dérange l’être
habitué à la classification et à la distinction, c’est celle qui fait aussi « sursauter » le
discours, qui fait passer au-dessus ou outre, pour une fois, comme c’est le cas dans le
texte de Gabriel Chevallier (cité plus loin), qui autorise de lever le voile de la censure du
désir de tuer : la chair (c’est-à-dire ici symbole du moi profond) suggère d’achever le
monstre hurlant. Il serait fraternel de l’achever, autrement dit, il serait bon de supprimer
le monstrueux pour restaurer l’ontologie pleine de l’humain, supprimer ce qui dérange.
La perte ultime de l’intégrité (au sens moral comme au sens physiologique)
réside finalement dans le fait que les corps finissent par perdre de leur consistance car ils
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!300 Jules Romains, Prélude, éd. cit., p. 104. 301 Homme, inhumain, humus, inhumer.. : ce nœud sémantique rassemble une nouvelle fois l’homme et la terre.
! ! ! !
!
134!
sont, par fragments, mélangés à la terre (un membre, une tête): par conséquent, ils n'ont
plus figure humaine. Et cette vision abjecte ramène à la mémoire collective, par le biais
du récit, « une terre d’oubli constamment remémorée302 ». L’on en revient à cette
question du corps recréé par une écriture que l’on pourrait qualifier de symptomatique :
la création narrative dans les textes qui nous concernent permet de rétablir l’existence
d’un corps oublié (physique et/ou religieux), à l’origine du monde et pourtant
monstrueux (le Golem ou le corps recomposé dans l’écriture). Une nouvelle fois, le récit
de guerre fait resurgir dans le temps présent, contemporain à l’écriture, un espace-temps
archaïque.
Corps amputés et gueules cassées : vers un physique hybride ?
On a apporté aussi un débris humain si monstrueux que tous, à sa vue, ont reculé, qu’il a étonné ces hommes que plus rien n’étonne. J’ai fermé les yeux : je n’ai que trop vu déjà, je veux oublier plus tard. Cela, cet être hurle dans un coin comme un dément. Notre chair soulevée nous suggère qu’il serait généreux, fraternel de l’achever303.
Cette citation empruntée à l’œuvre de Gabriel Chevallier évoque le summum de
l’horreur et de la confusion qu’apporte la guerre, dans ce qu’elle transporte de plus
violent et de plus inquiétant. Elle évoque la naissance de la monstruosité, non plus
comme le résultat d’une naissance « incontrôlable », créé in utero, mais comme la
modification du « normal » préexistant, de l’habituel en monstrueux, qui réclame un
élan « fraternel », afin de restaurer l’unité de la scission engendrée par l’effet de
l’éclatement des chairs. C’est tout du moins comme cela que les textes considérés
retranscrivent ce que certains poilus ont expérimenté. Nous avons déjà mentionné cette
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!302 Julia Kristeva, op. cit., p. 16. 303 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 102.
! ! ! !
!
135!
idée de « débris », qui se retrouve sous le vocable de « guenille » chez Raymond
Escholier puis plus tard à nouveau « débris » dans l’œuvre de Primo Levi304 et qui dans
ces deux cas font référence à la dégradation mentale, ontologique, morale de l’être
humain. Ici, le mot « débris » décrit littéralement les restes charnels d’un humain blessé,
décomposé par un tir d’obus. Le mot n’énonce pas le détail, n’insiste pas sur une partie
du corps en particulier, mais décrit plutôt une masse informe. Le ressenti abject ici,
distingué dans le geste de recul des hommes que pourtant plus grand chose n’étonne, se
manifeste à travers l’objectivation d’un sentiment né d’une vision monstrueuse : une
masse informe, de chair – qui normalement, vue en tas, évoque la viande et donc une
matière sans vie – et qui est cependant vivante. L’espace de latence qui existe entre voir
et comprendre – formulé ici par l’étonnement – fait associer dans l’esprit du témoin
deux matières qui normalement s’opposent : organique et anorganique. C’est
l’association littéraire du « cela » et du vivant, la vue du « cela » qui pourtant hurle, qui
occasionne le mouvement de recul. Le dégoût né du sentiment d’angoisse s’explique par
la difficile rationalisation à opérer, c’est-à-dire accepter que le non-vivant puisse émettre
un son humain. En effet la voix n’est-elle pas une des expressions propres au vivant ?
L’expérience immédiate, visuelle, est vécue comme une expérience profondément
répulsive et le narrateur affirme devoir fermer les yeux. Il a vu l’horreur mais cette
monstruosité là, il se doit de l'effacer de sa mémoire, il doit s’en détourner. Il faut faire
tomber dans l’oubli ce qui échappe à la capacité cognitive de description : non
formulable dans l’intériorité psychique, innommable ou plutôt, difficilement
conceptualisable. Car en effet, à quel monde cette masse informe et hurlante appartient-
elle ? Les vocables disponibles à la narration ne peuvent alors être que le cela, sans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!304 Cf. supra, p. 110.
! ! ! !
!
136!
genre, indéfini, monstrueux. Bien qu’il soit livré à fréquenter le monstrueux, contraint de
faire face à l’insoutenable, l’homme ne se résout pas à abdiquer totalement son
humanité. Le narrateur de La Peur dira : « Les soldats parlent de ces choses simplement,
sans approuver ni blâmer, parce que la guerre les a habitués à trouver naturel ce qui est
monstrueux305 ». Il faut donc trouver une nouvelle catégorie, ou tout du moins une
nouvelle façon de nommer et donc de ranger dans un champ conceptuel cet être mi-
homme, mi-monstre.
Michel Surya, de manière certes quelque peu obscure, évoque ainsi l’apparition
dans les textes littéraires d’une nouvelle figure, hybride : « Un jour la littérature a formé
des figures qui n’avaient pour elles qu’une extrême pauvreté à opposer à tout ce qui
s’enorgueillissait de sa force306 ». C’est en ces termes que Surya porte son attention sur
le monde d’en-bas, sur ce qu’il considère être « en deçà » de l’humain. Dans son
ouvrage consacré pour partie à l’analyse de la question de la métamorphose chez Kafka,
il expose ce que constituerait selon lui le résultat figuré de la transformation humaine en
autre chose. Selon Surya, ces figures ressembleraient « plutôt qu’à l’homme lui-même,
plutôt qu’à l’homme ancien, à quelque chose qui serait lui encore mais infime, humilié,
mutilé, indigne et banni. En réalité, à un reste, à un rebut d’homme307 ». Analyser les
textes qui nous concernent à l’aune de l’œuvre de Surya nous permet d’intégrer la
question de la métamorphose du rebut, de ce qui reste, en termes littéraires, la
transformation de l’expérience visuelle en expérience intellectualisée et retranscrite dans
le récit. Le rebut d’homme prend forme dans le roman de guerre au moment où
l’homme, être vivant, progressivement se désintègre, en une sorte de semi-vivant (pour
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!305 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 191. 306 Michel Surya, Humanimalités, Paris, Léo Scheer, 2004, p. 11. 307 Ibid.
! ! ! !
!
137!
ne pas employer le terme de « mort-vivant » qui impliquerait un champ d’analyse trop
vaste et diverse par rapport à notre étude). Cependant, les textes évoquent bien cet
homme qui ne l’est plus totalement. Il y a ces poilus que le froid meurtrit et dont les
pieds se décomposent, tel cet « homme vivant qui se découvre tout à coup des pieds de
cadavre avancé308 ». Cet homme hybride, dont on ne peut dire s’il appartient à une
catégorie plus qu’à une autre. Physiquement composite, le poilu mentalement oscille en
permanence entre la peur de la mort et l’angoisse du vivant. Beaucoup de témoignages
évoquent le désir qu’avaient certains soldats d’être morts pour échapper à cette angoisse
de peur incessante. Une peur telle qu’elle modifie le rapport au réel et au tangible en
faisant paraître les vivants morts, et les morts, vivants. En effet, Carine Trévisan
souligne : « Non seulement l’ordre symbolique qui départage le vivant du mort
s’effondre, les tabous touchant le cadavre (…) reposant sur la croyance quasi universelle
que le cadavre est impur et qu’il souille tout ce qui le touche (…) sont transgressés, mais
la perturbation des limites entre vie et mort affecte la perception que le vivant a de son
corps propre. Si le mort est encore vivant, le vivant est déjà colonisé par le cadavre309 ».
C’est sur ce trouble de la perception que se bâtit l’hybridité, qui n’est autre qu’une
impossibilité à définir à proprement parler le champ d’appartenance d’un objet, et
s’affirme comme un processus de substitution imagée qui prend le pas sur l’impossible
opération cognitive de ségrégation, de séparation systémique. Les lignes de démarcation
qui sont fondatrices de toute civilisation (guerre / paix, vie / mort, solide / liquide…)
sont remises en question. Et il ne s’agit pas de dire que nous sommes totalement dans
« l’inhumain », mais dans des contextes flous.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!308 Jules Romains, Verdun, éd. cit., p. 102. 309 Carine Trévisan, op. cit., p. 51.
! ! ! !
!
138!
Quand le corps est atteint, les textes soulignent l’étonnement et parfois le dégoût
auxquels font face les soldats. Et cet étonnement se transforme en terreur quand le
visage est touché. Alors que dans les formes hybrides sus-citées, l’on hésite (les textes
font fréquemment usage du « on dirait »), la rencontre avec la gueule-cassée provoque
un choc. Il s’agirait alors d’une Unheimlichkeit inversée si l’on peut dire : alors que
normalement, c’est le familier qui a pour capacité de paraître inquiétant, ici, l’inquiétant
doit trouver sa place dans le familier. De fait, les textes que nous considérons offrent très
peu de description des mutilés de la face : car en effet, comment reformer l’informe,
donner vie, contextualiser ce qui n’a pas de contours définis ? Comment traduire l’image
sans trahir la « chose » ? L’historien se trouve face au même vide narratif. Ainsi Sophie
Delaporte affirme : « Il paraît difficile à l’historien de saisir la douleur et la parole des
mutilés de la Première Guerre mondiale. Il semble en effet qu’un pan tout entier échappe
à l’écriture 310 ». Ici, échapper réfère à l’absence de textes, au silence narratif,
probablement par difficulté d’articuler le soi – reconnu immédiatement par son visage –
à la blessure de la face. Ceci s’explique du point de vue historiographique par le fait que
les témoignages de mutilés proviennent essentiellement de publications issues des
associations d’invalides qui se sont créées après-guerre ou encore de témoignages
émanant du corps médical. Il semble qu’individuellement et sorti d’un contexte
associatif, le « je » propre au discours individuel des Gueules Cassées ait eu du mal à
s’exprimer que ce soit au travers de journaux intimes ou de récits autobiographiques, ou
encore dans le cadre de romans. En effet, le sujet semble particulièrement tabou lorsqu’il
s’agit de récits à la première personne : impossibilité d’écrire sur soi quand son propre
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!310 Sophie Delaporte, « Le corps et la parole des mutilés de la Grande Guerre », Guerres mondiales et conflits contemporains, No. 205 (Janvier-Mars 2002), pp. 5-14, p. 5.
! ! ! !
!
139!
mode de se révéler au monde – le visage311 – est altéré. Il faut attendre la fin du XXe
siècle pour que le sujet soit évoqué plus librement, et encore, ce n’est pas par ceux qui
en ont été victimes ou témoins directs mais sous la plume d’auteurs contemporains. Je
pense notamment à La Chambre des officiers312 de Marc Dugain, inspiré par la thèse de
Sophie Delaporte, qui narre la guerre du point de vue des Gueules Cassées.
Si en effet comme l’écrit Sophie Delaporte citant David Le Breton, le visage est
le « lieu le plus humain de l’homme313 », que reste-t-il alors de l’humain une fois le
soldat défiguré ? Comment reconnaître et nommer ce semblable dont l’apparence nous
est si étrangère à première vue ? Et d’autant plus, comment faire parler celui dont le
siège de la verbalisation, de la parole a été atteint ? Au sujet des Gueules Cassées,
Sophie Delaporte affirme : « Défiguré, le blessé se retrouve confronté à l’expérience du
démantèlement de sa personnalité, à la suppression « d’être »314 ». Cela expliquerait-il
l’absence de récits sur le sujet dans les années de guerre ou proches de la guerre ?
Gabriel Chevallier est celui qui ose le plus de la description du monstrueux. Mais en ce
qui concerne des descriptions de mutilations faciales, nous n’avons que peu de traces,
même dans La Peur. Comme si cette nouvelle apparence qui laisse le visage défiguré
n’appartenait pas au registre humain et par conséquent serait inénarrable. Soulignons
brièvement le fait que le vocable de « gueules cassées » emprunte son vocabulaire au
domaine animalier. En effet, « gueule » n’est pas une terminologie appropriée, au sens
littéral du terme, pour décrire le visage humain. On associe aux blessés du visage une
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!311 Le visage est le siège de l’altérité en ce qu’il est ce qui s’impose de manière a priori aux yeux de celui qui regarde (à ce sujet, cf. entre autres Lévinas, Éthique et Infini, Paris, Livre de Poche, 1984). 312 Marc Dugain, La Chambre des officiers, Paris, Pocket, 1999. 313 David Le Breton, « Handicap d’apparence : le regard de l’autre », Ethnologie française, XXI, no 3, 1991, pp. 323-330, cité par Sophie Delaporte, « Les défigurés de la Grande Guerre », Guerres mondiales et conflits contemporains, No. 175 (Juillet 1994), pp. 103-121, p. 103. 314 Sophie Delaporte, « Les défigurés », op. cit., p. 103.
! ! ! !
!
140!
terminologie dégradante en ce qu’elle se réfère clairement à l’animalité plus qu’à
l’humanité, et qui plus est, une animalité brisée. Le visage a perdu toutes traces
humaines, et non seulement, il perd encore plus de son intégrité en ce qu’il se présente
abîmé, désintégré. Littéralement dé-figuré c’est-à-dire privé de sa propre substance.
L’expression souligne la difficulté qu’a également la littérature pour nommer le « ça »,
le produit de ce qui reste et qui apparaît à la suite d’une blessure profonde au visage,
d’une mutilation. L’amputation, acte de suppression par excellence, n’apporte pas de la
matière, elle en enlève. Se pose alors la question du « devenir » narratif du membre
manquant. C’est ce « ça », qu’on ne peut précisément décrire, d’autant plus que chaque
blessure est différente et donne à chaque blessé de la face une allure dissemblable. Il n’y
a en effet pas d’uniformité de la blessure (et donc une nouvelle fois se pose le problème
de la catégorie) selon que le visage a été emporté pour moitié ou que le blessé peut
conserver ou non sa capacité à parler, à mastiquer, à voir, à entendre etc.
Le « membre manquant » est dans tous les cas une suppression, une ablation
d’une partie de l’être. Sophie Delaporte s’appuyant en partie sur les travaux de Weir
Mitchell (1829-1914), médecin américain spécialisé dans les troubles et traumatismes
nerveux, évoque le sentiment de pérennité du membre manquant chez les amputés, qui
n’arrivent pas à intégrer « l’altération de [leur] schéma corporel315 ». L’on appelle cela la
pérennité du « membre fantôme316 ».
Autre meurtrissure passée sous silence, Gabriel Chevallier évoque une mutilation
toute particulière, celle des parties génitales d’un de ses compagnons d’hôpital.
Particulière parce qu’elle fait dévier le récit sur la question du genre, thématique peu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!315 Sophie Delaporte, « Le corps (…) », éd. cit., p. 9. 316 Ibid.
! ! ! !
!
141!
abordée dans le récit de guerre.317 Lorsque le narrateur de La Peur lui demande : « Rien
de très grave mon vieux ? », l’autre répond : « Moi ? Je ne suis plus un homme318 ». Plus
loin le narrateur avoue : « Au bas de son ventre, j’ai vu la honteuse mutilation319 ». Cette
citation est révélatrice dans la mesure où nulle part dans le texte il n’est clairement
mentionné de quelle mutilation il s’agit. Et au-delà de l’aspect générique et du discours
sur la masculinité, ce qui est important c’est l’absence de vocable pour évoquer le
membre manquant, ainsi que l’affirmation par le blessé qu’il n’est plus un homme.
Absence de vocable, ou alors mot fantôme, qui par son absence, évoque le dit « membre
fantôme » ? Le discours sur la masculinité, non reconnu comme tel, se fond ici dans un
discours plus général qui insiste sur la perte d’humanité, et qui par son aspect global
annihile le discours sur le genre. Ainsi, ne pouvoir nommer le « ça » permet de ne pas
nommer directement la perte de masculinité. Un discours au service d’un autre donc. Si
« dans la dévoration du visage ou la défiguration non seulement l’identification du
vivant au mort profané est plus intense mais sans visage, le mort n’est plus
personne320 », dans la perte des attributs sexuels, c’est l’identité humaine qui semble
disparaître sous la plume de Chevallier. La littérature de guerre peine à catégoriser cet
être duel, composite, moitié mort, moitié vivant et semble mal à l’aise dans le discours
de l’hybridité, elle va décider de faire parler un autre narrateur et de problématiser la
possibilité même de franchir la barrière de l’humain : c’est ainsi que l’animal entre en
scène dans le roman de guerre.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!317 À ce sujet, lire l’œuvre de Jean-Yves Le Naour, Misères et tourments de la chair durant la Grande Guerre. Les mœurs sexuelles de Français, 1914-1918, Paris, Aubier, 2002, qui évoque la souffrance affective et sexuelle qui a marqué des millions de Français séparés les uns des autres pendant la guerre. 318 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 122. 319 Ibid. 320 Carine Trévisan, op. cit. p. 57.
! ! ! ! !
! 142!
PART III – Bestiaire guerrier – De l’animal symbolique au « je » des bêtes :
préludes littéraires à la mort de l’Homme
« L’abject nous confronte […] à ces états fragiles où l’homme erre dans les territoires de l’animal321 »
La thématique animale parcourt le récit de guerre, que ce soit dans l’évocation de
l’animal à proprement parler, c’est à dire en tant qu’être vivant distinct de l’humain,
utile ou nuisible, de compagnie ou sauvage (puis parfois apprivoisé) et qui accompagne
le soldat au front ou que ce soit l’homme représenté en tant qu’animal. Progressivement
l’animal apparaît comme un nouveau personnage, une nouvelle voix dans la narration de
guerre sous les traits d’un être physique matérialisé mais aussi comme figure
symbolique. Rendant compte d’une pluralité d’images et de représentations, l’écriture de
l’animalité en temps de guerre se confronte à la définition même du mot et participe à la
grande question de la barrière entre humanité et animalité. En effet, où cette barrière se
situe-t-elle ? L’animalité de l’homme – et d’ailleurs quelle est-elle ? – ne se manifeste-t-
elle que lorsqu’il combat ?
Il s’agit de voir quelle est la place de l’animal dans la narration et la manière
dont il est considéré. Double ou miroir de l’homme, figure de substitution du langage,
symbole de la souffrance humaine, l’animal, en dehors de sa propre ontologie, est
porteur, dans les œuvres littéraires de la Première Guerre mondiale que nous
considérons, d’une dimension qui dépasse ce qu’Heidegger appelait sa « pauvreté en
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!321 Julia Kristeva, op. cit., p. 5.
! ! ! ! !
!
143!
monde322 ». La dimension ontologique des animaux présents dans la littérature de guerre
dépasse ce pur lien de fonction vitale au milieu qui les environne puisqu’ils interagissent
avec l’homme et que leurs actions / relations ont une fonction motrice dans la narration.
L’analyse de l’animalité dans le discours de guerre relance le débat sur la porosité (ou
non) de la frontière qui existe entre l’homme et l’animal. Car si certains romans
mentionnent l’animal comme compagnon de tranchée, évoquant la rencontre littérale
mais aussi littéraire entre espèce humaine et espèce animale (Élie Faure, Maurice
Genevoix), d’autres se font le porte-voix d’un narrateur explicitement animal (Pierre
Chaine, Pierre Mac Orlan). D’un autre côté, bien souvent, les récits font référence à cet
homme qui devient animal alors qu’il est confronté à l’expérience violente de la guerre.
Ce glissement, qui à première vue semble aisé car il rejette en dehors de la sphère
humaine la question de la responsabilité de l’acte violent, souligne en réalité la crainte
chez l’homme d’une perte de sa spécificité (au sens littéral l’être humain serait menacé
de fracture, de désintégration de ce qui le constitue) et d’une régression, questions
évoquées précédemment dans le présent travail. La question principale que nous nous
posons ici réside dans l’utilisation de l’animalité dans le discours de guerre : comme
mise en scène de l’animal réel – animal personnage – mais aussi dans sa représentation
symbolique. En effet, qu’est-ce que l’animal nous donne à voir ? De quelle(s) voix et de
quel(s) discours est-il le dépositaire ? Le regard que les auteurs portent sur les chevaux,
les rats, les poux, les chiens, existe-t-il comme un regard purement d’altérité ou est-ce
une manière de proposer un regard sur l’homme civilisé que la guerre bouleverse ?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!322 Ceci est une des thèses de Martin Heidegger définie dans Les concepts fondamentaux de la métaphysique : monde, finitude, solitude, Paris, Gallimard, 1992. Pour Heidegger, « la pierre est sans monde », « l’animal est pauvre en monde » et « l’homme est configurateur de monde ». L’animal est lié à chaque « objet » environnant en fonction de ses intérêts vitaux.
! ! ! ! !
!
144!
Il faut tout d’abord prendre en considération la dimension historique de la
relation homme-animal. Les soldats ont, en temps de paix, utilisé, côtoyé, aimé et connu
des animaux selon des codes socialisés et par conséquent arrivent au front, porteurs
d’une expérience et d’une perception que la guerre va remettre en question. Comment la
guerre, qui bouleverse les rapports sociaux, transforme-t-elle cette relation à l’animal ?
Qu’advient-il de l’asymétrie, caractérisée par la domination a priori de l’homme sur
l’animal, dans le rapport de l’un à l’autre ? Qu’en est-il de la dépendance qui justifie la
présence de certaines espèces animales auprès de l’homme ?
L’animalité dans le roman de guerre portée par la présence des animaux comme
personnages composant le récit d’une part, et par le « je » des bêtes d’autre part,
n’annonce-t-elle pas un repositionnement de l’hégémonie de l’homme au sein de la
biodiversité et de fait, de sa propre conception philosophique ? Les récits ne révèlent-ils
pas la crainte que la mort de l’homme advienne conjointement / en raison du formidable
sursaut de violence qui a eu lieu lors de ce premier conflit mondial ? Le discours sur
l’animal en guerre et dans la guerre met plus souvent en lumière une histoire humaine de
l’animal aux dépens de l’appropriation du discours par l’animal. Quand c’est le cas
cependant, comme dans le cas des Mémoires d’un rat de Pierre Chaine, inexorablement
l’animalité est contée du point de vue humain (le discours peut-il être autre
qu’anthropocentrique ?). Cependant, il est intéressant de voir ce que l’animal a « à dire »
sur l’homme en guerre.
Dans un premier temps, j’analyserai brièvement la cohabitation entre animaux et
humains au front, et la façon dont elle est retranscrite dans les romans de tranchées, puis
j’interrogerai la question du discours de l’animal dans le roman de guerre et enfin, je me
! ! ! ! !
!
145!
pencherai sur le sacrifice de l’homme-animal, à savoir sur la possibilité de transfert du
discours humain en un discours animal et ses conséquences sur la narration.
! ! ! ! !
!146!
Chapter V – Cohabitations : l’animal dans la guerre entre exploitation matérielle et
exploitation symbolique.
L’animal, cet autre : le compagnon de tranchée
La Grande Guerre a eu recours à l’utilisation d’animaux domestiques et
domestiqués : leur usage a été multiple, des chevaux de traits aux chevaux
d’infanterie 323 , des pigeons voyageurs des unités colombophiles 324 aux chiens
messagers325 ou chiens sanitaires. Un rapport différent à l’animal se crée, non seulement
fondé sur les nouveaux services exigés de l’animal mais aussi sur un environnement qui
induit de nouveaux liens affectifs.
Les trois exemples qui suivent et qui mettent en scène les animaux dans des
récits de guerre racontent l’animal comme compagnon, dans sa représentation
différenciée par rapport à l’homme. Soit que l’animal s’inscrit alors dans la sphère de
l’altérité ; il est l’autre par excellence, entité naturelle qui prend forme au regard des
considérations et des perceptions que l’homme a de lui, cette « altérité particulière,
porteuse de sens326 ». Le cheval, le corbeau mais aussi le rat de Pierre Chaine ou de Mac
Orlan dans une moindre mesure, sont certes des compagnons (ce qui les inscrit dans une
perspective d’une animalité domestiquée), mais ils sont reconnus de manière a priori
comme singuliers – et donc différents physiologiquement de l’homme –, c’est-à-dire
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!323 Damien Baldin, citant la revue vétérinaire militaire [« Statistique du service vétérinaire de l’armée pour la campagne 1914-1918 », Revue vétérinaire militaire, Tome V, 31 mars 1922, 1er fascicule, p. 7-35, 2e fascicule, p. 199-215, 3e fascicule, p. 299-309 ; Tome VI, 31 mars 1923, 1er fascicule, p. 26-35] affirme que « l’armée française mobilisera, entre le 31 juillet 1914 et le 11 décembre 1918, 1 880 000 chevaux (dont 150 000 mulets) ». Damien Baldin, « De la contiguïté anthropologique entre le combattant et le cheval », op. cit. 324 Cf. à ce titre le film de Gabriel Le Bomin, Les Fragments d’Antonin, France, 2006. 325 Le roman d’Alice Ferney, Dans la guerre, Paris, Babel, 2005, raconte l’histoire d’un chien de tranchées utilisé comme chien messager. 326 Dominique Lestel, L’animalité. Essai sur le statut de l’humain, Paris, Hatier, 1996, p. 65.
! ! ! ! !
!
147!
chacun doté d’attributs et de terminologies propres à leur espèce. Le cheval de Maurice
Genevoix a bien des naseaux, le corbeau d’Élie Faure a bien un jabot, des ailes et un
bec, et le rat de Chaine ou de Mac Orlan possède une queue nue et un museau pointu.
Leur comportement dépend chacun de l’éthologie objectiviste327 sur lequel les textes
insistent – et c’est d’ailleurs ce qui engage de manière particulière la narration ; ainsi le
cheval est prompt à la fuite, le corbeau pourvu d’une grande intelligence et le rat,
intelligent et curieux328. Certes, ces considérations comportementalistes ne peuvent
totalement se distinguer de l’aura symbolique qui entoure chacune de ces espèces.
Néanmoins, c’est par le biais du comportement propre à chacun que le récit introduit tel
ou tel animal. C’est autour du comportement que se construit la trame narrative puisque
ce dernier permet la relation à l’humain, plus particulièrement au soldat et à son
environnement direct.
Dans son récit Nuit de guerre, Maurice Genevoix relate la rencontre du narrateur
avec un cheval. « Et j’entends aussitôt un bruit rythmique et sourd, comme d’un trot sur
la terre molle329 ». L’animal intervient dans le récit par le biais de l’ouïe, qui permet à
l’imagination de détecter le bruit du trot au milieu des vacarmes qui sont ceux de la
guerre ; le narrateur se trouve en effet déjà dans un environnement sonore violent, au
milieu de coups de fusil et de bombardements. Avant que le cheval n’apparaisse, ce sont
les sons de son allure qui attirent l’attention du narrateur, car ils diffèrent du tumulte
ambiant. Puis, « devant moi, entre deux arbustes, le vieux cheval gris apparaît. Il s’est
arrêté court dès qu’il m’a vu. Il reste là, immobile sur ses pattes enflées, les naseaux
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!327 Sur cette question, voir Dominique Lestel, Les animaux sont-ils intelligents ?, Paris, Le Pommier, 2012, pp. 15-16. 328 Nous relevons ici les traits communément attribués à chacune des espèces mentionnées. 329 Maurice Genevoix, Nuit de guerre, éd. cit. p. 320.
! ! ! ! !
!
148!
battants, une oreille pointée vers moi, l’autre tendue en arrière, du côté où sifflaient les
balles330 ».
La description de la rencontre à proprement parler passe par un face à face visuel
qui mérite d’être analysé. Tout d’abord, le cheval semble en piteux état. Cette condition
va susciter la compassion du narrateur, qui l’interpellera par un « Tu saignes, mon
pauvre vieux331 ? », terme certes affectueux plus que justifiant d’un âge mais qui
confirme l’empathie éprouvée. Quoique sur l’âge, nous puissions émettre une
interprétation différente : le « tu » renvoie au tutoiement que l’on adresse à un enfant,
l’infans, « celui qui ne parle pas », comme le rappelle justement Isabelle Baladine
Howald 332 . Le « tu » confèrerait au cheval une qualité « d’infériorité » non pas
consciemment et nécessairement dépréciative, mais communément admise. Revenons à
la description. Ses membres enflés témoignent probablement d’un manque de soins liés
à une période d’errance. Avant que le narrateur établisse un contact tactile avec l’animal,
il s’opère un moment de latence, délai nécessaire à la rencontre de deux espèces :
l’animal s’arrête court, permettant le face à face durant lequel chacun observe l’autre.
Cet instant en suspension où le cheval détaille l’homme et vice versa permet à l’une
comme à l’autre espèce de passer par une phase d’observation puis d’identification.
L’immobilité du cheval soulignée par la narration laisse le temps à la description du
reste de son corps : les pattes, les naseaux puis les oreilles et un peu plus loin, le poitrail
blessé, les flancs décharnés. La description des oreilles qui pointent dans deux directions
différentes est à mon sens fondamentale car c’est « au-dessus », « à la croisée » de ces
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!330 Ibid. 331 Ibid. 332 Isabelle Baladine Howald, « L’animal inspire », Le Portique [En ligne], 23-24 | 2009, document 8, mis en ligne le 28 septembre 2011, Consulté le 10 janvier 2013. URL : http://leportique.revues.org/index2441.html
! ! ! ! !
!
149!
organes que se crée le pont entre humanité et animalité, entre animal domestiqué et
animal sauvage. Cette position des oreilles indique, de la part du cheval, son indécision à
s’avancer vers l’homme. L’inquiétude animale, c’est celle de cet « “Être-aux-aguets” de
celui qui n’est jamais tranquille parce que ce qu’il possède – lieu, nourriture, femelle,
vie – se trouve constamment menacé333 ». Son instinct lui fait maintenir son attention sur
le bruit des bombardements, qui se situent en arrière de lui alors qu’il fait face, dans le
même temps, à un autre ennemi potentiel, l’homme. Mais entre deux peurs, il va choisir
la moindre : c’est tout du moins ce dont nous convainc la narration. Ainsi il se met à
brouter et le narrateur verbalise le lien qui vient de se créer : « On est ami, n’est-ce
pas ?334 ». Genevoix, souvent reconnu par la suite comme écrivain animalier335, introduit
à ce moment du récit l’animal comme médiateur entre deux mondes et entre deux
atmosphères.
Tout d’abord, le cheval est le médiateur entre le souvenir enfoui d’un monde
sauvage dont son espèce a émergé, palimpsestes révélés par la promptitude à fuir, et le
désir d’approcher le monde des humains, promis par la caresse. Mais le cheval est
également médiateur entre la sauvagerie des hommes (ceux qui bombardent) et leur
bonté (ceux qui caressent), entre leur violence, qui serait perçue comme un rejet
d’humanité et leur capacité de compassion. Il crée le lien par sa crainte, qui est d’une
part liée au bruit, souvenir immédiat des blessures qu’il porte (« un filet vermeil sinue au
poitrail336 »), et qui d’autre part le soustrait au contact immédiat avec l’homme. Et la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!333 Elisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998, p. 35. 334 Maurice Genevoix, Nuit de guerre, in Ceux de 14, éd. cit. p. 320. 335 Je pense notamment ici à Rroû (1931) ou à La Dernière harde (1938) ou encore bien sûr à Le Roman de Renard (1958) entre autres œuvres qui constituent le bestiaire de Genevoix. 336 Maurice Genevoix, Nuit de guerre, in Ceux de 14, éd. cit., p. 320.
! ! ! ! !
!
150!
crainte de l’animal décrite par le narrateur produit chez le lecteur un effet d’empathie : la
médiation semble complète et totale, entre l’être humain à savoir le « soi-même » et
l’être autre, ici animal, qui ne fait que renvoyer l’image de celui qui le regarde à lui-
même. Car en effet, derrière cet animal blessé, nous y reviendrons dans la troisième
partie de ce chapitre337, c’est l’image de l’humain blessé qui affleure. Dans son étude sur
le cheval et la Grande Guerre, Damien Baldin affirme : « Il est certain également que la
mort du cheval est vécue comme la transposition de celle du camarade ou même encore
comme l’anticipation et la prémonition de la sienne propre338 ». La mort du cheval
n’intervient pas directement ici mais est suggérée par le piteux état de l’animal et s’il est
seulement blessé, il semble que le narrateur vive la blessure comme sienne ou que tout
du moins la souffrance de l’animal soit perçue comme liée à la responsabilité humaine.
De manière aussi abrupte que le cheval arrive dans le récit, il en repart. Le cheval est le
compagnon du narrateur pendant quelques pages, et puis, sans transition, l’on revient au
récit de guerre proprement dit : « Il grêle des obus339 ». Cette brièveté de l’intervention
de l’animal dans le récit mérite d’être soulignée. Y a-t-il une gêne à considérer trop
longtemps l’animal alors que le propos principal porte sur un grand désastre humain ?
L’animal traverse la scène, repasse rapidement dans le hors-champ.
Le narrateur de La Sainte Face lui se livre pendant près de quatre pages à une
réflexion sur le monde animal. Cette partie débute lorsqu’il mentionne son intérêt pour
le repas des animaux du zoo de chaque grande ville où il se rend. Dans l’animal en train
de manger, le narrateur affirme qu’il « y retrouve l’homme340 ». Ces observations
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!337 Cf. infra, Épilogue, p. 186. 338 Damien Baldin, op. cit. 339 Maurice Genevoix, Nuit de guerre, in Ceux de 14, éd. cit., p. 321. 340 Élie Faure, op. cit., p. 126.
! ! ! ! !
!
151!
servent en réalité à introduire Baptiste : « Baptiste est mon corbeau, ou plutôt le corbeau
de la formation. Mais il est manifeste que je suis son meilleur ami341 ». Le texte insiste
sur le rapport non pas d’une espèce à une autre, mais d’un individu à un autre. Chacun
n’est pas le représentant de son espèce mais est présent dans son individualité. Baptiste
est la mascotte de l’unité et ce type de relation entre soldats et animaux est fréquent.
Damien Baldin affirme en effet que la guerre « oblige à une cohabitation presque
permanente entre combattants et animaux342 ». La reconnaissance officielle de l’animal
mascotte, présent pour entretenir le moral des troupes, ne suffit pas à expliquer la
relation qu’entretiennent soldats et animaux au front. Certes, la présence de l’animal
permet, temporairement, de penser à autre chose qu’à la guerre. C’est une distraction, un
report d’affection sur un être qui ne combat pas, qui représente non seulement une forme
de neutralité (bien que sa représentation en temps que symbole colle fortement à
l’identité de la section), mais parfois même plus, une forme d’innocence et une
résistance face à la mort. François-Xavier Lavenne affirme même que l’animal au front
est une « résistance à la barbarie343 », car il « ouvre des lignes de fuite344 ». Soulignons
le paradoxe qu’il y a à trouver dans l’animal un garant de la culture dans une situation
proche de la barbarie. Comme si cet homme qui doute tant de lui-même pouvait se
rassurer par la présence de l’animal. L’animal semble plus socialisé que l’homme, n’a
pas perdu ses repères : le narrateur raconte le manège qui s’opère entre lui et le corbeau
chaque matin, ce dernier venant chercher de la nourriture : « Rassasié, il affecte d’avoir
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!341 Ibid., p. 129. 342 Damien Baldin, op. cit. 343 François-Xavier Lavenne, « Ce sous-animal qu’on appelle un homme. L’animal et les secrets de la vie dans l’œuvre de Céline », in Jacques Poirier (dir.), L’animal littéraire. Des animaux et des mots, op. cit., p. 43. 344 Ibid.
! ! ! ! !
!
152!
toujours faim, sachant que les temps sont durs, et l’avenir précaire345 ». En évoquant la
relation à Baptiste, le narrateur introduit une réflexion plus large sur la réalité de la
guerre et ses conséquences économiques problématiques. En attribuant à Baptiste une
capacité à se projeter dans l’avenir, le narrateur s’extrait du présent immédiat. L’action
ritualisée qui les occupe au quotidien et les rapproche permet de mentionner le passage
du temps au front mais aussi de mettre en parallèle le jeu homme/animal avec le « jeu »
martial. Le vocabulaire utilisé est celui du monde militaire et stratégique : « J’ai beau
ruser, changer mon heure, scruter tous les recoins de la cour pour le dépister, je suis
“ repéré ”346 ». Aussi adroitement que le narrateur tente de se soustraire à la pression du
corbeau, ce dernier finit par avoir gain de cause et par être nourri. S’établit alors une
relation basée autour de la notion de don, don de nourriture contre don de
divertissement : « Il joue. Il est artiste, comme moi347 ».
Ainsi, non seulement l’oiseau permet au soldat de se divertir mais il permet, à un
autre niveau, à l’auteur, d’établir un lien entre culture humaine et culture animale.
Baptiste est donc pourvu de sentiments humains : « Il est jaloux. Quand je caresse un
chien, il vient du fond de l’horizon, et, du bout de son bec, à coups durs et serrés, pique
tantôt mes bottes, tantôt les pattes du chien […]348 ». Les deux protagonistes du récit
sont artistes et jouent – séparément comme acteurs mais aussi ensemble. Le mimétisme
de leurs actions rapproche le monde animal du monde des hommes ou peut-être est-ce
l’inverse : ainsi l’intérêt que porterait un animal neutre – non pourvu d’une violence
moralement répréhensible – à un humain en guerre, dédouanerait partiellement l’homme
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!345 Élie Faure, op. cit., p. 129. 346 Ibid. 347 Ibid., p. 130. 348 Ibid.
! ! ! ! !
!
153!
de ses actions violentes, par effet de proximité et de porosité. La violence humaine se
rapprocherait donc de la violence animale, étant partiellement vidée d’intentions
contraires à l’éthique.
Le passage sur le corbeau finit de la même manière chez Élie Faure que chez
Maurice Genevoix et l’on repasse sans transition au monde de la guerre : « L’Italie entre
en guerre. On rit. Moi j’ai envie de pleurer349 ». La volonté d’Élie Faure de ne pas
s’éterniser sur la relation du narrateur à Baptiste (qui n’occupe qu’une dizaine de pages
dans le roman) s’inscrit dans un discours qui se veut particulièrement humano-centré : la
voix animale ne domine pas le texte et le corbeau intervient essentiellement pour
confirmer le narrateur dans son humanité.
Autre animal personnage de roman de tranchées, le rat Ferdinand de Pierre
Chaine, qui dans Les Mémoires d’un rat, fait s’exprimer l’animal à la première
personne. L’animal-compagnon ici prend la parole, débutant le récit en justifiant la
présence des rats de tranchées comme un événement providentiel : « Combien de soldats
se seraient laissés surprendre par l’ennemi, si notre activité nocturne n’avait pas stimulé
leur vigilance350 ! », affirme Ferdinand. Le récit de Chaine propose lui aussi ce rapport
« d’amitié » entre un homme et un animal, mais cette fois-ci, inversé : c’est le rat qui
décrira tout au long des pages la relation à son maître Juvenet. D’autant que leur relation
commence sur un malentendu. Alors que les soldats souhaitent supprimer le rat capturé
par ruse (une saucisse dans un piège aura eu raison de sa liberté), un colonel suggère que
sa présence sera utile à l’escouade puisque le rat « servira d’avertisseur en cas d’attaque
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!349 Ibid. 350 Pierre Chaine, op. cit., p. 13.
! ! ! ! !
!
154!
par les gaz351 ». Ferdinand sera donc avant tout utile. C’est cette condition qui justifiera
son maintien en vie, lui permettant de mettre par écrit ses impressions sur la vie dans les
tranchées. Il s’agit là d’une posture de décentrement, où l’animal se fait entomologiste,
observant l’homme352.
Le rapport homme / animal dans ces trois exemples souligne l’altérité comme un
rapport de compagnonnage, une relation bénéfique de l’un à l’autre353 : dépendance
affective tout comme complémentarité d’ordre pratique. Les œuvres de Genevoix et de
Faure qui s’inscrivent dans une perspective réaliste (celle de Pierre Chaine est à part
puisqu’elle met en scène l’animal comme narrateur, faisant prédominer le discours
animal supposé sur le discours de l’humain) abordent la question de l’animalité dans ce
qu’elle constitue « l’ensemble des espèces vivantes différentes de l’espèce humaine354 ».
Néanmoins, il y a une recherche évidente dans les œuvres précitées de mise en relation
de l’homme et de l’animal, si ce n’est sur un plan d’égalité, tout du moins dans un
rapport affectif de compagnonnage, qui suppose une parité relative dans les récits
considérés. La dépendance affective est intensifiée par un paramètre propre à la guerre
qui lie hommes et animaux : ils sont unis par une même menace, ils sont confrontés au
même danger, parfois aux mêmes peurs. De la survie de l’un dépend celle de l’autre.
Dans le cas de Baptiste le corbeau, l’animal est décrit comme possessif et jaloux :
attributs humains s’il en est, leur mention évoque une recherche de continuité entre
action humaine et action animale supposée (c’est-à-dire narrativement interprétée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!351 Ibid., p. 35. 352 La suite de mon analyse de Les Mémoires d’un rat porte essentiellement sur le discours du rat comme narrateur. Cf. infra. 353 Au sujet du rapport homme / animal dans la guerre comme rapport de compagnonnage, voir François-Xavier Lavenne, « Ce sous-animal qu’on appelle un homme. L’animal et les secrets de la vie dans l’œuvre de Céline », in L’animal littéraire. Des animaux et des mots, op. cit., pp.37-51. 354 Valérie Camos, Frank Cézilly, Pierre Guenancia et Jean-Pierre Sylvestre, Homme et animal, la question des frontières, Versailles, Quae, 2009, p. 5.
! ! ! ! !
!
155!
comme telle). Le comportement animal ici se pare d’une spécifié émotionnelle a priori
propre à l’humain et de l’attribuer au corbeau permet de raccourcir la distance homme-
animal. De même lorsque le narrateur de Ceux de 14 caresse le cheval. En effet, les
rapports tactiles entre hommes et animaux permettent physiquement de raccourcir la
barrière qui sépare les deux espèces. Considérant de plus la progression du texte, la
caresse précède, et par conséquent, appelle le vocable « ami ». En touchant le cheval, le
soldat amorce un début de relation qui coupe court à la phase de vis-à-vis qu’évoque
précédemment le récit. Ainsi se crée une ambiguïté dont le discours sur l’animalité n’a
jamais pu se départir. En touchant, en raccourcissant la distance d’un « moi » rationnel
et pensant à l’autre différent, l’on finit par effacer la frontière entre humanité et
animalité. Car si le comportement animal est ce qui dessine cette limite, en opposition au
comportement humain, alors quid de l’animal dont le comportement est décrit comme
humain ? Ceci est d’autant plus valable dans une relation « positive » qui lie le soldat et
l’animal au front.
Cependant, l’animal en guerre n’a pas toujours une connotation positive. Sa
représentation dans le récit ne souligne alors plus le rapport bénéfique mutuel (les
caresses chez Genevoix pour apaiser le cheval, le jeu concédé chez Faure et l’attention
de Juvenet pour son rat chez Chaine) mais au contraire celui de la nocivité. Et au-delà du
désagrément certain et du risque sanitaire qu’apportent par exemple poux et rats et que
les textes dénoncent, s’établit une correspondance entre la chute de l’homme d’une part,
au sens eschatologique, et l’apparition de certaines bêtes dans les tranchées et des
superstitions qui leur sont liées, d’autre part.
! ! ! ! !
!
156!
L’animal obsédant : cohabitation forcée
Si les animaux au front ont parfois un statut d’auxiliaire, bien souvent la
présence de certains d’entre eux est redoutée. Il y a d’un côté les animaux amenés avec
les troupes ; c’est le cas des chevaux notamment ou des chiens. Mais il y a aussi ceux
qui viennent « d’eux-mêmes » ou tout du moins, dont la présence n’est pas souhaitée.
Rats et poux sont les principaux animaux mentionnés dans les récits de tranchées
comme des êtres nuisibles. Les nuisances qu’ils apportent sont multiples : saleté,
surpopulation dont découle une impression de grouillement, démangeaisons, maladies,
destructions des denrées comestibles mais aussi des équipements. La mauvaise
réputation du rat, entretenue au cours des siècles, principalement liée à son rôle dans la
diffusion des épidémies de peste et dans le saccage des récoltes, n’a pas manqué
d’influencer la littérature, française comme mondiale. Au XXème siècle encore, le genre
Rattus (qui regroupe plus d’une centaine de sous-espèces) hante les récits d’une ombre
symbolique, ombre souvent disproportionnée à sa petite taille. Que ce soit dans The Rats
in the Walls de Howard Phillips Lovecraft (1923) ou Rats de James Herbert (1974) –
suivi plus tard de Lair et Domain -, le rat est tour à tour anthropophage, mutant et
monstrueux, désireux d’éradiquer tant des individus éparses que l’espèce humaine tout
entière. Historiquement, le rat a toujours été celui que l’on a cherché à tenir à l’écart. Il
est l’animal de « l’immonde355 » par définition, voisin refusé de l’homme civilisé,
constamment proche car jamais tout à fait éradiqué. La barrière entre homme et rat, dont
l’installation concrète et symbolique est la résultante d’une lutte continue, explicite,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!355 Evelyne Grossman, « Il faut écrire comme un rat trace une ligne », Colloque « Animalité », 4-7 octobre 2007, Parlement des philosophes ; http://www.parlement-des-philosophes.org/multimedia/06-Grossman.mp3 (dernière consultation le 11 janvier 2013).
! ! ! ! !
!
157!
intense et permanente, est rompue au front. D’une tentative de mise à distance, l’on
passe à une cohabitation continue, à une promiscuité telle qu’elle donne une légitimité à
la présence du rat dans le roman de guerre. Ce qui était donc de l’ordre de la pollution,
puisque le rat véhicule saleté et microbes et augmente leur prolifération, rentre
progressivement dans la sphère ordonnée et propre et renvoie à un monde passé,
archaïque : « Outre le fait que – nuisible – il connote les maladies dont il est porteur, et
notamment les pestes – ce qui nous renvoie encore au Moyen Age–, il est également une
part du quotidien pour le soldat […]356 », affirme Nicolas Beaupré. De son côté,
l’historien Paul Fussel en parlant des rats affirme : « The famous rats also gave constant
trouble. They were big and black, with wet, muddy hair. They fed largely on the flesh of
cadavers and on dead horses. […] Their hunger, vigor, intelligence, and courage are
recalled in numerous anecdotes357 ».
Cette transgression de l’impur et du sale dans l’univers quotidien des poilus n’a
pas échappé à l’attention des soldats-écrivains. Ainsi, la littérature de la Première Guerre
mondiale développe l’image du rat nécrophage, acteur d’une souillure symbolique sur le
cadavre en ce qu’il inflige au soldat défunt et bien souvent déjà mutilé, une seconde
mort. Jean Giono – et il n’est pas le seul - dans Le grand troupeau (1931) décrit des rats
dévorant des cadavres et s’étend longuement sur ces gloutons festins macabres. Cette
image est utilisée aussi chez René Naegelen comme le suggère Pierre Schoentjes358.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!356 Nicolas Beaupré, op. cit., p. 157. 357 Paul Fussel, op. cit., p. 49. : « Ces fameux rats posaient sans cesse des problèmes. Ils étaient gros et noirs, avec des poils mouillés et plein de boue. Ils se nourrissaient principalement de la chair des cadavres et des chevaux morts. […] Leur faim, leur vigueur, leur intelligence et leur courage sont rappelés dans des nombreuses anecdotes. ». Je traduis. 358 Pierre Schoentjes, La Grande Guerre, éd. cit.
! ! ! ! !
!
158!
L’apparition du rat et / ou du poux est textuellement concomitante à une prise de
conscience de la condition misérable dans laquelle évolue le poilu ; si les débuts de
roman évoquent cette atmosphère de « fleur au fusil », alors que la guerre s’enracine
l’imagerie des nuisibles apparaît dans les textes. L’apparition de telles images est aussi
la mise en mots du rejet de notre part d’animalité refoulée en ce que ces animaux
nuisibles soulignent l’impossible comparaison avec ce qui répugne. Chez Gabriel
Chevallier « Les poux marquaient la chute dans l’ignominie359 […] ». En effet, les poux
apparaissent alors que le narrateur s’exclame : « Notre arrivée dans le cercle enchanté
fut une désillusion360 », ce qui contraste avec la gaité du départ à la page précédente.
Après plusieurs mois en caserne, le narrateur souhaite enfin vivre l’excitation que
promet le champ de bataille. Or il s’aperçoit bien vite que seul le prix du sang sort les
hommes de cette ignominie : « […] un homme ne pouvait s’évader de cette crasse de la
guerre que si son sang coulait361 ». Le monde de l’animal repoussant, c’est celui de la
guerre et de la même façon que se divise le monde de l’arrière et le monde des
tranchées, le bestiaire guerrier se fragmente entre animaux purs et impurs, connotés en
fonction des territoires physiques mais aussi mentaux qu’ils habitent. Et le corps en
souffrance cherche constamment à échapper au monde du sordide : « Nos baraquements
étaient tellement infestés de poux que j’allais souvent dormir dans un champ362 » admet
le narrateur de La Peur. En établissant une distance entre son corps et le corps, pourtant
minuscule mais immonde des poux, le narrateur cherche à recréer un monde pure-ment
humain. Cependant, il avoue que l’humidité des champs lui infligera des coliques qui
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!359 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 44. 360 Ibid., p. 39. 361 Ibid., p. 44. 362 Ibid., p. 47.
! ! ! ! !
!
159!
finiront par l’épuiser. Il n’y a donc pas de choix vraiment que celui de cohabiter avec les
animaux nuisibles, de partager un monde.
Chez Pierre Mac Orlan tout comme chez Pierre Drieu La Rochelle, la présence
des rats et des poux363 signe également le déshonneur dans lequel est tombé l’homme.
Elle est perçue chez Mac Orlan comme une volonté du règne animal de vouloir mener
un combat contre l’espèce humaine, parallèle évident à la guerre que se livrent les
hommes : « Ce n’est qu’au début de l’année 1915 que les effets de la grande
mobilisation des rats se firent sentir dans la lutte implacable qu’ils engagèrent contre les
hommes364 ».
Pierre Drieu La Rochelle dira : « Cette tranchée qui n’a pas quinze jours
d’existence et qui est vieille comme le monde. Sur ces collines, ce ne sont que des débris
infects, des corps qui pourrissent. Charnier et marché aux puces365 ». Double-entendre
qui, à l’aide d’images mortifères, évoque un fourmillement d’objets épars, et la
profusion des nuisibles qui occupent la tranchée et se nourrissent de la mort. La notion
de désordre ici souligne la déstructuration de l’espace en un espace informe mais aussi
l’invasion d’un monde qui normalement reste dans les marges. Ces images fortes
décrivant la perception qu’ont les soldats des nuisibles renvoient aux notions de pureté
et de souillure analysées par l’anthropologue Mary Douglas366.
Cette cohabitation, subie et verbalisée signifie bien une sujétion à l’incommodité,
mais aussi une crainte des humains d’être trop près, trop proches, de ce qui les dégoûte.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!363 L’on ne peut s’empêcher de penser à La Peste de Camus, texte certes publié après la Seconde Guerre mondiale, mais qui évoque, par le biais de la métaphore de la prolifération du nazisme, la perte de l’humanité en l’homme. 364 Pierre Mac Orlan, op.cit., p. 85. 365 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 159. 366 Mary Douglas, De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La Découverte, 2001.
! ! ! ! !
!
160!
Et en étant trop proches des animaux, les hommes craignent de tomber dans l’abject
(rappelons, ce qui est jeté hors de) et c’est ce que ce type de littérature de guerre révèle.
Cette crainte de côtoyer l’abject ne s’applique alors plus seulement aux nuisibles mais
elle s’étend à l’animalité dans son ensemble. Car en effet, que cherche à faire la
narration dans les exemples mentionnés si ce n’est à défaire tout lien qui l’unirait au
monde animal ? « L’homme se coupe de l’animal, du matériel, de l’instinctuel. Il se
coupe du désordre, du variable, du promiscu – appélation archaïques du péché originel
qui a perdu son tranchant – il instaure l’ordonné, l’invariant, le codifié. D’un côté
l’inessentiel et de l’autre l’essentiel, voilà ce qui est déterminé dès l’origine367 », écrit
Serge Moscovici. La promiscuité d’avec les nuisibles – qui impliquerait à terme la
probable transgression des barrières séparant le monde humain du monde animal – et par
extension d’avec le monde animal dans son ensemble engendre une confusion des
espèces qui renvoie alors à une situation d’apocalypse, dont la mise en scène est
théâtralisée par la guerre elle-même en arrière plan. Kristeva dira d’ailleurs à propos de
cette barrière fragile qui cherche à conserver l’identité des mondes qu’elle est le topos –
lieu d’apocalypse – où prend forme « toute littérature368 ». Guerre et apocalypse ne
formeraient alors plus qu’un seul et même lieu, ne seraient que l’annonce d’une seule et
même fin, tout du moins pour l’homme. Giorgio Agamben dans L’Ouvert369 aborde la
probabilité d’une survivance animale, nous y reviendrons. Mettant à jour l’opposition
entre Georges Bataille et Alexandre Kojève, il révèle une théorie clef selon laquelle la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!367 Serge Moscovici, « Domestiquer la vie, ensauvager la vie », in Hommes domestiques et hommes sauvages, Paris, 10/18, 1974, chapitre I, pp. 21-29, cité par Boris Cyrulnik (dir.), Si les lions pouvaient parler. Essai sur la condition animale, Paris, Gallimard, 1998, p. 99. 368 Julia Kristeva, op. cit., p. 245. 369 Giorgio Agamben, L’ouvert. De l’homme et de l’animal, Paris, Rivages, 2002.
! ! ! ! !
!
161!
mort de l’homme à la fin de l’histoire qu’elle annonce, laisse néanmoins subsister
l’animal. Et c’est peut-être cette concession que l’homme n’est pas prêt à faire.
Cette fin apocalyptique constitue par conséquent une désacralisation du corps et
de la chair humaine. Les textes soulignent ce qui semble avoir profondément marqué les
acteurs et témoins de la guerre de tranchées, à savoir l’irruption d’un monde informe,
désorganisé, chaotique, sale, abject dans le monde de tous les jours. Qui plus est, ce
monde nouveau qui voisine de manière tant affirmée avec les poilus, n’est pas un monde
statique ; nous avons vu que les bombardements incessants contribuaient au brassage
perpétuel des corps et objets en tout genre. Mais pas seulement : en effet la présence
d’animaux visibles comme les rats ou moins visibles comme les poux et puces, renforce
cette image d’un monde qui grouille, dont les mouvements sont incontrôlables,
indéfinissables, qui échappent à la tentative de réaffirmation et de séparation de mondes
différenciés, celui de l’ordre versus celui du désordre, pur versus impur, vie versus mort,
etc.
Le roman de tranchées distingue donc a priori deux catégories d’animaux : les
« bons », ceux qui renvoient l’homme à son humanité et les nuisibles, qui la menacent.
Par leur présence incontrôlée et incontrôlable ces derniers participent de manière
concomitante aux destructions infligées par la guerre qui ébranlent les structures de la
société. Cependant la question de la cohabitation de l’animal et de l’homme en guerre
renvoie symboliquement à cette altérité de l’un qui menace l’identité de l’autre. À tel
point que l’identité narrative va progressivement céder le pas à son double, et pourtant
craint, animal.
!
! 162!
Chapter VI – Le « je » des bêtes
La présence permanente des animaux dans les tranchées semble avoir permis à la
voix animale de prendre le relai de la voix humaine. En effet, au-delà de sa présence
physique, comme animal nuisible ou comme compagnon de tranchées, l’animal est
utilisé par la littérature de guerre pour une autre fonction, celle de l’expression d’une
voix nouvelle, tantôt mixte – elle est alors la voix double de l’homme –, tantôt
singulière, propre à l’animal.
La voix de l’homme-animal est une voix qui fluctue : elle s’exprime en se fixant
sur les oscillations internes du narrateur humain, qui tantôt se perçoit et évoque ses
actions comme les fruits d’un comportement humain, tantôt se perçoit comme bestial. La
voix animale dans ce cas de va-et-vient fonctionne donc comme une voix-relai, qui
ramène au devant de la scène ce qui passe hors-champ. Cette incarnation du narrateur en
animal peut s’opérer sur toute la longueur du récit ou être partielle, momentanée,
porteuse d’une métaphore qui ne dure qu’un temps : le personnage mixte, hybride,
l’homme-animal apparaît alors comme celui dont le discours cherche à dénoncer la
violence sans pour autant parvenir à se donner une identité discursive fixe.
Lorsqu’elle n’est voix que du seul animal – bien que production inexorablement
humaine – elle tâche d’être présente et ce de manière invariable sous des traits
animaliers ; c’est justement dans cet effort d’invariabilité qu’apparaît sous la plume
d’auteurs comme Chaine ou Mac Orlan un discours animal propre à la guerre. Ainsi,
dans les exemples que nous considérons, les auteurs exploitent le bestiaire des tranchées
et lui donnent la parole. Le narrateur devient alors poilu, se dote de quatre pates, d’une
! ! ! ! !
! !
163!
queue, d’un museau, les limites de sa corporalité devenant celles de l’animal incarné par
le « je ». Le support narratif permet d’être projeté dans l’espace des tranchées en toute
liberté, d’explorer les rêves et pensées les plus secrètes du genre humain en se posant
comme observateur interne, quand le soldat-écrivain choisit de se taire. En effet, les
frontières du nouveau corps animal incarné se modifient et fluctuent, entre réduction
d’échelle ou au contraire augmentation des volumes, suivant l’animal incarné. Les
exemples qui suivent ne concernent que la voix d’animaux plus petits que l’homme. Lié
à cette réduction d’échelle, une des fonctions de l’animal porteur de la voix humaine
sera alors de proposer une interprétation particulière de la guerre à partir d’un nouveau
point de vue.
Dans cette partie, ce que je souhaite évoquer tout particulièrement c’est la vision
utilitaire qui est faite de l’intégration d’un personnage animal dans la narration, plus
particulièrement mettre en lumière pourquoi et comment la voix narrative de l’animal
raconte, en quoi l’animal sert la narration. En effet, la violence vécue dans les tranchées,
comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent, paraît si étrangère à l’homme –
contrairement à la position que prend Élie Faure à ce sujet – qu’il semble impossible à
l’écrivain de faire parler l’homme comme acteur de violence. La participation à un
événement d’une extrême violence est difficilement intégrée consciemment comme une
production qui appartient à ce même homme qui se conçoit comme civilisé, éduqué,
policé. Ce qui devient donc un insupportable discours de soi – puisque ce même
discours se heurte à des désirs paradoxaux où la question du maintien de l’éthique
affronte la nécessité de vaincre – lié à l’impossible acceptation de la violence comme
phénomène humain, va contraindre le modèle narratif à évoquer une autre violence que
! ! ! ! !
! !
164!
la violence humaine, une autre mort que la sienne. C’est d’ailleurs ce que suggère
Damien Boldin lorsqu’il s’interroge sur une forme de représentation de mort
animale : « Les descriptions très réalistes de la mort des chevaux ne sont-elles pas
simplement un moyen employé par les auteurs pour rabattre leur description de l’horreur
des corps déchiquetés du champ de bataille sur l’animal plutôt que sur les hommes, et ce
même si la démarche est inconsciente ?370 ». Ces images seraient-elles donc une
substitution à la représentation de la mort et des cadavres humains ? La distance
d’énonciation est alors créée de manière suffisante pour étayer la critique de l’auteur sur
l’homme en guerre. Ou pour, comme l’affirme François-Xavier Lavenne, regrouper sous
la catégorie d’« animal », tout ce qui n’est pas l’homme371. Cependant, hormis Pierre
Chaine, peu d’auteurs osent donner la voix à l’animale in extenso.
L’homme-animal : ambiguïté du discours du « je »
Nicolas Beaupré dans son ouvrage Écrire en guerre, écrire la guerre, consacre
une partie à l’écriture de l’animalité dans le texte de guerre, partie intitulée : « En deçà,
l’animal 372 ». Il affirme que « l’animalisation vient radicaliser encore l’image du
barbare » et que « alors que le barbare venait d’un au-delà dangereux pour l’humanité
civilisée, l’animal est en deçà de l’humanité373 ». Par animalisation ici, il s’agit de
l’identification de l’autre sous les traits d’un animal. Cette affirmation prend en compte
les textes qui stigmatisent l’ennemi en le représentant sous les traits d’un animal
nuisible, mettant sur un pied d’égalité barbarie et animalité ou encore, qui affirment que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!370 Damien Baldin, op. cit., p. 371 François-Xavier Lavenne, cité par Jacques Poirier (dir.), op. cit., p. 37. 372 Nicolas Beaupré, op. cit., p. 156. 373 Ibid.
! ! ! ! !
! !
165!
l’arrivée de l’ennemi correspond à l’invasion des tranchées par les animaux nuisibles
(rats, poux), ce que nous venons de voir. Dans ces deux cas, en effet, l’utilisation de
l’animal dans la représentation de guerre tend à représenter un monde de « l’en-deçà ».
Roland Dorgelès dans une des lettres écrites à Madeleine datée du 4 janvier 1915 dira :
« Certains soirs on n’est plus qu’une bête crevée374 ». Mais c’est sans faire appel à
d’autres œuvres qui relatent la guerre de 14-18 et dans lesquelles la place de l’animal
n’est pas évoquée dans une dialectique négative et où son renvoi dans les lignes de la
barbarie est beaucoup moins évident et catégorique. L’utilisation du bestiaire peut mettre
en lumière l’homme qui souffre – cette empathie évoquée dans le rapport d’amitié avec
des animaux dans les tranchées (cf. supra) – ou l’homme-animal ridicule ; chez Gabriel
Chevallier, pour un temps, les soldats équipés de leur masque à gaz se muent en
hommes-porcs : « Les museaux de cochon nous rendent monstrueux et grotesques. Nous
sommes surtout pitoyables, la tête penchée sur la poitrine375 ». Ici, l’animalité à laquelle
le soldat est renvoyé n’est que le support de la satire faite à l’encontre de la guerre. Il
n’est rien de glorieux dans l’homme au combat, nulle grandeur ne permet de transcender
son état et bien au contraire, il a l’air d’un grotesque animal. D’autant que c’est de son
groin que le porc fouille la fange. C’est donc cet « en-deçà » que mentionne Nicolas
Beaupré, exprimé par un « je » dont le discours s’adapte à un ressenti négatif. « Je » cet
homme-animal grotesque.
Il n’est pas rare en effet que les textes évoquant la guerre du point de vue du
soldat, point de vue humain, fassent fréquemment référence à cet homme, pourtant
animal, qui combat. La perception de cet homme qui vacille et penche vers l’animalité
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!374 Roland Dorgelès, Je t’écris, éd. cit., p. 170. 375 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 239.
! ! ! ! !
! !
166!
varie d’un auteur à l’autre et l’hybridité concédée au personnage ne le fait cependant pas
nécessairement pencher du côté de l’a-civilité, de la brutalité. Auxiliaire à la force
physique, la pérennité d’une présence animale en l’homme permettra de continuer à se
battre en sauvant sa peau. Certes, ce truisme a été maintes fois repris, mais il s’oppose à
la vision de la présence animale dans les textes comme appartenant au monde de l’en-
deçà : ce qui reste en l’homme de l’animal n’abaisse pas l’homme, dans certains cas, il
le sauve. Pourtant, dans le cas d’Élie Faure, il semble que l’auteur n’arrive pas à se
décider de manière définitive sur le rôle de l’animalité dans la guerre. Ainsi il écrit :
« L’homme n’est pas un animal raisonnable, c’est un animal raisonnant376 ». Il instaure
de fait un rapprochement évident voire même une égalité de nature entre homme et
animal, sous-tendue par l’utilisation du verbe être, mais aussi entre raison et instinct. Or
chez Faure, ce statut d’égalité entre homme et animal est complexe. Si l’homme est
naturellement violent, c’est parce que son instinct de vie, de manière essentielle au sens
propre du terme le lui dicte. Établissant une comparaison entre les jeunes animaux et les
enfants, il affirme : « Cette prétendue loi de conscience qui condamne et interdit la
guerre ne serait-elle, en fin de compte, qu’un signe de sénilité ? L’être organiquement
très vivant a toujours des instincts violents. Et l’enfant, par définition, vit avec violence.
Il est bon et sanguinaire naturellement377 ». Le propos de Faure illustre parfaitement – et
alimente – le débat sur la barrière entre nature et culture, inné et acquis. Ici, point de
barrière entre bonté et violence, instinct et maîtrise de soi : la vitalité animale est inscrite
dans l’homme. Se portant en faux contre la vision qui consiste à dire que l’homme est
bon par nature, Élie Faure introduit chez l’homme cette part d’animalité, ici synonyme
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!376 Élie Faure, op. cit., p. 150. 377 Ibid., p. 128.
! ! ! ! !
! !
167!
de cruauté, que l’époque des Lumières dans une tendance rousseauiste a tant cherché à
rejeter378. Plus loin dans le texte, l’auteur insuffle une propriété négative à cette
animalité humaine : « Naturellement, j’avance à quatre pattes : on est du XXe siècle ou
on n’en est pas379 » affirme-t-il. Le progrès célébré en ce début de siècle s’est vu
détrôner et supplanter par les relents d’animalité que nous renfermons et réprimons en
vain. Le « je » qui s’exprime est donc tiraillé entre le raisonnement et l’instinct, et s’il
peut verbaliser une pensée rationalisée, il le fera en marchant comme un animal, à quatre
pattes.
Autre écrivain du corpus à évoquer ce personnage mixte, Raymond Escholier
affirme : « Et de se sentir guetté sans sympathie par une sorte de double clairvoyant et
ironique, l’animal humain se roidit, surmonte la débâcle de ses nerfs tendus au
paroxysme380 ». L’homme-animal d’Escholier est clairement un composite double et
duel, tout comme chez Faure. L’on ne sait pas qui guette qui, qui censure ou au contraire
excite qui. La dualité implique une réciprocité qui nous empêche de départager,
d’affirmer qui de l’homme ou de l’animal est le juge de l’autre. Est-ce l’animal en
l’homme qui observe l’homme, comme dans le discours des rats (Chaine et Mac
Orlan) ? Ou l’homme, qui observe en lui sa part d’animalité ? Cette indécision à pencher
dans un monde plus que dans un autre souligne l’intangible cohabitation entre animal et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!378 Cette idée exprimée par Élie Faure n’est pas sans rappeler le discours de Baudelaire sur la nature : « nous verrons que la nature n'enseigne rien, ou presque rien, c'est-à-dire qu'elle contraint l'homme à dormir, à boire, à manger, et à se garantir, tant bien que mal, contre les hostilités de l'atmosphère. C'est elle aussi qui pousse l'homme à tuer son semblable, à le manger, à le séquestrer, à le torturer; car, sitôt que nous sortons de l'ordre des nécessités et des besoins pour entrer dans celui du luxe et des plaisirs, nous voyons que la nature ne peut conseiller que le crime », in Charles Baudelaire, Curiosités esthétiques [Document électronique] ; L'art romantique : et autres œuvres critiques, [textes établis par Henri Lemaître], Paris, Bordas. http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-101426&M=tdm, Dernière consultation le 25 février 2013. 379 Élie Faure, op. cit., p. 161. 380 Raymond Escholier, op. cit., p. 194.
! ! ! ! !
! !
168!
homme. Et si, comme l’affirme Rémy Gagnon, l’animal « permet à l’homme d’articuler
un rapport sensé au monde », alors l’on comprend mieux sa présence dans certains récits
de guerre. L’animal, double indispensable, agit comme un médiateur permettant
d’articuler l’expérience personnelle d’un monde de chaos à un monde explicable,
d’articuler l’indicible au dicible, l’insoutenable au regardable et concevable.
L’allusion à l’animalité chez Pierre Drieu La Rochelle est plurielle mais ce qui
domine et parcourt principalement son œuvre c’est la comparaison des armées à un
troupeau. À l’inverse de Faure ou d’Escholier, l’animal passe du statut de l’élocution
singulière à celle du collectif : « J’avais cru à une certaine coïncidence entre mon élan et
celui du troupeau381 ». Cette comparaison a été beaucoup utilisée dans le roman de
tranchées (pensons encore à l’œuvre Le Grand troupeau de Giono ou comme nous
venons de le voir, au texte d’Élie Faure) mais dans le cadre de l’œuvre de La Rochelle,
elle permet au narrateur de se soustraire à une masse qu’il juge indigne de lui. L’animal,
c’est l’Autre. Ainsi il affirme : « Et à mesure que je voulais me séparer de ce troupeau
qui prenait tranquillement le chemin de la retraite, je sentais qu’en moi c’était la force et
l’orgueil qui se relevaient 382 ». La nostalgie d’une armée forte, déjà évoquée
précédemment, se réaffirme paradoxalement dans la critique d’une obéissance aveugle
qui pousse ses compatriotes à se battre. La complexité du sens de l’engagement chez
Drieu, manifeste au travers des propos de son narrateur, réside dans ce passage qui
précède son désir de désertion. Ainsi, le narrateur souhaite se désengager de la masse,
tout en affirmant une supériorité de valeurs qui en réalité le pousse à déserter. Il
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!381 Ibid., p. 73. 382 Ibid., p. 91.
! ! ! ! !
! !
169!
poursuit : « Tous ces types sont des salauds, des pleutres ; il faut les lâcher383 ». Ce
désengagement de la masse considéré à un autre niveau de discours ressemble à une
tentative de dissociation homme / animal, autrement dit de rétablissement d’une
frontière ferme et tranchée entre sa propre animalité et son humanité. Il s’agirait alors de
« déserter » la sphère animale afin de réaffirmer sa seule humanité. Et pourtant, le
narrateur ne semble pas pouvoir maintenir cette distinction quand il affirme : « Nous
criions. Qu’est-ce que nous criions ? Nous hurlions comme des bêtes. Nous étions des
bêtes. Qui sautait et criait ? La bête qui est dans l’homme, la bête dont vit l’homme. La
bête qui fait l’amour et la guerre et la révolution384 ». L’animal qui habite le soldat dans
ce cas s’exprime bien de manière animale : il crie, c’est-à-dire qu’il ne verbalise pas la
peur, la violence, ce qui l’assaille, il émet un son (ce qui vient avant le verbe, avant la
parole). Mais curieusement il est aussi profondément social puisqu’il fait l’amour plutôt
qu’il ne s’accouple. Il est capable aussi de révolution. L’emploi du mot ici prête à
confusion. Attribuée à l’animal (ou à l’homme-animal ?), laquelle des définitions
prévaut ? Est-ce celle du bouleversement, du changement, engendré alors par notre part
d’animalité ou celle au contraire d’une boucle dont le point de départ et le point
d’arrivée sont les mêmes ? Auquel cas, l’animalité en l’homme qui induit la violence est
celle qui empêche toute évolution vers un monde moral, dont les rapports sociaux
seraient dans une vision absolue sans violence.
Néanmoins, l’emploi de la comparaison plutôt que de la métaphore dans cet
extrait de Drieu permet de rester dans la sphère humaine, de ne pas franchir la barrière,
de ne pas entrer pleinement dans l’animalité. Ainsi, l’état « animal » de l’homme ne
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!383 Ibid. 384 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 64.
! ! ! ! !
! !
170!
serait que transitoire, le cri de bête ne serait que le prolongement vers l’extérieur d’une
peur viscérale, l’expression d’une terreur enfouie qui se manifesterait en cri. L’état
animal de l’homme, au même titre que sa primitivité en guerre serait la manifestation de
restes ataviques latents, que le contact de la violence permettrait de libérer.
La thématique du troupeau, ou du mouton, s’inscrit dans un discours globalisant
qui curieusement fait du narrateur – dans ce cas mis en scène par un auteur ayant
participé à la guerre – un narrateur extradiégétique. C’est le cas chez Gabriel Chevallier,
dont le narrateur avoue : « Les hommes sont des moutons. Ce qui rend possible les
armées et les guerres. Ils meurent victimes de leur stupide docilité385 » ; ici le narrateur
de La Peur semble s’extraire de l’espèce humaine qu’il analyse. L’emploi du pronom
« ils » le distancie clairement de son sujet d’analyse. Ce qui porte à ambiguïté, car de
quel troupeau se distingue-t-il ? De la troupe, du bataillon, rassemblement d’hommes qui
malgré leurs peurs continuent de se battre ou du troupeau de bêtes, réunies sous la
bannière de la docilité aveugle ?
Pour suppléer à cette ambivalence, à savoir laquelle de la voix animale ou de la
voix humaine domine, d’autres auteurs ont choisi un narrateur pleinement – mais cela
est-il vraiment possible ? – animal.
Rateries
« Je ne suis pas un rat d’opéra ; n’attendez pas de moi des récits polissons ni des
contes égrillards […]. Né dans les camps, j’ai connu, dès l’âge le plus tendre, le tumulte
des champs de bataille ; mes parents m’ont nourri d’espoirs glorieux et de détritus
militaires. Vous avez déjà deviné que l’auteur de ces lignes est un de ces innombrables !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!385 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 19.
! ! ! ! !
! !
171!
rats de tranchées qui, de la mer aux Vosges, ont juré de tenir, eux aussi, « jusqu’au
bout ! »386 ». Voici l’incipit de l’œuvre de Pierre Chaine, Les Mémoires d’un rat.
Ferdinand, dès le début, prend la parole et ce tout au long du récit. À aucun moment le
narrateur ne change. Dans le récit de Chaine, la double structure oxymorique
fréquemment identifiée dans les fables est présente ici dès le titre : en effet, qui est cet
animal qui écrit ses mémoires ? La distanciation « vision haute /vision basse » (que l’on
retrouve là aussi dans la plupart des fables de La Fontaine ou d’Ésope) qui oppose une
« intelligence supérieure et une intelligence plus modeste » est incarnée dans l’œuvre de
Chaine par une différenciation d’espèce. L’écriture de mémoires, propre à l’homme, ne
conviendrait normalement pas à l’espèce animale personnifiée par le rat Ferdinand.
L’écriture tout court d’ailleurs. Or le texte de Chaine convainc son lecteur de la
« normalité » d’une improbable réalité387. La structure du récit est celle d’un récit
« humain » si l’on peut dire, la voix reste humaine et le schéma narratif reste plutôt
banal. C’est tout du moins ce qu’il paraitrait à la première lecture. L’état initial (état
d’équilibre) de Ferdinand est celui d’un rat, et la guerre interviendra comme chez
n’importe quel soldat (et soldat-écrivain) comme élément déclencheur de la rupture de
cet état d’équilibre. Ainsi, la structure du roman de tranchées – mobilisation, guerre au
front, retour parfois à l’arrière-front puis à nouveau au front, et pour certains, fin de la
guerre qui constitue la situation finale d’énonciation – est la même dans le récit de
Chaine. Si ce n’est que parallèlement à cette structure s’établit un changement dans la
vie de Ferdinand.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!386 Pierre Chaine, op. cit., p. 13. 387 Ceci est précisément la technique maîtresse de Kafka dans La Métamorphose (1915).
! ! ! ! !
! !
172!
Ferdinand est certes un rat mais sa différenciation d’avec l’espèce humaine, son
opposition de facto va se réduire lorsqu’il est nommé, Ferdinand, et lorsqu’il est vêtu,
concrètement et symboliquement, de l’habit du poilu : narrateur fabuleux, Ferdinand
endosse progressivement les attributs d’un narrateur vraisemblable.
Dire la guerre : se mettre à nu ?
Qu’est-ce que l’animal permet de dire de ce que l’homme ne sait pas dire ? Bien
souvent, persiste l’idée que l’écriture de ce qui semble indicible est une façon de se
mettre à nu. Dire l’indicible – les souffrances de la guerre – constituerait d’autant plus
une mise à nu devant un lecteur ou devant les siens qui « n’imaginaient pas que ça
pouvait être comme ça la guerre388 ». Une mise à nu donc qui dévoilerait de manière trop
crue la primitivité des sentiments, des ressentis, du corps en action différent du corps
pensant, du corps souillé, fatigué, meurtri. C’est en cela que réside l’ambiguïté du
discours de soi qui à la fois déshabille et pourtant déguise, habille l’âpreté du vécu, par
de la pudeur (de l’enrobage ?) ou parfois au contraire par de la très grande laideur : dans
ce dernier cas, il s’agit d’une mise en scène par le biais d’une multiplication de
descriptions obscènes comme dans le cas de l’œuvre plusieurs fois évoquée de Jean
Giono389.
Comment l’œuvre de Pierre Chaine et son discours sur la guerre se situent-ils au
sein de cette question du témoignage et de la mise à nu ? L’auteur substitue au langage
direct, humain, celui de son protagoniste rat, Ferdinand. Or des animaux, Derrida nous
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!388 Sur ce sujet, cf. chapitre I. 389 C’est tout du moins ce qu’affirme Pierre Schoentjes in Fictions, éd. cit.
! ! ! ! !
! !
173!
dit qu’on croirait abusivement qu’ils sont « nus sans le savoir390 ». Une substitution de
voix narrative liée à de la pudeur alors ? Proposer un narrateur « nu par nature » comme
pour s’éviter à soi de se déshabiller par le langage ? Cependant Dérida affirme par
ailleurs que l’animal ne peut être véritablement nu ; car, en effet, comment l’être si l’on
n’a « jamais songé à se vêtir391 » ? En voulant proposer une autre véracité, plus « vraie »
que celle qu’il aurait pensé offrir en faisant le choix d’un narrateur humain, une vérité
distante du langage « humain » (c’est-à-dire langage pensé, pensant, analytique) Pierre
Chaine cherche à se soustraire à tout soupçon de fabulation392. Mais plus le récit avance,
plus il a cependant du mal à s’écarter d’un discours philosophique propre à l’humain.
Certes, le rat nous dit « On ne retrouvera pas sous ma plume l’héroïsme souriant et
bavard des « récits du front393 » ». Mais il est on ne peut plus humain : il pense et
philosophe et, qui plus est il est habillé. « Je pus alors constater dans la glace que ma
robe gris-brun était devenue bleu horizon394 », affirme-t-il. Juvenet ira même jusqu’à
compléter l’uniforme de Ferdinand en inscrivant sur son dos le numéro du régiment :
« J’étais immatriculé ! j’étais soldat ! il me sembla que je devenais un autre rat. Je
n’éprouvais plus qu’une pitié arrogante pour les vulgaires rongeurs dont la vie ou la
mort importait peu au salut de la patrie395. »
Or l’intention a priori qui semble diriger la volonté de substituer la voix animale
à la voix humaine est que le narrateur parlera plus librement. Mais alors que Ferdinand
commence tout juste à parler (en ce sens que nous sommes au début du récit), voilà que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!390 Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, Paris, Galilée, 2006, p. 19. 391 Ibid. 392 Je pense ici à la question de la véracité du discours qui a beaucoup inquiété Jean Norton Cru. Cf. Jean Norton Cru, Témoins. Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928, Paris, Editions Les Etincelles, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2006 [1929]. 393 Pierre Chaine, op. cit., p. 15. 394 Ibid., p. 42. 395 Ibid.
! ! ! ! !
! !
174!
son maître l’habille ! Il l’habille des couleurs du régiment pour en faire un rat soldat. Un
rat vêtu de l’habit règlementaire, d’un uniforme. Uniformité de la voix narrative ? Peut-
être pas, mais d’une voix qui diffère finalement peu des écrits de guerre à la première
personne (humaine c’est-à-dire). Aussi faut-il chercher une modification de point de vue
et donc une spécificité à la voix animale ailleurs que dans l’apparent conformisme de
Ferdinand.
Les tranchées à vue de nez
L’intérêt que présente un narrateur de petite taille, personnifié sous la forme d’un
rat, réside dans ce que sa condition physiologique offre une représentation singulière de
la vie de tranchées. Physiquement, la perception qu’il a du champ de bataille diffère de
ce qu’un homme pourrait voir et relater. La distance de ce qui est vu / perçu change par
rapport à ce qui est retranscrit.
C’est en effet le rat qui voit la tranchée, à hauteur non plus d’homme mais de rat.
Les distances sont donc proportionnellement réduites, les sens modifiés396. On suit la
narration en fonction des sensations perçues par le rat, sensations qui ne cesseront d’être
modifiées en cherchant à coller aux sensations humaines – mimétisme du rat et de son
propriétaire Juvenet – car le rat cherche paradoxalement à s’humaniser. Ainsi, quelle
contrainte narrative la physiologie du rat impose-t-elle à Chaine ? Est-ce un
rétrécissement du monde que la narration nous propose ? Il est certain que le jeu des
échelles importe dans la narration bien que nous puissions argumenter qu’une vue
d’ensemble soit plus appropriée pour juger la guerre qu’une réduction d’échelle. Mais la
petitesse du rat permet de mettre en lumière, par opposition, l’angoisse de l’homme et !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!396 Notons le lien entre « modification » et « métamorphose ».
! ! ! ! !
! !
175!
son impuissance face à l’écrasante machine de guerre. Sa petite taille lui est enviée car
Ferdinand est plus à même de se cacher et donc de se préserver des bombardements. Lui
même affirme : « À cause de la petitesse de ma taille qui diminue sur moi la zone
dangereuse, je crus pouvoir abaisser le facteur des risques en ma faveur et mettre ma vie
à quatre contre un397 ». Mais ce dernier rappelle que l’échelle est toute relative et que la
taille n’empêche pas la peur : « Chacun courbait le dos sous l’avalanche, m’enviant
d’être un rat tandis que j’aurais préféré être une puce398 ». Poussée à l’extrême, la
réduction d’échelle à terme implique la disparition du visible : le soldat ne serait alors
plus une proie accessible. Ainsi, rapetisser deviendrait le pendant verbal de l’action à
proprement parler qui consiste à se mettre dans un trou399. Or, alors que le rat pourrait
profiter du bénéfice sécuritaire que lui offre sa taille, ce à quoi il aspire, c’est justement à
sortir de l’ombre.
De l’égout à la lumière
Le rat narrateur dans l’œuvre de Chaine évolue au cours du récit suivant une
progression qu’il me semble intéressante d’analyser. Alors que traditionnellement, le rat,
animal souterrain, représente l’univers d’en bas (voire de l’en-deçà suggéré par Nicolas
Beaupré), naissant et vivant en effet le plus souvent dans un trou, creusant terriers et
galeries, Ferdinand commence sa vie et son récit, dans un univers sinon de lumière, tout
du moins de clair-obscur. La situation initiale du récit suggère déjà que Ferdinand est
voué à un destin spécial : « […] je puis désigner exactement l’endroit où je vis le jour :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!397 Ibid., p. 90. 398 Ibid., p. 97. 399 Sur cette même thématique, cf. Kafka, Le Terrier (1923), qui raconte l’histoire d’un petit animal, narrateur à voix humaine, creusant un royaume de galeries souterraines dans lesquelles il se terre et se cache.
! ! ! ! !
! !
176!
c’était dans le plafond en rondins de l’abri d’un capitaine […]. Notre nid était installé au
deuxième étage et nous n’avions plus qu’un rang de rondin au dessus de notre tête400 ».
Sa naissance est une mise à jour, à la fois formelle et textuelle et se prolonge tout au
long du récit. L’espace occupé par la lumière est cependant partiel et Ferdinand nous
rappelle, ne brusquons pas la temporalité narrative, qu’un rat vit tout de même dans des
espaces confinés, réduits, étroits : « Les boyaux débouchaient sur une grande esplanade
en carton bitumé […] ». Mais tout de suite, la description s’ouvre sur un champ de
vision plus vaste, une « grande esplanade », terrain de jeu des petits rats. Sa capacité à
élargir le spectre de son environnement va suivre tout le récit, introduction métaphorique
de sa capacité future à juger de la nature humaine ; Ferdinand pense, il est même très
lucide.
À l’instar d’un personnage de fable, Ferdinand entre dans le récit dans un état et
en ressort modifié. Il change, et ce, comme son maître, avec la guerre. Il y a donc bien,
comme dans une fable, un élément déclencheur de mutation – et non pas de
métamorphose, j’insiste - à la fois dans l’attitude du rat mais aussi dans sa capacité à
percevoir le monde qui l’entoure. Mais ces mouvements du rat et du maître, bien que
parallèles, sont cependant contraires. Évolution pour l’un, repli sur soi pour l’autre,
accession au savoir humain pour l’un, plongée dans les ténèbres pour l’autre.
À ce titre, les jeux de lumières sont primordiaux dans le récit de Chaine. Le rat
sort de son trou et devient clairvoyant et l’homme clairvoyant, perspicace, philosophe,
entre dans un monde souterrain à double titre : physiquement et en termes cognitifs
(guerre nouvelle celle des tranchées, guerre d’inaction, ensauvagement [le brutalization
de Moss]-). Au début du récit, Ferdinand décrit son enfermement dans la cage de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!400 Pierre Chaine, op. cit., p. 19.
! ! ! ! !
! !
177!
Juvenet comme une aliénation, pourtant garante de sa survie : « J’avais pris l’habitude
des espaces restreints et le goût du renoncement à soi-même qui était la rançon de mon
insoucieuse sécurité401 ». Parallèlement au rapport qui unit au départ le prisonnier puis le
compagnon et son maître, le texte de Chaine analyse la question de l’enfermement du
corps dans un espace sans issues.
En effet, Chaine fait sortir le rat de l’ombre, du monde souterrain, des ténèbres et
lui fait faire le mouvement inverse de ceux des soldats. Nous lecteurs, assistons à un
processus de renversement qui, s’il paraît relativement aisé à voir, renferme un autre
niveau d’analyse. Car en effet, l’intérêt de Chaine est-il vraiment de laisser la place au
discours de l’animal, au « je » du rat, à cette « zootobiographie » dont parle Derrida402 ?
Pas uniquement. Car comme le dit Derrida, toujours, « L’affabulation, on en connaît
l’histoire, reste un apprivoisement anthropomorphique, un assujettissement moralisateur,
une domestication. Toujours un discours de l’homme ; sur l’homme ; voire sur
l’animalité de l’homme, mais pour l’homme, et en l’homme403 ». S’il s’agit de placer le
rat au centre, c’est peut-être pour chasser de ce même centre – auto-humanocentré –
l’humain à qui les fondements, raisons d’être, ici et après, échappent. L’humain est
déchu de sa place – en raison des événements et par l’écriture – et son humanité qui le
fuit l’envoie – ou renvoie ? – à une animalité, symbolisée ici par le rat. Si l’homme ne
peut plus parler – mutisme violemment imposé -, ne peut plus créer, ne peut plus
empêcher, alors l’animal parlera pour dire ce que l’homme ne sait plus / peut plus
formuler : l’horreur, la déchéance, l’absurde.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!401 Ibid., p. 51. 402 Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, Galilée, Paris, 2006, 57. 403 Jacques Derrida, op. cit., p. 60.
! ! ! ! !
! !
178!
Ce qui apparaît comme une absence de réalisme dans le récit de Chaine – à
savoir l’utilisation d’une voix narrative animale – a pour but semble-t-il de renforcer la
véracité du propos humain sur la guerre. L’on assiste à deux mouvements contraires :
d’un côté une mise à nu, que l’ « autre, animal », effectue pour soi et par soi ; de l’autre
une mise à distance verbalisée par un verbe qui n’appartient que partiellement à
l’homme (puisqu’il est langage) mais qui sort de la « bouche » de l’animal. La mise à
distance est confirmée dans le récit quand, lors du dénouement, Ferdinand nous apprend
qu’il n’a pas « écrit » ses mémoires au front : « À l’heure où j’écris ces lignes, le canon
continue de gronder sur le champ de bataille. Mais la guerre est finie pour moi404 ».
C’est loin du front que le rat peut penser et écrire. Ainsi Chaine met en avant la question
de la neutralité dans l’écriture et conclut son ouvrage sur une note profondément
ironique : le rat est devenu plus patriote que les hommes qu’il a côtoyés : « Maintenant
que j’assiste à la guerre de plus haut, je partage avec mes collègues l’opinion que la
conduite en est molle et décousue405 ». Le jugement sur la guerre affirme Chaine
n’appartiendrait donc pas au ressenti de l’immédiateté mais serait possible uniquement
dans la distance406. Si le rat semble épris de sentiments humanistes et pacifiques alors
qu’il est au front, son opinion diffère lorsqu’il n’en est plus soumis à la violence directe.
Chaine propose donc un texte sur la question fondamentale de la mémoire et du
témoignage, mais aussi de l’oubli du traumatisme : loin des massacres, l’homme a
tendance à gloser. Et bien sûr à oublier qu’en guerre, il a pu être animal.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!404 Pierre Chaine, op. cit., p. 107. 405 Pierre Chaine, op. cit., p. 109. 406 Bien que le rat passe d’un espace à l’autre, il conserve le moi parlant qui renforce son ipséité discursive.
! ! ! ! !
! !
179!
Le rat comme narrateur se retrouve aussi chez Pierre Mac Orlan. Le rapport
homme / rat est basé sur un rapport de confrontation de deux espèces. Dans le cas de
Pierre Mac Orlan, l’auteur introduit la thématique des rats par un procédé mimétique.
Alors que la guerre des hommes débute par une mobilisation, il en est de même pour les
rats. Cela permet ainsi de donner à « l’invasion » des rats une dynamique volontariste,
qui leur est propre et qui répond à la logique rationnelle de mener campagne contre les
hommes. Le rat est ainsi mis sur un pied d’égalité avec l’espèce humaine, les deux
groupes peuvent donc commencer de s’observer mutuellement dans un objectif de
critique morale et sociale réciproque.
Dans un chapitre intitulé « Conseil d’un rat à son fils407 » le narrateur raconte le
combat des hommes contre les rats. Mais l’incapacité des hommes à éradiquer les
rongeurs fait dire au narrateur que les rats sont dotés d’une intelligence…humaine. À ce
stade de la narration commence un processus de personnification qui se poursuit au
chapitre suivant où là, l’auteur utilise le même procédé que dans l’œuvre de Pierre
Chaine : un rat prend la parole. Dans la conversation qui occupe le papa rat à son fils,
papa rat explique la faiblesse des hommes. « Tu verras que notre petitesse est l’essence
même de notre puissance. L’homme est beaucoup trop grand, beaucoup trop fort pour
s’attaquer à nous408 ». L’on remarque la possible mise en parallèle avec le texte de
Chaine quant au rapport de taille qui oppose narrateur animal et homme au front. Ici
c’est l’inutilité de la force humaine face à l’intelligence de la nature qui est soulignée.
L’homme est « un pauvre géant sans malice409 » et il « est de tous les êtres vivants le
plus facile à déconcerter. (…) Une éducation tendancieuse et beaucoup trop restreinte lui
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!407 Pierre Mac Orlan, op. cit. p. 98. 408 Ibid. p. 100. 409 Ibid. p. 101.
! ! ! ! !
! !
180!
donne, dès l’adolescence, une confiance exagérée dans ses facultés, sa puissance et son
adresse410 ». Cette raillerie à l’égard des hommes, énoncée d’un point de vue extérieur
sert une argumentation philosophique sur la destinée de l’humanité et
vraisemblablement sur l’absurdité de la guerre. Dans le cas de l’emploi de la force,
résultant ici à de fortes pertes en vies humaines, la force physique, selon le narrateur,
dessert l’homme. Elle ne lui est d’aucune utilité puisqu’elle le voue à sa propre fin. Ici,
le point de vue de René Girard411, quoique discutable quant à la dialectique adoptée pour
sa démonstration, se rapproche de cette énonciation. La guerre, dans sa dynamique de
rivalité mimétique, porte un elle la fin apocalyptique du monde. Le « pauvre géant sans
malice » s’autodétruira dans le désir d’obtenir chez autrui ce qu’il ne pourra que
posséder par la violence.
La fin de ce chapitre se termine sur une note délicieusement abjecte : « La guerre
des hommes, en détruisant nos greniers, nous oblige à vivre dans les champs avec les
mulots nos cousins. Il faut accepter la volonté du Tout-Puissant. Ne te désole pas. Sous
la clarté d’argent de la lune, je vois luire, derrière les fils de fer que les hommes ont
tendus, les formes gonflées d’une corne d’abondance d’où s’échappe jusqu’à l’infini une
provende intarissable412 ». Alors que dans le récit de Mac Orlan, les hommes forcent les
rats à la mixité sociale413, par leur propre destruction ils offrent à ces derniers de quoi
manger. Les cadavres humains profiteront à une autre espèce, animale. Le retournement
dialectique (les rats qui se mettent à parler et à penser) permet de mettre à nu le danger
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!410 Ibid. 411 In Girard, René, Achever Clausewitz, Paris, Carnets Nord, 2007 412 Pierre Mac Orlan, op. cit., p. 106. 413 Il est intéressant de constater que chez Mac Orlan, il y a une volonté de rapprocher les espèces dans l’espace narratif, là où d’autres auteurs tendent à vouloir clairement séparer monde animal et monde humain.
! ! ! ! !
! !
181!
premier que constituerait alors la guerre, et je crois que ce point est fondamental :
l’annihilation de l’humain par lui-même.
Puissance animale, rivalités mimétiques
Les récits de Pierre Chaine et Mac Orlan relèguent l’homme à une place d’acteur
de second rang. Certes il est toujours présent dans le champ narratif, mais ses actions ne
prédominent pas, ne sont pas le moteur du récit. Le dynamisme de la narration n’est pas
porté par le poilu qui raconte l’histoire de manière intradiégétique mais par un animal
narrateur (dans le cas de Chaine et partiellement dans celui de Mac Orlan) ou par la mise
sur un pied d’égalité entre protagoniste humain et protagoniste animal dans le cas de
Pierre Mac Orlan. Dans ces deux cas, le discours supprime peu à peu l’homme du récit,
par procédé de substitution. Le nouveau point de vue est dominé par l’animal ou tout du
moins par ce que la narration confère à la voix animale.
C’est justement le texte de Mac Orlan qui aborde de manière la plus ambiguë
mais la plus éloquente le rapport homme-animal dans la guerre. La particularité du
roman, à la différence de celui de Pierre Chaine, est que rats et hommes sont en constant
conflit, et qu’en changeant à plusieurs reprises de narrateur, et donc de point de vue,
Mac Orlan offre deux perspectives, celle des rats sur les hommes et inversement ; c’est
d’ailleurs ce qui constitue une partie du moteur narratif et ce jusqu’au dénouement. Ce
rapport de force qui oppose les poilus et les rats pose la question de la domination, à
terme, d’une espèce sur l’autre. Car le conflit qui les oppose est un conflit jusqu’à la
mort.
! ! ! ! !
! !
182!
L’introduction des rats dans le texte est progressive et la transition d’un narrateur
à un autre se fait en passant de l’homme au rat. La transition s’effectue par effet miroir
bien qu’en supprimant le caractère animal du rat : son anthropomorphisation est telle
qu’il finit par être considéré comme un semblable. Le chapitre intitulé « La cité des
rats », que nous avons déjà mentionné, consiste en un récit de bataille à l’intérieur du
récit de guerre proprement dit, mise en abîme des scènes de batailles et de la guerre
contre les rats qui est évoquée tour à tour comme une « Saint-Barthélemy414 » puis
comme une chasse : « Un cri aussi aigu que leurs dents redoutables annonçait au
chasseur que l’âme de son ennemi venait d’abandonner sa trop faible enveloppe415 ».
Les adversaires, d’un côté le bataillon des poilus, de l’autre la « république416 » des rats,
se font face et la bataille qu’ils mènent vise à la domination d’une espèce par l’autre; il
s’agit en effet d’éradiquer les rats. Cependant considérer l’organisation des rats comme
sociale, et plus particulièrement comme une république consiste à leur conférer une
importance d’un ordre certain : les muridés ont passé le cap d’une des différenciations
primordiales entre hommes et animaux. Deux « réalités » distinctes se trouvent
assimilées par l’usage d’un vocabulaire commun, d’un champ sémantique commun. Le
langage chez Mac Orlan ne cherche plus à diversifier, mais à fusionner, quoique la
fusion s’arrête dans le choix d’un animal nuisible et dans le combat qui est mené contre
ce dernier : les qualificatifs humains qui lui sont associés sont péjoratifs.
Cette technique narrative où l’ennemi officiel, en l’occurrence le soldat
allemand, est remplacé par un nuisible, suggère une substitution d’une espèce – humaine
– par une autre – animale. Mais s’il paraît évident que le conflit hommes / rats fait écho
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!414 Pierre Mac Orlan, op. cit., p. 86. 415 Ibid., p. 87. 416 Ibid., p. 85.
! ! ! ! !
! !
183!
à la guerre qui se joue, le parallèle ainsi créé ne hiérarchise pas les deux différentes
espèces en présence. « Ce gros dégoûtant-là, dont la queue traîne sur le sol comme un
lombric malade, nous le connaissons bien. Il possède l’art de prendre les gens pour des
imbéciles […]417 ». Le rat possède l’art de, il est donc l’égal de l’homme qui tente tant
bien que mal de mettre en œuvre son art de la guerre. De plus l’homme qui chasse le rat
est témoin de l’abandon de l’âme du corps de son ennemi. Il confère à l’animal ce qui lui
est propre, annihilant la barrière d’ordinaire crée par l’affirmation courante qui consiste
à dénuer les animaux d’âme. Or, le « gros dégoûtant » devient le « gars » qui est « là,
dans la cour, à côté de la mare ; son petit dos râblé et légèrement pelé, absorbe
béatement les pâles rayons d’un soleil d’hiver 418 ». Non seulement le « sinistre
personnage sait » puis « ricane dans sa moustache », mais il « pense419 ». Intervient alors
curieusement dans le récit de Mac Orlan une intentionnalité animale, ce qui entre une
nouvelle fois en contradiction avec ce que l’on confère communément à l’animal.
Andréa Potestà rappelle en effet à ce sujet : « L’animal n’a pas un agir intentionnel, cela
veut dire qu’il n’a qu’un monde environnant circonscrit, défini en fonction de l’instinct
vital qui le pousse seulement à discerner la survie de la mort420 ». Le discours de Mac
Orlan par conséquent renforce la mise sur un pied d’égalité du soldat et du rat : ce
dernier a même le don « d’une ubiquité prodigieuse421 » qui empêche d’ailleurs les
poilus de l’attraper et de le tuer. Un soldat suggère alors d’utiliser l’artillerie lourde. Et
c’est alors qu’un « miaulement caractéristique se rapproche, se rapproche et cependant
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!417 Ibid., p. 93. 418 Ibid., p. 93. 419 Ibid., p. 94. 420 Andréa Potestà, « De l’inutile. Formes animales », Le Portique [en ligne], 23-24 | 2009, document 2, mis en ligne le 28 septembre 2011, consulté le 27 janvier 2013. URL : http://leportique.revues.org/index2428.html 421 Pierre Mac Orlan, op. cit, p. 96.
! ! ! ! !
! !
184!
que l’obus éclate, fume, détruit un pan de mur et empeste la cour, nous nous lançons
comme des bolides, dans l’ouverture béante de la porte de la cave. […]. – Il n’a pas
éclaté bien loin, dit Alfred. Un grattement familier lui répond […]. Il est là422 ». La
présence du rat est mise en parallèle avec celle du danger constant des obus et elle
rivalise avec celle de l’ennemi. Mais c’est le rat qui domine la scène, dans la mesure où
les poilus échappent de peu à l’obus, parce qu’ils sont focalisés sur la chasse au rat.
Dans le cadre des récits où du début à la fin, la présence de l’animalité supplante
la présence humaine, comme c’est le cas dans l’œuvre de Pierre Chaine – c’est tout du
moins le cas le plus évident – il s’agit de savoir si cette domination du discours concorde
ou tout du moins potentiellement annonce la mort, pour l’instant de manière figurée, de
l’humanité. En effet, dans son ouvrage L’Ouvert, Giorgio Agamben suggère l’idée
suivante : « L’anéantissement définitif de l’homme au sens propre doit […]
nécessairement impliquer aussi la disparition du langage humain […]423 ». L’on pourrait
donc penser que la disparition, dans l’écriture, de celui qui combat et qui témoigne de
l’expérience du front, remplacé par un autre témoin, inattendu et normalement sans
parole, permet de palier la disparition, ou tout du moins ressentie comme telle, de ce qui
constitue l’humain. Tout dépend en réalité du choix de l’animal utilisé pour soutenir la
narration, en fonction de ce qu’il est l’objet d’une subjectivation négative ou positive 424.
Dans les deux cas, c’est cette subjectivation – fortement liée à l’anthropomorphisation
quand la narration s’adresse à l’animal et animalisation de l’homme quand le discours !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!422 Ibid., p. 97. 423 Giorgio Agamben, L’Ouvert, éd. cit., p. 20. 424 J’emprunte l’expression à Catherine Rémy in « Une mise à mort industrielle ‘humaine’ ? L’abattoir ou l’impossible objectivation des animaux », Politix, vol. 16, n° 64, Quatrième trimestre 2003, pp. 51-73. Catherine Rémy explique que la subjectivation positive implique que l’animal en question soit perçu de manière positive (l’animal compagnon que nous avons mentionné plus haut) et inversement, la subjectivation négative met en lien l’homme avec un animal nuisible, négatif et par conséquent implique un rapport violent.
! ! ! ! !
! !
185!
part du prétendu point de vue animal – qui entraîne, au choix, compassion ou haine de
soi, réponse de cet homme qui se regarde sans être capable de comprendre comment et
pourquoi il est capable d’une telle violence.
! ! ! ! !
! ! ! 186!
Épilogue Blessures animales, morts, boucherie : préludes littéraires à la mort de l’homme.
Dans la boue et dans le sang, sur la terre grise,
un vieux cheval agonise et lance à chaque passant
l'appel désespéré d'un regard impuissant (...)
« Le cheval tué » in Jean Arbousset, Le Livre de « Quinze Grammes », Caporal, Paris, Crès, 1917.
Une étude de la représentation du bestiaire animal nous amène à nous interroger
sur un cliché fréquemment utilisé par les auteurs, celui de la guerre comme boucherie.
Si, comme nous l’avons vu, l’animal et son bestiaire prennent le pas sur l’homme
narrateur – chez Chaine et Mac Orlan par exemple –, étouffant la voix humaine, il
semble que la destruction de l’image animale – c’est-à-dire la mort de l’animal – puisse
constituer une sorte de prélude à la mort de l’homme. En effet, mort littéraire mais aussi
mort philosophique. Mettre en relief l’animal en guerre, et plus particulièrement
l’animal blessé et / ou mort, semble être une nouvelle technique de substitution
narrative : quid pro quo, la mise en scène de l’anéantissement de l’animal n’est autre que
l’annonce de l’anéantissement de l’homme. Ainsi, l’animal trouvera son dû lorsque lui
sera offert le rôle titre, celui du narrateur principal. Le seuil de l’animalité traversé voire
transgressé, comme nous venons de le voir, la confusion animal / humain, confusion des
voix narratives mais aussi des représentations, autorise un renversement, un jeu sur les
images. Ainsi, parler de la mort à la guerre en tant que boucherie après avoir
narrativement assumé la confusion des niveaux (animaux et humains) ne relève pas
nécessairement alors d’un poncif mais contribue à suggérer une réflexion sur les limites
de l’humain, et sur la production poétique, artistique, en temps de guerre.
! ! ! ! !
! ! !
187!
Les textes choisis présentent souvent la même particularité, à savoir un
« tremblement », une hésitation dans le discours entre le choix d’une voix animale ou
celui d’une voix humaine. Cette difficulté à garder de manière constante une
représentation, soit totalement animale, soit totalement humaine, souligne la crainte
sous-jacente que l’humanité en guerre va inconditionnellement à sa perte.
Dans les pages qui suivent, j’analyserai dans un premier temps des descriptions
d’animaux blessés ou morts. Je considèrerai ensuite les représentations du champ de
bataille comme territoire de chasse et comme grand abattoir. En effet, la grande question
que pose la mort brutale et l’éclatement, puis la disparition des corps est celle de la
transformation en une matière autre : une chair tellement à nu que l’on finit par imaginer
une viande de boucherie. Pour parvenir à cette image, les auteurs que nous considérons
utilisent l’artifice technique de la description de la mort animale ou tout du moins de
l’analogie entre mort des soldats et mort animale.
Animaux blessés
L’un des textes les plus émouvants dans l’exposition de la blessure animale est
probablement celui de Maurice Genevoix. « Les grands yeux troubles me regardent,
voilés parfois d’un lent clignement. Il flotte dans leur eau profonde un infini de stupeur
triste425 ». La synecdoque laisse de côté l’aspect purement animal du cheval et renforce
l’anthropomorphisation de la bête, corroborée par l’adjectif « triste ». L’humanité du
cheval est palpable et le choix des yeux n’est pas anodin : c’est par le regard que
s’échange et se noue le lien émotionnel, la compassion. L’animal n’est plus objectivé, et!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!425 Maurice Genevoix, Nuit de Guerre, éd. cit., p. 321.
! ! ! ! !
! ! !
188!
est donc mis à distance, de manière éphémère : il s’agit d’une distance fictive,
momentanée, qui permet la réappropriation du ressenti par le narrateur humain. Ainsi,
c’est grâce au medium du regard que la narration peut s’ouvrir sur le constat du mauvais
traitement :
Oui, je comprends : tu es un vieux cheval très las. L’abri que te donnaient tes maîtres, chaque soir, en récompense de ton labeur du jour, tu ne l’as plus, ni le râtelier plein de foin, ni la musette gonflée d’avoine. Tu es devenu si maigre que tes os crèvent ta peau. Tu as eu si peur, tant de fois, que tes genoux ne cessent de trembler. Et cela dure. Et qu’à la fin ceux de là-bas te tuent, cela, n’est-ce pas, t’est bien égal ?...426 . Ici le terme « avoine », aliment d’une bête qui travaille, est l’un des derniers de
ce passage qui implique un lien direct à l’animalité. L’ambiguïté s’insinue dans le récit
alors que sujet animal et sujet humain peuvent à présent aisément se confondre.
L’animal sert par conséquent d’accroche à la transposition du discours humain, il est
porte-voix, mais aussi « porte-corps ». La forme humaine (autre manifestation que nous
avons vue dans le rapport du poilu à la boue) transparaît sous la peau de l’animal,
épousant ses contours. Sa surface, sa silhouette, et plus profondément son étant, se
perdent dans les contours du corps humain. La souffrance animale, et plus
particulièrement la blessure de la bête ouvrent alors la voie à la blessure humaine. Ce qui
caractérise le cheval en tant qu’équidé, se fond en partie avec ce qui caractérise
l’anatomie humaine ; l’avantage de la nomination des parties du corps équin est que le
cheval et l’homme partagent des dénominations communes : pieds ou genoux par
exemple. Le cheval est débarrassé de son corps, du traumatisme qui affecte le corps et
fait trembler les genoux, tremblements sur lesquels Genevoix insiste en disant qu’ils
durent. Cheval et soldat partagent ce tremblement, tremblement qui évoque l’incertitude
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!426 Ibid.
! ! ! ! !
! ! !
189!
de la voix narrative, non pas dans le propos en lui même qui clairement évoque la peur,
la fatigue, mais dans la paternité du propos.
Le tremblement des genoux de l’animal accompagne la vacillation de la voix
narrative, le mouvement infligé par l’incertitude, le doute sur qui ou quoi parle. Certes,
l’on aurait pu partir du constat inverse et affirmer que c’est le cheval qui se pare du
traumatisme du soldat, de sa psyché blessée. Mais comme nous l’avons mentionné
précédemment, le cheval disparaît rapidement de la narration. Cette disparition soudaine
qui affecte également le récit d’Élie Faure quand il s’agit du corbeau Baptiste, ouvre une
porte à l’interprétation du non-dit : il s’agit en effet de revenir au témoignage humain de
l’expérience de guerre. Le regard que propose le narrateur sur la souffrance animale
autorise en retour – parce que ce regard n’est pas limité, qu’il est l’ouverture sur l’autre
mais fondamentalement sur soi en ce qu’il implique une notion de va-et-vient – le regard
de l’animal sur l’humain, et c’est ce retour du regard, effet miroir, qui engendre la
compassion face à l’insupportable.
Chasse et boucherie
La mort de l’animal comme thème inscrit dans l’écriture de la guerre est restituée
suivant deux axes ou sous-thèmes : la chasse et la boucherie. La chasse entre dans une
longue tradition culturelle humaine mais, explique Wolfgang Sofsky, son objet a
évolué : « Depuis que les hommes ne sont plus uniquement chasseurs, ils ne chassent
plus les mammouths, les ours, les bisons ou les chevaux sauvages, mais d’autres
! ! ! ! !
! ! !
190!
hommes427 ». Le glissement chasse animale / chasse à l’homme s’effectue de fait
aisément dans le récit de guerre. Pourtant affirme-t-il, « il faut se garder de confondre ce
schéma avec celui d’un combat428 ». Or le personnage de Jerphanion dans « Prélude à
Verdun » affirme que « la chair écrabouillée, étant boche, rentre dans la catégorie
perdreau ou lapin de garenne429 ». Car ce que le texte crée, c’est un processus de
distanciation provoqué par l’image : passés au statut d’animaux cynégétiques, niés dans
leur humanité, les soldats d’en face sont moins difficiles à tuer. La vie humaine
conserverait alors dans le propos de l’auteur une supériorité sur la vie animale,
permettant, par assimilation d’idées et d’images, de transgresser l’interdit du meurtre.
Mais cette image de la chasse n’est pas seulement utilisée pour évoquer l’ennemi
comme proie. Gabriel Chevallier utilise cette métaphore et l’applique à son propre
camp : « Les hommes qui riaient ne furent plus qu’un gibier traqué, des animaux sans
dignité dont la carcasse n’agissait que par l’instinct430 ». Le poilu est traqué, c’est-à-dire
qu’il est réduit au statut de proie. L’homme devient otage de ses semblables et donc de
lui-même, d’une situation qu’il ne contrôle pas, sur laquelle il n’a aucune emprise : il
devient ainsi comme « l’animal » d’Heidegger uniquement mu par ses impulsions, son
instinct de survie. De surcroît, l’emploi du mot « carcasse », corps vidé de ses organes
vitaux, implique que non seulement la chair humaine a perdu de son humanité, puisque
son corps se transforme en corps animal, mais bien que toujours vivant, l’homme est
déjà mort, déjà condamné.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!427 Wolfgang Sofsky, Traité de la violence, éd. cit., p. 140. 428 Ibid., p. 141. 429 Jules Romains, Prélude, éd. cit., p. 71. 430 Gabriel Chevallier, op. cit., p 63.
! ! ! ! !
! ! !
191!
Pour Élie Faure, le monde animal reprendrait, dans une certaine mesure ses
droits, c’est au moins ce qu’autoriserait la guerre : « La chasse aux bêtes est fermée
pendant la chasse à l’homme, et la bête reprend son droit, puisque l’homme lui laisse le
pouvoir d’en disposer. Tandis qu’on détruit d’un côté, la vie monte, et tend à dominer
l’autre431 ». Une chasse en supplante une autre, comme si se renouvelaient de la sorte
des espèces animales auparavant traquées. Le monde moral n’a cependant pas gagné sur
le monde animal puisque toujours d’après Élie Faure, « il y a longtemps que le monde
moral se serait dévoré lui-même432 ». Ainsi la guerre apparaîtrait comme un événement
entraînant le rééquilibrage des forces et des mondes, le monde humain et moral d’un
côté et le monde animal de l’autre. Mais plus qu’un rééquilibrage, dans une perspective
humano-centrée, c’est la disparition du monde humain qu’impose la guerre. Cette
considération sur la guerre dans l’œuvre de Faure intervient à un moment du récit où le
narrateur circule à cheval,
par toutes ces campagnes, dans l’eau ruisselante d’automne où la dépouille des branches sature la boue des chemins, dans le silence de l’hiver que le bruit du canon souligne, dans la jeune puissance du printemps qui s’étire à son éveil jusqu’à l’extrémité des arbres, dans la pesanteur de l’été. Tout est comme un chœur qui s’enfle433.
Le tableau que le texte donne à voir est perçu non pas à hauteur d’homme, mais
de l’homme à cheval, du couple hybride, couple indécis, centaure qui analyse dans sa
dualité le monde qui l’environne. La présence du cheval, compagnon de chasse, permet
d’introduire d’autres animaux traditionnellement chassés et consécutivement, d’établir le
parallèle entre la chasse animale et la chasse à l’homme. Ainsi, la comparaison entre
chasse aux animaux et chasse à l’homme qui suit intervient alors que le point de vue de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!431 Élie Faure, op. cit., p. 123. 432 Ibid. 433 Ibid., p. 122.
! ! ! ! !
! ! !
192!
l’énonciation « surplombe » le monde animal : « Le pas ou le trot du cheval fait lever de
toute part des perdreaux, des faisans, des cailles, des lièvres434 ». Cette domination
uniquement induite par la situation d’énonciation est en réalité un mirage. Car sous les
pas des soldats, métaphoriquement, ce sont d’autres soldats qui sont « levés ».
Si le poilu est représenté comme figure cynégétique, alors qu’il est encore dans
l’espace du vivant, une fois mort, sa chair est assimilée à de la viande de boucherie.
Cette comparaison n’est pas une comparaison propre à la Première Guerre mondiale.
Elle apparaît déjà dans le chant XVI de L’Iliade435 où Homère compare Troyens et
Danaens au combat à des bouchers. Le texte est riche en métaphores rapprochant actes
guerriers et mises à mort d’animaux. Toujours dans le chant XVI, Homère décrit ainsi la
mise à mort de Thestôr :
Et Thestôr était affaissé sur le siège du char, l'esprit troublé ; et les rênes lui étaient tombées des mains. Patroklos le frappa de sa lance à la joue droite, et l'airain passa à travers les dents, et, comme il le ramenait, il arracha l'homme du char. Ainsi un homme, assis au faîte d'un haut rocher qui avance, à l'aide de l'hameçon brillant et de la ligne, attire un grand poisson hors de la mer. Christopher Coker, chercheur en sciences politiques spécialiste des conflits,
confirme que le champ de bataille lors des guerres antiques, notamment tel qu’il est
décrit dans le poème d’Homère, ressemblait à une boucherie et que le démembrement
des corps y était permanent436.
Certes, l’image de la boucherie dans les œuvres littéraires de la Première Guerre
mondiale est bien évidemment liée à l’ampleur des tueries. Elle participe de la
métaphore des troupes en troupeaux, qui lentement vont vers la mort. Ainsi, le narrateur
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!434 Ibid., p. 123. 435 « Et les lances aiguës, et les flèches ailées qui jaillissaient des nerfs s'enfonçaient autour de Kébrionès, et de lourds rochers brisaient les bouchers », traduction de Leconte de Lisle (1866), Chant XVI. 436 Christopher Coker, The Warrior Ethos, Military Culture and the War on Terror, New York, Routledge, 2007, p. 56.
! ! ! ! !
! ! !
193!
de La Peur avoue : « Nous hésitions entre une inutile révolte et une résignation de bêtes
à l’abattoir437 ». Mais il ne s’agit pas seulement d’évoquer la masse, dolente, de ces
hommes, victimes désignées. L’analogie entre soldats et bêtes d’abattoir renforce la
désacralisation du corps humain, utilisé comme « chaire à canon », masse informe
envoyée au feu. Une nouvelle fois l’individualité est rejetée au profit de la multitude, le
« je » est étouffé, supprimé par la « grande surcharge des corps438 » comme dirait
Foucault. Alors qu’une telle représentation inciterait le lecteur à se détacher
émotionnellement de l’humain, il semblerait que l’imagerie de la chair d’abattoir, dans
certains cas, suscite l’empathie éprouvée vis à vis des poilus contraints de se battre.
Or, si l’on s’arrête à la représentation purement carnée des corps des soldats, la
valeur de la vie humaine n’a pas l’importance qu’elle avait en temps de paix ; chair
humaine et chair animale n’entrent d’ordinaire jamais en compétition. L’une et l’autre
sont particulièrement distinctes, dans la mesure où la viande reste le propre de la bête de
boucherie, c’est-à-dire comestible. Cette dernière est monnayable, elle a valeur
économique sauf quand elle est avariée ou qu’il s’agit de charogne. À l’inverse, jamais
la chair humaine n’est monnayable, cessible pour un prix défini. Or justement, la guerre
rabaisse le corps humain à de la chair puis de la chair à de la viande. Ainsi, Chevallier
évoque « des viandes humaines rouges et violettes, pareilles à des viandes de boucherie
gâtées […]439 ». Plus loin, son narrateur souligne la multitude de cadavres « alignés,
entassés ! Il n’y avait qu’une expression pour traduire : on marchait dans la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!437 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 78. 438 Michel Foucault, « Des Espaces autres. Hétérotopie. », Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49. 439 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 82.
! ! ! ! !
! ! !
194!
viande…440 ». La viande humaine ici s’encombre d’une image d’autant plus forte qu’elle
n’est pas consommable et qu’elle est donc, à double titre, gâchée. Or cette viande, bien
que reléguée à de la matière flasque et sans vie (ou parce que reléguée) va pourtant se
rebeller, de manière ponctuelle. Gabriel Chevallier justifie ainsi les mutineries, affirmant
que « les poilus se sont sentis perdus, jetés à la boucherie par des incapables qui
s’entêtaient. La chair à canon s’est révoltée, parce qu’elle avait trop pataugé dans les
flaques de sang et qu’elle ne voyait pas d’autres moyens de se sauver441 ». C’est parce
qu’il y a eu une analogie possible entre les poilus, pas encore morts, et leur sort probable
en viande de boucherie, parce que cette possible comparaison a eu lieu, qu’elle a soulevé
l’indignation et engendré un dernier sursaut de révolte. Pitoyable humain, bétail dont la
rébellion sera réprimée elle aussi dans le sang. Les « incapables qui s’entêtaient »
revêtent l’habit des sacrificateurs permettant à la narration de s’organiser autour d’un
idée cohérente et intelligible : les victimes ne sont pas responsables de cette ab-jection
dans un espace mortifère.
Drieu La Rochelle établit lui aussi un parallèle entre le champ de bataille et un
abattoir :
L’immense foire en ce moment, au soleil d’août 1914, sur une aire immense et circulaire autour de l’Europe, achevait de rassembler le bétail le plus héroïquement passif qu’ait jamais eu à prendre en compte l’Histoire qui brasse les troupeaux. Les bouchers allaient entrer et un vague soupçon me secouait dans mon sommeil ; ce couloir de Chicago, ce n’était pas la carrière de gloire dont pourtant avait besoin l’orgueil de ma jeunesse442. La référence à Chicago renvoie à l’inauguration en 1865 dans l’un des plus
grands pôles économiques de l’Illinois, des Union Stock Yards, équarrissoirs qui seront
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!440 Ibid., p 233. 441 Ibid., p. 234. 442 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 39.
! ! ! ! !
! ! !
195!
le symbole du premier lieu d’abattage d’animaux à grande échelle443. Dans son ouvrage
clef Le Silence des bêtes, Élisabeth de Fontenay affirme que le pacte que l’Occident
avait noué avec l’animalité a été brisé par « les abattoirs de Chicago444 ». La guerre
apparaît donc chez Faure également comme le théâtre d’une mort non maîtrisée par ceux
qui la subissent et pourtant organisée par ceux qui l’ont orchestrée. Le soldat apparaît
dans les textes comme un objet sacrificiel et par conséquent n’a pas la maîtrise du rituel.
Soldats et bêtes sont sacrifiés pour des dieux insatiables. Au cours du sacrifice se lient et
s’entremêlent à la fois les espèces et le statut de la boucherie et du sacré : alors que
l’animal d’abattoir nourrit l’homme, le soldat nourrit la terre.
« Assaillants, soi-disant vainqueurs, ils murmuraient : “On nous fait tuer
bêtement” Témoin de ce désordre, de cette boucherie, je pensais : bêtement n’est pas
assez dire445 » affirme le narrateur de La Peur. C’est bien ce qui gêne, une fois encore,
ce désordre, c’est-à-dire cette transgression des frontières, cette attribution d’un langage
animalier alors qu’il est question d’hommes.
Mais tout le paradoxe réside dans le fait que les victimes sont en même temps les
bouchers. La seule manière d’expulser hors de soi et de comprendre ce phénomène est
donc de supprimer dans les textes ce qu’il reste d’humain, en remplaçant le narrateur par
quelque chose d’autre, en lui ôtant une part de son humanité. « Ce ne sont pas des
hommes, ceux qui peuvent supporter cette morne boucherie446 » affirme Drieu La
Rochelle. Il est impossible d’accepter l’inconcevable, à savoir une mise à mort auto-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!443 Entre 1865 et 1900, on recense l’abattage de 400 millions de bestiaux (source : http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/2883.html Dernière consultation le 27 novembre 2012). 444 Élisabeth de Fontenay, op. cit., p. 17. 445 Gabriel Chevallier, op. cit., p. 89. 446 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 179.
! ! ! ! !
! ! !
196!
infligée. Plus loin, face au chaos, il ajoute : « Il y a là des milliers d’hommes. Et on ne le
voit pas. Où sont-ils ? Cachés, ensevelis dans la terre, déjà ensevelis. […] Plus de
maisons, plus d’arbres, plus d’herbes. Plus d’animaux sur plusieurs lieues. C’est tout ce
que je me rappelle : la solitude, la solitude immobile 447 ». Cette solitude, c’est
finalement l’antichambre d’un espace-temps apocalyptique qui annonce à terme
l’anéantissement de l’espèce humaine. Tout disparaîtra, les hommes comme les
animaux.
Le recours aux notions de « boucherie » et d’« abattoir » est particulièrement
intéressant si on leur associe une dimension spatiale : Catherine Remy souligne en effet
la différence entre tuerie et boucherie, rappelant que la boucherie a à voir avec la
question de la séparation sociale entre l’ endo et l’ exo 448. Ce qui renvoie à ce que nous
avons mentionné plus haut comme étant une séparation entre le pur et l’impur
également. La notion d’exo a tout à fait sa place ici si l’on se souvient de l’importance
de la dichotomie entre front et arrière. La boucherie a lieu au front, espace qui, rappelons
le, est séparé de l’arrière. Ainsi, l’espace où se joue la « boucherie de 14 » serait le lieu
où prend place la tuerie socialement organisée du soldat, de ceux qui portent les armes.
La séparation spatiale telle qu’elle est évoquée dans les narrations souligne une fois
encore cette incapacité à dire ou tout du moins à narrer proche de soi, dans cet espace
intérieur de l’intime, à évoquer la violence dans une sphère d’intimité. La violence vécue
des soldats ne peut être narrée que dans un espace autre pour reprendre l’expression de
Foucault449. Aussi si le champ de bataille est un lieu réel, il est également un espace
chargé d’une forte signification, presque mythifié en ce qu’il est cet endroit où l’on
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!447 Ibid. 448 Cf. Catherine Remy sur la question de l’exurbanisation, op. cit, p. 6. 449 Michel Foucault, op. cit.
! ! ! ! !
! ! !
197!
expire, où littéralement le souffle sort de soi, hors de la vue des non-combattants. Seuls
en reviendront les combattants qui ont survécu et seront à même de témoigner : ils
tenteront de restituer l’expérience de cet espace, de faire partager une réalité qui n’a de
sens que pour eux.
Lorsque Drieu La Rochelle fait allusion à ces milliers de morts que l’on ne voit
pas, il évoque le poilu paré des attributs du bouc émissaire dans la mesure où il est
« expulsé » du domaine social en paix450. Puisque le sacrifice humain en tant que tel
n’est pas concevable, ce qui d’habitude caractérise le sacrifice de substitution est ici mis
en scène par la narration : la substitution prend forme grâce au travestissement de
l’homme en animal. Chez Jules Romains, cette image de grande boucherie est bien
intimement liée au thème du sacrifice : « Les attaques locales, c’était le pigeon qu’on
égorge sur un autel de fortune, pour que l’idole prenne patience jusqu’à l’immolation
solennelle du taureau451 ».
L’hypothèse d’une extinction proche est double. Car dans la mort, tant vécue que
perpétrée, l’homme entraîne avec lui son double mystérieux, à la fois craint et nécessaire
à lui conférer son statut d’humain : « Étrange veuvage de la terre sans l’homme, sans
l’œil. Et si, en plus de cela, cette terre est dépouillée, nue. Si on a […] chassé au loin ses
animaux, alors quelle chose inimaginable, inhumaine452 » poursuit Drieu La Rochelle.
La disparition des animaux dans la guerre serait alors un prélude à celle des hommes.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!450 Distinguons l’animal de boucherie de l’animal sacrificiel, celui-ci étant revêtu d’un caractère sacré. 451 Jules Romains, Prélude à Verdun, éd. cit., p. 20. 452 Pierre Drieu La Rochelle, op. cit., p. 181.
! ! ! ! !
! ! ! 198!
Conclusion
Violence, fragmentation des corps, régression à un stade humain primitif,
« retour » à un stade animal, tout autant de représentations qui soulèvent une question
philosophique essentielle, celle de la négation de l’humain, voire de son éventuelle
disparition. Comme Agamben le précise dans L’Ouvert, il y a un lien direct entre perte
du langage et disparition de l’étant. Si une partie des narrations que nous avons
analysées substituent au langage humain un langage ou tout du moins, un système de
représentations animales, un bestiaire comme nous avons choisi de l’appeler, alors c’est
que l’emploi de cette imagerie implique sinon la probable disparition du genre humain,
au moins la perte de ce qui le caractérise : éthique, respect de la vie, respect des morts.
De même en ce qui concerne les représentations des soldats comme êtres primitifs ;
l’être primitif est barbare, il est celui qui, selon la conception grecque ancienne, ne parle
pas la langue, voire qui ne parle pas tout court. Priver de parole c’est donc ôter la
capacité à exprimer son expérience de l’horreur. Et pourtant, la littérature a réussi à
évoquer la catastrophe de la Première Guerre mondiale.
Les auteurs choisis ont anticipé ce que la guerre annonçait philosophiquement, à
savoir une remise en question de l’essence de l’homme voire de l’éventualité de son
extinction. Car en effet, curieuse chose que cette guerre, que la guerre, qui laisse sur le
champ de bataille des fragments de corps, de chair et de sang et qui hantent les
mémoires ; que faire de ces terribles blessures ? Par quels moyens de représentation
formuler l’indicible ? C’est à cette question que nous avons tenté de répondre. Certes, la
guerre est une destruction, destruction de la beauté des paysages, des vies humaines, des
créations humaines. En même temps, l’art, et en l’occurrence la littérature, a pour
! ! ! ! !
! ! !
199!
vocation l’expression esthétique de l’expérience humaine, y compris dans sa dimension
tragique, dans ses aspects les plus sombres. Il existe dans ces textes une dialectique
constante entre représentations du sang et des chairs morcelées d’un côté, et mise en
forme littéraire, esthétique et stylistique, de l’autre, l’écriture se nourrissant de la
souffrance manifeste.
Ce que cette thèse a cherché à mettre en avant, c’est principalement
l’interprétation narrative de la guerre, du point de vue d’auteurs ayant participé au
premier conflit mondial. Il ne s’agit pas de chercher une vérité sur la guerre, tant sur le
plan événementiel que sur le plan des ressentis, multiples s’il en est, mais de voir
comment le discours narratif se structure, autour de quelles idées, quelles analyses et
principalement, quelles images lorsqu’il est question de restituer par des mots
l’expérience de la guerre et de la mort brutale, injuste, qui ne prévient pas. L’expérience
est une plongée dans le monde de l’immanence. Il s’agit de voir ce que cette expérience
du réel permet à l’auteur d’écrire.
Nous avons tenté de cerner le champ des contraintes narratives : environnement
violent, rude, réduit, contraintes physiques de l’écriture dans le cas des journaux tenus
au front, crainte de la censure, crainte du jugement de l’arrière, autocensure, volonté de
transmettre et de témoigner sans pour autant s’épancher, auxquels s’ajoutent les
transformations complexes que la mémoire fait subir à l’expérience vécue. Ceci nous a
permis d’avancer une première hypothèse à savoir que la Première Guerre mondiale a
manifestement ébranlé la conception que l’on avait du monde. Plus précisément, elle a
provoqué une transformation profonde des rapports homme / animal. Le poilu, face à la
! ! ! ! !
! ! !
200!
mort, à la violence, au froid, aux conditions de vie dans les tranchées, commence de
réinterpréter le monde.
La présence de l’animalité dans la littérature de guerre participe de cette
réinterprétation dans la mesure où elle ouvre un nouveau monde, un « arrière-monde
insaisissable », « contre lequel l’intelligence se brise453 » et dont la profondeur de champ
est démultipliée quand concourent à sa création violence, primitivisme, abjection…
Pourtant, l’animalité tout en participant à la création de ce nouvel espace à côté de
l’homme, constitue un facteur positif déterminant pour la perpétuation de l’humanité. En
effet, l’animalité apporte, nous l’avons vu, ce souffle de vie, tel un renouveau du Verbe,
au sens littéral, une renaissance de la parole, dans un monde où prévalent souffrance et
mort. Si l’on accepte la pérennité de l’animal en l’homme, alors l’on accepte une
nouvelle zone de survie, là où toute vie semblait suspendue, où la tragédie de la guerre
dans toute sa brutalité semblait anéantir toute création humaine. La présence de l’animal
en guerre a donc contribué, pour les soldats, d’une part à dire la guerre, d’autre part à
survivre dans des conditions d’existence qui s’éloignaient de l’humanité.
Le discours des auteurs choisis est une forme d’anticipation « des » discours les
plus profonds sur ce qui reste de l’homme après une catastrophe. Adorno affirme à
propos de la Shoah, qu’« Écrire un poème après Auschwitz est barbare, car toute culture
consécutive à Auschwitz n'est qu'un tas d'ordures454 ». Les écrivains combattants,
témoignant d’un événement antérieur à la Seconde Guerre mondiale, avaient déjà
intuitivement saisi la dimension indicible de la guerre. Ils ont réussi à élaborer des
techniques littéraires pour traduire l’ineffable. Cette question de l'inexprimable telle
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!453 Rémy Gagnon, « Frères de sang : l’homme et l’animal d’Agamben à Aristote », Contre-jour : cahiers littéraires, n.13, 2007, p. 106. 454 Theodor Adorno, Prismes, Paris, Payot, 1986, p. 26.
! ! ! ! !
! ! !
201!
qu’elle est soulevée par Adorno aurait donc pu se poser à la suite de la Première Guerre
mondiale. Pourtant, les œuvres considérées nous ont montré qu’il est possible d’engager
un discours esthétisant à la suite de la « boucherie » qu’a été la guerre. Il est donc
toujours possible d’écrire au sujet de et après la barbarie. À ceux qui voyaient, sur le
moment, la guerre comme une fin de l’homme, la période de l’entre-deux-guerres a
prouvé le contraire. Si la Grande Guerre a bien provoqué une rupture profonde et
durable avec ce qui préexistait en termes de production littéraire et artistique, elle n’a
cependant pas empêché un renouveau esthétique important. L’écriture des deux guerres
présente ainsi parfois une continuité dans la description des horreurs vécues. Il est en
effet possible d’établir une certaine parenté quant aux thèmes abordés pour soutenir la
narration et quant à l’esthétique proposée, entre les textes étudiés et les romans écrits
plus tard, pendant ou après la Seconde Guerre mondiale. Les premiers n’ont cependant
pas eu le rôle préventif, édifiant, souhaité par leurs auteurs : la Der des ders ne sera pas
la dernière et si l’écriture dépeint les horreurs vécues, elle ne prépare jamais à celles à
venir.
Les écrivains étudiés ont tous, par des styles d’écriture différents, avec des
œuvres de valeur littéraire différente, suggéré la construction d’un nouveau système de
représentation. Une fois disparus les écrivains combattants puis les derniers poilus, la
voix romanesque de la Première Guerre mondiale ne s’est pas tue. Cet épisode de
l’histoire est resté une source à laquelle ne cessent de puiser les écrivains contemporains.
Jean Echenoz et Jean Rouaud, pour les plumes les plus littéraires ou encore Marc
Dugain, Laurent Gaudé et Alice Ferney, continuent de faire vivre dans les mémoires la
vie au front, le désarroi des êtres séparés par la guerre, la souffrance des grands blessés,
! ! ! ! !
! ! !
202!
la place des animaux en guerre. Le creuset romanesque que constitue la Grande Guerre a
en outre alimenté une abondante production cinématographique. Capitaine Conan, de
Betrand Tavernier, s’est inspiré du roman éponyme de Roger Vercel, La Chambre des
officiers, roman de Marc Dugain a été mis en images par François Dupeyron et Un long
dimanche de fiançailles, film de Jean-Pierre Jeunet a, quant à lui, porté à l’écran l’œuvre
de Sébastien Japrisot.
De la même façon qu’il est possible d’affirmer que notre perception de l’histoire
ne fait que changer, il semble que la narration d’un événement passé ne soit jamais
achevée. La littérature de guerre participe du culte de la mémoire. « Écrire la guerre »
est alors un acte commémoratif qui, parallèlement aux commémorations officielles et à
l’édification d’espaces culturels - musées, mémoriaux, reconstitutions historiques,
chemins touristiques des tranchées - visant là aussi à « se souvenir », contribue à
l’élaboration d’une réflexion à long terme sur la guerre et plus généralement sur les
sociétés humaines.
S’il me fallait poursuivre cet axe de recherche, il serait pertinent d’élargir mon
corpus et d’analyser des œuvres que j’ai laissées de côté, que ce soit Le Feu, d’Henri
Barbusse, La guerre à vingt ans, de Maurice Barrès, Le Voyage de Ferdinand Céline,
Les croix de bois, de Roland Dorgelès, Les silences du colonel Brambel d’André
Maurois ou encore Le Grand troupeau de Jean Giono, pour ne citer que certains titres.
De la même façon, l’étude pourrait aussi inclure des sources plus larges comme
les lettres de soldats et journaux intimes, que j’ai peu abordés (cf. lettres de Dorgelès).
Toujours au regard des thématiques concernées, les œuvres d’écrivains européens ou
! ! ! ! !
! ! !
203!
américains ayant pris part à la Grande Guerre offriraient un terreau fertile à une étude
comparative. Je pense entre autres aux écrivains suivants: Ernst Jünger, In
Stahlgewittern, Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues; Thomas E. Lawrence,
Seven pillars of Wisdom; Ernest Hemingway, The farewell to arms; Dalton Turbo,
Johnny got his gun; Robert Graves, Goodbye to all that.
Enfin, la même démarche épistémologique pourrait s’appliquer à des conflits
contemporains comme les guerres en Irak ou en Afghanistan, moyennant de nouvelles
perspectives d’analyse qui prendraient en compte la révolution technologique introduite
par le numérique dans les media contemporains ; aux journaux « papier » se sont
substitués journaux en ligne, réseaux sociaux et blogs. Alors que la transformation
radicale des champs de bataille s'accompagnait d'une redéfinition des rapports avec
"l'arrière", les contraintes d’écriture étaient bouleversées et les métiers du journalisme
transformés en profondeur: les techniques de collecte mais aussi la manière de relayer,
de surveiller et/ou d’évaluer l’information, changeaient tout autant. En amont, la nature
même de l’information et le champ qu’elle couvre ont également changé. La plupart des
nouveaux formats relèvent de l’auto-édition et leur production, massive en
termes de quantité, est souvent « brute», non légitimée par une expertise éditoriale et une
publication commerciale. Bien que le risque de censure existe toujours bel et bien,
variant d’un État à l’autre selon le niveau de contrôle de l’information, les écrits mis en
ligne, grâce à la dimension interactive de la relation auteur / lecteur, sont ouverts aux
commentaires et controverses. Ces nouvelles formes de publication s’inscrivent dans le
règne de l’immédiateté, sans rapport avec la temporalité des romans ou carnets écrits au
front sous la Grande Guerre. Leur impact sur l'écriture romanesque resterait à analyser :
! ! ! ! !
! ! !
204!
comment écrire « au présent » les guerres d'aujourd'hui? Malgré les bouleversements
survenus depuis un siècle, le roman n'a rien perdu de sa capacité à mettre l'histoire en
récit. Grace à sa puissance créatrice, il esthétise le laid, évoque l’indicible, donne du
sens aux tragédies humaines. La littérature tend à l’universalité : avec la distance qui lui
est propre, face à l'expérience, elle peut encore organiser le chaos du monde.
! ! ! ! !
! ! ! 205!
BIBLIOGRAPHIE
I. Œuvres de guerre
A- Sources primaires - Œuvres de tranchées
Romans
Benjamin, René, Gaspard, Paris, Fayard, 1935 [1915].
Chaine, Pierre, Mémoires d’un rat, Paris, Taillandier, 2008 [1917].
Chevallier, Gabriel, La Peur, Paris, Le dilettante, 2008 [1930].
Drieu La Rochelle, Pierre, La comédie de Charleroi, Paris, Gallimard, 1982 [1934].
Escholier, Raymond, Le sel de la terre, Amiens, Edgar Malfère, 1925.
Faure, Elie, La Sainte Face, Paris, Bartillat, 2005 [1918].
Genevoix, Maurice, Ceux de 14, Paris, Flammarion, 2007 [1950].
Mac Orlan, Pierre, Les Poissons Morts, Paris, Payot, 1917.
Romains, Jules, Prélude à Verdun, in Les hommes de bonne volonté, Paris, Robert Laffont, 2003 [1938].
Romains, Jules, Verdun, in Les hommes de bonne volonté, Paris, Robert Laffont, 2003 [1938].
Carnets, lettres et essai
Barthas, Louis, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918, Paris, Maspero, 1978.
Dorgelès, Roland, Bleu horizon. Pages de la Grande Guerre, Paris, Albin Michel, 1949.
Dupray, Micheline (éd.), Roland Dorgelès, Je t'écris de la tranchée : correspondance de guerre, 1914-1917, Paris, Albin Michel, 2003.
Paroles de Poilus, Lettres et carnets du front, 1914-1918, Paris, Flammarion, 1998.
Nicot, Jean, Les poilus ont la parole, Lettres du front 1917-1918, Bruxelles, Complexe, 1998.
! ! ! ! !
! !
206!
B- Sources secondaires
Littérature
Camus, Albert, La Chute, Paris, Gallimard, 2012. Céline, Ferdinand, Casse-Pipe, Paris, Gallimard, 1975. Cendrars, Blaise, J’ai tué, Paris, ed. George Crès, 1919. Conrad, Joseph, Heart of Darkness, Boston & New York, St. Martin's Press, 1996. Defoe, Daniel, Robinson Crusoe, London, Taylor, 1719. Dugain, Marc, La Chambre des officiers, Paris, Pocket, 1999. Ferney, Alice, Dans la guerre, Paris, Babel, 2005. Gaudé, Laurent, Cris, Paris, Actes Sud, 2001. Jünger, Ernst, Orages d’acier, Paris, Livre de Poche, 2002. Kafka, Franz, La Métamorphose, et autres récits, Paris, Gallimard, 1991. --- Le Terrier, Paris, Mille Et Unes Nuits, 2012. Levi, Primo, Si c’est un homme, Paris, Julliard, 1987. Proust, Marcel, Le Temps retrouvé, Paris, Gallimard, 2000. Tournier, Michel, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, 1967. Rouaud, Jean, Les Champs d’honneur, Paris, Minuit, 1990. Rousseau, Jean-Jacques, Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761. Vernes, Jules, Les Grands navigateurs du XVIIIe siècle, Hetzel, Paris, 1879. Zola, Émile, La Bête Humaine : Les Rougon Macquart, Paris, Le Seuil, 1970, tome 5.
Filmographie
Dupeyron, François, La Chambre des officiers, Laurent et Michel Pétin prod., France, 2001.
Genet, Jean-Pierre, Un long dimanche de fiançailles, 2003 Production, Warner Bros France, Tapioca Films, TF1 Films production, France, 2004.
! ! ! ! !
! !
207!
Le Bomin, Jabriel (réal.), Les Fragments d’Antonin, Dragoonie Films, Les Productions Lederman, France, 2006.
Tavernier, Bertrand, Capitaine Conan, Little Bear, Les Films Alain Sarde, TF1 Films production, France, 1996.
II. Ouvrages théoriques A- Critique littéraire, philosophie
Andries, Lise, « Les images et les choses dans Robinson et les robinsonnades », in Études françaises, vol. 35, nº 1, 1999, p.95-122.
Baudelaire, Charles, Curiosités esthétiques [Document électronique] ; L'art romantique : et autres œuvres critiques, [textes établis par Henri Lemaître], Paris, Bordas, http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-101426&M=tdm
Beaupré, Nicolas, Écrire en guerre, écrire la guerre, France, Allemagne 1914-1920, Paris, CNRS éditions, 2006.
Bonadeo, Alfredo, Mark of the Beast: Death and Degradation in the Literature of the Great War, Lexington, KY., University Press of Kentucky, 1989.
Cazals, Rémi et Frédéric Rousseau, 14-18, le cri d'une génération, Toulouse, Privat, 2003
Decoret, Sylvie, Lettres du front et de l'arrière, 1914-1918, Carcassonne, Les Audois, 2000.
Deleuze, Gilles, « Zola et la fêlure », in Logique du sens, Paris, Editions de Minuit, 1969, pp. 373-386.
Dubois, Jacques et Gauvin, Lise, « Présentation », Études françaises, vol. 35, n° 1, 1999.
Dupray, Micheline, Roland Dorgelès. Un siècle de vie littéraire française, Paris, Albin Michel, 2000. Foucault, Michel, Dits et écrits (1984), T. IV, « Des espaces autres », n° 360, pp. 752 - 762, Gallimard, Paris, 1994. Girard, René, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, 1961.
Hurcombe, Martin, Novelist in conflict: Ideology and the Absurd in the French Combat Novel of the Great War, New York, Rodopi, 2004.
! ! ! ! !
! !
208!
Lejeune, Philippe, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975.
Norton Cru, Jean, Témoins. Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928, Paris, Editions Les Etincelles, 1929.
--- Témoins, Paris, Allia, 1997 [1930].
Ricœur, Paul, La Métaphore Vive, Paris, Seuil, 1975.
Trévisan, Carine, Les fables du deuil, La Grande Guerre : mort et écriture, Paris, Puf, 2001.
Schoentjes, Pierre, Fictions de la Grande Guerre, Variations littéraires sur 14-18, Paris, Garnier, 2009.
--- (dir.), La Grande Guerre, un siècle de fictions romanesques, Paris, Droz, 2008.
B- Violence, guerre, animalité, primitivisme, rapports homme/animal
Adorno, Theodor, Prismes, Paris, Payot, 1986.
Agamben, Giorgio, Le langage et la mort, Paris, Bourgeois, 1997.
L’ouvert. De l’homme et de l’animal, Paris, Rivages, 2002.
Audoin-Rouzeau, Stéphane, Combattre. Une anthropologie de la guerre moderne (XIXe-XXIe siècle), Paris, Seuil, 2008.
Baladine Howald, Isabelle, « L’animal inspire », Le Portique [En ligne], 23-24 | 2009, document 8, mis en ligne le 28 septembre 2011.
Bataille, Georges, « L’interdit lié à la mort », L’érotisme, Œuvres complètes, Tome X, Paris, Gallimard, 1987.
Boccara, Michel, La part animale de l’homme ; esquisse d’une théorie du mythe et du chamanisme, Paris, Economica, 2002.
Bourke, Joana, An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth Century Warfare, London, Granta, 1999.
Camos, Valérie, Cézilly, Franck, Guenancia, Pierre et Sylvestre, Jean-Pierre, Homme et animal, la question des frontières, Versailles, Quae, 2009.
Coker, Christopher, The Warrior Ethos, Military Culture and the War on Terror, New York, Routledge, 2007.
Corbin, Alain, Courtine, Jean-Jacques et Georges Vigarello, (dir.), Histoire du corps, Tome 3, Les mutations du regard, Le XXe siècle, Paris, Seuil, 2006.
! ! ! ! !
! !
209!
Cyrulnik, Boris (dir.), Si les lions pouvaient parler, Paris, Gallimard, 1998.
Danchev, Alex, On Art and War and Terror, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009.
Douglas, Mary, De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La Découverte, 2001.
Eller, Jack David, Violence And Culture: A Cross-Cultural And Interdisciplinary Approach, University of Michigan, Wadsworth, 2005.
Fontenay (de), Elisabeth, Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998.
Freud, Sigmund, « Deuil et mélancolie » in Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968.
--- « Au-delà du principe de plaisir » in Essais de psychanalyse, Paris, Éditions Payot, 1968.
--- « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » in Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981.
--- « Psychologie des foules et analyse du moi », Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981.
Gagnon, Rémy, « Frères de sang : l’homme et l’animal d’Agamben à Aristote », Contre-jour : cahiers littéraires, n 13, 2007, p. 106.
Girard, René, La Violence et le sacré, Paris, Hachette, 1998.
Heidegger, Martin, Les concepts fondamentaux de la métaphysique : monde, finitude, solitude, Paris, Gallimard, 1992.
Kristeva, Julia, Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, Paris, Seuil, 1980.
Le Naour, Jean-Yves, Misères et tourments de la chair durant la Grande Guerre. Les mœurs sexuelles de Français, 1914-1918, Paris, Aubier, 2002.
Lestel, Dominique, L’animalité. Essai sur le statut de l’être humain, Paris, Hatier, 1996.
--- Les animaux sont-ils intelligents ?, Paris, Le Pommier, 2012.
Manuel, Didier (dir.), La figure du monstre. Phénoménologie de la monstruosité dans l’imaginaire contemporain, Nancy, Presse Universitaires de Nancy, 2009.
Piette, Albert, L’être humain, une question de détails, Charleroi, Socrate, 2007
Poirier, Jacques (dir.), L’animal littéraire. Des animaux et des mots, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2010
Potestà, Andréa, « Animal, trop animal », Le Portique, numéro 23-24, 2009.
! ! ! ! !
! !
210!
--- « De l’inutile. Formes animales », Le Portique [en ligne], 23-24 | 2009, document 2, mis en ligne le 28 septembre 2011, consulté le 27 janvier 2013, http://leportique.revues.org/index2428.html
Rémy, Catherine, « Une mise à mort industrielle ‘humaine’ ? L’abattoir ou l’impossible objectivation des animaux », Politix. Vol. 16. N° 64. Quatrième trimestre 2003, pp. 51-73.
Schaeffer, Jean-Marie, La fin de l’exception humaine, Paris, Gallimard, 2007.
Simon, Anne, « Hybridité animale et végétale dans Deux Cavaliers de l’orage (Giono)», Nouvelles Francographies, vol. 1, n°1, septembre 2007, pp. 205-216.
Sofsky, Wolfgang, Traité de la violence, Paris, Gallimard, 1998.
--- L'ère de l'épouvante ; Folie meurtrière terreur guerre, Paris, Gallimard, 2002.
Surya, Michel, Humanimalités, Paris, Léo Scheer, 2004.
Taylor, Anne-Christine, « Primitif » in Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Pierre Bonté et Michel Izard (Dir.), Paris, Quadrige/Puf, 2004.
Autre medium :
Grossman, Evelyne, « Il faut écrire comme un rat trace une ligne », Colloque « Animalité », 4-7 octobre 2007, Parlement des philosophes ; http://www.parlement-des-philosophes.org/multimedia/06-Grossman.mp3
III. Histoire et historiographie
Audoin-Rouzeau, Stéphane & Becker, Annette., 14-18, retrouver la guerre, Paris, Gallimard, 2000.
Baldin, Damien, De la contiguïté anthropologique entre le combattant et le cheval, in Revue historique des armées, 249 | 2007: « Le cheval dans l'histoire militaire », pp. 75-87.
Becker, Jean-Jacques, 1914 : comment les français sont entrés dans la guerre, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1977.
Becker, Jean-Jacques et Audoin-Rouzeau, Stéphane, Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918, Paris, Bayard, 2004.
Chickering, Roger, Imperial Germany and the Great War, 1914-1918, Washington DC, Georgetown University Press, 2004.
Corbin, Alain, Courtine, Jean-Jacques et Georges Vigarello (dir.), Histoire du corps, T.3 Les mutations du regard. Le XXème siècle, Paris, Seuil, 2006.
! ! ! ! !
! !
211!
Delaporte, Sophie, Les Gueules Cassées. Les blessés de la face de la Grande Guerre, Paris, Noêsis, 1996.
--- « Les défigurés de la Grande Guerre », Guerres mondiales et conflits contemporains, 175, Juillet 1994, pp. 103-121.
--- « Le corps et la parole des mutilés de la Grande Guerre », Guerres mondiales et conflits contemporains, 205, Janvier-Mars 2002, pp. 5-14.
Doughty, Robert, Pyrrhic Victory, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2005.
Eksteins, Modris, Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age, Toronto, Key Porter Books, 1989.
Ferguson, Niall, The Pity of War: Explaining World War I, New York, Basic Books, 1999.
Fussell, Paul, The Great War and Modern Memory, New York, Oxford University Press, 1975.
Horne, John, « Entre expérience et mémoire : les soldats français de la Grande Guerre », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2005/5, 60e année, pp. 903-918.
Lerner, Paul, Hysterical Men: War, Psychiatry, and the Politics of Trauma in Germany, 1890-1930, New York, Cornell University Press, 2003.
Miquel, Pierre, Les Poilus, Paris, Plon, 2000.
Moss, George, Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, New York, Oxford University Press, 1991.
Prost, Antoine, Les anciens combattants et la société française 1914-1939, volume 3: Mentalités et Idéologies, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978.
Prost, Antoine et Jay Winter, Penser la Grande Guerre. Un essai d’historiographie, Paris, Seuil, 2004. Ricoeur, Paul, Histoire, mémoire et oubli, Paris, Seuil, 2000. Rousseau, Frédéric, Les procès des témoins de la Grande Guerre, L’affaire Norton Cru, Paris, Seuil, 2003. Smith, Leonard, Audoin-Rouzeau, Stéphane et Becker, Annette, France and the Great War, 1914-1918, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. Sherman, Daniel, The Construction of Memory in Interwar France, Chicago, University of Chicago Press, 2001. Wieviorka, Annette, L’ère du témoin, Paris, Hachette, 2002.




































































































































































































































![Primitivism about intrinsicality [online] · 1 November 2013 1 Primitivism About Intrinsicality ALEXANDER SKILES Université de Neuchâtel This is a shortened version of a chapter](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5e82868ca3042162b1577ad9/primitivism-about-intrinsicality-online-1-november-2013-1-primitivism-about-intrinsicality.jpg)