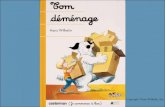Sophie Prévost LATTICE (CNRS/ENS, Paris) · changement est le résultat d’une variation. cf ....
Transcript of Sophie Prévost LATTICE (CNRS/ENS, Paris) · changement est le résultat d’une variation. cf ....
Sophie PrévostLATTICE (CNRS/ENS, Paris)
Changement linguistique Changement linguistique et Grammaticalisationet Grammaticalisation
1) Le changement des langues : un constat et une problématique
2) Un type de changement linguistique : la grammaticalisation
1.1. Toutes les langues naturelles changent
… et elles changent sans cesse !
Changement : gains / pertes / modifications de formes et de constructions.
Constatempirique qui ne va pas de soi : on perçoit mal le changement au moment où il se produit
Pas de contre-exemple au changement dans les langues : trait universel=> on peut faire l’hypothèse que c’est un trait de la faculté même du langage
�“Paradoxe” du changement :
Toutes les langues changent alors que c’esta priori un facteur de trouble dansl’intercompréhensionMais tout ne change pas en même temps : le « système » change point par point ; Succession de deséquilibres et de rééquilibrage du système
Charles Bally :« Les langues changent sans cesse et ne
peuvent fonctionner qu’en ne changeant pas. A chaque moment de leur existence, elles sont le produit d’un équilibre transitoire. Cet équilibre est donc le résultat de deux forces opposées : la tradition, qui retarde le changement, lequel est incompatible avec l’emploi régulier d’un idiome, et d’autre part les tendances actives, qui poussent cet idiome dans une direction déterminée.»
1932, Linguistique générale et linguistique française,p.18
1.2. Comment la langue peut-ellefonctionner si elle change sans cesse ?
Réponse apportée par la socio-linguistique et la notion de variabilité
Labov :« Il serait faux de concevoir la communautélinguistique comme un ensemble de locuteurs employant les mêmes formes. On la décrit mieux comme étant un groupe qui partage les mêmes normes quant à la langue (1976 : 228 )…Il paraît justifié de définir une communauté linguistique comme étant un groupe de locuteurs qui ont encommun un ensemble d’attitudes sociales envers la langue. »(Sociolinguistique, 1976, p. 338, note 40)
« Une maîtrise quasi innée des structures
hétérogènes…fait partie de la
compétence linguistique de l’individu
unilingue. L’un des corollaires de ce
point de vue est que, pour une langue
utilisée par une communauté complexe
(c'est-à-dire réelle), c’est l’absence d’une
hétérogénéité structurée qui se révèlerait
dysfonctionnelle. »
(Weinrich, Labov et Herzog « Empirical Foundations for a Theory of LanguageChange », 1968, p. 100-101, traduit dans Labov, 1976, p.100)
L’hétérogénéité serait donc constitutive des langues : tout sujet parlant est capable de produire et d’interpréter ces variations.
Approche qui permet de dépasser le paradoxe du changement, puisque le changement est le résultat d’une variation.
cf . Jakobson : « Pendant un certain temps, le point de départ et le
point d’aboutissement de la mutation se trouvent coexister sous la forme de deux couches stylistiques différentes […] Un changement est donc, à ses débuts, un fait synchronique »(1952/63, Essais de linguistique générale, p. 37)
Toute variante est un candidat au changement,
tout changement comporte d’abord une étape de variation,
mais toute variation ne débouche pas sur un changement :
- la variante peut disparaître,
- ou bien la variation peut se maintenir (ex. de la négation en français)
Modèle possible : A > Ab > aB > B
1.3. Spécificité de l’approche diachronique
Diachronie : terme forgé par Saussure, pour penser la dimension évolutive de la langue, la mutabilitédu signe linguistique.
« Est synchronique tout ce qui se rapporte à l’aspect statique de notre science, diachronique tout ce qui a trait aux évolutions. De même synchronie et diachronie désigneront respectivement un état de langue et une phase d’évolution »
Cours de linguistique, 1ère partie chap.3, p. 116-117 :
La démarche diachronique reste difficile. Idéalement elle ne se résume pas à la somme
d’états synchroniques successifs : elle doit expliquer comment on passe de l’un àl’autre.
La diachronie doit rendre compte de l’évolution , et non simplement enregistrer des changements.
Evolution: processus invisible que l’on explique et reconstruit,
mais qui reste toujours du domaine de l’hypothèse
Le Facteur temps :� Comment discrétiser / segmenter le temps ? � Comment discerner les frontières où les
changements se produisent ? � Approche diachronique : d’abord
déterminer la taille des synchronies puis leur fréquence.
………………………………………
=> Choix qui mettent en cause :� la granularité du découpage� la conception de la nature même de
l’évolution : changements brusques ou progressifs
1.4. Intérêt de l’étude du changement dans les langues:
� Connaissance des états passés d’une langue� Meilleure compréhension de la langue que
nous parlons et écrivons aujourd’hui,� Possibilité de formuler des hypothèses sur
son devenir� Pas de contre-exemple au changement dans
les langues (trait universel)=> Trait de la faculté même du langage=> Relative compréhension du langage en tant que faculté cognitive (en comparant l’évolution de différentes langues)
Le changement est universel,mais les types de changements eux-mêmes sont universels.
Toutes les langues connaissent :
� des phénomènes de réanalyse(modification d’une structure / règle en profondeur, sans modification de la structure en surface)
� des cas d’analogie: simplification des paradigmes (la forme de surface change ≠ structure profonde)
� des emprunts
� des phénomènes de grammaticalisation : évolution d’une forme d’un statut lexical vers un statut grammatical
� Rapports polémiques entre : grammaticalisation, réanalyse et analogie;
Pour certains, la grammaticalisation n’a pas de statut spécifique (sous-ensemble de la réanalyse…)
� Autre position : la grammaticalisation est un processus de changement complexe,
qui implique certains mécanismes dont réanalyseet analogie, qui peuvent se produire en dehors de la grammaticalisation.
� Lexicalisation/dégrammaticalisation
� Grammaticalisation : type de changement très répandu et désormais bien décrit
� Un terme employé assez couramment, mais souvent avec un sens un peu vague
Au sens strict, « grammaticalisation »:
� unphénomène (processus + résultat), un type de changement linguistique largement décrit depuis la fin des années 70’
� une approche, un cadre d’analyse, voire une théorie depuis les 80’
Type de changement très ancien et repéré dans toutes les langues depuis plus de 2 siècles.
Meillet (1912) retient 2 procédés pour la constitution des formes grammaticales :
- analogie: assez brutale, elle opère des changements de détail
- grammaticalisation : « passage d’un mot autonome -> élément grammatical »
progressive, elle peut opérer des changements plus profonds, modifier le système
1. Définition
Evolution d’une forme d’un statut lexical vers un statut grammatical, ou d’un statut grammatical vers un statut plus grammatical
= Elément linguistique>élément plus grammatical
� Meillet (1912) : « passage d’un mot autonome au rôle d’élément grammatical »
� Lehmann (1982) : « From the diachronic point of view, it is a process which turns lexemes intogrammatical formatives and renders grammatical formatives still more grammatical ».
Traugott (1996 : 183) : « Grammaticalization […] is that subset of linguistic
changes whereby lexical material in highlyconstrained pragmatic and morphosyntactic contextsbecomes grammatical, and grammatical materialbecomes more grammatical ».
-> Importance des constructions et des contextes : une forme n’évolue pas de manière isolée.
� Idée d'une « pente»: item lexical > item grammatical > clitique > affixe > 0 (ce qui ne signifie pas que toute la pente est parcourue)
Autre approche, plus récente, suite aux travaux de Givon :
Evolution du discursif > morpho-syntaxiqueFixation des stratégies discursives dans les
structures morpho-syntaxiques2 approches qu'on peut résumer par deux
slogans : « la morphologie d'aujourd'hui est la syntaxe d'hier » et « la syntaxe d'aujourd'hui est la pragmatique d'hier »
Approches compatibles : l'utilisation des formes lexicales dans le discours peut conduire à des structures morpho-syntaxiques.
� Quelques exemples de grammaticalisation :
- Prépositions < noms/verbes : en face de, à côté de, suivant…
- Article défini < démonstratif : le < illum
- Pronom indéfini on < substantif hom« homme »
- Adverbe de négation < substantif : pas, point, mie
- Auxiliaires < verbes pleins : avoir (possession), will(volonté)
- Futur français : aimerai < amare habeo
- Périphrases futures < verbes de motion : be going to / aller …
Des phénomènes récurrents dans toutes les langues (cf. World lexicon of grammaticalization, Heine et Kuteva 2002)
⇒ une constante de l’activité humaine
⇒ les changements ne sont pas le fruit du hasard
2. Processus et mécanismes
Processus caractérisé par des principes et mécanismes, relevant de différents domaines (morphologique, phonétique, syntaxique, sémantique, pragmatique…), avec une relation de partielle consécutivité.
Cf. Hopper et Traugott (2003) pour une présentation exhaustive et récente de ces différents mécanismes et Marchello-Nizia (2006)
2.1. Prérequis et facteurs déclenchants
Les prérequis:
� Nature des « candidats » : plutôt des catégories majeures (nom, verbe)
� Sémantisme assez général: aller s'est grammaticalisé en auxiliaire, mais pas cheminerou courir
� Fréquence(critère lié au précédent)
Prérequis nécessaires mais non suffisants : la grammaticalisation n’est pas systématique
-> Les motivations
Elles sont surtout d’ordre pragmatique :- pression de la norme, des groupes influents
- désir d’expressivité, cf. Meillet :
« toujours le besoin d’expression fait créer des groupes qui, par l’usage, perdent leur valeur expressive et servent alors de formes grammaticales, dénuées de force. »
- Notion revue avec une prise en compte plus explicite de l’allocutaire : volonté de produire un effetcf. Keller (1994) : « parlez de façon à être remarqué » (social success)
2.2. Les mécanismes � Principe de l’unidirectionnalité� Réanalyse: Changement dans la structure profonde d’une unité,
sans manifestation en surface (reparenthésage)Caractère abruptD'abord dans des contextes discursifs spécifiques
� Extension (analogique) : C’est elle qui permet de percevoir la réanalyseCaractère progressif- will : perte de la limitation à des sujets + hum- pas: n'est plus restreint aux verbes de motion
Rôle essentiel du contexte
2.2.1. Phénomènes morpho-syntaxiquesassociés à la réanalyse
� recatégorisation:
changement de catégorie (majeure > mineure, ou mineure > plus mineure)
� décatégorialisation:
Perte des marqueurs de catégorialité et privilèges syntaxiques de catégories majeures : inaptitude à référer, perte de l'article, des désinences verbales...Ex. des auxiliaires en anglais
� perte de liberté:
� hausse de la liaison structurelle et phénomènes de coalescence, par ex :
- un mot devient clitique, voire affixe
- un ex-complément se soude à son radical : adv en -ment, futur amare habeo
� une fixation de la position
2.2.3. les changements sémantiques
Un peu sous-estimés au départ, car approche centrée sur les aspects morpho-syntaxiques
Passage du sens lexical au sens grammatical
= Affaiblissement sur le plan sémantique ->‘désémantisation’, ‘affaiblissement’,
‘décoloration’, ‘semantic bleaching’(Peyraube: ‘javellisation’)
Mais interprétation qui ne reconnaît que le sens lexical
Approche désormais plus nuancée :
� le sens grammatical parfois plus complexe (par ex. dans les prépositions)
� ‘Déplacement du sens’, de nature métaphorique ou métonymique
Et même si « affaiblissement » du sens lexical à la fin du processus, au début souvent un renforcement sur le plan pragmatique.
La métaphorisationLa métaphore serait plutôt le résultat du
changement, pas son moteur
Mise au jour de chaînes sémantiques, avérées dans de nombreuses langues différentes (cf. Heine et Kuteva 2002)
Toutes les positions ne sont pas forcément instanciées
� Personne/partie du corps > objet > activité > espace > temps > qualité
- prépositions spatiales < parties du corps: en face de, au dos de, à la tête de, aux pieds de, à côté de …
- prépositions temporelles < espace : dans l’espace de, après, after
- auxilaires temporels < verbes de mouvement : il va/ vient de pleuvoir
- behind: qualité < espace : intellectually behind, arriéré
� (Espace) > temps > cause / opposition,concession
Since, puisque / alors que, while
La métonymisationcf. Traugott et Dasher 2002
Processus qui serait à l’origine de nombreux changements, même si le résultat peut être interprété comme une métaphore
Idée que la possibilité d’évolution se trouve dans le sens même du mot et qu’un trait va se développer dans certains contextes.
Contextes qui vont favoriser une inférence
« invited inference »
Inférence qui va peu à peu se sémantiser, se conventionnaliserpar l’usage fréquent
Chemin : sens codé dans le lexique > nouvelles valeurs sémantiques contextuelles > signification liée à un nouveau type de contexte (polysémie pragmatique) > nouveau sens codé
Mais l’ancien sens peut se maintenir : polysémie
Exemples :
• Aller : mouvement > intention > futur
• Dès lors que / puisque : temporel (post) > causalCf. Post hoc, ergo propter hoc : l’antécédent devient cause
• tandis que (<tanz dis < tamdiu)/alors que : concomittance > opposition (concession):
Le nouveau sens se développe dans des contextes ambigus : Il est sorti tandis /alors qu’il faisait beauIl est sorti tandis /alors qu’il pleuvait
Initialement pragmatiques et associatifs, les changements ont lieu dans le flux du discours
La subjectification(Cf Traugott 1995 et passim)
Mouvement vers une interprétation abstraite et subjective du monde (en termes de langage):
Sens ancré dans le monde de la référence > sens ancrés dans la monde des locuteurs (raisonnement, croyance, attitude métatextuelle / discours)
Explicite le point de vue du locuteur.Intervient dans le processus d’inférence. Exemples typiques : • Adverbes d’énonciation : franchement, sincèrement,
vraiment ...• Marqueurs évaluatifs du haut degré/degré excessif:
beaucoup < un beau coup (Marchello-Nizia)
2.3. La temporalité des changements
L’étude des textes montre que la plupart des changements sont progressifs,
et non « catastrophiques »: cf. Lighfoot 79 :
Changement se ferait via la réanalyse et donc via une nouvelle grammaire et passerait donc par les enfants en phase d’acquisition.
Approche revue par la suite :
- La grammaire des adultes peut se modifier
- Un adulte peut maîtriser plusieurs grammaires (cf. grammaires en compétition)
Idée aussi que le chagement doit être initié par un groupe influent … ce que ne sont pas les enfants.
Le changement se fait progressivement et par étapes.
Modèle en 4 étapes proposé par Heine (2002)Cf processus de sémantisation des inférences.
- Stade 1 : initial stage : sens originel- Stade 2 : bridging context: construction d’une
inférence -> nouvelle signification qui passe au premier plan. Contextes spécifiques
- Stade 3 : switch context: contexte incompatible avec signification d’origine. Le sens originel passe au second plan (mais toujours là). Nouveau sens n’apparaît pas que dans contextes ambigus.
- Etape 4 : conventionalisationdes nouveaux contextes qui marquent la primauté du sens nouveau.
Heine:changement du sens d’un mot = changementdes constructions dans lesquelles il peut entrer
A > Ab > aB > BSchéma possible, mais le sens A peut se maintenir. On parle de divergence : la forme originale demeure
comme item lexical autonomeEx de avoir : j’ ai une voiture neuve
j’ ai bien dormije viendrai
Hagège (1993) parle de « preuve par anachronie », signe que la grammaticalisation est achevée:
Je vais aller au marché / il n’a pas fait un pas