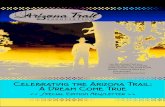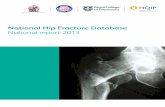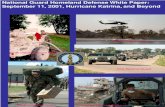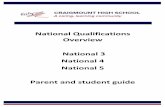Réferentiel National
-
Upload
kdsessions -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Réferentiel National
-
8/18/2019 Réferentiel National
1/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
1
MINISTERE DE L’ ENERGIE, DE L’ ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L’ AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
MINISTERE DE L’ INTERIEUR, DE L’ OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
MINISTERE DE L’ AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Projet deréférentiel national
de la défense extérieurecontre l'incendie
-
8/18/2019 Réferentiel National
2/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
2
PLANDU REFERENTIEL NATIONAL DE LA DEFENSE
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIEIntroduction
1- Préambule2- L’essentiel et l’esprit
Chapitre 1LES PRINCIPES DE
LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
1.1 L’approche par risques1.2 Les quantités d’eau de référence1.3 Le calcul des distances1.4 Le cas des exploitations agricoles1.5 Cohérence d’ensemble, approche globale
Chapitre 2LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DES DIFFERENTS POINTS D’EAU INCENDIE
2.1 Caractéristiques communes
2.1.1 Pluralité des ressources2.1.2 Capacité et débit minimum2.1.3 Pérennité dans le temps et l’espace
2.2 Inventaire indicatif des points d’eau incendie concourrant à la DECI
2.2.1 Points d’eau incendie normalisés2.2.1.1 Poteaux d'incendie2.2.1.2 Bouches d'incendie
2.2.2 Points d’eau incendie non normalisés2.2.2.1 Points d’eau naturels ou artificiels2.2.2.2 Points de puisage2.2.2.3 Réseau d'irrigation agricole2.2.2.4 Citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réserves
fixes 2.2.2.5 Autres dispositifs
-
8/18/2019 Réferentiel National
3/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
3
2.3 Equipement et accessibilité des points d’eau incendie2.4 Glossaire
-
8/18/2019 Réferentiel National
4/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
4
Chapitre 3
LA SIGNALISATION DES POINTS D’EAU INCENDIE3.1 Couleur des appareils3.2 Exigences minimales de signalisation3.3 Protection et signalisation complémentaire3.4 Symbolique de signalisation et de cartographie
Chapitre 4GESTION GENERALE DES POINTS D’EAU INCENDIE
ET DES RESSOURCES EN EAU
4.1 Défense extérieure contre l’incendie et gestion globale des ressources en eau4.2 Les points d’eau incendie privés4.3 Cas d’aménagement de points d’eau incendie publics sur des parcelles privées4.4 Gestion des points d’eau incendie par un délégataire4.5 Utilisation des points d’eau incendie
Chapitre 5RECEPTION, CONTRÔLE, ENTRETIEN ET SUIVI OPERATIONNEL
DES POINTS D’EAU INCENDIE
5.1 – Réception
5.1.1 Points d’eau incendie alimentés à partir d’un réseau sous pression5.1.1.1 Cas d’un seul point d’eau incendie5.1.1.2 Cas de plusieurs points d’eau incendie
5.1.2 Autres points
5.2 – Contrôle
5.2.1 BI et PI alimentés à partir d’un réseau de distribution d’eau public5.2.2 Les BI et PI alimentés par un réseau d’eau public de distribution d’eau mais
situés sur un domaine privé5.2.3 Les points d’eau incendie alimentés à partir d’un réseau privé
5.3 – Entretien permanent
5.4 – Reconnaissance opérationnelle
5.4.1 BI et PI alimentés par un réseau d’eau
5.4.2 Points d’eau incendie artificiels ou naturels
5.5 – Visites conjointes
-
8/18/2019 Réferentiel National
5/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
5
Chapitre 6LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE6.1 Possibilités opérationnelles du SDIS6.2 Grilles de couvertures6.3 Adaptations locales6.4 Consultation6.5 Vérifications
Chapitre 7LE SCHEMA COMMUNAL
DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
7.1 Objectifs
7.2 Processus d'élaboration
7.2.1 Analyse des risques7.2.2 Etat de l’existant de la défense incendie7.2.3 Application des grilles de couverture
7.3 Constitution du dossier du SCDECI
7.3.1 Courrier de demande7.3.2 Référence aux textes en vigueur7.3.3 Méthode d’application7.3.4 Etat de l’existant de la défense incendie7.3.5 Analyse, couverture et propositions7.3.6 Cartographie7.3.7 Divers7.3.8 Procédure de mise en application
7.4 Procédure de révision
ANNEXES
Annexe n°1 Normes de référenceAnnexe n°2 Code d'observation points d’eau incendieAnnexe n°3 Exemple de SCDECI : cartographie de la DECIexistanteAnnexe n°4 Exemple de SCDECI : cartographie de propositionsAnnexe n°5 Exemple de SCDECI : Tableau de propositionsAnnexe n°6 Nomenclature d’une base de données des points d’eau incendie
-
8/18/2019 Réferentiel National
6/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
6
Introduction
Préambule
Ce référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) complète ledécret n°2009- du … 2009 relatif à l'aménagement, l’entretien et la vérification des pointsd’eau incendie servant à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie codifié aux articlesR2212-16 et suivants du Code général des collectivités territoriales..
Il définit une méthodologie, il présente des solutions possibles et fixe les grands principes,dont une hiérarchisation simplifiée des risques à couvrir par la défense incendie.
Il n'est pas directement applicable sur le terrain.
Il est nécessairement décliné par un règlement départemental de la défense extérieurecontre l’incendie (RDDECI) et, à la demande des communes, par les schémas communaux de ladéfense extérieure contre l’incendie (SCDECI).
Il s'adresse à l'ensemble des acteurs concernés par le sujet, principalement les sapeurs- pompiers mais aussi les élus, administrations, distributeurs d'eau, aménageurs urbains,…
Il définit des principes généraux relatifs à l'implantation et à l'utilisation des points d’eauincendie destinés à la DECI en laissant aux échelons locaux la cohérence et l'adaptation dans samise en œuvre.
Il constitue une « boîte à outils » pour établir le règlement départemental et les schémascommunaux de défense incendie.
Il aborde l’ensemble des questions relatives à la DECI permettant de donner des bases oudes pistes de solutions aux concepteurs de celle-ci.
Il aborde les principes généraux de la défense extérieure contre l’incendie et détaille la protection des bâtiments. Ainsi la DECI des espaces naturels, des infrastructures de transport oudes installations industrielles n’est pas directement abordée.
Toutefois, les mesures relatives à la protection des forêts contre l’incendie peuvent êtreintégrées au RDDECI et aux SCDECI dans les conditions fixées par le décret susvisé,
particulièrement pour ce qui concerne des zones d’interface entre les forêts et l’urbanisation.
Les mesures de défense extérieure contre l’incendie pour les autres espaces naturels ou lesvoies et ouvrages routiers ou ferroviaires, par exemple, si elles ne relèvent pas d’autresréglementations, peuvent être abordées après analyse des risques dans les RDDECI et lesSCDECI. Il en est de même pour les besoins en eau destinés à la lutte contre des sinistres autresque les incendies (certaines pollutions par exemple).
Les domaines qui ne sont pas traités dans ce référentiel et dans les autres réglementationsapplicables en matière de défense incendie doivent être réglés au niveau local.
-
8/18/2019 Réferentiel National
7/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
7
Pour l’application du présent référentiel :
- aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne, leterme :- « préfet » est remplacé par "préfet de police"- « service départemental d’incendie et de secours » est remplacé par « brigade de sapeurs-
pompiers de Paris »,- « règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie » est remplacé par
« règlement interdépartemental de défense extérieure contre l’incendie »,- « schéma départemental d'analyse et de couverture des risques » est remplacé par
« schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques »,- à la commune de Paris, le terme "maire" est remplacé par "préfet de police".
- à la commune de Marseille, le terme « service départemental d’incendie et de secours » estremplacé par « bataillon des marins-pompiers de Marseille».
L’essentiel et l’esprit de la nouvelle défense extérieure contrel’incendie
La nouvelle défense extérieure contre l’incendie a pour objectif de moderniser et declarifier le domaine en s’appuyant sur des expériences de terrain qui ont donné de bons résultats.
Principes généraux
La réforme donne une nouvelle assise juridique, de niveau réglementaire, à ce domaine etvise à :
- réaffirmer et clarifier les pouvoirs des maires dans ce domaine tout en améliorant et enadaptant le cadre de leur exercice,
- préciser les rôles respectifs des communes et du service départemental d'incendie et desecours (S.D.I.S.) dans le domaine de la défense contre l’incendie,
- améliorer le niveau de sécurité en permettant de développer une défense contre
l’incendie efficiente,- inscrire la défense contre l’incendie dans une approche globale de gestion des ressourcesen eau et d’aménagement des territoires,
- optimiser les dépenses financières afférentes.
La défense contre l’incendie se met en cohérence avec les lois de décentralisation, deréforme des services d'incendie et de secours et de modernisation de la sécurité civile.
Une nouvelle approche de conception de la défense contre l’incendie est définie : l’analysedes risques est au cœur de la définition des ressources en eau pour l’alimentation des engins delutte contre l’incendie. Enfin, elle permet d’intégrer et d’adapter ces moyens de défense aux
contingences de terrain, dans une politique globale soit à l’échelle départementale, soit à l’échellecommunale. Il ne s’agit donc plus de prescrire de manière uniforme sur tout le territoire lescapacités en eau mobilisables.
-
8/18/2019 Réferentiel National
8/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
8
L’objectif final est de réaliser une défense communale de proximité qui parte de référencesgénérales établies au niveau national, déclinées et coordonnées au niveau départemental.
Cadre
Un cadre réglementaire à 3 niveaux est fixé : national, départemental et communal. Lesanciens textes sont abrogés (circulaires du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du 9 août1967 ainsi que les parties afférentes du règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-
pompiers communaux).
Le cadre national
Le cadre national, pris sous la forme du décret n°2009- et de l’arrêté du ….2009 fixant le présent référentiel méthodologique définit :
- les grands principes,- la méthodologie commune,- les solutions techniques possibles (proposée sous forme de panel non exhaustif),- la cohérence technique minimum : prises, signalisation, …
Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie
Le règlement départemental est la clef de voûte de la nouvelle réglementation de ladéfense contre l’incendie. C'est à ce niveau que sont élaborées les "grilles de couverture". Il estréalisé à partir d’une large concertation avec les élus et les techniciens et arrêté par le préfet dedépartement.
Il permet de fixer des règles adaptées aux risques à défendre.
Il prend en compte les moyens et les techniques des services d’incendie et de secours ainsique leurs évolutions
Il est ainsi complémentaire du schéma départemental d’analyse et de couverture desrisques (S.D.A.C.R.) et intégré au règlement opérationnel du service départemental d’incendie etde secours.
Le schéma communal de défense extérieure contre l’incendie
Le schéma communal de défense extérieure contre l’incendie est élaboré pour chaque commune, à sa demande, par le S.D.I.S., conseiller technique du maire en la matière. Il est arrêté par le maire.
Il définit les différents risques sur tout le territoire de la commune ainsi que l’existant enmatière de défense contre l’incendie. Ainsi, il permet non seulement d’identifier le type de risquescouvert par la défense incendie existante mais surtout de mettre en évidence le complément qu'ilconviendrait de disposer pour mettre en adéquation les risques et les protections. Ce schéma doitégalement prendre en compte le développement projeté de l'urbanisation.
Il définit les besoins réels de ressources en eau pour la commune et permet la planificationdes équipements de renforcement ou de complément de cette défense. Il fixe, sur proposition du
-
8/18/2019 Réferentiel National
9/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
9
SDIS, les objectifs et les moyens permettant d'améliorer la défense des risques existants et prenden compte leur évolution prévisible.
Principes détaillés
L’analyse des risques
La réforme est notamment basée sur l’analyse des risques, une méthode qui s’appliquedans la continuité du SDACR, en définissant les risques comme suit :
- courants : Ils sont répartis en risques courants faibles, ordinaires et importants. les risques courant importants sur les agglomérations à forte densité ; les risques courants ordinaires sont les risques des autres agglomérations; les risques courants faibles sont constitués par les hameaux, écarts, …
- particuliers (zones d’activités , bâtiments agricoles,…)
L’adaptation des besoins en eau
Les quantités d’eau de référence et l’espacement des points d’eau entre eux et par rapportaux enjeux, sont ainsi adaptés à l’analyse des risques :
· risques courants :§ faibles : au minimum 30 m3 utilisables en 1 h. Cette quantité d’eau et la
durée peut être adaptée en fonction de la nature des risques à défendre,§ ordinaires : 120 m3 utilisables en 2 heures,§ importants : plusieurs sources de 120 m3 utilisables en 2 heures, au cas par
cas
· risques particuliers : une grille de couverture doit être précisée dans le règlementdépartemental impliquant éventuellement une étude spécifique.
Les ressources en eau
Les ressources en eau utilisables sont des ouvrages publics et privés constitués par :
· les bouches et poteaux d’incendie alimentés à partir d’un réseau de distributiond’eau ;· les points de ressource en eau naturels ou artificiels ;· les points d'aspiration ou autres prises d’eau conformes aux spécifications fixées
pour chaque département.
Le principe de l’utilisation cumulative de plusieurs ressources en eau est établi, dès lors oùchacune fait plus de 30 m3.
Le suivi des points d’eau
-
8/18/2019 Réferentiel National
10/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
10
Les règles relatives au suivi des points d’eau sont également éclaircies :
• responsabilité communale du contrôle : sous l’autorité du maire, un dispositif de contrôletant pour les points d’eau publics que privés est mis en place , afin de garantir la mise à
disposition permanente des points d'eau,
• reconnaissance de l’existence et de l’accessibilité par le SDIS : le SDIS, en accord avec lemaire, effectue une reconnaissance opérationnelle des points d'eau. Les résultats de cettereconnaissance sont transmis au maire,
· répertoriation opérationnelle des points d’eau par les SDIS.
-
8/18/2019 Réferentiel National
11/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
11
Chapitre 1
LES PRINCIPES DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
L’efficacité des opérations de lutte contre les incendies dépend notamment de laconnaissance des risques du secteur et de l’existence des ressources en eau.
Ainsi, chaque maire doit, en liaison avec le SDIS, entretenir les points d’eau incendie publics existants et aménager des nouveaux points d’eau incendie publics pour assurer lacouverture des risques.
L'évaluation des besoins en eau demeure une compétence des services départementaux
d'incendie et de secours. Cette évaluation s’appuie sur une analyse des risques. Bien quespécifique à chaque projet, elle peut être appréciée sur la base des principes suivants :
1 1 L’approche par risques
La conception de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) doit être complémentairedu schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) prévu à l’articleL1424.7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La méthodologie d'évaluation des besoins en eau (volume et distances des points d’eau
incendie) destinée à couvrir les risques d'incendies bâtimentaires s'appuie sur la différentiation desrisques courants et particuliers.
1.1.1 Le risque courant
Le risque courant qualifie un événement non souhaité qui peut être fréquent, mais dontles conséquences sont plutôt limitées. Ce type de risque va principalement concerner lesimmeubles d’habitation.
Exemple : feu de chambre ou d’appartement, feu de maison, ...
Afin de définir une défense incendie adaptée et proportionnée aux risques, il est nécessairede décomposer le risque courant en 3 catégories :
Le risque courant faible : il peut être défini comme un risque d’incendie dont l’enjeu estlimité en terme patrimonial, isolé, à faible potentiel calorifique ou à risque de propagation quasinul aux bâtiments environnants.
Il peut concerner, par exemple un bâtiment d’habitation isolé en zone rurale.
-
8/18/2019 Réferentiel National
12/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
12
Le risque courant ordinaire : il peut être défini comme étant un risque d’incendie à potentiel calorifique modéré et à risque de propagation faible ou moyen.
Il peut concerner par exemple un lotissement de pavillons, un immeuble d’habitationcollectif, une zone d’habitat regroupé….
Le risque courant important : il peut être défini comme un risque d’incendie à fort potentiel calorifique et / ou à risque de propagation fort.
Il peut concerner par exemple une agglomération avec des quartiers saturés d’habitations,
un quartier historique (rues étroites, accès difficile, …), de vieux immeubles où le bois prédomine,une zone mixant l’habitation et des activités artisanales ou de petites industries à fort potentielcalorifique.
1.1.2 Le risque particulier
Le risque particulier qualifie un événement dont l’occurrence est très faible, mais dontles enjeux humains ou patrimoniaux peuvent être importants. Les conséquences et les impactsenvironnementaux, sociaux ou économiques peuvent être très étendus.
Il peut concerner par exemple les établissements recevant du public de première catégorie,
les immeubles de grande hauteur ou les sites industriels,…Il peut concerner également le risqued’incendie dans les exploitations agricoles (ce type de risque est spécifiquement traité au paragraphe 1.4).
Dans tous les cas, ces différentes typologies de sites nécessitent une approche particulièredans laquelle les principes de la prévention contre l’incendie mis en application, visant à empêcher la propagation du feu en particulier, peuvent être pris en compte dans la définition des solutions.
1 2 Les quantités d’eau de référence :
La quantité d’eau nécessaire pour traiter un incendie doit prendre en compte les deux phases
suivantes, d’une durée totale moyenne de deux heures :
La lutte contre l’incendie au moyen de lances, comprenant :- l’attaque et l’extinction du ou des foyers principaux ;- la prévention des accidents (explosions, phénomènes thermiques, etc…)- la protection des intervenants,- la protection des espaces voisins (bâtiments, tiers, espaces boisés , etc…).
Le déblai et la surveillance incluant l’extinction des foyers résiduels nécessitant l’utilisationde lances par intermittence.
-
8/18/2019 Réferentiel National
13/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
13
La nécessité de poursuivre l’extinction du feu sans interruption et d’assurer la protection desintervenants exige que cette quantité d’eau puisse être utilisée sans déplacement des engins. Ainsi,au regard des moyens des sapeurs-pompiers, qui doivent être facilement et rapidement mis enœuvre , les points d’eau incendie doivent être positionnés à proximité immédiate du risque.
1 2 1 Les quantités d’eau de référence pour le risque courant
- Pour le risque courant faible : la quantité d’eau demandée doit correspondre à un besoin au regard du risque réel que constitue le bâtiment.
Ainsi, il est admis que les besoins minimums correspondant à l’incendie d’unehabitation individuelle d’une surface développée inférieure à 250 m² (surface horsœuvre brute) et distante de 8 mètres de toute autre risque sont de 30 m3 utilisable en 1heure ou de 30 m3 instantanément disponible.
Cette surface de référence et cette distance d’isolement peut varier en fonction descaractéristiques des bâtiments (matériaux de construction, volumes,…) ou de leur environnement (risque de propagation en provenance ou en direction d’un espacenaturel…).
- Pour le risque courant ordinaire : la quantité d’eau demandée est de 120m3 utilisablesen 2 heures.
- Pour le risque courant important : il y aura lieu de prévoir l’intervention simultanée de plusieurs engins-pompes de 60 m3/h : l’estimation du débit horaire dont il seranécessaire de disposer à proximité de chaque risque isolé doit être fonction du nombrede lances que comporte le dispositif d’attaque défini a priori par les sapeurs-pompiers.
1 2 2 Les quantités d’eau de référence pour le risque particulier
Les besoins en eau sont calculés suivant une analyse basée sur :
- le potentiel calorifique (faible, fort) ;- l’isolement- la surface la plus défavorable (ou volume) ;- la durée d’extinction prévisible. Par défaut, la durée moyenne retenue sera de 2 heures. Il
est régulièrement démontré que le volume total utilisé est globalement celui du dispositif théorique utilisé pendant 2 heures : pendant la phase de montée en puissance, ce dispositif augmente au fur et à mesure jusqu’à obtenir un débit suffisant pour être maître du feu ; ledispositif sera alors réduit au fur et à mesure de l’extinction finale.
Le calcul de ces besoins est effectué à partir d’une grille indicative nationale afin d’éviter des bases de calcul trop disparates pour la même activité d’un département à l’autre (exemple :implantation de grandes surfaces de ventes standardisées). Il est précisé dans chaque règlementdépartemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI).
Un modèle de grille pour les établissements recevant du public (ERP) et les établissements
d’activités (industrielles, tertiaires…) est précisé ci-dessous :
-
8/18/2019 Réferentiel National
14/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
14
Tableau indicatif des débits d’eau pour les ERP et bureaux
Bureaux et ERP à risque courant Bureaux et ERP à risque particulier 1
PRINCIPE 500 litres/minute par tranchede 500 m²
1000 litres /minute par tranchede 500 m²
DUREE 2 heures 2 heures
RECOUPEMENT Coupe-feu 2 heures minimumde façade à façade
Coupe-feu 2 heures minimumde façade à façade
Tableau indicatif des débits d’eau pour les autres bâtiments
Principes 500 litres/minute pour 500 m² pour les bâtiments à faible
potentiel calorifique
1000 litres /minute pour 500 m² pour les bâtiments à fort potentiel
calorifique
La superficie à prendre en compte pour le calcul est la plus grande surface non recoupée par des murs CF dedegré 2 h continu de façade à façade.
Dans le cas d’une installation d’extinction automatique sur tout le bâtiment, le débit pourra être divisé aumaximum par 2. Les débits d’eau nécessaires pour l’extinction automatique et pour la défense extérieure
contre l’incendie sont distincts.De même, la présence de moyens de secours et d’équipe d’intervention interne permanente, un coefficient deminoration pourra être prévu.
Par ailleurs, pour les risques particuliers ou les risques courants importants, notamment dansles zones d’activités industrielles ou commerciales, il peut être préconisé qu’au minimum un tiersdes besoins en eau soit satisfait à partir de bouches ou de poteaux d’incendie alimentés par unréseau en permanence sous pression.
Il conviendra de s’assurer du débit nominal lors de l’utilisation simultanée de plusieurs pointsd’eau incendie.
Les installations classées
Pour les installations classées soumises à déclaration, les arrêtés types peuvent définir les moyensen eau nécessaires.
Pour les installations classées soumises à autorisation, l’établissement doit être doté de moyens delutte contre l’incendie (poteaux ou bouches d’incendie, privés ou publics…) appropriés au risque.La quantité d’eau d’extinction et de refroidissement doit être validée en fonction d’une analyse derisques et inscrite dans l’arrêté préfectoral d’autorisation..
1 Tels que défini par l’article CO 6 du règlement de sécurité des ERP
-
8/18/2019 Réferentiel National
15/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
15
L’ensemble du dispositif doit être mis en cohérence avec le règlement opérationnel. Celui-cidéfinit la montée en puissance prévisible et possible des moyens publics de lutte contrel’incendie qui pourraient être normalement mis en œuvre dans des délais compatibles afin
de limiter la propagation rapide d’un incendie.
Cette approche peut conduire à une limitation des débits demandés au regard de la réponseopérationnelle des services d’incendie et de secours.
De même, cette approche doit être mise en cohérence avec des mesures de réduction durisque à la source (mesures de prévention).
Les débits de référence présentés dans ce paragraphe (30, 60, 120 m3) ne constituent pas des paliers fixes. Ainsi, l’analyse du risque peut aboutir à préconiser des valeurs intermédiaires : 45,75, 90 m3, etc.
1 3 Le calcul des distances
Le calcul des distances est fixé entre le risque et le point d’eau incendie par lescheminements praticables par les moyens des sapeurs pompiers. Le RDDECI doit définir lesdistances retenues, il peut également fixer la distances des points d’eau entre eux. Afin d’éviter detrop grandes disparités dans les départements, une grille indicative est présentée ci-dessous :
¨ pour le risque courant :
Niveau de risque distance entre un point d’eau incendie et un risque
Risque courant faible 400 m maximum
Risque courant ordinaire 200 mètres maximum
Risque courant importantCette distance peut être réduite
(100 m par exemple ou points d’eau incendie disposés enquinconce)
La distance fixée à 400 mètres est liée à la longueur des tuyaux équipant les engins « debase » de lutte contre l'incendie. Elle est localement adaptables aux caractéristiques réellesdes engins d’incendie.
-
8/18/2019 Réferentiel National
16/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
16
¨ Pour les risques particuliers :
Les distances à respecter sont :
A faible potentiel calorifique A fort potentiel calorifique
Distance entre le point d’eauincendie le plus proche et la
plus grande zone non recoupée
150 m 100 m
Distance entre 2 points d’eauincendie
150 à 200 m 100 à 150 m
Ensemble du dispositif (points d’eau incendie concourant
a priori au dispositif de lutte)
Les points d’eau incendie doivent être situés à moins de 500 m de l’accèsau bâtiment
La distance de 500 mètres correspond à des possibilités d’alimentation en eau réalisé aumoyen d’un engin d’incendie de type « dévidoir automobile ».
La distance entre un point d’eau incendie et un risque à défendre influe notablement surles délais, les volumes des moyens à mettre en œuvre par les sapeurs-pompiers et surl’efficacité de leur action.
1.4 Cas des bâtiments agricoles
Le particularisme du risque d’incendie dans les bâtiments agricoles doit conduire à unexamen particulier de leur défense extérieure contre l’incendie.
Les incendies les plus souvent rencontrés en milieu agricole intéressent les bâtiments
d’élevage mais en plus grand nombre les stockages de fourrages ou les stockages de diversesnatures. Ces derniers présentent un fort potentiel calorifique mais aussi un potentiel decontamination de l’environnement ou d’explosion.
Les bâtiments agricoles peuvent regrouper plusieurs types de risques :· habitation isolée et/ou enclavée et/ou contiguë aux risques ci-dessous,· élevage avec stockage de matières pulvérulentes,· stockage de produits cellulosiques (paille, foin…),· stockage d’hydrocarbure et de gaz (chauffage des locaux d’élevage et de
serres…),
· stockage de matériels et de carburants,· stockage de produits phytosanitaires
-
8/18/2019 Réferentiel National
17/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
17
· stockage d’engrais, notamment ceux à base d’ammonitrates,· stockage d’alcool (viticulture…),· ….
Ainsi les exploitations agricoles représentant un risque particulier peuvent relever de laréglementation des installations classées.
Compte tenu de ces risques et de l’isolement géographique fréquent des exploitations, ilconviendra de privilégier des capacités minima d’extinction sur place qui peuvent être communesavec des réserves ou des ressources à usage agricole (irrigation, hydratation du bétail…) sous desformes diverses : citernes, bassins,… Dans ces derniers cas, des prises d’eau aménagées utilisables
par les sapeurs-pompiers peuvent idéalement être prévues.
En fonction du potentiel calorifique, ces capacités hydrauliques primaires –si elles ne sont
pas suffisantes- peuvent être complétées par une ou des capacités extérieures en fonction des principes d’extinction du feu retenus a priori.
Afin de ne pas sur dimensionner le potentiel hydraulique destiné à la défense incendie et defavoriser l’action des secours, les exploitants doivent prendre en compte la réduction du risque àla source et en limiter les conséquences par des mesures de prévention telles que :
· compatibilité des produits chimiques stockés au même endroit,· séparation des engrais à base d’ammonitrates avec les autres produits,· séparation des stockages entre eux (fourrages notamment),· séparation des remises d’engins et des stockages,· recoupement des locaux par une séparation constructive coupe feu,· isolement des bâtiments entre eux par un espace libre suffisant au regard des flux
thermiques générés par un sinistre,· …
Certaines de ces dispositions constructives ou d’exploitation, relèvent de mesures de bonsens.
Sur la base d’une analyse des risques qui met en évidence :
- l’absence d’habitation, d’activité d’élevage ou de risques de propagation à d’autresstructures ou à l’environnement,
- une valeur faible de la construction et /ou du stockage à préserver,- des risques de pollution par les eaux d’extinction,
il peut être admis que ces bâtiments agricoles ne nécessitent pas une action d’extinction par les sapeurs-pompiers en cas d’incendie et ne disposent pas, en conséquence, de défenseextérieure contre l’incendie spécifiques à ces bâtiments.
NOTA : Les stockages de fourrages isolés « en plein champs » hors bâtiment peuventégalement ne faire l’objet d’aucune défense extérieure contre l’incendie.
Particulièrement en milieu agricole, il conviendra de rechercher des solutionspragmatiques, adaptées aux risques, simples et durables.
-
8/18/2019 Réferentiel National
18/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
18
1.5 Cohérence d’ensemble, approche globale
En fonction des analyses de risques et des objectifs de sécurité à atteindre, les RDDECI et
les SCDECI vont définir :- les volumes ou les débits des points d’eau incendie,- les distances séparant ceux-ci des risques,- les distances des points d’eau incendie entre eux.
Une cohérence est recherchée entre, d’une part, le SDACR et le règlement opérationnel -lesmoyens mobiles du SDIS, leurs caractéristiques, leurs équipements, leur répartition géographique,…- et, d’autre part, la défense extérieure contre l’incendie.
Aussi, de nombreux facteurs peuvent être pris en considération pour concevoir la DECI etinfluer sur les préconisations en matière de points d’eau incendie :
Sur l’analyse des risques :
- l’analyse des enjeux à défendre,- l’appréciation de la valeur des enjeux à protéger au regard de celle des équipements de
défense contre l’incendie,- les mesures de prévention réglementaires ou pratiques,- les contraintes réglementaires liées à certaines installations,- les objectifs de sécurité incendie,- …
Sur les techniques opérationnelles des services d’incendie et de secours :
- les techniques opérationnelles utilisées a priori ou spécifiquement,- la sollicitation physique des sapeurs-pompiers engagés sur opération,- les délais d’intervention face à la cinétique de développement d’un incendie,- la disponibilité des sapeurs-pompiers et des moyens qui peuvent être engagés (personnel et
matériel roulant),- les caractéristiques des engins d’incendie,- l’évolution des techniques opérationnelles d’extinction,- …
La prise en compte de tout ou partie de ces critères peut ainsi influer sur la conception de ladéfense incendie.
Par exemple, la couverture du risque courant faible peut ainsi conduire à des préconisationsvisant :
- au renforcement des départs de secours (par exemple : départ systématique et simultané dedeux engins pompes),- au raccourcissement des distances entre le risque et les points d’eau incendie ( par exemple 200mètres maximum)
-
8/18/2019 Réferentiel National
19/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
19
- à disposer de manière instantanée de l’ensemble de la ressource en eau ( par exemple uneréserve de 30m3 disponible immédiatement plutôt qu’une alimentation à partir de 30 m3
/ heure)
soit à d’autres solutions, des combinaisons ou une modulation des différentes réponsesopérationnelles, préventives et prévisionnelles .
Le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie et les schémascommunaux de défense extérieure contre l’incendie intègrent ces approches, en tant que de
besoin.
-
8/18/2019 Réferentiel National
20/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
20
Chapitre 2LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DES DIFFERENTS POINTS D’EAU INCENDIE
2.1 Caractéristiques communes des différents points d’eau incendie
La défense extérieure contre l’incendie ne peut être constituée que d’aménagementsfixes.
L’emploi de dispositifs mobiles ne peut être que ponctuel et consécutif à uneindisponibilité temporaire des équipements.
2.1.1 Pluralité des ressources.
Il peut y avoir, après avis du service départemental d’incendie et secours (S.D.I.S.),plusieurs ressources en eau pour la même zone à défendre dont les capacités ou les débits sontcumulables pour obtenir la quantité d’eau demandée.
2.1.2 Capacité et débit minimum.
Ne peuvent être intégrés dans la défense extérieure contre l’incendie que :
- les réserves d’eau d’au moins 30 m3 utilisables,
- les réseaux assurant, à la prise d’eau, un débit de 30m3
/h sous 1 bar de pressiondynamique au minimum.
Si les réseaux d’eau sous pression ne répondent pas à ces caractéristiques ou y répondentde manière aléatoire ou approximative il conviendra de recourir à d’autres dispositifs pour compléter ou suppléer cette ressource.
Ce seuil permet de s'adapter aux circonstances locales sans prendre en compte desressources inadaptées qui pourraient rendre inefficace l’action des secours et mettre en péril lessinistrés et sauveteurs.
De manière générale, les débits des points d’eau incendie sous pression à prendre encompte sont les débits constatés et non les débits nominaux des appareils.
2.1.3 Pérennité dans le temps et l’espace.
Tous les dispositifs retenus doivent présenter une pérennité dans le temps et l’espace.
Ce principe implique, en particulier, que l’alimentation des prises d’eau sous pression soitassurée en amont pendant la durée fixée (capacité des réservoirs ou des approvisionnementsnotamment).
-
8/18/2019 Réferentiel National
21/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
21
L’efficacité des points d’eau incendie ne doit pas être réduite ou annihilée par lesconditions météorologiques. Leur accessibilité doit être permanente.
L’interruption momentanée de l’alimentation en eau des engins peut être admise dans les
phases de déblais et de surveillance des incendies notamment dans le cadre du risque courantfaible. Par ailleurs cette interruption est admise dans le cadre de la lutte contre les feux d’espacenaturel.
D’une manière générale, les points d’eau incendie –en particulier les poteaux d’incendie-doivent satisfaire au minimum aux conditions de débit prescrites. Si ce n’est pas le cas, ilconvient d’adopter le dispositif d’un degré immédiatement inférieur dont lescaractéristiques extérieures correspondent aux capacités réelles.
2.2- Inventaire des points d’eau incendie concourant à la DECI
2.2.1Points d’eau incendie normalisés
2.2.1.1 Poteaux d'incendie
Les poteaux d’incendie (PI) doivent être conçus et installés conformément aux normescitées en annexe n°1 sous réserve des dispositions du présent référentiel, notamment pour ce quiconcerne la couleur ou la maintenance .
2.2.1.2 Bouches d'incendieLes bouches d’incendie (BI) doivent être conçues et installées conformément aux normes
citées en annexe n°1 sous réserve des dispositions du présent référentiel notamment pour ce quiconcerne la maintenance.
2.2.2Points d’eau incendie non normalisés
Le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie doit comprendre uninventaire des points d’eau incendie non normalisés retenus par le SDIS pour constituer la DECI.On citera pour exemple :
2.2.2.1 Points d’eau naturels ou artificiels
Les cours d'eau, mares, étangs, retenues d’eau, puits, forages, réserves ou réseaux d’eau, par exemple, constitués pour alimenter les dispositifs de type « canon à neige », … peuvent êtreadoptés sous réserve de répondre aux caractéristiques du paragraphe 2.1.
2.2.2.2 Points de puisage
Ils sont constitués d’un puisard relié à un plan d’eau ou cours d’eau par une canalisationde section assurant le débit requis.
-
8/18/2019 Réferentiel National
22/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
22
Les puisards d’aspiration
Les puisards d’aspiration, tels que décrits dans les textes antérieurs, ne doivent plus être installéscar le débit des canalisations d’alimentation permet souvent l’implantation d’un poteau d‘incendie
présentant de meilleures garanties d’utilisation ou à défaut une réserve de 30 m3 ré alimentée.
2.2.2.3 Réseau d'irrigation agricole
Les réseaux d’irrigation agricole peuvent être utilisés, sous réserve que l’installation présente les caractéristiques de pérennité citées ci-dessus et que les bornes de raccordement soientéquipées d’un ½ raccord symétrique de 65mm ou de 100mm directement utilisable par les SDIS.
2.2.2.4 Citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réservesfixes
Elles peuvent être alimentées par les eaux de pluie, par collecte des eaux au sol ou deseaux de toiture. Les citernes alimentées par collecte des eaux de pluie au sol peuvent être équipéesd’une vanne de barrage du collecteur afin d’éviter les retours d’eau d’extinction.
Elles peuvent être alimentées par un réseau d’eau ne pouvant fournir le débit nécessaire àl’alimentation d’un poteau d’incendie ou par porteur d’eau (cas particulier de la DFCI ). Dans lecas des réserves ré alimentées automatiquement par un réseau sous pression, le volume de réserve
prescrit peut-être réduit du double du débit horaire d’appoint dans la limite de la capacité minimalede 30m3.
Exemple : pour un débit d’appoint de 15m3/h=>15x2 = 30 m3 => réserve prescrite de 120 m3 – 30 m 3 = 90 m3 à réaliser.
Dans le cas de réserve à l’air libre un dispositif devra permettre le maintien permanent dela capacité nominale prévue (débit d’appoint automatique, sur dimensionnement intégrantl’évaporation moyenne annuelle...)
2.2.2.5 Autres dispositifs
Tous autres dispositifs reconnus opérationnels et antérieurement répertorié par le SDIS peuvent être retenus. C’est, par exemple, le cas des puisards de 2m3 ne pouvant êtreimmédiatement remplacés..
Le règlement départemental de DECI peut agréer tout autre dispositif répondant auxcaractéristiques générales citées aux paragraphes 2.1 et 2.3 du présent chapitre.
Lorsque les points d’eau incendie retenus par le RDDECI sont dotés de prises deraccordement aux engins d’incendie, celles ci doivent être utilisables directement et enpermanence par les moyens du SDIS.
Les piscines privées
-
8/18/2019 Réferentiel National
23/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
23
Ces ouvrages ne présentent pas, par définition, les caractéristiques requises notamment en termede pérennité de la ressource, de pérennité de leur situation juridique (en cas de changement de
propriétaire) ou en terme de possibilités d'accès des engins d'incendie…
Ils peuvent être utilisés exclusivement dans le cadre de l’auto protection de la propriété, mais nedoivent pas être intégrés au règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie ouaux schémas communaux ou intercommunaux de la défense extérieure contre l’incendie.
2.3- Equipement et accessibilité des points d’eau incendie
2.3.1 Les ouvrages ou dispositifs cités en 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.4, 2.2.2.5, peuventêtre :
-équipés complètement (plate-forme de mise en station et dispositif fixe d’aspiration)
-équipés partiellement (plate forme de mise en station)-non équipés (permettant à minima la mise en oeuvre d’une moto pompe flottante)
Une plate forme de mise en station des engins est constituée d’une surface de 4m x 3m par moto-pompe remorquable au minimum ; 8m x 4m par véhicule poids lourd au minimum ;
présentant une résistance au poinçonnement permettant la mise en station d’un véhicule poidslourd, dotée d’une pente de 2% permettant d’évacuer les eaux de ruissellement et d’un dispositif fixe de calage des engins. Le RDDECI peut fixer des caractéristiques techniques complémentairesen fonction des spécifications des engins d’incendie susceptibles d’être mis en œuvre.
Plan
Evacuation d’eau et calage
Pente
8 m
4 m
A
Berge
ente
ente
ente
-
8/18/2019 Réferentiel National
24/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
24
Un dispositif fixe d’aspiration est composé d’au moins un ½ raccord symétrique , une canalisationrigide ou semi-rigide, une crépine sans clapet implantée à 50 cm du fond du bassin au moins et à30 cm en dessous du niveau le plus bas du volume disponible. Dans le cas ou plusieurs dispositifssimilaires doivent être installés sur la même ressource, ils doivent être distant de 4m au moins l’unde l’autre.
0.3 m minimum
0.5 m minimum
5,5 m maximum
H : 0,5m mini à 0,8 m maxi
½ raccord symétrique
Canalisation rigide ousemi-rigide
Crépine sans clapet
-
8/18/2019 Réferentiel National
25/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
25
Chaque dispositif doit être régulièrement nettoyé et entretenu. Si ce ne peut être le cas il pourra être pivotant pour n’être immergé qu’en cas de besoins afin d’éviter l’envasement et le bouchage de la crépine. Tout autre dispositif visant a maintenir la pérennité du dispositif pourraêtre agréé par le RDDECI.
Les réserves d’eau à l’air libre peuvent avantageusement être équipées d’une échellegraduée permettant de repérer le niveau de remplissage de référence.
La prise de raccordement à la pompe d’un dispositif d’aspiration, en particulier celles desciternes fixes, peut être protégée par un coffre identique à ceux équipant les PI. Dans cecas, cette protection doit pouvoir être ouvertes avec les mêmes accessoires que ceuxpermettant la manœuvre des poteaux d’incendie normalisés. Ces prises sont signaléesconformément au chapitre 3.
Toutefois, dans ce cas, l’installation d’un poteau d’incendie de type normalisé est àproscrire. Le dispositif doit être celui d’une prise d’aspiration.
- Ouvrage non équipé
Dans le cadre du risque courant faible ou pour la défense des espaces naturels ou agricolesil peut-être admis par le RDDECI qu’une réserve ou un point de puisage soit uniquementaccessible à pied afin de mettre en oeuvre un dispositif d’alimentation du type moto-pompeflottante par exemple.
2.3.2 Accessibilité
Tous les points d’eau incendie cités au chapitre 2 doivent être accessibles aux engins oumatériels d’incendie dans des conditions permettant de les utiliser.
Ils doivent répondre, lorsque c’est le cas, aux réglementations afférentes à la sécuritéincendie des immeubles d’habitation ou des établissements recevant du public.
Ils doivent être situés à moins de 10 m. du point de stationnement de l’engin adaptélorsqu’il s’agit de prises d’eau sous pression non normalisées.
Les poteaux et bouches d’incendie normalisés doivent être situés à moins de 5 m. du pointde stationnement de l’engin.
Les points d’eau incendie peuvent être implantés en prenant en compte une distance permettant d’éviter ou de limiter l’exposition au flux thermique. Une distance d’isolement entre le point d’eau incendie et une façade peut ainsi être prescrite.
D’une manière générale, les règles d’implantation, d’installation et d’accessibilité à tous lestypes de points d’eau incendie doivent être validées par le SDIS et être précisées dans lesRDDECI.
2.3.3 Mesures de protection
-
8/18/2019 Réferentiel National
26/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
26
Toutes dispositions réglementaires ou de bon sens doivent être prise pour protéger lessurfaces d’eau libre afin d’éliminer tout risque de noyade accidentelle. Les dispositifs de sécuritédevront permettre la mise en oeuvre des engins et matériels des sapeurs-pompiers sans délai etsans outillage spécifique (dispositif de condamnation manœuvrable par polycoises ou tricoises, par
exemple).
QUELQUES EXEMPLES D EQUIPEMENTS
Réserve incendie alimentée par recueil d’eau de pluieavec trop plein et alimentation d’appoint
Réserve incendie souple avec colonnes fixes d’aspiration enterrées et protégées par capot
-
8/18/2019 Réferentiel National
27/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
27
2.4 Glossaire
Accessibilité : capacité d’une voie ou d’une zone à assurer la mise en station et en action d’unengin de lutte contre l’incendie ou du matériel divers de lutte contre l’incendie.
Capacité utilisable : volume d’eau disponible pour l’usage des moyens du SDIS dans les limitesdes contraintes de mise en aspiration des engins, notamment la hauteur géométrique d’aspirationet la hauteur d’eau en dessous et au dessus de la crépine.
Hauteur d’aspiration : hauteur entre la surface du niveau le plus bas du volume d’eau utilisableet le plan de station de la pompe mise en oeuvre.
Prise d’eau : tout équipement sous pression permettant l’alimentation des engins de lutte contrel’incendie.
Point d’eau incendie : toute source d’alimentation en eau des engins de lutte contre l’incendielistée par le référentiel national ou agréé par le règlement départemental de DECI.
-
8/18/2019 Réferentiel National
28/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
28
Chapitre 3LA SIGNALISATION DES POINTS D’EAU INCENDIE
3.1 Couleur des appareils
Les poteaux d’incendie sous pression sont de couleur rouge incendie sur 50 % de leur surface au moins. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants. Le rouge symboliseainsi un appareil sous pression d’eau permanente.
Les capots de protection des colonnes d’aspiration (en particulier des citernes aériennes ouenterrées) sont de couleur bleu ciel sur 50 % de leur surface au moins. Ils peuvent être équipés dedispositifs rétroréfléchissants. Le bleu symbolise ainsi un appareil sans pression permanente ounécessitant une mise en aspiration.
Les poteaux d’incendie branchés sur des réseaux d’eau surpressés sont de couleur jaunesur 50 % de leur surface au moins. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants. Le
jaune symbolise ainsi un appareil dont la mise en œuvre nécessite des précautions particulière.
Les RDDECI peuvent compléter ces colorations ou y adjoindre des marques pour indiquer d’autres caractéristiques essentielles des appareils.
3.2 Exigences minimales de signalisation
A l’exception des poteaux d’incendie qui peuvent en être dispensés, les points d’eauincendie font l’objet d’une signalisation permettant d’en faciliter le repérage et d’en connaître lescaractéristiques essentielles pour les services d’incendie dans les conditions fixées par lesRDDECI.
La signalisation par panneau, lorsqu’elle est prescrite, est uniformisée pour l’ensemble duterritoire national, elle répond à la description suivante :
Un panneau de type « signalisation d’indication » carré de 500mm au moins de côté- sur fond blanc rétro réfléchissant,- bordure rouge incendie,- installé entre 1,20m et 2m du niveau du sol de référence,Comportant les indications :- au sommet : la mention : « POINT D’EAU INCENDIE »,- le numéro d’ordre du point d’eau incendie,- au centre, un signe de forme géométrique et de couleur bleue symbolisant la capacité
du point d’eau incendie, reprenant les figures du paragraphe 3.4,- les caractéristiques de l’accès à la prise d’eau,- l’indication de l’implantation exacte si le panneau n’est pas au droit du point d’eau
incendie (le panneau doit être implanté en bordure de voie carrossable, de préférence publique)
-
8/18/2019 Réferentiel National
29/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
29
Exemple de point d’aspiration de capacité >60
m3, accessible aux moto-pompes remorquables,
N° d’ordre 128, situé au droit du panneauindicateur.
Exemple de point d’aspiration de capacité >60
m3, accessible aux moto-pompes remorquables,
N° d’ordre 128, situé à 20m à droite du panneau indicateur.
Pour la signalisation des bouches d’incendie difficilement repérables en zone urbaine, cemême panneau peut être utilisé ou un modèle réduit de 250mm de côté pour apposition sur façade.
Le RDDECI peut apporter toutes précisions ou préconisations complémentaires à cesdispositions.
3.3 Protection et signalisation complémentaireIl appartient à chaque maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’interdire ou de
réglementer le stationnement au droit des prises d’eau et des plates-formes de mise en station quile nécessiteraient. De même, l’accès peut être réglementé ou interdit au public La signalisationdevra, dans ce cas, être conforme aux règlements en vigueur.
Dans les zones où la circulation et/ou le stationnement peuvent perturber la mise enoeuvre des prises d’eau, des protections physiques peuvent être mises en place afin d’interdire auxvéhicules l’approche des prises d’eau ou d’assurer leur pérennité. Ces dispositifs ne doivent pasretarder la mise en oeuvre des engins des sapeurs-pompiers.
POINT D’EAUINCENDIE
ACCES MPR N° 128
POINT D’EAU INCENDIE
ACCES MPR N° 128
20 m
-
8/18/2019 Réferentiel National
30/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
30
De plus, des dispositifs de balisage des points d’eau incendie visant à faciliter leur repérage(pour les bouches d’incendie, pour les points d’eau incendie situés dans les zones de fortenneigement…) peuvent être installés. Ces dispositifs peuvent également être utilisés pour empêcher le stationnement intempestif ou pour apposer la numérotation du point d’eau incendie.
Ces dispositifs de protection et/ou de balisage sont préférentiellement de couleur rougeincendie.
Ces dispositifs peuvent être prévus par le RDDECI pour être homogénéisés dans ledépartement.
3.4 Symbolique de signalisation et de cartographie
Afin d’identifier sur cartes, plans et tout support cartographique les différents points d’eauincendie de DECI la symbolique ci-dessous constitue une référence commune à l’ensemble desacteurs. Cette symbolique est extrapolée de la charte graphique éditée par l’école nationalesupérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Elle constitue la base symbolique commune mais
peut être complétée dans le cadre du règlement départemental ou de coordinationsinterdépartementales pour répondre à des besoins spécifiques. Dans ce cas une légendeaccompagnera les éditions de cartes mises à la disposition des renforts extra-départementaux.
Cette représentation peut être complétée des informations telles que le numéro d’ordre oula capacité précise en fonction de l’échelle de la carte.
Cette symbolique qui se veut simplifiée ne peut imager toutes les caractéristiques des points d’eau incendie.
La symbolisation nationale minimale permet aux intervenants d’identifier le type de pointd’eau incendie. Elle prend les formes basiques suivantes
Poteau d’incendie : un cercle , abréviation utilisable : PI
Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie : un carré, abréviation utilisable : BI
Point d’aspiration aménagé (point de puisage, …) : un triangle, abréviation utilisable : PA
Citerne aérienne ou enterrée : un rectangle, abréviation utilisable CIT
-
8/18/2019 Réferentiel National
31/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
31
Point de ravitaillement des Avions Bombardier d’Eau et/ou Hélicoptéres Bombardier d’Eau (positionnable sur ou à proximité du symbole du point d’eau)
Cette symbolique pourra être complétée par d’autres informations caractérisant lescapacités minimales du point d’eau incendie, notamment par remplissage de la forme géométriqueou par indication extérieure.
-
8/18/2019 Réferentiel National
32/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
32
Chapitre 4GESTION GENERALE DES POINTS D’EAU INCENDIE
ET DES RESSOURCES EN EAU4.1 Défense extérieure contre l’incendie et gestion globale des ressources en eau
La gestion des ressources en eau consacrées à la DECI s’inscrit dans les principes et lesréglementations applicables à la gestion globale des ressources en eau.
Dans le cadre du développement durable, les principes d’optimisation et d’économie del’emploi de l’eau sont également applicables à la DECI. Ils s’inscrivent en cohérence avec lestechniques opérationnelles arrêtées et les objectifs de sécurité des personnes (sauveteurs etsinistrés) et des biens définis.
Lors de la conception de la DECI :
L’utilisation du réseau d’adduction d’eau potable pour la lutte contre les incendies doitêtre compatible avec l’usage premier de ces réseaux, en particulier pour ce qui concerne ledimensionnement des canalisations.
Le recours aux réseaux d’eau potable pour alimenter les engins d’incendie n’est passystématique.
La mise en place de réseaux d’eau brute répondant principalement à la défense incendie ne
se justifie que dans de rares cas.
Des ressources variées peuvent être utilisées :
- Eaux de pluie récupérées pour le remplissage des citernes,- Utilisation des points d’eau naturels aménagés- …
Ces ressources doivent répondre aux dispositions du chapitre 2.
En situation opérationnelle :
La recherche de la préservation des ressources en eau, face à un sinistre, peut aussiconduire le directeur des opérations de secours, après avis du commandant des opérations desecours, dans certains cas, à opter pour une limitation de l’utilisation de grandes quantités d’eau.
Par exemple, en considérant l’absence de risques pour les personnes, l’impossibilité desauver le bien sinistré ou sa faible valeur patrimoniale, l’absence de risque de pollutionatmosphérique notable par les fumées, la priorité de l’opération se limitera à surveiller le sinistreet à empêcher sa propagation aux biens environnants. Il peut s’agir ainsi d’éviter de gérer descomplications démesurées face à l’enjeu du bien sinistré :
- l’exposition les sauveteurs à des risques sans sauvetage des personnes ou des biens- une pollution importante par les eaux d’extinction,
-
8/18/2019 Réferentiel National
33/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
33
- la mise à sec des réservoirs d’eau potable en période de sécheresse,- …
4.2 Gestion des points d’eau incendie par un délégataire
Lorsqu’il existe une gestion déléguée du service de l’eau, les travaux relatifs aux poteauxet bouches d’incendie peuvent être confiés par le maire au délégataire, notamment lorsqu’il s’agitd’un réseau commun à l’adduction d’eau et à l’incendie.
Mais dans tous les cas de figure, ce qui relève de la compétence du service de distributionde l’eau doit être clairement distingué de ce qui relève de la compétence du maire et du budgetcommunal au titre de la lutte contre les incendies.
Ces dépenses ne peuvent en particulier donner lieu à la perception de redevances pour
service rendu aux usagers du réseau de distribution de l’eau puisque la lutte contre les incendiesconstitue une activité de police au bénéfice de l’ensemble de la population.
4.3 Les points d’eau incendie privés
Les points d’eau incendie sont dits privés, appelés dans l’article R2212-… du CGCT« ouvrages privés », lorsqu’ils sont implantés sur des terrains ou des constructions à usage privé.
Ces dispositifs, même dans cette situation, sont destinés à être utilisés par les services publics d’incendie et de secours agissant sous l’autorité du directeur des opérations de secours(autorité de police administrative générale, le maire ou le préfet).
Les frais d’achat, d’installation, d’entretien, de signalisation et de contrôle de ces ouvragessont à la charge du propriétaire. Il lui revient également d’en garantir l’accessibilité aux engins delutte contre l’incendie.
L’autorité de police doit s’assurer que ces ouvrages sont contrôlés périodiquement par le propriétaire. Le résultat de ces contrôles doit ainsi être transmis au maire (voir chapitre 7).
Si la gestion de ces ouvrages est confiée, pour tout ou partie, ne serait-ce que pour le
contrôle, à la collectivité publique (après accord de celle ci), une convention doit formaliser cettesituation.
Ces ouvrages peuvent également être rétrocédés par convention à la collectivité.
Les services d’incendie et de secours effectuent une reconnaissance opérationnelle de ces points d’eau incendie, après accord du propriétaire, dans les mêmes conditions que les ouvrages publics.
Ces ouvrages sont répertoriés par le SDIS qui leur attribue un numéro d’ordre oud’inventaire exclusif de toute autre numérotation. Ce numéro est apposé sur l’appareil ou sur un
dispositif de signalisation par le propriétaire.
-
8/18/2019 Réferentiel National
34/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
34
4.4 Cas d’aménagement de points d’eau incendie publics sur des parcelles privées.
Pour le cas d'implantation des réserves artificielles (notamment) en terrains privés, le mairede la commune peut, en premier lieu, demander au propriétaire de vendre à la commune la
parcelle concernée.
Le maire peut également procéder par négociation avec le propriétaire en établissant desgaranties mentionnées dans un acte contractuel.
En cas d'impossibilité d'accord amiable et contractuel, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre. L'utilité publique est constituée pour ce typed'implantation, sous le contrôle du juge administratif.
En cas de mise en vente de la parcelle par le propriétaire, la commune peut se porter acquéreur prioritaire si elle a instauré le droit de préemption urbain, dans les conditions prévues
par les articles L 211-1 et suivants du code de l'habitation.
Par contre, la procédure de servitude passive d'utilité publique ne peut être mise en œuvre.La défense incendie ne figure pas dans la liste de servitudes d'utilité publique affectant l'utilisationdu sol définie à l'article R 126-3 du code de l'urbanisme.
4.5 Utilisation des points d’eau incendie
Les points d’eau incendie publics, en particulier ceux qui sont alimentés par un réseaud’eau sous pression sont par principe réservés aux services d’incendie et de secours.
Seul le maire peut autoriser, après avis du délégataire, l’utilisation ponctuelle des pointsd’eau incendie à d’autres usagers suivants des modalités et des contreparties qui lui convient dedéterminer. De plus, pour l’usage des réseaux d’eau potable, ces utilisateurs doivent être informésdes précautions à prendre afin d’éviter les retours d’eau lors des puisages. Pour les autorisationsde puisage plus régulières, il est recommandé de mettre en place des appareils de puisage ad hoc
équipés d’un dispositif de protection des réseaux contre les retours d’eau.
Pour les réserves d’eau, de telles autorisations de puisage sont également possibles maisdoivent délivrées avec une extrême prudence car la quantité minimum prévue pour la DECI doitêtre garantie.
Le maire peut décider, après approbation par les services d’incendie et de secours, de lamise en place de dispositifs de plombage ou de limitation d’usage des points d’eau d’incendie. Al’exception des dispositifs de plombage facilement sécable, ces dispositifs doivent être
préalablement approuvés par le ministère en charge de la sécurité civile. Ces matériels sont à lacharge de la commune, ainsi que leurs éventuels outils afférents qui doivent être fournis aux
services d’incendie et de secours en nombre suffisant.
-
8/18/2019 Réferentiel National
35/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
35
Chapitre 5RECEPTION, CONTROLE, ENTRETIEN
ET RECONNAISSANCE OPERATIONNELLEDES POINTS D’EAU INCENDIE
Les modalités de réception, de contrôle, de reconnaissance opérationnelle et de suiviopérationnel des points d’eau incendie doivent être précisées dans le RDDECI.
L’entretien des points d’eau incendie est organisé dans le cadre communal.
5.1 – Réception
La réception d’un point d’eau incendie consiste à s’assurer que le point d’eau incendiecorrespond en tout point aux caractéristiques nominales (décret n° 2009-…, arrêté du …2009,normes, RDDECI, …). Elle doit permettre de s’assurer de la fiabilité du point d’eau incendie etune utilisation rapide en toutes circonstances par les sapeurs-pompiers.
5.1.1 Points d’eau incendie alimentés à partir d’un réseau sous pression
5.1.1.1 Cas d’un seul point d’eau incendie
La réception doit être systématique à chaque création de nouveau point d’eau incendie.Elle doit permettre de s’assurer que le point d’eau incendie correspond en tout point aux
spécificités de conception et d’installation de la norme ou des dispositions du RDDECI lerégissant.
· Les BI et PI alimentés à partir d’un réseau de distribution d’eau public doivent faire l’objet àleur création d’une réception par le concessionnaire telle que définie par la norme en vigueur ou par le RDDECI
Une attestation de réception réalisée par l’installateur devra être communiquée aumaire de la commune et au SDIS.
· Les BI et PI situés sur un domaine privé doivent faire l’objet d’une déclaration de
réception à la charge du propriétaire. L’attestation de réception doit être transmise aumaire et au SDIS.
Pour chaque point nouvellement créé, une vérification à vocation opérationnelle pourraêtre réalisée par le SDIS.
-
8/18/2019 Réferentiel National
36/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
36
5.1.1.2 Cas de plusieurs points d’eau incendie
Dans le cas où plusieurs points d’eau incendie sont susceptibles d’être utilisés ensimultané, il conviendra de s’assurer du débit de chaque point d’eau incendie en situationd’utilisation combinée et de l’alimentation du dispositif pendant au moins 2 heures.
Une attestation de débit simultané est fournie par le gestionnaire du réseau d’eau dans cecas.
5.1.2 Autres points d’eau incendie
Tous les autres points d’eau incendie doivent faire l’objet d’une visite de réception par leSDIS afin d’être intégrée à la liste départementale prévue à l’article du décret n° 2009- …du
2009 …
5.2 – Contrôle
Le contrôle doit être effectué afin de s’assurer que le point d’eau incendie est alimentédans des conditions hydrauliques conformes aux caractéristiques techniques du point d’eauincendie concerné.
Les maires devront s’assurer qu’un contrôle périodique pour chaque point d’eau incendiea été effectué.
5.2.1 BI et PI alimentés à partir d’un réseau de distribution d’eau public et autrespoints d’eau incendie publics
Ce contrôle est effectué selon une périodicité et des modalités qui peuvent être fixées par le RDDECI sans être inférieure à deux ans.
Ce contrôle est matériellement organisé par la commune. Lorsqu’il n’est pas réalisé enrégie, il fait l’objet d’une convention ou autres dispositions contractuelles passées avec le
prestataire.
Le contrôle doit faire l’objet d’un compte rendu qui devra être adressé au maire. Aminima, toute modification ou changement dans les caractéristiques du point d’eau incendie par rapport au dernier contrôle, doit être transmis au SDIS.
5.2.2 Les BI et PI situés sur un domaine privé (mis à disposition des services desecours)
Les propriétaires doivent effectuer les contrôles et transmettre les comptes-rendu au maireet au SDIS.
Le maire doit s’assurer que ces ouvrages sont contrôlés périodiquement par le
propriétaire. Il peut donc être amené à rappeler cette obligation au propriétaire, en particulier lorsque la périodicité du contrôle est dépassée.
-
8/18/2019 Réferentiel National
37/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
37
Si le contrôle des points d’eau incendie privés est réalisé par la collectivité publique (aprèsaccord de celle-ci), une convention doit formaliser cette situation.
5.3 – Entretien permanent
L’entretien permanent est la mise en place d’une organisation visant à assurer unfonctionnement normal et permanent du point d’eau incendie. L’entretien des points d’eauincendie publics est la charge de la commune. Une convention peut être passée avec un prestatairede service. L’entretien des points d’eau incendie privés est à la charge du propriétaire.
Tout point d’eau incendie défectueux devra être remis en état opérationnel
Tout point d’eau incendie indisponible devra être remis en service dans les meilleurs délais.
Toute indisponibilité et remise en état devront être transmis au SDIS.
5.4 – Reconnaissance opérationnelle
La reconnaissance opérationnelle, organisée par le SDIS, vise à s’assurer que le pointd’eau incendie est utilisable par les services d’incendie et de secours. Elles portent sur :
5.4.1 BI et PI alimentés par un réseau d’eau :
La reconnaissance opérationnelle porte sur l’aspect opérationnel du point d’eau incendie etdoit comporter au minimum sur :§ l’accès,§ la signalisation des BI,§ l’implantation,§ les abords.
Éventuellement, après accord de la commune, les caractéristiques hydrauliques(écoulement de l’eau, débit, pression).
5.4.2 Points d’eau incendie artificiels ou naturels :
Une reconnaissance opérationnelle des abords et des aires d’aspiration devra être effectuée par le SDIS. Un compte rendu de vérification transmis au maire portera, au minimum, sur :
§ l’accessibilité aux engins de lutte,§ la signalisation,§ toutes anomalies visuellement constatées.
La transmission des résultats de la reconnaissance opérationnelle constitue également unmoyen de contact privilégié entre le maire ou les services communaux et le SDIS sur le sujetde la sécurité incendie.
-
8/18/2019 Réferentiel National
38/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
38
5.5 – Visites conjointes
Le contrôle tel que prévu au paragraphe 5.2 et la reconnaissance opérationnelle telle que prévue au paragraphe 5.4 peuvent être effectués de manière conjointe par un ou plusieursservices. Dans ce cas, une convention pourra être établie entre les différents partenaires.
5.6 - Numérotation des points d’eau incendie
Les points d’eau incendie sont répertoriés par le SDIS qui leur attribue un numéro d’ordreou d’inventaire exclusif de toute autre numérotation. Ces numéros peuvent être attribués par commune. Ils sont apposés dans le cadre de l’entretien courant des appareils par la commune oudans le cadre d’accords conventionnels.
Au mieux, cette numérotation peut figurer sur la signalisation prévue au paragraphe 6.2 ou
être portée directement sur l’appareil.
5.7 - Base de données des points d’eau incendie
Le SDIS tient et met à jour une base de données recensant l’ensemble des points d’eauincendie concourant à la défense incendie. Celle-ci a pour objectif premier de renseigner lacartographie opérationnelle du service.
Un exemple des données figurant dans une telle base informatisée est fourni en annexen°6.
-
8/18/2019 Réferentiel National
39/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
39
Chapitre 6
LE REGLEMENT DEPARTEMENTALDE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
Un Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI) estélaboré dans chaque département. Il est décliné et adapté à partir des principes généraux fixésdans le présent référentiel national.
Il doit être élaboré pour répondre non seulement aux particularités locales mais aussi aux problématiques mises en évidence dans le schéma départemental d'analyse et de couverture desrisques (SDACR). Afin que la défense incendie des communes soit mise en cohérence avec
l’ensemble de l’organisation des services d’incendie et de secours, le RDDECI doit être intégrédans le règlement opérationnel.
Le RDDECI doit aussi permettre d'accompagner le développement rural, urbain et deszones d'activités tout en assurant aussi la DECI de l'existant.
Le RDDECI est réalisé par le service départemental d'incendie et de secours en étroiteconcertation avec l'ensemble des acteurs impliqué dans la création et l'entretien des points d’eauincendie. Il est arrêté par le préfet.
Il doit comprendre a minima :
- des "grilles de couverture" de la DECI par type de risque (courant et particulier) en tenantcompte notamment des risques et des ressources spécifiques au département. Elles permettent, dedéterminer les quantités d'eau dont doivent pouvoir disposer aisément et à tout moment lesservices d'incendie.
- un inventaire des points d’eau incendie non normalisés retenus par le SDIS pour constituer laDECI
6.1 Possibilités opérationnelles du SDISAinsi que le prévoit le chapitre 1, le règlement opérationnel doit définir la montée en puissance
prévisible et possible des moyens publics de lutte contre l’incendie qui pourraient êtrenormalement mis en œuvre dans des délais compatibles afin de limiter la propagation rapide d’unincendie.
Cette montée en puissance doit être traduite par un dispositif envisageable dans un délai donnéet des conditions normales. Ce « dispositif théorique » doit prendre en compte l’équipement et larépartition des moyens de lutte contre l’incendie du SDIS.
Ainsi, le RDDECI doit préciser les conditions d’alimentation en eau des engins de luttecontre l’incendie en fonction des caractéristiques des points d’eau incendie référencés au chapitre 2.
-
8/18/2019 Réferentiel National
40/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
40
EXEMPLE :
Un dispositif pour la lutte contre l’incendie d’un risque courant faible peut comprendre :
- Au point d’attaque, 2 LDV 250 ;- Le véhicule pompe avec un débit nominal de 500 l/mn minimum ;- Un point d’eau incendie de 30 m3 situés à 400m du risque.
Pour les surfaces inférieures à 20 m² et non habitées, il peut être admis que les moyens mobiles duSDIS sont satisfaisants.
Un dispositif pour la lutte contre l’incendie d’un risque bâtimentaire lié à l’exploitation agricole, présentant un potentiel calorifique, notamment :
- Au point d’attaque, 2 LDV 250 pour 500 m²;- Un véhicule porteur d’eau avec une pompe de 1000 l/mn minimum;- Un point d’eau incendie de 30 m3 utilisable en 1 heure par tranche de 500 m² de bâtiment et situé àmoins de 200 m du risque.Exceptionnellement, cette distance pourra être portée à 400 m maximum tenant compte des moyensspécifiques du SDIS.
6.2 Grilles de couvertures
A partir des valeurs définies au chapitre 1, le RDDECI peut prévoir une adaptation auxrisques spécifiques du département.
Exemple de grille de couverture pour le risque courant faible
Bâtiment Distance max du point d’eauincendie
Quantité minimale d’eau
habitation de la 1ère famille d’unesurface inférieure à 250 m² etdistante de 8 mètres de tout autre
risque.
400m 30 m3 utilisable en 1 heure ou 30 m3
- habitation de la 1ère famille d’unesurface supérieure à 250 m² etdistante de 8 mètres de tout autrerisque- habitation de la 2ème famille d’unesurface inférieure à 250 m² etdistante de 8 mètres de tout autrerisque.
400m 45 m3 utilisable en 1 heure
habitation de la 2ère famille d’unesurface supérieure à 250 m² et non
distante de 8 mètres de tout autrerisque.
200m 60m3 utilisable en 1h
-
8/18/2019 Réferentiel National
41/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
41
Exemple de grille de couverture pour le risque particulier
1ère étape : définir le risque (débit de référence) et la surface de référence:
Principes - débit de 30 m3/h pour 500 m² si faible potentiel calorifique- débit de 60 m3/h pour 500 m² si fort potentiel calorifique (1)
Surface de référence (S)En m²
( S ) superficie la plus grande non recoupée par des murs CF de degré 2 h continu de façade à façade
(1) Etablir un listing des risques en 2 catégories en fonction du potentiel calorifique et du risque d’éclosiond’un incendie
2ème étape : appliquer les coefficients liés à l’établissement :
CRITERES Coefficients applicables(majoration – compensation)
Hauteur de stockage (2)≤ 3 mètres
≤ 8 mètres
≤ 12 mètres
> 12 mètres
0+ 0,1+ 0,2+ 0,5
Type de constructionOssatureSF >1 heureSF > 30’SF
-
8/18/2019 Réferentiel National
42/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
42
6.3 Adaptations locales
Il doit être fixé dans le RDDECI les grands principes permettant l’adaptation aux risquesgénérés par les opérations de réhabilitation et de transformation de l’habitat rural ancien. Cerèglement peut fixer aussi les principes de l’autoprotection de l’habitat des zones particulièrementisolées qui ne pourra être décidée que par le maire, au sein du schéma communal de défensecontre l'incendie (SCDECI).
Le RDDECI peut prendre en compte tous les points d’eau incendie définis au chapitre 2. Desspécificités locales peuvent être intégrées dans le RDDECI dès lors que les principes générauxdéfinis dans le présent référentiel sont respectés.
L’autoprotection:Dans le cas d’un risque courant faible et isolé tant des ressources en eau répertoriées que desstructures du SDIS - cet isolement pouvant être permanent ou saisonnier (fort enneigementchaque hiver par exemple)- il pourra être admis le principe de l’autoprotection.
Ce principe repose sur la mise en place d’un système spécifique et unique proportionné au risqueet aux objectifs de l’autoprotection.
Il permet une action très rapide et organisée par le propriétaire ou le locataire afin d’éviter une propagation rapide de l’incendie dans l’attente des moyens des services publics ou assurer la
protection des biens par rapport au risque.
Il conviendra toutefois de s’assurer que le délai d’intervention des moyens des services publics estcompatible avec une action efficace de ceux-ci.
6.4 Processus de consultation
Une importante concertation doit s'établir sur les objectifs et le contenu du RDDECI.
Elle doit permettre d’associer tous les acteurs concernés. Cette concertation est une desclefs de l’adhésion de l’ensemble des partenaires de la DECI.
Le RDDECI est réalisé sous l’autorité du préfet par le SDIS.
Il doit constituer un travail collégial de terrain pour appliquer les règles nationales,organiser et adapter la méthode de défense, définir les moyens d’atteindre les objectifs.
Les communes et les EPCI concernés sont donc associées au processus d’élaborationnotamment par l’intermédiaire de l’association départementale des maires ou à défaut avec descommunes représentatives (des communes urbanisées et des communes rurales).
Son élaboration doit également être faite en partenariat et concertation avec les services de
l’Etat et des collectivités territoriales chargés de l’équipement et de l’urbanisme, des affairessanitaires, de l’agriculture et de la forêt…:
-
8/18/2019 Réferentiel National
43/48
Projet de référentiel national défense extérieure contre l’incendieversion 14 du 28 janvier 2009 MIOMCT / DDSC / SDGR
DOCUMENT DE TRAVAIL
43
La participation des services du Conseil général doit ainsi être recherchée. En effet, laDECI s’insère dans le cadre de plusieurs politiques départementales :
- organisation départementale des services d’incendie et de secours,- aménagement des zones rurales,- dynamisation de zones d’activités artisanales ou industrielles,- équipement des routes,….
Dans cette approche l’avis du Conseil général peut être recueilli.
D’autres organismes peuvent être associés tout particulièrement les services publics deseaux.
Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (CASDIS)est obligatoirement saisi du projet de RDDECI. Le CASDIS est l’instance privilégiée pour discuter de la cohérence entre les préconisations édictés par le RDDECI et la politique du SDIS.
Pour la préfecture, le document final doit être présenté au collège des chefs de services dela préfecture.
Enfin, il doit être arrêté par le préfet et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du SDIS.
Un mémento, guide pratique ou site internet explicatif et informatif à destination desmaires concernés et des autres acteurs peut avantageusement compléter le RDDECI. Dans cecadre, le RDDECI peut avantageusement comporter des fiches explicatives permettant decomprendre les délais moyens de mise en œuvre des dispositifs de lutte contre l’incendie enfonction de l’éloignement ou des capacités des points d’eau incendie.
6.5 Vérifications
Le RDDECI peut prévoir les modalités spécifiques mises en place dans le département pour les contrôles et reconnaissances opérationnelles des points d’eau incendie visés au chapitre5.
Il s’agit en particulier de préciser la périodicité de ces vérifications des points d’eauincendie.
-
8/18/2019 Réferentiel National
44/48
Projet de référentiel national défense extér