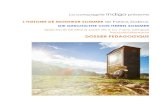Notes gallo-romainesbibnum.enc.sorbonne.fr/omeka/files/original/bdd8f1... · dautre part, la seule...
Transcript of Notes gallo-romainesbibnum.enc.sorbonne.fr/omeka/files/original/bdd8f1... · dautre part, la seule...

NOTES GALLO-ROMAiNES'
X
VERC lN(;lT()flI\ SE REND A ClS
- CRITIQUE DES TEX'I'ES
On possède cinq récits diflreiils (le la reddition (le Verciii-gétorix à Césa r : celui d'un l.émoiii oculaire, César lui-inmeceux de trois éc.i'i vains (l( l'cInluiI'e, Flonis, Plutarqiic, DioriCassiiis ; celui (111,1 h isloricn clirél j eu. Orose_
.JO (lis récits (iill['euIts, et 11011 COfllt'a(liClOit'(s, Car je voit-(Irais inotitrer que, cri dépit tic 101)iIliOfl couratiic, les textes deces cinq auteurs se complèteuit et ne se combattent pas Chacundeux a choisi dans les di ers ilétails de lévél)clnelit. ceux quiconvenaient le plus à la nature de son ouragc, et les a inter-pi'étés à sa manière; mais q&on réunisse ces (létails, On verraque, loin (le s'opposer, ils saccordcnt.
La reddiliori s'est colilposée (le trois actes, la négocialiourentre Vercingétorix et César, les J)réparalifs de l'entrevue des(toux chefs, l'entrevue elle - mèune. Exaiuiuiouis l'une aprèsFauti'e, chez les cinq auteurs, les circonstances qui ont accom-pagné ces trois actes.
S les /iéJOCi(lliOflS.
i' Discours vie t ei'ciiiglori è son conseil. - Le leIHl(tT1ilifl dc
la défaite, le roi ules Arvernes COIiOqUa son conseil et liiian rroiuça qu'il fallait se rendre. Cette réunion et ce discoursne nous sont connus que pat' César et Ot'ose s
s et ta lleeae les (U1C ((OcienI(es, aiiiiics I8((i,, I ((00 t1 ITJOI.2. Poster', die, tercioijetn'i.r eon"ilio ",neoealo. . . de,,,o,,1,at. Cs2r, V I I, $'i, S I . -
Vercingetorij' Obu (lie, 'oiujreyatis ororobus. qui fivqu er'r,sr'ra,,t I ce rt i (L impropre,puirqrie IJIICIIrI dc gcr ri'- 4liI «(I fui, (I vrai lire], rkril.... Oro', 'S 1, I I, S 10.
Document.i.'.-.:
0000005531417

132 1IEVUF. DES II'UDES ANCIENNES
D'après les Commeo/uires, lallociilion de Vercingétorix ren-fermait les deux points suivants - il rappelait qu'il n'avai1pris les armes que pal' amour (le la liberté' - il s'offrait envictime expiatoire, que les Gaulois voulussent le livrer ivantaux Romains ou le tuer euxintiies .
Je retrouve ces deux points, en termes presque idCIlt.I(1U05,chez Orose. Mais lccrivaiui chrétien ajoute deux choses aulexie dc César :Vercingétorix s'excusa 11011 IIS sculemetit
(lavoir défeiidu la liberté o, niais aussi d'avoir I'Oflhl)U
l'alliance avec Ronie ii 3; - avant de s'offrir en viet hue ii luiseul j)otIt' tous o, il proposa aux chefs d' a aller tous à la mort o
A ces lieux additions, on m'econiiait l'cspi'il. tendancieuxd'Orose. La première a effet de rappeler, après le. patrio-lisrtue de \ ercimugélorix, son infraction ( lit li jurée. La secondefera ressortir la l.clueté (les chefs gaulois. préférant la mno,'t (leleur roi à un suicide gloI'ieUN. L'écrivain ciirétiemi tient àmettre tous ces eus cii [';'iclieuise poshirc : ce qui m'autoriseà Croire q iiii U iuiveuité cl lion pas emnI)i'Liuité ail leurs les deux
l)CIISéCS qu ' il ajoute au texte de César.u° Réponse des chfs. - Oi'ose est seul à dire explicitetiient
(hiC les chefs désiraient le sacrifice iuilhivilluel (le \crcingétorixet qu'ils l'acceplèremul sur le clianil) ; il usisle unime sur ce t'ait,car il lui fournit une occasion nouvelle (le ructtt'e en lumièrel'ignomiiiie des Gaulois '. - L'acceptation des chefs ressort, diireste. im1ulic'iteiiieuit. (lu texte des (,'wwnenluires e Après lesparoles du roi, (les députés fuient, au sujet de Ces choses,
Premier poi n L : Id leflur,i se suseep issi' non suarum neccssilalu,n sed cornninri laliberlatis ciao. S
s. E)e,,xiinit' point : Et q000iwn 511 ,forluaae ci'dcndiwi, AD CTItAMQUE REM 5F
OFFcnRc, ses morte sue iioiiwnistisfoeere sen eivarn Iradere rePut.. L'lntcrpresgraccus donne : iIoZtpŒ .rŒrJx C.LsJri f ': .i , e etc.
3. Preiniir point :Se auctorern boue jide deJ'endendae tibertatis alqice InIumpcu(IL,focderis fuisse,
4. Deuxibme point t Et nwv, Sive Romanis SESE .tD MORTZ.St osiNEs O ERAST aire sesotuni pro omrob,,s deulont.
r,.moins, ce qui est fort vraiourihlaiil,', qu'il ait mal compris le kïte le César,et qu'il ait, par inadvertance, appliqué aux Gaulois les nints se offeuie (comparez,notes 2 et 4, les deux textes), alors qu'ils se rapportent à V,rci,,'éturix. Nom-breuses sont les erreurs commises par Orose et ducs simpicnicmrtlute lecturerapide de César; vo yez VI, ii, s t, , 5.
I. Itiqutc Gal! j rot ,anlatem, quan* pu iore atujaoindu; tc,cc'ranl, guosi ex cousilio ,eqisitulsuinterejit, iii3O aibi reniant precantes, min soluin velu t nurlors,n inujit I e'eit'iis 't cd ide-rut,!. Orose. 'il, t t,ii.

NOTEs GALLO-R0\I .1NF 133
e1lvOéS au proconsulOrose, je le crois, s'est borné à
amj)lilier l'indication donnéeCésar.3 fléL/n (le Céxor. - La réponse faite aux parlementaires
ii'est Iuenti cinée que i r César. 11 leu r fut déclaré qu'il litlaitlivrer les aimes cl amener les chefs » c'est-à-dire sans doute
toux les chef . li semble i' i que le Romain se soit refusé hsaflC [ionflel' la proposition tic Vercingetori. - Mais comme,d'autre part, la seule exécut lori connue est celle de celtii-ci.qe la vie fuI conservée h tous les autres . qu'Alésia ne parait
u, ir été bi'tlée ni pillée, que vingt itiille Arvci'iies etuelis, parmi les prisotiiliers. furent. laissés libres ", il est
vraisemblable que le pror()Ilsul fini t par accepter, sans le direexpi'esséîneitt. la VIC de son principal adversaire en échangede toutes les autres. En toid cas, c'u se présentant seul, euvictime expiatoire. \ci'ciiigétui'i x allait faire comme si Césai'avait consenti à SOIt ilévotietriciit pour tous, et obliger leRoniaiti à lagréer inalgi'é liii. - Je supl)OsC qu'à la fur ducolloque oit fixa Ilteui'c à laquelle de ait avoir lieu la cérémoflie (le la cciii! iii on -
Si, (le tous l(5 éCI'iVaili s pavens, César est le seul (111i parle(le ces négociations, c'est que les p011t'pa1s politic1ues onttoujours rt'Ç1 d iilict', clans les L'ûWffleJt/Oi,'eS, t itic lesse'ries théiti'aIes : il expIique plus qii il lie racoii te ri. - Si le-hi'et.ien Oi'ose s'est. coitiplu à montrer les Gaulois i'efiisaiit deiiioui-ir et sacrifiant leu u' chef, c'est puni' trouver ii n mou f (k'plus à déitigrer les pa> eiis'-.
Il. Le,s J.fl'éJKl1'(Il1f de la reddition.
Taudis (1(i'il a (lével(Jl)pé le récit (tes négociai iOns. Césai' uéIOU ité à I 'exiréine ce I ui (les pu'épar'ati fs de la i'eddi tioui
• iii iritur dc his rebus »d (;i,es(wem (eqa(i, Car, VII, 5», S 3.i. Jiibv( aima Lradi, priricqies produci. \ Il, 8j, 3.:i. \ Il, Sq, S 5.
VII, $q, 5; o, 3 cf. Vii!, 3. 5. Peut-trc la reddition titi-clic reridu&' pIiifacili par le fait qun le luIier n'avait jamais touchd les ilurs d'Alisia (cf. Cisiii,Il, 3s, 5 t Ciecron, i) i)fficiu, I, ii,
r.:i. liirtius, VIII, pruif., 5I 'ail iidi (s /l»i; dia qui . UI ISCTO... e.rpliearcm. I ru ise. I. pro!.,I

REVUF DES f TFDES ANCIENNEs
d' l&ia et dc son eut revue avec Vercingélorix : c 'étiiciit pourlui détails inutiles. l'acte rie la soumission axait! seul 11e1q1ievaleur. - De la irnie ii1aui'i'e, Orose ne (lit plus rien de ce(l iii va silix leil n ' y a point trouvé ,iiati're à irlirticsIiiriiuiics. Les iiarratioiis COuS ienneni)('Ii LIUX éci'i ail-15 (liiivisent un but dogmatique.En revanche, Florus. Plut iliqile,I )ion ( assius. narrateurs avant tout, et niitourciix dii pittores-(Jt1e, apr's avoir totaheirient itégi igé les prétiiiii na ires polit iqiles.s'ét.eiident volontiers sur les eircorislanees le la céréril(_)nje
I' JF Cxur .''ias/a11t,.C est le seul point., dans cetteaffure, iuc César ait iioté dans ses Coinme,iluires : tr Il s'assit,dit -il, devant le camp. (lans les retraiichemerits ; » il mont rt.'par là que c'est cii inrperalor vainqueur, sur un sol clé,jà romain.
qu'il a tenu à recevoir l'hommage des assiégés. - DionCassius ajoute que César était assis (r sur son Iriluinal »3. - Ilrésulte (lu texte de Pltitai'ç1nc que le siège de César ou l'es-trade qui le portait étaient isolés, puisque \ ercingétoi'ix 1)11Een faire le tour à ci icval .
2" Eqtuipeinen/ (le Vei'ciflgflr)rie. -- PI utar( l Ile nous apprendque le chier gaulois se rendit (levai) I ( revètu de ses 1)1115belles arrne., iuiont.é sur un cheval somptueusement harnaché .— Fiorns miientionne, outre le cheval cl les armes du Gaulois,ses plaques dc (ié('orai.ioil, Ou phalèt'es - Dion Cassius rapporte
r . K ra iu'r cL Di tLenI,u 'rger, dan leur evcel lei r te éd i t ion I Ii' Csa r (ri;' rd ,p. 3 4o), n';r con liii L aucu ri' cra ri e aux r"ii (s rie ce fait arr tres qr te r'l iii de CésarjI I t'oit t, il isen t-i s, Irsine,z A ns1r,u,'h arif /r ss$w'iscJle (;eaubivll,'di ikeil C'i'sL poussertroll loin te sceptiriarite rima essasurr do couver' qu'us olîrr'itt, ait eruntritirc, buterais'rruI,lanu'c. - 11 n ' y pas à s'étonnr'r fliC Césrr ait sorilu donner, à cette urémonlie
dc la reddition, un caracti'ro sotenrnri : e'tait nussej. l'tisagrn dc cheCs romains defrapper par (IN scànes grandioses l'imagination d's aii(CUS. Viruz l'iuurirmage deTi rida te devin n t Corbu lori (Tacite, _1,unal,'s, XV. :nq t : hure... in menhirs (ennpli .' nnri'dio tri-tunsxl e! sedr'm curulsr,r, de. (cf. Josi'jrlie. III, 3 C,,: j s'rr,,', 'kr CC%t-ytrv 'darr apiL4zia'i). Trajnrn cires lis barbares t 't innr. Pnnnqvriqrnr'. LVI): inirnanescanrrpoa sella rnirnxli.,. prcnrere, etc. Clirnide et Caraelacuns , itontie (Tacite. ,Innciles,XII, 36) : Campe qnni castra praejocel..., halerne tuJrquu.'sqnrn' lradUu'le....!ribwtali adslitil.
z. Ipse in rnnJsni(ione pro castris consin!if. César. Vil, Sc, S f,. - Flornts (I, P5, S 26) ditin castra n-e,nLsr't ( Verrinqetarij), texte où ea,strn est, par ning,nrde, e" punir mrrnni!io.
3. KVp.é',u,, sirve. Dioir Cassius, XL. - r. S r4. K'Toa z'u rrr Kn2x6i'ra',Piritarqiic, Vie rIe s$sar, \ XVII.5. U')zprér &' ù6n'i n;nv t),w'i 'Œ xJ,r,5ia xa'i asxj'r 'ntvr,'r, I'lutarquc,
Vie de c'éaar, XXVII.il, Eqnnu,n, et plr.alu'ras e! ana croie.,, projeeit. rlorus, I, .5, 5 6. ii' no crois pas
que lc phalhros fnisserit irworinues ilt's guerriers ecfles tors de la ru'ddiliort deCaractacn t s à CIa r ide t ) ii te, Annales, 511, Ii», plrak,'rs lorquesqnne traducta. J e faisdes réserves, à cet égard, sur les théories dc Longpérier. lEurres, t. II, p. 177 et s.

OFF.5 G IW-lI1"i5.1NFS I3
à ce propos que \ ercingétoi'i X étaie fort grand et telTible à
voir en armes '3° I)ans quelle intenik#n il se rendit auJ)r?s (Ir (.'sur. - Sur ce
point, un seul texte précis, celui de Dion Cassius : Il espéraitqiiaaiit été autrefois l'ami (le César. il obtiendrait sonpa idoit C'est u ne Ii potlièst' de l'écrivain grec, ce ii 'est pasun détail du récit. Je ne l'accepte pas. Dîna a eu le souci, dansson Histoire, de rechercher les mobiles et les impressions deshommes : qiiafl(l il ne les contiait pas, il les imagine 3 . C'est iiiips-cliologuc, mais médiocre. Il n'a pas défiguré l'extérieur dela SCène qui va se passer entre les deux chefs, tuais il ui'en a pascompris le sens. Il a transfotiné en Ufl entrevue pureitient hu-
inaine ce qui a été, pour \ei'cingétorix, une cérémonie religieuse.Cette scène, César, qui ne l'a pas racontée, l'a cïPli(lUée pat'
avance, en relatant la pro posit ion faite par l'Arverne au conseildes Gaulois. Vercingétori est venu, conformément à sa promesse, se présenter en victime volontaire et expiatoire; c'estpour cela que, comme une victi trie, il s'est montré avec sesplus beaux oi'neinents, ses armes mie guerre et son cheval deparade; et. c'est pour cela qu'il est venu seul.
'j" Arrivée du du:!' qaulois. - Il sortit à cheval des portesde la ville, n clii Plutarque . CC Saris être annoncé par unhéraut. » dit Dion Ctissius, u il parut à l'improviste devantCésai', de nianière à trouhlet' quelques -uns n Je ne suispoint sr tout à fait mu te ce n trouble n ne soit pas de l'in-vention de Dioti, toujoui's prêt à noter des sensations. Ittstii'plus, il n'avait rien tiuc de très naturel les Romainsn'étaient i préparés à l'apparition stihite de Vercingétorix,ni à ce qu'il se présentàt non pas en appareil de xaincu. maisen costume de guerre.
I, "A'.(')yp xt io tt;'tn;,; Diois Cassi,is,L,
4i,2. Cnmpar'z Floru-, I, '5, S 21 : Flic r»IjOre. rsrmi.s spiriltiqlze lerribilis,5. 'Ezi.'.ii t)s tnrs K%ips iyzy6vn. 7'.'CJ Y 7X ' ŒJ
I)ion (;iu.. XI., ! r. S 51.3. \Vilrnans, pour ilautres motir", est tu morne avis quo nous ,\'&Iwn praeferiniUit»siwre:n, dit- il du l)iuur. quili il? ctCnfll ronsiliit inquif,ut... &WpC causas furqd.
(Lic J'ssnlibrzs JCWfliS, r 835, p. 5»).5. 'Etirocsv ,tu).ijv. I'Iutarquc, XXVII.5. Tjj)irp'o a'v [Cé,ar] j. i'JXE'Jp.evn;, zaS.,.aCpvv; 5Ør.
r'a:. ilion Cassiris, XI., tir, S I.

i36 REVUE Î)ES TUDE$ .&NCIE\ES
III. L'entrevue.
Des trois récits de Flonis, (le Plutarque et de Dion Gassius,il résulte que le Gaulois s'est livré lui-même. Jules Césarécrit : Vereinqelorix rledi/ur' . Mais dedjiur peut tout aussi biensignifier se livrer » qnc être livré ». L'auteur des Conunen-(aires parait songer au premier sens, et. distinguer entreVercingétorix venant se rendre et les antres chefs amenéscomme vaincus ou captifs: au deditur de Fun, il opposeduces proilueun/ur a . - César tdït - il même écrit (le(ijtw' dans lesens de e fut li ré» 3, que. je ne m'en inquiéterais pas. Peuimportait ii son esprit précis et laïque le mode de la reddition,Fapparence, les formules et les sïmboles : si l'Arverne avaitFair (le se rendre lui—même, il était évident qu'en réalitéc'étaient les chefs de son conseil qui l'abandonnaient à lamerci des Romains.
Mais, pour nous, qui ('herchons à trouver dans l'apparence,dans les formules cl les symboles, la pensée des hommes quiy ont eu recours, il est nécessaire, au contraire. de suivreininutieusen-tent les (létails de la cérémonie. C'est. aux troishistoriens narrateurs qu'il faut les demander.r Le cercle ô ehee,t14. -- Plut.arquie nous fait connaître que
Vercingétorix fit d'abord, à cheval, le tour (le César assis, -Ce n'est point là un acte de bravade ni de parade, mais uncérémonial religieux, celui de la victime qui se présente6.
I. VII, Sq, S 4.. VII, $q, s . Cf. t t, s : Jumenta prodaci; t, 3 Equos produci. Ces deux lettes
à propos de ta reddition de places fortes..3. Selon moi, le flint Lic César, deditur, correspond surtitt à l'acte de Vercingétoriï
arrachant ses armes (cf. p. 137).4. C'est une invelitioti que te dire, conime le font Fr. Montiier ( Vcrcingétoi-i.v,
' éd., 1875, p. 27I) et liient d'autres : s Il lit décrire lroi.ç cercles à son cheval. sKi x).,, r.pKi'raaÂeis-,Plittarqnie, X'dVll. 'Eç
n'impi ique p;i s le trot ou Ii ga Ictp.. (riruin. flei,tscfit' llytholoyu', éd. Mvycr, t. I, p. 4, croit qucper cire,ii(u,fl eiurept'
(cf. p. 4 t et !s) signi lie, riiez les (ierrna I fiS contiine riiez les t ries ('t les Itoina t us, (1(155aie freiu'illiq :u Toile qienqen cf. Vaeht,-dqe, p. s$. Tluerrv, Histoire des (ustlois 5 I,p. 3si, S eu ra son de supposer que Iai t lois o nie Il t par là qu'accomplir u iiniiiiat usité. - Le rues dus iii-s victi Inc-s lors des ceremotiies lustrales (par exempleà Home, \larqiiardl, Staalsverii.iiltung, III, p. 9uo) jieut étre rapproché il,! celui de\ercingétorix : l'Arverne, comme les victimes des jours dc lust ratio, étant destiné à des

5t)TES GALI.O—RoM.&IlI. 13790 Les armes arrachées. - Il sauta ensuite t bas de son
cheval, arracha ses phalères et scs armes, les jeta aux pieds deCésar, en lui pr&eiitaiit sans cloute aussi son cheval. - Cesdétails, qui viennent i la fois (le Plutarque' et (le Florus 2,
signifiaient chez Vercingétorix l'aveu de sa défaite et sa traits-formation en vaincu ou captif3.
3" La supplicalion. - I 1 Iuta ique écrit, qu ' i il s'assit auxpieds (le César 4; et Dion Cassius, qu'o il tomba à ge-noux n ce qui est. pins précis et plus vraisemblable. Cedernier ajoute o Tendant en avant les deux mains, il prit
l'altitude d'uit suppliant C . » Sapplex, dit aussi Floriis 7 . - Maiscette supplication muette n'est pas la prière d'un vaincu qti i
demande pardon à un ennemi. Elle es le geste d'un hoturite
siii-ritices i'xpiatoires. - Voir encore, sur cit cercle trac ti par des ictimes, le texte sicurieux dc Grégoire-le-Grand Dia1oqtu's, lii. 8; Mignc, t. i.XX\ Il, col. 984): Lango-
hardi.., more strn i,nrnolaeeriinl euput cuprue 1)iabolo, IIOC El PER cIn':UITVM eizrrentes etcarmine neJ'anclo OEDICSN'rES. Cumque it(uci ipsi prias suhniissis rervici bas ador»rctnt. etc.
I. Et-ra px èp. o; oj %tito',, r- ' - ii'i Lz'4. Plutarque, X XUI.s. Equuiii et jhaIeroa et sua urina tinte Corsons qenua jirojecit. Floru'.. I, 44,G.3. Cf. VII, 4e, G:,icdai rcioniis tendcrc,licou tIcs ois'.. 4, et ilianqile cites xl
dedilioric'm siqnific'at'e et pi-oject i_ç ,,rmjs, marient tteicc'i' Iini. Il faut I ri', je crois, iledi.
Li» flem stC;NiL"lc 'itE PIIOJIC rts.xlLMIo,t'l ,,iorieui ch'j,,'ecc'tri. de ittèrsie qu'on lit. Il, i3. 2
Matins tendere et vocic sir.siricxne.fi. AxŒflhsa; 'si r; 'o' Kxhnpo;. Piutarqui', XXVII.5. IIvrii'i èy'',v : lloi ','.exaiii propose d'ajouter o't. Dioit Cassius. Xl., iii, S t. -
Gros Irai ii it par t' toniba aux geliolix dc' César». C'est Une faute. M. iluissevain,consulté par uioicc suij('t, m'éc'rit : s I I,fl,'i &c'est toi,ibt1 sur ses qenoIi.l.
Si Dioti iva iL t-iii ilu iii rs' tout b tin_i' qenoir liE ;iS.s li. I L au l'ait écritpaŒ»'# 2't
b ''v'.t (y!j.,xta)Voir LI, ii, S 3 et h: LIX. 97,'u; LXX\l, r,, s 4-"
6. Tc4 -t ',siiocaa;rj, tc'xte clii ci'.. : l)ioii Cassitis. XL, 'i, 5 s. Je corrigeenoxi'a; ( avec Li 'u nclav iii '. 'i isi ra (avec 1 ii ici lori) : Reluis r 't Boisses s in on t icri Irtt ies;. Mc in aun I Iloissi'va j ii n t 'ii t au sujet iIi' ce lex Ii
ii Le cs '.sage ci I)ioii Cassius, Xl,. 4i, s, est ivi,Ii'miruuiit fautif. Le ins. L (il liv iii
t qu'il n, le Luw'c'ntiii;iva j a rit 'rz '/rrrrl'xÇiiÇrs. l3i us mon éd tion, j'ai laissé laviulga te t,.', raira i rie, sol titi Se5 r Ilc'i u na r t l'après li ' L isticuuuu» t, (»q3 ) ; niais c'estune coiijei-Iiiri dix i'o1iisti' le ce uts. (oui tic ceLui ,lit Pari.simss if'u8q, tut encore di'ccliii du Vendus 316; soir tiioti i)iiiuc. 1. t'- xxxiii, ii. -u). laquelle pourrait, su I,esoiîi,i"tre juste, mais i1iui, à dire vrai, ni,' senil,l,' inaiitlr'naiit fausse. Car iii l'iruls'rprétatioiide Reiske, st,'inqerL' et i-antùrcj lieI'i' ,jca,iIuS, t clic iliîiccie iiîlqi'ii , t' qtiod fanant cujjcliecu;itcs e!
muent unies, ni' oit' tairait a,liicissitilc'. ii qui '.4 '/ri7 it5Z'i te peut lias sigiitlier iuiucclis
coniorquere. - xii l'i ii krpr, li hou i nu iqUl'l' )OEi titan renvoi à PI atoti, I'hued, , p. i 7,nit nie parait. lotit compte loI., a,',u'IuLal,le, strccrwt u' xPlute e\ lrCs -siculi élrullgc polir lire u1iue qtuc . lqli'un p1155'' lis mains itou autre cii lu' Sctp1iliiuit.
u Je r r, ci s n t ii- ta' qi i'il s'agit il 'ii n geste il u supplex. Leparsxxr di' lu 'ut n ria titisiii,' parait ,tc'rciteuï : nIiez fliiun, oit cittanclrtuit'2t'tags'to; (cl'. F,\V. t4,4; l_X', I, I
4: LXXVII!. .4,4. Ers outre, cette ciucijecturi' iii' se reeiuui,mariili' lias par sa vrai-si'iiihiaitce 1 iali4ogrttpIiiitu(' c'i'stelait Ic"h,iit aussi ii une lic-oit qui luit t un I
ittaiiilc'ituuit S l'i'»pril Ttïi'EXEI l'ErlI t tI.l'A,i'i'.i-rs tu:, ',' ip oC'est ibm' p'" Iit(ii unI nui, tiqtwi.
. 11h' rex-----ctpjh'.r cnn, ii, rasir,, ,'cniaa,'l ; l"lorus, 1, 45, S sG. - Sur l'altitude il,' 1,-r-
cingétorix, cf. les rexluari4ues de M. l'Arbois dc Juibainvillo. itevue celtique, iqoo, p . ciii.

t 38 IIEVIE lIES 1TFI)ES NClENNES
qui sadresse à une divinité t, et, dans 1'esp'cc. à César vain-(lueur, auquel Vercingétoi'ix Se (101111e en icEinw volontaire.Elle et le s'smbole 1mai et contine le résumé de la cérémoniet w t entière de la reddition .
'i Des paroles 'lui farce! eha, fres. - D'après Plutarque etDiuii t assius, sont fi )l'lliels i'i ce propos, Yerciiigélorix neprononça aucune pat'ol&' cii se l)l'e l lta1it ainsi à ( ésar ', et jeles ci'ois_ - Florus. au contraire, liii fait, dire Ces (1tICli1tlesitiots !JO/H's ; foient t'il'tlm, rie frsrlissime. rieisli.
La coutradici ion (1Ui parait entre ces deux traditions PeUtêtre écartée de deux manières: ou hkn Florus, qui rechercheles mots à effet, aura inventé celui-là, ce qui, jusqu'à nouveloi'drc, me parait plus 'raiseinbtable; ou bien 'Vercingétorix lesaura prononcés vraiment, non pas tout tic suite, mais enreporise aux paroles de César.
I. Sur I'y''Oritv en ntanièrc do supplication, Ourt ixe.,ia, voyez de nom-brou tt' lis dans le Theatiu,'its d'Esti enne, do r 533, coi.r -
'l'eritlre tv's mains ri uva n t 50m vie avoir étt, 'lieZ l( GaUlois, un tics signes quiprécédaient l'acte de la soumission formelle VII, 48, j 3; cf.47, j ; VI!, 40.(((tOnna !endv','r, siqnifieerc ds'diliont,,n); lI. i3,'t (menus tendere, et 10cc aiqsJcurc...scie in... Jotcskile,n i!enire). l)ans l y s trois Cas quo nOUS votions iii" citer, le gest('est accompagné de jiivroles, soit pour annoncer la reddition et prountItre l'amitié(Il. i3), soit pour ,nortertt deprecari (VII, 4e; VII, 67 et 68). Vercingétorix s'estIuvsriié z u geste muet, et, de 1(1 u s, il a jeté ses armes as - ah t de tendre les rusains,ce qui, jtiirit zut détails de sa sentie, parait montrer la portée surtout religieusede sa sup1vliealion, - D'ordin;iirv', les tiuvins étaient ouvertes et étendues, pesais,nenibua sou more, dit César des Gaulois (lI, i3, s 1; 1, 3i,3 VIl, 47,5); maisil ne s'agit, dans ces trois textes, que de t'inimcs at d'enfants et, dans ces trois casencore, le pvtssis ,uûnibuus est accompaguté tl vriros verbales.
3. 'IIyzs 4yvs. l'lutarviue, XXVII. - Esu ii' nis. Dion, X L, 4', 5 z.4. Je doutric le texte des manuscrits. La plupart les v,'vlïtt,tirs mod('rnes (iahn,
tSS:i et tI lalm, 187 ; Ittsïttitlu, t 8q1) on t accepte /tvnhc, inséré dans son récit parPétrartiu v ' Jitsloruvr Iii Iii C.'rit'ia, XVIII, S'a, éd. I ,u niai ii', p. 4 : En Iutibe, ittqtiit,ferlent. eh', . M. Fit bi , t' insulté ta r moi sur vijiîérentes cnnujr'clui l'es. nii'év'rit ni sujet(iv' v' lvi I e 't Lut conj ot'l ire Ivabel, acceptée par Ruperi , G ronov itii, G rav i us, niepanait impOsai bic: c'est le cri pr h'qiicl I,' v a j n ( I v u I.u lr Ont te public' constate la défaitetiti n glavjiateyi r : e Il vin tien t, il z SOIt compte; o ici 'v' serait le gladiateur (ruu3taplm-rique qui parlerait ainsi dvi titi - mémo à la troisièuïii' personne. - Je n'ai trouvéutullv' port la conjecture habco, Si elle s ét proposée, c'est pour lever la difilciiltéil t te je signa le, Il resterait alors à démon tro r que !vabeo "tait, COlO lite habet, ( 11Wforum mIe cou sacrée, celle - là dans la bouclmv' lu s;, lut-u, Cv untilinvi celte ci dans celledu vainqueur ou des spectateurs. Je ne saclic pas qu'il en ait été ainsi. Ilabes estmoins vil' qtie imabe, selon ta très juste remarque de t;r:u't lus. Mais, très conservateuren critique verbale, je garderai tout de mème itabes, t e rce que c'est la leçon desmanuscrits, et qu'elle doiiue un sens satisfaisartt quoique )ttvbc dorme sine nuancede sens meillv'tin'e. IIvu?ws« ji'ommt cev'i] est à toi, fpuisquo], très brave, tu asvaincu un e ljras't'. t ikttvt' e Ouï' toti t cet-i I 'mvl,Partiv'nne 't ou t tiens.,, n - Cettecession impur-a tise 1i rut niietu x la résigna li ' ut fa rout:lie de 'crcingétorix qu'unesimple constatatin.vrt à l'indicatif,

NOTES ( \LLf)-ROMAtNE' :t()
Car, au dire de Dion Cassiits, tandis que tout. le monde se
taisait, Vercingétorix comme les Romains t , le proconsulinvectiva son adversaire. liii reprochant d'avoir rompu l'amitiéd'autrefois . C'est alors que le (atiloi lit petit .-ètre la trèsl)rève et très digne réponse que l"lorus liii al triinie.
5° L fin de l'entrevue. - César, disent Plutarque et DioiiCassius ", le fit emprisonner et réserver peur le triomphe. EtDion mentionne deux f is. au inomen L de sa reddition et aucours des triomphes, à la (laie (le 'i6, Fexécitlioii de Vercin-gétorix 5.
Des cinq auteurs qui ont raconté la reddition de Vercin-gétorix, un seul a écrit sans autres sou r('eS que ses souvenirspersonnels, Jules César : son texte n'a servi de modèle qu'àOro.se, qui le paraphrase sans bien le comprendre. - Florus,Plutarque. Dion Cassius. qui ont. insisté sur les détails pitto.I'esques que néglige César, ont dû les emprunter à d'autresécrivains, et., sans (Ioule. à un seul et nième historien, 'file-Live, épris comme eux (les narrations j Inagées et vivantes.
Tive-Live, le déclamateur Flotiis ajoute titie phrase à effet,le prudhoinme Dion Cassiiis quelques réflexii utS morales,tandis que l'honnête Plularque suit consciencieusement sonauteur. Mais réiniissez César et Tite-Live. vous avez le sens et.le récit détaillé du dernier acte libre de Vei'cingétorix, à la foisvaincu qui se livre et victime ivante (Jui s'offre pour tous.
C MILLE JULLIAN.
i. 'H.ra Et L)inn ajoitte eette nouvelle observation psycho-logique Ti oi i.vrTy,''t%'5yr,; .it LVT€t XL C.}
1p')':erptIOEtI)ion ne perd pas non plus cett(r ortasion pour faire une remarque d'ordre
ruerai César, dit-il, Fut e Ispéré surtout par et' souvenir d'amitié dont Vercin-géttriï avait espéré surtout ou salut : 4.1KiïŒ')&tt'iz't i7tiza'i.5t (; v'./).c.r&pŒv;XŒI OE'tQt,5E).
3. "AXptpfJi.F.',o it1j';s,. Pliitarju'. \ \ 't II... c' I souvenir de son iiigratitiideit t7i arv
&)' e;t i't'L')Ç Wr'y t,ti,t'xkxspertes it st:tItX'L.ItoissevatulroSto!tozizst'i. lion. Xl., ii.3
5. Dion. note préctdente et XLIII, it.

I I4ELI ItiSI1IES':iKtNEs
Al ési a.
J'ai essa é (le Hit' rendre compte, dair un réeenl vo yage r Alie-sainte-Reine, tic ce qu'a\ ait été celti cité dans l'arilit1iiik', en dcli irsdis évéiretireiris iiiilitaii'es de la campagne dc )2
Je ne crois Ias que le iront d'. t/esia suit gaulois. M. Saluinon Reiriaclime t'appelle qu'il doit ètre le mènre que celui (l'A leria en Corse, et (lue,111tant, leur origine à tous deux est Ligute. Ces t aussi mon sen tintent.
Ce nom a-t-il clé, dès l'aliuril, celui d'une 's ille Je lie lepas.( ruine tarit de cités de la (iiule, Ninies, Calions et autres, Alise ale roui tic sa source . Le radical (le ce irnot se retrouve (mus rlill'éi'e.nrlstorils de sources (01 de rivières des pa y s celtiques :i Et. la 1)iiilcipaleCtIIlOSité (l'Alésia en dehui's dr son's cuirs liisluinlues est une ahuri-dante fontaine qui fuit célèbre air Mo yen-Age et bien au delà, et qui
il û avoir tir tout temps un caractère sacrél)iutltire rapporte 5 , au sujet d'Alésia, unie eurrienist' tradition, qu'il
(luit ernipruirter à Posidoriios, c'est-à-dire à un atilcuir antérieur àCésar' et au siège tIr 5',' \ltsia aunait été Ibuidée pan' hercule, qui yaurait dahu une grande partie tic soir armée vagabonde 1 . Et ce devintune belle ville. Mais plus tard les paysans barbares dii voisinage seirièlèreuil aux colutis, et, plus nombreux tln't:'u\, leur inipusèrenit leursIliiliirs sauvages. Ce qui est inténx's'auit dans celte tradition. cc l'estpas lui prtsr;'nice l,anuale de la légende dl lert'ule. niais la Ilienitioru ticdeux étals politiques dillreunts dans la ville d'Alésia. Il rie serait pas
impossible qu'il eût là un lointain et confus souvenir d'une doubledu tutuuuation . celle des Liguies et telle (les Celtes, Il est encore fort
11 y a Hile .41,suz antique dans la Marne (cantitri le Si iite-Meuuettotilti, 1)leliou.iituirc lojogu'ajt/t ique, p.
.tlisuulhu, Ausouc, Muselle, :171 . Aquis F• ljisinrii, 'la hie dc l'en Linger, etc. Araj)procher pcut-ètre des rivières Lisia, Lisez,, etc. (ii y u un ruisseau ils l,isnn, prèsd'i;tise cri Franche-Cuiiitti.A rapprocher cri Lotit cas des rivières Auzon (il y a unt.u l zt'tn près tic Gergûr le, .4 l.sti,u'ni tians la Vienne, Die!. lup. pi3. eh'.), Auxon, Alzon,Auzounet, t )zon, Oze (1'( lie est une tics ii t i'i . t's ii 'Altsi t), l.oz,'. 'Li.
3. lie i;i l'impossiiiiIih, selon moi, tl'acet'1rtei i'tiiiiuIiigit' ltrteot' par Ilolder,col. •':' t:t. air. [ancien irlaumilaisi ail =- frit [rt'lts'il.J,, trt ' tiuigiit'ruii izittiirs ticcelle iIi' ml'Art,ois (le JulmainviUe (Les premier. !umhita,mu il,' I'Rui'opr', I. Ii, iSija. p. oi-aoO: rt *Al t sa- ail. ,'rh', ItOIIt ligrire iL gerinammiqile tic l'auliue,. - Vii t,tut cas • .tlisaet ses tièrt vs nie parait ii ii item cern mun rie souries, vestige tic ta langue d t r pi ri sancien petipie de la Gaule, les Ligures prohaliletitezit.
4.....ta Sanetorurn,septenttmrc, III, p. tilime jugeas jiereqri,ueruzm affliclueque,tariittt!is fitleluun ail etutt (f Onteut) eanu,'sui. I 1m icltesute, I.t's .4nliqrmire: des Villes, 16sp.tL nu fonlimiite pros citanite du uttititttv0is [r'tt le souitiitet tiièiiie iii. laniroitiagiic], qui giiéi'it iuiiratil li'tt.t'mtrturt plusieurs sortis iii' iittii;idlis.
I V.u, 12 cf. V,, t. Il nt's I. in iposs I liii' de t oir laits mette 'AXîiune vil leii ht Gaule méridionale, par exemple .lais, '011m rite tl'attlrr's lotit pesé (Dielionnai,'ea,''!irtiloqiqmtc de la Gaule, t, I, p. 3t ; llirschfeitl, u:-pti.v, \ III, p. !t3p).
si. L'élytuologie: 'Ai.r1 2... zi5.t:, que donne i)iotlorc, doit se retrouverpour d'autres locaiit,s grei'qiio,.à rtcjnis sr,'nmti,lablcs (t'f. Wissosva, 1. 1, col. u3u),

'O'fES t; Il.()'LU)Mk I NES I ' I
curieux de constaler, dans cette tradition. la cro yance à un recul de
la ciiiisation. semblable à ceux qui l'arcliéologir' permet précisérneul
uiiji ttird'hui de constater chez les l)t'tIPl cs des régions celtiques t.
I )ii dore ajoute. toujours, à ce que je crois. d'après PosidoniosCelte illc est. aujourd'hui encore en grand hi tuilent chez les Celtes.
o,nrnc étant le foyer et la métropole de toute la Celtique a . t Rien
i'empêche (le penser qu'elle i pu ;i tir tin rôle religieux dans la Gaule
(lit centre, ou tout au moi us dau la f; aule édueit iii', qu'elle V ii été
tine sorte de cité sainte, Qui soit, du reste, la situation d'.désia,
campée. toute isolée, dans un vaste carrefour oi'u ah tritissent de toutes
parts des roules antiques 3 , ne s'étonnera pas que l'assertion de Posi-
donios ou dc I)iodore isiérite quelque confia iicc.On a (lécouYcrt à lise une des inscriptions gauloises les iltis
longues et les mieux gravées que l'on connaisse ; cc qui prouve
ulL1'p1's le siège (le 5, la montagne demeura fréquentée et populaire
dans le monde celtique.On y a trouvé également un certain nOml)re d'inscriptions
romaines '. Trè peti de ces inscr iptiins. p0111' flC pas (lire aucune,
sont funéraires. La presque totalité soiit des déditaces r des di mités
\lnrs, Bellune, la Victoire, le dieu Moritasgiis et uni res. di mités
militaires poui . la 1)1H1)alt, mais, seilil)le-t-il. tlttririnu pi'éroniaiiie7.i:ll porteiit (les iioms de hauts fonctionnaires et prèiECS municipaux.Li u' ins et lduens. l)onc. à l'époque romaine. .Uésia parait avi tirconservé son caractère reIigieux. Le martyre ou la tradition desainte Reine allait le lui maintenir an M tyen-.ge et jusqu'à nos jours.
J'ai à peine besuiiï dc rapf)elct' qu ' t/t?.1a. après avoir été l'oppidum
des landubiens, demeura le centre du paqu.s quils formèrent dans
Par exernisit' cri lriaiide, où M. Reiiiaclt tprouver un Yéritai)Ie retour de
barbarie au temps de tirivasiOn dis t1 ptt . s cet litlues (Reu'ue .'ebiqae, t qoo, p. r 73).
r.Kz),ur u.(o t r&rtt', YX2()Lp.6c7t ).es, tt
K).ux 1i
3. Et les ont été iiid j rttiées en premier I rit ia d'A mille, !"(ah'eit',ttens, p. 483.
'i. Le nausée f t, Iie. pour tuodett' qu'il soit, est ioteltigeiuuniciit instaltt., a'.ec nusoin qui fait honneur à ta nuttiticipalité et iii maire de lit comnunne.
3, Coupas. \lll, 880. C'est luit' iruscriptioit tohive. 11 y t. t tir tiu,i .tLtStlA'.
6. l.ejsy , Inoeripl touts nuutiquue.s de la (Xdctl Or, r $8q, p. u é et suis . CorprIS, XIII.
p 43-4 r, et n' a$8, Les numéros 2577. b et e, apparliennent à ta urièine inscriptittit
et peusent se lire ainsiF l. iteu, ,tgiubua Itonori buis apud sites FVNctusF)AC pi tu tt't que pnt M. A
Les antres fragmetits tir u' 2577 appartiennent chacun à une inscriptiOn JilTérente.Lejay, p . t é, rappelle la dé'oiiverte d'un temple Létrasty te, à l'est du Mont-
.t,uixois, à la Croix Sitiuit-Cluarles.5. Ce qu'indiquutra[t aussi sa qualité tic chef-lieu tic pagus (cf. Ilevue des tutdes
,uucierultes, iqel , p. qa. n. 2). t' Ce concours de vuit' puihuliquies au Mrtuit-AUois, t dii
ti t, il le, ri P° hit'ru q t t'_1 truie 5e cOT(lrVit ri t t' tilt itiit assez lior t sa n t. u) — Mai t t
faut ajouter pie la ville paratt avoir quitte te ptatcaii pour s'installer en COntre-l)aS,prés de la source e.t surtout pIns bas. là où est aujourd'hui Alise. En réalité, il faut
distinguer le bourg uh'Alkc et Sainte-Rtiu1e, longtemps séparés.

I RE\ L Dt-.I, U LILSC1t.
lr ciu des lduens que cc pagus prit plus tard le noni (le sa capitaleet de int le pays d',uxojs t et (111e l'Auojs a subsisté, comme pas't. bailliage, avec Semur pour chef-lieu, jusqu'à la Révolution 2,
1 (tIC perpétuité de la circonscription cl. de son nom est une preuvede plus dc l'identité d'Al jse-Sajjjte_ Reine avec Alésia, oppidumÏandwtiorfjf,1
Les parentés de peuples chez les Gaulois.
J ai ci té, dans la Repue des J'(uj/es (znei,» ,we,S' t qo i p. 93, n. , iicertain flOflhl)l'C (le textes teIa1il aux liens de parenté, vrais nu fictifs,que les J)eulpIcs gaulois établissaient entre eux,
En oici un autre (bat je ne nl'aperçnis Iuie lilaintenant. Les Rèuiiesdisent à César Cown,('fl1jp' Il, ' qiuuis sont unis à peU Pi's àtons les Relges, propi/iqu(/jbziç a/'f/nit(l/ibL,qfw conjwfcti. (:otliInc' lesBénies se disaient Par ailleurs frères des Siiessions (11, 3, et queles Suessions passaient pour avoir eu l'hégémonie sur la Belgique,il est possible que les Belges se soient i'onsidérés, tort
Ou àComme une xér'itable e fraternité e ou tout au moins conim' uneliimiillc distincte dans la plus grande famille celtique.
Il est bon, du reste, dc l'eniarquer que les mariages paraissent avoirété assez fréquents, et iii tout cas perrilis, entre les différentes cités dela Gaule: il y avait connuàiurn entre elles. Orgétorix l'llelvète donnesa fille à l)urnnor j l'Eçlueri il, 3). La nière de I)tlmnjrjx est remariéechez les Bituriges (I, r8 : sa soeur et d'autres parentes, (Jans d'autrescités ('ibidem) A, L'exogamie de ces grandes iiiusons celtiques est unfait digne d'ètrc noté, et qui n peut-ètre sa source dans d'anciennescoutumes de clans .
C. JULLIA\.
t. Paqus .ilisie,sj.s, tetes 0/Id Ilolde,', cul. qi -e2. Les suldfvjsiuj, ecclésiastiqiies ne correspu,idsj1'nt plis, sur cc point, au pa!Ji.spriiriitif; cf. l)esncoprs, ,4nnairc hLtorique polip. rt.3. Jusqu'à plu a ru pli i n formé, je t le peu ï il tIlt] ri li moi nd ra rap ] ort entre lavictoire do ( '8r 't la fète et pFoc('ssinhi le Saiit,. Reine, leseph'ii lire, contrairerssc'n t ii ce qui' tl'au tre,. on t su ppos. 'u' il u q u i'li I 10 relation «tu tri li' pa aiu ts III' 'lle culte de sainte Reine, ('est, j , crois, par la dévoti,n à Ils Sou.irce r cette soi ri'i' ae,ubk'( 5 ut r joué tin ri',] e dits la o s.siorI de li sain te i'ium ja.ssif iinpius prw:/'ei.tus tiiIj'ru'i'ou quoddam rn'uqniwu et iliip!eI'i «qua et deperi cor, , etc. t Puissio, laits les .4'Lo, p. 3La iiuérc' de l)urflflorjx me jiir.iit as oit' été uuiiirjé,' trois fois t' d'uit, lit, elle ula uio'orem i'.: uuof,'c le l)unuuruuirjx lins autre, elle u t )uunlloriv; 3' cl i'lle convole,de par la sol,,(é de son IiI'., en triisijn ' noces, vii mi'me temps que Sf'q dc'iixenfants se marient euï - nième, tout cela nie parait irili(11eI que beaucotiji de
mariages devaient avoir, chez leu nobles gaulois, unie ituportaii'e politique.. L''vnguiuiie n'est juS OIt n'est plus la ràgle entre gens d'une même cité. Clic,,
les 'trévires, ln&lutioi,iar ii marié sa fille ii sou eOunpotriot Gingétori (V, ii J- - luece que, chez les trsernes, Vercassivellaun est cousin d Vereiigéluj,-i jur tes 1u'iunues(VII, 76), on ne peut rien conclure dans un sens oit dans l'suutrs',

BIBLIOGRAPHI E
Ricochon, Tablelies et Jbrmules magiques à double sens, i série.Paris, Picard, ioi jfl_5U de ', p., t pi.M. Ricochun a eu un rare courage; il s'est attaqué, lui huitième, ii la
plaque d'argent de Poitiers. Je ne puis allirmer qu'il en ait résolu tousles mystères. Mais je cn)is qu'il a suivi la bonne voie pour les expli-tucr, en s'adressant h larcellus, lequel lui fournit de préckurappi'ochements'. - Mais je ferais des réserves sur sa théorie d'iuttexte h «double portée » ou h sllabes désarticulées s - Je croirais bien
plutôt à une formule h sens unique. niagique et phxlactérique, comiw
celles du D' Re rustiea et de lai'cellus, sans le moindre SOUS-entendU
graveleux ou autre. . J.
Muller, De Civitutes van Gu/lii. lxtt'ait des Fer/wndelingen ilertkctdemie van %, etenschûppeiz te - I msle,'da,n, u/'cleelizq Lettre
kunile. N. s., Il, t. Amsterdam, \liiller, 1898; gr. in-8' (leSa p., 2 C.
tude. stalistiquc, avec cliscussioris, tableaux et cartes sur lesiités des proinccs des Gaules dans les quatre premiers siècles.Le travail (le M. Muflet' marque beaucoup de bonne volonté, jit;ijsbeaucoup d'inevpérience. Je ne puis le considérer que connue undébut. L'auteur n'a vu les différentes questions que d'assez loin, sanstrop se rendre compte de leur difficulté. Il n'a pas consulté lequart des ouvi'ages nécessaires, il a peut utilisé les inscriptions, il anégligé les vai'iantes (les manusci'its, et il s'en ( jouit (top olontiei'sh des livres qui ont "ail leur leiilps il. h des opinions démodées, iirbien des points, je ne peux admettre Ses conclusions: bu est le pasde Ru(-h, et non Baonnc, comme il l'indique; il est impossible de
ltit'c des I)alii un peuple des Ilautcs-l'vrénées, cl dc placer lesB(iens eduens entre Sevei's et Lcize, etc.
t
i. l,es deux prcIllires ligues soiit faiite à reconstituer: Bi ywitaw'ioi wiiita(1i nui'ota(agis [iliot s grecs icrits en tettrea latine[ (prends nu prlpure [nu quelque clioed'approcl la ii leu x fois de la l'On taurle). - Je 'u ppiCsc en su j le. ou corrigea n t kg'-rInCent le texte: lui, CWI j SI)(i)i I, l'iFii j.fI!C'ill l l(tlCh iii »(ingc'ailt uii rôle lu cIii»n et iii' Miii
siier j t 'IciC ijans tes iuicautiltiiiis - \i,'ntrait, i'iitlii, aalls ( l i i i ' j ' ILil' charge, piiiii' lenioment, dc donner itiic t' p1 ju-atini, aux deux preniiera unit, iIii.iia 1f aaiarase lulateJUSiiTUl(ili), etc.

ltl Cl IFS iTimF.s ANC1EN'ES
Poli!, L'inse pij,lion iiufi,milse iii' l'Ieltlhyx. trad. par J. Déche-lette. Extrait des 1tu,itres ilc lit SociéW (due,rnc', t. \ \ I \
utun, f)ejussieu. Ii)OI ; iii-8 de 3.^ p.. i pi.
Fractuction . cOm i t I t lée par (lileiclues n i tUs. titin mémoire publiéen iSSo, i Berliit, sur la cèlèbic inscription. \OUS aurions vouhi fille\l. l)éehelettc, moin rèservé, mitlli1iliàt ce notes cl profitât de locca-skin pour uiietire au courant la bibliographie (le Ce illonurneuit, dresséeru 585 par Itoidiit ilan le bitte \\ I (les Men g ojpes de la "kiciélée(lfteflflC. c. .i.
Dernarteau, Le t'ose hMoniqoe de Ilersiril. Liège. GoIliier, 1900iii 8' (le 26 pages,3 planches. Extrait du tonte XXI X diiRuile!,,, de I institut ure1uoioi'jique liéjeois.
I:traiige. objet que te vase ib' liruize. tri iii é tians une sépulture duI la tut-Enipi re, à I Ierstal - lez - l.iige. Su r h' cou unie, sont figurés
c tuples rlivuisciueri L enlatés n. ai tiitinaliies scènes de pria-pisine conj ligué. Sur le iise lui - mèrnt, au ci 'ni raire, quatre gravespeisoiinages. avec 1 costiitute i'l les atlrihuts lus philusophus grecs.Contrat' que Fait r du cette brochure explique par les leçons de laT)hIilosoPlIie épicurienne, dont li' pi sse.sscur du vase aura été unadepte. Le travail de lartisle qui Fa ciselé parait fort bon. La brochuredc M. Demartt,au est uonseiencieusu ut flous i lie des traits flOUVCOUXstil telLe ci' ihisatioti galtii-rcimaiui' du lcYs de i'ongies, qui paraît.avoir subi un (chIps d a irèt après \la ru - Aurèle r.
Franz Cumont, A propos du ruse de Ileislol. lhiuixcllcs. Vro.itiant, i quo in -5" de iG p. et t pi. El i'aii. tits tnh/(iles tu.
lu Sci^i t!'w'chéoltwjie (le !fru;rellex, t. \ I
(l'est une ié1uonse il M. l)trnaitctii. \l. Cutiititi ou croit jias ii_1ule,. figures de ce ase sOiCflt une alliiiiiii i lenseiguitiierit (I( la (liCitifledu jiaisit ou à la ph ilosopitie épieu I iunne. Scion t ui, les austèresphilosophes (leu bas sont les iiiètii, I]1IC les jdirultii's d'en haut;représentés par UI) artiste giitaihiti u. ici a cc le costume grave (luintiitre de philosophie, là tIans la tititiité de Iwnulor Cifl(lCdoPttFfl. Etl'ensemble peut être conimenté par les YCrS tic Juvénal
Qui (7urios siinulunt et I3acchanal,a L'ivunt.
I leu xses rie 1)rC,fl/r' .k lueur L i 511 il I)tllr, Or L t& Lrouvs près de 'ifii ri I i'Tougrc. tu us ilcu v u iii rr ii rsirritent i Marc A in rte. Ce contraste des il eu'
sries rie scuitlire lait suriir air biis-tilief li 1riu (lieU lier, n' 63, p. i86), où ils s, ii cAtè de scèiie l,aria1e. la plus ustraorilunaire vkioi rie phallisrur-i ecrnnupuriqu'oit pu j e i ina 1 i lier. J,' crinri ii 't I fi u t le ra e mcl or dii vase d'Herstal.