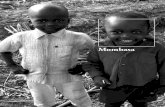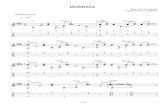Net peace mombasa presentation
-
Upload
imag-imagazine -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Net peace mombasa presentation
LE ROLE DES MEDIAS ET DE LA COMMUNICATION DANS LE PROCESSUS DE MAINTIEN DE
LA PAIX EN SOMALIE.
Mombasa, Kenya, le 24 septembre 2013
1. Introduction L’homme contemporain, où qu’il évolue, subit dans son quotidien l’action des médias qui rythment son organisation. Qu’il soit en temps de quiétude, de peur ou de guerre, l’homme a toujours besoin d’information et dans une certaine mesure, la communication soude son appartenance sociale, au moins pour deux raisons :
1. Le besoin de savoir s’il ya danger dans son environnement, si le danger se rapproche ou s’éloigne afin d’adopter un comportement conséquent selon la situation ;
2. Le besoin de se réaliser, d’améliorer son vécu. Dans ce cas, l’information donne des renseignements sur les opportunités, les nouveaux défis, et de ce fait renseigne les choix pour mieux s’organiser.
Par la force des choses, Les media sont devenus le quatrième pouvoir. Leur puissance infléchit l'opinion publique. Pour beaucoup, ils sont devenus le "prêt à penser". Ils sont ambivalents, véhiculant le meilleur et le pire. Une anecdote, vers les années 1995 - 96, le Burundi (mon pays), à l’instar de certains pays en Afrique, vit une période chaotique sur le plan politique. Un petit rappel : 1993, un président est assassiné. Des massacres à grande échelle que le Conseil de Sécurité des Nations Unies nommera « actes de génocide » endeuillent tout le pays. Dans leurs efforts de revenir à la raison, les acteurs politiques amorcent un dialogue qui par moments va capoter. Alors en 1995, le débat est en panne. Et qu’est-ce qu’on voit ? Une cohorte de journalistes venus du nord (généralement bien informés), débarquent par centaines et font le plein des hôtels de Bujumbura. Normal parce qu’il y avait crise me direz-vous ! Mais, la raison profonde de cet intérêt soudain est plutôt étonnent : « couvrir le génocide en direct » !!! Voilà ce qui pouvait provoquer un intérêt soudain pour les médias. Et pourtant, le pays a connu d’autres occasions de se faire connaître positivement ! Michel Ben Arous pose que « l'art de la désinformation fait partie intégrante de l'art de la guerre. Paraître toujours plus fort que l'ennemi, plus valeureux, animé d'une meilleure morale, mieux aimé du peuple, dépositaire d'une légitimité supérieure, … », ces pratiques traversent des siècles et sont partie intégrante des armes de guerre . Les guerres changent de forme et d'objet mais les parties en guerre restent par essence désinformatrices. Le journaliste doit rester éveillé, attentif sur ces pratiques bien éloignées de l’information vérifiée aussi complète que possible dont il est défenseur. L’information confère à celui qui en a la maîtrise, ou plutôt qui en maitrise les moyens une supériorité évidente. Les pires atrocités peuvent s’appeler « guerre propre » pendant que le défaut de moyens de communication gardera méconnus les efforts de paix. Nous devons le comprendre et le faire comprendre.
2. Contexte de création de Net Peace Le Réseau Net Peace a vu le jour à Addis-Abeba au terme d’un atelier de deux jours (du 2 au 4 novembre 2011) sur l’architecture africaine de Paix et de sécurité. Organisé par l’Union Africaine, cet Atelier était axé sur le thème « Promouvoir la culture de la paix dans les médias ». Pourquoi ? Aux yeux des plus hauts responsables de l’Organisation continentale ; il apparaissait que malgré les importants efforts consentis dans le domaine de la communication, les actions de l’Union Africaine, notamment dans la gestion des questions de la paix et de la sécurité, restaient largement méconnues, voire ignorées par la communauté des médias. Non sans raison.
� On assiste à un contexte mouvementé sur le continent : 2010 – 2011 : Côte d'Ivoire (conflit post électorale), le printemps arabe avec ses conséquences notamment le drame Libyen, l’interminable conflit aux facettes multiples en République Démocratique du Congo, …
� L’action de l’UA dont l’opinion attend plus d’efficacité que l’OUA est invisible, en tout cas, il
n’est pas notée. (Ce qui ne veut pas dire que l’UA n’agit pas). En tout cas, l’organisation est présentée comme inerte.
� Les informations sont essentiellement données par les médias du nord. Ceux du continent africain s’effacent ou traitent l’information partiellement ou simplement subissent l’orientation (chaque information a son angle !) donnée par ces medias européens ou américains « généralement bien informés !! ».
� Le défaut de communication de la part de l’union Africaine « dissémine » la perception d’une institution inefficace, incapable d’anticipation et d’engagement, un club des chefs d’Etats plus préoccupé par le soutien mutuel que les intérêts des populations à la base (d’où plus de communiqués que d’actions et … langue de bois !!).
� En face (à l’UA), on évoque une indigence de maîtrise des processus de décision de l’UA constatée chez les médias. On décrit des médias peu informés, plutôt réactifs, incapables d’analyses profondes et pertinentes, … bref mauvaise qualité professionnelle.
Bref, le médiatique s’accommode mal du diplomatique (info sur le vif –vs- démarche de conciliation). Une certaine méfiance est notée entre les deux mondes. Ces différents constats ont prévalues à la création un réseau des journalistes africains pour la paix. Net Peace s’établit en tant que réseau pour pouvoir attirer l’attention sur les faits et gestes qui se déroulent sur le continent africain et qui seraient potentiellement des menaces à la paix tout en accompagnant les initiatives porteuses des raisons d’espérer.
3. Pourquoi le Réseau Net Peace ? Au 17è siècle, Théopraste RENAUDOT, bien introduit à la cour de France (médecin, secrétaire du Roi, Commissaire Général des pauvres du Royaume) écrivit dans ‘La Gazette de France’, «cette feuille est utile auprès du public en ce qu’elle empêche plusieurs faux bruits qui servent souvent d’allumettes aux mouvements et discordes intestines. Il s’agit là de rumeurs incontrôlées, souvent colportées dans la société et qui provoquent des mouvements sociaux»1. Par cette affirmation Renaudot défend la profession de journalisme qui doit servir des nouvelles vérifiées pour éloigner les rumeurs dangereuses qui nuisent à la marche paisible de la société. Mais surtout, il attire l’attention sur le fait que, tout en jouant leur rôle de pourvoyeurs de nouvelles et de critique des acteurs sociaux, les journalistes ont la responsabilité d’éduquer et de promouvoir certaines valeurs telles que la paix sociale, la justice, la cohésion nationale, etc. Par extension, il interpelle la société sur son intérêt à garantir aux médias la liberté de d’aborder sans restriction toute sorte de sujet.2 Depuis donc le 17è siècle déjà, la toute puissance des médias est reconnue porteuse d’énorme responsabilité sociale d’éducation et de promotion des valeurs fondamentales telles que l’unité nationale, la paix et la coexistence entre les peuples, les nations, les groupes ethniques et autres identités; des valeurs indispensables au développement, à la formation des citoyens libres, capables d’opiner. Voilà pourquoi nous croyons que le réseau Net Peace a des raisons d’exister. Parce que si les médias ont acquis cette toute puissance –parfois contestée mais jamais démentie – les journalistes africains doivent garder à l’esprit que l’usage qu’ils en font est déterminant. Pour son émancipation l’homme a besoin d’une information cohérente, complète, précise et objective pour comprendre son environnement.
1 Voir http://prixrenaudot.free.fr/histoire.htm
2 TJADE EONE, Michel, faut-il une déontologie des médias ?, actes des 41è assises de la Presse Francophone,
Yaoundé, novembre 2009.
Le réseau nait donc avec l’objectifs de s’engager, ou plutôt susciter un engagement des différents médias à s’intéresser aux questions (multiples et multiformes) de sécurité en Afrique et à s’engager pour la paix (en permettant aux publics de connaître les efforts de l’Union Africaine pour la paix). Pour cet exercice, le réseau Net Peace avec l’appui du département d’information de l’Union Africaine prévoit de renforcer les capacités d’analyse et d’interprétation des crises d’une part ; et une meilleure connaissance des outils et procédures de l'UA dans les situations de conflit (médiation et autres formes), de l’autre. Pour cela il prévoit de mettre en place de programmes de renforcement des capacités (formation dans la couverture des conflits, bourses d'études, visites de terrain au sein des missions de maintien de la paix, etc.). L’architecture de mise en œuvre est bâtie sur un partenariat renforcé entre l’Union Africaine et les Médias. Il s’agit principalement d’accorder aux médias l’accès aux salles des délibérations de l’UA notamment en faisant correspondre le calendrier des rencontres de la commission de paix et de sécurité avec des rencontres des journalistes de Net Peace. Ceci pourrait porter à confusion dès lors qu’on est dans le journalisme. Mais Net Peace est convaincu que la promotion de la paix n’est nullement une invitation à la promotion de la pensée unique ou du totalitarisme. L’appel pour la paix ne signifie pas la négation des oppositions. Peut-on simplement l’envisager ? NON. La confrontation d’idées opposée et des voix dissonantes enrichit et construit la démocratie. Les médias leur donnent un cadre équilibré et pacifique d’expression et contribuent de ce fait à prévenir les recours à la violence.
Net Peace se doit d’exister pour plusieurs raisons, permettez-moi d’en citer deux :
1. Première raison : les médias n’existent pas pour eux-mêmes, ils ont des rôles permanents qu’ils doivent jouer
Les médias ont un rôle et un pouvoir considérable dans la société. A ce sujet, Francis Balle soutient que les médias n’ont pas vocation d’exister pour eux-mêmes mais qu’ils existent pour le public et tous les publics. Nous lisons : « des médias, toujours plus nombreux et variés, quel usage les gens font-ils ? A quelle fin ? Avec quel espoir, secret ou affiché ? L’important, ce n’est pas seulement ce que les gens font des médias, c’est aussi ce qu’ils en attendent, ce qu’ils en perçoivent et ce qu’ils en pensent. Le pouvoir des médias, leur rôle, leur statut, dépend, en dernière analyse, des relations qu’ils entretiennent avec les autres pouvoirs qui sont à l’œuvre dans la société : d’abord ceux des gouvernants ; ceux, ensuite, des financiers ou des marchands ; ceux, enfin des artistes, des savants ou des créateurs ».3
Donc, donner l’mage du monde fait partie du rôle des médias. Les médias ont plusieurs rôles à jouer afin de veiller au bien commun en collaborant, surveillant, facilitant et critiquant les gouvernements. Les médias peuvent non seulement aider à trouver un compromis mais également renforcer les positions les plus extrémistes qui peuvent mener à des actions violentes. Si nous ne jouons pas ce rôle, les autres vont le jouer à notre place, en notre nom et avec la légitimité de la mission de tout journaliste, créer un citoyen éclairé.
2. Deuxième raison : nous devons inculquer, voir construire de bons modèles
En présentant les informations dans une certaine hiérarchisation voulu et décidé par le journaliste, il crée une influence certaine sur l’opinion. Les journalistes présentent les modèles qu’ils construisent ou des situations qu’ils dénoncent. L’Afrique, c’est aujourd’hui, mais c’est surtout demain. Nous devons penser l’Afrique à la lumière de notre progéniture. Ceci nous confère une responsabilité énorme à savoir construire une Afrique positive, fière dans la perception de nos enfants, l’Afrique de demain.
3 BALLE, Francis. – Médias et sociétés. – 9
ème éd. –Paris : Montchretien, 1999, p. 569
En effet, dans la quasi totalité des sociétés d’Afrique se pose ce débat autour des conflits de génération. Si les générations ont toujours existé à travers les âges, l’influence de la communication et des médias en a modifié la nature des rapports. Ce n’est plus la jeunesse qui s’oppose à la sagesse mais plutôt la modernité, compris et présentée par un monde extérieur aux repères culturels différents des nôtres qui écrase le patrimoine culturel traditionnel.
Les jeunes constituent une cible particulière, en ce sens que le patrimoine est une richesse qui n’appartient pas seulement aux générations actuelles comme cette sagesse qui nous fait remarquer que « la terre ne nous appartient pas, ce sont nos petits enfants qui nous la prêtent ».
Jadis, les contes et légendes étaient considérés comme des outils d’éducation civique et des véhicules de la culture entre générations. Des noms mythiques ou des personnalités légendaires qui étaient plutôt des référents dans ce processus d’édification de la personnalité des enfants (jeunes et moins jeunes), étaient associés à des hauts lieux, qui dans l’imaginaire collective interne à chaque société africaine symbolisaient le départ de quelque exploit, généralement d’intérêt général et particulièrement lié au respect des droits humains. De la sorte, le devoir de respect et de protection du patrimoine culturel immatériel était transmis de génération en génération.
Mais aujourd’hui, force est de constater qu’il ya déficit à ce niveau. Alors que la plupart de nos sociétés sont dominées par l’oralité, le dysfonctionnement dans ce processus traditionnel de transmission des connaissances généré par l’évolution des comportements et des modes de vie du « temps moderne » crée un déséquilibre qu’il faut compenser par d’autres moyens répondant aux exigences du moment. Pour cet exercice, les moyens de communication de masse, en particulier les radios jouent un rôle inégalé.
Cette jeunesse est prise en otage entre les repères traditionnels et la dictature du développement. Le monde actuel est animé par la compétition. La concurrence est omniprésente et les médias amplifient leur action. Dans ce monde donc, notre rôle est double : compenser cette pratique ancestrale d’éducation communautaire perdue et cultiver les valeurs de fair play. Les jeunes ne demandent que des modèles.
Anecdote : Deux célébrités du sport ; Cobby Bryan le célèbre basketteur américain (noir à en juger la couleur e sa peau) et Lionel Messi, footballeur argentin qu’on ne présente plus (et je crois savoir qu’il n’est pas noir) sont représentés dans un avion, la Turkish Airlines. Entre les deux un enfant, fasciné par les gestes professionnels des deux grands joueurs, l’un usant de ses mains, l’autre des pieds, chacun selon son art, quoi !!
Le gamin donc admire les exploits, à voir ses mouvements, il voudrait s’identifier à chacun des joueurs qui ne se ressemblent pas, qui ne jouent pas à la même chose, mais qui sont tous les deux une incarnation de vie, de joie, … de paix. Qu’il s’appelle George Weah, Zinedine Zidane, Bupka ou autre Marie José Perec, Teddy Renner, la vraie identité pour les jeunes, c’est ce qu’ils font, ce qui les font adopter les surnoms de ces grandes figures. Les médias n’auraient de raison d’exister en dehors de cette mission de créer ce citoyen éclairé et serein, bien informé et capable de prendre des décisions bien informées. Ceci exige du journaliste qu’il soit au service de la dignité de la personne humaine et de la sauvegarde de la collectivité.
4. Structuration de Net Peace Par sa vocation telle que définie lors de sa création, Net Peace a l’ambition de porter un œil sur le continent Africain en n’oubliant pas d’analyser les signaux extérieurs qui s’imposeraient à l’Afrique de manière générale ou à une de ses régions. Six régions sont créées suivant la cartographie régionale admise par l’Union Africaine : région Nord, Est, Ouest, Centre et Sud. A ces cinq régions vient s’ajouter la diaspora. La hiérarchie fonctionnelle prévoit un bureau composé au départ par un président, un vice-président et un secrétaire. Au terme de la première année d’existence et à la suite du départ de la
présidente, le bureau a été recomposé en incluant, en plus du président et du secrétaire général, un représentant par région. Chaque pays a un coordinateur pour le réseau, choisi par ses pairs. Il représente ces derniers au sein de Net Preace régional qui a à son tour un bureau avec un président à la tête. Chaque région mène des activités en autonomie mais en relation avec le bureau de Net Peace Afrique. Les Membres sont des journalistes professionnels qui manifestent un intérêt marqué pour les questions de paix (couvre les conflits, les questions de sécurité). Mais comme le journaliste ne travaille pas seul, ll a été décidé d’étendre l’adhésion aux institutions et spécialistes des médias travaillant dans les domaines de la paix et de la sécurité (notamment pour les personnes ressources). Le bureau est élu pour un mandat de deux ans renouvelable une fois et a la charge de réaliser, au delà de la structuration du réseau (élaboration des règles de procédure pour le réseau, coordination, …), d’être l'interface entre les démembrements du réseau dans les régions et l'Union Africaine et autres partenaires.
5. Les acquis Pour le moment, certaines activités ont été réalisées mais le réseau, vieux déjà de trois ans peine encore à s’affirmer dans son rôle tel que rêvé à sa création :
� Le réseau constitué
� Il ya des réflexions et échange d’informations entre membres du réseau en particulier la coordination. C’est ainsi que certaine d’entre nous ont pu suivre la crise au Mali et se référer au site de la Maison des médias du Mali pour être au vif de l’information. Ceci n’a pas été suffisant car n’a pas permis le partage entre tous les journalistes du réseau mais c’st quand-même une avancée notable en termes d’initiatives collectives.
� Dans le cadre des activités de l’AMISOM, des voyages de presse ont été organisés par la division communication. Des journalistes du réseau ont pu y prendre part. Il faut noter qu’entendre raconter par les médias du nord (RFI, BBC, VOA, Al Jazeera, … informer ceux du sud sur les avancées, échecs ou drames … des troupes sur terrain était une source de frustration des journalistes africains que nous sommes. Heureusement, il ya eu cette initiative.
� Grâce à l’appui de l’Union Africaine, un site a été créé ainsi qu’une page face book. Ils ne sont pas encore exploités pleinement, les discussions se poursuivent avec la division communication pour pouvoir alimenter le site et éventuellement être référé sur le site de l’Union Africaine.
� Le réseau est vendu. Des demandes d’adhésion individuelles ou d’autres réseaux ont été reçues. C’est le cas de Soul Beat Africa Democracy et Governance Network
(http://networks.comminit.com), Face book http://www.facebook.com/SoulBeatAfrica
6. Les défis Le réseau fait face à un certain nombre de défis : - Renforcement des capacités : tout volontaristes qu’ils puissent être, les journalistes ne sauront
jamais communiquer que sur des sujets dont ils ont la maîtrise ; la plus belle fille ne peut donner que ce qu’elle a dit-on ! Les questions de sécurité méritent peut-être plus que les autres secteurs un programme particulier de renforcement des capacités.
En effet, nous devons arriver à raconter notre histoire selon nos propres termes et éviter le fatalisme dont nous sommes souvent victimes. Certes le journalisme est universel mais la compréhension des sociétés et de ses mécanismes a sa part aussi.
- Les dirigeants africains doivent réaffirmer la confiance en eux-mêmes d’une part et, en leurs
journalistes d’autre part. Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, il est plus facile pour un journaliste du nord (quelque soit le media) d’interviewer un chef d’Etat africain ou d’être au courant de ses rendez-vous qu’un journaliste africain. Ceci se pose encore comme un défi.
- AMISOM est une initiative qui recrée, afin disons consolide, la fierté africaine. Mais au regard des développements avec l’élargissement des aires de violence qui même isolées renseignent sur la volonté de porter loin de la base des Al Shabab la terreur et le sang. Ce qui vient de se passet à Nairobi nous rappelle les événements qui ne font pas encore partie du passé. Le terrorisme en Afrique de l’Ouest, les menaces sur certaines régions du Maghreb, …. Bref un mouvement qui mérite d’être analysé et suivi. Quels sont les connexions possibles ? Quelles sont les implications sur le pays et les régions ? Quels sont les facteurs favorisants ? Plus que jamais, spécialistes des stratégies militaires, politiques et médias doivent croiser leurs analyses.
- Que dire des crises persistantes internes aux Etats et qui pour la plupart prennent racine dans ce qu’il convient d’appeler bonne gouvernance ». Peut-on véritablement espérer une société prospère, défait des crises sans bâtir une société respectueuse des droits humains les plus élémentaires ? Le souci de régler les comptes de certains dirigeants doublé du besoin d’assurer un équilibre de la terreur pour mieux survivre reste le drame générateur de bien de situations qui continueront à porter un coup dur à l’Afrique.
- Enfin, tant que les journalistes constitués en réseau comme NetPeace n’obtiendront pas la
possibilité d’accréditation auprès des organismes comme l’Union Africaine et notamment assister aux rencontres du conseil de sécurité, il sera toujours difficile d’anticiper. Le rôle proactif des medias n’a de sens que s’ils peuvent détecter les signaux avant-coureurs d’une éventuelle crise et de pouvoir attirer l’attention des décideurs sur les manifestations et les conséquences potentielles.
Conclusion L’information domine le monde. Elle permet, voire favorise l'intégration de l’individu dans son environnement. Elle lui permet d’opérer des choix avisés lorsqu’elle est correctement donnée. Par contre, elle peut plonger toute une société dans sa perte lorsqu’elle est mal appréhendée. Parce que l’homme ne peut plus facilement se déconnecter de son environnement, ile est obligé de rester à l’écoute des médias, des informations qu’ils véhiculent et qu’il essaie de comprendre et éventuellement relativiser ou capitaliser. Johan Galtung compare « le métier du journalisme traditionnel à un médecin qui observerait l'évolution d'une maladie sans tenter d'en proposer un soin4. Le processus de la maladie est considérée comme naturel, au même une lutte entre le corps humain et tout ce qui est facteur pathogène et donc un micro-organisme, un traumatisme. (1) Le journalisme traditionnel se confinerait à couvrir un conflit ou un événement en attendant un gagnant ou en tout cas le dénouement. Mais au-delà, le journaliste a le devoir d’alerte, de critique et le devoir de participer à faire émerger et entretenir le des capacités d’analyse des situations. Pour son affirmation et sa consolidation, le réseau Net Peace, souhaite être au plus près des opérations de maintien de la paix en Afrique. Pour cela, nous travaillons à convaincre l’Union Africaine d’accréditer Net peace à ses rencontres. Afin de continuer à susciter un intérêt du plus grand nombre de journaliste à s’intéresser aux questions de paix et de sécurité, un prix de meilleur production/artricle sur cette thématique pourrait être institué.
4 Johan GALTUNG, High road, low road , charting the course for peace journalism « Track Twoo » vol7 n°4, 1998
disponible sur www.ccr.ac.za/archive/Two/7-4