La Contribution de la Radio Diffusion vers les ... Report French - Jan 2008.pdf · sur...
Transcript of La Contribution de la Radio Diffusion vers les ... Report French - Jan 2008.pdf · sur...
La Contribution de la Radio Diffusion vers les
Objectifs Millénaire pour le Développement dans le Sud de Madagascar
Une étude de l’Andrew Lees Trust ‘Projet Radio’
par
Leo Metcalf, Nicola Harford and Mary Myers
Financé par DFID
Janvier 2007
Andrew Lees Trust, c/o Warchild, 5 Anglers Lane, London NW5 3DG, UK Tel: (44) 207 424 9256
[email protected] www.andrewleestrust.org
1
Résumé exécutif
La présente évaluation d'Andrew Lees Trust Projet Radio (désigné ci-après ALT/PR) s'intéresse a évaluer les impacts des émissions radio sur les connaissances et les attitudes des auditeurs dans le sud de Madagascar concernant certains objectifs MDG. Elle constate que le projet connaît un succès certain à changer et renforcer les connaissances et les attitudes dans des domaines tels que le VIH/sida, le planning familial, la santé de la mère et de l'enfant, les questions environnementales, les questions sociales et administratives et l'inégalité entre les sexes. La radio influe en outre de manière positive sur l'utilisation des services de santé, l'inscription à des cours d'alphabétisation, la construction de foyers améliorés, la plantation d'arbres, les rendements agricoles ainsi que sur la sensibilisation à des stratégies de réduction de la pauvreté, par le biais d'associations d'activités rémunératrices et communautaires.
La présente évaluation se penche sur les méthodes et l'organisation du projet ALT/PR et trouve de nombreux avantages à son mode de fonctionnement particulier, articulé autour d'un axe triple. Cet axe en appelle à la participation des stations radio, des communautés et des prestataires de services locaux, réunis dans un partenariat mutuellement avantageux en vue d'assurer la production, la distribution et la diffusion d'émissions radio. La stratégie consistant à fournir des postes de radio à des groupes d'écoute semble être une grande réussite et nos enquêtes révèlent un fort degré d'engagement et d'enthousiasme de la part des auditeurs, tout particulièrement chez les femmes. La capacité que présente la radio à s'adapter au travail sur le terrain réalisé par les prestataires de services locaux, et à le renforcer, est indéniable.
ALT/PR tire parti de la récente libéralisation des ondes radio à Madagascar et contribue au développement de la capacité d'un nombre important de petites stations radio FM dans le Sud. Le projet a également pour effet de renforcer les aptitudes organisationnelles et de communication entre un grand nombre de prestataires de services gouvernementaux et non gouvernementaux.
Notre étude s'intéresse également aux défis qu'a relevés le projet ALT/PR et, dans certains cas, auxquels il reste confronté. Il s'agit de défis de gestion et de mise en réseau dans une région qui est particulièrement pauvre et désavantagée. Le projet a toujours du mal à veiller à ce que ses émissions radio restent en permanence de nature véritablement participative. La forte demande de ses services se fait à un coût : celui de risquer de surmener le personnel, tout particulièrement au niveau des cadres de direction. Le projet ALT/PR a prouvé sa rentabilité et jouit d'une bonne réputation sur le plan local, toutefois les activités de collecte de fonds constituent toujours une préoccupation très prenante.
Le projet ALT/PR s'attaque d'ores et déjà au défi majeur sur le long terme, qui consiste à soutenir le mécanisme de réseau qu'il a mis en œuvre et nous mettons en évidence des signes de durabilité qui sont encourageants.
Notre discussion en conclusion dresse la comparaison entre le projet ALT/PR et d'autres projets radio éducatifs dans des pays en voie de développement et elle prend du recul sur les objectifs réalisables par la radio et ceux qui ne le sont pas. Certaines réflexions sur l'élargissement de ce projet sont suivies de recommandations à l'attention de DFID.
2
Table des matières Cartes
Remerciements
Acronymes
Introduction.............................................................................................….... 10 Contexte...............................................................................................………..11
Les grands objectifs MDG
Méthodologie de l'étude.................................................................…………..17 Matrice de notre cadre conceptuel
Matrice des composants de la recherche
Impact.......................................................................................................…... 22 Impact environnemental des émissions radio.............................…………. 22
Contexte des questions environnementales Émissions radio produites sur des themes environnementaux Constatations quant à l'impact environnemental de la radio
Impact de la radio sur la fréquentation de cours 'alphabétisation......…...25 Contexte sur l'alphabétisation au sud de Madagascar
Émissions radio produites sur la question de l'alphabétisation Constatations
quant à l'impact de la radio sur la fréquentation de cours d'alphabétisation
Impact des émissions radio sur la santé.................................……………...28 Contexte sur les questions de santé
Émissions radio produites sur les questions sanitaires
Constatations quant à l'impact de la radio sur la santé
Autres résultats de santé Résultats de l'étude à l'hôpital d'Ejeda
Moyens de subsistance.................................................................................. 37 Contexte sur les moyens de subsistance : l'agriculture et autres activités
rémunératrices
Émissions radio produites sur des thèmes de moyens de subsistance
Constatations quant à l'impact de la radio sur les moyens de subsistance
3
Impact de la radio sur les inégalités entre les sexes.................................. .41 Contexte sur les questions liées aux spécificités de chaque sexe
Impact des émissions radio sur les inégalités entre les sexes
Impact des groupes d'écoute sur les relations entre les sexes
Impact de la radio sur les affaires sociales et administratives........…….... 43
Contexte sur les affaires sociales et administratives
Constatations
Impacts à plus large échelle en matière de développement du réseau radio PR…………………………………………………………………………………...... 45
Analyse institutionnelle.................................................................................. 48 Contenu radio local et pertinent groupes d'écoute
Avantages du partenariat basé sur un axe triple
(Partenaires PCID, radios locales, groupes d'écoute)
Rentabilité
Défi d'expansion
Défis du contexte
Défi de participation
Défis de la mise en réseau
Défi de durabilité Forces, faiblesses, opportunités et contraintes d'ALT/PR
Discussions et recommandations........................................….....................60 Où se situe ALT/PR par rapport à d'autres projets radio ?
La radio : les objectifs réalisables et ceux qui ne le sont pas
Comment déployer le modèle PR ?
Bibliographie.................................................................................................. 63 Annexe 1 : Méthodologies des études composantes
Annexe 2 : MDG - Objectifs Millénaire pour le Développement
Annexe 3 : Émissions diffusées
Annexe 4 : Partenaires PCID
Annexe 5 : Cartographie du projet ALT/PR
4
Carte 1 : Sud de Madagascar (province de Tuléar), indiquant les principaux centres et les principales régions où travaillent les partenaires du projet ALT/PR
5
Carte 2 : Province de Tulear (Sud de Madagascar), indiquant l’emplacement des stations radio des partenaires
6
Carte 3 : Couverture radiophonique des stations radio avant 1998 dans le Sud de Madagascar
Carte 4 : Couverture radiophonique des stations radio en 2004 dans le sud de Madagascar, montrant une augmentation de la couverture radiophonique
7
(N.B. nous retenons le terme « Androy » pour les régions d'Antandroy et le terme « Anosy » pour les régions d'Antanosy.)
Carte 5 : Sud de Madagascar illustrant les différentes régions ethniques
Remerciements Nous souhaiterions remercier tout le personnel d'ALT basé à Madagascar et au Royaume-Uni ainsi que tous les enquêteurs qui nous ont aidé à effectuer cet exercice d'évaluation. En voici les noms :
Alpha, Andriamanantena Rakotoarivelo, Auguste Fanomezana, Blandine Nome, Charlotte Razafindramaka, Claudia Rakotovoavy, Constance, Daniel Andriamanjaka, Emilie Rasoamampitohy, Felix Tsiebony, Gerry de Lisle, Guillaume Sop, Hanitra Raharimanana, Harri Rabearivony, Jaisel Vadgama, Jean Alidor Tanteliniaina, Jean Florent Mahretse, Jeanette Tsivandrona, Joanna Lamoure, Josée Victoria Rafidiniaina, Joseph Ralindrasana, Konezy, Lezin Josephson Solofoniaina, Lightfoot Tsiambany, Lovasoa Randrianambinina, Marcellin Manovosoa, Martin Soja, Matthew Buck, Max Kurtz Cadji, Mahandry, Nadya, Ndrema Andriamanatene Rakotoarivelo, Ndriaka Loubien, Olga Harisoa, Omega Rasoanirina, Roland Remeha, Rosalba Leonelli, Ryan Kelley, Sambeterake Tohasoa, Simon Davison, Steve Lellelid, Sosthene Robson, Suzanna Johansson, Tsatsake Vincent, Willy Rafano.
Et plus particulièrement, nous souhaiterions remercier Yvonne Orengo, Conseillère technique auprès d'ALT/PR, pour toute son inspiration et pour l'aide qu'elle a apportée tout au long du travail. Nous sommes également reconnaissants du soutien reçu par Gordon Adam, Julia Russell et de tous les employés de Media Support Solutions Limited. Nos remerciements vont également au principal bailleur de fonds d'ALT, à savoir la Commission Européenne. Toutes les illustrations sont avec la permission d'ALT. Pour finir, nous souhaiterions remercier les membres de l'équipe ICD du DFID à Londres, qui ont cru au projet et nous ont donné les moyens de réaliser cette étude passionnante et précieuse.
Leo Metcalf, Nicola Harford et Mary Myers, janvier 2007
8
Acronymes
ADB Banque Africaine de Développement
SIDA Syndrome d'Immunodéficience Acquise
ALT Andrew Lees Trust
AC Association Communautaire
CD Disque Compact
CEL Centre Écologique Libanona
CNLS Comité National pour la Lutte Contre le SIDA
DFID Department for International Development (UK) (Ministère britannique du
développement international)
ENDS Service de Données Environnementales
CE Commission Européenne
FGD Discussion de Focus Groupe
OG Organisation Gouvernementale
VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine
ICD Information et Communication pour le Développement
TIC Technologies de l'Information et des Communications
GE Groupe d'Ecoute
MDG Objectifs Millénaire pour le Développement
S+E Suivi et Évaluation
ONG Organisation Non Gouvernementale
PCID Partenaires en Communication et Information pour le Développement
PVVIH Personnes Vivant avec le VIH/SIDA
CPP Cycle de Production Participatif
PR Projet Radio
PRSP Stratégie de réduction de la pauvreté
PSDR Programme de Soutien du Développement Rural
SAP Système d'Alerte Précoce
IST Infection Sexuellement Transmissible
SWOC Analyse des forces, faiblesses, opportunités et contraintes
TMM Toko Mitsitsy Mahafaly (Projet des fourneaux améliorés)
TOR Termes de référence
PAM Programme alimentaire mondial
9
Introduction ALT/PR a confié la présente étude sur le projet radio Andrew Lees Trust a Media Support Solutions Limited avec le financement du DFID en vue de renforcer la justification d'investissements dans les technologies ICD (Informations et communication pour le développement). L'objectif recherché était également de mettre à l'épreuve de manière indépendante des méthodes de suivi et d'évaluation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication comme outil de développement.
Ce rapport est en majeure partie la synthèse de onze rapports d'étude conçus pour se joindre et se compléter les uns les autres. Ceux-ci ont été réalisés par des personnes différentes à des moments différents, entre août 2005 et décembre 2006, chacun ayant sa propre méthodologie. La matrice figurant aux pages 9 à 11 présente un résumé de chaque étude et des méthodologies employées.
L'étude globale a été conçue par Nicola Harford, en consultation avec Leo Metcalf. Metcalf a dirigé et rédigé la plupart des rapports d'étude individuels en faisant appel à diverses équipes d'enquêteurs sur place, dont certains étaient des employés du projet ALT/PR et d'autres avaient été recrutés séparément1. L'étude à l'hôpital d'Ejeda a été réalisée par Suzanna Johansson et l'étude du groupe d'écoute a été effectuée par Jaisel Vadgama, tous deux des consultants indépendants. Steve Lellelid, responsable des études sur l'enquête d'alphabétisation et des stations radio, est associé à ALT/PR en étant responsable d'une autre ONG dans le sud de Madagascar. Parmi les autres contributions à cet exercice d'évaluation, il reste à citer un manuel de méthode d'évaluation de l'impact sur la radio (Metcalf, à venir) et une analyse institutionnelle réalisée par Yvonne Orengo, l'ancienne directrice de projet d'ALT/PR et son actuelle conseillère technique, (Orengo, 2007). Le présent rapport a été compilé par Mary Myers à partir de tous les rapports susvisés, ainsi que d'après le rapport de Harford concernant sa première visite de briefing à ALT/PR en avril (Harford, 2005)2.
Par ailleurs, le présent rapport s'appuie également sur d'autres exercices et rapports de suivi et d'évaluation effectués tout au long de la vie du projet, des cartes et d'autres données techniques provenant de partenaires du projet, et sur des documents secondaires, tels que la récente enquête sur les foyers effectuée par le Programme alimentaire mondial (PAM, 2006).
Le désir de réaliser cette évaluation est venu en premier lieu d'ALT/PR lui-même qui, après sept années d'existence, souhaitait faire le bilan de l'impact de ses travaux jusqu'à ce jour, tant pour lui-même qu'à destination de ses donateurs, partenaires et collaborateurs présents et futurs. Grâce au financement accordé par le DFID pour effectuer cette évaluation, des systèmes de suivi ont été mis en œuvre au sein d'ALT et le personnel local a reçu une formation au suivi et à l'évaluation. Un grand nombre des enquêteurs supplémentaires qui ont été contractés à titre provisoire pour réaliser cet exercice ont, par la suite, été embauchés pour travailler pour d'autres organisations en raison des connaissances qu'ils avaient acquises en matières de groupes d'écoute, de réunions de groupe et d'écoute de groupe.
Le deuxième élan dont a fait l'objet cette évaluation est venu du DFID, qui a suggéré que l'étude devrait se porter sur le lien qui existe entre les communications radio et la réduction de la pauvreté, ce qui nous a incité à utiliser comme cadre une partie des grands objectifs MDG.
Notes en pied de page 1 Voir les Remerciements pour en obtenir la liste complète.
2 Tous les rapports contributifs sont disponibles séparément et dans leur intégralité auprès de Andrew Lees Trust,
certains se trouvant sur le site web et certains sur demande (voir www.andrewleestrust.org). Dans la plupart des cas, des questionnaires et d'autres instruments utilisés y sont annexés. Voir la Bibliographie pour obtenir la référence complète à l'ensemble des rapports.
10
Contexte
Depuis 1999, Andrew Lees Trust (ALT)1 met en œuvre un projet radio éducatif intitulé « Système d'alerte précoce utilisant des diffusions radiophoniques pour le sud de Madagascar », baptisé Projet Radio (PR) et financé par la Commission européenne. Ce projet a pour but de donner les moyens aux populations isolées d'améliorer leurs sécurité alimentaire et de réduire les effets de la pauvreté par l'éducation assurée par la radio. PR y arrive grace a la participation de stations radio locales, de groupes d'écoute villageois et d'ONG (organisations non gouvernementales) partenaires.
Projet Radio est implanté à Fort Dauphin (voir Carte 1) et opère dans l'ensemble des provinces du Sud de Tuléar
2 et, plus récemment, à Fianarantsoa, couvrant une région
habitée par plus de deux millions de personnes. PR collabore avec des partenaires locaux et assure la formation de leurs agents malgaches actifs sur le terrain (des écologistes, agronomes, travailleurs sociaux) pour élaborer des émissions radio éducatives qui apportent aux villageois des informations sur tous les aspects du développement. Le projet produit en moyenne 14 émissions par mois dans la province de Tuléar ; jusqu'à ce jour, 1 540 émissions ont été diffusées sur des stations radio FM locales. Parmi les sujets abordés, on retiendra les suivants : • Protection du bétail contre les maladies • Réduction des risques d'infection du VIH • Entreposage des aliments et amélioration des récoltes • Protection des régions sylvicoles • Amélioration de la santé La structure du projet ALT/PR s'articule autour de la participation et de l'échange de trois groupes de parties prenantes, qui sont également les bénéficiaires du projet : tout d'abord les groupes d'écoute villageois, ensuite les stations FM locales, et enfin les partenaires ONG/OG, organisés dans un réseau appelé partenaires PCID. (Voir ci-dessous).
Radios Projet Radio
Matériaux et formations
Groupes d’écoutevillageois
Stations radio FM
Partenaires PCID
* Partenaires en Communication et Information pour le Développement (PCID) Réseau rural de communications
(voir Annexe 4 pour obtenir la liste complète des partenaires PCID).
Le rôle de PR est de former, fournir du matériel, coordonner les mécanismes d'échange et faciliter un réseau régional de communications entre ces trois groupes de parties prenantes. Sur les 49 partenaires PCID, 18 sont sous la direction d'organisations gouvernementales ou d'autorités locales, 18 sont des organisations internationales ayant des bureaux locaux ou sont des projets financés par des institutions ou des programmes internationaux et 13 sont des associations locales ou des ONG malgaches. (Voir l'Annexe 4 pour obtenir la liste complète des partenaires ALT/PR). Toutes les stations radio affiliées sont des stations FM implantées sur le plan local, dans la communauté ou de nature commerciale.
Les émissions radiophonique sont réalisées dans des dialectes locaux, selon des formats qui sont attrayants et pertinents. La procédure de production est participative : baptisée CPP
11
(Cycle de production participatif), elle s'attache à s'approcher le plus possible aux besoins des auditeurs sans pour autant que les villageois ne réalisent eux-mêmes les émissions. Le CPP est detaille ci dessous et un exemple réel d'émission concernant le SIDA, est présenté à la page 13.
Details du cycle de production participatif
1. Évaluation des besoins Quatre groupes de discussion qui se sont tenus dans l’Androy en février 2004
2. Identification des thèmes
Trois thèmes identifiés :
- Comment le virus VIH attaque le corps
- La transmission
- La prévention
3. Rédaction de scripts
Simple analogie à des pratiques agricoles locales, pour illustrer comment le virus du VIH attaque le corps humain.
Un dialogue entre deux femmes d’Antandroy qui parlent le même dialecte : une femme explique comment les insectes (en l’occurrence, le virus du VIH) peut ravager le cactus (les anticorps), endommageant ainsi le champ (le corps) que le cactus protège ; en conséquence, des infections opportunistes (des animaux familiers à la région) y pénètrent et détruisent le corps.
4. Répétitions et enregistrement Réaliser l’émission avec des communautés villageoises locales
5. Montage
Le coordinateur technique d’ALT a monté l’émission et y a ajouté le jingle de PR et une annonce incitant les auditeurs à se rendre au bureau d’ALT s’ils ont des questions sur le contenu de l’émission
6. Prétest de l’émission
Prétest auprès de 2 groupes d’écoute dans l’Androy. Les membres du groupe doivent pouvoir identifier les messages clés ainsi que mentionner le format de dialecte et de communication qui est le plus rapproché de leurs vies.
7. Ajustements/corrections
Après le feed-back des villageois obtenu lors des prétest. Pour cette émission, aucun ajustement n’a été nécessaire.
8. Montage définitif et contrôles techniques
Le coordinateur technique d’ALT PR a vérifié le montage définitif. L’émission a été évaluée par un évaluateur indépendant avant la diffusion.
9. Diffusion
L’émission a été diffusée en avril 2004 sur tout le réseau radiophonique PCID d’ALT/PR.
10. Surveillance et évaluation des impacts
Les impacts auprès des groupes ont fait l’objet d’une étude en 2005. Parmi le feedback reçu des villageois locaux a été le suivant : « L’émission a beaucoup aidé, surtout lorsque la femme a pris un exemple de nos vies de tous les jours et a utilisé le cactus, le champ et les autres ennemis de notre culture, chose que nous avons vivement appréciée. »
12
ALT a vu le jour en 1995 sous la forme d'un fonds commémoratif, soutenant un centre de formation local, puis a entamé son travail sur le terrain en 1999 avec seulement neuf employés à temps plein à Madagascar et une assistante à temps partiel au Royaume-Uni. À peine sept ans plus tard, ALT compte 60 employés répartis entre sept bureaux (six à Madagascar) et deux principaux projets au sud de l'île. ALT/PR a été mis en place et géré par Yvonne Orengo (ressortissante britannique) de 1999 à 2005 ; depuis, la gestion du projet est assurée par un responsable malgache, Daniel Andriamajaka, Y. Orengo remplissant le rôle de conseillère technique. (Voir l'Annexe 5 pour obtenir la liste des bureaux, des studios et du personnel de Radio Projet).
Depuis sa création, les réalisations du projet sont les suivantes :
• Diffusion de 1 540 émissions • Distribution de 2 514 postes de radio à des groupes d'écoute de villageois • Création de deux bibliothèques du programme régional (provinces de Tuléar et
de Fianarantsoa) • Lancement de six studios de production • 75 formations externes de plus de 857 partenaires et agents sur le terrain • Association de 49 ONG et prestataires de services sur le plan local, réunis sous
PCID • Fourniture de 52 appareils d'enregistrement professionnels destinés à la
production d'émissions • Affiliation de 23 stations radio FM • Lancement de deux nouvelles stations radio locales. • Mise à jour du signal d'émission de trois stations radio locales et amélioration de
la capacité technique et de l'équipement de 17 stations FM rurales. Le financement est assuré en majeure partie par la Commission européenne, mais compte également la participation de la Banque Mondiale, par le biais du CNLS du gouvernement de Madagascar, de l'Unicef, de l'Ambassade britannique et d'autres encore. Le financement de la présente évaluation est assuré par le DFID.
Les grands objectifs MDG
L'extrême pauvreté et la faim (Objectif MDG 1) Madagascar fait partie des pays les moins avancés, comptant une population d'environ 18 millions d'habitants (2005). Le pays arrive en 143e position des 177 pays à l'indice du développement humain des Nations Unies3. 85 % de la population malgache subsiste avec moins de 2 US$ par jour et la situation est particulièrement aigue dans le Sud, des sécheresses régulières et une insécurité alimentaire chronique.
Dans le Sud, 25 % des foyers sont jugés en situation d'insécurité alimentaire (EC SAP 2002). En 2006, 80 % des foyers avaient reçu de la nourriture à crédit au cours des six mois précédant l'enquête du PAM. Un-quart des foyers puisent leur eau potable d'une source améliorée, alors que 40 % d'entre eux doivent s'en remettre aux rivières ou aux ruisseaux pour leurs besoins en eau, quelle que soit la saison. Seulement 4 % des foyers utilisent des toilettes à chasse d'eau ou des latrines à fosse améliorées à des fins d'assainissement. En termes de possessions, seulement 50 % des foyers possèdent un lit et 12 % seulement ont au moins une chaise ; seulement 14 % possèdent des vélos, alors que les motos et les voitures restent extrêmement rares (PAM, 2006).
Manque d'éducation primaire (Objectif MDG 2) D'après le PAM (2006), seulement 26 % des foyers de la région d'implantation d'ALT ont un enfant en âge d'école primaire inscrit à l'école, 5 % d'entre eux ont un enfant à l'école secondaire. Sur les enfants d'école primaire inscrits à l'école, 33 % avaient été absents de l'école une semaine ou plus lors du dernier mois de l'année scolaire précédente. Les raisons de cet absentéisme s'expliquent par les maladies ou le travail à la ferme.
14
Santé de la mère et de l'enfant (Objectifs MDG 4 et 5) À Madagascar, près de 160 enfants meurent tous les jours du paludisme, de diarrhée ou de problèmes respiratoires causés par des infections. La moitié des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition4. Les niveaux de malnutrition maternelle sont parmi les plus élevés de l'Afrique subsaharienne, avec près de 19 % des femmes sont considérées souffrir d'insuffisance alimentaire (PAM, 2006). À Madagascar, 45 % des enfants sont en retard de croissance à l'âge de 24 mois (PAM, 2006), les régions rurales étant les plus touchées. Dans le Sud, les services de santé sont particulièrement mauvais, avec seulement 49 % des femmes pouvant accéder et utiliser des soins anténataux qualifiés (PAM, 2006).
VIH/sida (Objectif MDG 6) La prévalence du VIH au sein de la population générale a été faible par rapport à d'autres pays d'Afrique. Malheureusement, depuis 1996, cette prévalence ne cesse d'augmenter : de 0,01 % en 1996 pour passer à 0,15 % en 1999 puis à 0,3% à la fin de 2001, elle s'est multipliée selon un facteur de 355.
La toute dernière étude réalisée au Madagascar entre mai et juillet 2003 révèle que le taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes s'élève à 1,1 %6. Cela indique également que l'épidémie est désormais entrée dans sa phase généralisée et risque ainsi de se répandre à la population dans son ensemble.
D'après le PAM, le Programme alimentaire mondial :
Madagascar est mûr pour subir une hausse rapide des infections VIH (PAM, 2006).
Dégradation environnementale (Objectif MDG 7) Madagascar est prédisposé aux catastrophes naturelles, tout particulièrement aux cyclones et aux sécheresses. Au cours des 35 dernières années, au moins 46 catastrophes naturelles ont, à elles toutes, touché plus de 11 millions de personnes.
Madagascar abrite 5 % des espèces animales et végétales du monde, dont 80 % d'entre elles sont uniques à Madagascar ; on retiendra ainsi les lémuriens, trois familles d'oiseaux endémiques et des baobabs (PAM, 2006). La destruction des forêts présente la plus grosse menace posée à la faune et à la flore. Des estimations récentes laissent entendre que entre 1 % et 2 % des forêts restantes de Madagascar sont détruits tous les ans pour servir de combustible, de bois de construction et pour défricher des parcelles agricoles et de pâturage7.
Les pressions que subit l'environnement ont provoqué la disparition de pratiquement l'intégralité de la forêt locale d'épineux. Des témoignages vieux de 40 ans attestent de ces changements rapides :
… conduire le long de la route de Tsihombe à Faux Cap était semblable à traverser un tunnel, tellement la forêt d'épineux était haute et dense de part et d'autre. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus aucun arbre debout. Les gens doivent s'éloigner de plus en plus de leurs maisons pour trouver du bois de construction.8
Mauvaise disponibilité de l'information (Objectif MDG 8 : Cible 18)
Les caractéristiques les plus frappantes de la pauvreté à Madagascar, telles qu'elles sont ressenties par les pauvres, sont l'isolement et l'impuissance. Les pauvres manquent totalement de moyens de communication, si ce n'est avec leur propre communauté immédiate (Banque Mondiale, 1996)
Madagascar a souffert 30 ans de contrôle médiatique hautement restrictif et la libéralisation de ses politiques de diffusion n'est que très récente. En 1998, ALT/PR découvrit qu'il
15
n'existait qu'une seule station radio FM en fonctionnement dans la région de l'Androy : Radio Jet A, et la faiblesse de son signal d'émission signifiait que des milliers de personnes n'avaient pas accès aux émissions diffusées. Radio Nationale Malagasy (RNM) ne couvrait pas toutes les régions du Sud, ce qui est toujours le cas. Beaucoup de villageois du Sud ne comprennent pas aisément, ou n'aiment pas écouter, la langue officielle du Haut Plateau du Nord qu'elle utilise pour ses diffusions, bien qu'ils soient reconnaissants de recevoir les avertissements de cyclones et les actualités nationales. Il existe une division historique entre la population Merina « éduquée » du Nord et les groupes ethniques côtiers du Sud. Les habitants ruraux du Sud perçoivent parfois la radio nationale comme étant un appareil gouvernemental. Dans l'évaluation intitulée WB Poverty Assessment effectuée en 1996, 88 % des personnes interviewées dans le Sud ont déclaré ne pas faire confiance à l'État et n'étaient pas disposées à collaborer à des émissions sous son contrôle.
Désormais, le Ministère des Communications a octroyé une licence à 244 stations radio sur le plan national et les médias malgaches sont libres et pluralistes. La couverture radio s'est améliorée dans le Sud, grâce surtout au soutien reçu par ALT/PR (voir Cartes 3 et 4). Toutefois, la pauvreté et l'illettrisme limitent de beaucoup l'accès à l'information.
D'après une enquête récente réalisée par le PAM (2006), seulement 23 % des foyers du Sud profond (des districts d'Ambovombe-Androy, Ampanihy, Bekily, Beloha, Nosy-Boraha) possèdent un poste de radio et 1 % d'entre eux ont une télévision. Seulement 34 % des chefs de famille sont alphabétisés (le plus faible de tous les groupes échantillonnés aux quatre coins du pays), avec 78 % des chefs de famille et 82 % des épouses entièrement dépourvus de quelque éducation que ce soit.
Notes en pied de page 1 Voir Andrew Lees Trust : www.andrewleestrust.org 2 À noter que ‘Tuléar’ et ‘Toliara’ sont des appellations utilisées de manière interchangeable pour désigner la même province 3 Rapport sur le développement humain du PNUD de 2006 http ://hdr.undp.org/hdr2006/report.cfm 4 Voir Unicef : www.unicef.org/infobycountry/madagascar_24356.html 5 Rapport sur l'épidémie mondiale de VIH/sida, Fiches techniques épidémiologiques pour Madagascar, 2002. 6 Ministère de la Santé malgache 2003 7 C. Kremen Traditions That Threaten www.pbs.org/edens/Madagascar/paradise.htm 8 Entretiens personnels avec Steve Lellelid, avril 2006
16
Méthodologie de l'étude La présente section est un récapitulatif de la manière dont a été conçue la recherche globale et des méthodes utilisées dans chaque étude composante. (Voir l'Annexe 1 pour obtenir le texte complet des Méthodologies des études composantes) La matrice présentée aux pages 9 à 11 indique comment se reflètent les grands objectifs MDG dans les 11 éléments séparés de l'étude, dans notre choix de personnes interrogées et dans l'éventail des sujets abordés dans l'évaluation. Elle récapitule également les grandes techniques méthodologiques utilisées et les résultats qui en découlent.
Notre cadre conceptuel
Le fil conducteur de cette évaluation s'est axé sur la question globale suivante : que pensent, croient, ressentent et disent les auditeurs radiophoniques du sud de Madagascar sur les questions des objectifs MDG en matière d'environnement, de santé, d'éducation, de sexe et de pauvreté soulevées dans les émissions radio produites par le projet ALT/PR ?
À cet égard, nous nous sommes penchés principalement sur les « cibles visées ». Par cibles visées, nous entendons les facteurs qui influent sur la manière dont agissent les gens pour changer des pratiques existantes (qu'elles soient liées à leur santé ou à leur subsistance) et la facon dont ils sont mobilisés a changer de comportement, dans le cas du projet ALT/PR, par le biais des émissions radio informatives et éducationnelles. Cela s'appuie sur la supposition qu'aucun projet de communication ne peut en fait convaincre les gens à faire des choses ; il ne peut que leur fournir les moyens de le faire/realiser. De même, bien qu'il ne puisse influencer tous les facteurs qui aident les gens à changer de comportement (il peut en influencer certain) , comme par exemple en termes de prix/disponibilité des biens et services, de politique, de climat et de maints autres facteurs qui y contribuent.
Les cibles visées se distinguent des accomplissements comportementaux et sociaux, qui constituent l'objectif ultime (voir le diagramme ci-dessous). L’objectif ultime s'agit de ce que font les gens après avoir atteint les cibles visées. Par exemple, si l'accomplissement comportemental/social ultime serait pour tous les hommes sexuellement actifs d'avoir pour habitude d'utiliser des préservatifs afin d'endiguer l'épidémie de VIH/sida, la cible visée serait que les hommes aient une meilleure perception de l'utilité des préservatifs.
Cadre conceptuel pour l'évaluation du projet
17
Résultats de communication
Cibles visées Résultats en terme de changement
comportemental/social
Fournir des informations
Dissiper des mythes Lier aux services Montrer les avantages Encourager la discussion Encourager le soutien Modeler des compétences
Accroître :
• Connaissances • Bénéfices perçus • Efficacité personnelle • Discussions • Intentions • Soutien social • Accessibilité
Adopter des pratiques
Adopter les services Changer le comportement Action collective
En résumé, notre principal objectif était de déterminer si le fait d'écouter la radio avait permis d'atteindre des cibles clés du projet ALT/PR.
Tout un éventail de méthodes a été utilisé pour pouvoir dresser un tableau complet de la manière dont le projet ALT/PR a atteint les cibles visées. Nos différentes études ont donc fait appel tant à des méthodes qualitatives qu'à des méthodes quantitatives, s'appuyant aussi bien sur des enquêtes de relativement grande échelle (par ex. : l'enquête de Vadgama de 2006 auprès de 100 groupes d'écoute) que sur des aperçus ponctuels (par ex. : l'enquête de Metcalf dans un seul village sur le nombre de postes de radio achetés) (Metcalf, 2006). Nous nous sommes concentrés sur de nombreux sujets différents et sur toute une palette d'implantations du projet, couvrant l'ensemble des grandes régions du sud de la province de Tuléar, aussi bien urbaines que rurales. Nous avons également effectué des comparaisons expérimentales entre les villages affichant des degrés d'écoute très faibles (mal desservis par la couverture radiophonique) et des villages ayant un bon accès radiophonique. Une véritable mosaïque de résultats en a découlé, que le présent rapport s'attache à réunir.
Dans les rapports individuels, les auteurs de chaque étude mentionnent les difficultés rencontrées lors de la réalisation de l'étude. Le manuel sur le suivi et l'évaluation (Metcalf, à venir) souligne les leçons acquises et la manière de minimiser les inexactitudes. La plupart des études ont eu à relever des problèmes de toutes sortes : difficultés de traduction influant les réponses des villageois, insuffisance des données conservées par les travailleurs sanitaires locaux, adoption insignifiante de graines de sorgho en raison de la sécheresse et des parasites, pour ne citer qu'eux. En conséquence, des éléments de certaines études n'étaient tout simplement pas suffisamment rigoureux pour être inclus dans le présent rapport. Les enquêteurs ont été scrupuleux à n'inclure ici que des résultats capables de faire l'objet d'un examen rigoureux.
18
Matrice des composants de la recherche Étude d'évaluation Intitulé/Auteur Implantation
géographique Date Description Echantilon
1 Évaluation de la Phase II du Projet ‘Radio SIDA’ / Leo Metcalf
3 villes et villages avoisinants : Anosy, Ambovombe et Tsihombe
Août-Sept 2005
Etude d’évaluation de l'impact des émissions sur le SIDA produites par le projet ALT/PR, en termes de connaissances et croyances chez la population cible.
27 groupes de discussion dans des zones rurlaes et urbaines ; 269 sondes choisis au hasard, au sein et a l’exterieur de groupes d’ecoute.
2 Étude d'évaluation d'Ejeda / Suzanna Johansson
Hôpital d'Ejeda, Région de Mahafely
Oct-Déc 05
Etude d’évaluation de l’impact des émissions sanitaires diffusées à la radio de l'hôpital d'Ejeda : Radio Feon ny Linta, en partenariat avec l'Unicef
250 personnes de la région d'Ejeda, la moitié issue de groupes d'écoute et la moitié composée d'individus choisis au hasard en-dehors de groupes d'écoute.
3 Statut des stations radio associées du Sud du Madagascar / Steve Lellelid
Toute la province de Tuléar Déc 2005 Audit des stations radio partenaires du Projet Radio, pour en évaluer la capacité/le statut technique ainsi que l'impact et l'influence du partenariat avec PR.
15 stations radio partenaires.
4 Partenariat d'ALT avec l'hôpital de SALFA à Ejeda : Étude approfondie sur les accomplissements comportementaux/ Leo Metcalf
Ejeda, Région de Mahefaly Avril -Juin 2006
Étude examinant l'adoption des services hospitaliers attribuable à la création de la station radio de l'hôpital : Radio Feon ny Linta. En supplément, petite étude sur les propriétaires de postes de radio dans le village d'Anamanta.
70 entrevues de départ avec des femmes ; 19 propriétaires de postes de radio dans le village d'Anamanta.
5 Plantation d'arbres et semence de sorgho/ Leo Metcalf
Région de l'Androy : Tsihombe
Mai 2006 Étude de petite échelle de l'influence de la radio sur l'adoption par les fermiers locaux de jeunes plants d'arbres et de graines de sorgho.
88 individus interviewés au sujet des arbres et 16 fermiers interrogés au sujet du sorgho.
6 Étude sur le travail de communication d'ALT pour le PSDR : Impacts sur la création de revenus /Leo Metcalf
Région d'Atsimo-Andrefana Mar-Août 2006
Cette étude se penche sur l'impact des activités de communication entreprises par le projet ALT/PR avec le Programme de Soutien du Développement Rural (PSDR) financé par la Banque Mondiale. Des associations de communauté pouvaient s'adresser au PSDR pour entreprendre des activités rémunératrices.
3 groupes d'écoute et 3 associations ; interviews avec 6 informateurs clés
7 Enquête de groupes d'écoute établis par le projet ALT/PR à Madagascar/ Jaisel Vadgama
4 regroupements régionaux :Toliara, Tsihombe, Ambovombe et Anosy
Mai-juin 2006
Enquête de groupes d'écoute pour évaluer la réussite de leur mode de fonctionnement.
100 groupes d'écoute dans un éventail d'implantations de l'ensemble du sud de Madagascar.
8 Rapport d'étude d'évaluation d'alphabétisation /Steve Lellelid
Région de l'Androy Juin 2006 Évaluation de l'adoption et de l'impact d'un programme d'alphabétisation dirigé par une ONG locale : « Tahantanee », s'intéressant spécifiquement à l'effet de la radio sur la fréquentation de cours d'alphabétisation.
273 etudiants choisis au hasard parmi un éventail de cours d'alphabétisation (165 sites).
9 Étude sur l'impact de Projet Radio sur la réduction de la pauvreté dans la région de l'Androy / Leo Metcalf
Région de l'Androy Avr-Août 2006
Examen de l'impact de l'écoute de la radio dans la région de l'Androy sur des sujets comme la santé, l'hygiène, l'agriculture, la protection de l'environnement, les fourneaux améliorés, l'élevage de bétail et le développement rural.
268 interrogés choisis au hasard dans 11 communautés rurales, plus 8 groupes d'écoute ruraux comprenant 96 individus.
10 Enquête sur les Partenaires en Communication et Information pour le Développement (PCID) /Nicola Harford
Province de Tuléar Août-Déc2006
Enquête sur l'impact et l'influence de Projet Radio sur les organisations membres du réseau PCID créé par le projet
28 agences gouvernementales, non gouvernementales et donatrices (82 % de l'ensemble des membres PCID de la province de Tuléar).
19
11 Évaluation sur les fourneaux améliorés Leo Metcalf
Région de l'Androy, Région d'Atsimo-Andrefana
Mai-juin 2006
Examen de l'impact et du soutien de la radio à 2 projets d'économies de combustibles sous la direction d'ALT
4 discussions en groupe, 7 interviews avec des témoins privilégiés, examen du document.
Étude d'évaluation
Intitulé/Auteur Principales constatations Impacts concernant les objectifs MDG
soulevés par l'étude Thèmes envisagés par l'étude DFID
1
Évaluation de la Phase II du Projet ‘Radio SIDA’ / Leo Metcalf
Connaissances sur le VIH/sida clairement attribuables à des émissions radio : 89 % des personnes interrogées ont indiqué que la radio était leur source d'information sur le sida. 68 % d'entre elles savaient que ces émissions étaient produites par le projet ALT/PR.
Objectif MDG 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies contagieuses
Réduction de la pauvreté (par l'amélioration de la santé) Méthodologies de suivi et d'évaluation
2
Étude d'évaluation d'Ejeda / Suzanna Johansson
- La radio est la principale source d'information sur le VIH/sida. - Les connaissances sur la santé de la mère et de l'enfant étaient plus élevées chez les groupes d'écoute. - L'organisation et la motivation à la station radio RFL reste un problème.
Objectif MDG 4. Améliorer la santé des enfants Objectif MDG 5. Améliorer la santé maternelle Objectif MDG 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies contagieuses
Réduction de la pauvreté (par l'amélioration de la santé) Élargissement du modèle PR. Méthodologies de suivi et d'évaluation
3
Statut des stations radio associées du Sud du Madagascar / Steve Lellelid
Parmi les avantages du partenariat noué avec PR, il faut retenir la fourniture d'équipement, la formation technique et de production, des CD mensuels des émissions du PCID ; le feedback reçu indique clairement qu'elles sont très appréciées du grand public. Des problèmes techniques subsistent. Les stations obtiennent leur formation d'autres organisations mais peu mentionnent leurs liens avec des membres PCID.
Objectif MDG 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement (par la mise à disposition de technologies d'information et de communication)
Élargissement du modèle PR
4
Partenariat d'ALT avec l'hôpital de SALFA à Ejeda : Étude approfondie sur les accomplissements comportementaux/ Leo Metcalf
Le chiffre global de la fréquentation hospitalière est en baisse, en raison de la cherté des coûts hospitaliers et de la sécheresse qui ne fait qu'exacerber la pauvreté. Toutefois, les services gratuits annoncés à la radio ont suscité une adoption sensiblement accrue.�L'achat de postes de radio a nettement augmenté après la mise en service de la station locale.
Objectif MDG 4. Améliorer la santé des enfants Objectif MDG 5. Améliorer la santé maternelle Objectif MDG 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies contagieuses
Réduction de la pauvreté (par l'amélioration de la santé) Méthodologies de suivi et d'évaluation
5
Plantation d'arbres et semence de sorgho /Leo Metcalf
La radio a fortement incité les populations à planter des arbres et adopter le programme de prêt de semences de sorgho : - Les actions publicitaires radiophoniques sont responsables de 59 % de l'ensemble des arbres distribués. - 56 % des participants ont mentionné la radio comme source directe d'information sur le programme de graines de sorgho, mais l'adoption globale du sorgho reste faible en raison des parasites et du climat.
Objectif MDG 1 : Réduction de la pauvreté Objectif MDG 7. Environnement durable
Réduction de la pauvreté (par la diversification des cultures, la sécurité alimentaire, la protection environnementale). Impact économique (par des activités rémunératrices). Méthodologies de suivi et d'évaluation.
6
Étude sur le travail de communication d'ALT pour le PSDR : Impacts sur la création de revenus/ Leo Metcalf
Le travail du projet ALT/PR a renforcé la campagne de communication du PSDR. Les émissions radio ont abouti à une augmentation sensible du nombre de candidats à des prêts. Toutefois, l'absence de suivi de la part des agents du PSDR est responsable des résultats décevants du programme global de prêt, bien que l'élément radio n'y fût pas pour beaucoup.
Objectif MDG 1. Réduction de la pauvreté Objectif MDG 3. Égalité des sexes Objectif MDG 7. Durabilité environnementale
Réduction de la pauvreté (par la diversification des cultures, la sécurité alimentaire, la protection environnementale). Impact économique (par des activités rémunératrices). Méthodologies de suivi et d'évaluation.
20
Étude d'évaluation Intitulé/Auteur
Principales constatations Impacts concernant les objectifs MDG soulevés par l'étude
Thèmes envisagés par l'étude DFID
7 Enquête de groupes d'écoute établis par le projet ALT/PR à Madagascar/ Jaisel Vadgama
La majorité des groupes d'écoute fonctionnent comme prévu : - 82 % d'entre eux font part d'une écoute communale régulière. - 59 % font part de discussions qui se tiennent régulièrement.
Objectif MDG 2 : L'éducation pour tous Objectif MDG 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement (par la mise à disposition des technologies de l'information et de communication)
Élargissement du modèle PR Méthodologies de suivi et d'évaluation
8 Rapport d'étude d'évaluation d'alphabétisation/ Steve Lellelid
Plus de la moitié des étudiants attribuent à la radio l'inspiration d'étudier. Objectif MDG 2 : L'éducation pour tous Objectif MDG 3. Égalité entre les sexes
Réduction de la pauvreté (par l'accès à l'alphabétisation)
9 Étude sur l'impact de Projet Radio sur la réduction de la pauvreté dans la région de l'Androy / Leo Metcalf
La radio a changé les connaissances de ses auditeurs, notamment en matière de santé (par ex : planning familial, vaccination) et d'amélioration des techniques agricoles. Elle a exercé un impact particulièrement sensible auprès des femmes. La radio est une source importante et précieuse de conseils en matière de développement, d'actualités, d'informations, qui sont d'importance vitale pour la vie au quotidien.
Tous les objectifs MDG Réduction de la pauvreté (par l'information, le lien à des services, les changements de comportement et de pratiques). Méthodologies de suivi et d'évaluation
10 Enquête sur les Partenaires en Communication et Information pour le Développement (PCID)/ Nicola Harford
La radio élargit la portée des efforts des membres IEC des membres du PCID, ouvre les communautés à une influence externe et aboutit à des gains économiques, environnementaux, sanitaires et pédagogiques. 68 % des partenaires disposent désormais d'un responsable dédié aux communications. 64 % d'entre eux prévoient régulièrement un budget pour les activités de communication dans leurs offres de financement.
Objectif MDG 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement (par la mise à disposition de technologies d'information et de communication).
Élargissement du modèle PR
11 Évaluation sur les fourneaux améliorés/ Leo Metcalf
Dans les villages disposant d'un meilleur accès à la radio mais recevant les mêmes visites et la même formation sur le terrain, un plus grand nombre de femmes avaient adopté ces fourneaux. Des fourneaux ont été construits dans des villages sans aucune formation, s'appuyant entièrement sur les émissions radio.
Objectif MDG 1 : Réduction de la pauvreté Objectif MDG 3 : Égalité des sexes Objectif MDG 4. Amélioration de la santé chez les enfants Objectif MDG 7. Environnement durable
Réduction de la pauvreté (par une réduction de l'utilisation de bois à brûler, une meilleure santé, des gains d'efficacité par les femmes.
Thèmes d'étude/objectifs du DFID 1. Réduction de la pauvreté : les données d'impact concernent la réduction de la pauvreté ou les bases pour y parvenir. 2. Impact économique : les données d'impact concernent les activités rémunératrices et l'amélioration des moyens de subsistance, ou les bases pour y parvenir. 3. Élargissement du modèle PR à reproduire dans d'autres régions et au-delà : des leçons sont tirées des données, et des défis sont relevés pour reproduire et adapter le modèle PR 4. Méthodologies innovantes de suivi et d'évaluation : adaptation, combinaison et application de méthodes d'étude participative, qualitative et quantitative à un contexte de communication.
21
22
Impact
Impact environnemental des émissions radio L'étude a analysé l'effet et l’impact de l'écoute de la radio sur la participation des auditeurs dans des initiatives environnementales locales. Ces initiatives ont été lancées par ALT ou par d'autres ONG et prestataires de services dans le sud de Madagascar.
Plus spécifiquement, l'étude s'est intéressée aux effets de la radio sur :
• Les opinions concernant la conservation des forêts • L'adoption de foyers améliorés • La plantation d'arbres fruitiers et semis résistants à la sécheresse Contexte sur les questions environnementales
Comme on l'a vu dans notre section intitulée « Contexte » ci-dessus, à Madagascar, le défi environnemental est à la fois gigantesque et urgent. Le problème le plus immédiat dans le Sud est sans doute la déforestation et son action qui ne fait qu'empirer la sécheresse.
Plusieurs initiatives lancées par le gouvernement et les ONG s'attachent à protéger l'environnement naturel. Prenons par exemple les foyers améliorés, baptisés Toko-Mitsitsy (TM), qui sont produits à partir d'argile et de cendres et sont capables de réduire jusqu'à 75 % de la consommation de combustible. Dans le cadre de son projet séparé intitulé Projet Énergie financé par la loterie nationale britannique, ALT a présenté ces foyers comme un moyen simple et abordable de diminuer l'abattage d'arbres pour obtenir du bois à brûler.
Par ailleurs, ALT s'est attaché à encourager la plantation d'arbres par le biais d'une pépinière (avec une capacité de 6 000 plants) à Tsihombe, en coopération avec Peace Corps. L'objectif de cette pépinière est de faire pousser des plants d'arbres utiles qui résistent à la sécheresse (par ex. papayer, morenga, manguier, neem etc), pour qu'ils servent de pare-vent en vue de protéger les cultures (fruits, feuilles comestibles, etc) et de bois à brûler, de bois de construction, pour les remèdes traditionnels et pour faire de l'ombre. Les jeunes plants sont vendus à des prix abordables à des particuliers ou sont distribués à des associations.
Émissions radio portant sur des questions environnementales
Entre 1999 et 2006, au total, 354 émissions ont porté sur l'environnement, réalisées par divers partenaires de PCID. Voici une liste non exhaustive des sujets abordés : les latrines, les fourneaux économes en combustible, la protection des tortues, les dangers de l'abattage et du brûlis, la culture d'arbres fruitiers, l'importance de protéger les arbres, l'utilité des forêts, la manière dont les arbres se comportent vis-à-vis de la pluie, les parcs nationaux, l'importance de la biodiversité, la lutte contre les incendies, les dunes de sables, les ruches comme moyen de protection des forêts, les forêts locales sacrées, le charbon de bois, etc..
Fourneaux améliorés (appelés « TM ») Une série de 38 émissions radio a été réalisée sur les TM entre 2002 et 2005. Puis 11 autres émissions ont été produites en 2005 sous l'égide du projet Toko Mitsitsy Mahafaly (TMM), qui a élargi le projet à la région de Mahafaly et a été financé par Climate Care. Ces émissions ont abordé toute une variété de sujets, dont des informations sur les TM, les avantages d'utiliser des TM et des informations sur la manière de réparer des TM. Les formats utilisés ont varié grandement, les émissions prenant la forme d'histoires, de dialogues, de sketchs, de rapports d'actualités, d'interviews, de chansons et de poèmes. La radio a également servi à organiser des formations, en informant les populations du calendrier de ces formations dans les différents centres communaux. Ces émissions ont été diffusées 1 a 2 fois par mois par chacune des 17 stations radio partenaires du Sud.
23
Plantation d'arbres Deux séries radiophoniques ont été diffusées pour coïncider avec la distribution de semences (de décembre 2004 à avril 2005 et de février à avril 2006) depuis la pépinière de Tsihombe.
La première série de ces émissions s'est présentée sous la forme de simples annonces lues par les animateurs radio, commençant par une salutation adressée aux anciens et aux fermiers, pour se poursuivre par des informations sur le fait que les pluies étaient arrivées et que les jeunes plants de la pépinière étaient suffisamment grands pour être plantés. Puis la liste des espèces disponibles était lue, suivie d'un mot sur l'importance d'avoir des arbres. Le coût des arbres était donné, accompagné d'un message sur la façon dont les associations pouvaient déposer des demandes pour obtenir des arbres gratuitement. Pour finir, les heures d'ouverture de la pépinière ont été indiquées et son emplacement expliqué.
La deuxième série de cinq émissions différentes a fait l'objet de diffusions plus fréquentes, chacune durant entre 3 et 8 minutes. Elles étaient très variées, partant de listes sur les arbres disponibles à la pépinière pour aller jusqu'à des dialogues entre des femmes sur la meilleure façon de planter un arbre. Pour chaque émission, un spot de 20 à 40 secondes était également produit, contenant les messages principaux de l'émission. En moyenne, quatre émissions et huit spots ont été diffusés par semaine.
Constatations quant à l'impact environnemental de la radio
Foyers améliorés L'étude sur les foyers s'est produite sous la forme d'une enquête auprès de 268 personnes choisies au hasard parmi 11 communautés rurales, dans la région particulièrement pauvre et isolée de l'Androy. Les villages ne recevant aucun ou que peu de signaux radio ont été comparés aux villages ayant une bonne réception radio, en vue d'établir s'il existait ou non un lien entre l'écoute de la radio et l'adoption de fourneaux améliorés. Les résultats ont été contrôlés pour tenir compte d’autres variables socio-économiques et culturelles. Cet échantillon de 134 femmes pris au hasard a révélé que 61 % des femmes issues de villages recevant la radio comprenaient l'utilité d'un foyer amélioré et en utilisaient un, par rapport à seulement 47 % des femmes issues de villages dépourvus de la radio, bien qu'elles aient toutes reçu le même nombre de visites des agents de terrain chargés de promouvoir les nouveaux foyers.
D'après les agents de terrain, dans les villages avec radio, les femmes étaient plus disposées à adopter des foyers et bien moins craintives. En fait, une fois annoncée l'arrivée prochaine d'un formateur, il était fréquent qu'elles partent à l'avance ramasser les matériaux nécessaires pour la construction du foyer. D'après un formateur local :
Les femmes avaient entendu parler à la radio du Toko Mitsitsy et de son utilité ; elles en connaissaient parfaitement la théorie et il ne leur manquait plus qu'à apprendre les aspects pratiques de son mode de construction.
Les femmes d'un troisième groupe de villages, où les groupes d'écoute radiophonique sont bien organisés et réguliers depuis 2002, ont affiché des résultats meilleurs encore : parmi un échantillon de femmes prises au hasard auprès de groupes d'écoute, 81 % d'entre elles utilisent ou ont utilisé par le passé un foyer amélioré (n= 47). Cela prouve bien la valeur ajoutée de la radio. Les résultats indiquent que les femmes qui ont pu écouter des émissions radio pertinentes sur une période relativement longue (dans le cas présent depuis au moins 2002) affichent un taux d'adoption des foyers supérieur à d'autres, tout en bénéficiant du même type de contact avec les agents sur le terrain.
De plus amples études sur le terrain ont été réalisées dans la région de Mahafaly sur le projet TMM pour examiner le rôle que la radio a joué. Des discussions de groupe ont eu lieu avec les bénéficiaires, des entretiens individuels se sont déroulés avec des membres du personnel du projet et les femmes formés en qualité de formatrices locales dans les villages.
Cette étude a révélé que les émissions radio avaient joué un rôle important dans le projet. Les femmes des villages où il était prévu d'animer une séance de formation étaient au courant de ces foyers et y montraient de l'enthousiasme ; des cas ont été cités à plusieurs reprises de femmes issues de villages où aucune formation n'avait eu lieu mais qui, malgré tout, avaient construit leurs foyers, parfois en demandant conseil à des femmes qui en avaient déjà construit ou en s'appuyant sur les émissions radio qu'elles avaient entendues. D'après Remamoritsy, le maire d’Amboropotsy :
Les émissions sur les foyers TM sont bonnes car même des gens d'autres villages, qui n'avaient reçu aucune formation de la part des formateurs sur le terrain, sont parvenus à construire des TM grâce aux émissions diffusées. La langue utilisée est adaptée au terrain ainsi qu'au dialecte.
Les études ont révélé que la radio avait été utile au projet à divers égards. La radio avait :
• Encouragé les gens à participer au projet, en les informant des avantages du TM • Informé les maires, pour qu'ils informent les habitants de leurs circonscriptions de se
rendre en ville pour assister à la formation • Informé et encouragé les femmes à recueillir les matériaux et se préparer à la formation • Encouragé les femmes à assurer l'entretien de leurs TM et de quelle manière • Aidé les artisans à vendre des TM • Diffusé les informations sur les dangers que la déforestation présente pour l'environnement
Distribution d'arbres L'objectif visé était de quantifier dans quelle mesure la radio informait et incitait la population à acheter des arbres, ou les associations à faire la demande d'arbres gratuits, auprès de la pépinière arboricole.
Sur la première série radiophonique (de 2005), seuls des faits anecdotiques ont été recueillis : Peace Corps Volunteer1 a estimé que sur les 533 arbres vendus entre décembre 2004 et avril 2005, 90 % de ces ventes provenaient de personnes informées par le bouche à oreille et encouragées par la radio, ou directement par la radio.
Des données quantitatives ont été recueillies pour la deuxième série radiophonique (de 2006) et les résultats se sont révélés tout aussi positifs. Il a été demandé aux bénéficiaires comment ils avaient appris que des arbres étaient disponibles.
Les résultats ont montré que sur les 88 particuliers et associations qui s'étaient présentés à la pépinière pour y obtenir des jeunes plants d'arbres, la radio était responsable de 39 % du total des visites, alors que 48 % d'entre eux en avaient entendu directement parler par des membres d'ALT de leur connaissance. Toutefois, la radio était responsable d'un nombre plus important d'arbres vendus : 635 arbres ou 59% de tout arbres distribues grâce aux annonces/émissions radiophonique. En conséquence, les émissions radio ont joué un rôle indubitable à encourager les gens à venir chercher ou acheter des arbres.
635 arbres ou 59% de tout arbres distribues grâce aux annonces/émissions radiophonique o Nombre qui ont mentionné la
radio o Nombre qui ont mentionné le
personnel d’ALT ou le bureau d’ALT
o Autres réponses (ou pas de réponse)
24
25
Conservation des forêts La défense de l'environnement et l'agriculture, et en conséquence les moyens de subsistance, sont bien évidemment étroitement liés les uns aux autres ; cela se manifeste tout particulièrement clairement chez les fermiers du Sud du Madagascar, au vu des remarques recueillies. Par exemple, à la question de savoir les raisons de leurs émissions préférées, la présidente d'un groupe d'écoute a affirmé :
Toutes les actions de développement : de l'eau, de la pluie, de l'hygiène et de la santé, dépendent de la protection de l'environnement... c'est pour cela que nous aimerions avoir davantage d'émissions sur la prévention des feux de brousse2.
Un autre groupe a indiqué :
Les émissions sur la plantation d'arbres sont nos préférées, parce que dans le coin, nous n'avons eu aucune pluie, mais si nous plantons des arbres, la pluie pourrait peut-être se remettre à tomber
3
Messages d'ordre général sur l'environnement Les ONG affirment très clairement que les émissions radio les aident à faire passer leurs messages environnementaux. Par exemple, un porte-parole de SATRAHA a déclaré que du fait que les villageois faisaient partie de groupes d'écoute :
Ils sont bien informés sur les conséquences dévastatrices des feux de brousse, sur les avantages des arbres et leurs nombreux usages.
Un autre porte-parole de CIREEF a remarqué : Une croissance accrue [au sein du groupe d'écoute] des règles en matière de conservation et de la nouvelle politique sylvicole.
WWF nous a indiqué que les émissions radio sont responsables d'un : Changement de comportement vis-à-vis du braconnage des tortues et du défrichage de la brousse.
Et que : Les auditeurs se rappellent fréquemment de ces émissions.
Le Programme alimentaire mondial a indiqué que : Des initiatives de réhabilitation de pistes (routes) et de défrichage du cactus rouge sont visibles aux quatre coins de la région, en conséquence directe des émissions radio.4
Impact de la radio sur la fréquentation de cours d'alphabétisation
L'étude a analysé les effets de la radio sur la notoriété des cours d'alphabétisation et sur l'inscription et la participation à ceux-ci. L'étude a été réalisée par les chefs du projet, à savoir 22 personnes locales qui ont été recrutées et formées pour gérer et encadrer chacune plusieurs douzaines de centres d'alphabétisation.
Contexte de l'alphabétisation dans le sud de Madagascar
Le sud de Madagascar souffre d'un manque notoire en termes d'éducation. Même si des écoles primaires y existent (souvent assurées par l'Unicef), le taux d'abandon est de 70 % au premier trimestre5. Sauf à l'intérieur des zones urbaines et à proximité, on estime le taux d'alphabétisation dans les régions les plus rurales du sud à moins de 5 %6. Dans les écoles, les enfants reçoivent leur enseignement dans la langue officielle malgache, qui est différente de leur langue maternelle, le Tandroy ou d'autres langues locales, et avant l'arrivée de radios FM locales dans les années 1990,
toutes les émissions radio étaient uniquement diffusées en langue officielle. Les livres et autres sources imprimées sont rares, même dans la langue officielle. Il s'agit là d'un frein majeur à apprendre dans un cadre pédagogique formel ou à y participer.
Tahantanee, ce qui signifie « soin de la Terre », ONG confessionnelle basée à Tsihombe, a perçu la nécessité d'assurer une alphabétisation dans la langue locale et a mis en œuvre un projet d'alphabétisation dans la région de l'Androy. En étroite association avec le PAM, Tahantanee paie ses enseignants et ses cadres en aide alimentaire plutôt qu'en espèces. Cette ONG compte désormais 827 enseignants d'alphabétisation répartis dans la majeure partie de la région qui figure sur cette carte (d'une population d'environ 250 000 habitants).
Pointe extrême sud de Madagascar
Les cours d'alphabétisation sont gratuits et sont principalement destinés aux adultes qui en font la demande et se forment eux-mêmes en « centres de formation » dans leurs villages, qui consistent fréquemment en un espace sous un ficus ombragé. Les bancs, tableaux et tablettes sont généralement faits maison. Le manuel d'alphabétisation est profondément ancré dans la culture locale (par ex. : proverbes Tandroy) et s'appuie sur des questions réelles, comme l'élevage, la santé et le jardinage. Tahantanee travaille conjointement avec des stations radio locales : elle remet en effet des documents écrits sur des sujets présentés par la radio locale, comme par exemple des questions sur l'hygiène publique, le VIH/sida et des informations techniques sur l'agriculture, l'apiculture, etc... Les motifs donnés par les étudiants pour participer à ces cours sont des plus variés, depuis la gêne qu'ils ressentent à ne pas pouvoir signer leur nom jusqu'à leur désir d'éviter d'être escroqués dans le cadre de transactions commerciales.
Émissions radio réalisées sur le sujet de l'alphabétisation
Entre mars et avril 2005, ALT et des ONG partenaires locale ont produit toute une série d'émissions radio encourageant la fréquentation de cours d'alphabétisation. Quatre émissions distinctes ont ainsi été diffusées. Un spot a été produit et diffusé le 1er avril 2005 seulement par Radio Voron Kodohodo (VK) à Tsihombe dans le but de ce projet d'alphabétisation. Trois émissions radio d'alphabétisation de nature générale ont été enregistrées sur des CD de PR/PCID qui ont été distribués à toutes les stations radio du réseau en mars 2005 :
o Un dialogue débordant d'énergie entre deux hommes expliquant que le programme d'alphabétisation était gratuit et que le matériel nécessaire n'entraînait aucun coût, par l'utilisation de charbon pour écrire et/ou d'une vieille lame de pelle comme tablette.
o En plus de reprendre les points susvisés, l'émission indiquait que le taux de participation (à des programmes d'alphabétisation d'autres organisations) avait augmenté depuis que les gens avaient entendu dire que des objets à bas coût pouvaient être utilisés et que l'enseignement était gratuit
o Un monologue poétique sur le fait d'être libéré d'escroqueries, de sentiments de gêne, etc... Ce monologue a été tout particulièrement populaire et a été rediffusé à plusieurs reprises sur Radio VK avant et après l'annonce unique
26
Constatations quant à l'impact de la radio sur la fréquentation des cours d'alphabétisation
Les enquêteurs de l'organisation de Tahantanee ont enregistré les demandes d'admission à leur programme d'alphabétisation immédiatement après les annonces radio. Il en est ressorti une relation très claire de cause à effet entre la radio et à la fréquentation de cours d'alphabétisation. Le graphique ci-dessous indique la forte hausse de demande d'inscriptions en avril 2005, qui résultait de la première annonce radiophonique des cours d'alphabétisation gratuits qui avait été diffusée un mois auparavant, en Mars.
Progression de la demande de cours d’alphabétisation depuis l'annonce radiophonique initiale en 2005
• Centre d’alphabétisation- violet • Etudiants- bleu
Les cours ont pu commencer en août 2005, une fois que le nombre d'étudiants potentiels était connu et que suffisamment d'enseignants avaient été formés. La demande fut tellement élevée (avec près de 25 000 étudiants) qu'il n'y eut pas suffisamment de places pour répondre au nombre de candidats et qu'il devint difficile de trouver des enseignants potentiels. Le fait que 40 % des hommes étudiants (et 24 % des femmes étudiantes) faisaient trois kilomètres ou plus à pied pour assister à ces cours, certains allant même jusqu'à parcourir 20 km à pied (4 % d'hommes et 2 % de femmes), atteste bien du degré d'enthousiasme que ces cours ont suscité. Au bout de trois mois de cours, près de 60 % des étudiants en moyenne avaient atteint au moins un niveau 3 en lecture7.
Les cours étaient étayés d'émissions radio, qui figuraient et répétaient quelques-unes des leçons et certains des thèmes que les étudiants apprenaient en cours.
À la suite de quoi, une enquête fut réalisée auprès de 273 étudiants adultes choisis au hasard dans 165 centres d'alphabétisation de 17 communes différentes dans les régions de Beloha, Tsihombe et Ambovombe. Il était demandé aux personnes interrogées d'indiquer les motifs de leur présence dans un centre d'alphabétisation. La majorité d'entre elles (59 %) ont cité la radio comme étant la raison principale, suivie de « mon ambition personnelle » (20 %) et des assemblées locales (9 %). Des indications anecdotiques ont également révélé que dans les régions à faible pénétration de postes de radio (comme la commune de Tranomaro dans la région de l'Androy), l'engouement en faveur de l'alphabétisation y était nettement moins marqué, où les classes étaient de plus petite taille et moins cohésives8.
27
28
Impact des émissions radio sur la santé
Contexte sur les questions sanitaires
Notre section « Données de base » a dressé une vue d'ensemble des graves problèmes sanitaires qui existent aux quatre coins de Madagascar. Dans le sud, les services sanitaires sont particulièrement mauvais.
En raison de leur pauvreté et leur isolement rural, la plupart des gens rechignent à faire appel à des soins, sauf dans les cas les plus désespérés, en raison du coût des consultations hospitalières, des examens et des médicaments. Un séjour passé à l'hôpital signifie également qu'une famille dépense du temps et de l'argent précieux dans les transports publics, à payer la nourriture du malade et à assurer les soins par un autre membre de la famille. Lorsque les sécheresses sévissent et que les revenus agricoles sont maigres, les gens disposent de très peu de moyens pour assurer le coût des services sanitaires, ce qui a des répercussions sur la fréquentation hospitalière, comme nous le montreront plus loin les résultats de l'étude.
Près des trois-quarts de la population rurale vivant en dessous du seuil de pauvreté, et face à des pratiques culturelles qui accroissent les risques (citons la polygamie, des partenaires multiples, de premières relations sexuelles à un âge très tendre)9, et la pratique des « frères de sang »10, le sud est extrêmement vulnérable au VIH/sida. Par exemple, le taux d'infection par des MST dans la ville de Fort Dauphin est de 3,56 % (juin 2004), affichant une hausse alarmante depuis août 2003 où il n'était que de 1,39 %11.
Le danger n'est que plus imminent avec l'installation future de la mine de QMM12, qui présage de l'arrivée de quelque 600 travailleurs étrangers. Le statut économique et social des femmes de la région, conjointement à leurs sensibilités biologiques, ne font qu'accroître leur vulnérabilité à des risques d'infection.
Par ailleurs, les pratiques traditionnelles restent très vivaces dans le sud. Par exemple, les nouveaux-nés sont nourris d'une tisane sensée les laver des mauvaises choses. Dans de nombreux cas, celle-ci provoque de graves diarrhées qui peuvent s'avérer mortelles. Lorsque quelqu'un tombe malade, le premier réflexe ne consiste pas à se rendre à l'hôpital mais plutôt à s'en remettre à des docteurs traditionnels, des guérisseurs, qui parcourent les campagnes en vendant des antibiotiques et d'autres médicaments et cures supposées, toujours en quantités insuffisantes, appelés ombiasa (des « sorciers » traditionnels).
Les traditions culturelles et l'inégalité des relations entre les sexes pèsent également très lourdement sur la santé des femmes. Les travailleurs au projet ALT ont ainsi relevé des cas où des femmes ont souffert de complications à l'accouchement qui auraient pu être évitées si leur mari avait vendu l'une de ses vaches pour payer des soins médicaux qualifiés.
Émissions radio réalisées sur les questions sanitaires
Entre 1999 et 2006, au total, 539 émissions ont porté sur la santé, réalisées par divers partenaires de PCID. Voici une liste non exhaustive des sujets abordés : la purification de l'eau, le paludisme, le planning familial, les consultations anténatales, la santé de la mère et de l'enfant, l'allaitement maternel, l'alimentation de l'enfant, les vaccinations, le VIH/sida, l'hygiène, la prévention de la diarrhée et la réhydratation.
Émissions sur le VIH/SIDA L'équipe de recherche a analysé toute une série d'émissions radio produites par ALT et ses partenaires13 sur le sujet du VIH/sida, qui ont été financées spécialement par la Banque mondiale14. Ces émissions ont été conçues et diffusées en deux phases, entre janvier 2004 et août 2005. Ce sous-projet a été mis en œuvre sous les auspices du CNLS (Comité National de Lutte Contre le SIDA).
29
Après avoir entrepris une enquête de référence pour déterminer les niveaux d'information existants, les émissions radio se sont attachées à accroître la sensibilisation au VIH/sida, tout particulièrement dans les régions d'Anosy et de l'Androy. Les indicateurs ciblés se donnaient pour but de faire en sorte que :
o 40 % de la population puisse se rappeler des messages communiqués par les séries radiophoniques
o 50 % de la population des communautés rurales et urbaines soient capables de citer trois moyens de transmission
o 50 % de la population des communautés rurales et urbaines soient capables de citer trois méthodes de prévention
o Il se produise une augmentation de 20 % des consultations IST/VIH/sida dans les centres SSB (Services de Santé de Base).
Au total, 24 émissions ont été produites et diffusées lors de la première phase (2004) et 38 lors de la seconde (2005). Toutes ont été réalisées en observant le cycle de production participatif (CPP) ordinaire d'ALT, qui insiste sur la participation des auditeurs au contenu des émissions. Les émissions couvraient tout un éventail de thèmes de sensibilisation au VIH/sida (en langues Androy et Anosy), dont les thèmes suivants :
o La prévention par l'utilisation de préservatifs o La transmission du VIH de la mère à l'enfant o Le VIH dans les zones rurales o La lutte contre le sida o Le rapport entre les IST et le VIH/sida o Explication du virus VIH et de ses répercussions sur le système immunitaire (analogie à des
références locales). Émissions de l'hôpital d'Ejeda Dans la région de Mahafaly, un hôpital luthérien créa en juin 2004 une station radio avec le soutien du projet ALT/PR, co-financée par l'Unicef. Cette nouvelle station, baptisée Radio Feon’ ny Linta (RFL), comptait une équipe locale de réalisateurs d'émissions recrutés par ALT pour travailler en parallèle avec l'hôpital et la station radio, afin de veiller à ce que les émissions diffusées soient le fruit d'une synergie entre les besoins d'informations sur la santé et les services hospitaliers offerts dans la région.
Les émissions sanitaires diffusées à Ejeda d'août 2004 à décembre 2005 furent les suivantes :
Sujet Nombre d'émissions diffusées VIH/sida 55
Allaitement maternel 10
Planning familial 10
Santé d'ordre général 10
Vaccinations (autres que la polio) 8
Maladies sexuellement transmissibles 7
Hygiène 6
Polio 5
Paludisme 5
Consultation anténatale 4
Sur-eau16 et eau potable 3
Tuberculose 2
Choléra 1 Plantation de légumes en faveur d'un régime sain 1
Les femmes enceintes 1
TOTAL 128
30
Constatations quant à l'impact de la radio sur la santé
VIH/SIDA17
Une enquête par questionnaire fut réalisée pendant deux mois, qui cibla 270 individus choisis au hasard (122 femmes et 148 hommes), et 27 groupes de discussion. Les personnes interrogées ont été sélectionnées pour qu'elles constituent une section représentative des habitants ruraux et urbains, avec des chiffres plus ou moins égaux de personnes se réclamant en tant que membres de groupes d'écoute et en tant que non membres. L'étude portait sur la deuxième phase des émissions radio. Elle s'est déroulée en août - septembre 2005 à Fort Dauphin, Ambovombe, Tsihombe et dans les villages avoisinants respectifs.
Il fut demandé aux personnes interrogées de dresser par ordre d'importance la liste de leurs sources personnelles d'informations sur le VIH/sida. La radio en est ressorti de loin en tête, avec en moyenne 89 % des personnes interrogées (n = 270) citant la radio comme leur source d'information la plus importante concernant le VIH/sida. Les ONG figuraient en deuxième place et les posters en troisième. Parmi les personnes interrogées citant la radio comme source principale d'information, un nombre légèrement plus important d'entre elles habitaient la ville que la campagne (96 % par rapport à 82 %), et la télévision exerçait une influence notable auprès des citadins. Toutefois, dans les zones rurales tout comme dans les zones urbaines, la radio était de loin le gagnant en termes de dispense d'informations sur le VIH/sida.
J'apprécie le Projet Radio SIDA car depuis que j'écoute les émissions sur le sida, je sais beaucoup plus de choses.
Témoignage d'un interviewé à Ambovombe (A115)
La station radio de Voron-Kodohodo est mon unique source d'information sur le VIH/sida Interviewée à Namotoha (T333)
Il est intéressant de noter que 18 % seulement des personnes interrogées n'arrivaient pas à se rappeler du producteur de ces émissions, alors qu'en moyenne 75 % des répondants ruraux ont cité ALT ou PR comme l'organisation productrice des émissions VIH/sida dont ils se souvenaient. Les émissions étaient à tel point mémorables que, dans plusieurs cas, des membres de groupes de discussion étaient capables de répéter des dialogues émanant de ces séries radiophoniques, pratiquement au mot pour mot, ou pouvaient réciter des poèmes entiers diffusés précédemment.
L'enquête a révélé que la majorité des citadins comme des campagnards étaient bien au courant de la nature mortelle du sida et de ses modes de transmission. 85 % des personnes interrogées pouvaient citer le sida comme maladie, dont 60 % d'entre elles le précisaient comme maladie sexuelle, 52 % comme étant incurable et 58 % indiquant qu'elle pouvait avoir des conséquences mortelles.
Depuis la diffusion de ces émissions, nous en sommes arrivés à croire en l'existence du sida et nous en avons peur.(FGD 8)
Nous croyons en l'existence de cette nouvelle maladie parce que [la radio] Voron-Kodohodo en parle tout le temps (FGD7)
Il n'empêche qu'une minorité faible mais cependant significative (10 %) des personnes interrogées a déclaré que le sida n'existe pas, et 15 % d'entre elles pensaient que les moustiques pouvaient disséminer le virus. Par ailleurs, il en est ressorti que les attitudes vis-à-vis des personnes atteintes du VIH/sida (PVVIH) étaient embrouillées, 55 % d'entre elles affirmant qu'il fallait aider les PVVIH, alors que dans le même temps 41 % pensaient qu'il fallait les isoler. La déclaration de l'une des personnes interrogées illustre parfaitement bien cette attitude :
Il faut l'aider [la PVVIH], lui donner à manger et l'aider à consulter un médecin, puis il faut la mettre dans un endroit où elle ne peut pas entrer en contact avec la population.
31
Toutefois, l'étude a montré que les membres de groupes d'écoute radiophonique étaient moins nombreux à afficher des attitudes négatives vis-à-vis des PVVIH (seulement 40 % des personnes déclarant ne pas vouloir aider les PVVIH appartenaient à des groupes d'écoute), ce qui semble indiquer que les possibilités de discuter des stigmates que présente cette maladie et de la discrimination qu'elle suscite peuvent permettre de diminuer les attitudes négatives. Il n’en reste pas moins que ce type de convictions erronées et d’attitudes continue de poser un défi, tant pour le projet que pour tous les formateurs sanitaires. Les détails recueillis par l'étude concernant les pratiques normales (par exemple, beaucoup de personnes interrogées considéraient la fidélité impossible), les attitudes et les convictions erronées ont été extrêmement utiles pour recadrer les emissions futures.
Les enquêteurs ont découvert qu'il existait une demande généralisée pour d’avantage d'émissions sur le VIH/sida, ce qui semble indiquer que les émissions du projet ALT/PR sont très appréciées :
o 92 % ont affirmé désirer entendre plus d'émissions radio sur le VIH/sida o 53 % souhaiteraient entendre plus d'informations sur la manière de se protéger eux-mêmes o 61 % souhaiteraient entendre plus d'informations sur les symptômes du VIH/sida o 11 % ont spontanément demandé davantage de visites de la part d'animateurs sida (travailleurs
sur le terrain) sans qu'aucune question sur le sujet ne fût posée (n = 270) Ces résultats ont été confirmés par l'étude qualitative menée auprès des groupes de discussion, qui a souligné l'attrait que les émissions soient diffusées dans le dialecte local, en utilisant des chants et des poèmes issus de la culture locale. Les formats privilégiés se sont avérés être les mini sketchs, les dialogues et les conseils donnés entre amis. Voici quelques exemples de remarques :
Je me rappelle bien des poèmes écrits dans le dialecte d'Antanosy, ils sont excellents ! (FD64)
Je souhaiterais écouter d’avantage d'émissions car cette maladie pose une menace et est incurable ; la radio est une source d'information et d'éducation pour nous autres qui sommes des fermiers illettrés. (T347)
Nous détestons les émissions qui ne sont pas dans le dialecte d'Antandroy (FGD14)
Lors d'une enquête séparée effectuée auprès de 100 groupes d'écoute radiophonique (Vadgama, 2006), le sujet du VIH/sida en est ressorti très populaire et celui cité le plus fréquemment comme « émission préférée » parmi les thèmes concernant la santé. Malgré tout, quelques groupes (9 sur les 100) ont indiqué ne pas apprécier les émissions sur le VIH/sida :
Parce qu'il est tabou de discuter de l'usage du préservatif et des relations sexuelles avec des membres de la famille (AMB8)
Autre bonne constatation de cette enquête : sur les 100 groupes d'écoute, 32 ont affirmé que des gens de leur village avaient adopté les mesures de prévention contre VIH/SIDA suggérées à la radio dans leur village, tout particulièrement chez les jeunes qui utilisaient des préservatifs pour empêcher les infections.
Pour finir, les enquêteurs ont interviewé du personnel des 15 stations radio qui avaient diffusé les émissions de la campagne VIH/sida. Il en est ressorti que le personnel de la radio reçoit souvent directement des demandes d'informations sur le VIH/sida
Beaucoup de gens s'adressent à la station pour en savoir plus sur l'usage du préservatif et les moyens d'éviter les infections. Présentateur à Radio Ravenara
Les gens nous demandent de leur donner les meilleurs moyens de convaincre leurs amis. Présentateur à Radio Étoile
32
Les responsables18 de groupe d'écoute se sont également avérés des personnes clés dans la lutte contre le VIH/sida.
(En tant que président [du groupe d'écoute], je dois organiser une réunion hebdomadaire pour donner des conseils et encourager les questions sur les programmes PR/SIDA. Et quand il ne reste plus de préservatifs, je vais à Tsihombe chercher des préservatifs pour nous tous ici. Sakamasay, région de l'Androy).
Une autre constatation clé de cette enquête est le rôle crucial que joue le personnel de la radio lorsque les messages sont diffusés. Il n'y a pas de doute qu'il est nécessaire de continuer à renforcer les connaissances et la capacité de ces personnes clés, tant au sein de groupes d'écoute que dans les stations radio.
Constatations quant à l'impact de la radio sur le planning familial L'équipe de l'étude a comparé cinq villages n'ayant aucun ou que très peu d'accès à la radio (appelés VSR dans le tableau ci-dessous) à six villages disposant d'un bon accès à des émissions radio (appelés VAR
19). Ces groupes de villages se trouvent tous deux dans la région de l'Androy et tous deux
sont autrement identiques en termes socio-économiques. Il fut demandé à 134 femmes de dire ce qu'elles savaient sur les moyens d'éviter de tomber enceinte. L'étude a révélé que les femmes de villages ayant une bonne réception radio en savaient plus sur tous les types de méthodes de planning familial que les femmes des villages écoutant peu la radio ; l'échantillon a été contrôlé pour tenir compte des effets de l'âge, de la distance d'une clinique ou de l'effet potentiel d'agents sur le terrain faisant la promotion de techniques de planning familial. Par exemple, 46 % des femmes de villages VAR connaissaient l'existence de la pilule contraceptive, par rapport à 18 % dans l'autre groupe.
Impact de la radio sur le planning familial
n = 134 % de femmes issues de VSR (villages sans
radio)
% de femmes issues de VAR (villages avec
radios)
Quels sont les moyens pour éviter de tomber enceinte ?
Préservatif 0 7
Pilule 18 46
Piqûre 20 54
Calendrier 0 1
Ne sais pas 73 32
Où pouvez-vous obtenir ces méthodes de contraception ?
Hôpital CHRR (avec chirurgien) 18 43
Clinique de la commune 0 20
Boutique du coin 0 0
Ne sais pas 75 14
Après avoir accouché, quelle est la durée conseillée avant d'avoir un autre enfant ?
Femmes répondant 2 ou 3 ans 18 43
33
Ce tableau montre que la radio est une source d'information importante pour les questions de planning familial. Par exemple, 20 % de femmes des VAR citent les cliniques de la commune comme sources de méthodes de contraception, contre 0% dans les VSR, alors que 43 % des femmes des VAR citent l'hôpital local par rapport à seulement 18 % de celles des VSR. Ceci semble indiquer que la radio joue un rôle pour promouvoir la fréquentation des centres médicaux.
À noter également que 75 % des femmes issues de VSR ont répondu Ne sais pas à la question de l'endroit où elles pouvaient acquérir des méthodes de contraception, par rapport à seulement 14 % dans les VAR. La radio semble en outre exercer une forte influence en ce qui concerne l'espacement des naissances, 43 % des femmes des VAR donnant la réponse conseillée dans les émissions radio, par rapport à seulement 18 % de celles des VSR.
Constatations de l'impact de la radio sur la vaccination Dans le cadre de la même enquête (comparant un total de 134 femmes choisies au hasard issues de villages à forte écoute radiophonique (VAR) et à faible écoute (VSR), l'influence de la radio sur les connaissances et la pratique de la vaccination enfantine apparaît clairement (Voir le tableau suivant).
Impact de la radio sur la vaccination n = 134 % des femmes de VSR % des femmes de VAR
Vos enfants ont-ils été vaccinés ?
Oui 75 89
Connaissez-vous les vaccinations qu'ils ont reçues ? (% des femmes dont les enfants avaient été vaccinés)
Incapable d'en citer une 53 26
Capable d'en citer 1 11 2
Capable d'en citer 2 16 21
Capable d'en citer 3 22 58
Capable d'en citer 4 0 0
Combien de vaccins un enfant doit-il recevoir ?
4 vaccins (réponse correcte) 42 68
Où obtenez-vous des informations à ce sujet ?
Radio 8 32
Personnel hospitalier 2 5
Notables 33 S.O.
L'étude a révélé que 89 % des femmes issues de villages avec la radio avaient fait vacciner leurs enfants, par rapport à seulement 75 % de celles de villages à faible écoute radiophonique. Point plus important encore : d’avantage de femmes des villages avec radio (68 %) savaient qu'un enfant a besoin au total de quatre vaccins, par rapport aux femmes de villages sans radio (42 %). Tous les villages disposaient d'un accès égal aux services de vaccination et recevaient le même nombre de visites des agents sanitaires promouvant la vaccination. L'étude qualitative révèle également que la radio exerce
34
un impact considérable pour convaincre les mères à emmener leurs enfants se faire vacciner :
Nous avons suivi les conseils donnés à la radio et avons fait vacciner nos enfants (FGD 1 et FGD 4)
D'après un agent sanitaire rencontré à Tsihombe, la radio avait vraiment contribué à convaincre les gens de l'utilité de faire vacciner leurs enfants :
Grâce à la radio, ils comprennent la raison de notre présence ici.
Il en va de même pour la région d'Ambovombe, où le médecin de Ankilikira Beanatara CSB a déclaré :
Le nombre de mères qui amènent leurs enfants à l'hôpital ne cesse d'augmenter depuis la campagne de sensibilisation diffusée à la radio.19
Une ONG locale, MCDI Medical Care Development International, a indiqué que la radio avait un impact positif sur les campagnes de vaccination conduites dans sa région d'intervention (Vezo et Mahafaly) :
Nous avons relevé des répercussions notoires au sein des groupes depuis qu'ils écoutent les émissions. Après la diffusion des émissions, la participation des membres des groupes d'écoute s'accroît lors des campagnes de vaccination. 20
Autres constations
Notre enquête auprès de 100 groupes d'écoute a révélé que pratiquement tous mettaient en pratique les suggestions sanitaires avancées lors des émissions radiophoniques, l'usage de moustiquaires arrivant au premier plan (46 sur 173 des pratiques mentionnées), suivi par l'usage des préservatifs (32 mentions), l'adoption de mesures de planning familial comme avec les préservatifs, des piqûres et la pilule (31 mentions) et les soins anténataux et néonataux (25 mentions). Certains témoignages encourageants ont été enregistrés :
Grâce aux conseils reçus de la radio, l'incidence de toutes les maladies a baissé de beaucoup, ici à Tsarapioky, car nous suivons tous les conseils donnés : vaccination pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, utilisation de « super-moustiquaires » pour se protéger du paludisme, utilisation de WC, protection de l'eau à boire (AMB 11 )21
L'enquête a également mis en évidence quelques obstacles à la mise en œuvre d'idées nouvelles. Le coût de l'eau de Javel (chlorhydrate), des préservatifs et des moustiquaires est apparu comme autant d'obstacles importants (ces coûts ont été cités comme obstacles à des changements comportements par 8, 7 et 8 groupes d'écoute respectivement).
Notre enquête de partenaires PCID22 a recueilli de nombreux commentaires positifs sur les impacts sanitaires. Citons ainsi par exemple les rapports de MCDI :
Nous avons relevé des impacts majeurs en ce qui concerne la tuberculose au nord de Toliara et dans la commune de Miary, ainsi qu'à Befanamy à l'est de Toliara. Après la diffusion des émissions sur la tuberculose, le nombre des visites de dépistage chez les groupes d'écoute a augmenté sensiblement.
Une autre organisation, SISAL, a observé des changements au sein de la communauté après la diffusion des émissions, comme par exemple l'augmentation des consultations anténatales, de la participation aux campagnes de vaccination et de l'usage de moustiquaires pour la prévention du paludisme.
35
De même, à Fort Dauphin, ASOS a fait part :
[de] l'impact positif des émissions radio sur le comportement des auditeurs dans les villages autour de Behara. Nous avons noté une nette amélioration en termes d'hygiène, d'assainissement, [d'adoption de techniques de] planning familial, surtout après l'adoption du format de témoignage de familles qui avaient déjà mis en pratique ce genre de conseils.
Constatations suite à l'étude menée à l'hôpital d'Ejeda
Deux études23 se sont penchées sur l'impact d'une nouvelle station radio : Radio Feon’ ny Linta (RFL), sur l'ensemble d'une région desservie par l'hôpital d'Ejeda dans la région de Mahafaly. Elles se sont intéressées à l'efficacité de la radio en ce qui concerne les connaissances et la sensibilisation de ces habitants sur les questions de soins de la mère et de l'enfant et sur le VIH/sida. Plus de 250 personnes ont participé à des entretiens semi structurés et à des discussions de groupe. Parmi cet échantillon, la moitié était issue de groupes d'écoute et l'autre était constituée d'individus choisis au hasard en-dehors de groupes d'écoute. Les enquêteurs ont également consulté le registre de l'hôpital et ont effectué 70 entretiens de départ pour se faire une idée du degré d'adoption des services hospitaliers depuis la création de la nouvelle station radio. Une analyse d'observation et de contenu a également été effectuée à la station radio.
L'étude a révélé que 75 % des personnes interrogées (qu'elles appartiennent ou non à des groupes d'écoute) citaient la radio comme leur principale source d'information ; nous savons également que cela faisait des décennies qu'une station radio n'avait pas diffusées d'émissions depuis Ejeda. La radio nationale de Madagascar, RNM, n'offre pas une bonne couverture radiophonique dans cette région ; en conséquence, les réponses qui citent la radio comme source d'information se réfèrent pratiquement certainement aux émissions radio de RFL.
Les enquêteurs ont également trouvé que les achats de postes de radio avaient nettement augmenté depuis la mise en service de la nouvelle station radio. Dans le village d'Anamanta, sur les 19 postes radio existants, 13 avaient été achetés après 2004, après la création de RFL. L'achat de postes à Ejeda a nettement augmenté entre 2004 et 2005, passant de 1,792 postes à 2,736.
Les non membres de groupes d'écoute disposent d'un accès moins fréquent et moins intense à la radio. Lorsque les résultats ont été comparés entre les membres et les non membres de groupes d'écoute, les enquêteurs ont découvert qu'il existe une corrélation entre d'une part les réponses correctes et la connaissance de comportements sains et d'autre part le fait d'être membre d'un groupe d'écoute.
Comparaison entre les membres et non membres de groupes d'écoute
Groupes d'écoute Non membres de
groupes d'écoute
Que faites-vous si votre enfant attrape la diarrhée ?
Donne souvent à boire au bébé 71 % 32 %
Donne au bébé une tisane 5 % 32 %
Fais une solution SRO (solution de réhydratation orale)
18 % 8 %
Amène l'enfant à l'hôpital 95 % 23 %
Comment nourrissez-vous votre bébé ?
Au sein exclusivement 79 % 23 %
Donne au bébé une tisane 9 % 49 %
Jus de cendres 0 % 19 %
36
Notre étude a révélé une moins grande disparité des résultats au niveau des connaissances sur le VIH/SIDA. Un facteur majeur à cela tenait au fait qu'au cours de cette période, beaucoup des émissions sur le VIH/sida n'étaient pas dans le dialecte local de Mahafaly. Une autre raison peut tenir à la réticence de parler de questions sexuelles et au fait que l'hôpital et la station radio d'Ejeda sont contrôlés par des Luthériens très stricts, qui sont opposés à la polygamie, aux relations sexuelles en-dehors du mariage et à d'autres pratiques sexuelles locales.
Malgré tout, les résultats sur le VIH/sida étaient globalement positifs. Par exemple, à la question sur l'endroit où les gens pourraient obtenir de plus amples renseignements sur le VIH/sida, la plupart des groupes ont répondu : à la radio ou à l'hôpital. À notre question : De quoi avez-vous besoin pour lutter contre le VIH/sida ? Les gens ont répondu : Plus d'informations, plus de postes de radio car les villageois sont trop nombreux pour seulement un ou deux postes de radio, de plus longues émissions radio sur le VIH/sida, des chansons sur le VIH/sida car nous aimons écouter des chansons, ainsi que des préservatifs, et des conseils du médecin.
Les enquêteurs ont essayé d'analyser les registres hospitaliers pour établir si les émissions radio diffusées avaient incité les gens à se rendre à l'hôpital. Malheureusement, d'après les chiffres de l'hôpital, le nombre global de patients avait en fait baissé au cours des années récentes. De 5 819 patients en 2003, 5 878 ont été recensés en 2004, pour reculer à 3 757 en 2005. D'après le rapport du médecin en chef et d'après le personnel d'ALT, cette baisse est due aux sécheresses particulièrement graves qui ont sévi ces dernières années : les gens ont moins d'argent à dépenser et sont donc moins disposés à se rendre à l'hôpital sauf en cas d'urgence, car l'hôpital facture de petits honoraires pour ses services.
L'année 2004 a été une année difficile pour nous tous. La famine, ou « Kere » comme on dit ici, frappe de manière endémique le sud de Madagascar. Elle n'a fait que réduire le pouvoir d'achat de la population de la région. Les problèmes sanitaires sont ainsi relégués à l'arrière-plan, ce qui se répercute sur l'activité de notre hôpital 24
En revanche, pour les soins médicaux dispensés gratuitement, la radio s'est avérée un moyen de promotion efficace. Des ophtalmologues et des spécialistes du paludisme en visite à l'hôpital se sont servis de la radio pour appeler les patients à venir se faire soigner gratuitement. Aucune autre méthode d'information de la population ne fut utilisée, à l'exception d'une annonce dans l'une des églises de zone urbaine. Ces résultats témoignent d'un impact sensible :
o 2005 : les messages radiophoniques des ophtalmologues attirèrent 118 patients à l'hôpital, dont 44 se firent opérer de la cataracte.
o 2006 : les messages radiophoniques des ophtalmologues attirèrent 158 patients à l'hôpital, dont 45 se firent opérer de la cataracte.
o 2006 : les émissions sur le paludisme firent venir 960 patients à l'hôpital pour faire l'objet d'un diagnostic, 200 d'entre eux étant diagnostiqués de paludisme et soignés.
À partir des entretiens de départ avec 70 femmes à l'hôpital (59 % étaient des femmes enceintes, 36 % des femmes dont l'enfant était malade), il en est ressorti que la radio avait exercé une influence significative sur leur comportement à venir chercher des soins :
o 70 % des femmes présentes à l'hôpital pour des consultations anténatales ont cité la radio comme source d'information.
o 19 % de l'ensemble de l'échantillon ont indiqué que la radio leur avait conseillé d'aller à l'hôpital (par rapport à 69 % des femmes expliquant leur présence par « c'était mon idée » et 14 % d'entre elles citant le conseil d'amis/de voisins).
o 69 % d'entre elles ont cité la radio comme l'une de leurs sources d'information en matière de santé (contre 51 % citant un ami/voisin, 39 % l'autorité locale et 33 % l'hôpital, 19 % le bouche à oreille et 3 % le marché).
À Ejeda, il n'y a pas de doute que la nouvelle radio représente la source d'information la plus porteuse de la région et qu'elle joue un rôle significatif dans l'éducation des populations locales.
37
Moyens de subsistance
Contexte sur les moyens de subsistance : agriculture et autres activités rémunératrices
Le sud de Madagascar est une région où sévit une insécurité alimentaire chronique et dont les moyens de subsistance sont fragiles, même les années non frappées par la sécheresse. Les graves sécheresses de 1982 à 1992 provoquèrent le déplacement de près de la moitié de la population vers le nord25. La majorité de ceux qui restèrent (2 millions d'habitants environ) dépendent désormais de l'agriculture (surtout du maïs et du manioc), de l'élevage (les grands troupeaux de bétail sont désormais moins courants que les troupeaux de chèvres et de moutons), de jardins potagers et de migration des personnes non qualifiées, ainsi que de l'aide alimentaire pour assurer la survie de l'unité familiale.
Émissions radio réalisées sur les thèmes des moyens de subsistance
La majorité des émissions radio réalisées dans le cadre du projet ALT/PR se sont présentées sous la forme de conseils, d'informations et de discussions portant sur l'agriculture et les moyens de subsistance. Depuis 1999, plus de 300 émissions séparées ont été diffusées sur des thèmes agricoles, allant des maladies bovines à la plantation de manguiers. Par ailleurs, 354 émissions ont traité de sujets environnementaux (comme la protection des tortues) et 86 sur l'élevage de bétail (par ex : les vers parasitaires chez les veaux). L'une des émissions les plus appréciées concernait l'apiculture.
Entre 2003 et 2006, par le biais d'un partenariat avec un projet financé par la Banque mondiale et intitulé PSDR (Programme de Soutien du Développement Rural), ALT/PR a aidé à lancer une stratégie de communication et a facilité la réalisation d'une série spéciale de 18 émissions qui incitaient les Associations communautaires (AC) à faire des demandes de prêts pour leur permettre de créer de petites activités rémunératrices, comme des projets d'apiculture, de volaille, d'artisanat et de pêche. L'objectif recherché par le PSDR était d'accroître les revenus et de réduire la pauvreté dans les zones rurales. Malheureusement, en raison de l'absence de soutien technique sur le terrain, le projet semble avoir échoué (voir ci-dessous pour obtenir plus de renseignements sur nos constatations), bien que cela n'ait rien à voir avec les émissions radio. Constatations quant à l'impact de la radio sur les moyens de subsistance
Informations traitant de questions agricoles L'équipe de recherche a comparé cinq villages dont l'accès à la radio est inexistant ou très faible à six villages disposant d'un bon accès aux émissions radio26. Ces groupes de villages se trouvent tous deux dans la région de l'Androy et tous deux sont autrement identiques en termes socio-économiques. Toute une série de questions ont été posées aux femmes quant à leurs sources d'informations sur des questions traitant de l'agriculture et des revenus. À la question : « Où obtenez-vous vos informations sur les questions agricoles ? », la radio arrivait de loin en tête dans les villages avec radio (50 % citant la radio, 39 % le « bouche à oreille »), alors que dans les villages sans radio, les notables étaient la source principale (53 %), le « bouche à oreille » arrivant en seconde place (40 %), « amis et voisins » (38 %) en troisième, la radio n'étant citée que par 22 % des villageois disposant de peu d'accès à la radio (n = 134).
L'équipe d'étude a toutefois noté que même dans les « villages sans radio », les émissions radio avaient une influence, parce que les personnes interrogées avaient pu écouter l'un des rares postes de radio de leur village ou s'étaient rendues dans l'une des villes où se tiennent des marchés (Anjapaly ou Faux Cap ou Tsihombe), où elles avaient eu l'occasion d'écouter la radio. Les personnes interrogées faisaient parfois référence à des connaissances indirectes, dans les cas où quelqu'un a entendu quelque chose à la radio et lui en a fait part.
38
Mise en pratique des conseils dispensés Dans la même région, il fut demandé à 80 membres de huit groupes d'écoute s'ils étaient en mesure de mettre en pratique les conseils dispensés à la radio. Cela faisait au moins quatre ans (depuis 2002) que ces personnes interrogées, aussi bien des femmes que des hommes, écoutaient régulièrement les émissions radio. Sur les huit groupes, trois avaient construit des pare vent pour protéger leurs champs de coton ; trois groupes utilisaient des insecticides pour protéger leurs cultures ; quatre ont suivit les conseils diffusés à la radio sur le greffage de manioc et trois avaient planté du sorgho. La majorité d'entre eux ont déclaré utiliser désormais des « techniques agricoles modernes ».
Nous apprécions les émissions, car elles donnent des informations et des conseils que les fermiers et les éleveurs peuvent suivre pour améliorer leur mode de vie. (FGD7)
Par ailleurs, quatre des huit groupes ont indiqué qu'ils faisaient désormais vacciner leurs vaches ; trois ont indiqué qu'ils amènent leurs vaches voir le vétérinaire si elles sont malades ; et deux groupes ont indiqué qu'ils soignaient leurs vaches avec des plantes traditionnelles, comme de la pervenche. Bien que nous n'ayons pas de preuves que l'adoption de ces pratiques soit exclusivement le fait de la radio, nous pouvons affirmer avec confiance que la radio a exercé une influence majeure dans ces changements. Comme l'a dit l'un des groupes :
Avant de connaître les techniques modernes, nous utilisions des méthodes traditionnelles mais la production agricole était insuffisante. Maintenant, grâce à la radio, nous pouvons changer de méthodes en adoptant des techniques nouvelles qui nous permettent d'augmenter la quantité de nos produits agricoles. (FGD 5)
Et au sujet de l'élevage de bétail, un autre groupe a déclaré :
Notre bétail se porte mieux, nous faisons maintenant vacciner nos vaches dans notre village et les emmenons se faire soigner par le vétérinaire si elles ont un problème, grâce aux conseils et aux informations dispensés à la radio (FGD 4)
Sur la question de la culture du riz, un autre groupe n'a pas hésité à voir l'utilité de la radio :
Nous pratiquons l'éclaircissage des plants de riz au bout de huit jours et maintenant la production est en hausse grâce à la radio (FTU1) (Vadgama, 2006)
Parfois, après avoir écouté la radio, des particuliers mettent des conseils en pratique, mais dans trois des huit groupes, les participants ont révélé le faire ensemble :
Lorsque le GE entend des émissions importantes, il convoque une réunion de village pour annoncer l'information et mettre en pratique ce qui y a été dit ; grâce à cela, nos vies évoluent progressivement, tout comme notre village (FGD 6)
Après les émissions radio, nous rencontrons les villageois pour mettre en pratique des idées concernant l'agriculture, l'élevage de bétail et tout particulièrement la santé. Grâce à ces émissions, nous savons maintenant beaucoup de choses et le GE peut donner des conseils et aider à créer une association. (FGD 7)
Les ONG et prestataires de services sur le plan local se font l'écho de ces résultats positifs. Par exemple, un porte-parole pour MDP a indiqué à notre équipe :
Lorsque les thèmes des émissions diffusées coïncident avec le calendrier d'activités local, nous avons remarqué que les GE mettent en pratique le contenu des émissions. Par exemple, une émission sur les techniques de stockage de produits agricoles au moment des récoltes, les auditeurs appliquent les consignes promulguées par l'émission.
39
Effets positifs des groupes d'écoute Il ne fait pas de doute que l'union fait la force et que les villageois ont beaucoup à gagner du soutien mutuel qu'offrent les groupes d'écoute : À la question : « Si vous avez des questions sur quelconque des thèmes abordés dans les émissions, à qui vous adressez-vous ? », une pratique importante de partage des informations entre les membres est apparue :
Dans pratiquement tous les cas, nous demandons à d'autres membres du GE. (FGD1)
Nous n'avons besoin de personne d'autre : nous discutons des sujets entre nous. (FGD2)
Sur cet échantillon de huit groupes, trois avaient créé une association capable, entre autres choses, de faire la demande pour participer ou recevoir des fonds auprès de divers projets de développement locaux. Les témoignages reçus d'ONG locales, comme Vola Mahasoa, organisation locale de micro finance basée à Toliara, confirment cette constatation : ils font part d'une « hausse significative » de la demande de micro crédits de la part de membres de groupes d'écoute ainsi que des améliorations au niveau de la capacité des bénéficiaires existants à gérer le crédit (Harford, 2007).
Dans notre autre enquête auprès de 100 groupes d'écoute (Vadgama, 2006), 25 % d'entre eux ont déclaré qu'il existait une association dans le village qui avait été créée autour du groupe d'écoute, et 29 % ont indiqué qu'une association existait dans le village mais indépendamment du groupe d'écoute d'ALT (34 % indiquant qu'aucune association n'existait dans le village, et 2 % ne donnant aucune réponse).
Prêts contractés pour des activités rémunératrices Comme on l'a indiqué plus haut, la participation du projet ALT/PR au projet de prêt de la Banque mondiale : PSDR, a incité les enquêteurs à s'intéresser aux répercussions des communications, de la formation et des émissions radio sur le succès du PDSR27. Plus spécifiquement, l'étude s'est intéressée aux prêts contractés et si ces prêts étaient parvenus à générer des revenus pour les AC.
La radio semble avoir eu un effet positif sur le nombre de demandes de prêts.
Le changement tangible imputable à la collaboration d'ALT s'est manifesté au niveau du nombre de demandes de prêts : celui-ci a augmenté de 150 %, voire même de 200 %. Des émissions étaient diffusées à la radio FM, que les gens écoutaient et qui ensuite s'adressaient à PSDR pour obtenir le prospectus afin de savoir comment faire pour déposer une demande. (M G. Sop, Responsable des communications PSDR, 2005)
Les émissions d'ALT ont contribué de deux manières : tout d'abord, en aidant à augmenter le nombre d'associations faisant la demande de prêts, et ensuite en informant les membres d'associations des meilleures méthodes d'exploitation de leurs associations et en les tenant au courant des activités de PSDR.
40
Le tableau suivant indique que les demandes de prêts ont augmenté après l'atelier de communication que ALT a organisé avec des agents de communication du PSDR et suite aux émissions radio qu'ils ont produites.
Année Mois 2002 2003 2004 2005 2006
Janvier 1 62 38 59 1
Février 3 79 53 221 0
Mars 2 74 59 67 1
Avril 1 60 39 16 38
Mai 3 59 49 65 10
Juin 4 49 33 75 02
Juillet 9 54 76 50 S.O.
Août 16 56 78 121 S.O.
Septembre 49 86 103 31 S.O.
Octobre 42 145 103 55 S.O.
Novembre 26 62 163. 12 S.O.
Décembre 47 26 61 07 S.O.
TOTAL 203 812 855 779 52
Demandes de prêts d'associations communautaires dans la province de Tuléar (régions d'Anosy, de l'Androy et du sud-ouest)
L'atelier de stratégie de la campagne de communication pour les agents locaux du PSDR se déroula en septembre 2003 à Fort Dauphin. Le nombre de demandes de prêts avant l'atelier est indiqué en noir et les demandes après l'atelier figurent en bleu. Les émissions radiophoniques avaient commencé en avril 2004 et à partir de juillet, on relève une hausse très nette des demandes.
Toutefois, le projet PSDR n'apparaît pas comme une réussite globale. Il a été difficile d'obtenir des chiffres du PSDR, mais on estime que seule une faible proportion (14 % environ) des AC de la province de Tuléar sont parvenues à dégager des bénéfices. Parmi les six AC auxquelles notre équipe d'étude a rendu visite, aucune n'avait rapporté de l'argent. Les petites entreprises, telles que des poules pondeuses, des ateliers de couture, des projets d'apiculture et autres de ce type, ont tous souffert d'un manque de financement à temps, d'insuffisance de conseils techniques ou managériaux et de déficience de suivi sur le terrain28. Il semblerait que le PSDR n'ait pas accordé suffisamment de fonds à la mise en œuvre des activités que le projet ALT/PR avait recommandées. Par ailleurs, les activités de recueil de données ainsi que de suivi et d'évaluation entreprises par le PSDR ont été d'un niveau très médiocre. Il est donc difficile de se prononcer de manière fiable quant à l'impact que le travail de communication engagé par ALT a pu avoir sur les revenus et les moyens de subsistance dans le contexte du projet PSDR.
41
Impact de la radio sur les inégalités entre les sexes
Contexte sur les questions liées aux spécificités de chaque sexe Au sud de Madagascar, la tradition veut que les femmes jouent un rôle très secondaire dans la prise de décisions. Leur statut est très subordonné à celui des hommes et leur statut inférieur a de nombreuses conséquences négatives sur leur éducation, leur santé, leur nutrition et leur espérance de vie. La pauvreté a contraint la plupart des hommes à s'émigrer pendant de longues périodes pour trouver du travail, laissant derrière eux de très nombreux foyers dirigés par des femmes (25 % d'entre eux, d'après le PAM, 2006). Dans une certaine mesure, ALT/PR a tiré parti de cette tendance et encourage les communautés à élire des femmes comme responsables de groupes d'écoute et qu'elles reçoivent les radios à manivelle du projet. Ceci est en parti dû à la présence plus stable des femmes dans le village : elles sont ainsi plus disponibles pour donner au groupe d'écoute accès à la radio à des heures définies. Un autre facteur tient à leur statut au sein de la culture locale, comme l'explique Orengo :
Les questions de statut abondent... Beaucoup d'hommes refusent de pénétrer dans la zone d'un autre villageois pour y écouter la radio car cela équivaudrait automatiquement à accorder à ce dernier un statut plus élevé. Sur le plan culturel, les femmes sont plus susceptibles de circuler d'une zone individuelle à une autre avec moins de gêne, même au risque d'être perçues s'absenter trop fréquemment de leur maison et d'être qualifiées de « femmes à la porte blanche » (en d'autres mots, la porte est toujours fermée car elle n'est jamais là). (Orengo, 2006)
Bien qu'aucune émission radio n'ait été produite s'attaquant directement à la question des relations entre les sexes et les droits des femmes, il ne fait pas de doute que les femmes profitent tout particulièrement de l'accès à la radio. Notre exercice de cartographie de l'information a révélé que les hommes disposent d'un accès bien plus facile à des informations utiles en général, que ce soit au marché local, auprès de leurs amis et voisins, par le bouche à oreille (c'est-à-dire lors de conversations avec des gens hors du village) ou auprès d'officiels locaux. En revanche, le rôle des femmes dans la société et l'ampleur de leur charge de travail sont tels qu'elles disposent de très rares occasions leur permettant de se rassembler et d'échanger des informations entre elles ou avec des hommes qui ne sont pas leur mari ou leurs proches.
Toutefois, notre étude a révélé que le degré moindre d'accès à l'information par rapport aux hommes a été nettement amélioré par la diffusion d'émissions radio.
Le tableau suivant compare 60 femmes de villages ayant peu accès à la radio (VSR) à 74 femmes de villages ayant bon accès à la radio (VAR). Il montre que dans les villages avec peu d'accès à la radio, les « notables » du village étaient plus fréquemment cités comme source d'information sur toutes les questions de développement (75 %). Par contre, dans les villages avec un bon accès à la radio, la radio arrive au premier plan comme source d'information pour le développement, étant citée par 66 % des personnes interrogées alors que seulement 22 % des femmes citent les notables. Il ne fait pas de doute qu'une fois que les femmes ont accès à une autre source d'informations fiable, les « notables » perdent de leur proéminence.
Comparaison des sources d’information pour les femmes dans les VSR et les VAR
-% des femmes issues de VSR (bleu) - % des femmes issues de VAR (rose) - Radio - Notables - Marché - Enseignants - Ami ou voisin - Ombasa - Bouche à oreille - Résident du quartier - Hôpital
Par ailleurs, il était demandé aux femmes de citer les sources d'information sur le développement auxquelles elles pouvaient accéder le plus facilement. La réponse en faveur de la radio était une fois de plus très marquée et, en conséquence directe, l'influence des notables diminuée.
Voir le graphique ci-dessous, acces ‘facile’ aux sources d’information.
- % des femmes issues de VSR (bleu) - % des femmes issues de VAR (rose) - Radio - Notables - Marché - Enseignants - Ami ou voisin - Ombasa - Bouche à oreille - Résident du quartier - Hôpital
Ces constatations révèlent l'impact positif que peut avoir la radio sur la relation entre les sexes, en ce sens où les femmes, qui jusque-là devaient s'en remettre à ce que les hommes, qu'il s'agisse de leurs maris ou des notables, leur communiquent des informations, peuvent maintenant avoir un accès direct et facile à ces informations sur le développement en écoutant la radio. Cette perception de la radio comme source d'information privilégie pour les femmes est apparue dans une autre région, lors de l'étude réalisée à Ejeda, dans la région de Mahafaly (Metcalf, 2006 e.). Lors des 70 interviews effectuées auprès des femmes utilisant les services hospitaliers d'Ejeda, c'est bien la facilité d'accès de la radio qui ressort comme étant la raison la plus importante donnée pour expliquer son utilité en tant que source d'information.
Impact des groupes d'écoute sur les relations entre les sexes
À l'heure actuelle, le pourcentage de femmes au poste de responsables de groupes d'écoute du projet est a 68 % (Vadgama, 2006), et les groupes d'écoute constituent un point de rassemblement important pour les femmes (bien qu'ils soient ouverts aux hommes comme aux femmes). Par ailleurs, le projet accorde la priorité à former son équipe et ses partenaires aux techniques de discussion de groupe, soulignant l'importance de séparer les hommes des femmes pour donner la possibilité aux femmes et aux jeunes hommes de prendre la parole.
42
43
Des témoignages anecdotiques parlent de femmes se trouvant une autonomie nouvelle en étant capables de s'exprimer librement au sein de groupes d'écoute radiophonique. Ces groupes peuvent parfois être l'occasion de soulever des questions délicates sur les rapports entre les sexes. Comme l'une de nos équipes d'étude l'a fait remarquer :
En plus de comprendre les messages de prévention du VIH qu'elles avaient entendus, les femmes d'Andranokinaly [village] ont reconnu que, pour qu'ils soient efficaces, il fallait que ces messages de prévention du VIH soient adoptés aussi bien par les hommes que par les femmes et que cela justifiait de parler aux hommes des risques du VIH et de relations sexuelles non protégées, ce qui est un signe encourageant. Il en est ressorti une impression que les émissions radio ouvrent un espace qui permet aux femmes de discuter de problèmes entre elles, et voire même contribuent à une meilleure communication entre les hommes et les femmes sur les questions de fidélité et de rapports sexuels. (Harford, 2005)
Alors que ALT ne s'est pas délibérément donné pour objectif de changer le système social du village ni sa hiérarchie, il a promu un processus de distribution de postes de radio à la fois transparent et positif entre les sexes au niveau du village (Orengo 2006), dans l'espoir que le fait d'avoir des femmes responsables puisse, sur le long terme, potentiellement influer sur les relations entre les sexes en faveur des femmes.
Impact de la radio sur les affaires sociales et administratives
Contexte sur les affaires sociales et administratives
Lors de la réalisation d'exercices de cartographie des sources d'informations, il a été demandé aux villageois de citer toutes les sources d'informations dont ils disposaient en matière de Fandrosoana, qui est le mot malgache utilisé pour « développement », dont la traduction littérale signifie « aller de l'avant » ou « améliorer la vie », en d'autres mots leur perception de ce qui, d'après eux, est susceptible de réduire la pauvreté. Les sources données étaient écrites sur une feuille et représentées par des photos au profit des personnes illettrées.
Il est apparu clairement qu'ils attachaient tout autant d'importance aux questions administratives et sociales qu'aux questions sur la santé, l'agriculture ou l'éducation. Il est ainsi important de savoir comment obtenir des cartes d'identité, de renouveler les passeports sanitaires pour zébus, de comprendre les listes électorales et de connaître les dates de funérailles et de circoncisions. Ils trouvent cela absolument vital qu'ils puissent avoir des nouvelles de parents qui habitent dans d'autres régions du pays, qu'ils soient informés des conflits de bétail, des alertes de cyclone et de l'augmentation des prix. Beaucoup de ces informations sont données à la radio et les villageois dépourvus de radio sont non seulement démunis matériellement mais aussi démunis d'informations.
Lorsqu'il était demandé aux personnes interrogées d'expliquer leur motivation à appartenir à des groupes d'écoute radiophonique, elles ont indiqué que les groupes jouent un rôle important dans le partage de l'information, tant entre les membres de la communauté qu'avec des membres en-dehors de celle-ci. En effet, l'importance de partage de l'information a souvent été perçu comme étant « l'impact le plus marqué » du projet. Le gain de statut social par l'appartenance à un groupe d'écoute radiophonique est significatif.
Constatations
Lors de l'étude réalisée dans la région de l'Androy, 22 exercices de cartographie ont été entrepris dans 11 villages : deux dans chaque village par petits groupes d'environ six personnes, l'un d'hommes et l'autre de femmes29. Les villages dont l'accès à la radio est faible ou non existant ont été comparés aux villages disposant d'un bon accès. Les cartographies des sources d'information se sont concentrées sur les informations qui, d'après les gens, les aidaient à se développer ou à améliorer leur vie.
Les illustrations ci-dessous sont des exemples de deux exercices de cartographie réalisés par des groupes d'hommes dans les villages d'Ambolirano et de Benonoky. Les hommes y ont représenté leur perception des sources d'information les plus importantes qui se situent au niveau du village (en bas) jusqu'au niveau national (en haut). Le premier village, Ambolirano, dispose d'un bon accès aux émissions radio et donc la radio y figure largement, par rapport au second village, Benonoky, où un seul poste de radio est mentionné, et un de petite taille en plus de cela.
Cartes d'information : Comparaison entre les groupes d'hommes du village d'Ambolirano et du village de Benonoky (la radio est soulignée en rouge)
Les constatations suivantes sont ressorties de cet exercice :
o Les hommes disposent de bien meilleures sources d'information que les femmes, en raison de la migration économique et de leur mobilité sur le plan local (par exemple, les femmes se rendent moins souvent qu'eux au marché). Il est fréquent que les informations reçues par les femmes soient indirectes et qu'elles proviennent de leur mari.
o Dans les villages avec accès à la radio, la radio a été la source d'information citée le plus fréquemment comme étant à la fois la plus importante et la plus fréquente, tant pour les hommes que pour les femmes.
o Les cartes ont révélé que la radio constituait pour les femmes une source directe d'information à la fois porteuse et importante.
o La variété et l'importance des autres sources d'information pour les femmes semblent également être accrues dans les villages avec radio, ce qui laisse sous-entendre que la radio les incite peut-être à rechercher d'autres sources d'information. En effet, les enquêteurs ont remarqué que dans les villages à bonne réception radio, les femmes étaient généralement plus disposées à participer et à donner des informations.
La radio s'affiche clairement comme vecteur fort pour mettre un terme à l'isolement et pour relier au reste du monde les villages reculés. Comme l'ont déclaré des participants à un groupe de discussion à Ankatrafae Mazava :
Grâce au groupe d'écoute radiophonique, le village devient comme une ville et la vie au jour le jour évolue, et les villageois apprennent de nouvelles choses.
44
45
Impacts à plus large échelle en matière de développement du réseau radio PR
Comme on l’a vu dans notre section intitulée « Contexte», ALT/PR assure la coordination d'un réseau de 34 organisations de développement dans l'ensemble de la province de Tuléar30, qui est appelé le réseau des partenaires PCID (Partenaires en Communication et Information pour le Développement).
Une enquête réalisée31 auprès de 28 d'entre elles, représentant 82 % du réseau, a été effectuée ainsi qu'un audit32 de 15 des stations radio partenaires du projet ALT/PR afin de déterminer l'impact et l'influence de ce partenariat. Les résultats ont révélé que les partenaires de Projet Radio ont perçu et relevé des impacts multiples.
L'un des principaux impacts retenus est la hausse de sensibilisation et de compréhension du rôle que peuvent jouer les communications à soutenir, élargir et renforcer les activités d'un projet de développement basé sur le terrain. Peu de partenaires avaient participé à des communications radiophoniques avant de rejoindre le PCID. Il existe désormais 34 ONG et prestataires de services dans l'ensemble du sud de Madagascar capables d'élargir leur portée, par la transmission de l'information et de l'éducation, qu'elles n'auraient sinon pas été en mesure d'assurer sur le terrain pour des raisons de restrictions de personnel, de transport et de temps.
ONG, organisations gouvernementales et autres prestataires de services Lorsque les partenaires ont rendu fréquemment visite aux groupes d'auditeurs cibles et ont travaillé directement avec eux, les agents sur le terrain ont relevé une baisse du temps passé à expliquer ou mobiliser les villageois à participer à leurs projets. Par exemple, PHBM a indiqué qu'il était possible d'économiser jusqu'à 50 % du temps passé par ses agents sur le terrain en diffusant à l'avance des informations sur les activités prévues d'une visite sur le terrain, où les villageois étaient alors désireux et prêts à y participer.
Un porte-parole pour Vola Mahasoa témoigne d'un fait similaire :
Nous n'avons pas pu nous rendre dans tous les villages car nos moyens sont limités ; par exemple, nous ne disposons pas de suffisamment de personnel ni de transports et nous sommes soumis à des contraintes de temps. C'est donc pour nous un gros avantage de travailler avec PR. Notre programme a connu de grands changements depuis que nous sommes membres du PCID.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages similaires, comme par exemple, celui du porte-parole de KIOMBA :
D'un seul coup, toute notre population cible (et même la population non cible) se trouve informée et sa sensibilisation accrue.
Une autre organisation, FAFAFI, a indiqué que depuis qu'elle fait appel à la radio pour diffuser des messages, elle a relevé une augmentation du nombre de ses clients et ASOS, basée à Toliara, a remarqué une augmentation du nombre de produits contraceptifs vendus. Augmentations que ces organisations ont toutes deux attribué aux messages diffusés à la radio.
Le fait que 70 % des organisations du réseau se soient montrées disposées à désigner en leur sein une personne chargée des communications est assurément un signe positif. Les impacts sont positifs à un niveau institutionnel : ainsi, toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire, quelle que soit la durée depuis laquelle elles sont à leur poste, ont pu citer les avantages du projet ALT/PR, faire la liste des impacts et avancer des suggestions, remarques et recommandations. Par ailleurs, presque chaque partenaire souhaite contribuer activement à l'amélioration du réseau et à la poursuite du financement des activités de communication pour ses propres projets.
La principale raison citée pour devenir membre du PCID était le soutien des activités sur le terrain (90 %, soit 25 des 28 partenaires en ont parlé) ; parmi les autres raisons importantes, on retiendra
46
la réalisation d'émissions radio (57 %), l'accès à la formation et à du matériel (46 %) et l'accès à des stations radio (43 %). Six partenaires seulement (21 ) ont mentionné la distribution de postes de radio Freeplay comme raison de se joindre au réseau33
.
Le projet ALT/PR a par ailleurs joué un rôle important à développer les compétences au sein des organisations locales. Il ne fait pas de doute que les compétences radiophoniques se sont renforcées (par exemple dans la planification, la recherche, le développement, l'enregistrement et le montage d'émissions radio), mais il en est allé également de même pour la facilitation sur le terrain et la planification participative. Comme l'indique un porte-parole de Maison des Paysans (MDP) :
Nos agents sur le terrain ont bénéficié de la réalisation d'émissions radiophoniques thématiques et leur capacité a été renforcée en termes d'approches participatives « centrées autour des paysans », après avoir reçu une formation aux techniques de discussions de groupe.
La hausse des revenus pour les stations radio communautaires est un autre avantage du réseau PCID, les prestataires de services locaux ayant été alertés quant à la puissance d'impact de la radio. Nous avons constaté que plus de la moitié des partenaires du PCID font des émissions destinées à être diffusées en-dehors de l'accord du projet PR/PCID ; la plupart d'entre eux payent pour leur temps d'antenne et certains fournissent du matériel aux stations.
Stations radio Les liens que le projet entretient avec ses 17 stations radio affiliées ont été conçus de façon à que chaque partie prenante conserve son indépendance tout en assurant les échanges entre elles pour accroître l'accès aux ressources et à la formation technique, développer la capacité et assurer des diffusions dans les principales zones du projet.
Une étude réalisée en 2005 auprès de 14 stations affiliées à Toliara a révélé que sur les stations interviewées, 83 % indiquent avoir diffusé l'intégralité des émissions sur CD de Projet Radio. Seules deux stations ont reconnu ne pas avoir pu diffusé l'intégralité des CD, du fait soit qu'ils étaient endommagés, soit en pannes d'électricité. 66 % des stations disposent d'un calendrier ou d'un système programmé à l'avance pour diffuser les émissions de PR/PCID et 33 % admettent diffuser ces émissions de manière plus aléatoire (Lellelid, 2005). Près des trois-quarts ont indiqué avoir rediffusé certaines émissions de PR/PCID à la demande des auditeurs (Vadgama 2006).
Toutes les stations ont cité l'éducation, l'information et la communication comme étant l'un des principaux avantages de la collaboration avec ALT/PR pour leurs auditeurs. Le fait qu'elles continuent de diffuser témoigne bien de leur engagement à ce projet, même lorsqu'elles doivent parfois attendre longtemps que leur soit livré du matériel promis par ALT/PR en raison de problèmes d'importation et d'achat. Un tiers des stations du réseau se sont indépendamment aidées les unes les autres l'an dernier, que ce soit par des conseils de gestion, de l'aide technique ou de la dispense de formation ou d'échange d'émissions. Cela atteste bien des rapports très bénéfiques qui se nouent entre les stations en conséquence directe du réseau mis en place.
Le fait qu'à ce jour, aucune perte, vente ou disparition du matériel échangé avec les stations affiliées ne soit survenue constitue un autre indicateur de l'impact positif qu'elles exercent, bien que les problèmes de maintenance restent toujours une priorité pour assurer la durabilité.
47
Notes en pied de page Max Cadji, e-mail du 21
juillet 2006 Interview avec FTU1 (Vadgama, 2006) TSI18, (Ibid) Toutes les citations tirées de
Harford, 2007 Lellelid, 2006 Lellelid, 2006 Niveau 3 signifiant : « Lit relativement sans difficulté des textes plus avancés, bute par endroits.’ Lellelid, 2006
9 Une enquête du CNLS réalisée en 2004 a révélé que 50 % des jeunes de Fort Dauphin revendiquaient avoir eu des relations sexuelles avant l'âge de 16 ans (CNLS, Surveys to study behaviour in Madagascar, 2004, p. 27.)
10 Fatidra ou la pratique des « frères de sang » existe dans toute l'Androy et dans la région d'Anosy, tout particulièrement en zone rurale. Cette pratique autorise la création de confiance entre deux personnes, voire même deux familles. Elle consiste généralement en une cérémonie où deux hommes se font une légère entaille sur le bras à l'aide d'une lance et laisse leur sang se déverser dans un bol d'eau. Après l'avoir mélangé, les hommes le boivent à la petite cuillère. Un autre type de « fatidra » existe lorsque deux hommes se font une entaille au poignet puis se frottent les poignets l'un sur l'autre, le sang se mélangeant d'une plaie à l'autre (Metcalf, 2005)
11 Bureau du docteur en chef, CSB 2 FD, juin 2004
12 QMM SA est un joint-venture conclu entre le gouvernement de Madagascar, qui détient une part de 20 %, et QIT-Fer et Titane Inc qui détient une part de 80 %. Le projet vise à extraire de l'ilménite des forêts du littoral et de la côte du sud-est. L'ilménite est le métal qui produit du dioxyde de titane, agent blanchissant utilisé dans les peintures et dans de nombreux produits industriels et ménagers (comme dans le dentifrice par exemple).
13 ALT comptait 9 partenaires pour ce travail sur le VIH/sida, à savoir : l'Unicef, CLLS (Comité Local de Lutte contre le SIDA), PSI (Population Services International), SALFA, ASOS, PACT, Voron-kodohodo à Tsihombe ; Dr Gervais Raboanason de Site Sentinelle CHD2 à Fort Dauphin, Dr Sahondra Josiane Rakototiana du SSD d'Ambovombe, Dr Razanamihaja et Dr Sahondra Rasoarimanana au dispensaire de SALFA à Fort-Dauphin, Dr Mamytiana Raveloarijaona de Tsihombe CSBII, et Mrs Mamy, qui représentait l'ambassade américaine.
14 Un élément de 25 000 US$, fourni par le PMPS (Projet Multisectoriel pour la prévention du SIDA)
15 Ces émissions n'ont pas été toutes réalisées à Ejeda, comme par exemple les 55 émissions diffusées sur le VIH/sida
comportaient beaucoup des émissions de PR SIDA citées plus haut. 16
Sur-eau est le nom local utilisé pour un produit du chlore qui est distribué dans la région à des prix abordable. 17
Sauf mention contraire, toutes les citations sont extraites de Metcalf, 2005
18
Chaque groupe d'écoute compte deux personnes responsables du poste de radio, de sa disponibilité et de son rangement ; elles sont appelées responsables 19
Voir Metcalf, 2006 a. 20
Cité dans Harford, 2007 21
Cité dans Vadgama, 2006 22
Harford, 2007
3 Voir Johansson, 2005 et Metcalf, 2006 e.
2
4 Hôpital luthérien d'Ejeda, 2004 Activity report for the Technical Commission of the ALFA Hospital 2005
25
Lellelid, 2006 26
Voir Metcalf, 2006 a. 27
Voir Metcalf, 2006 c. 28
Notre enquêteur relève : L'une des associations avait acheté 200 poules pondeuses, il n'en reste maintenant plus que 20 ; une autre avait acheté 160 ruches, dont il ne reste plus que 20 au bout d'un an seulement, qui produisent très peu de miel ; une autre était passée de 200 ruches à 0 ; une autre... était en fait exploitée par la famille du président Fokotany, ce qui est illégal... au bout du compte, il semblerait que le PSDR n'ait fourni à aucune d'entre elles un quelconque soutien technique. (Metcalf, 2006 c.) 29
Voir Metcalf, 2006 a. 3
0 Qui compte maintenant 49 membres avec l'expansion du projet ALT/PR dans la province de Fianara
31 Harford, 2007
32 Lellelid, 2005
33 Les membres du PCID ont distribué au total 800 postes de radio Freeplay entre 2002 et 2005
48
Analyse institutionnelle1
Cette partie du rapport s'intéresse à la structure et à l'organisation d'ALT Projet Radio. L'équipe de l'étude s'attache d'une part à mettre en évidence les aspects de l'approche et du mode de fonctionnement du projet ALT/PR que nous jugeons avoir été innovants ou avoir le mieux fonctionné et d'autre part à indiquer les leçons qui ont été tirées et les défis qui subsistent.
Contenu radiophonique local et pertinent
L'approche du projet ALT/PR s'appuie sur l'idée que :
L'accès à l'information et à une éducation non formelle par la radio peut donner les moyens à des producteurs ruraux illettrés et isolés d'apprendre des façons d'améliorer leur sécurité alimentaire, d'accroître leur niveau de vie et de réduire les effets de l'extrême pauvreté. (Orengo, 2006)
Il n’y a aucun doute que la capacité de déploiement de la radio ajoute de la valeur aux initiatives de développement engagées sur le terrain ; toutefois, ce dont atteste le projet ALT/PR, c'est bien la portée encore plus accrue de la radio lorsqu'elle est à petite échelle et cible des objectifs locaux. Contrairement à de nombreux grands programmes centralisés d'éducation radiophonique, en Afrique et ailleurs, ALT se concentre sur les besoins de l'auditeur au niveau du village. Ainsi, ce qui sous-tend les réussites dont témoigne ce report, c'est la conviction d'ALT/PR que le développement par la radio ne sera réalisable que si la radio opère à un niveau local et propose un contenu pertinent. En conséquence, le projet essaie de veiller à ce que la tonalité, la langue, le format et le contenu soient spécifiques et répondent aux particularités d'un public du sud de Madagascar. En décidant de former des travailleurs de proximité d'ONG à réaliser des émissions radio qui font la promotion des sujets qui les intéressent plus particulièrement plutôt que de suivre la méthode plus ordinaire qui consiste à former des diffuseurs radio à réaliser des émissions sur des sujets dont ils ne sont pas familiers et qu'ils ne connaissent pas, ALT/PR a scellé les fondements de sa réussite.
Aucune émission n'est diffusée si elle ne concerne pas spécifiquement les auditeurs ciblés. Les choix de dialecte, d'accent et des idiomes utilisés par les présentateurs, de musique et de poèmes, font tous l'objet d'un choix minutieux pour attirer les auditeurs. Les stations radio partenaires du projet sont, pour la plupart, de petites radios communautaires diffusant sur de courtes distances sur les ondes FM. Les auditeurs s'identifient tant au messager qu'au message et ont la garantie d'une bonne réception. Les réalisateurs d'émissions d'ONG essaient de faire en sorte que leurs émissions soient vivantes, informées et pleines d'esprit. Cette touche locale est en grande partie la raison de la réussite du projet ALT/PR.
Groupes d'écoute
Un autre élément clé de l'approche de Projet Radio est la participation des groupes d'écoute (actuellement au nombre de 2 322). Les groupes d'écoute permettent non seulement aux villageois d'avoir accès à un poste de radio fiable et communal, mais suscitent aussi des discussions et des échanges de conseils en matière de développement. Dans un nombre de plus en plus important de cas, les groupes d'écoute se sont développés pour former maintenant des associations de développement à part entière. La priorité a été accordée aux femmes comme « présidentes » de groupe d'écoute. Cette approche qui consiste à favoriser un sexe est innovante et elle est importante dans cette région très traditionnelle et isolée de Madagascar.
Avantages du partenariat autour d'un axe triple : partenaires PCID, radios locales et groupes d'écoute
Comme l'explique notre section « Données de base », la structure du projet ALT/PR s'articule autour de la participation et de l'échange de trois groupes de parties prenantes, qui sont également les
49
bénéficiaires du projet : tout d'abord les groupes d'écoute villageois, ensuite les stations FM locales, et enfin les partenaires ONG/OG, organisés dans un réseau appelé partenaires PCID. L'inclusion de partenaires d'ONG/d'OG est tout particulièrement originale. Quand on leur demande quels sont les avantages de travailler avec ALT/PR, les partenaires soulignent l'utilité de la formation régulière à la production radiophonique et la gratuité du temps d'antenne pour les émissions, ainsi que les impacts exercés sur leurs bénéficiaires et l'efficacité de leurs propres projets.
La plupart des projets de développement par la radio se contentent d'établir un rapport à double sens entre les stations radio et les auditeurs. Mais comme Orengo le souligne :
Le projet a toujours affirmé qu'à elle seule, l'éducation à la radio n'est pas capable de modifier le comportement des populations sur le terrain, et qu'il ne sert à rien de diffuser des émissions dans le vide. C'est la raison pour laquelle il est attendu des partenaires qu'ils jouent un rôle si important auprès des groupes d'auditeurs, en assurant des contacts en tête à tête, de la formation et des services qui s'inscrivent en synergie avec les émissions diffusées à la radio.
Travailler avec des prestataires de services locaux a pour avantage additionnel de pouvoir puiser dans leur expertise locale et leur expérience sur le terrain et offre un potentiel bien plus certain de durabilité et de passage de relais, lorsque le moment sera venu pour que ALT se retire de Madagascar.
Un élément crucial du mécanisme d'échange du modèle de Projet Radio consiste en la fourniture de postes de radio Freeplay, qui fonctionnent à l'énergie solaire ou au moyen d'une manivelle, qui ont permis d'augmenter l'accès aux émissions radio par les populations du sud de Madagascar. Ils sont très utiles, car les revenus de ces populations sont souvent trop faibles pour pouvoir continuellement acheter de nouvelles piles. Les groupes cibles sont les producteurs ruraux et les femmes : les postes de radio sont remis à des groupes d'écoute par Projet Radio, que ce soit directement ou par le biais de partenaires. Les partenaires distribuent les postes de radio soit à des groupes avec lesquels ils travaillent déjà, soit à des groupes formés spécifiquement dans le but d'écouter les émissions de développement de PR/PCID.
Ce réseau articulé autour de trois axes développe également la capacité locale des stations radio rurales, des travailleurs de proximité sur le terrain et des agences de développement, pour veiller à ce que les nouvelles techniques et les nouveaux supports de communication restent bien au sein de la région.
Rentabilité
ALT/PR estime toucher environ 500 000 auditeurs sur une population d'environ deux millions d'habitants dans le sud de Madagascar. Les dépenses totales pour PR entre 2002 et la fin 2005 (soit une période de quatre ans) se sont élevées à 1 214 000 €. Si nous supposons que ces dépenses ont été réparties de manière uniforme sur chaque année, alors avec des dépenses annuelles de 303 500 €, ALT/PR a au cours des 4 dernières années touche chacun de ses auditeurs moyennant tout juste 0,62 € par personne par an.
La rentabilité du projet est également attestée par le nombre et la variété formidables d'émissions radio portant sur le développement et l'éducation qui sont diffusées aux auditeurs depuis 1999. En décembre 2006, celles-ci s'élevaient à 1 540 (pour obtenir une liste complète, voir l'Annexe 3).
Si l'on considère qu'au démarrage du projet en juin 1999, il s'agissait là d'une ONG britannique inconnue, ALT a remporté un succès considérable à obtenir du financement et reste confiant de pouvoir maintenir et élargir les activités du projet jusqu'en 2009 au moins.
Le tableau ci-dessous présente les coûts annuels simplifiés aux niveaux actuels (basés sur des projections pour l'an prochain). Les coûts du personnel sur place représentent un peu plus du tiers du budget, les coûts du soutien international et du matériel arrivant à la deuxième et à la troisième place.
50
Exemple des coûts annuels d'ALT/PR
Details Euros (€) Coût par an % du total du budget du projet
Studio de production 20 205 8,3
Coûts des bibliothèques locales 1 980 0,8
Réunions de partenaires (3 par an) 4 712 1,9
Formations des partenaires (3 par an) 6 700 2,8
Maintenance technique 1 332 0,5
Ingénieur technique international 3 132 1,3
Frais de matériel : pour les stations et les partenaires 33 383 13,7
Frais de personnel et d'exploitation pour assurer le soutien des activités sur le terrain 93 628 38,5
Frais de soutien international, y compris les participations britanniques (achats, assurance, etc...), travail de consultant et déplacements à Madagascar
69 335 28,5
Postes de radio GE : coûts de réparation et de remplacement 990 0,4
Véhicule du projet 7 504 3,1
TOTAL des coûts annuels 242 900 100,00
Défi posé par l'expansion
Il ne fait aucun doute que le projet ALT/PR a connu une expansion rapide et que, dans certains cas, n'a pas été en mesure de répondre à la demande. ALT a dû faire la part des choses entre la qualité (agissant dans une région restreinte) et la quantité (sur une région plus élargie). Le projet n'a parfois pas toujours réussi à garantir la qualité de toutes les émissions radio et de leur suivi dans la mesure qu'il aurait souhaitée. Comme le dit Orengo :
[Le projet a connu] une demande écrasante tant de la part des bénéficiaires du projet que des parties prenantes sur le plan régional et national qui, jusqu'à présent, est bien supérieure à la capacité du projet de répondre à tout ce que demandent ou requièrent les communautés qu'il essaie de desservir.
Au cours de la première phase, la structure de base de PR consistait en une petite équipe implanté dans une seule région, l'Androy, qui avait installé un studio et noué des liens localisés dans la région avec des ONG, des prestataires de services, stations radio et groupes d'écoute.
51
Puis en 2002, le projet a commencé à s'élargir à trois autres provinces (Vezo, Mahafaly et Antanosy), aussi bien pour répondre aux demandes locales que pour satisfaire les exigences de son principal bailleur de fonds, la Commission Européenne.
Toutefois, les ressources nécessaires pour reproduire la structure et les activités de base dans l'ensemble de ces régions n'existaient pas encore. Certaines régions étaient entièrement dépourvues de stations FM/couverture radiophonique et aucune installation de production radiophonique n'y existait.
ALT a été, en quelque sorte, victime de sa propre réussite. Par exemple, le projet a été porté à la connaissance d'agences nationales telles que le CNLS (Comité National de Lutte Contre le SIDA) et l'Unicef, ce qui a abouti à un ajout important en matière de formation et d'émissions radiophoniques sur les thèmes du VIH SIDA. Ce surplus de travail a eu pour conséquence positive un accroissement des ressources mises à la disposition d'ALT et de ses partenaires. Toutefois, devant le nombre supplémentaire de contrats de sous-traitance et de personnel, il a inévitablement fallu diluer le temps passé au management.
Le rôle d' Orengo en tant que chef de projet entre 1999 et 2005 était par moments surmené en raison de ses multiples responsabilités au sein d’ALT, et il était inévitable que certains domaines de la gestion et du développement du projet s'en ressentent. Par exemple, parallèlement à la charge de concevoir et mettre en œuvre les activités du projet, c'était à elle également que revenait la responsabilité de développer ALT, sa stratégie programmatique globale et ses activités de collecte de fonds (environ 4 M€ pour 10 ans).
PR a donc dû passer un temps considérable à installer l'infrastructure, assurer la formation et obtenir des fonds supplémentaires. De par la taille colossale de la région couverte, les distances entre chaque base du projet ALT et les centres de production, et la difficulté de communiquer avec un grand nombre de partenaires et de stations radios, une grosse partie de la deuxième phase d'activités s'est attachée à pourvoir aux nécessités élémentaires d'améliorer l'accès aux diffusions radiophoniques et de répondre aux besoins de formation et de soutien des partenaires à des fins de production radiophonique.
En plus de l'intérêt accru pour la radio et de sa demande renforcée, sur le plan du développement, il a fallu :
o Doubler le nombre de partenaires envisagés devant passer du temps avec le formateur principal
de PR dans 4 régions
o Réaliser des émissions pour le double du nombre de partenaires à partir d'un seul studio jusqu'en 2004
o Demande accrue pour l’evaluateur du projet o Multiplier de manière exponentielle le nombre de groupes d'écoute établis simultanément aux
quatre coins de la province o Accorder moins de temps et de ressources disponibles pour travailler étroitement avec groupes
d'écoute o Identifier et développer la capacité et les partenariats avec près du triple des stations radio
envisagées o Lancer deux nouvelles stations radio et en moderniser au moins 3 autres, tout en assurant le
soutien technique de 17 d'entre elles. o Assurer le suivi des impacts tout en disposant de moins de ressources o Accorder moins de temps pour améliorer la qualité du contenu des émissions et les formats
utilisés Ainsi, maintenant que l'infrastructure nécessaire est établie dans l'ensemble de la province de Tuléar, le projet est en train de se recadrer pour établir le modèle original et de base dans chaque région concernée. Il s'agit dorénavant de développer les relations et les compétences au sein de chacune des quatre unités de production régionale.
52
En d'autres mots, le projet est en train de renforcer sa structure de base, en s'appuyant sur les leçons qui ont été tirées depuis 1999, et avec :
o Une infrastructure améliorée o Des accords, pratiques et engagements établis avec le PCID o Des membres du PCID formés à la production d'émissions o 33 partenaires PCID équipés d'appareils d'enregistrement désignés o Plus de 2 300 groupes d'écoute en place et 1 220 autres postes radio prêts à être distribués à
d'autres groupes d'écoute o Six installations de production en place o Une équipe plus expérimentés de formateurs, producteurs et éditeurs o Quatre évaluateurs d'émissions radio locaux formés pour chaque région o Du soutien des agences nationales, par exemple des radios venant du CNLS
Voici ce qu'en pense Orengo :
Parce qu'ils comprennent désormais suffisamment le projet, ses avantages et la part qu'ils ont à y jouer, les partenaires et les stations radio vont pouvoir se sentir plus engagés et mieux se l'approprier.
Défis présentés par le contexte
Trois défis se détachent plus spécifiquement : la diversité linguistique, la mauvaise infrastructure et les problèmes de capacité locale
Langues Bien qu'il règne à Madagascar une philosophie sur le thème « un peuple une langue » (Merina ou langue « officielle »), les dix-huit groupes ethniques parlent chacun des dialectes distincts ; plus particulièrement dans les zones rurales et côtières, ce sont ces langues qui sont principalement utilisées et comprises.
En conséquence, les émissions du projet ALT/PR sont maintenant regroupées sur des CD distincts, en fonction des groupes ethniques de l'Androy, d'Anosy et de Vezo (qui inclut aussi Mahafaly) entre Ft Dauphin, sur la côte sud-est, jusqu'à Tuléar sur la côte sud-ouest. Cette division permet d'améliorer l'échange d'informations au sein de la région et apporte de la valeur ajoutée aux auditeurs mais a pu, toutefois, exercer des contraintes en matière de temps et de ressources du projet avant que les unités de production locale ne soient créées.
En attendant, certains partenaires du projet ont opté de programmer leurs messages pédagogiques dans la langue « officielle », en dépit de la formation reçue par ALT et bien qu'il ait été prouvé que les émissions réalisées dans la langue locale sont plus populaires et exercent un impact plus fort et des résultats meilleurs auprès des populations villageoises.
Mauvaise infrastructure Les niveaux médiocres de l'infrastructure présentent de nombreux défis. Malgré la libéralisation des télécommunications à Madagascar, (par ex. : des services de téléphones mobiles sont disponibles à Tuléar et Ft Dauphin depuis 2003), les communications avec les zones rurales se font encore en majorité par le biais de messages écrits envoyés par taxi-brousse. En raison de la mauvaise qualité des routes et de l'absence de lignes téléphoniques sur une grande partie de la province, il est difficile sur le plan logistique et très demandeur en temps d'assurer la coordination de 60 employés répartis entre six bureaux et d'essayer de réunir les 49 partenaires locaux pour qu'ils participent à des réunions régulières, alors que beaucoup ne possèdent ni véhicules ni carburant, sur une zone à peu près équivalente au sud de la France (mais sans la qualité de son réseau routier). Si l'on ajoute à cela la nécessité de distribuer des postes de radio dans les villages, de créer et d'assurer le suivi de 2 322 groupes d'écoute, le défi se présente sous toute son ampleur.
53
Un peu plus du quart des stations radio partenaires citent les retards de livraison de matériel comme étant la partie la plus difficile de la collaboration avec PR ; près du quart des autres stations citent les retards de communication et d'arrivée des CD comme étant un problème.
Assurer la couverture radiophonique est elle aussi problématique. ALT/PR décida très tôt qu'il serait plus stratégique et plus durable de travailler avec des stations existantes, plutôt que d'en créer ou d'en bâtir de nouvelles. Mais en raison des maigres ressources du secteur radiophonique rural, il est apparu très rapidement qu'il était nécessaire de développer la capacité des stations et d'améliorer la plage de couverture des signaux.
L'élargissement de la couverture radio figure parmi les réussites d'ALT/PR, toutefois celui-ci a relevé d'un défi de taille du fait que la majorité des stations radio au sein de la zone du projet sont un mélange d'entités privées, nationalisées ou d'ONG locales, présentant un degré varié d'expérience, de ressources et de compétences. Bon nombre de stations FM indépendantes ont du mal à assurer leur gestion financière et à accéder aux équipements et pièces de rechange pour les réparer. Les compétences requises pour assurer l'entretien et l'exploitation professionnelle des stations sont très mauvaises dans les régions rurales. Les journalistes des stations rurales sont souvent mal éduqués et manquent de formation, tant en termes de production que de maintenance technique. Les employés ont tendance à être sous-payés ou à travailler de manière bénévole et il n'est donc pas rare qu'ils changent fréquemment, et qu'ainsi la formation reçue soit perdue.
De même, les compétences techniques sont mauvaises et même en ayant été formés, les employés de la station font des erreurs de réglage technique, au détriment de la puissance de diffusion ou de sa qualité. En conséquence, les performances des stations et leur capacité à maintenir les nouveaux niveaux de couverture FM continuent de poser problème. Beaucoup de stations en sont venues à percevoir PR comme leur source principale de soutien pour tous leurs problèmes techniques, position qui est aussi irréaliste qu'intenable.
Questions de capacité locale Au sud de Madagascar, les membres du projet expérimentés et ayant reçu une formation professionnelle sont peu nombreux ; ceux qui sont fiables et éduqués sont farouchement convoités par les différentes agences de développement locales. Le recrutement de personnel relève donc d'un défi considérable et la formation constitue un élément primordial du travail au sein du projet, tant en interne qu'en externe. Parmi l'équipe de projet actuelle, quatre personnes seulement avaient suivi une formation en communications ou en techniques de production avant de se joindre au projet. Utiliser la radio comme outil de développement relève une expérience nouvelle et sans précédent qui en est encore à ses balbutiements pour un grand nombre des membres de l'équipe, .
Le projet s'est appuyé sur la contribution du chef de projet et de consultants externes (la plupart des expatriés) pour apporter la formation, l'expérience et l'expertise nécessaires afin de développer la capacité de l'équipe de projet et de ses partenaires. Malgré tout, la formation par les expatriés à la production radio a développé suffisamment de capacité depuis 2005 pour que les ateliers de formation puissent être gérés sur place.
Défi de participation
C'est en s’inspirant du cycle de production participatif (CPP) (voir le diagramme à la page 3) que les émissions radio sont censées être réalisées au sein d'ALT/PR. Toutefois, son bon fonctionnement n'est pas sans soulever certaines difficultés.
Le CPP devrait s'assurer que les émissions répondent aux besoins du public et le font participer au niveau de la recherche, de la collecte d'informations, de la réalisation des émissions et de l'évaluation. Et pourtant, l'élan provient toujours de l'extérieur : en effet, le format des émissions et leur contenu sont largement déterminés par les ONG partenaires et les stations radio, puisque ce sont elles qui maîtrisent le processus de la réalisation des émissions et de leur diffusion. Il subsiste donc toujours un maillon manquant entre les besoins perçus et exprimés des communautés et le contenu réel des émissions.
54
Étant donné que les partenaires produisent des émissions en s'appuyant sur leur expertise et discipline de développement propre, il devrait être dans leur intérêt d'aller régulièrement rendre visite aux GE pour catalyser les débats et l'intérêt pour les messages et les activités dont ils sont responsables. Pour les GE, leur présence devrait être l'occasion de soulever d'autres questions sur d'autres thèmes et de demander de l'aide en matière de formation. Dans l'idéal, ces demandes devraient être envoyées à ALT/PR qui pourrait se charger de les relayer au partenaire concerné. Ce n'est cependant pas encore le cas en raison de tous les problèmes de logistique, de capacité de personnel et de restriction de temps qui ont été mentionnés.
Par ailleurs, la couverture radiophonique et l'engagement à des principes participatifs restent aléatoires. Le projet a été présenté et expliqué de manière très approfondie dans certains villages, alors que d'autres ont tout simplement reçu le poste de radio comme motivation à participer à une initiative sanitaire ou de conservation menée par un partenaire, sans aucune explication complète du rôle d'ALT/PR ou du groupe d'écoute.
Comme nous l'avons indiqué, 82 % des groupes d'écoute font part d'écoute communale régulière, mais seulement 47 % d'entre eux ont reçu une visite de leurs partenaires PCID au cours de l'année passée. 5 % des groupes d'écoute ont indiqué avoir participé à des enregistrements d'émissions et 3 % à des pré tests, insuffisance qui s'est traduite par l'absence de « voix villageoises » dans beaucoup d'émissions de partenaires. Maintenir des groupes d'écoute et nouer des liens soudés avec eux nécessite d'y consacrer du temps et des ressources sur des grandes régions géographiques.
Nous avons également remarqué que peu de partenaires procèdent régulièrement à l'évaluation active de leurs propres émissions (29 % affirment réaliser des pré tests de leurs émissions sur le terrain auprès des groupes d'écoute), et pourtant, comprendre l'impact d'une émission fait partie intégrante du processus d'apprentissage et des liens avec les GE et constitue un aspect primordial pour mieux comprendre les messages et les méthodes d'aborder les communautés villageoises.
Orengo fait peut-être preuve de réalisme quant au degré idéal de participation auquel on peut tendre :
Bien que le projet ne soit pas parvenu à inclure les villageois dans tous les aspects de la réalisation d'émissions et du développement du projet, il implique les partenaires locaux et les stations locales qui, eux aussi, représentent la communauté locale. Ce sont bien ces membres actifs de la région qui offrent le plus grand potentiel de durabilité du réseau et qui, par leur participation, s'approprient véritablement des communications radiophoniques comme moyen de développement dans le sud de Madagascar.
Défis de la mise en réseau
Comme nous l'avons vu, ALT/PR assure la coordination d'un réseau complexe de parties prenantes articulées autour de trois axes : villageois, directeurs d'ONG, stations radio FM communautaires, chacun nécessitant des niveaux et des types différents d'attention et de soutien. Bien qu'elles le manifestent de manière relativement informelle, toutes les parties prenantes du réseau ont des engagements, objectifs et attentes qui leur sont propres qui demandent à être satisfaits. En qualité de facilitateur principal de ce réseau, l'équipe d'ALT/PR doit faire preuve de compétences de haut niveau pour négocier avec les partenaires et les bénéficiaires à chaque étape du processus de mise en réseau ; elle doit en outre faire preuve d'une très grande souplesse, tout en intégrant des promesses et des attentes dans les calendriers et les budgets du projet.
Par exemple, il faut compter parfois jusqu'à 12 mois pour former pleinement et prendre en charge un coordinateur régional, capable de maîtriser tous les différents éléments du projet afin d'être en mesure d'organiser des activités à un niveau régional ainsi que gérer une douzaine de partenaires et un minimum de trois stations radio.
55
Pour animer le réseau, PR doit organiser :
o Des réunions semestrielles du PCID o Des tables rondes annuelles des stations radio o Des réunions trimestrielles des unités de production régionales o Des réunions régulières avec les agents de communication o Des déplacements sur le terrain pour assurer le suivi des stations radio o Des visites régulières auprès des groupes d'auditeurs
Le maintien de ce réseau nécessite un plan de travail global clairement établi, une orientation, de la formation ainsi qu'un cadre (une équipe) administratif, logistique et financier bien organisé, qui se chargera d'assurer le soutien centralisé des unités de production régionales.
Jusqu'à présent, ALT/PR a extrêmement bien rempli cette fonction, mais il ne faut pas pour autant sous-estimer la tâche de la mise en réseau, tout particulièrement dans la perspective du développement du projet dans la Province de Fianarantsoa et des plans eventuels pour l’avenir de projet ALT à Madagascar.
Défi de durabilité
Le projet se donne pour but de se retirer du réseau d'ici 2010. L'objectif visé est que le PCID fonctionne de manière autonome et fasse appel de manière ponctuelle aux services d'ALT, qui pourrait parfois être cofinancés, mais dont la tendance serait que les partenaires assument progressivement la charge financière des activités.
Pour que cet objectif soit réaliste, il faut que les partenaires reçoivent du financement, que les stations radio rurales restent viables et maintiennent leur couverture radiophonique et que la gestion globale soit assurée.
Finances Certains partenaires démontrent qu'ils sont à la fois désireux et capables de trouver au sein de leurs opérations existantes des financements pour les communications : 64°% des PCID ont déclaré avoir des budgets de communication figurant parmi les propositions qu'ils soumettent à leurs propres bailleurs de fonds. Cet engagement de la part des partenaires du PCID atteste d'un profond changement par rapport aux débuts du projet et témoigne bien de l'importance perçue des communications radiophoniques comme soutien au développement.
Quelques chiffres bruts indiquent qu'en termes financiers, cet objectif pourrait être réalisable : si les frais de diffusion sont inclus dans les coûts de mise en réseau des partenaires locaux, et s'ils maintiennent aussi une unité de production locale, une seule région comptant trois stations radio (à titre d'exemple) aurait à trouver un minimum de 14 176 € environ par an pour couvrir ses frais de fonctionnement. Si les coûts de cette unité de production régionale étaient répartis entre douze partenaires, cela correspondrait à 1 181 € par an par partenaire, soit seulement 98 € par mois.
Diffusions radiophoniques rurales Assurer la durabilité de la radio rurale et communautaire soulève un problème dans toutes les zones rurales, en raison des possibilités publicitaires qui sont restreintes ainsi que des problèmes d'octroi de licence et réglementaires. En conséquence, la viabilité sur le long terme des stations rurales du sud de Madagascar n'est pas forcément garantie. Orengo se montre cependant optimiste et remarque que :
En réalité, les stations survivent avec très peu d'aide du PR (un seul appareil est échangé une fois tous les deux ans).
Le projet a déjà annoncé qu'il envisage, sur le long terme, de confier le réseau aux partenaires et aux stations radio sur le terrain. Il a négocié de nouvelles conditions avec le PCID et les stations radio, qui visent à garantir la propriété et le bon état matériel du réseau, et a insisté auprès de toutes les parties
56
prenantes de l'importance d'assurer l'entretien des ressources.
Les stations sont déjà en train de s'associer de manière plus soudée sous le nom des 3R (Réseau Radio Rurale) et les partenaires du PCID ont convenu de s'impliquer plus étroitement dans le soutien du réseau, y compris en payant pour les temps d'antenne, en désignant des agents de communication à temps plein, en se montrant disposés à aider à trouver des financements pour des équipements et en travaillant aux calendriers de programmation en étroite collaboration avec les stations.
En attendant, ALT/PR va continuer a apporter son aide pour renforcer la capacité de gestion et en identifiant des formateurs spécialisés dans des sujets pertinents, comme l'auto-finance, le développement de connaissances techniques et la maintenance. Par ailleurs, le projet espère travailler avec une agence locale pour poser des panneaux solaires et de meilleurs pylônes d'antenne dans toutes les stations radio afin d'offrir une meilleure couverture radiophonique. Les coûts d'amélioration de la couverture radiophonique vont être analysés.
Certaines régions bénéficieront automatiquement des investissements que consacrent des acteurs communicants de plus grande envergure, comme des hommes politiques et des églises par exemple, au secteur radiophonique. La radio rurale est en expansion a Madagascar et l'attitude du gouvernement vis-à-vis les communications est actuellement ouverte et positive. La scène médiatique est en train de changer à une telle vitesse qu'il est impossible de prédire dans quelle mesure la situation se sera améliorée d'ici cinq ans.
Gestion ALT/PR va devoir déléguer et décentraliser la gestion du réseau PCID. Le renforcement des unités de production régionale va permettre aux stations de s'impliquer plus directement dans le financement d'offres de la part des partenaires du PCID, qui peuvent alors les inclure dans des propositions de modernisation d'équipements et les engager dans des activités d'émissions et de production.
La question des studios de production qui appartiennent actuellement à ALT reste encore à résoudre. Une option possible consiste à en transférer la propriété aux stations radio. Toutefois, les partenaires de PCID ont indiqué clairement qu'ils voient un rôle pour que l'équipe d'ALT/PR continue d'agir en qualité de facilitateur du réseau et de fournir de la formation, du soutien technique et organiser des réunions de table ronde. À cet égard, il est possible que les studios deviennent l'unité locale de facilitation pour les partenaires et les stations- servant ainsi de vecteur neutre capable de les aider à financer des offres, des formations, et du travail de production et de liaison- un rôle qu'ils sont de plus en plus encouragés à assumer. En attendant, le nouveau réseau PCID est en train d'être lancé à Fianarantsoa et s'avère déjà un indicateur utile de ce que l'avenir nous réserve. Après le lancement de PR dans la nouvelle province en 2005, 12 partenaires et cinq stations se sont déjà associés pour la production et la diffusion d'émissions. N'ayant pas le bénéfice des années de soutien de PR, ils sont déjà en train de discuter des moyens pour assurer eux-mêmes le réseau futur : c'est là certainement un bon signe.
Notes en pied de page 1
Pour cette section, l'équipe d'étude s'est appuyée lourdement sur l'analyse institutionnelle d'Yvonne Orengo, la conseillère technique d'ALT/PR, intitulé Institutional Review of ALT/Projet Radio, 2007, disponible sous forme d'un document séparé.
2
L'équivalent d'environ 0,40 GBP aux taux de change actuels.
Forces, faiblesses, opportunités et contraintes du projet ALT/PR
NIVEAU auquel les facteurs opèrent Analyse SWOC
Interne : Projet Radio et ALT Externe : partenaires et auditeurs Structurel : contexte politique et économique, environnement du bailleur de fonds
Forces : Facteurs contribuant actuellement à la réussite du modèle Projet Radio
- Le développement et l'application de la méthodologie du Cycle de production participatif (CPP) qui veille à ce que la programmation réponde à des besoins et ait une résonance auprès du public. - Une équipe de personnes engagées et expérimentées, constituée au cours de plusieurs années. - Le projet a bénéficié d'un soutien constant et de l'expertise technique de consultants et de bénévoles. - Le personnel d'ALT et son projet sont bien respectés sur le plan local. - ALT a établi une présence dans la région et de bons antécédents et a déjà augmenté sensiblement l'accès aux communications dans la région. - Grand réseau de partenaires intéressés et d'un grand secours (groupes d'écoute, stations radio et membres du PCID). - Vif intérêt manifesté par les villageois vis-à-vis du contenu radiophonique. -Les organisations du PCID sont bien placées pour réaliser des émissions pédagogiques, en raison de leurs connaissances et de leur expérience spécialisées. - Les initiatives des partenaires s'étendent sur tout l'arc sud et leur présence contribue à couvrir de grandes distances géographiques pour l'élargissement du modèle. - La mise en réseau de stations radio garantit une large couverture des signaux.
- L'approche et l'expertise de Projet Radio sont sollicitées et influentes sur tout le territoire de Madagascar. - Un gouvernement et des bailleurs de fonds d'un grand secours. - Un gouvernement plus ouvert, un intérêt grandissant pour les communications et les médias dans le pays, faisant l'objet d'un soutien accru.
Faiblesses :Facteurs qui limitent actuellement la réussite du modèle Projet Radio
- La capacité de gestion et administrative est continuellement poussée à ses limites. De l'aide technique externe reste nécessaire (Projet Radio n'est pour le moment pas capable d'être 100 % malgache). - Les cadres supérieurs de direction sont trop rares pour pouvoir toujours assurer la qualité des émissions, le suivi et l'impact sur le développement des émissions radiophoniques. - Des carences de soutien et de suivi de la part des partenaires du PCID auprès des villageois. - Les membres disposent d'un temps limité pour s'engager de manière proactive à la réalisation des émissions avec les groupes d'écoute. - Les ressources limitées des partenaires restreignent le nombre de démonstrations pratiques qu'ils peuvent assurer pour venir étayer les émissions radiophoniques et fournir aux auditeurs des conseils à mettre en pratique ou de la formation. - Faiblesse des niveaux de compétence dans les stations radio rurales. - Des partenaires toujours relativement récents dans le domaine des communications utilisées pour le développement : nécessité d'améliorer l'expertise et les compétences. - Le Cycle de Production Participatif n'est pas toujours observé correctement. - La qualité des émissions est irrégulière.
- L'effet de la situation mondiale sur les budgets. Par exemple, USAID a récemment réduit son programme et son budget de gouvernance, qui comportait un élément important en termes de communication
57
NIVEAU auquel les facteurs opèrent
Analyse SWOC Interne : Projet Radio et ALT Externe : Partenaires et auditeurs
Structurel : contexte politique et économique, environnement du bailleur de fonds
Opportunités : Facteurs susceptibles de contribuer potentiellement à la réussite du modèle Projet Radio ainsi qu'à la durabilité des activités et de l'impact du projet
- L'expansion à la province de Fianar va apporter la possibilité de reproduire le modèle et de le peaufiner ; elle sera également l'occasion de déterminer les aspects à adapter en fonction de circonstances différentes et les moyens pour parvenir à cette adaptation. -Projet Radio pourrait au bout du compte devenir une ONG malgache, capable de lever ses propres fonds et de continuer à jouer un rôle clé au niveau des initiatives de développement basées sur les communications à Madagascar. - Un nouveau stagiaire pourrait être recruté pour aider au développement de la capacité de production des stations et des partenaires (par exemple en travaillant avec des groupes d'écoute et avec les unités de production locales pour les aider à faire des demandes de bourses).
- La demande croissante de formation à la production de la part des stations radio aura pour effet d'accroître les compétences de réalisation d'émissions et pourrait se traduire par une plus grande participation de la part des diffuseurs locaux à réaliser des émissions pertinentes vis-à-vis des besoins de leur public. - Le renforcement de la concurrence entre les stations radio dû à leur prolifération pourrait se traduire par un accroissement de la qualité et de la quantité des émissions en vue d'attirer du public et de le fidéliser. - Les stations commencent à formaliser les opportunités d'ouverture du réseau pour obtenir des soutiens à l'échelon international ou national. - Potentiel de créer des liens plus étroits entre les studios au sein des cinq régions/stations partenaires de la province de Toliara et les partenaires du PCID, décentralisant ainsi le rôle de PR et accordant davantage d'autonomie aux sous-groupes qui composent le PCID en matière d'élaboration de politiques et de pratiques. - Il se peut que les partenaires soient disposés à apporter une plus forte contribution à l'avenir pour assurer la poursuite des activités initiées par PR (formation, fourniture d'équipements, etc...). - Le fait que les partenaires de PCID soient disposés à intégrer des budgets de communication dans leurs propres propositions aux bailleurs de fond contribuera à la durabilité de la réalisation d'émissions et à la diffusion de matières ayant trait au développement. - Expansion et développement du réseau de PCID : de nouveaux membres se sont joints, ce qui pourrait apporter un nouveau souffle au réseau, davantage de ressources et pourrait faciliter les contacts entre les membres. - Nouvelles stations radio à établir avec le soutien des membres existants du PCID, comme par exemple WWF (à Itampolo).
- Dans la plupart des régions, il n'existe pas d'alternative à la radio comme moyen de communication de masse. - Présence d'une forte culture orale. - Environnement de politique favorable à la diffusion. - Autres bailleurs de fonds intéressés à apporter du soutien à des projets radio, comme par exemple le nouveau programme d'hygiène publique de l'Unicef financé par ADB, qui a une composante radiophonique. - Période de relative stabilité politique, peu de signes de l'imminence de troubles civils. - Décentralisation de l'administration : il est prévu que les districts reçoivent un financement directement de la CE, ce qui viendra gonfler les budgets des autorités locales, au détriment de l'infrastructure qui souffrira de la lenteur de la distribution auprès des régions des fonds du gouvernement central. - Les districts pourront déterminer le type d'assistance technique dont ils ont besoin et les payer directement. ALT prévoit de bâtir des liens avec les responsables de districts en 2007.
58
NIVEAU auquel les facteurs opèrent Analyse SWOC Interne : Projet Radio et ALT
Externe : Partenaires et auditeurs Structurel : contexte politique et économique, environnement du bailleur de fonds
Contraintes : Facteurs susceptibles de limiter potentiellement la réussite et la durabilité du modèle de Projet Radio
- Les employés clés risquent de partir pour des postes mieux rémunérés dans d'autres organisations (y compris partenaires).
- Certains partenaires du PCID pourraient avoir du mal à employer du personnel de communication à plein temps, particulièrement les ONG locales disposant de ressources limitées. - Les stations radio s'appuient trop sur le soutien technique de PR, créant ainsi de la dépendance et limitant la durabilité. - Certaines stations radio risquent de devenir trop ouvertement politisées (comme cela s'est déjà produit par le passé), contraignant PR à briser des liens et à réduire la couverture des émissions de PR/PCID.
- Ampleur considérable de la zone d'intervention, des langues différentes et de nombreux partenaires impliqués. - Le gouvernement de Madagascar continue de négliger le sud, ce qui se traduit par une lenteur des améliorations apportées à l'infrastructure, un manque d'opportunités pour les personnes qualifiées et la fuite des cerveaux qui en découle, vers la capitale et ailleurs. - Nature imprévisible du financement international, Madagascar n'ayant pas d'importance géopolitique et n'étant donc pas une priorité pour les bailleurs de fonds dans la crise que connaît actuellement le monde, malgré le risque réel d'une forte hausse de l'infection du VIH/sida. - Caractère probable des catastrophes naturelles, particulièrement des cyclones et des sécheresses, réduisant les gains en matière de moyens de subsistance, de santé et d'éducation réalisés grâce à l'accès à l'information et à l'éducation. - Les impacts sociaux, économiques et politiques de la nouvelle mine d'ilménite en cours de construction près de Fort Dauphin pourraient se répercuter sur les opérations d'ONG locales, comme ALT par exemple, et introduire, voire exacerber, la vulnérabilité à des menaces au développement, comme le VIH/sida par exemple, à laquelle la population locale est très sensible.
59
Discussions et recommandations
Comment le projet ALT/PR se porte-t-il par rapport à d'autres projets radio ?
ALT/PR est l'un des nombreux projets de communication mis en œuvre dans les pays en voie de développement qui ont reconnu la faculté de la radio à atteindre des communautés pauvres et a capitalisé dessus. Parmi les plus connues, on peut citer Soul City, la série dramatique de longue date en Afrique du Sud, la série de gouvernance de la BBC au Nigeria intitulée Story Story, la radio communautaire Mahaweli au Sri Lanka, Search for Common Ground’s Talking Drum Studios en Sierra Leone et les clubs Development Through Radio (DTR) du sud de l'Afrique1.
La particularité du projet ALT/PR tient à la manière dont il choisit de ne pas diffuser directement ses émissions radiophonique ni de les produire en exclusivité, mais en revanche d'assurer la coordination d'un partenariat articulé autour de trois axes : les stations radio, les communautés et les prestataires de services locaux. Cela permet ainsi à ALT de tirer parti de l'expertise en matière de développement que possèdent les prestataires de services (par exemple des agronomes, travailleurs sociaux, éducateurs, etc... qui sont qualifiés pour réaliser des émissions radio) en vue de garantir un contenu de bonne qualité, en temps voulu et pertinent, tout en renforçant également les stations radio rurales et en plus en donnant la parole aux communautés. En attendant, grâce a la radio le travail du gouvernement local et des ONG est facilité et élargi, leur couverture d'agissement auprès de leur public rural étant bien plus importante et approfondie que s'ils ne devaient s'en remettre qu'à leurs activités terrestres. Par ailleurs, ALT/PR se construit dans le même temps une stratégie de sortie pour lui-même, car d théorie, son rôle de coordinateur peut être assumé par le réseau qu'il a créé.
PR coordonne la production d'un CD mensuel comportant les émissions des partenaires et qui est envoyé à toutes les stations radio participantes ; il s'agit là d'un modèle idéal pour entrer en contact avec des diffuseurs éparpillés sur de très grandes zones géographiques, en leur envoyant des matériaux qui, eux-mêmes, sont développés par des producteurs différents, tout aussi distants géographiquement les uns des autres. C'est presque un miracle que le projet soit parvenu à maintenir sa cadence, en dépit d'infrastructures déficientes dans les domaines des transports et de la communication. Cette façon de procéder permet en outre d'assurer le contrôle qualité, sans pour autant avoir à se déplacer auprès de chaque partenaire (cette fonction est désormais décentralisée à chaque région).
En termes de rentabilité, le projet ALT/PR produit de bons résultats par rapport à d'autres projets. Par exemple, l'un des projets DTR en Afrique du Sud (Malawi DBU2) travaille avec un budget plus ou moins similaire (environ 317 000 USD par an), mais ne compte que 56 clubs d'écoute par rapport aux 2 322 groupes locaux d'ALT (bien qu'au Malawi, il y ait plus de contacts entre le personnel et les communautés). Lorsque l'on fait la comparaison avec d'autres projets qui envoient du contenu à des stations radio, comme le projet Search for Common Ground, en république démocratique du Congo3, le budget annuel d'ALT en matière de personnel et de frais généraux apparaît tout particulièrement rentable, car ALT est en mesure de transférer une grande partie de la rédaction de scripts et de la production à ses partenaires, c'est-à-dire au réseau PCID.
Même sans le comparer à d'autres projets, le coût annuel par bénéficiaires du projet ALT/PR, qui s'élève à 0,6 €, représente en tout état de cause un bon rapport qualité prix.
60
La radio : les objectifs réalisables et ceux qui ne le sont pas
Le DFID a déjà eu l'occasion de reconnaître la capacité que représente la radio pour satisfaire aux objectifs MDG des Nations Unies dans le cadre de plusieurs publications, notamment dans son rapport intitulé Voices of Change (DFID, Jan 2006). Cependant, ici comme ailleurs, le DFID a demandé à regrouper des informations et des communications rigoureuses attestant du travail de développement effectué, pour étayer les revendications avancées par ceux qui favorisent ce modèle. Il nous semble que les constatations de la présente évaluation peuvent contribuer de manière favorable à cette attestation. Par exemple, 89 % des personnes de notre échantillon ont déclaré que la radio était leur source d'information au sujet du VIH/sida ; que la radio avait incité la moitié des étudiants à s'inscrire à des cours d'alphabétisation ; qu'un nombre beaucoup plus important de femmes issues de villages avec un bon accès à la radio (68 %) savaient qu'un enfant a besoin de quatre vaccinations par rapport aux villages à mauvaise couverture radiophonique (42 %).
Par ailleurs, nous savons que les autres éléments de cette étude, à savoir le manuel de suivi et d'évaluation de Metcalf, l'Analyse institutionnelle détaillée d'Orengo, les cartographies du projet et les autres leçons acquises, vont tous contribuer énormément au travail futur d'ALT à Madagascar.
Néanmoins, il est également nécessaire de prendre du recul et de mettre en perspective les possibilités qu'offre la radio. La présente étude a démontré des gains impressionnants en matière de diffusion de l'information, d'accroissement des connaissances et de changement des attitudes. Cependant, ce n'est pas la radio, à elle seule, qui permet d'obtenir des changements comportementaux. Les remarques émanant de groupes d'écoute en attestent bien : ils affirment qu'ils ne peuvent pas toujours se permettre de mettre en pratique les mesures avancées, comme acheter des préservatifs ou du chlore, et ils souhaiteraient poser plus de questions et disposer de plus de démonstrations pratiques sur les nouvelles techniques agricoles et environnementales qui sont discutées. Et donc, pour poser les choses clairement, le contact en tête à tête, la formation, des services et du soutien pratique sont des facteurs importants pour aider les villageois à adopter les nouvelles informations et les appliquer dans leur vie quotidienne.
Nous n'avons aucun doute que le partenariat d'ALT articulé autour d'un axe triple va se développer et que les membres du PCID vont accorder davantage de temps et d'investissement en personnel pour faire en sorte que la radio soit un mode de communication interactif, où les villageois peuvent poser des questions à la radio et réaliser eux-mêmes des émissions. C'est ainsi que pourront être forgés certains des maillons manquants entre l'information et l'action, entre la connaissance et le changement comportemental.
Comment déployer le modèle PR ?
L'une des leçons qu'a tirées ALT, c'est que le développement par la taille risque de se faire aux dépens de la qualité, si l'élargissement de la couverture radiophonique ne s'accompagne pas de la création sur le plan local de studios de production capables d'y venir à l'appui. En d'autres mots, à moins de ne veiller à ce que les diffusions soient faites dans les dialectes locaux, à ce que les communications fonctionnent dans les deux sens et à ce que les réalités sociales, culturelles et agricoles des communautés particulières soient prises en compte, le risque est d’exercer un impact amoindri en matière de développement. C'est pour cette raison que les émissions pédagogiques traditionnelles, centralisées et communes à l'ensemble du pays, qui sont assurées par les radios d'état, étaient de taille démesurée. Trop souvent, elles s'adressaient aux gens comme s'ils étaient inférieurs, parlaient de sujets qui ne
61
les concernaient pas et passaient à côté du but.
En conséquence, le défi qui consiste à multiplier les « success-stories » du type de celle d'ALT/PR consiste à toucher davantage de gens sur des zones géographiques plus importantes, sans pour autant perdre de la particularité et de la couleur locale qui sont la marque propre de la radio pour le développement. Ce défi est réalisable, par la création d’un nombre suffisant d'unités de production régionales et la présence d’un nombre suffisant d'agents sur le terrain et de partenaires engagés (prestataires, départements du gouvernement local, ONG, etc...) aux quatre coins du pays pour produire de bonnes émissions de radio, et ensuite en assurer le suivi. Tout dépend de l'engagement des prestataires de services locaux à donner aux communications une priorité stratégique, à payer le temps d'antenne et, plus généralement, à apporter leur soutien à leurs stations radio locales.
Nous en concluons donc qu'en ce qui concerne la radio pour le développement, mieux vaut préférer une relative petitesse. La radio d'État a sa place, si elle est engagée à assurer un service public, mais elle ne contribuera à des impacts de développement que si elle se décentralise et travaille de pair avec les communautés locales, dans les langues locales. Les stations commerciales, à condition qu'elles se soient engagées à remplir un rôle de service public local, peuvent elles aussi avoir un impact en matière de développement.
En attendant, des projets comme ALT/PR doivent nouer des liens stratégiques dans les capitales avec des entités nationales, telles que des ministères et des ONG de plus grande échelle, pour que les inquiétudes régionales soient relayées au plan national et que, en retour, les prestataires de services gouvernementaux et non-gouvernementaux à tous les niveaux investissent dans la radio.
Recommandations destinées au DFID
• Financer plus de projets qui demandent aux prestataires de services locaux, y compris le gouvernement national et local, d'apporter leur soutien et leur collaboration aux stations radio pour produire du contenu radiophonique de bonne qualité.
• Soutenir les efforts au niveau national favorisant des politiques de diffusion
décentralisées, pluralistes et orientées vers le développement. • Soutenir les initiatives qui assurent la formation et encourager les investissements
privés et publics pour soutenir les médias et les ICD (technologies de l'information et de la communication pour le développement) sur le plan local en incluant non seulement la radio, mais aussi la téléphonie, la télévision et la presse écrite.
• Soutenir les efforts de Recherche et Développement pour trouver des sources
énergétiques et électriques durables, par ex. : radios solaires/à manivelle, chargeurs à manivelle pour téléphones mobiles, panneaux solaires pour les émetteurs radio, etc...
Notes en pied de page 1 De plus amples renseignements sur tous ces projets figurent à www.comminit.com et beaucoup sont présentés
dans la publication « Insight » du DFID 2 La « Development Broadcasting Unit » du Malawi
3 Search for Common
Ground’s Centre Lokole : cette radio réalise des émissions qui font la promotion de la paix et les envoie régulièrement à être diffusées par plus de 85 stations radio locales dans l'ensemble de la République démocratique du Congo.
62
Bibliographie
EC/SAP 2002 Données structurelles concernant la sécurité alimentaire : sud de Madagascar : Système d’alerte précoce Agence Européenne pour le Développement et la Santé : Brussels
Harford, N, 2005 ALT Project Radio Monitoring and Evaluation Consultancy – Report of Briefing Visit ALT: London and Madagascar
Harford, N., 2006 Survey of Partners for Communication and Information for Development (PCID) ALT : London & Madagascar
Johansson, S., 2005 Ejeda Evaluation Study ALT: London & Madagascar
Lellelid, S., 2005 ALT Projet Radio : The Status of Associated Radio Stations of South Madagascar ALT : London & Madagascar
Lellelid, S., 2006 Literacy Evaluation Study Report ALT: London & Madagascar
Metcalf, L., 2005 Assessment of Phase II of Project ‘Radio SIDA’ ALT : London & Madagascar
Metcalf, L., 2006 a. Research on the Impact of Projet Radio on Poverty Reduction in the Androy Region ALT: London & Madagascar
Metcalf, L., 2006 b. Research on the Andrew Lee’s Trust’s Communication Support to Fuel Efficient Stove Projects ALT : London and Madagascar
Metcalf, L., 2006 c. Research on the Andrew Lee’s Trust’s Communication Work for the Project for the Support of Rural Development (PSDR) ALT : London & Madagascar
Metcalf, L., 2006 d. Planting Trees And Sowing Sorghum : The Use of Radio by the Andrew Lees Trust’s Tree Nursery ALT : London & Madagascar
Metcalf, L., 2006 e. ALT’s Partnership avec the SALFA Hospital in Ejeda : Further Research on Behavioural Outcomes ALT : London & Madagascar
Metcalf, L. forthcoming Manual for the Impact Evaluation of Radio Information and Communication for Development Projects ALT: London & Madagascar
Orengo, Y., 2007 Institutional Review of Andrew Lees Trust Projet Radio ALT : London & Madagascar
Vadgama, J., 2006 Survey of Listening Groups Established through ALT/PR in Madagascar ALT: London & Madagascar
World Bank, 1996 Madagascar Poverty Assessment : Part 1 14044-MAG Population and Human Resources Division. World Bank : Africa Region
PAM, 2006 Madagascar : Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Vulnerability Analysis and Mapping Branch (ODAV) United Nations World Food Programme : Rome
63
Paysage aride, sud de Madagascar
Enfants, sud de Madagascar
Distribution de postes de radio en 2005 (région de Sarisambo)
Studio de production d'ALT/PR à Ambovombe
64
Foyers améliorés, en cours d'utilisation
Interview VIH SIDA
Groupe de discussion entre femmes pendant l'enquête VIH/sida
Groupe de discussions entre hommes
65
Annexe 1 : Méthodologies des études composantes
Méthodologie de l’Étude 1 : Évaluation de la Phase II de Project Radio SIDA/Leo Metcalf Réf. : Metcalf, L., 2005 Assessment of Phase II of Project Radio SIDA ALT: London & Madagascar
L'équipe d'évaluation a passé deux mois dans les régions de l'Androy et d'Anosy, entre août et septembre 2005. Les études ont été réalisées à Fort Dauphin, Ambovombe et Tsihombe, ainsi que dans des villages avoisinants.
Les activités suivantes ont été entreprises pour réaliser l'évaluation :
269 personnes ont été interviewées pendant une étude pour la base de données finale 16 réunions de groupe avec des groupes d'écoute (GE) dans des zones rurales et
11 en zones urbaines Un contrat a été signé avec un consultant britannique comptant de nombreuses
années d'expérience en matière de santé et de droits reproductifs et sexuels ainsi que dans le domaine du VIH/SIDA ; un consultant malgache, ayant l'habitude de procéder à l'évaluation de l'impact de projets de communication pour le développement, a lui aussi signé un contrat; Deux enquêteurs malgaches indépendants et un expert américain en techniques de
communication ont participé à l'étude. Trois animatrices, une par zone. Des groupes d’écoutes rurales de l'Androy et de la région d'Anosy. Des stations radio partenaires ont été mobilisées pour remplir des formulaires de
feedback sur la pertinence des émissions de l'avis des auditeurs. Des docteurs des dispensaires locaux ont participé au suivi, par le biais de
questionnaires portant sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida avec leurs patients.
Une semaine de formation/préparation à Fort Dauphin, durant laquelle :
Les enquêteurs ont reçu une formation en VIH/SIDA ainsi qu'aux méthodes de conduite d'entretiens qu'exigeait la base de données et aux méthodes utilisées pour simuler les discussion en focus group;
Lors de discussion en focus group, les questionnaires compilés pour la base de données et les thèmes de discussion ont fait l'objet de pré tests puis ont été finalisés,;
Le calendrier concernant la population à cibler ainsi que les districts et villages ciblés a été finalisé.
66
Enquête d’une semaine dans la région d'Anosy : Ville de Fort Dauphin et ses villages avoisinants
Base de donnees des femmes
Base de donnees des hommes FGD
District/Village GE Non GE GE Non GE Femmes Hommes
Ampamakiambato 6 7 5 2 2 1 Zone Urbaine
Antaninarenina 6 5 7 8 0 1
Enakara 5 7 6 6 1 1
Ranomafano 6 5 7 6 1 1 Zone rurale
Ampasy Nahampoana 0 0 0 0 1 1
Sous-total 23 24 25 22 5 5
Total 47 47 10
Enquête d’une semaine dans la région de l'Androy : Ville d'Ambovombe et ses environs
Base de donnees des femmes
Base de donnees des hommes FGD
District/Village GE Non GE GE Non GE Femmes Hommes
Anjatoka (I, II, III) 6 5 7
Avaradrova 0 8
Mahavelo 3 12 1 1 Zone urbaine
Tanambao (I, III & IV) 3 5 1
Ambanisariky 6 6 6 5 1 2
Ambazoa 3 4 6 3 1 1 Zone rurale
Agnafondravoay 4 2 6 1
Sub-total 25 25 24 26 4 5
Total 50 50 9
67
Enquête d’une semaine dans la région de l'Androy : Ville de Tsihombe et ses environs
Base de donnees
des femmes Base de donnees
des hommes FGD District/Village
GE Non GE GE Non GE Femmes Hommes
Ampamakiambato 5 6 1 1 1
Mangarivotra 6 13 1 1
Analafaly 1
Tsihombe Centre 1 2
Anja 1
Zone urbaine
Ambatasoa 1
Namotoha 6 6 7 1 1
Sakamasy 7 4 1 1
Befotaka 3
Ampilofilo 3
Zone rurale
Atsandrake 3
Sub-total 25 0 32 19 4 4
Total 25 51 8
Recueil de données Les données ont été recueillies sur le terrain, au moyen de questionnaires standardisés pré codés. La version définitive du questionnaire découlait d'un pré-test.
Les questions ont été formulées en vue d'obtenir les informations suivantes :
• Sources des informations sur le sida • Connaissances générales sur le sida • Connaissances des modes d'infection • Connaissances des moyens de prévention • Attitude vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH • Avis sur les émissions traitant du SIDA et sur les autres aspects appréciés et non
appréciés à prendre en compte pour les émissions futures.
68
Méthodologie de l’Étude 2 : Étude d'évaluation d'Ejeda/Suzanna Johansson Réf. : Johansson, S, 2005 Ejeda Évaluation Study ALT: London & Madagascar
L'évaluation a été réalisée à Ejeda entre octobre et décembre par une équipe de six enquêteurs malgaches et par Suzanna Johansson (Programme « Communication pour le Développement », du Département Arts et Communications, Université de Malmö, Suède).
L'équipe a travaillé pendant deux mois et demi avec des habitants locaux de la région d'Ejeda, utilisant l'hôpital d'Ejeda comme base principale pour ses activités. L'étude d'évaluation a été précédée de trois jours de formation et de préparation de l'équipe en septembre 2005, et de deux autres jours de formation et de préparation au début novembre. Les personnes interviewées étaient des membres de groupes d'écoute villageois (GE) et des non membres de groupes d'écoute (NGE). Les entretiens ont été réalisés auprès du même nombre de NGE que de personnes de GE. Les personnes interrogées ont été choisies au hasard pour faire en sorte qu'elles correspondent, dans la mesure du possible, aux profils des groupes d'écoute en termes d'âge et de sexe. Au total, 109 personnes ont été interviewées (55 femmes et 54 hommes).
L'étude a été effectuée dans les régions suivantes : • Andranotsiriny : rurale • Beahitse : rurale • Lambomaty : urbaine • Sakoatovo : urbaine • Belafike : rurale • Discussions de groupe : Farafatse : rurale • Ejeda : urbaine
69
Méthodologie de l'Étude 3 : Le statut des stations radio associées du sud de Madagascar/Steve Lellelid Réf. : Lellelid, S., 2005 ALT Projet Radio: The Status of Associated Radio Stations of South Madagascar ALT: London & Madagascar
Une enquête à base de questionnaires, réalisée auprès de 15 stations radio partenaires d'ALT/PR a été effectuée par deux techniciens de PR : R.Harri et Anto R, sur leurs missions régulières auprès des stations radio partenaires sur la période allant du 4 au 23 décembre 2005.
ID_Sta Nom écourté Station radio
1 Cactus Cactus Ambovombe
2 Fanilo-Amp Fanilo Ampanihy
3 VKD Vorokodohodo Tsihombe
4 MBS-fd MBS Fort-Dauphin
5 Soatalily Soatalily Tuléar
6 Kaleta-fd Kaleta Fort Dauphin
7 MBS-tlr Malagasy Broadcasting System (MBS) Tuléar
8 FA Betioky Feon’ny Atsimo Betioky
9 Fanjiry Fanjiry FtD
10 Kaleta-Abs Kaleta Amboasary
11 RCA RCA Ankililoaka
12 Mazava Mazava Ankililoaka
13 Linta Radio Feon’ny Linta Ejeda
14 Menarandra Menarandra Bekily (Radio Télévision Menarandra)
15 Ravenara Ravenara Amboasary
Les questions se sont portées sur les avantages et inconvénients de travailler avec ALT/PR, les problèmes techniques, dans quelle mesure les stations radio sont disposées à travailler avec le réseau PCID, leur vision sur le long terme pour l'avenir, etc...
70
Méthodologie de l’Étude 4 : Partenariat d'ALT avec l'hôpital SALFA à Ejeda - Étude avancées sur les résultats comportementaux/Leo Metcalf Réf. : Metcalf, L., 2006 e. ALT’s Partnership avec the SALFA Hospital in Ejeda : Further Research on Behavioural Outcomes ALT : London & Madagascar
1 Examen de la diffusion radiophonique et de la fréquentation hospitalière à partir des registres de l'hôpital 2 Examen des visites spécialisées consignées dans les registres hospitaliers 3 Entrevues de départ auprès de 70 femmes quittant l'hôpital N = 70 Nombre Pourcentage
Nombre de femmes 70 100
Femmes interviewées à la CSBII 49 70
Femmes originaires de zone rurale 55 79
Femmes originaires de zone urbaine (Ejeda) 13 19
Femmes appartenant à un groupe d'écoute d'ALT 6 9
Age moyen 18 S.O.
Nombre moyen d'enfants 4 S.O.
Nombre de femmes dépourvues de toute scolarisation 45 64,3
Femmes à l'hôpital pour une consultation anténatale 41 59
Femmes à l'hôpital, elles-mêmes étant malades ou leur époux 0 0
Femmes à l'hôpital, leur enfant étant malade 26 36
En cas de maladie, il s'agit de : paludisme 4 6
En cas de maladie, il s'agit de : Diarrhée 3 4
Ces femmes ont été interviewées à leur départ de l'hôpital de SALFA ainsi que de la Clinique de Santé de Base II (CSBII) gouvernementale à Ejeda.
Au total, 70 femmes ont été interviewées, 70 % d'entre elles à la CSBII. La raison à cela tient au fait qu'il était plus facile d'identifier les femmes quittant la CSBII plutôt que l'hôpital, et que la fréquentation de la CSBII était plus importante, les consultations étant gratuites.
Des entretiens ont également été réalisés avec tous les propriétaires de postes de radio du village d'Anamanta (Commune de Gogogogo).
Un examen des registres des stocks a été effectué pour connaître les ventes de postes de radio à Ejeda auprès de fournisseurs de postes au cours des années précédent la création de RFL et après.
71
Méthodologie de l’Étude 5 : Plantation d'arbres et culture du sorgho/Leo Metcalf (Fév-avr 2006) Réf. : Metcalf, L., 2006 d. Planting Trees And Sowing Sorghum: The Use of Radio by the Andrew Lees Trust’s Tree Nursery ALT: London & Madagascar
Activité Méthode de recherche Calendrier
Distribution d'arbres
Des interviews courtes et structurées avec chaque personne à qui des arbres ont été distribués (88 au total) Deux entretiens avec des témoins privilégiés du personnel sylvicole
Février 2006 : Examen rétrospectif des méthodes de communication utilisées de novembre 2004 à avril 2005. Février 2006 – Avril 2006 pendant la distribution de jeunes plants.
Distribution de sorgho
16 interviews individuelles avec des fermiers de 4 villages participant au programme. Deux entretiens avec des témoins privilégiés : des techniciens agricoles
Mars 2006 : Examen rétrospectif de la récolte de sorgho sur la période de novembre 2004 à avril 2005 dans quatre villages proches de Tsihombe
Méthodologie de l’Étude 6 : Étude du travail de communication d'ALT pour le PSDR : Impacts sur les activités rémunératrices/Leo Metcalf Réf. : Metcalf, L., 2006 c. Research on the Andrew Lee’s Trust’s Communication Work for the Project for the Support of Rural Development (PSDR) ALT : London & Madagascar
L'enquête s'est attachée à étudier :
• Le nombre de candidatures mensuelles d'AC depuis le commencement du projet, par rapport aux dates où s'est tenu l'atelier de campagne de communication et au commencement de la diffusion d'émissions du PSDR Méthode de recherche : Les données ont été demandées au PSDR
• Les émissions du PSDR, leur qualité et le but qu'elles se donnaient d'atteindre Méthode de la recherche : étudier les registres de PR et les évaluations d'émissions effectuées par un consultant indépendant • Témoignages du président et du trésorier des AC, ainsi que des partenaires stratégiques et des représentants de l'autorité locale Méthode de recherche : Interviews ouvertes avec des témoins privilégiés. • Entretiens avec Mr. Guillaume Sop, chargé de communication au PSDR jusqu'en 2004. Méthode de recherche : Entretien ouvert avec Guillaume. L'étude s'est déroulée pendant les mois de mars à août 2006.
72
Méthodologie de l’Étude 7 : Enquête des groupes d'écoute créés par le biais du projet ALT/ PR à Madagascar/ Jaisel Vadgama (Mai-juin 2006) Réf. : Vadgama, J., 2006 Survey of Listening Groups Established through ALT/PR in Madagascar ALT: London & Madagascar
L'enquête menée auprès des auditeurs a été réalisée à partir d'un échantillon de 100 villages du projet, sur une période de quatre semaines courant du 24 mai au 21 juin 2006. Les critères de sélection des villages étaient spécifiquement conçus pour :
• Inclure au moins 3-4 villages associés avec chaque partenaire majeur du PCID ; • Représenter toute une variété de circonstances géographiques (plus particulièrement, un mélange de villages relativement isolés et de villages moins isolés) ; • Maximiser le nombre de postes de radio opérationnels dans les villages faisant l'objet de l'enquête. Ce dernier critère a été inclus afin d'éviter de perdre du temps à réaliser des enquêtes « sans objet », c'est-à-dire où les GE sont non fonctionnels en raison de postes de radio en panne.
Bien qu'il ne s'agisse pas là d'un échantillonnage strictement aléatoire, rien ne vient indiquer que les critères de sélection font apparaître un parti pris à l'encontre de certains types de groupes d'écoute. En effet, l'échantillon de l'enquête doit être considéré représentatif sur toutes les questions soulevées, hormis celle concernant le fonctionnement des postes de radio.
À noter que les 100 villages de l'enquête sont sous divisés en quatre regroupements régionaux : Toliara, Tsihombe, Ambovombe et Fort Dauphin/Anosy, qui correspondent grossièrement à des zones culturelles, géographiques et administratives distinctes. Deux enquêteurs ont été affectés à chaque région et ont chacun réalisé 12 et 14 enquêtes.
Il était demandé aux enquêteurs de réaliser cinq activités dans chaque village, dans le cadre de leur enquête :
• Observer le poste de radio (son état, les conditions de rangements, etc...) • Interviewer les responsables du GE (sur le fonctionnement de base du GE) • Faciliter une discussion de groupe avec le GE regroupé dans son entier (couvrant les
opinions et les préférences, et évaluation des impacts en matière de développement sur le village)
• Interviewer le GE en l'absence des responsables (pour vérifier les réponses quant au fonctionnement de base du GE)
• Consigner toutes les observations et réflexions annexes sur le GE (son degré d'engagement, son intérêt, etc...)
Des dictaphones ont été fournis pour enregistrer les discussions, et permettre ainsi aux enquêteurs de se concentrer sur l'animation des discussions et prendre des notes plus tard dans la journée. Il était prévu de réunir un quorum de six à dix membres de GE pour chaque discussion bien que dans de rares cas, quatre membres seulement étaient présents.
En règle générale, les enquêtes semblent s'être déroulées de manière standardisée par tous les huit enquêteurs, conformément à la formation initiale. Toutefois, pour un petit nombre de questions, des divergences d'interprétation persistent, la différence des réponses s'expliquant par l'intervention des enquêteurs plutôt que par toute autre variable éventuelle. Ces résultats sont signalés et accompagnés des mentions restrictives appropriées.
73
Les enquêtes ont été réalisées en malgache, ou dans un mélange de malgache et de français, en fonction des compétences linguistiques de chaque enquêteur. Elles ont toujours été enregistrées sur support électronique dans la langue d'origine (mélange) avant d'être traduites, uniformément, en français. Méthodologie de l’Étude 8 : Rapport d'étude d'évaluation d'alphabétisation/Steve Lellelid (Juin 2006) Réf. : Lellelid, S., 2006 Literacy Évaluation Study Report ALT: London & Madagascar
Une enquête aléatoire à partir de questionnaires auprès de 273 étudiants adultes en alphabétisation a été réalisée dans 165 centres d'alphabétisation (sur un total de 824 sites de cours actifs), dans 17 communes différentes des régions de Beloha, Tsihombe et Ambovombe. L'échantillon a été sélectionné par les « animateurs » d'alphabétisation employés par l'ONG Tahantanee, qui réalise des cours d'alphabétisation. Chaque animateur a sélectionné cinq sites placés sous son contrôle et a visité chaque site, en choisissant deux personnes à interviewer par site.
Les animateurs n'avaient le droit de ne choisir qu'un seul site en zone urbaine, le reste devant être réparti le plus largement possible au sein de sa zone. Tous les efforts ont été entrepris pour veiller à la diversité de l'échantillon, tout en reflétant la composition démographique de l'ensemble des étudiants en alphabétisation. Au bout du compte, l'échantillon présentait une répartition entre les sexes de 143 hommes et 130 femmes (52 %/48 %) et la tranche d'âges de 20 à 50 ans représentait environ les deux-tiers de l'échantillon, avec 9 % de moins de 20 ans et 6 % de plus de 60 ans. Le questionnaire était en Tandroy, la langue maternelle de toutes les personnes interrogées.
Méthodologie de l’Étude 9 : Recherche de l'impact de Projet Radio dans la région de l'Androy Region/Leo Metcalf (Avril-août 2006) Réf. : Metcalf, L., 2006 a. Research on the Impact of Projet Radio on Poverty Reduction in the Androy Region ALT: London & Madagascar
La région littorale autour de la ville d'Anjapaly, au sud de Tsihombe, a été la première à faire l'objet de l'étude de l'impact des groupes d'écoute et des émissions radiophoniques de PR.
La radio a été créée à Tsihombe en juin 2004 : en conséquence, l'évaluation se porte sur des populations qui écoutaient les émissions de PR depuis deux ans au maximum.
La recherche dans cette région s'est effectuée dans six villages expérimentaux, où il était jugé que les villageois avaient un bon accès à des postes de radio ainsi qu'aux émissions radiophoniques FM ; elle les a appelés VAR (Villages avec Radios). L'accès envisagé était à la fois direct et indirect (lorsque les informations sont relayées par une personne qui les a entendues à la radio).
La recherche a également été effectuée dans cinq villages de référence qui disposent de peu de postes de radio et de peu d'accès aux émissions radiophoniques ; la plupart sont situés sur des flancs de colline et ne peuvent donc pas recevoir les ondes de la radio Hodohodo. Ces villages sont appelés VSR (Villages Sans Radio). Dans certains de ces villages, il est possible qu'un villageois possède un poste de radio pour lequel il achète des piles et ait
74
allongé son antenne au moyen d'un fil, souvent attaché sur plusieurs mètres de haut dans les airs, à un arbre ou un poteau. La réception reste toutefois mauvaise, peu de gens ont accès à ce poste et ceux qui y ont accès ne peuvent en profiter que rarement. D'après les enquêteurs, quand un poste de radio est cité dans le cas de ces villages, il y est souvent fait référence comme une source indirecte, c'est-à-dire l'information provient de quelqu'un qui l'a entendue à la radio alors qu'il se trouvait dans un autre village qui, lui, reçoit les ondes radio.
Les villages ont été sélectionnés en fonction de leurs similarités sur tous les autres aspects d'accès à l'information en-dehors de la radio : ils sont de taille similaire et sont éloignés de la même distance de Tsihombe (la grande ville la plus proche), et disposent d'à peu près le même accès au taxi brousse et aux cliniques locales.
Désormais, il est fait référence à cette étude sous le nom de « Étude de Tsihombe ». Villages avec accès à la radio Village Commune
1 Antanantsoa Anjapaly
2 Mokalava Anjapaly
3 Ambolirano/Ankobay Anjapaly
4 Andavakio Anjapaly
5 Marosaragna Anjapaly
6 Antsasavy Anjapaly
Villages sans accès à la radio Village Commune
7 Bevontake : Village Faux Cap
8 Benonoke Centre Faux Cap
9 Ankilemivory Faux Cap
10 Behiratse II Faux Cap
11 Behiratse I Faux Cap
La deuxième région où l'étude s'est penchée sur les impacts des groupes d'écoute s'est portée sur les environs d'Ambovombe, où les populations concernées étaient des membres de groupes d'écoute depuis au moins 2002. Harri Rabearivony, le Technicien d'ALT à Ambovombe, s'est chargé d'identifier les groupes d'écoute en question en s'appuyant sur les critères suivants :
• Couverts par la zone de diffusion de Radio Cactus • Considérés ruraux (c'est-à-dire situés à au moins 8 km d'Ambovombe ville) • Créés avant 2002 • Où le poste de radio fonctionne toujours, ou fonctionnait il y a encore six mois de cela.
75
Dorénavant, ces villages vont être qualifiés de VELL (villages avec écoute sur le long terme) et désormais il est fait référence à cette étude sous le nom de « Étude d'Ambovombe».
Village Commune
1 Ankilikira Beanatara
2 Beanayara Beanatara
3 Betioky Centre Ambohimalaza
4 Betioky Tragnotsiefa Ambohimalaza
5 Ankaramena Ambohimalaza
6 Vahavola Ankilbe Sampona
7 Sarehangy Ambovombe
8 Androvasoa Mitreaky Ambanisarika
Étude quantitative
Les données quantitatives ont été recueillies au moyen d'interviews individuelles structurées. Les questionnaires utilisés se sont concentrés sur du contenu portant sur la réduction de la pauvreté lors d'émissions diffusées au cours des cinq dernières années. Au total, 364 interviews furent réalisées, dans les 19 villages concernés.
Étude qualitative
• Étude de Tsihombe : Cartographie de la source d'information dans chacun des villages étudiés ; Deux Cartes de source de l'information (CSI) ont été réalisées en petits groupes d'environ 6 personnes, l'un composé de femmes et l'autre d'hommes. Les CSI se sont intéressés aux informations qui, d'après les gens, étaient susceptibles de les aider à se développer ou à améliorer leur vie. Au total, 22 cartes ont été réalisées dans 11 villages. • Étude d'Ambovombe : Enquête complète des auditeurs ; L'étude a été entreprise en s'appuyant sur la méthodologie d'Enquête complète des auditeurs mise au point lors de l'Enquête des auditeurs, et qui a consisté en des observations, des entretiens individuels, des entretiens de groupe et des discussions de groupe. Au total, huit enquêtes d'auditeurs ont été réalisées dans huit villages différents.
76
Méthodologie de l’Étude 10 : Enquête du PCID/Nicola Harford (Août-décembre 2006) Réf. : Harford, N. 2006, Survey of Partners for Communication and Information for Development (PCID) ALT: London and Madagascar
Un questionnaire semi structuré a été mis au point conjointement par le personnel de Projet Radio et par des consultants d'évaluation financés par le DFID. Ce questionnaire assez long comportait des questions ouvertes et des questions fermées, réparties en sept grandes catégories. Dans chaque cas, l'administration du questionnaire a été assurée par un membre du personnel de Projet Radio : il est bien apprécié que cette décision a pu introduire un élément de parti pris dans les réponses concernant les résultats de Projet Radio, les Malgaches étant peu enclins à se montrer ouvertement critiques, mais il n'existait pas d'autre alternative sur le plan logistique. Par ailleurs, l'interviewer principal est aussi l'enquêtrice du projet ; cela ne fait pas longtemps qu'elle travaille au projet, elle n'est pas impliquée dans la réalisation d'émissions radiophoniques ni dans la formation, ni dans la distribution de postes de radio, et elle n'est donc pas associée aux activités clés des membres du réseau PCID.
Si à l'origine, les questions ont été conçues en anglais puis traduites en français pour être imprimées, les interviews se sont déroulées en partie en français et en partie en malgache. Les réponses ont été consignées en français à la main puis ont été dactylographiées. Dix questionnaires remplis ont été traduits en anglais pour en faciliter l'analyse et les données ont été saisies dans une base de données sous Excel : bien que dans certains cas, les catégories de réponses étaient pré codées (et l'interviewer instruit de lire ou non les options données), dans d'autres les catégories de réponse étaient post-codées. Cette décision provenait en partie des personnes chargées de saisir les données et a donné lieu à des variations au niveau de l'interprétation des réponses. Par ailleurs, bien que le questionnaire ait fait l'objet d'un pré-test au démarrage de l'étude afin d'éliminer tous problèmes et toutes ambiguïtés, il était apparent au stade de l'analyse qu'il en subsistait. Un autre problème était dû à l'utilisation par différents enquêteurs de versions légèrement différentes du même questionnaire à des moments différents de l'étude, ce qui a nécessité de revérifier près de la moitié des données saisies. Ces contraintes étaient en grande partie attribuables aux difficultés de déplacement et de communication au sein de Madagascar et entre d'une part les consultants d'évaluation et d'autre part les enquêteurs du projet.
Lors de certains entretiens (par ex. : celui avec PSDR), même si cela faisait plusieurs années que l'organisation était membre du PCID, cela ne faisait pas longtemps que la personne interrogée travaillait pour l'organisation et elle disposait donc de connaissances limitées sur les liens qui existent entre le PR et les activités entreprises. En témoignent les réponses qui ne sont complétées qu'en partie, voire même incorrectement.
Les partenaires du PCID d'août à décembre 2006, c'est-à-dire pendant la période de l'enquête, s'élevaient au nombre de 34, donc 28 ont été interviewés, soit 82 % des partenaires du PCID. Toutefois, les six non inclus dans l'enquête en ont été délibérément exclus du fait de leur manque d'activité depuis quelque temps : en conséquence, il avait été estimé que leurs réponses ne seraient pas représentatives du réseau. Depuis, le nombre de partenaires a augmenté, pour en compter désormais 49, avec l'élargissement du projet à la région de Fianara. L'implantation des partenaires du PCID interviewés était comme suit : huit à Fort Dauphin (région d'Anosy), sept dans l'Androy (Ambovombe et Tsihombe) et huit dans la ville de Toliara.
Le questionnaire ne demandait pas de définir le type d'organisation ; cependant, il s'agissait de partenaires sous direction gouvernementale ou d'autorité locale, comme CISCO (Circonscription Scolaire) et PSDR (Programme de Soutien au Développement Rural), des ONG locales telles que Satraha et Voron Kodohodo, des ONG internationales comme WWF
77
et PACT, et des projets financés par des bailleurs de fonds, comme Objectif Sud (opéré par GRET, ONG française).
Méthodologie de l’Étude 11 : Évaluation des fourneaux améliorés/Leo Metcalf Réf. : Metcalf, L., 2006 b. Research on the Andrew Lee’s Trust’s Communication Support to Fuel Efficient Stove Projects ALT : London and Madagascar
Il avait été décidé de concentrer principalement la recherche sur le personnel et les bénéficiaires du projet TMM de foyers améliorés.
Des entretiens individuels ont été entrepris avec : • 2 agents sur le terrain TMM (animatrices principales) : - Elianne - Francia • 2 maires concernés par le projet TMM : - Le maire d'Amboropotsy (Remamoritsy) - Le maire d'Ankilimivory (Maherimana) • 2 formateurs locaux au TMM originaires d'Amboropotsy : - Vatananake - Marikely Brontine • 1 formateur local PE (Projet Énergie), originaire d'Ambanisarika (district
d'Ambovombe) Des discussions de groupe à Amboropotsy : • 1 groupe de femmes du groupe d'écoute (propriétaires de Toko Mitsitsy) • 1 groupe de femmes non membres d'un groupe d'écoute (propriétaires de Toko
Mitsitsy) • 2 groupes d'hommes (maris des femmes propriétaires de Toko Mitsitsy) Interviews structurées dans l'Androy • 181 interviews réalisées auprès de femmes originaires de régions à l'accès différent aux
radiodiffusions. D'autres sources d'information ont été étudiées, dont : • Projet Énergie Rapport d'activités sur 3 ans • Évaluation définitive du Projet Énergie • Rapport d'activités de Première Année pour TMM • Rapport d'activités définitif pour TMM
78
Annexe 2 : MDG - Objectifs Millénaire pour le Développement
OBJECTIF 1
Éradiquer l'extrême pauvreté et la faim Cible 1 : Réduire de moitié la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour avant 2015 Cible 2 : Réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim avant 2015
OBJECTIF 2
Assurer l'éducation primaire pour tous Cible 3 : Donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires avant 2015
OBJECTIF 3
Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes Cible 4 : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaires et secondaires avant 2005, si possible, et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015 au plus tard
OBJECTIF 4
Réduire la mortalité infantile Cible 5 : Réduire de deux tiers le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans avant 2015
OBJECTIF 5
Améliorer la santé maternelle Cible 6 : Réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle avant 2015
OBJECTIF 6
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladie Cible 7 : Stopper la propagation du VIH/sida et commencer à inverser la tendance actuelle avant 2015 Cible 8 : Maîtriser le paludisme, la tuberculose et d'autres grandes maladies, et commencer à inverser la tendance actuelle avant 2015
OBJECTIF 7
Assurer un environnement durable Cible 9 : Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales ; inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales Cible 10 : Réduire de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau durable avant 2015 Cible 11 : Améliorer sensiblement la vie d'au moins 100 millions d'habitants de taudis, d'ici à 2020
OBJECTIF 8
Mettre en place un partenariat mondial pour le développement Cible 12 : Poursuivre la mise en place d'un système commercial et financier ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non discriminatoire Cible 13 : Répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés, y compris un programme renforcé d'allègement de la dette, l'accès aux marchés, l'annulation des dettes bilatérales envers les créanciers officiels et l'octroi d'une aide publique au développement plus généreuse Cible 14 : Répondre aux besoins particuliers des États enclavés et des petits États insulaires en développement Cible 15 : Traiter globalement les problèmes d'endettement des pays en développement en prenant des mesures d'ordre national et international propres à rendre cet endettement viable à long terme Cible 16 : En coopération avec les pays en développement, créer des emplois décents et productifs pour les jeunes Cible 17 : En coopération avec l'industrie pharmaceutique, rendre les médicaments de première nécessité disponibles et abordables dans les pays en développement Cible 18 : En coopération avec le secteur privé, mettre les avantages que procurent les nouvelles technologies, en particulier les technologies de l'information et de la communication, à la portée de tous. PNUD. 2003 Human Development Report : Millennium Development Goals : A compact among nations to end human poverty. PNUD, New York, USA.
79
Annexe 3 : Émissions diffusées Andrew Lees Trust Projet Radio – Diffusions – Archives 1999 – Déc 06 (Mis à jour 26 jan 07)
Récapitulatif Émissions par thème
Agriculture 304
Éducation civique 5
Culturel 22
Développement rural 147
Droits/Lois 3
Éducation 62
Bétail 86
Environnement 354
Pêche 11
Santé 539
Sécurité 4
Sécurité alimentaire 3
Total 1 540
Diffusions par région
Androy 812
Anosy 360
Sud Ouest 333
Mahafaly 10
Haute Matsiatra 25
Total 1 540
Diffusions par an
1999 56
2000 73
2001 59
2002 62
2003 149
2004 307
2005 443
2006 391
Total 1 540
80
Annexe 4 : Partenaires du PCID
Région d'Anosy- 15 Partenaires PCID
Fort Dauphin
1 ANGAP Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées
2 ASOS Association Santé Organisation Secours
3 CARE Cooperative Assistance Relief Everywhere
4 CEL Centre Écologique Libanona
5 CIREEF Circonscription de l’Environnement, des Eaux et Forêts
6 CISCO Circonscription Scolaire
7 FAFAFI FAnentanana FAmbolena Fiompiana. S'attache à fournir aux communautés de la formation agricole
8 PACT Private Agencies Collaborating Together
9 PAM Programme Alimentaire Mondial
10 PECHE Ministère de la pêche
11 SSD Service de Santé du District
12 UADEL ANOSY Unités Régionales d’Appui pour le Développement Local
13 WWF World Wildlife Fund
14 CISCO Circonscription Scolaire
15 PHBM Projet du Haut Bassin du Mandrare
81
Région d'Androy- 12 Partenaires PCID
Ambovombe
1 CISCO Circonscription Scolaire
2 DMP Drought Mitigation Programme
3 GRET Groupe de Recherche et d'Échange Technologique
4 KIOMBA Oui, j'accepte ONG portant ses efforts sur le développement communautaire
5 SAP Système d'Alerte Précoce
6 SRSAPS Service Régional de la Santé Animale et Phytosanitaire Élevage
7 UADEL AD Unités Régionales d’Appui pour le Développement Local
Bekily
8 GTZ Deutsch Gesallschaft fur Technische Zusammenarbeit
Tsihombe
9 AFVP Association Française des Volontaires du Progrès
10 CISCO Circonscription Scolaire
11 SATRAHA Puissant développement local, environnement, agriculture et éducation
12 VK Voronkodohodo (Oiseau éléphant)
Région Vezo et Mahafaly- 11 Partenaires PCID Toliara
1 ASOS Association Santé Organisation Secours
2 CNA Centre National Antiacridien malgache
3 MCDI Medical Care Development International
4 MDP Maison des Paysans
5 PSDR Le Projet de Soutien au Développement Rural
6 SAGE Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement
7 SECALINE Projet de Madagascar de sécurité alimentaire et de nutrition
8 SISAL Sambatra Izay Salama (ONG VIH / Santé)
9 TOKY Confiance. Organisation agricole, concentrant son attention à la production de soja
10 VOLA MAHASOA Association de micro-finance
11 WWF World Wildlife Fund
82
Province de Fianarantsoa - Région Haute Matsiatra- 11 Partenaires PCID
Haute Matsiatra
1 ATS Association Tefy Saina
2 CISCO Circonscription Scolaire
3 CU Commune Urbaine
4 CMP Comite Multi Local de Planification
5 DRP Direction Régionale de la Population
6 DRS Direction Régionale de la Santé
7 ERI Eco Régional Initiative
8 FERT Formation pour l’Épanouissement et le Renouveau de la Terre
9 PSDR Projet de Soutien au Développement Rural
10 TIAVO TIAVO
11 UADEL HM Unités Régionales d’Appui pour le Développement Local
Sur les 49 partenaires du PCID, 18 sont sous la direction du gouvernement ou d'une autorité locale, soit 37 % ; 18 sont des organisations internationales ayant des bureaux locaux ou dont les projets sont financés par des institutions ou des programmes de rang international, par exemple sous l'égide de la Communauté européenne, de USAID, des Nations-Unies, de la Banque mondiale, ou d'autres organisations similaires, soit 37 % ; 13 sont des associations locales ou des ONG malgaches, soit 26 %
83
Annexe 5 : Cartographie du projet
Ressources ALT/PR, Partenaires et Stations radio (par région)
Anosy Androy Mahafaly Vezo Province de Fianara-4 régions Antananarivo Personnel
1 Chef de projet 1 Directeur financier 1 Coordinateur régional 1 Coordinateur d'évaluation 1 Assistant projet 1 Assistant financier *1 Réalisateur/rédacteur 1 Logisticien *1 Coord distribution *2 Agents de distribution *1 mécanicien/chauffeur 2 Gardiens *1 évaluateur à temps partiel
1 Technicien 1 Réalisateur/rédacteur 1 Asst admin/fin *1 Agent de distribution 1 Évaluateur à temps partiel
1 Réalisateur/rédacteur 1 Coordinateur local 1 Réalisateur/rédacteur 1 Asst admin/fin 1 Chauffeur 1 Agent de distribution 1 Évaluateur à temps partiel
1 Coordinateur régional 1 Réalisateur/rédacteur 1Assistant admin/fin 1 Coord distribution *5 Agents de distribution *1 Chauffeur 1 Gardien 1 Évaluateur à temps partiel
1 Assistant projet national *
Total 36 15 5 1 6 12 1
Équipement et ressources
1 studio de production, Fort Dauphin
2 studio de production : 1 Ambovombe; 1 Tsihombe
1 studio de production (pas encore avec PCID)
1 studio de production, Tuléar
1 studio de production, Fianarantsoa
Transports 1 Véhicule ALT PR 1 Véhicule ALT PR 1 Véhicule ALT PR Postes de radio
Stock de postes de radio destinés à être distribués/réparés/remplacés
Stock de postes de radio destinés à être distribués/réparés/remplacés
Stock de postes de radio destinés à être distribués/réparés/remplacés
* Employés à temps partiel participant sur une base de partage des coûts avec DMP (Drought Mitigation Programme), le programme sœur d'ALT. Le personnel en italique dénote le personnel de distribution de postes de radio financés par CNLS (contrat d'un an seulement)
84
Partenaires du
PCID Anosy Androy Mahafaly Vezo Fianara Province 4 Regions Antananarivo
Fort Dauphin Ambovombe Ampanihy Tulear Haute Matsiatra ANGAP CISCO WWF UADEL ASOS DMP MCDI PSDR CARE GRET / Objectif Sud MDP FERT CEL KIOMBA PSDR CISCO CIREEF SAP Vola Mahasoa Commune Urbaine CISCO SRSAPS SAGE CMP FAFAFI UADEL Androy ASOS TIAVO PACT CNA DRP PAM Seecaline ERI PECHE SISAL DRS SSD Toky ATS UADEL Anosy WWF
Amboasary Tsihombe CISCO Satraha (M Steven Lellelid) PHBM Voron Kodohodo AFVP CISCO
Bekily
GTZ
85
Stations radio FM affiliées Anosy Androy Mahafaly Vezo Fianara Province
4 Regions Antananarivo
Fort Dauphin Ambovombe Ejeda Tulear Fianarantsoa Antananarivo Radio MBS Radio Cactus RFA Ejeda Station MBS Radio MAMPITA Radio Kaleta Station Soa Talily Radio TSIRY Radio Fanjiry Radio Manambaro Amboasary Tsihombe Betioky Ankilililoaka Ambalavao
Radio Ravenara Voron Kodohodo RFA Betioky Station RCA Radio Akon’ny Tsienimparihy
RFM Amboasary Station Mazava Radio Kaleta
Betroka Beloha Ampanihy Ankazoaoabo Ambositra * Arc en Ciel * Radio Vasia Etoile Radio Fanilo * RTAM
* Akon’ny Manamana Radio FEON'NY MANIA
Bekily Bezaha Manakara
RadioMenarandra * RTL Tealongo Radio MBS * Mbitantsoa (Kalamavoy)
* Station radio qui diffuse les émissions d'ALT mais qui n'est pas officiellement une station affiliée.
Les noms en italique indique la suspension actuelle du réseau, attendant la conformité aux règlements du ministère.
86

























































































![Songbook - Headcorn Ukulele Group · [C]La la la la la [E7]laaaa la la [Am]la la la la la la [C7]laaaaaa La la la la [F]laaaa la la la la [G7]laaaa la la la [C]laaaa [C7] So [F]listen](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5fd12ba0d69a5f331475cebe/songbook-headcorn-ukulele-group-cla-la-la-la-la-e7laaaa-la-la-amla-la-la.jpg)







![LEAVIN’ ON A JET PLANE · [F] La la la la la [A7] laaaa la la [Dm] la la la la la la [F7] laaaaaa La la la la [Bb] laaa la la la la [C7] laaaa la la la [F] laaaa [F7] So [Bb] listen](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5fd12ba0d69a5f331475cebd/leavina-on-a-jet-f-la-la-la-la-la-a7-laaaa-la-la-dm-la-la-la-la-la-la-f7.jpg)




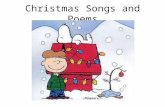

![Lake-O-Ukers Ukulele Strum October 25, 2019punchdrunkband.com/songpdfs/LakeOOct25-2019.pdf · [G] La la la la la [B7] laaaa la la [Em] la la la la la la [G7] laaaaaa . La la la la](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5fd12b9fd69a5f331475ceba/lake-o-ukers-ukulele-strum-october-25-g-la-la-la-la-la-b7-laaaa-la-la-em.jpg)
