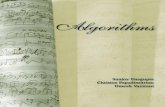L3_S2_anglais_grammaire_1999_2005
Transcript of L3_S2_anglais_grammaire_1999_2005
GRAMMAIRE : UAN36 - MAI 1999
Corrigé QUESTION UNIQUE : A partir de l’exemple :
It’s high time the BBC broadcast more symphonic music. que vous analyserez du point de vue des temps, vous expliquerez pourquoi l’expression prétérit modal est insatisfaisante. (20 pts) [Ne soyez pas avare d’exemples, d’exégèses ou d’éclaircissements.]
1) METHODE « GOUTEZ ET COMPAREZ » La première chose qui saute aux yeux dans l’exemple proposé est le contraste saisissant entre un présent (is = {BE} + {S}) et un prétérit (broadcast = {broadcast} + {ED}).
(1 pt) Or ce prétérit ne saurait refléter le temps chronologique comme ce serait le cas avec : I believe Beverley blew bubbles yesterday. (1 pt) Ici nous observons le même contraste entre un présent (believe = {believe} + {Ø}) et un prétérit (blew = {blow} + {ED}). La justification du présent est la validation de la relation prédicative I / BELIEVE (SOMETHING) pour un moment T, auquel réfère believe, qui n’exclut pas le moment To de l’énonciation. Cette analyse vaut également pour le premier verbe de l’exemple proposé. (0,5 pt) En revanche la justification du prétérit de blew est la non-coïncidence entre le moment T-1 auquel réfère blew et le moment To de l’énonciation. (0,5 pt) En d’autres termes, le présent, ici en liaison avec un verbe d’état (believe), a pour effet de construire une propriété du sujet syntaxique I. Le prétérit de blew a sa valeur temporelle de révolu : ce temps grammatical (tense) est ici le reflet du temps chronologique (time) : nous sommes dans le cas d’une représentation linguistique du premier ordre. (1 pt) Dans l’exemple proposé, maintenant, le présent is de {BE} a la même valeur que celui de believe. Tout change avec le second verbe de l’énoncé. Impossible d’accorder au prétérit broadcast de {broadcast} la même valeur temporelle de révolu qu’à blew puisque nous n’avons pas de décalage temporel entre T et To. D’un point de vue temporel, nous nous trouvons toujours dans de l’actuel. Mais ceci, le temps (grammatical) du verbe (broadcast) ne nous en dit rien [et d’ailleurs un prétérit n’a jamais pu référer à de l’actuel !]. (1 pt) 2) PROBLEME : A QUOI SERT DONC LE PRETERIT ICI ? � En tant que forme non auxiliée il ne saurait exprimer ni modalité ni aspect (ou alors le degré zéro de l’aspect—l’aspect aoristique). Ceci veut dire que le So n’intervient pas dans son énoncé ; il reste en retrait par rapport à lui. (1 pt) � En tant que forme finie, il sert à valider la relation prédicative qui unit le sujet the BBC au prédicat broadcast more symphonic music. (1 pt)
� En tant que temps grammatical, il sert à déclarer cette connexion sémique contrefactuelle par rapport à la situation d’énonciation. L’interprétation temporelle étant exclue, nous nous trouvons devant un cas de connexion sémique anticipée. (1 pt)
Le terme anticipé montre qu’il s’agit d’une démarche du même ordre que la référence au révolu : il s’agit de vivre ou d’imaginer par avance l’événement < broadcast more symphonic music > comme l’événement < blew bubbles yesterday > est vécu par avance par rapport à l’événement < believe + GN >. Ainsi que le dit Henri Adamczewski, il s’agit alors d’une sorte tout à fait particulière de passé, « d’un passé de type présuppositionnel où ce qui est en cause n’est pas la chronologie des événements extra-linguistiques mais celle des
1
opérations internes à l’anglais. » Il y a bien décalage, non plus entre deux temps (T et To) cette fois, mais entre deux opérations linguistiques : 1°) celle qui consiste à valider la connexion sémique (ou relation prédicative) THE BBC / BROADCAST MORE SYMPHONIC MUSIC ; (1 pt) 2°) celle qui consiste à énoncer it’s high time [for the BBC to broadcast more symphonic music]. (1 pt) L’énonciation it’s high time exige la validation de la relation prédicative qui suit comme présupposé. • Ce présupposé étant contrefactuel par rapport à la situation d’énonciation (Sito), le
prétérit est chargé d’attribuer la valeur logique « faux » à THE BBC / BROADCAST MORE SYMPHONIC MUSIC. (0,5)
• Au plan du posé, la validation, elle, ne se fait pas, nous l’avons dit, par rapport à la réalité du moment T auquel pourrait faire référence broadcast : broadcast ne réfère à aucun moment (n’a pas de référence temporelle) ; elle se fait par rapport à la construction théorique du souhait it’s high time. (0,5)
En d’autres termes, dans un cas (broadcast music) comme dans l’autre (blew bubbles), le prétérit exprime un décalage. Dans le second cas ce décalage concerne la succession temporelle des deux événements blew bubbles [T-1] et believe (something) [T] ; dans le premier cas, ce décalage concerne la succession des opérations linguistiques (c’est un cas de représentation linguistique du troisième ordre) : • c’est dans un premier temps [et il est remarquable que le mot temps soit ici utilisé non
dans son acception chronologique mais avec le sens de «mouvement » ou de « stade »]—c’est dans un premier temps que la relation prédicative qui unit the BBC à broadcast music est validée (= présentée comme vraie) ;
• c’est dans un second temps qu’est construit l’énoncé qui englobe THE BBC / BROADCAST MORE SYMPHONIC MUSIC, à savoir It’s high time [the Beeb ... music].
Ce travail second a pour effet de rejeter dans l’antériorité opérationnelle la construction de [the Beeb ... music]. (1 pt) C’est donc par anticipation purement théorique que le second prédicat, BROADCAST MORE SYMPHONIC MUSIC, est appliqué à son sujet, THE BBC. Cette anticipation à titre théorique rend irréelle la présupposition par rapport à la situation où est énoncé le souhait It’s high time. On peut ainsi mettre l’étiquette théorique (terminologie de Larreya) sur ce prétérit ou encore l’étiquette métalinguistique (terminologie d’Adamczewski) puisque l’opérateur {ED} travaille exclusivement sur le matériau linguistique (et non, ici, sur la traduction linguistique du monde extra-linguistique). (1 pt) Nous avons justifié le qualificatif métalinguistique ; il nous faut maintenant récuser le qualificatif modal. 3) ET LA MODALITE DANS TOUT CELA ? Bien évidemment it’s high time exprime un souhait de la part du sujet énonciateur et le prétérit dénote qu’on en reste au stade du souhait, sans que rien n’en résulte dans la réalité « mondaine ». Le souhait formulé par l’énonciateur manifeste un jugement de sa part, manifeste de sa part une intervention dans son énoncé qui relève de la modalité. (1 pt) L’appellation prétérit modal pourrait donc paraître justifiée. C’est oublier qu’on ne saurait mélanger les torchons temporels avec les serviettes modales.
2
La modalité peut se faire jour de diverses manières dans un énoncé : sous forme d’un verbe (I hope she doesn’t come !), d’un adverbe (Hopefully she won’t come !), d’un nom (My hope is that she breaks a leg). Au niveau du groupe verbal, mis à part le verbe, seuls les auxiliaires modaux sont porteurs de modalité et il n’y en a pas dans l’exemple proposé. (1 pt) Leur place est à gauche du groupe verbal, en tête des auxiliaires dans la construction < NP —— (Aux) V + compléments > The BBC should broadcast more music
should have broadcast more music should have been broadcasting more music
for the occasion La place des marqueurs de temps est à droite du verbe [broadcast, irrégulier, n’est pas un bon exemple pour faire apparaître ceci ; prenons un autre verbe] : Sarah talks a lot. Sarah talked a lot yesterday. ou à droite du premier auxiliaire Sarah has consulted a shrink before. Sarah had already consulted a shrink in the past. Il s’agit de deux systèmes d’oppositions différents : celui des temps, à droite du lexème verbal (ou du premier auxiliaire), est un système à deux termes ; (0,5 pt) celui des auxiliaires modaux, à gauche du lexème verbal, est un système à cinq (voire sept ou huit) termes. (0,5 pt) Le système temporel n’a rien à voir avec les divers systèmes d’auxiliaires et certainement pas avec le système des auxiliaires modaux. Le seul auxiliaire susceptible de se rapprocher des opérateurs de temps est used (to). Or used (to) se restreint à une valeur temporelle (il ne saurait avoir valeur métalinguistique) et de plus ce n’est pas un modal (il se construit avec to). Voilà pour l’aspect formel des choses. Du point de vue sémantique, maintenant, si l’auxiliaire modal a pour mission, entre affirmation et négation, d’évaluer le degré de validité de la relation prédicative, il ne la valide pas. A l’opposé, la forme finie non auxiliée valide directement cette relation. (1 pt) Il apparaît maintenant clairement que le « prétérit modal » est une chimère qui place la tête du lion prétérit sur le corps de la chèvre modale. « Prétérit modal » est une expression aussi incongrue que le seraient celles de « prétérit pélagique », « prétérit élégiaque » ou « prétérit paléozoïque ». CONCLUSION
Il faut rendre à César ce qui est à César et à high time ce qui lui appartient. C’est high time, associé à more, et non {ED}, qui exprime une modalité. (1 pt)
Quant à {ED}, sa valeur est plus abstraite que l’expression du temps chronologique (time) ; c’est l’expression d’un décalage (une présupposition de non-réalité) qui peut avoir plusieurs effets de sens : temporel, métalinguistique ou énonciatif (la fameuse—et fumeuse—« concordance des temps » du style indirect. (1 pt) En d’autres termes la langue anglaise utilise la forme prétérit comme boîte de rangement pour des opérations qui ne s’écartent pas trop les unes des autres. Ce principe de classification propre à la langue est caractéristique des représentations linguistiques du deuxième ordre. (1 pt)
3
CorrigéGRAMMAIRE : UAN36 - SEPTEMBRE 1999 QUESTION UNIQUE : Quelle différence faites-vous, dans la grammaire de l’anglais,
entre présent et actuel ? [Donnez des exemples.] (16 pts) Vous ramasserez votre exposé des faits dans une brève conclusion. (4 pts)
Dans une langue, aucune unité n’a de valeur ni même d’existence sinon par opposition à au moins une autre unité. (1 pt)
On appelle présent un temps grammatical qui, en anglais, s’oppose au temps grammatical prétérit. C’est cette opposition qui donne lieu au système des temps grammaticaux de l’anglais. [Sans prétérit, pas de présent] (2 pts) Ces deux morphèmes ont pour signifiant Ø / s pour le présent ; ED pour le prétérit.
(2 pts) A eux deux, ils constituent toutes les formes finies du verbe. C’est en tant que formes finies que l’un comme l’autre valide la relation prédicative. (2 pts) L’invariant du présent (son signifié) est de signaler que la validation de la relation prédicative se fait pour un moment qui n’exclut pas le moment To de l’énonciation et ceci, par opposition au prétérit qui, lui, l’exclut expressément. (2 pts) Cet invariant, selon le contexte ou la situation, peut donner lieu essentiellement à deux effets de sens que l’on calcule en fonction des rapports entre le moment d’énonciation, To, pris pour repère et le moment T auquel réfère l’énoncé (si un tel moment existe). (1 pt) S’il n’y a aucun rapport entre ces deux moments—ou si le moment T s’évanouit dans l’indétermination—l’effet de sens n’est pas temporel : aucune restriction n’est imposée à la validité de la relation prédicative :
T / To effet de sens atemporel (2 pts) [Notation synonyme alternative : T ω To]
Ex. : There is Nothing in Nature so irksome as general Discourses, especially when they turn chiefly upon Words.
(Addison) (1 pt) Si ces deux moments coïncident, l’effet de sens est temporel et la valeur temporelle du présent est l’actuel :
T = To effet de sens actuel (2 pts) Ex. : You’re treading on my toes ! (An anonymous victim) (1 pt) Il résulte de ceci que le temps présent est un morphème grammatical qui a pour signifiant Ø / s (1 pt), pour signifié « To non exclu » (1 pt) et que l’actuel est l’un des avatars de ce signifié, l’un de ses effets de sens (1 pt), effet de sens qui correspond à la restriction de la validation de la relation prédicative au To. (1 pt)
Bêtisier - Le système grammatical de l’anglais est composé de deux unités, le présent et le prétérit. - Le présent est la forme grammaticale que prend une phrase lorsque l’énonciateur (So) veut rendre compte du
moment présent alors que l’actuel réfère à la globalité des phrases mises au présent. - La valeur d’actuel du présent est une valeur temporelle au même titre que le présent atemporel. - Dans la grammaire de l’anglais le présent n’a pas de valeur. - Un moment présent est un moment qui se passe au moment où l’on parle, mais ça peut aussi être un moment
continu, même quand on ne parle pas.
4
EPREUVE SYNTHETIQUE de GRAMMAIRE : ELAN 26, MAI 2000
Corrigé Qu’entend-on par interrogation ? Quelles en sont les marques? [Soyez explicite dans vos réponses.] L’interrogation est l’une des modalités assertives. (1 pt) Comme les autres opérations d’assertion, elle est seconde par rapport à l’établissement de la relation prédicative. Elle survient donc au moment de la validation de cette relation qu’elle place en suspens. (1 pt)
Le sujet énonciateur (So) y a recours, • soit lorsqu’il ne sait pas comment valider la relation prédicative—de manière positive ou négative—et qu’il
demande à son co-énonciateur de le faire pour lui ; (1 pt) • soit lorsqu’il n’a pu instancier une place d’actant ou de circonstant et que, là aussi, il demande à son co-
énonciateur de le faire pour lui. (1 pt) Dans le premier cas, on parle de question de type fermé car ces questions n’ouvrent la possibilité qu’à deux réponses, oui ou non (yes/no-questions). (1 pt) Dans le second cas, il s’agit de questions de type ouvert, de questions qui ouvrent tout un paradigme d’options possibles (WH-questions). (1 pt) [Nous ne parlerons pas ici de l’interrogation indirecte.]
En tant qu’opération seconde par rapport à l’établissement de la relation prédicative, l’interrogation, pour pouvoir s’appliquer, nécessite l’existence d’un auxiliaire, représentant explicite et autonome de l’opération de prédication. (1 pt)
Cet opérateur de prédication indépendant du lexème verbal remplit deux fonctions essentielles :
1. C’est cet auxiliaire, en tant que représentant de l’opération de prédication, qui sert de cible à la nouvelle opération—ici, l’interrogation. (1 pt)
2. C’est cet auxiliaire, opérateur de prédication, qui porte la marque du temps grammatical. (1 pt) La seconde fonction exclut expressément to ainsi que tout auxiliaire du groupe verbal autre que le premier. Sinon tout opérateur de prédication fait l’affaire. Ce peut être : l’un des sept auxiliaires modaux (shall, will, may, can, must, need, dare), l’un des deux auxiliaires aspectuels (have, be) l’auxiliaire de voix passive (be) l’auxiliaire de modalité assertive, do, pour la forme aoristique des verbes.
La marque de l’interrogation est double : elle focalise en tête d’énoncé le constituant sur lequel porte l’interrogation ; (1 pt) elle impose un contour intonationnel à l’énoncé. (1 pt)
La marque des questions de type fermé est donc double : 1. C’est l’auxiliaire affecté de la marque de temps—c’est-à-dire le représentant de la relation prédicative sur
quoi porte la question—qui, focalisé, figure en tête d’énoncé. (1 pt) 2. L’énoncé est caractérisé par un rise, c’est-à-dire une intonation ascendante. (1 pt) � Has Gary had breakfast yet ? � Do you remember Peppercue and Barleycorn ? La marque des questions de type ouvert est également double : 1. C’est la PRO-forme mise au lieu et place du constituant non instancié qui, focalisée parce que la question
porte sur elle, passe en tête de séquence (à moins qu’elle ne s’y trouve déjà : cas de la PRO-forme sujet). (1 pt)
2. L’énoncé est alors caractérisé par un fall, c’est-à-dire une intonation descendante. (1 pt) � When did it all happen ? � What can she have been doing, then ? [C’est une seconde courbe qui affecte then !] La montée en tête de séquence, AU PREMIER PLAN ENONCIATIF, de l’auxiliaire représentant l’opération de prédication ou de la PRO-forme représentant le GN non instancié (ce qui exclut la PRO-forme sujet, qui n’a
5
jamais quitté sa place en tête de séquence) est due à la focalisation sur l’opération nouvelle de mise en cause, de mise en question. Elle donne lieu à deux effets concomitants : • D’abord, un décalage de la relation prédicative en queue de séquence, reléguée, à une forme non finie, dans
le préconstruit de L’ANTERIORITE OPERATIONNELLE. (1 pt) Ce décalage crée une PROFONDEUR ENONCIATIVE entre un premier plan focalisé et L’ARRIERE-PLAN auquel se trouve rétrogradée l’opération de prédication représentée par une relation prédicative dépouillée de toute marque de validation. (1 pt)
• Ensuite, une inversion du sujet et du premier (ou seul) auxiliaire—savoir celui qui est porteur de la marque
de temps grammatical. (1 pt) Dès qu’apparaît cette inversion de l’ordre sujet-temps, l’assertion, positive ou négative, se trouve
suspendue. Cela veut dire que le pôle positif est abandonné sans que pour autant le pôle négatif ne soit rallié. C’est cela l’interrogation, l’interrogation en général, qu’il s’agisse de questions fermées ou de questions ouvertes. Autrement dit, l’interrogation met en question la validation de la relation prédicative en parcourant inlassablement les deux valeurs, positive et négative, de l’assertion sans pouvoir jamais s’arrêter à aucune.
(2 pts)
NB1 - On dit parfois que la marque de l’interrogation est l’inversion du sujet et de l’auxiliaire. Ceci est faux. 1.1 - On peut rencontrer des questions sans inversion. Questions de type ouvert :
A : Gary swallowed a pair of slugs for breakfast this morning. B : Gary did WHAT ?
[il s’agit alors de langue parlée (ce qui ne saurait constituer une contre-indication à l’acceptabilité linguistique de la chose) et, surtout, il s’agit d’une reprise, d’une réaction (de révulsion) à une affirmation antérieure. NB - Reprise signifie « anaphore ». Do en association avec un something quelconque peut fonctionner comme substitut anaphorique : do so, do it, do that, do what.] Questions de type fermé : You remember Peppercue and Barleycorn ? ou même : Remember Peppercue and Barleycorn ? [ici encore nous avons affaire à de la langue parlée et la langue parlée peut se satisfaire de l’un des deux traits caractéristiques de l’interrogation, savoir l’intonation ascendante, trait qui, comme dirait M. de la Palice, n’apparaît jamais à l’écrit (sauf à considérer le ‘?’ comme une marque d’intonation montante, ce qu’il n’est pas, bien entendu).] 1.2 - On peut rencontrer des inversions sans qu’elles donnent lieu à interrogation : • (a) Only after repeated divine instructions and signs does Æneas overcome his natural impulse and obey.
(focalisation d’une restriction) • (b) Well do I remember the day when I proposed to her !
(focalisation d’un intensif) De ce point de vue, l’interrogation n’est qu’un cas particulier de l’opération de focalisation. NB2 - On dit parfois que la marque de l’interrogation est do. Ceci est faux. 2.1 - On peut rencontrer do hors des interrogations. Voir (a) et (b) ci-dessus ainsi que :
What Gary did was swallow a pair of slugs. (pseudo-clivée) Gary did swallow a pair of slugs. (emphase)
2.2 - On peut rencontrer des interrogations sans do : Has Gary had breakfast yet ?
NB3 - On peut enfin rencontrer des questions qui ne comportent ni do ni inversion : A : Kevin, then, sent a love letter. B : Who to ? [Néanmoins l’énoncé de B répond bien aux deux critères de l’interrogation : voir ci-dessus.]
6
Corrigé EPREUVE SYNTHETIQUE de GRAMMAIRE : ELAN26, septembre 2000 En vous fondant sur l’exemple de DO, vous expliquerez ce qu’il faut entendre par grammaticalisation. [Soyez explicite dans vos réponses.]
On entend par grammaticalisation le fait pour un morphème de passer de la classe des
lexèmes, unités en liste ouverte, à celle des morphèmes grammaticaux, unités en liste fermée. (2 pts)
Ce passage s’accompagne d’une désémantisation de l’unité. (1 pt) Dans le cas de DO, le processus de grammaticalisation est un processus synchronique.
Cela veut dire que coexistent actuellement, en l’an de grâce 2000, un DO lexical et un DO grammatical (le second ne s’est pas substitué au premier).
En outre il apparaît judicieux de distinguer non pas simplement deux fonctionnements opposés—le lexème verbal d’un côté ; l’auxiliaire, morphème grammatical, de l’autre—mais un gradient allant d’un pôle à l’autre et passant par deux étapes intermédiaires qui relèvent du premier fonctionnement (lexème verbal), savoir le simple opérateur de prédication (ainsi nommé en forçant un peu les choses) et l’opérateur de reprise (généralement pas à lui tout seul).
[Votre attention est attirée sur la succession de ces diverses étapes par l’adoption de PETITES MAJUSCULES.]
1er fonctionnement : le verbe
1.1 - Le VERBE LEXICAL INTRANSITIF C’est un lexème verbal qui dénote l’action dans son sens le plus général : Do or die. When in Rome, do as the Romans do. That’ll do. (1 pt) DO est ici un verbe intransitif : un verbe complet qui (comme dirait M. de la Palice)
n’a pas besoin de compléments. Afin de pouvoir noter des choses plus précises, il doit avoir recours aux services d’un complément (COD) et passer dans le camp des verbes transitifs.
1.2 - Le verbe lexical transitif C’est une unité au sens vague qui peut valoir pour un grand nombre d’autres unités
plus précises : What shall I do ? eat a steak and kidney pie read the Kamasutra blow my nose stand on my head etc.
DO apparaît ainsi comme l’image de tous les verbes dont le sujet peut être agent d’un procès, comme l’hyperonyme de tous les verbes agentifs—c’est un verbe agentif généralisé. (1 pt) (Un hyperonyme—ici, DO—a, par nécessité, une valeur sémantique plus abstraite et générale que chacun des groupes prédicatifs qu’il peut coiffer—eat a pie, run a Rolls, etc.)
Puisque le sens de DO est des plus vagues, il peut lui être associé un GN qui lui fournisse un apport de substance sémantique. DO est alors non plus intransitif (§ 1.1) mais transitif : un verbe incomplet qui NECESSITE UN APPOINT AUSSI BIEN SYNTAXIQUE (COD) QUE SEMANTIQUE. Cela correspond à la PREMIERE MODALITE d’un PREMIER PROCESSUS DE DESEMANTISATION, une désémantisation de facto. (1 pt)
7
En forçant un peu les faits, on pourrait dire qu’alors DO remplit la fonction de simple opérateur de prédication tandis que le substantif prend en main la charge signifiante. Ceci, bien sûr, n’est pas juste car DO ne quitte pas encore le giron lexical pour rejoindre la cohorte des unités grammaticales (il reste sémantisé même s’il est référentiellement vide) et le lien de DO avec son C1 n’est pas de même nature que celui qui unit la copule au GN attribut du sujet. DO demeure verbe transitif. Il n’en reste pas moins qu’avec son sens vague de verbe d’action, DO est plus proche des unités grammaticales (en liste fermée) que ne peuvent l’être des lexèmes comme chachka ou serendipity, ce qui lui permet de figurer dans un grand nombre de contextes :
Sarah did her nails / six years in jail / 90 mph / a headstand, etc. (1 pt) Ici DO se manifeste comme factotum polyvalent vis-à-vis de toute une variété de C1, c’est bien un verbe agentif généralisé. C’est le seul trait lexical qui lui reste ; il va chercher un complément de sens dans le contexte à droite (= 1e modalité d’un 1er processus de désémantisation).
1.3 - Le substitut anaphorique de verbe De même qu’une unité qui fonctionne à paradigme ouvert comme variable de parcours
(cf. le who interrogatif) a toutes les aptitudes pour fonctionner hors paradigme comme substitut anaphorique (cf. le who relatif), de même DO, qui fonctionne à paradigme ouvert dans What shall I do ? (où il peut avoir pour valeur aussi bien dance a waltz que stand on my head [voir § 1.2]), est substitut anaphorique dans : (1 pt)
The old women gossiped, as they had always done, squatting on the floor. [Adamczewski, 105] Ici DO fonctionne hors paradigme et ne peut avoir pour valeur que celle qui est repérable dans le contexte à gauche, c’est-à-dire gossip. (1 pt) Il est rare que DO, à lui seul, remplisse cette fonction anaphorique. C’est le plus habituellement le rôle de do so / do that / do it : (1 pt) She couldn’t deny and yet she wanted to do so. [Adamczewski, 105]
Dans cette fonction anaphorique, DO est toujours verbe, avec ses formes non finies (ici, infinitif et participe passé) aussi bien que finies, mais sa fonction de PRO-forme le réduit à l’état d’opérateur, coquille fonctionnelle vide de contenu sémantique puisque SON SENS NE PROVIENT QUE DU CONTEXTE (du contexte gauche, cette fois-ci), à l’exception de son trait de verbe agentif. Ceci correspond à une SECONDE MODALITE DU PREMIER PROCESSUS DE DESEMANTISATION. (1 pt)
L’étape suivante fait franchir à DO le Rubicon du sanctuaire grammatical : DO devient auxiliaire.
(Rubicon)
8
2e fonctionnement : l’auxiliaire En tant qu’auxiliaire, DO figure toujours à la gauche, immédiate ou non, d’une base verbale, c’est-à-dire à gauche de la forme nue du verbe. Cette position est celle des auxiliaires modaux. (1 pt)
Comme les autres auxiliaires modaux, DO ne possède que des formes finies (il est dépourvu d’infinitif et de participes). (1 pt)
Mais, contrairement aux autres auxiliaires modaux, il n’admet pas que d’autres auxiliaires viennent s’insérer entre lui et la base verbale. DO, auxiliaire, est incompatible avec tout autre auxiliaire dans un groupe prédicatif donné.
DO, auxiliaire modal, est un auxiliaire de remise en cause de la relation prédicative ; c’est un opérateur de la modalité assertive. (1 pt)
Chaque fois que la fonction prédicative a besoin d’être re-travaillée, si elle n’est pas portée par un opérateur de prédication autonome et explicite (have, be, must), alors c’est à DO qu’il revient de reprendre la relation prédicative déjà posée pour servir de cible et de réceptacle à la nouvelle opération. (1 pt) Bien noter ceci : DO, vidé de tout sens lexical, est alors opérateur de reprise. Ce n’est pas d’une reprise contextuelle qu’il s’agit ; DO n’est pas alors un anaphorique comme do so (1.3) ; DO ne reprend pas un terme ou une séquence de termes ; il reprend une fonction, la fonction prédicative. Ceci représente une valeur sémantique hautement abstraite (celle des morphèmes grammaticaux) qui n’est pas mise en rapport avec la réalité extra-linguistique—UNE VALEUR ENTIEREMENT GRAMMATICALE QUI N’A PLUS RIEN DE LEXICAL. Ayant perdu le seul trait sémantique lexical qui lui restait, celui de verbe agentif, DO alors a subi un SECOND PROCESSUS DESEMANTISATION. Quelle est la nouvelle opération à laquelle DO (mais aussi have, be ou must) peut être chargé de servir de cible ? 1. L’interrogation : Did you have a pleasant journey ? [Qf] What did you do ? [Qo] 2. La négation : That didn’t hurt your feelings, I hope ? 3. La mise en relief de la relation prédicative (emphase) :
She visited no picture galleries and no museums. What she did visit were the glass and china departments of the large stores. [Adam., 91]
4. La focalisation sur un constituant modalisé (qui porte sur la relation prédicative) négatif : Not till they were hoarse did they stop shouting. [Adamczewski, 99] restrictif : Only after repeated divine instructions and signs does Æneas obey. Intensif : Well do I remember the day when I proposed to her. 5. L’itération de la relation prédicative (à des fins de généralisation et de caractérisation) :
Harris always does know a place round the corner where you can get something brilliant in the drinking line. [Adamczewski, 97]
Violence never did solve anything. [Adamczewski, 97] (5 pts) [Qf] = Question de type fermé [Qo] = Question de type ouvert
9
ELAN26 1e session JUIN 2001 EPREUVE SYNTHETIQUE de GRAMMAIRE : Corrigé Comment se fait-il que will puisse avoir une valeur épistémique alors que la chose est refusée à can ? Démonstration. Les oppositions qui règlent les relations entre les quatre unités qui forment le cœur du système des auxiliaires modaux de l’anglais peuvent se représenter au moyen d’un tableau à double entrée, ainsi que le propose Antoine Culioli (entrées en caractères gras) et, à sa suite, Henri Adamczewski (entrées en caractères maigres et de moindre taille) :
Visée orientation ver sla prédication
non-Visée pas d’orientation
vers la prédication →S
Rel. Préd. non inhérente
shall
phase 1
may
phase 1
S→/ Rel. Préd. inhérente
will
phase 2
can
phase 2 (1pt)
SHALL et WILL visent une occurrence de validation de la relation prédicative : ils expriment la visée (A. Culioli), autrement dit l’orientation vers la prédication (H. Adamczewski), ce qui constitue la valeur EPISTEMIQUE commune à ces deux auxiliaires. (1pt)
SHALL et WILL s’opposent par leur valeur RADICALE ; de même aussi MAY et CAN : avec SHALL comme avec MAY, une contrainte pèse sur le référent du sujet syntaxique (→S, A. Culioli) parce que le Prédicat ne représente pas une propriété inhérente du Sujet syntaxique (H.
Adamczewski) : pas de relation préexistante entre S et P (phase 1) ; autrement dit, parce qu’il n’existe pas de rapport de congruence entre S et P (J.R. Lapaire & W. Rotgé).
(1pt) Cette contrainte a pour origine le sujet énonciateur, S0 (S0→S), qui est responsable de l’établissement du lien entre S et P : modalité subjective (P. Larreya). (1pt)
avec WILL comme avec CAN, l’origine du procès est localisée dans le sujet syntaxique (S→, A. Culioli) parce que le Prédicat représente une propriété inhérente du Sujet syntaxique (H.
Adamczewski) : la relation S-P existe déjà (phase 2) ; autrement dit, parce qu’il existe un rapport de congruence entre S et P (J.R. Lapaire & W. Rotgé).
Children can be very trying / Boys will be boys. (1pt) Le lien entre S et P existe indépendamment du sujet énonciateur, S0 , qui reste neutre : will et can sont l’expression d’une modalité objective (P. Larreya). (1pt)
Les deux valeurs, épistémique et radicale, de shall et de will sont le plus souvent
mêlées. Pourtant will, constituant le terme non marqué de l’opposition shall~will, peut voir totalement disparaître sa valeur radicale et ne conserver alors que sa valeur épistémique de visée. Pourquoi ? parce que l’opposition shall~will, c’est-à-dire l’opposition →S ~ S→ , se trouve alors neutralisée. (1pt)
10
C’est en particulier le cas lorsque BE + ING vient filtrer la valeur de visée aux dépens de la valeur radicale des auxiliaires modaux. Ex. : This time next week, Derek will be slowly sipping his port by the fireside. (1pt) Can, maintenant. Can se trouve pris dans une double opposition, 1] avec will (visée~non-visée) et 2] avec may (non-congruence~congruence). 1] CAN et WILL - Par opposition à will, avec CAN (et avec may), plus d’orientation vers la prédication : (1pt) la visée épistémique n’est plus de mise. Cela veut-il dire qu’il n’y ait plus de valeur épistémique possible ? = une fois disparue la valeur épistémique positive (orientation vers la prédication), l’absence d’orientation vers la prédication n’implique-t-elle pas une absence de valeur épistémique ? Comment se fait-il alors que may puisse revêtir le toge épistémique aussi bien que la radicale ? 2] CAN et MAY - Il faut d’abord noter que les deux valeurs, épistémique et radicale, de may sont bien séparables l’une de l’autre (éventualité et permission), contrairement à ce qui se passe pour shall. Il faut ensuite observer que si MAY permet d’envisager le prédicat comme une propriété non-inhérente (H. Adamczewski) du terme-source de la relation prédicative—comme il a déjà été dit plus haut—c’est que may, modalité subjective (Larreya), laisse au S0 toute latitude pour estimer la contingence de la soudure prédicationnelle (valeur épistémique). (2pts) Ex. : Derek may be sipping a martini just now, who knows ? POSSIBLE BILATERAL (valeur épistémique) (1pt) Cette possibilité, cette ultime possibilité d’interprétation épistémique se verrouille dans le cas de CAN puisque can incite à envisager le prédicat comme propriété inhérente du référent du sujet grammatical : Ex. : Derek can peel potatoes with speed and dexterity. S→ CAPACITE (valeur radicale) (1pt) Plus question alors pour le sujet énonciateur de venir mettre son grain de sel : can est une modalité objective et la relation S-P est tenue pour acquise (phase 2).
Ceci est vrai pour la valeur radicale S→ de capacité, on vient de le dire ; ceci est également vrai en cas de neutralisation de l’ opposition S→ ~ →S. Ex. : Derek can leave the country now, everything is arranged. POSSIBLE UNILATERAL (valeur radicale) (1pt) (rien ni personne ne s’y oppose : it’s up to him.) Plus question pour le S0 de faire quelque estimation que ce soit sur la contingence ou non de la relation prédicative, plus question de valeur épistémique. Ex. : * Derek can be sipping a martini just now, one never knows. (1pt) POSSIBLE BILATERAL (valeur épistémique : exclue)
Non-Visée + relation S-P acquise + So out = valeur épistémique exclue (propriété inhérente) (5pts)
11
EPREUVE SYNTHETIQUE de GRAMMAIRE : ELAN26 2e session SEPTEMBRE 2001
corrigé Faint heart never won fair lady. Focalisez never. Que se passe-t-il ? Expliquez. ETAPE N°1 Focaliser un élément, c’est attirer l’attention sur cet élément en le plaçant en un point remarquable de l’énoncé : ici, la première place :1 (1 pt) Faint heart never won fair lady *never faint heart won fair lady (1 pt) ETAPE N°2
L’énoncé obtenu est mal formé. Pourquoi ? Parce que l’opération de focalisation à la quelle il vient d’être procédé affecte un constituant négatif extérieur au groupe verbal (GV) mais portant sur la relation prédicative. (1 pt)
Or, une fois la relation prédicative posée (première opération dans la formation d’un énoncé), chaque fois qu’il est besoin d’effectuer un travail supplémentaire à son endroit, (1 pt) elle doit se manifester sous une forme contractée de reprise, vidée de tout sens lexical (1 pt) —ceci, bien entendu, si la forme verbale ne comporte pas déjà un représentant explicite et autonome de la prédication (be, have, can, etc.).
DO est cet opérateur de reprise. Il reprend non pas un terme ou une séquence de termes (ce n’est pas un anaphorique comme do so, who ou she) ; DO reprend une fonction, la fonction prédicative. (1 pt) Chaque fois, donc, que la fonction prédicative doit être retravaillée, si elle n’a pas déjà pour support un opérateur distinct du lexème verbal (un auxiliaire), alors apparaît DO qui re-présente, en la résumant, l’opération qui unit le sujet grammatical (S) au prédicat (P)—l’opération de prédication—afin de servir de cible et réceptacle à la nouvelle opération.(1 pt) Ici, pas d’auxiliaire dans le paysage prédicatif ; survient donc DO comme trace de l’opération première de prédication afin de servir de cible à l’opération seconde de focalisation. Et où survient-il ? à la proximité immédiate de l’élément auquel il sert de cible, c’est-à-dire à droite de never (1 pt) : *never DO faint heart won fair lady (1 pt) ETAPE N°3
Cet énoncé est à nouveau mal formé. En effet, dès qu’apparaît un auxiliaire dans une forme verbale, une division du travail se fait jour entre cet auxiliaire, nouvel opérateur de prédication, et le lexème verbal qui reste chargé de l’apport sémantique lexical et de la distribution des fonctions syntaxiques. (1 pt)
1 L’attribution de la première place à un élément ne correspond pas nécessairement à sa focalisation. C’est ainsi que la thématisation d’un élément, quel qu’il soit, ne correspond pas à une focalisation puisque la place canonique du thème de l’énoncé est le plus souvent la première—hors opération de focalisation d’un autre élément, justement—puisque ce thème prend la place du premier argument du verbe, à gauche de celui-ci. Dans the letter had been purloined, the letter, terme but de la relation prédicative, a été thématisé par rapport à l’énoncé actif correspondant, someone had purloined the letter, sans qu’aucune focalisation n’intervienne. S’il ne faut pas prendre la thématisation pour une focalisation, il ne faut pas non plus confondre focalisation et mise en relief pure et simple. La mise en relief peut être assurée par des moyens prosodiques, un special stress (ici noté par un soulignement du mot) affectant un élément à des fins de contraste : Brian broke the mug, not the teapot. La mise en relief prosodique peut se combiner à la mise en relief syntaxique par clivage de l’énoncé : IT WAS the mug THAT Brian broke, not the teapot. Ces mises en relief ne donnent pas lieu à l’épiphanie de DO. Le clivage, pourtant, participe à la fois de la mise en relief et de la focalisation puisqu’il entraîne le déplacement en tête d’énoncé de l’élément mis en relief (sauf s’il porte sur le sujet, thème de l’énoncé).
12
Or dans toute forme verbale finie, c’est par définition l’opérateur de prédication, celui qui unit le S au P, qui porte la marque du temps grammatical. Ici, l’opérateur de prédication est DO : (1 pt)
*never DO faint heart WIN+ED fair lady never did faint heart win fair lady. Cette fois-ci l’énoncé est bien formé. (1 pt)
EVALUATION Qu’y a-t-il de changé par rapport à l’énoncé primitif ? Le déplacement de never à
gauche de l’énoncé (étape n°1), le surgissement de DO (étape n°2), la migration de la marque de temps de l’ex-opérateur de prédication, le verbe WIN, au nouvel opérateur de prédication, l’auxiliaire DO. Cette migration entraîne une inversion entre le sujet grammatical faint heart et la marque de temps. (1 pt)
Cette inversion, il faut en rendre compte. Il a déjà été remarqué que deux opérations successives marquaient l’énoncé final : • 1. la construction d’une relation prédicative, FAINT HEART / WIN FAIR LADY • 2. la focalisation de l’un des constituants de l’énoncé, NEVER. Cette focalisation rejette l’opération première à l’arrière-plan énonciatif.2 (1 pt) Elle prend en compte l’opération première mais comme présupposé. C’est cette présupposition que matérialise l’inversion entre le sujet syntaxique et le marqueur de temps grammatical (comme c’est aussi le cas pour l’interrogation). (1 pt)
De façon remarquable, did marque la frontière entre les deux opérations : (1 pt) à sa gauche, la modalité négative focalisée qui témoigne de l’opération la plus nouvelle ; à sa droite est rejetée la relation prédicative, qui représente l’opération la plus ancienne, telle quelle, brute de coffrage, sans marque temporelle donc non validée : dans le plus simple appareil, telle Vénus sortant des eaux : FAINT HEART / WIN FAIR LADY. (2 pts)
[Never]premier plan ⎯ DO+ED ⎯ [faint heart / win fair lady]arrière-plan
relais prédicatif DO [Prétérit]
relation prédicative (2 pt)
FAINT HEART / WIN FAIR LADY
N e v e r DO reprend sous formecontractée la relationprédicative afin de servirde cible et réceptacle à lanouvelle opération : lafocalisation de never.
Never did faint heart win fair lady
2 Ainsi que le dirait M. de La Palice, une opération unique ne peut être ni antérieure ni postérieure à quelque autre opération que ce soit. Si survient une seconde opération, elle prend, aurait pu continuer M. de La Palice, la suite de la première. Ainsi se crée une relation d’antériorité-postériorité. La première opération (la prédication) se trouve déplacée à l’arrière-plan énonciatif par la seconde (la focalisation). Autrement dit l’opération de prédication n’est déplacée dans l’antériorité des opérations que lorsque survient une seconde opération : ici, celle de focalisation. C’est cela que signifie le rejet dans l’antériorité opérationnelle et rien de plus.
13
ELAN26 1e session JUIN 2002 EPREUVE SYNTHETIQUE de GRAMMAIRE :
What bothered you [at the time] ? Décrivez et justifiez les différentes étapes de la genèse de cet énoncé à partir de l’énoncé affirmatif correspondant. Rendez compte des ressemblances aussi bien que des différences entre les deux énoncés. (Vous n’avez pas à tenir compte des constituants entre crochets carrés.)
Corrigé
Cet énoncé représente une question de type ouvert. La question porte sur le constituant C0 dont la place n’a pas pu être instanciée par une unité du lexique. (1 pt) La forme affirmative primitive de cet énoncé est donc : GN bothered you [at the time].3 (0,5) Nous nous conterons d’une interprétation syntaxique stricte, mais une interprétation de type intersubjectif et dialogique était parfaitement licite (GN bothered me/us at the time). Opération n°1 - PRONOMINALISATION (1 pt) = SUBSTITUTION D’UNE PROFORME AU CONSTITUANT NON INSTANCIE Pour que l’énoncé soit attestable, le symbole catégoriel GN doit être remplacé par un indéfini (something : Something bothered you) ou par une proforme spécifique. L’indéfini something n’est pas porteur d’interrogation : contrairement à what, something n’ouvre pas un « menu » de possibilités. Avec something, vous n’avez qu’une seule option—indéterminée mais unique. En effet, something n’est pas une image ; il ne travaille pas sur l’axe paradigmatique. Pour mettre en question le constituant dont la place n’a pu être instanciée, il est nécessaire de faire appel à un ‘pronom’ interrogatif ou, plus exactement, à une proforme interrogative (puisqu’il s’agit d’un substitut de GN—pro-GN—et non d’un substitut de nom—pro-NOM). Il est nécessaire de faire appel à une proforme munie d’un WH- rhématique puisque l’élément en question est tellement nouveau qu’il ne peut être nommé. Ce WH- crée un déficit qui demande à être comblé, ouvre sur l’axe paradigmatique un éventail de possibilités entre lesquelles le coénonciateur devra choisir : les ‘pronoms’ interrogatifs sont tous des images de constituants figurant sur l’axe virtuel de la sélection, c’est-à-dire sur l’axe paradigmatique. (1 pt)
La proforme à choisir peut être who ; c’est qu’il s’agit alors d’un animé humain. La proforme peut être what s’il s’agit d’un non animé, ce qui est ici le cas de figure. What est un PRO-Groupe Nominal ; il représente dans l’énoncé le symbole catégoriel GN : WHAT bothered you [at the time] ? (0,5) What est une variable qui parcourt tous les GN susceptibles d’être à l’origine du procès bother. Opération n°2 - Il n’y en a pas : une seule opération permet d’aboutir à l’énoncé interrogatif. (1 pt) L’énoncé affirmatif qui nous a servi de point de départ est un énoncé artificiel qui comporte un symbole catégoriel : GN bothered you [at the time]. Un énoncé attestable, cela a été remarqué plus haut, comporterait un indéfini : Something bothered you [at the time]. La différence entre les deux énoncés est celle entre GN/something et what : (1 pt)
3 Si vous proposez comme exemple Lots of dark thoughts bothered me at the time, la place du C0 a été instanciée par une unité du lexique : alors la question n’a plus de raison d’être puisque vous connaissez déjà la réponse.
14
WHAT bothered you [at the time] ? A part cela, les deux énoncés sont identiques (sauf dialogue : passage de l’embrayeur me/us—something bothered me—à l’embrayeur you—what bothered you ?), jusque dans leur intonation la plus normale : un Fall.4
Pourquoi ? Pourquoi, en particulier, cette absence de DO à la forme interrogative d’un verbe qui se trouvait à une forme aoristique dans la construction affirmative ?
Ce ne serait pas le cas avec : Who did a few spots of rain ever bother ?
POINT N°1 : LA FOCALISATION 1e CONSTATATION - On sait que la place canonique du sujet est à la gauche du verbe car le sujet constitue le point de départ de la relation prédicative : c’est le thème de l’énoncé. (1 pt) 2e CONSTATATION - On sait qu’une question de type ouvert entraîne la focalisation en tête de séquence de l’élément dont la place n’a pu être instanciée par une unité du lexique et qui est représenté par une PROforme : (1 pt) *A few spots of rain ever bothered GN
Sans compter que ever est impossible dans ce contexte. Mais, comme dirait Kipling—dont nous fêtons cette année le 100e anniversaire de ses Just So Stories—ceci est une autre histoire.
Who did a few spots of rain ever bother ? CONSEQUENCE N°1 - Puisque la place du sujet est déjà la première, il ne saurait être focalisé. Autrement dit, la focalisation permet de défaire ce que la norme avait fait si la norme n’allait pas dans le même sens que la focalisation. Ce n’est pas le cas ici. La place du sujet était en tête de l’énoncé à la forme affirmative : en tête de l’énoncé il demeure à la forme interrogative. La focalisation de what n’a pas plus lieu d’être que celle de something. (1 pt) CONSEQUENCE N°2 - Puisqu’il n’y a pas de nouvelle opération par rapport à l’établissement de la relation prédicative (pas de focalisation), il s’ensuit que cette relation prédicative n’a pas à se rechercher un lieutenant qui la reprenne et la résume pour servir de cible (abstraite) et de réceptacle à une absence d’opération : pas d’émergence de DO. (1 pt) CONSEQUENCE N°3 - Puisque DO n’apparaît pas dans le paysage, il ne peut subtiliser sa marque de temps au lexème verbal : en l’absence d’auxiliation, bother conserve sa marque de forme finie, celle du prétérit (bothered) et l’ordre sujet-marque de temps persiste, imperturbable, sans broncher d’un cil. (1 pt) POINT N°2 : LA PREDICATION (1 pt) 1e CONSTATATION - On sait que l’opération de prédication consiste à lier une notion de type nominal avec une notion de procès pour faire de la première un sujet syntaxique et de la seconde un prédicat—un prédicat dont le domaine d’application se restreint au seul sujet
4 L’intonation descendante correspond à une simple demande d’information, à une demande purement formelle. On ne saurait pourtant écarter l’intonation montante dans le cas où l’énonciateur ferait preuve d’un intérêt personnel ou de sollicitude envers son co-énonciateur. On constate qu’alors les critères ne sont plus purement syntactico-sémantiques—ils sont pragmatiques.
15
syntaxique (H. Adamczewski, Grammaire linguistique de l’anglais, p. 10). Le résultat est l’obtention de la relation prédicative. (1 pt) Cette relation prédicative peut être validée par attribution d’une forme finie au verbe—éventuellement au premier de ses auxiliaires. 2e CONSTATATION - Nous constatons que notre énoncé comporte un sujet, what ainsi qu’un groupe prédicatif qui réunit un verbe, bother, et son C.O.D., you. Nous constatons en outre que le verbe est à une forme finie qui vient valider la relation prédicative. Quelle est cette relation prédicative ? Elle unit un prédicat qui correspond à la notion de procès « bother » à un sujet, what, qui ne correspond à aucune notion nominale. (2 pt) CONSEQUENCE - Puisque la place de sujet n’a pas pu être instanciée au moyen d’un lexème correspondant à une notion, c’est un sujet-support, variable de parcours de tous les Instruments possibles, qui vient la remplir. Puisque la PROforme what est mise pour tout Instrument possible du procès « bother », c’est qu’elle ne remplit la fonction de sujet que par un acte de subrogation parfaitement conventionnel. What est un fantôme de sujet. (1 pt) Or le sujet, au niveau syntaxique, correspond au point de départ de la relation prédicative et, au niveau notionnel, au terme source du procès : s’il n’y a pas de terme source à proposer, il est impossible de poser une relation prédicative. Si une relation prédicative est tout de même construite, c’est à titre purement formel, pour pouvoir poser une question à son propos—poser une question à propos d’un sujet virtuel. (1 pt) Il en résulte que what remplit ici la fonction de sujet à titre d’image de toutes les notions nominales possibles : c’est une variable de parcours. En tant que variable de parcours, what ouvre le paradigme de toutes ces virtualités de sujet (l’axe paradigmatique est bien celui des virtualités). Comme le disent André Joly et Dairine O’Kelly (Grammaire systématique de l’anglais, p. 247), lorsque la question porte sur le sujet « le verbe est incident à un sujet-support qui n’est pas posé mais simplement virtualisé. » CONCLUSION De quelque côté que l’on se tourne,
- que ce soit vers l’opération de focalisation, inexistante, - que ce soit vers l’opération de prédication, non réellement posée,
on se trouve confronté à une double impossibilité : - celle de voir paraître DO dans les parages - celle de voir inversé l’ordre sujet - marque de temps. (1 pt)
Pas de seconde opération (focalisation) succédant à une première (prédication) ; partant, pas de création de profondeur dans le champ énonciatif. CONCLUSION DE LA CONCLUSION Au lieu que l’absence de DO dans une question de type ouvert portant sur le sujet apparaisse comme une anomalie par rapport à la règle générale, elle confirme, au contraire, cette règle. DO n’est pas un marqueur d’interrogation : c’est précisément si DO surgissait obligatoirement pour interroger sur l’Instrument de bother qu’apparaîtrait une gigantesque exception à la règle générale. (2 pt)
16
ELAN26 2e session SEPTEMBRE 2002 Linguistique et grammaire III B EPREUVE SYNTHETIQUE de GRAMMAIRE :
What did you think [at the time] ? Décrivez et justifiez les différentes étapes de la genèse de cet énoncé à partir de l’énoncé affirmatif correspondant. (Vous n’avez pas à tenir compte des constituants entre crochets carrés.)
Corrigé
Cet énoncé représente une question de type ouvert. La question porte sur le constituant C1 dont la place n’a pas pu être instanciée par une unité du lexique (lors du passage par les règles lexicales). La forme affirmative primitive de cet énoncé est donc : *You thought GN [at the time]. 5 (1 pt) Nous nous contenterons d’une interprétation syntaxique stricte (étapes de la genèse de l’énoncé proposé à partir de l’énoncé affirmatif ci-dessus) mais une interprétation de type intersubjectif pouvait également s’envisager (I/we thought GN). GN est un symbole catégoriel. On ne trouve pas le symbole GN dans la langue de tous les jours. Opération n° 1 - PRONOMINALISATION = SUBSTITUTION D’UNE PROFORME AU CONSTITUANT NON INSTANCIE (1 pt) Afin de mettre en question le constituant dont la place n’a pu être instanciée, il est nécessaire de faire appel à un “ pronom ” interrogatif ou, plus exactement, à une PROFORME interrogative (puisqu’il ne s’agit pas du substitut d’un nom—pro-NOM—mais de celui d’un GN—pro-GN). Cette proforme doit être munie d’un WH- rhématique puisque l’élément en question est tellement nouveau qu’il ne peut être nommé. Ce WH- crée un déficit qui demande à être comblé : il ouvre sur l’axe paradigmatique un éventail de possibilités entre lesquelles le coénonciateur devra choisir : les prétendus “ pronoms ” interrogatifs sont tous des VARIABLES qui PARCOURENT un paradigme virtuel de constituants figurant sur l’axe de la sélection (c’est-à-dire sur l’axe paradigmatique). Le GN en question possède le trait sémantique (sème) ‘non animé’ : c’est donc le PRO-Groupe Nominal what qui est choisi pour représenter dans l’énoncé le symbole catégoriel GN : (*) You thought WHAT [at the time] ? What est une variable de parcours : une variable qui parcourt tous les GN susceptibles de servir de terme-but à la notion relationnelle “ think ”, sans jamais s’arrêter à aucun. (1 pt) Cet énoncé, tout à fait attestable dans un style colloquial—pour ne pas dire slipshod—nécessite une opération supplémentaire pour conquérir son droit d’entrée dans la langue soutenue ou simplement standard.
5 C’était bien GN qu’il fallait postuler comme C1 et non une séquence attestable dans la langue anglaise comme, par exemple : You thought she was crazy. Car alors, comment expliquer une question si la réponse est déjà connue ? En termes linguistiques, cela signifie que la transformation interrogative est automatiquement déclenchée chaque fois qu’un constituant n’a pu être instancié au moment du passage par les règles lexicales. Inversement, si tous les symboles caztégoriels ont pu être remplacés par des unités du lexique, la transformation interrogative n’a pas lieu d’être.
17
Opération n° 2 - FOCALISATION De façon quasi automatique on assiste à une montée du GN non instancié (sous la forme what) en tête de séquence. Pourquoi ? Parce que c’est justement là l’objet de la question. Le sujet énonciateur (S0) sait [en termes linguistiques, on parlera de présupposition]—il sait qu’à l’époque envisagée (at the time) son co-énonciateur a eu une certaine idée de la situation prise en référence mais il ignore laquelle.6 Autrement dit [= en termes grammaticaux, cette fois-ci] la relation Sujet (you)—Prédicat (think) est acquise (= présupposée). C’est le C1 correspondant à l’Objet Affecté par le procès think qui est soumis à interrogation ; c’est lui qui est placé sous les feux de la rampe. � “ Placé sous les feux de la rampe ” : cela veut dire [en termes linguistiques] que c’est très exactement ici que vient prendre place l’opération de focalisation. Le savoir antérieur du S0 (You thought GN) dont il vient d’être question est mis au rang des vieilles lunes (= présupposé) afin de pouvoir placer au centre de l’intérêt et mettre en valeur ce qui fait l’objet de la question. Autrement dit [= en termes linguistiques et grammaticaux, cette fois-ci] la relation prédicative se trouve rejetée dans l’antériorité opérationnelle et mise au rang de la présupposition (1 pt) lorsque survient une opération nouvelle—nouvelle par rapport à l’opération première de prédication—qui a pour but de focaliser le GN non instancié en tête de séquence sous les espèces d’une proforme interrogative en WH- (ici, what) : (1 pt) * WHAT you thought [at the time] ? � Dès cet instant, l’opération de focalisation suscite l’épiphanie de do 1°) pour représenter en la résumant la relation prédicative et 2°) pour servir de cible (abstraite) et de réceptacle à cette nouvelle opération. (1 pt) Ceci, bien entendu, à condition que ne se trouve pas déjà dans le Groupe Verbal un représentant explicite et autonome de l’opération de prédication, autrement dit, un auxiliaire. Dans ce cas (dans le cas où le GV ne comporte pas d’auxiliaire), do apparaît comme il le fait chaque fois qu’est remise en cause la relation prédicative ; chaque fois qu’il est besoin d’effectuer un travail supplémentaire à l’endroit de cette relation. (1 pt)
Lorsqu’il surgit, do vient se placer immédiatement à la droite du constituant propulsé en tête d’énoncé par la nouvelle opération de focalisation afin de servir de cible directe à cette opération. Du coup do se trouve à l’interface entre l’ancien (à sa droite) et le nouveau (à sa gauche) : il marque la séparation entre : (1 pt) • l’opération première, celle de prédication (représentée par la relation prédicative Sujet—
Prédicat rejetée en fin de séquence) et (1 pt) • l’opération seconde, celle de focalisation (représentée dans l’énoncé par le C1 placé en
première position). (1 pt) *What DO you thought [at the time] ?7
6 Bien entendu, cette exégèse n’a rien à voir avec une explication grammaticale. Elle constitue un commentaire sur une situation (réalité extra-linguistique) alors qu’une explication grammaticale met en jeu les opérations constitutives d’un énoncé et en rend compte. L’explication grammaticale porte sur des formes et sur des opérations en contexte (réalité linguistique). C’est la phrase suivante qui est chargée de la chose. 7 Il est évident que des phrases aussi agrammaticales ne sont ici présentées que pour la clarté de l’exposé. Chaque étape, numérotée de 1 à 3, n’est postulée qu’à titre didactique. La progression se fait pas à pas en envisageant chaque modification l’une après l’autre, de 1 à 5. On ne saurait, par exemple, concevoir l’apparition de do sans la captation concomitante par cet auxiliaire de l’héritage temporel de thought.
18
� Do est un auxiliaire : dès qu’il apparaît dans le paysage prédicatif, il devient, en cette qualité de (premier) auxiliaire, le nouvel opérateur de prédication au lieu et place du verbe à une forme aoristique (1 pt) et, à ce titre, c’est lui qui reçoit les insignes de la temporalité. En d’autres termes, le marqueur {ED} de prétérit qui était incident au lexème verbal think migre vers le nouvel arbitre des élégances prédicatives, do, auquel il s’amalgame pour donner lieu à did : (1 pt) What DO you THINK + ED [What] did [you think] [at the time] ? C1 OPERATEUR DE PRED. REL. PRED. 1er plan arrière-plan
focalisation frontière présupposition
� Du même coup think se trouve privé de sa marque de forme finie, ce qui traduit bien le rejet de la relation prédicative dans le préconstruit, à l’arrière-plan énonciatif : elle se trouve réduite à sa plus simple expression, Sujet (you) — Prédicat (think), prédicat ramené à sa forme non finie d’infinitif. (1 pt) La focalisation introduit ainsi un décalage (une profondeur énonciative) entre la relation prédicative mise au rang de la présupposition et reléguée à l’arrière-plan, d’une part, et, d’autre part, le constituant promu à la première place par focalisation. (1 pt) De ce décalage témoigne l’inversion entre le marqueur de temps (porté par do, sous sa forme did) et le sujet (you).8 (1 pt) � En outre, dès qu’apparaît une inversion entre le sujet et l’auxiliaire porteur de la marque de temps grammatical, l’assertion—positive ou négative—se trouve suspendue. (1 pt) En d’autres termes, l’ordre canonique de l’énoncé affirmatif est : Sujet—marque de Temps. Cet ordre traduit l’adéquation du linguistique à l’extra-linguistique (Cotte 1996:107). L’inversion de cet ordre signifie, à l’opposé, que la relation référentielle est suspendue, que l’assertion n’est ni positive ni négative. “ Désormais l’énonciateur ne parle plus sous le contrôle des faits mais c’est lui seul qui pose d’entrée une adéquation fictive ” (Cotte 1996:108). Le pôle positif est abandonné sans que pour autant le pôle négatif ne soit rallié.9 L’assertion est en suspens ; elle est mise en attente ; elle est mise en stand-by. Il n’est mis fin à ce suspense que par l’apport d’une réponse qui vient combler le vide constaté. Alors, mais alors seulement peut-on construire un énoncé résolument positif : ‘What did you think [at the time] ?’ ‘I thought you might have fared worse !’ Plus de constituant focalisé dans la réponse, plus de décalage de la relation prédicative, plus de mise en suspens de l’assertion. L’ordre des éléments redevient Sujet—Temps grammatical et la relation prédicative (I—thought) est à nouveau validée ; l’adéquation au réel, retrouvée. 8 Certains ont prétendu voir là une inversion entre le sujet (you) et le verbe (think) ! M. Afflelou peut certainement faire beaucoup pour eux... 9 V. Pierre Cotte, L’Explication grammaticale de textes anglais (Paris : PUF, 1996), p. 107.
19
Evaluation finale UNE REMARQUE PREALABLE Du point de vue des opérations constitutives de l’énoncé, nous avons pris en compte deux opérations successives : deux opérations dont chacune mettait en cause la relation prédicative :
1. la prédication 2. la focalisation.
L’opération de prédication est, bien entendu, commune aux deux énoncés affirmatif et interrogatif. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’il a été rendu compte du passage de l’énoncé affirmatif à la question de type ouvert, cette opération n’a pas eu à intervenir. En revanche il a été tenu compte d’une autre opération qui n’impliquait en rien la relation prédicative ni, à proprement parler, la construction de l’énoncé : une opération par défaut qui remplace par une PROforme en WH- tout Groupe Nominal qui n’a pu être instancié lors de son passage par les règles lexicales. De ce point de vue du passage de l’énoncé affirmatif à l’énoncé interrogatif correspondant, les deux opérations sont donc :
1. la pronominalisation 2. la focalisation.
POINTS DE RESSEMBLANCE ET DE DIFFERENCE ENTRE LES DEUX ENONCES Quels sont, maintenant, les points communs entre les deux énoncés pris en compte :
1. You thought GN 2. What did you think ?
• Le GN sujet you ; le verbe think. • La relation prédicative you—think. • L’ordre GN sujet—Verbe. (1 pt) Quels sont les points qui différencient ces deux énoncés ? • Le remplacement du symbole catégoriel GN par le morphème what. Opération n° 1 (0,5) • La focalisation de la proforme interrogative what en tête d’énoncé. Opération n° 2 (0,5)
Puis les conséquences entraînées par cette opération de focalisation : • L’émergence de do à la droite de what. (0,5) • Le passage du marqueur de temps grammatical du verbe think à l’auxiliaire do avec pour
corollaire le passage de la fonction ‘opérateur de prédication’ du verbe à l’auxiliaire. (0,5) • Le rejet de la relation prédicative à une forme non finie à la droite de l’énoncé (rejet dû à la
promotion de what en tête de séquence) = elle est décalée dans la présupposition. (0,5) • L’inversion entre le marqueur de temps et le sujet avec mise en suspens de l’assertion.
(0,5)
20
ELAN 26 JUIN 2003
Epreuve synthétique de grammaire Corri
The sun never went down with a brighter glory [on the quiet corner in Soho, than one memorable evening when the Doctor and his daughter sat under the plane-tree together.]
Focalisez never de façon à retrouver les premières lignes du chapitre XVII de A Tale of Two Cities. Expliquez chaque pas de votre raisonnement. (Vous n’avez pas à tenir compte des constituants entre crochets carrés.)
INTRODUCTION Remarque 1 – Focaliser un constituant est une opération qui consiste à placer dans une position remarquable un constituant sur lequel le sujet énonciateur désire attirer l’attention de son co-énonciateur. Une position remarquable est la position en tête de séquence.10 (1 pt) Note incidente à la remarque 1 – Placer un constituant en tête de séquence peut très bien n’entraîner aucune autre modification de l’énoncé initial. C’est ce qui se passe lorsque l’opération de focalisation n’a aucune incidence sur la relation prédicative : You’ve got some daughter ! → Some daughter you’ve got ! (Groussier & Rivière 1996:84) I felt an utter fool → An utter fool I felt too! (Quirk 1972:946) Remarque 2 – Mais s’il s’agit d’un constituant qui remette en cause d’une manière ou d’une autre l’opération de prédication (constituant interrogatif, négatif, restrictif ou, au contraire, intensif), alors l’opération de focalisation entraîne un remaniement supplémentaire de l’énoncé : une inversion du sujet et du morphème porteur de la marque de temps grammatical . (1 pt) Remarque 3 – Never est un constituant modalisé (un opérateur de parcours muni d’une modalité négative), extérieur au groupe verbal mais portant sur la relation prédicative.11 Sa focalisation apparaît donc bien comme opération seconde affectant la relation prédicative : opération seconde par rapport à une opération première qui est celle de prédication. Cette focalisation entraîne alors nécessairement le remaniement supplémentaire dont il vient d’être question. (1 pt) Le chemin est maintenant tracé ; nous savons où nous allons : nous pouvons donc procéder aux manipulations voulues. 10 Focaliser peut également consister à placer un élément en fin de séquence (en position rhématique), par exemple lorsqu’au passif l’Agent n’est pas effacé mais conservé et introduit par la préposition by (the mug was broken by Anthony of all people !). Pour end-focus, v. Quirk 1972:943-44. 11 La négation ne nie pas le seul constituant ever : ce n’est pas une négation de constituant mais une négation de phrase. La preuve en est qu’un ajout interrogatif prendrait immanquablement la forme affirmative : The sun never went down with a brighter glory, did it ? Alors que ce ne serait pas le cas avec une négation de constituant. Unfortunately the sun went down completely unnoticed, didn’t it ? Ni unfortunately ni unnoticed ne constituent des négations de phrases : l’ajout interrogatif revêt alors une forme négative. C.Q.F.D.
21
Opération n° 1 – PREDICATION Cette opération est la première opération constitutive de l’énoncé. Elle concerne l’énoncé proposé comme point de départ : elle n’intervient donc pas dans notre raisonnement sinon à titre de préalable acquis. Ce qui est acquis est donc l’union du sujet the sun et du prédicat went down. Opération n° 2 – NEGATION Est également acquise une opération de négation qui, parce qu’elle n’est pas incidente au Groupe Verbal (contrairement à ce qui serait le cas avec la particule négative not dans the sun didn’t go down…) mais à l’indéfini ever, n’entraîne pas l’émergence de do comme support de cette négation. Opération n° 3 – FOCALISATION C’est en ce point précis que débute notre cheminement, accompagné du raisonnement qui le soutient—raisonnement en 9 points. 1 - La seule focalisation du constituant négatif never en tête de séquence donne lieu à un énoncé mal formé : *Never the sun went down with a brighter glory than one memorable evening… Cette manipulation entraîne, comme nous l’avons remarqué (remarque 3 + remarque 2) un remaniement supplémentaire de l’énoncé. (1 pt) 2 - Afin de servir de cible (abstraite) et réceptacle à l’opération de focalisation d’une négation de phrase, l’opération première de prédication doit se trouver un lieutenant qui la reprenne et la résume. (1 pt) La focalisation marque l’intervention du So dans son énoncé et toute intervention de ce type se traduit par une auxiliation du Groupe Verbal. Si le GV ne comporte pas déjà un tel auxiliaire—c’est-à-dire un représentant explicite et autonome de l’opération de prédication—dans ce cas, do apparaît comme il le fait chaque fois qu’est remise en cause la relation prédicative ; chaque fois qu’il est besoin d’effectuer un travail supplémentaire à l’endroit de cette relation. (1 pt) Do fonctionne alors comme opérateur de reprise, de reprise non pas anaphorique (il ne reprend pas un terme ; il ne reprend pas le verbe), mais de reprise d’une fonction : do reprend la fonction prédicative. Il s’ensuit un partage des tâches entre do—morphème grammatical, chargé des relations entre termes de l’énoncé—et go, morphème lexical, chargé de la médiation entre le linguistique et l’extra-linguistique, chargé aussi de distribuer les fonctions syntaxiques qui relèvent de la rection verbale. (1 pt) 3 - Lorsqu’il surgit, do vient se placer à la droite immédiate du constituant propulsé en tête d’énoncé par la nouvelle opération de focalisation. Ceci, afin de servir de cible directe à cette opération : (1 pt) *Never DO the sun went down with a brighter glory than one memorable evening… Ce stade intermédiaire n’est posé qu’à titre indicatif : il est évident que nous avons affaire à un énoncé mal formé. 4 - En effet, le premier (ou seul) auxiliaire d’un GV est opérateur de prédication et, à ce titre, porte nécessairement la marque de forme finie. L’auxiliaire do, survenant dans le paysage prédicatif, revêt les attributs de sa fonction d’opérateur de prédication et s’empare de la marque de prétérit que lui cède went pour devenir go : Never did the sun go down with a brighter glory than one memorable evening… (1 pt)
22
5 - Du coup do se trouve à l’interface entre l’ancien (à sa droite) et le nouveau (à sa gauche). Il marque la séparation entre : (1 pt) • l’opération première, celle de prédication (représentée par la relation prédicative Sujet—
Prédicat, the sun/go down), à sa droite, et (1 pt) • l’opération seconde, celle de focalisation (représentée dans l’énoncé par le placement de
never en première position), à sa gauche. (1 pt) 6 - Ce décalage de la relation prédicative à la droite de l’énoncé crée une profondeur énonciative avec un premier plan (never focalisé à gauche de did) et un arrière-plan (la relation prédicative the sun/go down rejetée à droite de l’opérateur de prédication). Parce que never est placé sous les feux de la rampe—focalisé—la relation prédicative, elle, se trouve reléguée à l’arrière-plan énonciatif. (1 pt) 7 - Le fait qu’un auxiliaire apparaisse dans le paysage énonciatif a pour effet immédiat qu’il s’empare de la marque de temps grammatical au détriment du lexème verbal (point 4). Il s’ensuit que la relation prédicative qui est décalée à la droite de l’énoncé, est une relation prédicative dépourvue de sa marque de forme finie, une relation prédicative démonétisée du point de vue de l’opération première de prédication, une relation prédicative dont le verbe ne joue plus le rôle d’opérateur de prédication. Autrement dit, la relation prédicative se trouve rejetée dans l’antériorité opérationnelle (1 pt) et mise au rang de la présupposition. (1 pt) 8 - Le décalage de la relation prédicative en queue d’énoncé est la traduction syntaxique de sa relégation à l’arrière-plan énonciatif, de son rejet dans l’antériorité opérationnelle aussi bien que de sa mise au rang de présupposition. (1 pt) 9 - En outre, dès qu’apparaît une inversion entre le sujet (the sun) et l’auxiliaire porteur de la marque de temps grammatical (did), l’assertion—positive ou négative—se trouve suspendue.12 (1 pt) L’inversion entre l’opérateur de prédication (do) et le sujet (the sun) témoignait de la profondeur énonciative crée (points 6, 7 et 8 supra). L’inversion entre marqueur de forme finie (ED) et sujet (the sun) témoigne du trajet parcouru depuis le pôle négatif (The sun never went down with a brighter glory) jusqu’au pôle positif (but one memorable evening, it did). (1 pt)
SCHEMA FINAL
relais prédicatif DO [Prétérit]
relation predicative THE SUN / GO DOWN OPERATION PREMIERE
N e v e r DO sert de cible et réceptacle à l’OPERATION SECONDE : à la focalisation de never.
DO reprend et résume la relation prédicative
Never did the sun go down… (2 pt)
12 V. Pierre Cotte, L’Explication grammaticale de textes anglais (Paris : PUF, 1996), pp. 106-08.
23
[Voir H. Adamczewski, Grammaire linguistique de l’anglais, § 4.4.2, pp. 98-100. Voir également le corrigé du sujet de grammaire de septembre 2001.]
24
Corr
ELAN 26 SEPTEMBRE 2003 Epreuve synthétique de grammaire
Montrez ce qui oppose will à shall. (Pensez aux tableaux d’Antoine Culioli et de Paul Larreya.) Faites apparaître dans quels cas cette opposition se trouve neutralisée ou, à tout le moins, réduite à sa plussimple expression. Vous appuierez votre raisonnement d’exemples adéquats.
1. Les relations d’opposition au sein du carré central des auxiliaires de modalité Les oppositions qui règlent les relations entre les quatre unités qui forment le cœur du système des auxiliaires modaux de l’anglais peuvent se représenter au moyen d’un tableau à double entrée, ainsi que le propose Antoine Culioli (entrées en caractères gras) et, à sa suite, Henri Adamczewski (entrées en caractères maigres et de moindre taille) :
Visée orientation vers la prédication
non-Visée pas d’orientation
vers la prédication →S
relation prédicative non inhérente
shall
phase 1
may
phase 1
S→/ relation prédicative
inhérente
will
phase 2
can
phase 2
(1pt) La présentation de Culioli est fondée sur le sujet de l’énoncé (S), ou sujet syntaxique ;
celle de Larreya prend pour point de repère le sujet énonciateur (S0) :
Conséquencenécessaire
possibilité
S0→ nécessité/possibilité :
procède du S0
shall
nécessité subjective
may
possibilité subjective
(S0) nécessité/possibilité : indépendante du S0
will
nécessité objective
can
possibilité objective
(1pt)
25
Ces deux présentations sont tout à fait compatibles ; shall et will peuvent ainsi se noter de la manière suivante, en combinant les deux notations : S0→S pour shall (S0) / S→ ou (S0) / pour will. (1pt) [Mais puisque Larreya met le sujet énonciateur hors circuit, la représentation qui vient d’être donnée de will peut se ramener à celle de Culioli (S→/ ). L’intérêt de combiner les deux notations ne vaut donc que pour shall.] Le cadre du raisonnement est le suivant : aucune unité ne saurait avoir d’existence linguistique, c’est-à-dire de valeur, sinon par opposition avec au moins une autre unité. Shall et will prennent ainsi leur valeur à l’intérieur du système formé par les auxiliaires modaux et, singulièrement, au sein du carré central de cette classe où ils s’opposent l’un à l’autre ainsi que—respectivement—à may et à can.13 2. Ce qui rassemble shall et will
SHALL et WILL ont un trait commun qui les oppose à l’ensemble can/may : ils visent une occurrence de validation de la relation prédicative : ils expriment la visée (A. Culioli) ; autrement dit l’orientation vers la prédication (H. Adamczewski) ; autrement dit encore, la conséquence nécessaire (P. Larreya). Ce trait, sous ses trois dénominations, constitue la valeur EPISTEMIQUE commune à ces deux auxiliaires. Nous supposerons désormais ce trait présent dans tous nos exemples pour ne plus nous préoccuper que de ce qui oppose shall à will. (1pt)
3. Ce qui oppose shall à will SHALL et WILL s’opposent par leur valeur RADICALE : (1pt) avec SHALL une contrainte pèse sur le référent du sujet syntaxique (→S, A. Culioli) (1pt) parce que le Prédicat ne représente pas une propriété inhérente du Sujet syntaxique (H.
Adamczewski) : pas de relation préexistante entre S et P (phase 1) ; autrement dit, parce qu’il n’existe pas de rapport de congruence entre S et P (J.R. Lapaire & W. Rotgé).
(1pt) Cette contrainte a pour origine le sujet énonciateur, S0 (S0→S), qui est responsable de l’établissement du lien entre S et P : modalité subjective (P. Larreya). I promise you shall see her again before long. (Scheurweghs 1959:372) (1pt) Autrement dit, shall combine le trait ‘procède du S0’ (Larreya) et le trait ‘porte sur le S’ (Culioli).
avec WILL l’origine du procès est localisée dans le sujet syntaxique (S→, A. Culioli) (1pt)
parce que le Prédicat représente une propriété inhérente du Sujet syntaxique (H. Adamczewski) : la relation S-P existe déjà (phase 2) ; autrement dit, parce qu’il existe un rapport de congruence entre S et P (J.R. Lapaire & W. Rotgé).
(1pt) Le lien entre S et P existe indépendamment du sujet énonciateur, S0 , qui reste neutre : will est l’expression d’une modalité objective (P. Larreya). Boys will be boys. (1pt) Autrement dit, avec will le S0 est shunté et—hors cas de la neutralisation de l’opposition avec shall—le seul trait à demeurer est ‘procède du S’ (par opposition à →S).
4. Neutralisation de l’opposition shall∼will 13 Un système, comme chacun sait, est un réseau de valeurs fondées sur des oppositions. C’est exactement ce que font apparaître les deux tableaux, celui de Culioli et celui de Larreya.
26
Les deux valeurs, épistémique et radicale, de shall et de will sont le plus souvent mêlées. Pourtant certains facteurs peuvent intervenir pour neutraliser l’opposition shall~will, c’est-à-dire l’opposition →S ~ S→ et ne plus laisser émerger que la valeur épistémique de visée.14
4.1. SHALL
4.1.1. Réduction de la valeur radicale (S0→S) de shall à sa plus simple expression (S0→) A la première personne, le référent du sujet syntaxique s’identifie au sujet énonciateur : S0 ≡ S. Il y a réflexivité entre source et but déontique, le sujet énonciateur se donnant à lui-même sa propre loi. Dans ce cas, la notion de contrainte (exercée par le S0) pesant sur le S se trouve en grande partie abolie. C’est la valeur de prédiction, la valeur de visée qui prédomine : We shall all be back before dark. (Zandvoort 1961:76) Any problem you have I shall listen to with much care. (Scheurweghs 1959:333) (1pt) Bien difficile ici de déceler une contrainte (→S) pesant sur le S, qu’il s’agisse de we (pourtant couplé à un verbe non agentif) ou qu’il s’agisse de I. Tout au plus ces exemples révèlent-ils un engagement de la part du sujet énonciateur (S0→). Ce dernier n’est donc pas mis hors circuit mais la valeur radicale de shall se trouve singulièrement diminuée.15 (1pt) 4.1.2. Neutralisation complète de l’opposition S0→S ∼ (S0) / S→ La valeur radicale de shall peut totalement disparaître à la première personne (avec identité S0 ≡ S) si la réalisation du procès ne dépend pas du S0 qui ne saurait alors s’engager à ce propos : I shall be 25 next month. (Bouscaren & Chuquet 1987:53) Ici, l’accumulation des conditionnements ‘1e personne’, ‘verbe non agentif’, ‘procès échappant au contrôle du S0’ (c’est-à-dire ‘négation de toute possibilité de S0→)—cette accumulation vient effacer la possibilité de S0→ après avoir gommé toute possibilité de →S. Seule demeure la valeur épistémique de prédiction de la réalisation du procès.16 (1pt)
La valeur radicale de shall (S0→S) peut aussi entièrement disparaître, toujours à la première personne (où S0 ≡ S), en composition avec BE + ING (Adamczewski 1982:174-76 ; Bouscaren & Chuquet 1987:54 et 60 ; Souesme 1992:120 et 148). Si BE + ING filtre la valeur épistémique de shall (ou de will) aux dépens de sa valeur radicale, c’est que la construction BE + V-ING correspond à un verbe d’état c’est-à-dire à un verbe non agentif. Avec cette construction les relations intersubjectives se volatilisent. Ex. :
This time next week I shall be swimming in the Pacific. (Bouscaren & Chuquet 1987:54) In twenty minutes we shall be returning to Albert hall for the second part of the concert. (Adamczewski 1982:175) (1pt)
4.2. WILL
14 Si l’on a shall {visée, →S} et will {visée, S→}, lorsque est neutralisée l’opposition →S ~ S→, seule demeure la valeur de visée. De la même façon (voir corrigé de l’épreuve de linguistique d’ELAN 13 de cette même session de sept. 2003), si l’on a /σ/ <sibilante, sifflante> et /Σ/ <sibilante, chuintante>, lorsque est neutralisée l’opposition /σ/ ∫ /Σ/, seul demeure le trait ‘sibilant’. 15 Mais introduisons la modalité interrogative et aussitôt la valeur radicale de shall reparaît with a vengeance : Shall I open the window ? (Bouscaren & Chuquet 1987:53) Ici le S0 se place en situation de dépendance par rapport à son interlocuteur : quoi qu’il arrive, il s’en remet à la décision de celui-ci. 16 Dire que cette valeur radicale disparaît, c’est dire que son existence ne saurait être reconnue (M. de La Palisse). Et si la valeur radicale de shall n’a plus d’existence, c’est qu’elle ne s’oppose plus à aucune autre (principe premier de la linguistique) : l’opposition entre shall et will se trouve bien alors neutralisée.
27
L’option envisagée au § 4.1.1 ne peut pas jouer de la même façon avec will pour la bonne raison que dans ce cas le sujet énonciateur n’entre pas en ligne de compte. Son identification ou non avec le sujet syntaxique n’a donc aucun lieu d’être envisagée. Il s’ensuit que l’exigence d’identité entre sujet énonciateur et sujet syntaxique, posée au § 4.1.2, n’est plus un préalable à la neutralisation complète de l’opposition shall~will pour la bonne raison évoquée plus haut qu’avec will le S0 n’est pas pris en compte. Parce que pour ce qui est de will le S0 est court-circuité, la neutralisation de l’opposition shall~will fonctionne dès que l’opposition →S ~ S→ se trouve neutralisée. C’est ce qu’exprime A. Culioli en déclarant will terme non marqué de l’opposition shall~will.
(1pt) Deux cas sont alors à envisager. Le premier est celui où HAVE + EN ou BE + ING vient filtrer la valeur épistémique de will aux dépens de sa valeur radicale. Seule subsiste alors la valeur de visée : (1pt) You will have heard that I am going to America. (Zandvoort 1961:77) He’s three hours late already. He will have had an accident, I’m afraid. (Souesme 1992:148) In a few seconds, you will be hearing the chimes of Big Ben for six o’clock. (H. Adamczewski 1982:176) (1pt) Le second est celui où un repère temporel futur est posé qui conditionne l’effet de sens de prédiction, qui donne les pleins pouvoirs à l’expression de la visée : (1pt) Betty will leave tomorrow morning. He will be 30 next month. (Bouscaren & Chuquet 1987:60) He’ll be twelve in September. (Souesme 1992:150) I think it’ll rain tomorrow. (Larreya & Rivière 1999:102) (1pt) Ici will indique que la prédication est envisageable (= critère épistémique ‘orienté vers la prédication’) parce que l’énonciateur sait que la relation entre le sujet grammatical et le prédicat existe : la relation entre Betty et leave tomorrow ou celle entre he et be 30. Ceci est également vrai du dernier exemple même si dans le cas des prédicats atmosphériques le C0 n’est pas thème. Ce qui est visé est la réalisation du procès rain. Chez shall et will, nous l’avons constaté dès le départ, les deux valeurs épistémique et radicale se trouvent réunies, contrairement à ce qui se passe chez les autres modaux où c’est le contexte qui fait émerger l’une ou l’autre comme effet de sens local. Par exemple la nécessité exprimée par must peut prendre tantôt le visage de l’inférence (the chicken must be ready), tantôt celui de l’obligation (the chicken must be ready by one o’clock). Lorsque le contexte intervient de façon significative pour neutraliser17 l'opposition entre shall et de will, c’est pour ne plus laisser apparaître que ce qui leur est commun, la visée d’une occurrence de la validation de la relation prédicative. Resteraient à prendre en compte les cas où disparaît cette visée (ex. : If you will please follow me, I’ll show you the way) mais ceci est une autre histoire.
17 Pour la définition de la neutralisation, voir le corrigé du sujet de linguistique d’ELAN 13 de la première session 2003.
28
Bêtisier - « He will go to the cinema tomorrow. » Ici c’est la valeur épistémique qui prime. De même dans « oil will float over water » il n’y a aucune valeur de visée non plus.
- WILL n’a une valeur radicale que l’orsque l’opposition shall ∫ will est neutralisée c’à dire l’orsque be-ING » apparaît. - C’est la visée et la non visée qui oppose will à shall. Dans la cas de l’opposition entre visée/non visée pour Antoine Culioli shall exprime la visée et will la non visée. Il considère dans ce cas que le prédicat prend sa valeur dans le sujet syntaxique et cette valeur est ensuite neutralisée. Il y a un rapport de congruence entre le sujet et le prédicat pour shall et will. Will et shall ont tous deux une valeur de futur et de volonté. -Avec WILL on a une visée. Avec SHALL on a une congruence (adéquation entre l’intra et l’extra linguistique) ou non congruence. - WILL et SHALL expriment tous deux la volonté dans le futur. - Ce qui oppose will à shall c’est que le premier oriente vers la prédication. C’est un opérateur de visée alors que shall n’oriente pas vers la prédication. - Will exprime une certitude subjective purement factuelle. - Shall introduit une propriété du sujet.
Langue française - Le sujet syntaxique a toutes les propriètes, les caractéristiques pour s’associé au prédicat. « he » n’a pas de propriétés inhérentes qui puisse l’associé au prédicat. Le sj syntaxique à toutes les propriété pour s’associer au prédicat. - La Modalité IV réfère au relation entre le Sujet syntaxique et le prédicat. - « Oil » a toutes les caractéristiques naturels necessaire pour être lié au prédicat. - On peut voire la Modalité II prendre le dessus sans forcément nié l’autre. - Le sujet syntaxique a toutes les propriétés necessaire pour être lié au prédicat. - une source exterieur au sujet - Ce ne sera plus du aux propriétés du sujet syntaxique. - Lorsque l’énonciateur emploi WILL ou SHALL, … - Shall et will s’oriente tous les deux vers la visée. - S’il on avait eu « will » …
29
ELAN 26 JUIN 2004
Epreuve synthétique de GRAMMAIRE
Corrigé
Sujet analogue donné en septembre 2001 et
No member of staff must socialize with the inmates, under any circumstances. Focalisez le constituant under any circumstances. Que se passe-t-il ? Expliquez-le pas à pas. ETAPE N°1 Focaliser un constituant, c’est, pour le sujet énonciateur, attirer l’attention de son co-énonciateur sur cet élément en le plaçant en un point remarquable de l’énoncé. Une position remarquable est la position en tête de séquence.18 (1 pt) no member of staff must socialize with the inmates, under any circumstances *under any circumstances no member of staff must socialize with the inmates (1 pt) ETAPE N°2 L’énoncé obtenu est mal formé. Pourquoi ? Parce que l’opération de focalisation à la quelle il vient d’être procédé affecte un constituant porteur du quantifieur indéfini any.19 Or parmi les quantifieurs indéfinis (a, a single, one, many, all, every, …), certains n’apparaissent qu’en contexte non assertif et en particulier dans le champ d’une négation (c’est souvent le cas pour a single, much ou many ; toujours pour le curseur quantitatif any ou pour le curseur temporel ever [voir le cours de seconde année]). Dans l’énoncé proposé, any apparaît dans le champ de la négation de phrase portée par le constituant sujet no member of staff.20 (1 pt)
Tout indéfini placé à gauche de la marque de temps grammatical attire à lui la négation et il l’incorpore s’il s’agit de not. (2 pts)
Si plusieurs indéfinis figurent à gauche de la marque de temps, c’est au premier d’entre eux que revient la charge de porter la négation. Cette négation, incidente à l’indéfini any, déterminant de member (no = not + any), migre donc vers l’indéfini any, déterminant de circumstances (any + not → no) :
*under any circumstances not + any member of staff must socialize with the inmates
*under no circumstances any member of staff must socialize with the inmates (1 pt)
18 Voir notes des sujets de septembre 2001 et juin 2003 sur la thématisation, la focalisation et la mise en relief. 19 Il s’agit bien du any quantitatif et non du any qualitatif qui pourrait apparaître dans any shrimp could have told you that (Lewis Carroll). [Voir le cours de seconde année sur le GN.] 20 Une négation de phrase (par opposition à une négation de constituant) porte sur la relation prédicative. L’un des tests révélateur de son statut est celui du question tag positif : No member of staff must socialize with the inmates, must they ? She isn’t happy, is she ? Sinon, la négation est une négation de constituant : She’s unhappy, isn’t she ? She forced him not to smoke, didn’t she ?
30
L’énoncé obtenu, à nouveau, apparaît comme mal formé. ETAPE N°3 Quelle en est la raison ?
Une fois la relation prédicative posée (première opération dans la formation d’un énoncé), (1 pt) chaque fois qu’il est besoin d’effectuer un travail supplémentaire à son endroit, elle doit se manifester sous la forme d’un représentant explicite et autonome. Si la forme verbale n’en comporte pas déjà un, do apparaît pour jouer ce rôle. Ce n’est pas le cas ici puisqu’il existe un opérateur de prédication, must, indépendant du lexème verbal. C’est donc must qui sert de cible et réceptacle à la nouvelle opération, celle de focalisation. (1 pt) Ceci n’a aucune implication pour l’acceptabilité de notre énoncé : must est présent, must demeure. Ce qui, en revanche, a une implication, c’est la place où doit apparaître l’opérateur de prédication. Il doit survenir à la proximité immédiate de l’élément auquel il sert de cible, c’est-à-dire à droite de under no circumstances : (1 pt) *under no circumstances any member of staff must socialize with the inmates under no circumstances must any member of staff socialize with the inmates (1 pt) Cette fois-ci, notre énoncé est bien formé.
EVALUATION
Qu’y a-t-il de changé par rapport à l’énoncé primitif ? - Le déplacement de under any circumstances à gauche de l’énoncé (étape n°1) ; - la migration de la négation (qui était incorporée au quantifieur indéfini any,
déterminant de member, sous la forme de no) au déterminant any de circumstances, premier indéfini à précéder le marqueur de temps grammatical, auquel il s’incorpore pour donner no (étape n°2) ;
- la migration de l’opérateur de prédication, must, à la droite immédiate du constituant affecté par l’opération seconde de focalisation (étape n° 3).
Cette migration entraîne une inversion entre le sujet grammatical any member of staff et la marque de temps. Cette inversion, il faut en rendre compte. (1 pt)
Il a déjà été remarqué que deux opérations successives marquaient l’énoncé final : • 1. la construction d’une relation prédicative, (NO) MEMBER OF STAFF / (MUST) SOCIALIZE… • 2. la focalisation de l’un des constituants de l’énoncé, UNDER ANY CIRCUMSTANCES. Cette focalisation rejette l’opération première à l’arrière-plan énonciatif21 (1 pt) et, par là même, introduit une profondeur dans le champ énonciatif en fragmentant les opérations constitutives de l’énoncé en deux plans d’énonciation, décalés l’un par rapport à l’autre. L’élément qui désormais figure en premier lieu se trouve placé sous les feux de la focalisation ; la relation prédicative, placée en second lieu, est alors rejetée dans l’ombre et le
21 Ainsi que le dirait M. de La Palice, une opération unique ne peut être ni antérieure ni postérieure à quelque autre opération que ce soit. Si survient une seconde opération, elle prend, aurait pu continuer M. de La Palice, la suite de la première. Ainsi se crée une relation d’antériorité-postériorité. La première opération (la prédication) se trouve déplacée à l’arrière-plan énonciatif par la seconde (la focalisation). Autrement dit l’opération de prédication n’est déplacée dans l’antériorité des opérations que lorsque survient une seconde opération : ici, celle de focalisation. C’est cela que signifie le rejet dans l’antériorité opérationnelle et rien de plus.
31
présupposé. La focalisation prend bien en compte l’opération première mais comme présupposé. C’est cette présupposition que matérialise l’inversion entre le sujet syntaxique et le marqueur de temps grammatical (comme c’est aussi le cas pour l’interrogation). (1 pt) L’inversion en question a également pour effet d’extraire l’opérateur de prédication de sa position de lien entre le sujet, member of staff, et le prédicat, socialize et ainsi de suspendre l’assertion comme en témoigne (1 pt) 1 – le fait que sujet et prédicat coexistent côte à côte, le prédicat étant représenté par un verbe à une forme non finie : la relation prédicative n’est pas assertée ; 2 – le fait que l’assertion soit dévolue à un auxiliaire sorti du groupe verbal et placé à gauche du point de départ de la relation prédicative, c’est-à-dire à gauche du sujet. Si l’assertion est suspendue, cela se traduit par une oscillation entre ses deux pôles. Le pôle positif est abandonné sans que pour autant le pôle négatif ne soit atteint ou même visé [Cotte 1996 : 107]. Mais cette mise en suspens de l’assertion à l’arrière-plan s’explique par la focalisation au premier plan du constituant négatif under no circumstances qui oriente résolument l’assertion vers le pôle négatif. (1 pt)
De façon remarquable, must marque la frontière entre les deux opérations : (1 pt) à sa gauche, la modalité négative focalisée qui témoigne de l’opération la plus nouvelle ; à sa droite est rejetée la relation prédicative, qui représente l’opération la plus ancienne, telle quelle, brute de coffrage, sans marque temporelle donc non validée : dans le plus simple appareil : (ANY) MEMBER OF STAFF / SOCIALIZE WITH THE INMATES. (2 pts)
SCHEMA FINAL
relais prédicatif MUST [Présent]
relation prédicative MEMBER / SOCIALIZE OPÉRATION PREMIERE
Under no c. MUST sert de cible et réceptacle à l’OPERATION SECONDE : à la focalisation de under no circumstances.
MUST représente l’OPERATION PREMIERE, celle de prédication
(2 pt)
[under no c.]premier plan ⎯ MUST+∅ ⎯ [(any) member / socialize]arrière-plan Pierre Cotte, L’Explication grammaticale de textes anglais (Paris: PUF, 1996)
32
Bêtisier
ELAN 26 – JUIN 2004
[Les passages entre crochets carrés et en petits caractères sont des explications hors citation.]
GRAMMAIRE
No member of staff must socialize with the inmates, under any circumstances. Focalisez le constituant under any circumstances. Que se passe-t-il ? Expliquez-le pas à pas. - Focaliser, c’est thématiser un élément. - La focalisation revient à placer un constituant en tête de position. - L’élément focalisé devient alors le point de départ de la relation prédicative. - L’opération de prédication consiste à unir un Sujet S (ici “no member of staff”) à un prédicat P (“with the inmates”). - Le sujet arrive toujours en seconde position dans les phrases affirmatives en anglais. - L’élément focalisé comporte un indénombrable : “any”. - L’élément focalisé [under any circumstances] est à une forme négative. - 1 - “under any circumstances” contient un élément negatif “Any”.
- 1 - 1 - Le constituant “under any circumstances” est une “négation” de prédicat.
- Dans notre énoncé, la négation est exprimée deux fois, une fois au moyen de ‘no’ et une seconde au moyen de ‘any’. - 1 - La négation NO doit apparaître dans la séquence focalisée qui comportait déjà un élément négatif (any). - 1
- 1 - Nous sommes en présence de marques de négation : “any” et “no”. - L’énoncé subit une double négation à cause de any et de no. - 1 - Il n’y a pas de négation dans notre phrase. - Le lexème verbal se trouve décharger de la marque de temps au profit de must. - under no circumstances must no member of staff socialize with the inmates: La S/P [= relation prédicative] est privé de sa marque de temps qui a été reprise par le nouvel operateur de prédication must. - L’apparition de must dans le paysage énonciatif a pour effet qu’il s’empare de la marque de temps grammatical. - Ici il n’y a pas d’auxiliaire dans le paysage prédicatif. Do apparaît donc : * under no circumstances do no member of staff must socialize with the inmates. Or l’opérateur de predication Do ne peut être suivi du modal must qui doit être substitué à un lexème verbal, ici have to pour exprimer la nécessité : Under no circumstances do no member of staff have to socialmize with the inmates. Cette fois-ci l’énoncé est bien formé. On constate la migration de la marque de temps de l’ex-opérateur de prédication, le verbe socialize, au nouvel opérateur de prédication, l’auxiliaire Do. - *under any circumstances no member of staff must socialize with the inmates : cet énoncé est mal formé. Ceci est dû à la négation qui suit “no”.
33
- Dans la phrase de départ le constituent “under any circumstances” se trouve à l’arrière-plan énonciatif. - MUST marque la frontière entre l’arrière-plan et le premier plan. Le prédicat de l’énoncé de départ se trouve alors dépouillé de sa forme finie. - Relation prédicative : socialize with the inmates. - Tout changement de place d’un des constituants d’un énoncé entraîne une inversion du verbe et du sujet : focalisons « in the garden » dans Colonel Grant kissed Henrietta in the garden. * In the garden Colonel Grant kissed Henrietta nous avons un énoncé mal formé. - Lorsque l’on focalise un constituant, on a besoin d’un auxiliaire qui va reprendre et résumer la seconde opération de focalisation. - Le constituant “under any circumstances” est un groupe nominal composé ‘under’ adverbe. - Le GN “under any circumstances” est C0. - La focalisation de ce constituant [under no circumstances] est impossible car il contient une préposition et on ne peut jamais trouver en Anglais un C0 contenant une préposition en tête d’énoncé. Français - Focaliser, c’est mettre en exergue une séquence d’un énoncé. Pour se faire on lui donne une place de choix. - La focalisation rejette la S-P [= la relation predicative] dans la postérité opérationnelle. - en troizième position - ANY incorpore à lui la négation. - Elle est dans sa plus expression. - D’abord il advient de définir le terme de “focaliser”. - Le groupe nominale - L’auxiliaire modale - un énoncé incorrecte - le [groupe verbale]n
- la base verbal - Dans cet optique, … - [apparaitre]n
- L’opération à laquelle il vient d’être procédée… - Chaque fois qu’il ê besoin d’effectuer un travail supplémentaire… - L’on met se constituant en tête d’énoncé. - On doit faire appel à un auxiliaire qui reprenne et résume la relation prédicative ai celle-ci perdra sa marque de temps pour n’apparaître que comme charge sémantique. - Le sujet énonciateur cré une profondeur énonciative ai on a deux plans. - Pour qu’une nouvelle opération adviennent, un marquer autonome et explicite est nécessaire. - Il est suivit - l’accent sera mit sur ce constituant - S’il on ôte la virgule… - Nous avons focaliser et placer en tête d’énoncé under any circumstances. - L’énonciateur vient modalisé son énoncé. - must à entraîner une inversion du sujet. - Si il n’y avait pas eu must… - MUST ne se voie pas attribuer la marque de négation. - Malgré qu’il le soit déjà. - L’assertion négative doit apparait une seule fois.
34
- On a donc pas besoin de l’intervention de DO. - DO est à l’interphase entre la première et la seconde opération. - L’énoncé ci-dessu - Quelque soit la situation, … - La relation prédicative se trouve relayée au fin fond de l’énoncé. - La pose de la relation prédicative est relayée dans l’antériorité opérationnelle. - La relation prédicative est alors relayée à l’arrière-plan énonciatif. - La S-P [= relation prédicative] a été relayée, décalée dans le présupposé prédicationnel - La S/P sera donc déléguée dans le préconstruit de l’antériorité opérationnelle. - La première opération est relaguée en fin de phrase. - under any circumstances, no member of staff must socialize with the inmates. Ici en une seule opération, on obtient un énoncé grammaticalement correct. Ceci est du aux faits que ‘under any circumstances’ est un constituant phratique. Cela implique qu’il peut s’inciser dans n’importe quelle partie de la phrase. Anglais - It is under no circumstances that any members of staff must socialize with the inmates. - Under any circumstances, no member of staff must socialize with the inmates. Cet énoncé est attestable. - 2 - Under any circumstances no member of the staff must socialize with the inmates. L’énoncé est correct. - Under any circumstances must no member of staff socialize with the inmates.
- 2 - 2
- On met le verbe à une forme finie en lui faisant porter la marque de temps. No member of the staff socialize with the inmates. - Le passage de “under any circumstances” en tête de séquence, sa focalisation, ne change rien à l’énoncé qui est toujours recevable : Under any circumstances, no member of staff must socialize with the inmates. - Under no circumstances must member of staff socialize with the inmates. - Never do the sun go down. - Under any circumstances must any member of staff socialize with the inmates. - Under any circumstances, no member of staff must socialize with the inmates. L’énoncé est bien formé. - Under any circumstances, a member of staff must socialize with the inmates. - Under no circumstances, any member of staff must socialize with the inmates. Cet énoncé est attestable. - Under any circumstances must member of staff socialize with the inmates. - under any circumstances must a member of staff socialize with the inmates. - It is under any circumstances that no member of staff must socialize with the inmates. - * Whatever under any circumstance, no member of staff must socialize with the inmates. Cet énoncé est mal formé car on a une double négation dans l’énoncé.
35
ELAN 26 SEPTEMBRE 2004
Epreuve synthétique de GRAMMAIRE
Corrigé
Sujet déjà donné en
Qu’entend-on par interrogation ? Quelles en sont les marques? [Soyez explicite dans vos réponses.] L’interrogation est l’une des modalités assertives. (1 pt) Comme les autres opérations d’assertion, elle est seconde par rapport à l’établissement de la relation prédicative. Elle survient donc au moment de la validation de cette relation qu’elle place en suspens. (1 pt)
Le sujet énonciateur (So) y a recours, • soit lorsqu’il ne sait pas comment valider la relation prédicative—de manière positive ou
négative—et qu’il demande à son co-énonciateur de le faire pour lui ; (1 pt) • soit lorsqu’il n’a pu instancier une place d’actant ou de circonstant et que, là aussi, il
demande à son co-énonciateur de le faire pour lui. (1 pt) Dans le premier cas, on parle de question de type fermé car ces questions n’ouvrent la possibilité qu’à deux réponses, oui ou non (yes/no-questions). (1 pt) Dans le second cas, il s’agit de questions de type ouvert, de questions qui ouvrent tout un paradigme d’options possibles (WH-questions). (1 pt) [Nous ne parlerons pas ici de l’interrogation indirecte.]
En tant qu’opération seconde par rapport à l’établissement de la relation prédicative, l’interrogation, pour pouvoir s’appliquer, nécessite l’existence d’un auxiliaire, représentant explicite et autonome de l’opération de prédication. (1 pt)
Cet opérateur de prédication indépendant du lexème verbal remplit deux fonctions
essentielles : 3. C’est cet auxiliaire, en tant que représentant de l’opération de prédication, qui sert de cible
à la nouvelle opération—ici, l’interrogation. (1 pt) 4. C’est cet auxiliaire, opérateur de prédication, qui porte la marque du temps grammatical.
(1 pt) La seconde fonction exclut expressément to ainsi que tout auxiliaire du groupe verbal autre que le premier. Sinon tout opérateur de prédication fait l’affaire. Ce peut être : l’un des sept auxiliaires modaux (shall, will, may, can, must, need, dare), l’un des deux auxiliaires aspectuels (have, be) l’auxiliaire de voix passive (be) l’auxiliaire de modalité assertive, do, pour la forme aoristique des verbes.
La marque de l’interrogation est double : elle focalise en tête d’énoncé le constituant sur lequel porte l’interrogation ; (1 pt) elle impose un contour intonationnel à l’énoncé. (1 pt)
La marque des questions de type fermé est donc double :
36
3. C’est l’auxiliaire affecté de la marque de temps—c’est-à-dire le représentant de la relation prédicative sur quoi porte la question—qui, focalisé, figure en tête d’énoncé. (1 pt)
4. L’énoncé est caractérisé par un rise, c’est-à-dire une intonation ascendante. (1 pt) � Has Gary had breakfast yet ? � Do you remember Peppercue and Barleycorn ? La marque des questions de type ouvert est également double : 3. C’est la PRO-forme mise au lieu et place du constituant non instancié—la variable de
parcours—qui, focalisée parce que la question porte sur elle, passe en tête de séquence (à moins qu’elle ne s’y trouve déjà : cas de la PRO-forme sujet). (1 pt)
4. L’énoncé est alors caractérisé par un fall, c’est-à-dire une intonation descendante. (1 pt) � When did it all happen ? � What can she have been doing, then ? [C’est une seconde courbe qui affecte then !] La montée en tête de séquence, AU PREMIER PLAN ENONCIATIF, de l’auxiliaire représentant l’opération de prédication ou de la PRO-forme représentant le GN non instancié (ce qui exclut la PRO-forme sujet, qui n’a jamais quitté sa place en tête de séquence) est due à la focalisation sur l’opération nouvelle de mise en cause, de mise en question. Elle donne lieu à deux effets concomitants : • D’abord, un décalage de la relation prédicative en queue de séquence, reléguée, à une
forme non finie, dans le préconstruit de L’ANTERIORITE OPERATIONNELLE. (1 pt) Ce décalage crée une PROFONDEUR ENONCIATIVE entre un premier plan focalisé et L’ARRIERE-PLAN auquel se trouve rétrogradée l’opération de prédication représentée par une relation prédicative dépouillée de toute marque de validation. (1 pt)
• Ensuite, une inversion du sujet et du premier (ou seul) auxiliaire—savoir celui qui est
porteur de la marque de temps grammatical. (1 pt) Dès qu’apparaît cette inversion de l’ordre sujet-temps, l’assertion, positive ou
négative, se trouve suspendue. Cela veut dire que le pôle positif est abandonné sans que pour autant le pôle négatif ne soit rallié [Cotte 1996 : 107]. C’est cela l’interrogation, l’interrogation en général, qu’il s’agisse de questions fermées ou de questions ouvertes. Autrement dit, l’interrogation met en question la validation de la relation prédicative en parcourant inlassablement les deux valeurs, positive et négative, de l’assertion sans pouvoir jamais s’arrêter à aucune. (2 pts)
NB1 – Certaines copies ont prétendu que la marque de l’interrogation était l’inversion du sujet et du verbe. Ceci est faux. Prenez un énoncé à la forme affirmative : The Rosner brothers moved in with torrid Hungarian music. L’ordre des éléments est sujet – verbe. Le sujet, the Rosner brothers, est suivi du verbe, move in. Mettez cet énoncé à la forme interrogative (question de type fermé) : Did the Rosner brothers move in ? L’ordre des éléments est toujours sujet – verbe. Le sujet, the Rosner brothers, précède toujours le verbe, move in. NB2 – On dit parfois que la marque de l’interrogation est l’inversion du sujet et de l’auxiliaire. Ceci est faux.
37
1.1 - On peut rencontrer des questions sans inversion. 1°) Questions de type ouvert :
A : Gary swallowed a pair of slugs for breakfast this morning. B : Gary did WHAT ?
[il s’agit alors de langue parlée (ce qui ne saurait constituer une contre-indication à l’acceptabilité linguistique de la chose) et, surtout, il s’agit d’une reprise, d’une réaction (de révulsion) à une affirmation antérieure. NB - Reprise signifie « anaphore ». Do en association avec un something quelconque peut fonctionner comme substitut anaphorique : do so, do it, do that, do what.] 2°) Questions de type fermé : You remember Peppercue and Barleycorn ? ou même : Remember Peppercue and Barleycorn ? [ici encore nous avons affaire à de la langue parlée et la langue parlée peut se satisfaire de l’un des deux traits caractéristiques de l’interrogation, savoir l’intonation ascendante, trait qui, comme dirait M. de la Palice, n’apparaît jamais à l’écrit (sauf à considérer le ‘?’ comme une marque d’intonation montante, ce qu’il n’est pas, bien entendu).] 1.2 - On peut rencontrer des inversions sans qu’elles donnent lieu à interrogation : • (a) Only after repeated divine instructions and signs does Æneas overcome his natural
impulse and obey. (focalisation d’une restriction) • (b) Well do I remember the day when I proposed to her !
(focalisation d’un intensif) De ce point de vue, l’interrogation n’est qu’un cas particulier de l’opération de focalisation. NB3 – On dit parfois que la marque de l’interrogation est do. Ceci est faux. 2.1 - On peut rencontrer do hors des interrogations. Voir (a) et (b) ci-dessus ainsi que :
What Gary did was swallow a pair of slugs. (pseudo-clivée) Gary did swallow a pair of slugs. (emphase)
2.2 - On peut rencontrer des interrogations sans do : Has Gary had breakfast yet ?
NB4 – On peut enfin rencontrer des questions qui ne comportent ni do ni inversion : A : Kevin, then, sent a love letter. B : Who to ? [Néanmoins l’énoncé de B répond bien aux deux critères de l’interrogation : voir ci-dessus.]
Pierre Cotte, L’Explication grammaticale de textes anglais (Paris: PUF, 1996)
Bêtisier
38
ELAN 26, grammaire – JUIN 2004
[Les passages entre crochets carrés et en petits caractères sont des explications hors citation.] - On entend par interrogation une phrase qui se conclut par un point d’interrogation. - L’interrogation est un phénomène du langage qui est caractérisé par l’apparition d’un point d’interrogation à la fin de la phrase. - L’interrogation bouleverse l’ordre de la phrase et à la fin de la séquence nous trouvons un point d’interrogation. - L’interrogation est marquée par la présence du point d’interrogation ( ?). - L’interrogation est le résultat de la focalisation du prédicat. et de l’inversion sujet-verbe. Did he go to London ? - It is unusual for Steve to drinkC1 water. -1 - It is [unusual for Steve Warren to drink water]GN C1 -1 - It surprised [everyone that Henrietta should marry Robert] GN C1 -1 - The problem is [to know what does she want] C1 -1 - La forme aspectuelle Be -en - La relation prédicative est reléguée en queue de séquence à une forme finie. -1 - C’est l’auxiliaire affecté de la marque de temps, c’est-à-dire de la relation prédicative qui, focalisé, figure en tête d’énoncé. - La focalisation a pour marqueur le « special stress » et le clivage. -1 - Le « stress » relève de la prosonique. - On entre dans le domaine de l’oralité qui est grammaticalement incorrect.
39
ELAN 26 juin 2005 Grammaire III B
Epreuve synthétique de GRAMMAIRE (même épreuve qu’en mai 2000 et septembre 2004)
Corrigé Qu’entend-on par interrogation ? Quelles en sont les marques? [Soyez explicite dans vos réponses.] L’interrogation est l’une des modalités assertives. (1 pt) Comme les autres opérations d’assertion, elle est seconde par rapport à l’établissement de la relation prédicative. Elle survient donc au moment de la validation de cette relation qu’elle place en suspens. (1 pt)
Le sujet énonciateur (So) y a recours, • soit lorsqu’il ne sait pas comment valider la relation prédicative—de manière positive ou
négative—et qu’il demande à son co-énonciateur de le faire pour lui ; (1 pt) • soit lorsqu’il n’a pu instancier une place d’actant ou de circonstant et que, là aussi, il
demande à son co-énonciateur de le faire à sa place. (1 pt) Dans le premier cas, on parle de question de type fermé car ces questions n’ouvrent la possibilité qu’à deux réponses, oui ou non (yes/no-questions) : elles n’offrent qu’une seule alternative, le choix entre l’intérieur et l’extérieur du domaine notionnel associé au procès exprimé par le verbe. (1 pt) Dans le second cas, il s’agit de questions de type ouvert, de questions qui ouvrent tout un paradigme d’options possibles (WH-questions).22 (1 pt) [Nous ne parlerons pas ici de l’interrogation indirecte.]
En tant qu’opération seconde par rapport à l’établissement de la relation prédicative, l’interrogation, pour pouvoir s’appliquer, nécessite l’existence d’un auxiliaire, représentant explicite et autonome de l’opération de prédication qu’il reprend en la résumant.23 (1 pt)
Cet opérateur de prédication indépendant du lexème verbal remplit deux fonctions
essentielles : 5. C’est cet auxiliaire, en tant que représentant de l’opération de prédication, qui sert de cible
et réceptacle à la nouvelle opération—ici, l’interrogation. (1 pt) 6. C’est cet auxiliaire, parce qu’il est opérateur de prédication, qui porte la marque du temps
grammatical. (1 pt) La seconde fonction exclut expressément to ainsi que tout auxiliaire du groupe verbal autre que le premier. Sinon tout opérateur de prédication fait l’affaire. Ce peut être : l’un des sept auxiliaires modaux (shall, will, may, can, must, need, dare), l’un des deux auxiliaires aspectuels (have, be) l’auxiliaire de voix passive (be) l’auxiliaire de modalité assertive, do, pour la forme aoristique des verbes.
22 Type est un mot masculin en français. On ne dit pas *une type ouverte mais un type ouvert de question, une question de type ouvert. De même : un château de type moyenâgeux (et non *moyenâgeuse), une réponse de type cinglant (et non *cinglante), une histoire de type belge (et non … ah ben si !). 23 Sauf question portant sur le sujet puisque alors il n’y a pas eu établissement d’une relation prédicative étant donné que le sujet est un sujet-support virtualisé (Joly-O’Kelly 1990:247).
40
La marque de l’interrogation est double : elle focalise en tête d’énoncé le constituant sur lequel porte l’interrogation ; (1 pt) elle impose un contour intonationnel à l’énoncé. (1 pt)
La marque des questions de type fermé est donc double : 5. C’est l’auxiliaire affecté de la marque de temps—c’est-à-dire le représentant de la relation
prédicative sur quoi porte la question—qui, focalisé, figure en tête d’énoncé. (1 pt) 6. L’énoncé est caractérisé par un rise, c’est-à-dire une intonation ascendante. (1 pt) � Has Gary had breakfast yet ? � Do you remember Peppercue and Barleycorn ? La marque des questions de type ouvert est également double : 5. C’est la PRO-forme mise au lieu et place du constituant non instancié qui, focalisée parce
que la question porte sur elle, passe en tête de séquence (à moins qu’elle ne s’y trouve déjà : cas de la PRO-forme sujet). (1 pt)
6. L’énoncé est alors caractérisé par un fall, c’est-à-dire une intonation descendante.24 (1 pt) � When did it all happen ? � What can she have been doing, then ? [C’est une seconde courbe qui affecte then !] La montée en tête de séquence, AU PREMIER PLAN ENONCIATIF, de l’auxiliaire représentant l’opération de prédication ou de la PRO-forme représentant le GN non instancié (ce qui exclut la PRO-forme sujet, qui n’a jamais quitté sa place en tête de séquence) est due à la focalisation sur l’opération nouvelle de mise en cause, de mise en question. Elle donne lieu à deux effets concomitants :
• D’abord, un décalage de la relation prédicative en queue de séquence, reléguée, à une forme non finie, dans le préconstruit de L’ANTERIORITE OPERATIONNELLE. (1 pt) Ce décalage crée une PROFONDEUR ENONCIATIVE entre un premier plan focalisé et L’ARRIERE-PLAN auquel se trouve rétrogradée l’opération de prédication représentée par une relation prédicative dépouillée de toute marque de validation : l’ordre thématique-rhématique est inversé par l’interrogation. (1 pt)
• Ensuite, une inversion du sujet et du premier (ou seul) auxiliaire—savoir celui qui est porteur de la marque de temps grammatical. (1 pt)
Dès qu’apparaît cette inversion de l’ordre sujet-temps, l’assertion, positive ou négative, se trouve suspendue. Cela veut dire que le pôle positif est abandonné sans que pour autant le pôle négatif ne soit rallié. C’est cela l’interrogation, l’interrogation en général, qu’il s’agisse de questions fermées ou de questions ouvertes. Autrement dit, l’interrogation met en question la validation de la relation prédicative en parcourant inlassablement les deux valeurs, positive et négative, de l’assertion sans pouvoir jamais s’arrêter à aucune : (2 pts)
Tu veux ou tu veux pas ? Tu viens, oui ou non ? She’s coming, isn’t she ? She’s not coming, is she ? 他来不来呢 ? tā lái bù lái ne ? « Vient-il ? »
(m. à m., « il vient / pas vient, est-ce que ? »)
24 Un fall comme à la forme affirmative car on sait déjà que la relation prédicative est acquise. La question de type ouvert partage donc des traits avec la question de type fermé—focalisation du constituant frappé du sceau rhématique de l’indécidable et inversion sujet / auxiliaire porteur de la marque de temps (= opérateur de prédication)—d’une part mais aussi avec la forme affirmative de l’énoncé d’autre part—intonation conclusive (fall) traduisant le caractère acquis de la relation prédicative.
41
N.B.1 – Le point d’interrogation < ? > n’est pas une marque spécifique de l’interrogation anglaise. Il s’utilise en français aussi—oui, oui, en français aussi—et également en grec, en hébreu ou en chinois. Le point d’interrogation < ? > est polyglotte ! N.B. 2 – On ne peut pas expliquer une phrase interrogative par la transformation d’une phrase affirmative. On ne peut pas dire : « Prenons une phrase affirmative Peter left at three Cindy plays the violin Et essayons de la transformer en phrase interrogative : When did Peter leave ? Does Cindy play the violin ? » Une question est justement posée parce qu’il manque un élément. L’élément manquant peut être un actant ou un circonstant de l’énoncé (question de type ouvert). Ce peut par exemple être l’heure à laquelle Peter s’est esquivé, le circonstant TIME : Peter left TIME ?. L’élément manquant peut être la validation de la relation prédicative : est-elle à valider, oui ou non ? (question de type fermé) : Cindy play / not play ( ?) the violin. C’est justement ce manque, ce creux sémantique, qui déclenche la transformation interrogative. Ce n’est que de l’autre côté du miroir que les réponses précèdent les questions !
42
ELAN 26 – grammaire juin 2005
Bêtisier
[Entre crochets carrés et en caractère plus menus, des explicitations hors citation]
- Une phrase interrogative est une phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un ?. - La marque la plus importante [de l’interrogation] est le point d’interrogation. - [L’une des deux marques de l’interrogation est l’] apparition de l’élément portant la relation predicative. - L’interrogation est marquée par la quatrième modalité de CULIOLI, c'est-à-dire la modalite radicale ou intersubjective. - Les auxiliaires sont aussi des marques d’interrogation. - Les modaux sont aussi des marqueurs d’interrogation dans leurs formes affirmatives et dans leurs formes négatives - L’énonciateur a recours à l’interrogation quand il n’a pas peu instancié un constituant de l’énoncé. - On entend par interrogation toute demande de réalisation de la relation prédicative. - Si la phrasxe affirmative comporte déjà un auxiliaire affixé au lexème verbal … - L’interrogation est une relation prédicative. - L’interrogation suspend la relation prédicative. - une WH-question est une interrogation ouverte. Il y a autant de réponses que de questions possibles. - Les WH-questions nécessitent aussi parfois la presence de DO auxiliaire quand il n’y a pas de sujet dans la phrase, le WH-word suffit - ex What was this ? -2 - L’interrogation, en tant qu’opération seconde, nécessite un representant explicite et autonome de la nouvelle opération (ici l’interrogation). - [Que la question soit de type ouvert ou fermé,] la relation prédicative n’étant pas validée, il est nécessaire de faire intervenir un élément qui pourra servir de cible et aussi de réceptacle à cette relation prédicative. - Il faut alors recourir à DO, seul capable d’intervenir pour servir de cible et de réceptacle à la relation prédicative. -1 - L’opération de remise en cause de la relation prédicative est une opération seconde et c’est cette opération que {DO} va représenter. - L’interrogation a besoin pour cible d’un représentant explicite et autonome du lexème verbal. - Le question tag reprend et résume la relation prédicative, il sert de réceptacle et de cible. - On retrouve les auxiliaires sur les questions tags : Are you sleeping ? - Lorsqu’il n’y a aucun auxiliaires, il faut un lieutenant pour reprendre et résumer l’énoncé afin de servir de cible et réceptacle. - L’interrogation parcours inlassablement les zones positives ou négatives de l’enoncé. - La focalisation d’un mot est le fait de le choisir comme thème de l’énoncé. - La proforme doit être thématisée en tête d’énoncé : When did I have to go ?
43
- What do you think of that man ? : L’énoncé subit une pronominalisation puis une focalisation. - La copule « be » est un auxiliaire. - Les WH-words sont des morphèmes lexicaux. - L’inversion entre la marque de tense et le sujet est due à un special stress de l’auxiliaire porteur de la marque de tense. - [L’inversion sujet-marque de temps suspend l’assertion.] Cela signifie que l’assertion positive se trouve tout à fait ralliée, stoppée sans que ce ne soit le cas pour l’assertion négative. - Who broke the mug ? Il y a inversion de l’ordre canonique <sujet – verbe + temps>. - Il y a inversion entre le sujet et le prédicat : What did Brian break ? Did Kevin read this book ? - Lorsqu’il y a une interrogation en anglais, il y a une inversion du verbe et du sujet : Brian has broken the mug. - A la forme interrogative, il y a une inversion entre le sujet et le prédicat : Has he eaten all the cake ? - What did you think ? On remarque que le sujet de l’énoncé est rejeté à la droite du verbe. - Do you need her laptop ? On voit bien qu’il y a une opération qui consiste à inverser le sujet et le prédicat de leur fonctionnement habituel à la voix active. - A la voix interrogative, il y a modification de l’intonation. - L’élément focalisé est directement suivit de l’operateur de predication, ceci releguant au premier plan de l’enonciation l’opération 2de de predication à une forme finie. -1 - L’énoncé interrogatif doit se terminer par un point d’interrogation et avoir une inversion sujet-verbe. Le verbe doit porter la marque de temps de l’interrogation, il sera donc à une forme finie et l’énoncé sera validé. -1 - Au niveau grammatical, on observe le rejet du sujet grammatical à la droite du support de la marque de temps. - Lorsqu’il y a une interrogation, il y a un changement qui peut être constaté au niveau du temps. - Dans les phrases affirmatives nous avons un « rise ». - Une courbe intentionnelle est imposée par ce type de question. - L’interrogation donne lieu à une accentuation particulière : l’accent de phrase descend (c’est un fall). - Un énoncé interrogatif introduit par DO n’est pas à une forme finie. - Who did Break the mug ? Who n’ouvre pas un menu de possibilités : *Barbara broke the mug *The cat mal formés car c’est Brian qui est la cause du « cassage de mug ».
44
Langue - (Les questions de types fermées / de type ouvertes) x 104. - un balayage entre le pôle positive et négative - l’énoncé affirmative - un sujet syntaxique suivie d’un prédicat - une place n’a pas pu être instancié. - Cette dernière a besoin d’être caractérisé - la relation prédicative est décalé - La relation prédicative est relégué au second plan. - le lexème verbale - le sujet grammaticale - le temps grammaticale - le relais prédicationnelle - Elle est vide de sens lexicale. - L’apparition de DO n’a rien de surprenante. - Les questions de type ouverte sont aussi appelé les ‘WH’ questions. En effet celle-ci commencent souvent par ‘wh’. - On a une proforme mis à la place du constituant non instancié. - Les questions de type fermé limite la réponse à deux possibilités. - Il serait vraiment inexacte de dire … - un représentant explicit et autonome - le champs des réponses possibles - le champs libre - le champs des réponses - L’élément focalisé est directement suivit de l’operation de predication. - de part cette opération on réalise … - c’est énoncé n’est pas envisageable. - c’est énoncé n’est pas recevable. - cette énoncé … - On a pas l’introduction de toute un paradigme de possibilité - si on en a pas déjà un - Si il n’existe pas un représentant … - Si il y a présence d’un WH- … - (Si il y a déjà un auxiliaire)n
- Si il y a focalisation, … - si il n’y a pas d’autre auxiliaire - si il n’y a pas d’autre représentant - L’énonciateur demande si il peut valider la relation prédicative. - Il demande à son interlocuteur si il a la capacité physique de voir quelque chose. - la courbe intonationnelle descent. - la focalisation est la mise en place d’un terme de l’énoncé en position remarque. - La relation prédicative est mise en suspend. - L’interrogation place en suspend la validation de la relation prédicative. - Un opérateur qui parcours la classe des inanimés. - des adverbes qui parcours tous les éléments d’une même classe. - il parcours inlassablement les deux pôles.
45
- L’énonciateur parcours inlassablement les deux zones du domaine notionnel associé au procès. - Une interrogation met en suspens la validation de la S-P jusqu’à ce que le So vienne la validée. - Il n’a pas pu instancié un constituant - L’énonciateur est incapable d’instancié cette place. - Il va porté le temps grammatical. - Il va résumé la relation prédicative - C’est la focalisation qui va marqué l’opération. - Le sujet énonciateur n’a pas pu instancié l’un des constituants de la relation prédicative. - pas de remaniement syntaxique qui témoignerai de la focalisation - C’est le fait que se soit l’auxiliaire … - DO devenu operateur de predication, prend ça marque de temps au verbe et le laisse nu se qui suspend la validation de la relation prédicative. - Cela crée une profondeur énonciative avec l’opération seconde au premier plan et l’opération première relégue à l’arrière plan énonciatif. - La SP est relaillée à l’arrière plan énonciatif [NB1 – Le verbe RELAILLER n’existe pas en français. NB2 – le verbe RELAYER n’a pas le même sens que le verbe RELEGUER …] - {DO} est utilisé par défaut, lorsqu’un lexème verbal necessite ses besoins. - Say requiert les besoins de {DO}. - L’unité non instanciée sera représentée par une proforme en WH- qui parcourera tous les éléments … - On aura le shéma suivant - Ces deux exemples étant bien sûr clotûrés par un point d’interrogation. - Hors, DO apparaît ici en position remarquable. - Que se passet’il quand … - L’opération à lieu - La relation thematique est rejetée a droite - Is the baby is sleeping ? - Did Brian breake the mug ? - What did Fred steale ? - You are hill. - How long will it take for Jean to correct these copies ? - Does anyone know where is Sarah ? - Is she coming at Patrick’s party ? - Would you like to go to the America ? - I didn’t heard. -2
46
ELAN 26 septembre 2005 Grammaire III B
Epreuve synthétique de GRAMMAIRE
Corrigé Sujet analogue donné en
septembre 2001 et juin 2003. En juin 2004, sujet pratiquement
identique. La question avait été traitée aux
cours des 10 II au 3 III 2005. The switch must not be left on under any circumstances. Focalisez le constituant under any circumstances. Que se passe-t-il ? Expliquez-le pas à pas. ETAPE N°1 Focaliser un constituant, c’est, pour le sujet énonciateur, attirer l’attention de son co-énonciateur sur cet élément en le plaçant en un point remarquable de l’énoncé. Une position remarquable est la position en tête de séquence.25 (1 pt) the switch must not be left on under any circumstances. *under any circumstances the switch must not be left on. (1 pt) ETAPE N°2 L’énoncé obtenu est mal formé. Pourquoi ? Parce que l’opération de focalisation à la quelle il vient d’être procédé affecte un constituant porteur du quantifieur indéfini any.26 Or parmi les quantifieurs indéfinis (a, a single, one, many, all, every, …), certains n’apparaissent qu’en contexte non assertif et en particulier dans le champ d’une négation (c’est souvent le cas pour a single, much ou many ; toujours pour le curseur quantitatif any ou pour le curseur temporel ever [voir le cours de seconde année]). Dans l’énoncé proposé, any apparaît dans le champ de la négation de phrase portée par la particule négative not.27 (1 pt)
Tout indéfini placé à gauche de la marque de temps grammatical attire à lui la négation et il l’incorpore s’il s’agit de not. (2 pts)
Si plusieurs indéfinis figurent à gauche de la marque de temps, c’est au premier d’entre eux que revient la charge de porter la négation. Cette négation, incidente au Groupe Verbal must be left on, migre donc vers l’indéfini any, déterminant de circumstances, placé à gauche de la marque de forme finie portée par must et alors any + not → no :
*under any circumstances the switch must not be left on
*under no circumstances the switch must be left on (1 pt)
L’énoncé obtenu, à nouveau, apparaît comme mal formé. 25 Voir notes des sujets de septembre 2001 et juin 2003 sur la thématisation, la focalisation et la mise en relief. 26 Il s’agit bien du any quantitatif et non du any qualitatif qui pourrait apparaître dans any shrimp could have told you that (Lewis Carroll). [Voir le cours de seconde année sur le GN.] 27 Une négation de phrase (par opposition à une négation de constituant) porte sur la relation prédicative. L’un des tests révélateur de son statut est celui du question tag positif : the switch must not be left on under any circumstances, must it ? She isn’t happy, is she ? Sinon, la négation est une négation de constituant : She’s unhappy, isn’t she ? She forced him not to smoke, didn’t she ?
47
ETAPE N°3 Quelle en est la raison ?
Une fois la relation prédicative posée (première opération dans la formation d’un énoncé), (1 pt) chaque fois qu’il est besoin d’effectuer un travail supplémentaire à son endroit, elle doit se manifester sous la forme d’un représentant explicite et autonome. Cette opération supplémentaire (forme d’insistance, négation, focalisation d’un constituant modalisé extérieur au groupe verbal) est le fait du So qui intervient ainsi dans son énoncé. Cette intervention se marque par un auxiliaire. Si la forme verbale n’en comporte pas déjà un, do apparaît pour jouer ce rôle. Ce n’est pas le cas ici puisqu’il existe un opérateur de prédication, must, indépendant du lexème verbal. C’est donc must qui sert de cible et réceptacle à la nouvelle opération, celle de focalisation du constituant modalisé under no circumstances. C’est PARCE QUE le constituant focalisé est modalisé qu’il affecte la relation prédicative et c’est parce qu’il affecte la relation prédicative que celle-ci doit se faire représenter par un opérateur de prédication explicite et autonome qui serve de cible et réceptacle à la nouvelle opération.28
(1 pt) La présence préalable de cet auxiliaire n’a aucune implication pour l’acceptabilité de notre énoncé : must est présent, must demeure. Ce qui, en revanche, a une implication, c’est la place où doit apparaître l’opérateur de prédication. Il doit survenir à la proximité immédiate de l’élément auquel il sert de cible, c’est-à-dire à droite de under no circumstances : (1 pt) *under no circumstances the switch must be left on under no circumstances must the switch be left on (1 pt) Cette fois-ci, notre énoncé est bien formé. 28 Le constituant focalisé extérieur au GV peut avoir reçu une modalité négative (Not till they were hoarse did they stop shouting), restrictive (Only after repeated divine instructions and signs does Æneas overcome his natural impulse and obey) ou intensive (Well do I remember the day when I proposed to her). Mais—contrairement aux affirmations de certaines copies—un constituent extérieur au GV peut très bien figurer en tête de séquence, à la gauche du sujet syntaxique, sans pour autant être modalisé ou avoir subi une focalisation. Dans ce cas, sa présence en tête de phrase ne donne pas lieu à l’apparition d’un opérateur de prédication autonome à sa droite immédiate ni, par conséquent, à une inversion du sujet et du morphème porteur du marqueur de temps ni à la suspension de l’assertion qui résulterait d’une telle inversion. Ex. : At Christmas [the stores]sujet stay open late. – In 1920 [Poland and Russia]sujet were still at war. – In final position in a speech group, [the appearance of a consonant]sujet entailed a lengthening of the stem vowel. Dans ces trois cas, le constituant placé en tête de phrase est extérieur au GV mais il ne comporte aucun élément qui porterait sur la relation prédicative : l’inversion sujet/marque de temps n’a aucune raison d’être. Tel n’est pas le cas dans notre exemple où la négation, si elle est incidente à circumstances, porte sur toute la phrase, exactement comme dans l’énoncé premier. Sa place a changé ; sa portée, non.
48
EVALUATION Qu’y a-t-il de changé par rapport à l’énoncé primitif ?
- Le déplacement de under any circumstances à gauche de l’énoncé (étape n°1) ; - la migration de la négation (qui était incidente au GV must be left on) vers le
déterminant any de circumstances, premier indéfini à précéder le marqueur de temps grammatical, auquel elle s’incorpore pour donner no (étape n°2) ;
- la migration de l’opérateur de prédication, must, à la droite immédiate du constituant affecté par l’opération seconde de focalisation (étape n° 3).
Cette migration entraîne une inversion entre le sujet grammatical the switch et la marque de temps. Cette inversion, il faut en rendre compte. (1 pt)
Il a déjà été remarqué que deux opérations successives marquaient l’énoncé final :
• 1. la construction d’une relation prédicative, THE SWITCH / (MUST NOT) BE LEFT ON… • 2. la focalisation de l’un des constituants de l’énoncé, UNDER ANY CIRCUMSTANCES. Cette focalisation rejette l’opération première à l’arrière-plan énonciatif 29 (1 pt) et, par là même, introduit une profondeur dans le champ énonciatif en fragmentant les opérations constitutives de l’énoncé en deux plans d’énonciation, décalés l’un par rapport à l’autre. L’élément qui désormais figure en premier lieu se trouve placé sous les feux de la focalisation ; la relation prédicative, placée en second lieu, est alors rejetée dans l’ombre et le présupposé. La focalisation prend bien en compte l’opération première mais comme présupposé. C’est cette présupposition que matérialise l’inversion entre le sujet syntaxique et le marqueur de temps grammatical (comme c’est aussi le cas pour l’interrogation). (1 pt) L’inversion en question a également pour effet d’extraire l’opérateur de prédication de sa position de lien entre le sujet, the switch, et le prédicat, be left on et ainsi de suspendre l’assertion comme en témoigne (1 pt) 1 – le fait que sujet et prédicat coexistent côte à côte, le prédicat étant représenté par un verbe à une forme non finie : la relation prédicative n’est pas assertée ; 2 – le fait que l’assertion soit dévolue à un auxiliaire sorti du groupe verbal et placé à gauche du point de départ de la relation prédicative, c’est-à-dire à gauche du sujet. Si l’assertion est suspendue, cela se traduit par une oscillation entre ses deux pôles. Le pôle positif est abandonné sans que pour autant le pôle négatif ne soit atteint ou même visé [Cotte 1996 : 107]. Mais cette mise en suspens de l’assertion à l’arrière-plan s’explique par la focalisation au premier plan du constituant négatif under no circumstances qui oriente résolument l’assertion vers le pôle négatif. (1 pt)
De façon remarquable, must marque la frontière entre les deux opérations : (1 pt)
à sa gauche, la modalité négative focalisée qui témoigne de l’opération la plus nouvelle ; à sa droite est rejetée la relation prédicative, qui représente l’opération la plus ancienne, telle quelle, brute de décoffrage, sans marque temporelle donc non validée : dans le plus simple appareil : THE SWITCH / BE LEFT ON. (2 pts)
29 Ainsi que le dirait M. de La Palice, une opération unique ne peut être ni antérieure ni postérieure à quelque autre opération que ce soit. Si survient une seconde opération, elle prend, aurait pu continuer M. de La Palice, la suite de la première. Ainsi se crée une relation d’antériorité-postériorité. La première opération (la prédication) se trouve déplacée à l’arrière-plan énonciatif par la seconde (la focalisation). Autrement dit l’opération de prédication n’est déplacée dans l’antériorité des opérations que lorsque survient une seconde opération : ici, celle de focalisation. C’est cela que signifie le rejet dans l’antériorité opérationnelle et rien de plus.
49
SCHEMA FINAL
relais prédicatif MUST [Présent]
relation prédicative THE SWITCH / BE LEFT ON OPÉRATION PREMIÈRE
Under no c. MUST sert de cible et réceptacle à l’OPERATION SECONDE : à la focalisation de under no circumstances.
MUST représente l’OPERATION PREMIERE, celle de prédication
(2 pts)
[under no c.]premier plan ⎯ MUST+∅ ⎯ [the switch / be left on]arrière-plan borne frontière Pierre Cotte, L’Explication grammaticale de textes anglais (Paris: PUF, 1996)
50
ELAN 26 – grammaire – septembre 2005
Bêtisier
- « any » est un quantifieur restrictif (ou totalement négatif). En effet, « any » peut signifier « aucun » : « I don’t have any friends, comme la restriction : « Do you have any friends ? » -1
N.B. – Ceci est un magnifique exemple de l’erreur qui consiste à plaquer sur une langue (l’anglais) la structure propre à une autre langue (le français). Aucun est bien négatif ; any ne l’est aucunement. L’élément négatif de la phrase anglaise est not. [A propos de any, voir le cours de 2e année sur le GN.]
- Nous sommes en présence de deux éléments négatifs : « any » et « not ». -1 - Any est composé de not + any. - Must est suivi par un lexème verbal au prétérit à la forme finie, left on. Must ne va pas revêtir les attributs de la fonction prédicative, il va les laisser au lexème verbal qui le suit. -2 - Under any circumstances must not the switch be left on: L’énoncé est correct et bien formé. -1 - Under any circumstances must the switch not be left on : l’énoncé est grammaticalement correct, et la focalisation de l’élément « under any circumstances » réussie avec succès. - Under any circumstances must the switch be left on : ici cet énoncé est recevable. -1 - Under any circumstances the switch must not be left on. Cet énoncé est mal formé: il contient ‘any’ qui a une connotation de totalité, mais cette connotation n’est pas à sa place ici. Pour cela nous allons prendre ‘No’ : under no circumstances the switch must not be left on. -1 - The switch must not [be]copule [left]adj. on. - *under no circumstances the switch must be left on. La focalisation de “under no circumstances” a inversé l’ordre canonique sujet-verbe. -1
51