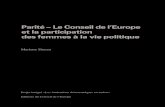Document de travail 48 La participation en matière de ......DESCRIPTION DES QUATRE TYPES DE...
Transcript of Document de travail 48 La participation en matière de ......DESCRIPTION DES QUATRE TYPES DE...

Avril 2019
Document de travail 48
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Impressum
EacuteditricePromotion Santeacute Suisse
Auteur-e-sDr Patrick Ischer et Chloeacute Saas Fondation O2
Direction du projet Promotion Santeacute SuisseDr Manon Delisle responsable de projets Relations partenaires
Direction du projet Commission de Preacutevention et de Promotion de la Santeacute (CPPS) du GRSPAlexia Fournier Fall coordinatrice CPPS
Groupe drsquoaccompagnement (ordre alphabeacutetique)Homa Attar-Cohen Service du Meacutedecin Cantonal Genegraveve Martine Bouvier Gallacchi Servizio di promozione e valutazione sanitaria Tessin Laure Chiquet Service de la santeacute publique Jura Tania Larequi Service de la santeacute publique Vaud Emilie Morard Gaspoz Office du meacutedecin cantonal Valais Fabienne Plancherel Service de la santeacute publique Fribourg Claude-Franccedilois Robert Service de la santeacute publique Neuchacirctel Preacutesident de la CPPS Lysiane Ummel Mariani Service de la santeacute publique Neuchacirctel
Seacuterie et numeacuteroPromotion Santeacute Suisse Document de travail 48
Forme des citationsIscher P amp Saas C (2019) La participation en matiegravere de promotion de la santeacute Document de travail 48 Berne et Lausanne Promotion Santeacute Suisse
Creacutedit photographique image de couvertureiStockphoto
Renseignements et informationsPromotion Santeacute Suisse Wankdorfallee 5 CH-3014 Berne teacutel +41 31 350 04 04 officebernpromotionsantech wwwpromotionsantech
Texte originalFranccedilais
Numeacutero de commande010281FR 042019
Cette publication est eacutegalement disponible en italien (numeacutero de commande 010281IT 042019)
Teacuteleacutecharger le PDFwwwpromotionsantechpublications
copy Promotion Santeacute Suisse avril 2019
Promotion Santeacute Suisse est une fondation soutenue par les cantons et les assureurs-maladie En vertu de son mandat leacutegal (Loi sur lrsquoassurance-maladie art 19) elle exeacutecute des mesures destineacutees agrave promouvoir la santeacute La Fondation est soumise au controcircle de la Confeacutedeacuteration Son organe de deacutecision suprecircme est le Conseil de Fondation Deux bureaux lrsquoun agrave Berne et lrsquoautre agrave Lausanne en forment le secreacutetariat Actuellement chaque personne verse en Suisse un montant de CHF 480 par anneacutee en faveur de Promotion Santeacute Suisse Ce montant est encaisseacute par les assureurs-maladie pour le compte de la Fondation Informations compleacutementaires wwwpromotionsanteacutech
Dans la seacuterie laquoDocument de travail de Promotion Santeacute Suisseraquo la Fondation publie des travaux reacutealiseacutes par elle-mecircme ou sur mandat Ces documents de travail ont pour objectif de soutenir les expertes et experts dans la mise en place de mesures dans le domaine de la promotion de la santeacute et de la preacutevention Le contenu de ces derniers est de la responsabiliteacute de leurs auteurs Les do cuments de travail de Promotion Santeacute Suisse sont geacuteneacuteralement disponibles sous forme eacutelectronique (PDF)
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 3
Eacuteditorial
Lrsquoaction communautaire est un axe important de la promotion de la santeacute et repreacutesente lrsquoun des cinq piliers de la promotion de la santeacute selon la Charte drsquoOttawa Agir au niveau communautaire requiert un niveau eacuteleveacute de participation souvent difficile agrave obtenir sur le terrain Crsquoest pourquoi Promotion Santeacute Suisse et les cantons latins regroupeacutes au sein de la Confeacuterence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) ont deacutecideacute drsquoeacutelaborer des pistes et recommandations sur la participation en matiegravere de promotion de la santeacuteLes deacutemarches participatives sont freacutequemment recommandeacutees dans le domaine de la promotion de la santeacute Cependant dans la pratique ces termes suscitent de nombreuses questions Ce document y reacutepond tout drsquoabord par lrsquoeacutelaboration drsquoun cadre theacuteorique qui deacutefinit le terme de participation sur la base drsquoune eacutetude de litteacuterature Il montre les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une telle deacute-marche participative eacutenumegravere les diffeacuterents degreacutes de leur implication de lrsquoinformation agrave la (co-)deacuteci-sion en passant par la consultation et la (co-)construction et syntheacutetise les eacutetapes drsquoun proces-sus participatif Ce cadre theacuteorique est ensuite confronteacute au terrain par lrsquoanalyse de trois bonnes pratiques en matiegravere de processus participatifs Le rapport clocirct sur les eacutecueils agrave eacuteviter et une liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
La participation donne aux diffeacuterents groupes de population une meilleure maicirctrise des deacutecisions qui influencent leur santeacute Elle renforce la coheacutesion sociale et assure une bonne adeacutequation entre les projets de promotion de la santeacute et les besoins des beacuteneacuteficiaires Nous nous reacutejouissons qursquoun tel document voie le jour il permettra drsquoameacuteliorer et de consolider lrsquoaction des cantons latins dans ce domaine drsquoactualiteacute
Prof Dr Thomas MattigDirecteur Promotion Santeacute Suisse
Laurent KurthPreacutesident de la Confeacuterence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales CLASSConseiller drsquoEacutetat Deacutepartement des finances et de la santeacute canton de Neuchacirctel
4 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Table des matiegraveres
Synthegravese du rapport 5
1 Introduction 8
2 Meacutethode 10
3 Deacutefinition de la participation 11
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif 13
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes 15
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif 19
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute 22
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative 23
9 Bibliographie 24
Annexe 1 Glossaire 25
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein 26
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 5
Synthegravese du rapport
Ce document eacutelaboreacute par les cantons latins et Pro-motion Santeacute Suisse donne un cadre theacuteorique qui deacutefinit le terme de participation sur la base drsquoune eacutetude de litteacuterature Ce cadre est ensuite confronteacute au terrain par lrsquoanalyse de trois bonnes pratiques en matiegravere de processus participatifs
Conseils et eacuteleacutements essentiels bull En premier lieu il est important de rappeler que toutes les actions ne neacutecessitent pas neacutecessaire-ment une approche participative Il est par contre important drsquoeacutevaluer systeacutematiquement cette opportuniteacute lors du lancement drsquoun projet de promotion de la santeacute bull Il existe diffeacuterents degreacutes de participation dont les niveaux se valent Ainsi tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre consideacutereacutee comme un degreacute eacuteleveacute de participation) bull Il est toutefois fondamental de se poser la ques-tion de savoir jusqursquoougrave les acteurs et les actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part bull Mener un processus participatif neacutecessite une meacutethodologie et une expertise dans le domaine cela ne srsquoimprovise pas Un accompagnement professionnel est neacutecessaire bull Les projets participatifs ont lrsquoavantage de viser un veacuteritable empowerment et ainsi perdurer Ce-pendant pour assurer lrsquoancrage des projets il faut ecirctre conscient que lrsquoautonomisation totale des parties prenantes et lrsquoauto-organisation sans coordination geacutenegraverent souvent des difficul-teacutes qui peuvent compromettre le succegraves des projets
La participation comporte de nombreux avantages bull Empowerment Stimule lrsquoindeacutependance de lrsquoindi-vidu et le soutien social permet aux individus drsquoexercer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute Permet une meilleure maicirctrise des deacuteci-sions et actions qui influencent sur la santeacute des diffeacuterents groupes de population bull Adeacutequation avec les besoins des beacuteneacuteficiaires Meilleure adheacutesion des beacuteneacuteficiaires aux projets bull Renforcement de la coheacutesion sociale bull Plus grande eacutegaliteacute des chances Agrave condition de tenir particuliegraverement compte des personnes vulneacuterables bull Renforcement de processus intersectoriels bull Effet multiplicateur bull Impleacutementation de programmes ou projets sur le long terme
La participation comprend eacutegalement certains risques tels que
bull Lrsquoeacutepuisement des parties prenantes bull Des deacutelais significatifs souvent neacutecessaires pour arriver agrave lrsquoautonomisation de la communauteacute bull Un coucirct financier que certaines instances admi-nistratives ou certaines institutions ne peuvent assumer bull Un peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute communautaire limiteacute par la dimension et la taille du groupe des personnes concerneacutees bull Drsquoeacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indivi-duels et collectifs bull La potentielle remise en cause des postures traditionnelles bull La difficulteacute agrave faire collaborer des personnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents
6 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
bull La vulneacuterabiliteacute de certaines cateacutegories de la population qui peuvent demeurer invisibles bull Le fait que certains porteurs et certaines por-teuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participa - tives mais qursquoils ou elles se sentent deacutemuni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale
Lrsquoeacutevaluation de ce type de deacutemarche se fait princi-palement au niveau drsquoune eacutevaluation de processus Cependant quand cela se justifie une eacutevaluation drsquoimpact peut avoir du sens
1 Modegravele deacuteveloppeacute par la Commission de Preacutevention et de Promotion de la Santeacute (CPPS) et Promotion Santeacute Suisse en srsquoinspirant drsquoeacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteurs
DESCRIPTION DES QUATRE TYPES DE PARTICIPATION DES ACTEURS ET ACTRICES1
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 7
2 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions2
8 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
laquoIl ne faut pas partir avec des ideacutees toute faites il faut au
contraire se montrer agrave lrsquoeacutecoute des beacuteneacuteficiairesraquo
(Responsable de projet genevois)
La Charte drsquoOttawa adopteacutee le 21 novembre 1986 par la premiegravere Confeacuterence internationale pour la promotion de la santeacute a jeteacute les bases pour que cette promotion considegravere lrsquoindividu comme le maicirctre de sa propre santeacute Cette charte deacutefinit les conditions de possibiliteacutes qui doivent permettre entre autres de laquodonner agrave tous les individus les moyens et les occasions voulus pour reacutealiser pleine-ment leur potentiel de santeacuteraquo (OMS 1986 2) et eacutenonce cinq actions qui doivent permettre de reacute-pondre agrave cette exigence (eacutelaborer une politique pu-blique saine creacuteer des milieux favorables renfor-cer lrsquoaction communautaire acqueacuterir des aptitudes individuelles reacuteorienter les services de santeacute) La troisiegraveme de ces recommandations fait clairement reacutefeacuterence agrave la participation puisque lrsquoon peut lire dans son explicitation les propos suivants laquoLa pro-motion de la santeacute procegravede de la participation effec-tive et concregravete de la communauteacute agrave la fixation des prioriteacutes agrave la prise des deacutecisions et agrave lrsquoeacutelaboration des strateacutegies de planification pour atteindre un meilleur niveau de santeacute La promotion de la santeacute puise dans les ressources humaines et physiques de la communauteacute pour stimuler lrsquoindeacutependance de lrsquoindividu et le soutien social et pour instaurer des systegravemes souples susceptibles de renforcer la par-ticipation et le controcircle du public dans les questions sanitaires Cela exige lrsquoaccegraves illimiteacute et permanent aux informations sur la santeacute aux possibiliteacutes de santeacute et agrave lrsquoaide financiegravereraquo (OMS 1986 4) La qua-triegraveme insiste sur le soutien qui doit ecirctre accordeacute aux individus afin que ceux-ci soient agrave mecircme laquodrsquoexer-cer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute et de faire des choix favorables agrave celle-ciraquo (ibid 4) Selon Deschamps cette charte propose de fait une veacuteritable alter-native aux tendances politiques et eacuteconomiques du moment dans la mesure ougrave elle laquocomplegravete notre deacutemocratie repreacutesentative par des proceacutedures de deacutemocratie partici-pative et cela nrsquoest pas superflu dans un contexte de crise du politique et de perte de confiance du peuple
agrave lrsquoeacutegard de ses repreacutesentants eacutelusraquo (Deschamps 2003 320)On remarque donc que cette charte accorde une im-portance consideacuterable au principe de participation et drsquoempowerment Agrave lrsquoinstar drsquoautres concepts (ap-proche mobilisation ou actions communautaires processus deacutemarches ou approches participatives) elle rend compte drsquoune volonteacute de favoriser les pro-cessus deacutemocratiques et de placer lrsquoindividu au centre des preacuteoccupations Selon Mouterde et al (2011) la participation des potentiels beacuteneacuteficiaires srsquoavegravere par ailleurs particuliegraverement preacutecieuse dans la mesure ougrave elle
bull Favorise le deacutecloisonnement professionnel et lrsquointersectorialiteacute Les facteurs de santeacute appa-raissent comme des dimensions de lrsquoaction mais sont pris en compte avec drsquoautres dimensions drsquoordre psychologique social environnemental etc bull Permet la laquocapacitationraquo et lrsquoempowerment des gens et des communauteacutes il srsquoagit ainsi de les mettre en capaciteacute de srsquoimpliquer et de srsquoengager bull Vise la recherche drsquoune prise de conscience et drsquoune eacutemancipation des membres drsquoune commu-nauteacute ce qui permet de tendre agrave une responsabi-lisation de cette derniegravere Cela paraicirct particu-liegraverement inteacuteressant et utile dans une peacuteriode de tension croissante sur les ressources drsquoautant plus que la participation est susceptible de favo-riser une meilleure reacutegulation des actions de santeacute publique
Au regard des expeacuteriences romandes et tessinoises qui ont eacuteteacute analyseacutees pour eacutelaborer le preacutesent docu-
ment la mise en place de projets participatifs srsquoavegravere beacuteneacutefique car elle permet de consideacuterer avec une attention particuliegravere les be-soins reacuteels des beacuteneacuteficiaires qui peuvent proposer des solutions aux problegravemes qursquoeux-mecircmes per-
ccediloivent et qursquoils ou elles ont envie de reacutesoudre Ce faisant ilselles srsquoengagent dans le processus et se
1 Introduction
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 9
laquoLes porteurs et les animateurs doivent accepter que certains groupes ne sont pas preneurs
des propositions ou qursquoils preacutefegraverent eacutevoluer dans des
structures associatives hieacuterar-chiques Crsquoest comme avec
un enfant on peut transmettre ce en quoi on croit mais ce
qursquoil va en faire ne nous appar-tient pasraquo
(Responsable de projet vaudois)
responsabilisent ce qui eacutevite geacuteneacuteralement de sus-citer des frustrations Qui plus est la participation peut induire une impleacutementation de programmes sur le long terme et les compeacutetences acquises du-rant le processus peuvent ensuite ecirctre mobiliseacutees pour drsquoautres projets dans drsquoautres contextes Par conseacutequent tout porte agrave croire que la participation contribue agrave ameacuteliorer les deacutemarches en matiegravere de promotion de la santeacute Or le passage de lrsquoeacutenonciation de tels preacuteceptes agrave leur mise en ap-plication concregravete srsquoavegravere parfois difficile Ainsi lrsquoun des auteurs qui a contribueacute agrave lrsquoouvrage collectif 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promo-tion de la santeacute dans divers pays francophones eacutecrit laquoFaire action de plaidoyer pour faire recon-naicirctre la deacutemarche de promotion de la santeacute reste donc bien lrsquoun des enjeux majeurs des anneacutees agrave venir Pour lrsquoheure la promotion de la santeacute semble insuffisante agrave bien des eacutegards pour mobiliser et faire participer Ce qui nrsquoest pas la moindre des inconvenances puisque ce sont juste-ment lagrave des objectifs qursquoelle entend atteindreraquo (Lo-renzo 2012 66) Constat par ailleurs repris dans la conclusion en ces termes laquoHormis la diversiteacute et la complexiteacute des contextes dans lesquels se meut la Charte drsquoOttawa il reste un certain nombre de deacute-fis agrave relever pour reacuteellement faire eacutevoluer les pra-tiques Le besoin de renforcer les approches partici-patives le travail en partenariat et la collaboration intersectorielle la neacutecessiteacute drsquoaugmenter la dispo-nibiliteacute des ressources et lrsquoimportance de se doter drsquooutils drsquoeacutevaluation se sont par exemple fait res-sentirraquo (Lannes amp Sanni Yaya 2012 85)Le preacutesent document a pour objectif de prendre acte de ces quelques mises en garde afin de mettre en place des processus participatifs qui tiennent compte des besoins de la population et de beacuteneacutefi - cier de reacutesultats aussi peacuterennes que possible Crsquoest
pourquoi il est proposeacute dans ce qui suit de deacutefinir le concept de laquoparticipationraquo puis drsquoapporter des eacuteleacute-ments de reacuteponses aux questions suivantes qui sont les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une deacutemarche par ticipative Quel est le degreacute de leur implication Comment permettre un suivi et mesu-rer lrsquoampleur et les impacts drsquoun projet de participa-tion dans le cadre de la promotion de la santeacute Quelles sont les eacutetapes agrave suivre pour mener agrave bien
un tel projet Quelles peuvent ecirctre les difficulteacutes rencontreacutees Ensuite il est mentionneacute une liste de questions qursquoil est neacutecessaire de se poser avant de mettre en place une deacutemarche participative Afin drsquoillustrer certains de ces eacuteleacutements trois projets sont briegrave-vement preacutesenteacutes Srsquoil peut pa-raicirctre difficilement envisageable de les reproduire dans un autre contexte il nrsquoen demeure pas moins que ces exemples doivent permettre de saisir certains en-
jeux relatifs aux processus participatifsEn deacutefinitive crsquoest dans le dessein drsquoapporter une meilleure compreacutehension de la participation en ma-tiegravere de promotion de la santeacute que les cantons latins et Promotion Santeacute Suisse se sont donneacute pour ob-jectif de deacutefinir un cadre conceptuel commun et drsquoidentifier les possibiliteacutes drsquoapplications concregravetes dans les strateacutegies et projets agrave venir dans ce do-maine Cette maniegravere de proceacuteder est fon damentale puisque comme le notent Fournier et Potvin laquoca-racteacuteriser puis mesurer la participation commu-nautaire ne sont pas des exercices de style futiles Au moment ougrave cette notion occupe une place preacute-pondeacuterante dans le discours des professionnels de la santeacute il serait utile de preacuteciser ce que lrsquoon entend et surtout ce que lrsquoon attend de la participation com-munautaire Cette clarification permettrait de reacuteeacuteva - luer des strateacutegies qui se basent sur cette notion et drsquoeacutevi ter une deacuterive rheacutetoriqueraquo (Fournier amp Potvin 1995 54)
10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

Impressum
EacuteditricePromotion Santeacute Suisse
Auteur-e-sDr Patrick Ischer et Chloeacute Saas Fondation O2
Direction du projet Promotion Santeacute SuisseDr Manon Delisle responsable de projets Relations partenaires
Direction du projet Commission de Preacutevention et de Promotion de la Santeacute (CPPS) du GRSPAlexia Fournier Fall coordinatrice CPPS
Groupe drsquoaccompagnement (ordre alphabeacutetique)Homa Attar-Cohen Service du Meacutedecin Cantonal Genegraveve Martine Bouvier Gallacchi Servizio di promozione e valutazione sanitaria Tessin Laure Chiquet Service de la santeacute publique Jura Tania Larequi Service de la santeacute publique Vaud Emilie Morard Gaspoz Office du meacutedecin cantonal Valais Fabienne Plancherel Service de la santeacute publique Fribourg Claude-Franccedilois Robert Service de la santeacute publique Neuchacirctel Preacutesident de la CPPS Lysiane Ummel Mariani Service de la santeacute publique Neuchacirctel
Seacuterie et numeacuteroPromotion Santeacute Suisse Document de travail 48
Forme des citationsIscher P amp Saas C (2019) La participation en matiegravere de promotion de la santeacute Document de travail 48 Berne et Lausanne Promotion Santeacute Suisse
Creacutedit photographique image de couvertureiStockphoto
Renseignements et informationsPromotion Santeacute Suisse Wankdorfallee 5 CH-3014 Berne teacutel +41 31 350 04 04 officebernpromotionsantech wwwpromotionsantech
Texte originalFranccedilais
Numeacutero de commande010281FR 042019
Cette publication est eacutegalement disponible en italien (numeacutero de commande 010281IT 042019)
Teacuteleacutecharger le PDFwwwpromotionsantechpublications
copy Promotion Santeacute Suisse avril 2019
Promotion Santeacute Suisse est une fondation soutenue par les cantons et les assureurs-maladie En vertu de son mandat leacutegal (Loi sur lrsquoassurance-maladie art 19) elle exeacutecute des mesures destineacutees agrave promouvoir la santeacute La Fondation est soumise au controcircle de la Confeacutedeacuteration Son organe de deacutecision suprecircme est le Conseil de Fondation Deux bureaux lrsquoun agrave Berne et lrsquoautre agrave Lausanne en forment le secreacutetariat Actuellement chaque personne verse en Suisse un montant de CHF 480 par anneacutee en faveur de Promotion Santeacute Suisse Ce montant est encaisseacute par les assureurs-maladie pour le compte de la Fondation Informations compleacutementaires wwwpromotionsanteacutech
Dans la seacuterie laquoDocument de travail de Promotion Santeacute Suisseraquo la Fondation publie des travaux reacutealiseacutes par elle-mecircme ou sur mandat Ces documents de travail ont pour objectif de soutenir les expertes et experts dans la mise en place de mesures dans le domaine de la promotion de la santeacute et de la preacutevention Le contenu de ces derniers est de la responsabiliteacute de leurs auteurs Les do cuments de travail de Promotion Santeacute Suisse sont geacuteneacuteralement disponibles sous forme eacutelectronique (PDF)
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 3
Eacuteditorial
Lrsquoaction communautaire est un axe important de la promotion de la santeacute et repreacutesente lrsquoun des cinq piliers de la promotion de la santeacute selon la Charte drsquoOttawa Agir au niveau communautaire requiert un niveau eacuteleveacute de participation souvent difficile agrave obtenir sur le terrain Crsquoest pourquoi Promotion Santeacute Suisse et les cantons latins regroupeacutes au sein de la Confeacuterence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) ont deacutecideacute drsquoeacutelaborer des pistes et recommandations sur la participation en matiegravere de promotion de la santeacuteLes deacutemarches participatives sont freacutequemment recommandeacutees dans le domaine de la promotion de la santeacute Cependant dans la pratique ces termes suscitent de nombreuses questions Ce document y reacutepond tout drsquoabord par lrsquoeacutelaboration drsquoun cadre theacuteorique qui deacutefinit le terme de participation sur la base drsquoune eacutetude de litteacuterature Il montre les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une telle deacute-marche participative eacutenumegravere les diffeacuterents degreacutes de leur implication de lrsquoinformation agrave la (co-)deacuteci-sion en passant par la consultation et la (co-)construction et syntheacutetise les eacutetapes drsquoun proces-sus participatif Ce cadre theacuteorique est ensuite confronteacute au terrain par lrsquoanalyse de trois bonnes pratiques en matiegravere de processus participatifs Le rapport clocirct sur les eacutecueils agrave eacuteviter et une liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
La participation donne aux diffeacuterents groupes de population une meilleure maicirctrise des deacutecisions qui influencent leur santeacute Elle renforce la coheacutesion sociale et assure une bonne adeacutequation entre les projets de promotion de la santeacute et les besoins des beacuteneacuteficiaires Nous nous reacutejouissons qursquoun tel document voie le jour il permettra drsquoameacuteliorer et de consolider lrsquoaction des cantons latins dans ce domaine drsquoactualiteacute
Prof Dr Thomas MattigDirecteur Promotion Santeacute Suisse
Laurent KurthPreacutesident de la Confeacuterence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales CLASSConseiller drsquoEacutetat Deacutepartement des finances et de la santeacute canton de Neuchacirctel
4 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Table des matiegraveres
Synthegravese du rapport 5
1 Introduction 8
2 Meacutethode 10
3 Deacutefinition de la participation 11
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif 13
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes 15
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif 19
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute 22
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative 23
9 Bibliographie 24
Annexe 1 Glossaire 25
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein 26
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 5
Synthegravese du rapport
Ce document eacutelaboreacute par les cantons latins et Pro-motion Santeacute Suisse donne un cadre theacuteorique qui deacutefinit le terme de participation sur la base drsquoune eacutetude de litteacuterature Ce cadre est ensuite confronteacute au terrain par lrsquoanalyse de trois bonnes pratiques en matiegravere de processus participatifs
Conseils et eacuteleacutements essentiels bull En premier lieu il est important de rappeler que toutes les actions ne neacutecessitent pas neacutecessaire-ment une approche participative Il est par contre important drsquoeacutevaluer systeacutematiquement cette opportuniteacute lors du lancement drsquoun projet de promotion de la santeacute bull Il existe diffeacuterents degreacutes de participation dont les niveaux se valent Ainsi tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre consideacutereacutee comme un degreacute eacuteleveacute de participation) bull Il est toutefois fondamental de se poser la ques-tion de savoir jusqursquoougrave les acteurs et les actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part bull Mener un processus participatif neacutecessite une meacutethodologie et une expertise dans le domaine cela ne srsquoimprovise pas Un accompagnement professionnel est neacutecessaire bull Les projets participatifs ont lrsquoavantage de viser un veacuteritable empowerment et ainsi perdurer Ce-pendant pour assurer lrsquoancrage des projets il faut ecirctre conscient que lrsquoautonomisation totale des parties prenantes et lrsquoauto-organisation sans coordination geacutenegraverent souvent des difficul-teacutes qui peuvent compromettre le succegraves des projets
La participation comporte de nombreux avantages bull Empowerment Stimule lrsquoindeacutependance de lrsquoindi-vidu et le soutien social permet aux individus drsquoexercer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute Permet une meilleure maicirctrise des deacuteci-sions et actions qui influencent sur la santeacute des diffeacuterents groupes de population bull Adeacutequation avec les besoins des beacuteneacuteficiaires Meilleure adheacutesion des beacuteneacuteficiaires aux projets bull Renforcement de la coheacutesion sociale bull Plus grande eacutegaliteacute des chances Agrave condition de tenir particuliegraverement compte des personnes vulneacuterables bull Renforcement de processus intersectoriels bull Effet multiplicateur bull Impleacutementation de programmes ou projets sur le long terme
La participation comprend eacutegalement certains risques tels que
bull Lrsquoeacutepuisement des parties prenantes bull Des deacutelais significatifs souvent neacutecessaires pour arriver agrave lrsquoautonomisation de la communauteacute bull Un coucirct financier que certaines instances admi-nistratives ou certaines institutions ne peuvent assumer bull Un peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute communautaire limiteacute par la dimension et la taille du groupe des personnes concerneacutees bull Drsquoeacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indivi-duels et collectifs bull La potentielle remise en cause des postures traditionnelles bull La difficulteacute agrave faire collaborer des personnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents
6 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
bull La vulneacuterabiliteacute de certaines cateacutegories de la population qui peuvent demeurer invisibles bull Le fait que certains porteurs et certaines por-teuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participa - tives mais qursquoils ou elles se sentent deacutemuni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale
Lrsquoeacutevaluation de ce type de deacutemarche se fait princi-palement au niveau drsquoune eacutevaluation de processus Cependant quand cela se justifie une eacutevaluation drsquoimpact peut avoir du sens
1 Modegravele deacuteveloppeacute par la Commission de Preacutevention et de Promotion de la Santeacute (CPPS) et Promotion Santeacute Suisse en srsquoinspirant drsquoeacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteurs
DESCRIPTION DES QUATRE TYPES DE PARTICIPATION DES ACTEURS ET ACTRICES1
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 7
2 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions2
8 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
laquoIl ne faut pas partir avec des ideacutees toute faites il faut au
contraire se montrer agrave lrsquoeacutecoute des beacuteneacuteficiairesraquo
(Responsable de projet genevois)
La Charte drsquoOttawa adopteacutee le 21 novembre 1986 par la premiegravere Confeacuterence internationale pour la promotion de la santeacute a jeteacute les bases pour que cette promotion considegravere lrsquoindividu comme le maicirctre de sa propre santeacute Cette charte deacutefinit les conditions de possibiliteacutes qui doivent permettre entre autres de laquodonner agrave tous les individus les moyens et les occasions voulus pour reacutealiser pleine-ment leur potentiel de santeacuteraquo (OMS 1986 2) et eacutenonce cinq actions qui doivent permettre de reacute-pondre agrave cette exigence (eacutelaborer une politique pu-blique saine creacuteer des milieux favorables renfor-cer lrsquoaction communautaire acqueacuterir des aptitudes individuelles reacuteorienter les services de santeacute) La troisiegraveme de ces recommandations fait clairement reacutefeacuterence agrave la participation puisque lrsquoon peut lire dans son explicitation les propos suivants laquoLa pro-motion de la santeacute procegravede de la participation effec-tive et concregravete de la communauteacute agrave la fixation des prioriteacutes agrave la prise des deacutecisions et agrave lrsquoeacutelaboration des strateacutegies de planification pour atteindre un meilleur niveau de santeacute La promotion de la santeacute puise dans les ressources humaines et physiques de la communauteacute pour stimuler lrsquoindeacutependance de lrsquoindividu et le soutien social et pour instaurer des systegravemes souples susceptibles de renforcer la par-ticipation et le controcircle du public dans les questions sanitaires Cela exige lrsquoaccegraves illimiteacute et permanent aux informations sur la santeacute aux possibiliteacutes de santeacute et agrave lrsquoaide financiegravereraquo (OMS 1986 4) La qua-triegraveme insiste sur le soutien qui doit ecirctre accordeacute aux individus afin que ceux-ci soient agrave mecircme laquodrsquoexer-cer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute et de faire des choix favorables agrave celle-ciraquo (ibid 4) Selon Deschamps cette charte propose de fait une veacuteritable alter-native aux tendances politiques et eacuteconomiques du moment dans la mesure ougrave elle laquocomplegravete notre deacutemocratie repreacutesentative par des proceacutedures de deacutemocratie partici-pative et cela nrsquoest pas superflu dans un contexte de crise du politique et de perte de confiance du peuple
agrave lrsquoeacutegard de ses repreacutesentants eacutelusraquo (Deschamps 2003 320)On remarque donc que cette charte accorde une im-portance consideacuterable au principe de participation et drsquoempowerment Agrave lrsquoinstar drsquoautres concepts (ap-proche mobilisation ou actions communautaires processus deacutemarches ou approches participatives) elle rend compte drsquoune volonteacute de favoriser les pro-cessus deacutemocratiques et de placer lrsquoindividu au centre des preacuteoccupations Selon Mouterde et al (2011) la participation des potentiels beacuteneacuteficiaires srsquoavegravere par ailleurs particuliegraverement preacutecieuse dans la mesure ougrave elle
bull Favorise le deacutecloisonnement professionnel et lrsquointersectorialiteacute Les facteurs de santeacute appa-raissent comme des dimensions de lrsquoaction mais sont pris en compte avec drsquoautres dimensions drsquoordre psychologique social environnemental etc bull Permet la laquocapacitationraquo et lrsquoempowerment des gens et des communauteacutes il srsquoagit ainsi de les mettre en capaciteacute de srsquoimpliquer et de srsquoengager bull Vise la recherche drsquoune prise de conscience et drsquoune eacutemancipation des membres drsquoune commu-nauteacute ce qui permet de tendre agrave une responsabi-lisation de cette derniegravere Cela paraicirct particu-liegraverement inteacuteressant et utile dans une peacuteriode de tension croissante sur les ressources drsquoautant plus que la participation est susceptible de favo-riser une meilleure reacutegulation des actions de santeacute publique
Au regard des expeacuteriences romandes et tessinoises qui ont eacuteteacute analyseacutees pour eacutelaborer le preacutesent docu-
ment la mise en place de projets participatifs srsquoavegravere beacuteneacutefique car elle permet de consideacuterer avec une attention particuliegravere les be-soins reacuteels des beacuteneacuteficiaires qui peuvent proposer des solutions aux problegravemes qursquoeux-mecircmes per-
ccediloivent et qursquoils ou elles ont envie de reacutesoudre Ce faisant ilselles srsquoengagent dans le processus et se
1 Introduction
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 9
laquoLes porteurs et les animateurs doivent accepter que certains groupes ne sont pas preneurs
des propositions ou qursquoils preacutefegraverent eacutevoluer dans des
structures associatives hieacuterar-chiques Crsquoest comme avec
un enfant on peut transmettre ce en quoi on croit mais ce
qursquoil va en faire ne nous appar-tient pasraquo
(Responsable de projet vaudois)
responsabilisent ce qui eacutevite geacuteneacuteralement de sus-citer des frustrations Qui plus est la participation peut induire une impleacutementation de programmes sur le long terme et les compeacutetences acquises du-rant le processus peuvent ensuite ecirctre mobiliseacutees pour drsquoautres projets dans drsquoautres contextes Par conseacutequent tout porte agrave croire que la participation contribue agrave ameacuteliorer les deacutemarches en matiegravere de promotion de la santeacute Or le passage de lrsquoeacutenonciation de tels preacuteceptes agrave leur mise en ap-plication concregravete srsquoavegravere parfois difficile Ainsi lrsquoun des auteurs qui a contribueacute agrave lrsquoouvrage collectif 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promo-tion de la santeacute dans divers pays francophones eacutecrit laquoFaire action de plaidoyer pour faire recon-naicirctre la deacutemarche de promotion de la santeacute reste donc bien lrsquoun des enjeux majeurs des anneacutees agrave venir Pour lrsquoheure la promotion de la santeacute semble insuffisante agrave bien des eacutegards pour mobiliser et faire participer Ce qui nrsquoest pas la moindre des inconvenances puisque ce sont juste-ment lagrave des objectifs qursquoelle entend atteindreraquo (Lo-renzo 2012 66) Constat par ailleurs repris dans la conclusion en ces termes laquoHormis la diversiteacute et la complexiteacute des contextes dans lesquels se meut la Charte drsquoOttawa il reste un certain nombre de deacute-fis agrave relever pour reacuteellement faire eacutevoluer les pra-tiques Le besoin de renforcer les approches partici-patives le travail en partenariat et la collaboration intersectorielle la neacutecessiteacute drsquoaugmenter la dispo-nibiliteacute des ressources et lrsquoimportance de se doter drsquooutils drsquoeacutevaluation se sont par exemple fait res-sentirraquo (Lannes amp Sanni Yaya 2012 85)Le preacutesent document a pour objectif de prendre acte de ces quelques mises en garde afin de mettre en place des processus participatifs qui tiennent compte des besoins de la population et de beacuteneacutefi - cier de reacutesultats aussi peacuterennes que possible Crsquoest
pourquoi il est proposeacute dans ce qui suit de deacutefinir le concept de laquoparticipationraquo puis drsquoapporter des eacuteleacute-ments de reacuteponses aux questions suivantes qui sont les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une deacutemarche par ticipative Quel est le degreacute de leur implication Comment permettre un suivi et mesu-rer lrsquoampleur et les impacts drsquoun projet de participa-tion dans le cadre de la promotion de la santeacute Quelles sont les eacutetapes agrave suivre pour mener agrave bien
un tel projet Quelles peuvent ecirctre les difficulteacutes rencontreacutees Ensuite il est mentionneacute une liste de questions qursquoil est neacutecessaire de se poser avant de mettre en place une deacutemarche participative Afin drsquoillustrer certains de ces eacuteleacutements trois projets sont briegrave-vement preacutesenteacutes Srsquoil peut pa-raicirctre difficilement envisageable de les reproduire dans un autre contexte il nrsquoen demeure pas moins que ces exemples doivent permettre de saisir certains en-
jeux relatifs aux processus participatifsEn deacutefinitive crsquoest dans le dessein drsquoapporter une meilleure compreacutehension de la participation en ma-tiegravere de promotion de la santeacute que les cantons latins et Promotion Santeacute Suisse se sont donneacute pour ob-jectif de deacutefinir un cadre conceptuel commun et drsquoidentifier les possibiliteacutes drsquoapplications concregravetes dans les strateacutegies et projets agrave venir dans ce do-maine Cette maniegravere de proceacuteder est fon damentale puisque comme le notent Fournier et Potvin laquoca-racteacuteriser puis mesurer la participation commu-nautaire ne sont pas des exercices de style futiles Au moment ougrave cette notion occupe une place preacute-pondeacuterante dans le discours des professionnels de la santeacute il serait utile de preacuteciser ce que lrsquoon entend et surtout ce que lrsquoon attend de la participation com-munautaire Cette clarification permettrait de reacuteeacuteva - luer des strateacutegies qui se basent sur cette notion et drsquoeacutevi ter une deacuterive rheacutetoriqueraquo (Fournier amp Potvin 1995 54)
10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 3
Eacuteditorial
Lrsquoaction communautaire est un axe important de la promotion de la santeacute et repreacutesente lrsquoun des cinq piliers de la promotion de la santeacute selon la Charte drsquoOttawa Agir au niveau communautaire requiert un niveau eacuteleveacute de participation souvent difficile agrave obtenir sur le terrain Crsquoest pourquoi Promotion Santeacute Suisse et les cantons latins regroupeacutes au sein de la Confeacuterence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) ont deacutecideacute drsquoeacutelaborer des pistes et recommandations sur la participation en matiegravere de promotion de la santeacuteLes deacutemarches participatives sont freacutequemment recommandeacutees dans le domaine de la promotion de la santeacute Cependant dans la pratique ces termes suscitent de nombreuses questions Ce document y reacutepond tout drsquoabord par lrsquoeacutelaboration drsquoun cadre theacuteorique qui deacutefinit le terme de participation sur la base drsquoune eacutetude de litteacuterature Il montre les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une telle deacute-marche participative eacutenumegravere les diffeacuterents degreacutes de leur implication de lrsquoinformation agrave la (co-)deacuteci-sion en passant par la consultation et la (co-)construction et syntheacutetise les eacutetapes drsquoun proces-sus participatif Ce cadre theacuteorique est ensuite confronteacute au terrain par lrsquoanalyse de trois bonnes pratiques en matiegravere de processus participatifs Le rapport clocirct sur les eacutecueils agrave eacuteviter et une liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
La participation donne aux diffeacuterents groupes de population une meilleure maicirctrise des deacutecisions qui influencent leur santeacute Elle renforce la coheacutesion sociale et assure une bonne adeacutequation entre les projets de promotion de la santeacute et les besoins des beacuteneacuteficiaires Nous nous reacutejouissons qursquoun tel document voie le jour il permettra drsquoameacuteliorer et de consolider lrsquoaction des cantons latins dans ce domaine drsquoactualiteacute
Prof Dr Thomas MattigDirecteur Promotion Santeacute Suisse
Laurent KurthPreacutesident de la Confeacuterence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales CLASSConseiller drsquoEacutetat Deacutepartement des finances et de la santeacute canton de Neuchacirctel
4 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Table des matiegraveres
Synthegravese du rapport 5
1 Introduction 8
2 Meacutethode 10
3 Deacutefinition de la participation 11
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif 13
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes 15
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif 19
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute 22
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative 23
9 Bibliographie 24
Annexe 1 Glossaire 25
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein 26
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 5
Synthegravese du rapport
Ce document eacutelaboreacute par les cantons latins et Pro-motion Santeacute Suisse donne un cadre theacuteorique qui deacutefinit le terme de participation sur la base drsquoune eacutetude de litteacuterature Ce cadre est ensuite confronteacute au terrain par lrsquoanalyse de trois bonnes pratiques en matiegravere de processus participatifs
Conseils et eacuteleacutements essentiels bull En premier lieu il est important de rappeler que toutes les actions ne neacutecessitent pas neacutecessaire-ment une approche participative Il est par contre important drsquoeacutevaluer systeacutematiquement cette opportuniteacute lors du lancement drsquoun projet de promotion de la santeacute bull Il existe diffeacuterents degreacutes de participation dont les niveaux se valent Ainsi tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre consideacutereacutee comme un degreacute eacuteleveacute de participation) bull Il est toutefois fondamental de se poser la ques-tion de savoir jusqursquoougrave les acteurs et les actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part bull Mener un processus participatif neacutecessite une meacutethodologie et une expertise dans le domaine cela ne srsquoimprovise pas Un accompagnement professionnel est neacutecessaire bull Les projets participatifs ont lrsquoavantage de viser un veacuteritable empowerment et ainsi perdurer Ce-pendant pour assurer lrsquoancrage des projets il faut ecirctre conscient que lrsquoautonomisation totale des parties prenantes et lrsquoauto-organisation sans coordination geacutenegraverent souvent des difficul-teacutes qui peuvent compromettre le succegraves des projets
La participation comporte de nombreux avantages bull Empowerment Stimule lrsquoindeacutependance de lrsquoindi-vidu et le soutien social permet aux individus drsquoexercer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute Permet une meilleure maicirctrise des deacuteci-sions et actions qui influencent sur la santeacute des diffeacuterents groupes de population bull Adeacutequation avec les besoins des beacuteneacuteficiaires Meilleure adheacutesion des beacuteneacuteficiaires aux projets bull Renforcement de la coheacutesion sociale bull Plus grande eacutegaliteacute des chances Agrave condition de tenir particuliegraverement compte des personnes vulneacuterables bull Renforcement de processus intersectoriels bull Effet multiplicateur bull Impleacutementation de programmes ou projets sur le long terme
La participation comprend eacutegalement certains risques tels que
bull Lrsquoeacutepuisement des parties prenantes bull Des deacutelais significatifs souvent neacutecessaires pour arriver agrave lrsquoautonomisation de la communauteacute bull Un coucirct financier que certaines instances admi-nistratives ou certaines institutions ne peuvent assumer bull Un peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute communautaire limiteacute par la dimension et la taille du groupe des personnes concerneacutees bull Drsquoeacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indivi-duels et collectifs bull La potentielle remise en cause des postures traditionnelles bull La difficulteacute agrave faire collaborer des personnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents
6 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
bull La vulneacuterabiliteacute de certaines cateacutegories de la population qui peuvent demeurer invisibles bull Le fait que certains porteurs et certaines por-teuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participa - tives mais qursquoils ou elles se sentent deacutemuni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale
Lrsquoeacutevaluation de ce type de deacutemarche se fait princi-palement au niveau drsquoune eacutevaluation de processus Cependant quand cela se justifie une eacutevaluation drsquoimpact peut avoir du sens
1 Modegravele deacuteveloppeacute par la Commission de Preacutevention et de Promotion de la Santeacute (CPPS) et Promotion Santeacute Suisse en srsquoinspirant drsquoeacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteurs
DESCRIPTION DES QUATRE TYPES DE PARTICIPATION DES ACTEURS ET ACTRICES1
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 7
2 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions2
8 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
laquoIl ne faut pas partir avec des ideacutees toute faites il faut au
contraire se montrer agrave lrsquoeacutecoute des beacuteneacuteficiairesraquo
(Responsable de projet genevois)
La Charte drsquoOttawa adopteacutee le 21 novembre 1986 par la premiegravere Confeacuterence internationale pour la promotion de la santeacute a jeteacute les bases pour que cette promotion considegravere lrsquoindividu comme le maicirctre de sa propre santeacute Cette charte deacutefinit les conditions de possibiliteacutes qui doivent permettre entre autres de laquodonner agrave tous les individus les moyens et les occasions voulus pour reacutealiser pleine-ment leur potentiel de santeacuteraquo (OMS 1986 2) et eacutenonce cinq actions qui doivent permettre de reacute-pondre agrave cette exigence (eacutelaborer une politique pu-blique saine creacuteer des milieux favorables renfor-cer lrsquoaction communautaire acqueacuterir des aptitudes individuelles reacuteorienter les services de santeacute) La troisiegraveme de ces recommandations fait clairement reacutefeacuterence agrave la participation puisque lrsquoon peut lire dans son explicitation les propos suivants laquoLa pro-motion de la santeacute procegravede de la participation effec-tive et concregravete de la communauteacute agrave la fixation des prioriteacutes agrave la prise des deacutecisions et agrave lrsquoeacutelaboration des strateacutegies de planification pour atteindre un meilleur niveau de santeacute La promotion de la santeacute puise dans les ressources humaines et physiques de la communauteacute pour stimuler lrsquoindeacutependance de lrsquoindividu et le soutien social et pour instaurer des systegravemes souples susceptibles de renforcer la par-ticipation et le controcircle du public dans les questions sanitaires Cela exige lrsquoaccegraves illimiteacute et permanent aux informations sur la santeacute aux possibiliteacutes de santeacute et agrave lrsquoaide financiegravereraquo (OMS 1986 4) La qua-triegraveme insiste sur le soutien qui doit ecirctre accordeacute aux individus afin que ceux-ci soient agrave mecircme laquodrsquoexer-cer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute et de faire des choix favorables agrave celle-ciraquo (ibid 4) Selon Deschamps cette charte propose de fait une veacuteritable alter-native aux tendances politiques et eacuteconomiques du moment dans la mesure ougrave elle laquocomplegravete notre deacutemocratie repreacutesentative par des proceacutedures de deacutemocratie partici-pative et cela nrsquoest pas superflu dans un contexte de crise du politique et de perte de confiance du peuple
agrave lrsquoeacutegard de ses repreacutesentants eacutelusraquo (Deschamps 2003 320)On remarque donc que cette charte accorde une im-portance consideacuterable au principe de participation et drsquoempowerment Agrave lrsquoinstar drsquoautres concepts (ap-proche mobilisation ou actions communautaires processus deacutemarches ou approches participatives) elle rend compte drsquoune volonteacute de favoriser les pro-cessus deacutemocratiques et de placer lrsquoindividu au centre des preacuteoccupations Selon Mouterde et al (2011) la participation des potentiels beacuteneacuteficiaires srsquoavegravere par ailleurs particuliegraverement preacutecieuse dans la mesure ougrave elle
bull Favorise le deacutecloisonnement professionnel et lrsquointersectorialiteacute Les facteurs de santeacute appa-raissent comme des dimensions de lrsquoaction mais sont pris en compte avec drsquoautres dimensions drsquoordre psychologique social environnemental etc bull Permet la laquocapacitationraquo et lrsquoempowerment des gens et des communauteacutes il srsquoagit ainsi de les mettre en capaciteacute de srsquoimpliquer et de srsquoengager bull Vise la recherche drsquoune prise de conscience et drsquoune eacutemancipation des membres drsquoune commu-nauteacute ce qui permet de tendre agrave une responsabi-lisation de cette derniegravere Cela paraicirct particu-liegraverement inteacuteressant et utile dans une peacuteriode de tension croissante sur les ressources drsquoautant plus que la participation est susceptible de favo-riser une meilleure reacutegulation des actions de santeacute publique
Au regard des expeacuteriences romandes et tessinoises qui ont eacuteteacute analyseacutees pour eacutelaborer le preacutesent docu-
ment la mise en place de projets participatifs srsquoavegravere beacuteneacutefique car elle permet de consideacuterer avec une attention particuliegravere les be-soins reacuteels des beacuteneacuteficiaires qui peuvent proposer des solutions aux problegravemes qursquoeux-mecircmes per-
ccediloivent et qursquoils ou elles ont envie de reacutesoudre Ce faisant ilselles srsquoengagent dans le processus et se
1 Introduction
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 9
laquoLes porteurs et les animateurs doivent accepter que certains groupes ne sont pas preneurs
des propositions ou qursquoils preacutefegraverent eacutevoluer dans des
structures associatives hieacuterar-chiques Crsquoest comme avec
un enfant on peut transmettre ce en quoi on croit mais ce
qursquoil va en faire ne nous appar-tient pasraquo
(Responsable de projet vaudois)
responsabilisent ce qui eacutevite geacuteneacuteralement de sus-citer des frustrations Qui plus est la participation peut induire une impleacutementation de programmes sur le long terme et les compeacutetences acquises du-rant le processus peuvent ensuite ecirctre mobiliseacutees pour drsquoautres projets dans drsquoautres contextes Par conseacutequent tout porte agrave croire que la participation contribue agrave ameacuteliorer les deacutemarches en matiegravere de promotion de la santeacute Or le passage de lrsquoeacutenonciation de tels preacuteceptes agrave leur mise en ap-plication concregravete srsquoavegravere parfois difficile Ainsi lrsquoun des auteurs qui a contribueacute agrave lrsquoouvrage collectif 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promo-tion de la santeacute dans divers pays francophones eacutecrit laquoFaire action de plaidoyer pour faire recon-naicirctre la deacutemarche de promotion de la santeacute reste donc bien lrsquoun des enjeux majeurs des anneacutees agrave venir Pour lrsquoheure la promotion de la santeacute semble insuffisante agrave bien des eacutegards pour mobiliser et faire participer Ce qui nrsquoest pas la moindre des inconvenances puisque ce sont juste-ment lagrave des objectifs qursquoelle entend atteindreraquo (Lo-renzo 2012 66) Constat par ailleurs repris dans la conclusion en ces termes laquoHormis la diversiteacute et la complexiteacute des contextes dans lesquels se meut la Charte drsquoOttawa il reste un certain nombre de deacute-fis agrave relever pour reacuteellement faire eacutevoluer les pra-tiques Le besoin de renforcer les approches partici-patives le travail en partenariat et la collaboration intersectorielle la neacutecessiteacute drsquoaugmenter la dispo-nibiliteacute des ressources et lrsquoimportance de se doter drsquooutils drsquoeacutevaluation se sont par exemple fait res-sentirraquo (Lannes amp Sanni Yaya 2012 85)Le preacutesent document a pour objectif de prendre acte de ces quelques mises en garde afin de mettre en place des processus participatifs qui tiennent compte des besoins de la population et de beacuteneacutefi - cier de reacutesultats aussi peacuterennes que possible Crsquoest
pourquoi il est proposeacute dans ce qui suit de deacutefinir le concept de laquoparticipationraquo puis drsquoapporter des eacuteleacute-ments de reacuteponses aux questions suivantes qui sont les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une deacutemarche par ticipative Quel est le degreacute de leur implication Comment permettre un suivi et mesu-rer lrsquoampleur et les impacts drsquoun projet de participa-tion dans le cadre de la promotion de la santeacute Quelles sont les eacutetapes agrave suivre pour mener agrave bien
un tel projet Quelles peuvent ecirctre les difficulteacutes rencontreacutees Ensuite il est mentionneacute une liste de questions qursquoil est neacutecessaire de se poser avant de mettre en place une deacutemarche participative Afin drsquoillustrer certains de ces eacuteleacutements trois projets sont briegrave-vement preacutesenteacutes Srsquoil peut pa-raicirctre difficilement envisageable de les reproduire dans un autre contexte il nrsquoen demeure pas moins que ces exemples doivent permettre de saisir certains en-
jeux relatifs aux processus participatifsEn deacutefinitive crsquoest dans le dessein drsquoapporter une meilleure compreacutehension de la participation en ma-tiegravere de promotion de la santeacute que les cantons latins et Promotion Santeacute Suisse se sont donneacute pour ob-jectif de deacutefinir un cadre conceptuel commun et drsquoidentifier les possibiliteacutes drsquoapplications concregravetes dans les strateacutegies et projets agrave venir dans ce do-maine Cette maniegravere de proceacuteder est fon damentale puisque comme le notent Fournier et Potvin laquoca-racteacuteriser puis mesurer la participation commu-nautaire ne sont pas des exercices de style futiles Au moment ougrave cette notion occupe une place preacute-pondeacuterante dans le discours des professionnels de la santeacute il serait utile de preacuteciser ce que lrsquoon entend et surtout ce que lrsquoon attend de la participation com-munautaire Cette clarification permettrait de reacuteeacuteva - luer des strateacutegies qui se basent sur cette notion et drsquoeacutevi ter une deacuterive rheacutetoriqueraquo (Fournier amp Potvin 1995 54)
10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

4 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Table des matiegraveres
Synthegravese du rapport 5
1 Introduction 8
2 Meacutethode 10
3 Deacutefinition de la participation 11
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif 13
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes 15
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif 19
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute 22
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative 23
9 Bibliographie 24
Annexe 1 Glossaire 25
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein 26
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 5
Synthegravese du rapport
Ce document eacutelaboreacute par les cantons latins et Pro-motion Santeacute Suisse donne un cadre theacuteorique qui deacutefinit le terme de participation sur la base drsquoune eacutetude de litteacuterature Ce cadre est ensuite confronteacute au terrain par lrsquoanalyse de trois bonnes pratiques en matiegravere de processus participatifs
Conseils et eacuteleacutements essentiels bull En premier lieu il est important de rappeler que toutes les actions ne neacutecessitent pas neacutecessaire-ment une approche participative Il est par contre important drsquoeacutevaluer systeacutematiquement cette opportuniteacute lors du lancement drsquoun projet de promotion de la santeacute bull Il existe diffeacuterents degreacutes de participation dont les niveaux se valent Ainsi tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre consideacutereacutee comme un degreacute eacuteleveacute de participation) bull Il est toutefois fondamental de se poser la ques-tion de savoir jusqursquoougrave les acteurs et les actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part bull Mener un processus participatif neacutecessite une meacutethodologie et une expertise dans le domaine cela ne srsquoimprovise pas Un accompagnement professionnel est neacutecessaire bull Les projets participatifs ont lrsquoavantage de viser un veacuteritable empowerment et ainsi perdurer Ce-pendant pour assurer lrsquoancrage des projets il faut ecirctre conscient que lrsquoautonomisation totale des parties prenantes et lrsquoauto-organisation sans coordination geacutenegraverent souvent des difficul-teacutes qui peuvent compromettre le succegraves des projets
La participation comporte de nombreux avantages bull Empowerment Stimule lrsquoindeacutependance de lrsquoindi-vidu et le soutien social permet aux individus drsquoexercer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute Permet une meilleure maicirctrise des deacuteci-sions et actions qui influencent sur la santeacute des diffeacuterents groupes de population bull Adeacutequation avec les besoins des beacuteneacuteficiaires Meilleure adheacutesion des beacuteneacuteficiaires aux projets bull Renforcement de la coheacutesion sociale bull Plus grande eacutegaliteacute des chances Agrave condition de tenir particuliegraverement compte des personnes vulneacuterables bull Renforcement de processus intersectoriels bull Effet multiplicateur bull Impleacutementation de programmes ou projets sur le long terme
La participation comprend eacutegalement certains risques tels que
bull Lrsquoeacutepuisement des parties prenantes bull Des deacutelais significatifs souvent neacutecessaires pour arriver agrave lrsquoautonomisation de la communauteacute bull Un coucirct financier que certaines instances admi-nistratives ou certaines institutions ne peuvent assumer bull Un peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute communautaire limiteacute par la dimension et la taille du groupe des personnes concerneacutees bull Drsquoeacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indivi-duels et collectifs bull La potentielle remise en cause des postures traditionnelles bull La difficulteacute agrave faire collaborer des personnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents
6 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
bull La vulneacuterabiliteacute de certaines cateacutegories de la population qui peuvent demeurer invisibles bull Le fait que certains porteurs et certaines por-teuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participa - tives mais qursquoils ou elles se sentent deacutemuni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale
Lrsquoeacutevaluation de ce type de deacutemarche se fait princi-palement au niveau drsquoune eacutevaluation de processus Cependant quand cela se justifie une eacutevaluation drsquoimpact peut avoir du sens
1 Modegravele deacuteveloppeacute par la Commission de Preacutevention et de Promotion de la Santeacute (CPPS) et Promotion Santeacute Suisse en srsquoinspirant drsquoeacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteurs
DESCRIPTION DES QUATRE TYPES DE PARTICIPATION DES ACTEURS ET ACTRICES1
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 7
2 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions2
8 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
laquoIl ne faut pas partir avec des ideacutees toute faites il faut au
contraire se montrer agrave lrsquoeacutecoute des beacuteneacuteficiairesraquo
(Responsable de projet genevois)
La Charte drsquoOttawa adopteacutee le 21 novembre 1986 par la premiegravere Confeacuterence internationale pour la promotion de la santeacute a jeteacute les bases pour que cette promotion considegravere lrsquoindividu comme le maicirctre de sa propre santeacute Cette charte deacutefinit les conditions de possibiliteacutes qui doivent permettre entre autres de laquodonner agrave tous les individus les moyens et les occasions voulus pour reacutealiser pleine-ment leur potentiel de santeacuteraquo (OMS 1986 2) et eacutenonce cinq actions qui doivent permettre de reacute-pondre agrave cette exigence (eacutelaborer une politique pu-blique saine creacuteer des milieux favorables renfor-cer lrsquoaction communautaire acqueacuterir des aptitudes individuelles reacuteorienter les services de santeacute) La troisiegraveme de ces recommandations fait clairement reacutefeacuterence agrave la participation puisque lrsquoon peut lire dans son explicitation les propos suivants laquoLa pro-motion de la santeacute procegravede de la participation effec-tive et concregravete de la communauteacute agrave la fixation des prioriteacutes agrave la prise des deacutecisions et agrave lrsquoeacutelaboration des strateacutegies de planification pour atteindre un meilleur niveau de santeacute La promotion de la santeacute puise dans les ressources humaines et physiques de la communauteacute pour stimuler lrsquoindeacutependance de lrsquoindividu et le soutien social et pour instaurer des systegravemes souples susceptibles de renforcer la par-ticipation et le controcircle du public dans les questions sanitaires Cela exige lrsquoaccegraves illimiteacute et permanent aux informations sur la santeacute aux possibiliteacutes de santeacute et agrave lrsquoaide financiegravereraquo (OMS 1986 4) La qua-triegraveme insiste sur le soutien qui doit ecirctre accordeacute aux individus afin que ceux-ci soient agrave mecircme laquodrsquoexer-cer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute et de faire des choix favorables agrave celle-ciraquo (ibid 4) Selon Deschamps cette charte propose de fait une veacuteritable alter-native aux tendances politiques et eacuteconomiques du moment dans la mesure ougrave elle laquocomplegravete notre deacutemocratie repreacutesentative par des proceacutedures de deacutemocratie partici-pative et cela nrsquoest pas superflu dans un contexte de crise du politique et de perte de confiance du peuple
agrave lrsquoeacutegard de ses repreacutesentants eacutelusraquo (Deschamps 2003 320)On remarque donc que cette charte accorde une im-portance consideacuterable au principe de participation et drsquoempowerment Agrave lrsquoinstar drsquoautres concepts (ap-proche mobilisation ou actions communautaires processus deacutemarches ou approches participatives) elle rend compte drsquoune volonteacute de favoriser les pro-cessus deacutemocratiques et de placer lrsquoindividu au centre des preacuteoccupations Selon Mouterde et al (2011) la participation des potentiels beacuteneacuteficiaires srsquoavegravere par ailleurs particuliegraverement preacutecieuse dans la mesure ougrave elle
bull Favorise le deacutecloisonnement professionnel et lrsquointersectorialiteacute Les facteurs de santeacute appa-raissent comme des dimensions de lrsquoaction mais sont pris en compte avec drsquoautres dimensions drsquoordre psychologique social environnemental etc bull Permet la laquocapacitationraquo et lrsquoempowerment des gens et des communauteacutes il srsquoagit ainsi de les mettre en capaciteacute de srsquoimpliquer et de srsquoengager bull Vise la recherche drsquoune prise de conscience et drsquoune eacutemancipation des membres drsquoune commu-nauteacute ce qui permet de tendre agrave une responsabi-lisation de cette derniegravere Cela paraicirct particu-liegraverement inteacuteressant et utile dans une peacuteriode de tension croissante sur les ressources drsquoautant plus que la participation est susceptible de favo-riser une meilleure reacutegulation des actions de santeacute publique
Au regard des expeacuteriences romandes et tessinoises qui ont eacuteteacute analyseacutees pour eacutelaborer le preacutesent docu-
ment la mise en place de projets participatifs srsquoavegravere beacuteneacutefique car elle permet de consideacuterer avec une attention particuliegravere les be-soins reacuteels des beacuteneacuteficiaires qui peuvent proposer des solutions aux problegravemes qursquoeux-mecircmes per-
ccediloivent et qursquoils ou elles ont envie de reacutesoudre Ce faisant ilselles srsquoengagent dans le processus et se
1 Introduction
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 9
laquoLes porteurs et les animateurs doivent accepter que certains groupes ne sont pas preneurs
des propositions ou qursquoils preacutefegraverent eacutevoluer dans des
structures associatives hieacuterar-chiques Crsquoest comme avec
un enfant on peut transmettre ce en quoi on croit mais ce
qursquoil va en faire ne nous appar-tient pasraquo
(Responsable de projet vaudois)
responsabilisent ce qui eacutevite geacuteneacuteralement de sus-citer des frustrations Qui plus est la participation peut induire une impleacutementation de programmes sur le long terme et les compeacutetences acquises du-rant le processus peuvent ensuite ecirctre mobiliseacutees pour drsquoautres projets dans drsquoautres contextes Par conseacutequent tout porte agrave croire que la participation contribue agrave ameacuteliorer les deacutemarches en matiegravere de promotion de la santeacute Or le passage de lrsquoeacutenonciation de tels preacuteceptes agrave leur mise en ap-plication concregravete srsquoavegravere parfois difficile Ainsi lrsquoun des auteurs qui a contribueacute agrave lrsquoouvrage collectif 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promo-tion de la santeacute dans divers pays francophones eacutecrit laquoFaire action de plaidoyer pour faire recon-naicirctre la deacutemarche de promotion de la santeacute reste donc bien lrsquoun des enjeux majeurs des anneacutees agrave venir Pour lrsquoheure la promotion de la santeacute semble insuffisante agrave bien des eacutegards pour mobiliser et faire participer Ce qui nrsquoest pas la moindre des inconvenances puisque ce sont juste-ment lagrave des objectifs qursquoelle entend atteindreraquo (Lo-renzo 2012 66) Constat par ailleurs repris dans la conclusion en ces termes laquoHormis la diversiteacute et la complexiteacute des contextes dans lesquels se meut la Charte drsquoOttawa il reste un certain nombre de deacute-fis agrave relever pour reacuteellement faire eacutevoluer les pra-tiques Le besoin de renforcer les approches partici-patives le travail en partenariat et la collaboration intersectorielle la neacutecessiteacute drsquoaugmenter la dispo-nibiliteacute des ressources et lrsquoimportance de se doter drsquooutils drsquoeacutevaluation se sont par exemple fait res-sentirraquo (Lannes amp Sanni Yaya 2012 85)Le preacutesent document a pour objectif de prendre acte de ces quelques mises en garde afin de mettre en place des processus participatifs qui tiennent compte des besoins de la population et de beacuteneacutefi - cier de reacutesultats aussi peacuterennes que possible Crsquoest
pourquoi il est proposeacute dans ce qui suit de deacutefinir le concept de laquoparticipationraquo puis drsquoapporter des eacuteleacute-ments de reacuteponses aux questions suivantes qui sont les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une deacutemarche par ticipative Quel est le degreacute de leur implication Comment permettre un suivi et mesu-rer lrsquoampleur et les impacts drsquoun projet de participa-tion dans le cadre de la promotion de la santeacute Quelles sont les eacutetapes agrave suivre pour mener agrave bien
un tel projet Quelles peuvent ecirctre les difficulteacutes rencontreacutees Ensuite il est mentionneacute une liste de questions qursquoil est neacutecessaire de se poser avant de mettre en place une deacutemarche participative Afin drsquoillustrer certains de ces eacuteleacutements trois projets sont briegrave-vement preacutesenteacutes Srsquoil peut pa-raicirctre difficilement envisageable de les reproduire dans un autre contexte il nrsquoen demeure pas moins que ces exemples doivent permettre de saisir certains en-
jeux relatifs aux processus participatifsEn deacutefinitive crsquoest dans le dessein drsquoapporter une meilleure compreacutehension de la participation en ma-tiegravere de promotion de la santeacute que les cantons latins et Promotion Santeacute Suisse se sont donneacute pour ob-jectif de deacutefinir un cadre conceptuel commun et drsquoidentifier les possibiliteacutes drsquoapplications concregravetes dans les strateacutegies et projets agrave venir dans ce do-maine Cette maniegravere de proceacuteder est fon damentale puisque comme le notent Fournier et Potvin laquoca-racteacuteriser puis mesurer la participation commu-nautaire ne sont pas des exercices de style futiles Au moment ougrave cette notion occupe une place preacute-pondeacuterante dans le discours des professionnels de la santeacute il serait utile de preacuteciser ce que lrsquoon entend et surtout ce que lrsquoon attend de la participation com-munautaire Cette clarification permettrait de reacuteeacuteva - luer des strateacutegies qui se basent sur cette notion et drsquoeacutevi ter une deacuterive rheacutetoriqueraquo (Fournier amp Potvin 1995 54)
10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 5
Synthegravese du rapport
Ce document eacutelaboreacute par les cantons latins et Pro-motion Santeacute Suisse donne un cadre theacuteorique qui deacutefinit le terme de participation sur la base drsquoune eacutetude de litteacuterature Ce cadre est ensuite confronteacute au terrain par lrsquoanalyse de trois bonnes pratiques en matiegravere de processus participatifs
Conseils et eacuteleacutements essentiels bull En premier lieu il est important de rappeler que toutes les actions ne neacutecessitent pas neacutecessaire-ment une approche participative Il est par contre important drsquoeacutevaluer systeacutematiquement cette opportuniteacute lors du lancement drsquoun projet de promotion de la santeacute bull Il existe diffeacuterents degreacutes de participation dont les niveaux se valent Ainsi tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre consideacutereacutee comme un degreacute eacuteleveacute de participation) bull Il est toutefois fondamental de se poser la ques-tion de savoir jusqursquoougrave les acteurs et les actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part bull Mener un processus participatif neacutecessite une meacutethodologie et une expertise dans le domaine cela ne srsquoimprovise pas Un accompagnement professionnel est neacutecessaire bull Les projets participatifs ont lrsquoavantage de viser un veacuteritable empowerment et ainsi perdurer Ce-pendant pour assurer lrsquoancrage des projets il faut ecirctre conscient que lrsquoautonomisation totale des parties prenantes et lrsquoauto-organisation sans coordination geacutenegraverent souvent des difficul-teacutes qui peuvent compromettre le succegraves des projets
La participation comporte de nombreux avantages bull Empowerment Stimule lrsquoindeacutependance de lrsquoindi-vidu et le soutien social permet aux individus drsquoexercer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute Permet une meilleure maicirctrise des deacuteci-sions et actions qui influencent sur la santeacute des diffeacuterents groupes de population bull Adeacutequation avec les besoins des beacuteneacuteficiaires Meilleure adheacutesion des beacuteneacuteficiaires aux projets bull Renforcement de la coheacutesion sociale bull Plus grande eacutegaliteacute des chances Agrave condition de tenir particuliegraverement compte des personnes vulneacuterables bull Renforcement de processus intersectoriels bull Effet multiplicateur bull Impleacutementation de programmes ou projets sur le long terme
La participation comprend eacutegalement certains risques tels que
bull Lrsquoeacutepuisement des parties prenantes bull Des deacutelais significatifs souvent neacutecessaires pour arriver agrave lrsquoautonomisation de la communauteacute bull Un coucirct financier que certaines instances admi-nistratives ou certaines institutions ne peuvent assumer bull Un peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute communautaire limiteacute par la dimension et la taille du groupe des personnes concerneacutees bull Drsquoeacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indivi-duels et collectifs bull La potentielle remise en cause des postures traditionnelles bull La difficulteacute agrave faire collaborer des personnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents
6 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
bull La vulneacuterabiliteacute de certaines cateacutegories de la population qui peuvent demeurer invisibles bull Le fait que certains porteurs et certaines por-teuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participa - tives mais qursquoils ou elles se sentent deacutemuni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale
Lrsquoeacutevaluation de ce type de deacutemarche se fait princi-palement au niveau drsquoune eacutevaluation de processus Cependant quand cela se justifie une eacutevaluation drsquoimpact peut avoir du sens
1 Modegravele deacuteveloppeacute par la Commission de Preacutevention et de Promotion de la Santeacute (CPPS) et Promotion Santeacute Suisse en srsquoinspirant drsquoeacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteurs
DESCRIPTION DES QUATRE TYPES DE PARTICIPATION DES ACTEURS ET ACTRICES1
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 7
2 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions2
8 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
laquoIl ne faut pas partir avec des ideacutees toute faites il faut au
contraire se montrer agrave lrsquoeacutecoute des beacuteneacuteficiairesraquo
(Responsable de projet genevois)
La Charte drsquoOttawa adopteacutee le 21 novembre 1986 par la premiegravere Confeacuterence internationale pour la promotion de la santeacute a jeteacute les bases pour que cette promotion considegravere lrsquoindividu comme le maicirctre de sa propre santeacute Cette charte deacutefinit les conditions de possibiliteacutes qui doivent permettre entre autres de laquodonner agrave tous les individus les moyens et les occasions voulus pour reacutealiser pleine-ment leur potentiel de santeacuteraquo (OMS 1986 2) et eacutenonce cinq actions qui doivent permettre de reacute-pondre agrave cette exigence (eacutelaborer une politique pu-blique saine creacuteer des milieux favorables renfor-cer lrsquoaction communautaire acqueacuterir des aptitudes individuelles reacuteorienter les services de santeacute) La troisiegraveme de ces recommandations fait clairement reacutefeacuterence agrave la participation puisque lrsquoon peut lire dans son explicitation les propos suivants laquoLa pro-motion de la santeacute procegravede de la participation effec-tive et concregravete de la communauteacute agrave la fixation des prioriteacutes agrave la prise des deacutecisions et agrave lrsquoeacutelaboration des strateacutegies de planification pour atteindre un meilleur niveau de santeacute La promotion de la santeacute puise dans les ressources humaines et physiques de la communauteacute pour stimuler lrsquoindeacutependance de lrsquoindividu et le soutien social et pour instaurer des systegravemes souples susceptibles de renforcer la par-ticipation et le controcircle du public dans les questions sanitaires Cela exige lrsquoaccegraves illimiteacute et permanent aux informations sur la santeacute aux possibiliteacutes de santeacute et agrave lrsquoaide financiegravereraquo (OMS 1986 4) La qua-triegraveme insiste sur le soutien qui doit ecirctre accordeacute aux individus afin que ceux-ci soient agrave mecircme laquodrsquoexer-cer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute et de faire des choix favorables agrave celle-ciraquo (ibid 4) Selon Deschamps cette charte propose de fait une veacuteritable alter-native aux tendances politiques et eacuteconomiques du moment dans la mesure ougrave elle laquocomplegravete notre deacutemocratie repreacutesentative par des proceacutedures de deacutemocratie partici-pative et cela nrsquoest pas superflu dans un contexte de crise du politique et de perte de confiance du peuple
agrave lrsquoeacutegard de ses repreacutesentants eacutelusraquo (Deschamps 2003 320)On remarque donc que cette charte accorde une im-portance consideacuterable au principe de participation et drsquoempowerment Agrave lrsquoinstar drsquoautres concepts (ap-proche mobilisation ou actions communautaires processus deacutemarches ou approches participatives) elle rend compte drsquoune volonteacute de favoriser les pro-cessus deacutemocratiques et de placer lrsquoindividu au centre des preacuteoccupations Selon Mouterde et al (2011) la participation des potentiels beacuteneacuteficiaires srsquoavegravere par ailleurs particuliegraverement preacutecieuse dans la mesure ougrave elle
bull Favorise le deacutecloisonnement professionnel et lrsquointersectorialiteacute Les facteurs de santeacute appa-raissent comme des dimensions de lrsquoaction mais sont pris en compte avec drsquoautres dimensions drsquoordre psychologique social environnemental etc bull Permet la laquocapacitationraquo et lrsquoempowerment des gens et des communauteacutes il srsquoagit ainsi de les mettre en capaciteacute de srsquoimpliquer et de srsquoengager bull Vise la recherche drsquoune prise de conscience et drsquoune eacutemancipation des membres drsquoune commu-nauteacute ce qui permet de tendre agrave une responsabi-lisation de cette derniegravere Cela paraicirct particu-liegraverement inteacuteressant et utile dans une peacuteriode de tension croissante sur les ressources drsquoautant plus que la participation est susceptible de favo-riser une meilleure reacutegulation des actions de santeacute publique
Au regard des expeacuteriences romandes et tessinoises qui ont eacuteteacute analyseacutees pour eacutelaborer le preacutesent docu-
ment la mise en place de projets participatifs srsquoavegravere beacuteneacutefique car elle permet de consideacuterer avec une attention particuliegravere les be-soins reacuteels des beacuteneacuteficiaires qui peuvent proposer des solutions aux problegravemes qursquoeux-mecircmes per-
ccediloivent et qursquoils ou elles ont envie de reacutesoudre Ce faisant ilselles srsquoengagent dans le processus et se
1 Introduction
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 9
laquoLes porteurs et les animateurs doivent accepter que certains groupes ne sont pas preneurs
des propositions ou qursquoils preacutefegraverent eacutevoluer dans des
structures associatives hieacuterar-chiques Crsquoest comme avec
un enfant on peut transmettre ce en quoi on croit mais ce
qursquoil va en faire ne nous appar-tient pasraquo
(Responsable de projet vaudois)
responsabilisent ce qui eacutevite geacuteneacuteralement de sus-citer des frustrations Qui plus est la participation peut induire une impleacutementation de programmes sur le long terme et les compeacutetences acquises du-rant le processus peuvent ensuite ecirctre mobiliseacutees pour drsquoautres projets dans drsquoautres contextes Par conseacutequent tout porte agrave croire que la participation contribue agrave ameacuteliorer les deacutemarches en matiegravere de promotion de la santeacute Or le passage de lrsquoeacutenonciation de tels preacuteceptes agrave leur mise en ap-plication concregravete srsquoavegravere parfois difficile Ainsi lrsquoun des auteurs qui a contribueacute agrave lrsquoouvrage collectif 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promo-tion de la santeacute dans divers pays francophones eacutecrit laquoFaire action de plaidoyer pour faire recon-naicirctre la deacutemarche de promotion de la santeacute reste donc bien lrsquoun des enjeux majeurs des anneacutees agrave venir Pour lrsquoheure la promotion de la santeacute semble insuffisante agrave bien des eacutegards pour mobiliser et faire participer Ce qui nrsquoest pas la moindre des inconvenances puisque ce sont juste-ment lagrave des objectifs qursquoelle entend atteindreraquo (Lo-renzo 2012 66) Constat par ailleurs repris dans la conclusion en ces termes laquoHormis la diversiteacute et la complexiteacute des contextes dans lesquels se meut la Charte drsquoOttawa il reste un certain nombre de deacute-fis agrave relever pour reacuteellement faire eacutevoluer les pra-tiques Le besoin de renforcer les approches partici-patives le travail en partenariat et la collaboration intersectorielle la neacutecessiteacute drsquoaugmenter la dispo-nibiliteacute des ressources et lrsquoimportance de se doter drsquooutils drsquoeacutevaluation se sont par exemple fait res-sentirraquo (Lannes amp Sanni Yaya 2012 85)Le preacutesent document a pour objectif de prendre acte de ces quelques mises en garde afin de mettre en place des processus participatifs qui tiennent compte des besoins de la population et de beacuteneacutefi - cier de reacutesultats aussi peacuterennes que possible Crsquoest
pourquoi il est proposeacute dans ce qui suit de deacutefinir le concept de laquoparticipationraquo puis drsquoapporter des eacuteleacute-ments de reacuteponses aux questions suivantes qui sont les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une deacutemarche par ticipative Quel est le degreacute de leur implication Comment permettre un suivi et mesu-rer lrsquoampleur et les impacts drsquoun projet de participa-tion dans le cadre de la promotion de la santeacute Quelles sont les eacutetapes agrave suivre pour mener agrave bien
un tel projet Quelles peuvent ecirctre les difficulteacutes rencontreacutees Ensuite il est mentionneacute une liste de questions qursquoil est neacutecessaire de se poser avant de mettre en place une deacutemarche participative Afin drsquoillustrer certains de ces eacuteleacutements trois projets sont briegrave-vement preacutesenteacutes Srsquoil peut pa-raicirctre difficilement envisageable de les reproduire dans un autre contexte il nrsquoen demeure pas moins que ces exemples doivent permettre de saisir certains en-
jeux relatifs aux processus participatifsEn deacutefinitive crsquoest dans le dessein drsquoapporter une meilleure compreacutehension de la participation en ma-tiegravere de promotion de la santeacute que les cantons latins et Promotion Santeacute Suisse se sont donneacute pour ob-jectif de deacutefinir un cadre conceptuel commun et drsquoidentifier les possibiliteacutes drsquoapplications concregravetes dans les strateacutegies et projets agrave venir dans ce do-maine Cette maniegravere de proceacuteder est fon damentale puisque comme le notent Fournier et Potvin laquoca-racteacuteriser puis mesurer la participation commu-nautaire ne sont pas des exercices de style futiles Au moment ougrave cette notion occupe une place preacute-pondeacuterante dans le discours des professionnels de la santeacute il serait utile de preacuteciser ce que lrsquoon entend et surtout ce que lrsquoon attend de la participation com-munautaire Cette clarification permettrait de reacuteeacuteva - luer des strateacutegies qui se basent sur cette notion et drsquoeacutevi ter une deacuterive rheacutetoriqueraquo (Fournier amp Potvin 1995 54)
10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

6 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
bull La vulneacuterabiliteacute de certaines cateacutegories de la population qui peuvent demeurer invisibles bull Le fait que certains porteurs et certaines por-teuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participa - tives mais qursquoils ou elles se sentent deacutemuni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale
Lrsquoeacutevaluation de ce type de deacutemarche se fait princi-palement au niveau drsquoune eacutevaluation de processus Cependant quand cela se justifie une eacutevaluation drsquoimpact peut avoir du sens
1 Modegravele deacuteveloppeacute par la Commission de Preacutevention et de Promotion de la Santeacute (CPPS) et Promotion Santeacute Suisse en srsquoinspirant drsquoeacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteurs
DESCRIPTION DES QUATRE TYPES DE PARTICIPATION DES ACTEURS ET ACTRICES1
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 7
2 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions2
8 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
laquoIl ne faut pas partir avec des ideacutees toute faites il faut au
contraire se montrer agrave lrsquoeacutecoute des beacuteneacuteficiairesraquo
(Responsable de projet genevois)
La Charte drsquoOttawa adopteacutee le 21 novembre 1986 par la premiegravere Confeacuterence internationale pour la promotion de la santeacute a jeteacute les bases pour que cette promotion considegravere lrsquoindividu comme le maicirctre de sa propre santeacute Cette charte deacutefinit les conditions de possibiliteacutes qui doivent permettre entre autres de laquodonner agrave tous les individus les moyens et les occasions voulus pour reacutealiser pleine-ment leur potentiel de santeacuteraquo (OMS 1986 2) et eacutenonce cinq actions qui doivent permettre de reacute-pondre agrave cette exigence (eacutelaborer une politique pu-blique saine creacuteer des milieux favorables renfor-cer lrsquoaction communautaire acqueacuterir des aptitudes individuelles reacuteorienter les services de santeacute) La troisiegraveme de ces recommandations fait clairement reacutefeacuterence agrave la participation puisque lrsquoon peut lire dans son explicitation les propos suivants laquoLa pro-motion de la santeacute procegravede de la participation effec-tive et concregravete de la communauteacute agrave la fixation des prioriteacutes agrave la prise des deacutecisions et agrave lrsquoeacutelaboration des strateacutegies de planification pour atteindre un meilleur niveau de santeacute La promotion de la santeacute puise dans les ressources humaines et physiques de la communauteacute pour stimuler lrsquoindeacutependance de lrsquoindividu et le soutien social et pour instaurer des systegravemes souples susceptibles de renforcer la par-ticipation et le controcircle du public dans les questions sanitaires Cela exige lrsquoaccegraves illimiteacute et permanent aux informations sur la santeacute aux possibiliteacutes de santeacute et agrave lrsquoaide financiegravereraquo (OMS 1986 4) La qua-triegraveme insiste sur le soutien qui doit ecirctre accordeacute aux individus afin que ceux-ci soient agrave mecircme laquodrsquoexer-cer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute et de faire des choix favorables agrave celle-ciraquo (ibid 4) Selon Deschamps cette charte propose de fait une veacuteritable alter-native aux tendances politiques et eacuteconomiques du moment dans la mesure ougrave elle laquocomplegravete notre deacutemocratie repreacutesentative par des proceacutedures de deacutemocratie partici-pative et cela nrsquoest pas superflu dans un contexte de crise du politique et de perte de confiance du peuple
agrave lrsquoeacutegard de ses repreacutesentants eacutelusraquo (Deschamps 2003 320)On remarque donc que cette charte accorde une im-portance consideacuterable au principe de participation et drsquoempowerment Agrave lrsquoinstar drsquoautres concepts (ap-proche mobilisation ou actions communautaires processus deacutemarches ou approches participatives) elle rend compte drsquoune volonteacute de favoriser les pro-cessus deacutemocratiques et de placer lrsquoindividu au centre des preacuteoccupations Selon Mouterde et al (2011) la participation des potentiels beacuteneacuteficiaires srsquoavegravere par ailleurs particuliegraverement preacutecieuse dans la mesure ougrave elle
bull Favorise le deacutecloisonnement professionnel et lrsquointersectorialiteacute Les facteurs de santeacute appa-raissent comme des dimensions de lrsquoaction mais sont pris en compte avec drsquoautres dimensions drsquoordre psychologique social environnemental etc bull Permet la laquocapacitationraquo et lrsquoempowerment des gens et des communauteacutes il srsquoagit ainsi de les mettre en capaciteacute de srsquoimpliquer et de srsquoengager bull Vise la recherche drsquoune prise de conscience et drsquoune eacutemancipation des membres drsquoune commu-nauteacute ce qui permet de tendre agrave une responsabi-lisation de cette derniegravere Cela paraicirct particu-liegraverement inteacuteressant et utile dans une peacuteriode de tension croissante sur les ressources drsquoautant plus que la participation est susceptible de favo-riser une meilleure reacutegulation des actions de santeacute publique
Au regard des expeacuteriences romandes et tessinoises qui ont eacuteteacute analyseacutees pour eacutelaborer le preacutesent docu-
ment la mise en place de projets participatifs srsquoavegravere beacuteneacutefique car elle permet de consideacuterer avec une attention particuliegravere les be-soins reacuteels des beacuteneacuteficiaires qui peuvent proposer des solutions aux problegravemes qursquoeux-mecircmes per-
ccediloivent et qursquoils ou elles ont envie de reacutesoudre Ce faisant ilselles srsquoengagent dans le processus et se
1 Introduction
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 9
laquoLes porteurs et les animateurs doivent accepter que certains groupes ne sont pas preneurs
des propositions ou qursquoils preacutefegraverent eacutevoluer dans des
structures associatives hieacuterar-chiques Crsquoest comme avec
un enfant on peut transmettre ce en quoi on croit mais ce
qursquoil va en faire ne nous appar-tient pasraquo
(Responsable de projet vaudois)
responsabilisent ce qui eacutevite geacuteneacuteralement de sus-citer des frustrations Qui plus est la participation peut induire une impleacutementation de programmes sur le long terme et les compeacutetences acquises du-rant le processus peuvent ensuite ecirctre mobiliseacutees pour drsquoautres projets dans drsquoautres contextes Par conseacutequent tout porte agrave croire que la participation contribue agrave ameacuteliorer les deacutemarches en matiegravere de promotion de la santeacute Or le passage de lrsquoeacutenonciation de tels preacuteceptes agrave leur mise en ap-plication concregravete srsquoavegravere parfois difficile Ainsi lrsquoun des auteurs qui a contribueacute agrave lrsquoouvrage collectif 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promo-tion de la santeacute dans divers pays francophones eacutecrit laquoFaire action de plaidoyer pour faire recon-naicirctre la deacutemarche de promotion de la santeacute reste donc bien lrsquoun des enjeux majeurs des anneacutees agrave venir Pour lrsquoheure la promotion de la santeacute semble insuffisante agrave bien des eacutegards pour mobiliser et faire participer Ce qui nrsquoest pas la moindre des inconvenances puisque ce sont juste-ment lagrave des objectifs qursquoelle entend atteindreraquo (Lo-renzo 2012 66) Constat par ailleurs repris dans la conclusion en ces termes laquoHormis la diversiteacute et la complexiteacute des contextes dans lesquels se meut la Charte drsquoOttawa il reste un certain nombre de deacute-fis agrave relever pour reacuteellement faire eacutevoluer les pra-tiques Le besoin de renforcer les approches partici-patives le travail en partenariat et la collaboration intersectorielle la neacutecessiteacute drsquoaugmenter la dispo-nibiliteacute des ressources et lrsquoimportance de se doter drsquooutils drsquoeacutevaluation se sont par exemple fait res-sentirraquo (Lannes amp Sanni Yaya 2012 85)Le preacutesent document a pour objectif de prendre acte de ces quelques mises en garde afin de mettre en place des processus participatifs qui tiennent compte des besoins de la population et de beacuteneacutefi - cier de reacutesultats aussi peacuterennes que possible Crsquoest
pourquoi il est proposeacute dans ce qui suit de deacutefinir le concept de laquoparticipationraquo puis drsquoapporter des eacuteleacute-ments de reacuteponses aux questions suivantes qui sont les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une deacutemarche par ticipative Quel est le degreacute de leur implication Comment permettre un suivi et mesu-rer lrsquoampleur et les impacts drsquoun projet de participa-tion dans le cadre de la promotion de la santeacute Quelles sont les eacutetapes agrave suivre pour mener agrave bien
un tel projet Quelles peuvent ecirctre les difficulteacutes rencontreacutees Ensuite il est mentionneacute une liste de questions qursquoil est neacutecessaire de se poser avant de mettre en place une deacutemarche participative Afin drsquoillustrer certains de ces eacuteleacutements trois projets sont briegrave-vement preacutesenteacutes Srsquoil peut pa-raicirctre difficilement envisageable de les reproduire dans un autre contexte il nrsquoen demeure pas moins que ces exemples doivent permettre de saisir certains en-
jeux relatifs aux processus participatifsEn deacutefinitive crsquoest dans le dessein drsquoapporter une meilleure compreacutehension de la participation en ma-tiegravere de promotion de la santeacute que les cantons latins et Promotion Santeacute Suisse se sont donneacute pour ob-jectif de deacutefinir un cadre conceptuel commun et drsquoidentifier les possibiliteacutes drsquoapplications concregravetes dans les strateacutegies et projets agrave venir dans ce do-maine Cette maniegravere de proceacuteder est fon damentale puisque comme le notent Fournier et Potvin laquoca-racteacuteriser puis mesurer la participation commu-nautaire ne sont pas des exercices de style futiles Au moment ougrave cette notion occupe une place preacute-pondeacuterante dans le discours des professionnels de la santeacute il serait utile de preacuteciser ce que lrsquoon entend et surtout ce que lrsquoon attend de la participation com-munautaire Cette clarification permettrait de reacuteeacuteva - luer des strateacutegies qui se basent sur cette notion et drsquoeacutevi ter une deacuterive rheacutetoriqueraquo (Fournier amp Potvin 1995 54)
10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 7
2 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions2
8 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
laquoIl ne faut pas partir avec des ideacutees toute faites il faut au
contraire se montrer agrave lrsquoeacutecoute des beacuteneacuteficiairesraquo
(Responsable de projet genevois)
La Charte drsquoOttawa adopteacutee le 21 novembre 1986 par la premiegravere Confeacuterence internationale pour la promotion de la santeacute a jeteacute les bases pour que cette promotion considegravere lrsquoindividu comme le maicirctre de sa propre santeacute Cette charte deacutefinit les conditions de possibiliteacutes qui doivent permettre entre autres de laquodonner agrave tous les individus les moyens et les occasions voulus pour reacutealiser pleine-ment leur potentiel de santeacuteraquo (OMS 1986 2) et eacutenonce cinq actions qui doivent permettre de reacute-pondre agrave cette exigence (eacutelaborer une politique pu-blique saine creacuteer des milieux favorables renfor-cer lrsquoaction communautaire acqueacuterir des aptitudes individuelles reacuteorienter les services de santeacute) La troisiegraveme de ces recommandations fait clairement reacutefeacuterence agrave la participation puisque lrsquoon peut lire dans son explicitation les propos suivants laquoLa pro-motion de la santeacute procegravede de la participation effec-tive et concregravete de la communauteacute agrave la fixation des prioriteacutes agrave la prise des deacutecisions et agrave lrsquoeacutelaboration des strateacutegies de planification pour atteindre un meilleur niveau de santeacute La promotion de la santeacute puise dans les ressources humaines et physiques de la communauteacute pour stimuler lrsquoindeacutependance de lrsquoindividu et le soutien social et pour instaurer des systegravemes souples susceptibles de renforcer la par-ticipation et le controcircle du public dans les questions sanitaires Cela exige lrsquoaccegraves illimiteacute et permanent aux informations sur la santeacute aux possibiliteacutes de santeacute et agrave lrsquoaide financiegravereraquo (OMS 1986 4) La qua-triegraveme insiste sur le soutien qui doit ecirctre accordeacute aux individus afin que ceux-ci soient agrave mecircme laquodrsquoexer-cer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute et de faire des choix favorables agrave celle-ciraquo (ibid 4) Selon Deschamps cette charte propose de fait une veacuteritable alter-native aux tendances politiques et eacuteconomiques du moment dans la mesure ougrave elle laquocomplegravete notre deacutemocratie repreacutesentative par des proceacutedures de deacutemocratie partici-pative et cela nrsquoest pas superflu dans un contexte de crise du politique et de perte de confiance du peuple
agrave lrsquoeacutegard de ses repreacutesentants eacutelusraquo (Deschamps 2003 320)On remarque donc que cette charte accorde une im-portance consideacuterable au principe de participation et drsquoempowerment Agrave lrsquoinstar drsquoautres concepts (ap-proche mobilisation ou actions communautaires processus deacutemarches ou approches participatives) elle rend compte drsquoune volonteacute de favoriser les pro-cessus deacutemocratiques et de placer lrsquoindividu au centre des preacuteoccupations Selon Mouterde et al (2011) la participation des potentiels beacuteneacuteficiaires srsquoavegravere par ailleurs particuliegraverement preacutecieuse dans la mesure ougrave elle
bull Favorise le deacutecloisonnement professionnel et lrsquointersectorialiteacute Les facteurs de santeacute appa-raissent comme des dimensions de lrsquoaction mais sont pris en compte avec drsquoautres dimensions drsquoordre psychologique social environnemental etc bull Permet la laquocapacitationraquo et lrsquoempowerment des gens et des communauteacutes il srsquoagit ainsi de les mettre en capaciteacute de srsquoimpliquer et de srsquoengager bull Vise la recherche drsquoune prise de conscience et drsquoune eacutemancipation des membres drsquoune commu-nauteacute ce qui permet de tendre agrave une responsabi-lisation de cette derniegravere Cela paraicirct particu-liegraverement inteacuteressant et utile dans une peacuteriode de tension croissante sur les ressources drsquoautant plus que la participation est susceptible de favo-riser une meilleure reacutegulation des actions de santeacute publique
Au regard des expeacuteriences romandes et tessinoises qui ont eacuteteacute analyseacutees pour eacutelaborer le preacutesent docu-
ment la mise en place de projets participatifs srsquoavegravere beacuteneacutefique car elle permet de consideacuterer avec une attention particuliegravere les be-soins reacuteels des beacuteneacuteficiaires qui peuvent proposer des solutions aux problegravemes qursquoeux-mecircmes per-
ccediloivent et qursquoils ou elles ont envie de reacutesoudre Ce faisant ilselles srsquoengagent dans le processus et se
1 Introduction
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 9
laquoLes porteurs et les animateurs doivent accepter que certains groupes ne sont pas preneurs
des propositions ou qursquoils preacutefegraverent eacutevoluer dans des
structures associatives hieacuterar-chiques Crsquoest comme avec
un enfant on peut transmettre ce en quoi on croit mais ce
qursquoil va en faire ne nous appar-tient pasraquo
(Responsable de projet vaudois)
responsabilisent ce qui eacutevite geacuteneacuteralement de sus-citer des frustrations Qui plus est la participation peut induire une impleacutementation de programmes sur le long terme et les compeacutetences acquises du-rant le processus peuvent ensuite ecirctre mobiliseacutees pour drsquoautres projets dans drsquoautres contextes Par conseacutequent tout porte agrave croire que la participation contribue agrave ameacuteliorer les deacutemarches en matiegravere de promotion de la santeacute Or le passage de lrsquoeacutenonciation de tels preacuteceptes agrave leur mise en ap-plication concregravete srsquoavegravere parfois difficile Ainsi lrsquoun des auteurs qui a contribueacute agrave lrsquoouvrage collectif 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promo-tion de la santeacute dans divers pays francophones eacutecrit laquoFaire action de plaidoyer pour faire recon-naicirctre la deacutemarche de promotion de la santeacute reste donc bien lrsquoun des enjeux majeurs des anneacutees agrave venir Pour lrsquoheure la promotion de la santeacute semble insuffisante agrave bien des eacutegards pour mobiliser et faire participer Ce qui nrsquoest pas la moindre des inconvenances puisque ce sont juste-ment lagrave des objectifs qursquoelle entend atteindreraquo (Lo-renzo 2012 66) Constat par ailleurs repris dans la conclusion en ces termes laquoHormis la diversiteacute et la complexiteacute des contextes dans lesquels se meut la Charte drsquoOttawa il reste un certain nombre de deacute-fis agrave relever pour reacuteellement faire eacutevoluer les pra-tiques Le besoin de renforcer les approches partici-patives le travail en partenariat et la collaboration intersectorielle la neacutecessiteacute drsquoaugmenter la dispo-nibiliteacute des ressources et lrsquoimportance de se doter drsquooutils drsquoeacutevaluation se sont par exemple fait res-sentirraquo (Lannes amp Sanni Yaya 2012 85)Le preacutesent document a pour objectif de prendre acte de ces quelques mises en garde afin de mettre en place des processus participatifs qui tiennent compte des besoins de la population et de beacuteneacutefi - cier de reacutesultats aussi peacuterennes que possible Crsquoest
pourquoi il est proposeacute dans ce qui suit de deacutefinir le concept de laquoparticipationraquo puis drsquoapporter des eacuteleacute-ments de reacuteponses aux questions suivantes qui sont les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une deacutemarche par ticipative Quel est le degreacute de leur implication Comment permettre un suivi et mesu-rer lrsquoampleur et les impacts drsquoun projet de participa-tion dans le cadre de la promotion de la santeacute Quelles sont les eacutetapes agrave suivre pour mener agrave bien
un tel projet Quelles peuvent ecirctre les difficulteacutes rencontreacutees Ensuite il est mentionneacute une liste de questions qursquoil est neacutecessaire de se poser avant de mettre en place une deacutemarche participative Afin drsquoillustrer certains de ces eacuteleacutements trois projets sont briegrave-vement preacutesenteacutes Srsquoil peut pa-raicirctre difficilement envisageable de les reproduire dans un autre contexte il nrsquoen demeure pas moins que ces exemples doivent permettre de saisir certains en-
jeux relatifs aux processus participatifsEn deacutefinitive crsquoest dans le dessein drsquoapporter une meilleure compreacutehension de la participation en ma-tiegravere de promotion de la santeacute que les cantons latins et Promotion Santeacute Suisse se sont donneacute pour ob-jectif de deacutefinir un cadre conceptuel commun et drsquoidentifier les possibiliteacutes drsquoapplications concregravetes dans les strateacutegies et projets agrave venir dans ce do-maine Cette maniegravere de proceacuteder est fon damentale puisque comme le notent Fournier et Potvin laquoca-racteacuteriser puis mesurer la participation commu-nautaire ne sont pas des exercices de style futiles Au moment ougrave cette notion occupe une place preacute-pondeacuterante dans le discours des professionnels de la santeacute il serait utile de preacuteciser ce que lrsquoon entend et surtout ce que lrsquoon attend de la participation com-munautaire Cette clarification permettrait de reacuteeacuteva - luer des strateacutegies qui se basent sur cette notion et drsquoeacutevi ter une deacuterive rheacutetoriqueraquo (Fournier amp Potvin 1995 54)
10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

8 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
laquoIl ne faut pas partir avec des ideacutees toute faites il faut au
contraire se montrer agrave lrsquoeacutecoute des beacuteneacuteficiairesraquo
(Responsable de projet genevois)
La Charte drsquoOttawa adopteacutee le 21 novembre 1986 par la premiegravere Confeacuterence internationale pour la promotion de la santeacute a jeteacute les bases pour que cette promotion considegravere lrsquoindividu comme le maicirctre de sa propre santeacute Cette charte deacutefinit les conditions de possibiliteacutes qui doivent permettre entre autres de laquodonner agrave tous les individus les moyens et les occasions voulus pour reacutealiser pleine-ment leur potentiel de santeacuteraquo (OMS 1986 2) et eacutenonce cinq actions qui doivent permettre de reacute-pondre agrave cette exigence (eacutelaborer une politique pu-blique saine creacuteer des milieux favorables renfor-cer lrsquoaction communautaire acqueacuterir des aptitudes individuelles reacuteorienter les services de santeacute) La troisiegraveme de ces recommandations fait clairement reacutefeacuterence agrave la participation puisque lrsquoon peut lire dans son explicitation les propos suivants laquoLa pro-motion de la santeacute procegravede de la participation effec-tive et concregravete de la communauteacute agrave la fixation des prioriteacutes agrave la prise des deacutecisions et agrave lrsquoeacutelaboration des strateacutegies de planification pour atteindre un meilleur niveau de santeacute La promotion de la santeacute puise dans les ressources humaines et physiques de la communauteacute pour stimuler lrsquoindeacutependance de lrsquoindividu et le soutien social et pour instaurer des systegravemes souples susceptibles de renforcer la par-ticipation et le controcircle du public dans les questions sanitaires Cela exige lrsquoaccegraves illimiteacute et permanent aux informations sur la santeacute aux possibiliteacutes de santeacute et agrave lrsquoaide financiegravereraquo (OMS 1986 4) La qua-triegraveme insiste sur le soutien qui doit ecirctre accordeacute aux individus afin que ceux-ci soient agrave mecircme laquodrsquoexer-cer un plus grand controcircle sur leur propre santeacute et de faire des choix favorables agrave celle-ciraquo (ibid 4) Selon Deschamps cette charte propose de fait une veacuteritable alter-native aux tendances politiques et eacuteconomiques du moment dans la mesure ougrave elle laquocomplegravete notre deacutemocratie repreacutesentative par des proceacutedures de deacutemocratie partici-pative et cela nrsquoest pas superflu dans un contexte de crise du politique et de perte de confiance du peuple
agrave lrsquoeacutegard de ses repreacutesentants eacutelusraquo (Deschamps 2003 320)On remarque donc que cette charte accorde une im-portance consideacuterable au principe de participation et drsquoempowerment Agrave lrsquoinstar drsquoautres concepts (ap-proche mobilisation ou actions communautaires processus deacutemarches ou approches participatives) elle rend compte drsquoune volonteacute de favoriser les pro-cessus deacutemocratiques et de placer lrsquoindividu au centre des preacuteoccupations Selon Mouterde et al (2011) la participation des potentiels beacuteneacuteficiaires srsquoavegravere par ailleurs particuliegraverement preacutecieuse dans la mesure ougrave elle
bull Favorise le deacutecloisonnement professionnel et lrsquointersectorialiteacute Les facteurs de santeacute appa-raissent comme des dimensions de lrsquoaction mais sont pris en compte avec drsquoautres dimensions drsquoordre psychologique social environnemental etc bull Permet la laquocapacitationraquo et lrsquoempowerment des gens et des communauteacutes il srsquoagit ainsi de les mettre en capaciteacute de srsquoimpliquer et de srsquoengager bull Vise la recherche drsquoune prise de conscience et drsquoune eacutemancipation des membres drsquoune commu-nauteacute ce qui permet de tendre agrave une responsabi-lisation de cette derniegravere Cela paraicirct particu-liegraverement inteacuteressant et utile dans une peacuteriode de tension croissante sur les ressources drsquoautant plus que la participation est susceptible de favo-riser une meilleure reacutegulation des actions de santeacute publique
Au regard des expeacuteriences romandes et tessinoises qui ont eacuteteacute analyseacutees pour eacutelaborer le preacutesent docu-
ment la mise en place de projets participatifs srsquoavegravere beacuteneacutefique car elle permet de consideacuterer avec une attention particuliegravere les be-soins reacuteels des beacuteneacuteficiaires qui peuvent proposer des solutions aux problegravemes qursquoeux-mecircmes per-
ccediloivent et qursquoils ou elles ont envie de reacutesoudre Ce faisant ilselles srsquoengagent dans le processus et se
1 Introduction
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 9
laquoLes porteurs et les animateurs doivent accepter que certains groupes ne sont pas preneurs
des propositions ou qursquoils preacutefegraverent eacutevoluer dans des
structures associatives hieacuterar-chiques Crsquoest comme avec
un enfant on peut transmettre ce en quoi on croit mais ce
qursquoil va en faire ne nous appar-tient pasraquo
(Responsable de projet vaudois)
responsabilisent ce qui eacutevite geacuteneacuteralement de sus-citer des frustrations Qui plus est la participation peut induire une impleacutementation de programmes sur le long terme et les compeacutetences acquises du-rant le processus peuvent ensuite ecirctre mobiliseacutees pour drsquoautres projets dans drsquoautres contextes Par conseacutequent tout porte agrave croire que la participation contribue agrave ameacuteliorer les deacutemarches en matiegravere de promotion de la santeacute Or le passage de lrsquoeacutenonciation de tels preacuteceptes agrave leur mise en ap-plication concregravete srsquoavegravere parfois difficile Ainsi lrsquoun des auteurs qui a contribueacute agrave lrsquoouvrage collectif 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promo-tion de la santeacute dans divers pays francophones eacutecrit laquoFaire action de plaidoyer pour faire recon-naicirctre la deacutemarche de promotion de la santeacute reste donc bien lrsquoun des enjeux majeurs des anneacutees agrave venir Pour lrsquoheure la promotion de la santeacute semble insuffisante agrave bien des eacutegards pour mobiliser et faire participer Ce qui nrsquoest pas la moindre des inconvenances puisque ce sont juste-ment lagrave des objectifs qursquoelle entend atteindreraquo (Lo-renzo 2012 66) Constat par ailleurs repris dans la conclusion en ces termes laquoHormis la diversiteacute et la complexiteacute des contextes dans lesquels se meut la Charte drsquoOttawa il reste un certain nombre de deacute-fis agrave relever pour reacuteellement faire eacutevoluer les pra-tiques Le besoin de renforcer les approches partici-patives le travail en partenariat et la collaboration intersectorielle la neacutecessiteacute drsquoaugmenter la dispo-nibiliteacute des ressources et lrsquoimportance de se doter drsquooutils drsquoeacutevaluation se sont par exemple fait res-sentirraquo (Lannes amp Sanni Yaya 2012 85)Le preacutesent document a pour objectif de prendre acte de ces quelques mises en garde afin de mettre en place des processus participatifs qui tiennent compte des besoins de la population et de beacuteneacutefi - cier de reacutesultats aussi peacuterennes que possible Crsquoest
pourquoi il est proposeacute dans ce qui suit de deacutefinir le concept de laquoparticipationraquo puis drsquoapporter des eacuteleacute-ments de reacuteponses aux questions suivantes qui sont les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une deacutemarche par ticipative Quel est le degreacute de leur implication Comment permettre un suivi et mesu-rer lrsquoampleur et les impacts drsquoun projet de participa-tion dans le cadre de la promotion de la santeacute Quelles sont les eacutetapes agrave suivre pour mener agrave bien
un tel projet Quelles peuvent ecirctre les difficulteacutes rencontreacutees Ensuite il est mentionneacute une liste de questions qursquoil est neacutecessaire de se poser avant de mettre en place une deacutemarche participative Afin drsquoillustrer certains de ces eacuteleacutements trois projets sont briegrave-vement preacutesenteacutes Srsquoil peut pa-raicirctre difficilement envisageable de les reproduire dans un autre contexte il nrsquoen demeure pas moins que ces exemples doivent permettre de saisir certains en-
jeux relatifs aux processus participatifsEn deacutefinitive crsquoest dans le dessein drsquoapporter une meilleure compreacutehension de la participation en ma-tiegravere de promotion de la santeacute que les cantons latins et Promotion Santeacute Suisse se sont donneacute pour ob-jectif de deacutefinir un cadre conceptuel commun et drsquoidentifier les possibiliteacutes drsquoapplications concregravetes dans les strateacutegies et projets agrave venir dans ce do-maine Cette maniegravere de proceacuteder est fon damentale puisque comme le notent Fournier et Potvin laquoca-racteacuteriser puis mesurer la participation commu-nautaire ne sont pas des exercices de style futiles Au moment ougrave cette notion occupe une place preacute-pondeacuterante dans le discours des professionnels de la santeacute il serait utile de preacuteciser ce que lrsquoon entend et surtout ce que lrsquoon attend de la participation com-munautaire Cette clarification permettrait de reacuteeacuteva - luer des strateacutegies qui se basent sur cette notion et drsquoeacutevi ter une deacuterive rheacutetoriqueraquo (Fournier amp Potvin 1995 54)
10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 9
laquoLes porteurs et les animateurs doivent accepter que certains groupes ne sont pas preneurs
des propositions ou qursquoils preacutefegraverent eacutevoluer dans des
structures associatives hieacuterar-chiques Crsquoest comme avec
un enfant on peut transmettre ce en quoi on croit mais ce
qursquoil va en faire ne nous appar-tient pasraquo
(Responsable de projet vaudois)
responsabilisent ce qui eacutevite geacuteneacuteralement de sus-citer des frustrations Qui plus est la participation peut induire une impleacutementation de programmes sur le long terme et les compeacutetences acquises du-rant le processus peuvent ensuite ecirctre mobiliseacutees pour drsquoautres projets dans drsquoautres contextes Par conseacutequent tout porte agrave croire que la participation contribue agrave ameacuteliorer les deacutemarches en matiegravere de promotion de la santeacute Or le passage de lrsquoeacutenonciation de tels preacuteceptes agrave leur mise en ap-plication concregravete srsquoavegravere parfois difficile Ainsi lrsquoun des auteurs qui a contribueacute agrave lrsquoouvrage collectif 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promo-tion de la santeacute dans divers pays francophones eacutecrit laquoFaire action de plaidoyer pour faire recon-naicirctre la deacutemarche de promotion de la santeacute reste donc bien lrsquoun des enjeux majeurs des anneacutees agrave venir Pour lrsquoheure la promotion de la santeacute semble insuffisante agrave bien des eacutegards pour mobiliser et faire participer Ce qui nrsquoest pas la moindre des inconvenances puisque ce sont juste-ment lagrave des objectifs qursquoelle entend atteindreraquo (Lo-renzo 2012 66) Constat par ailleurs repris dans la conclusion en ces termes laquoHormis la diversiteacute et la complexiteacute des contextes dans lesquels se meut la Charte drsquoOttawa il reste un certain nombre de deacute-fis agrave relever pour reacuteellement faire eacutevoluer les pra-tiques Le besoin de renforcer les approches partici-patives le travail en partenariat et la collaboration intersectorielle la neacutecessiteacute drsquoaugmenter la dispo-nibiliteacute des ressources et lrsquoimportance de se doter drsquooutils drsquoeacutevaluation se sont par exemple fait res-sentirraquo (Lannes amp Sanni Yaya 2012 85)Le preacutesent document a pour objectif de prendre acte de ces quelques mises en garde afin de mettre en place des processus participatifs qui tiennent compte des besoins de la population et de beacuteneacutefi - cier de reacutesultats aussi peacuterennes que possible Crsquoest
pourquoi il est proposeacute dans ce qui suit de deacutefinir le concept de laquoparticipationraquo puis drsquoapporter des eacuteleacute-ments de reacuteponses aux questions suivantes qui sont les acteurs et actrices concerneacute-e-s par une deacutemarche par ticipative Quel est le degreacute de leur implication Comment permettre un suivi et mesu-rer lrsquoampleur et les impacts drsquoun projet de participa-tion dans le cadre de la promotion de la santeacute Quelles sont les eacutetapes agrave suivre pour mener agrave bien
un tel projet Quelles peuvent ecirctre les difficulteacutes rencontreacutees Ensuite il est mentionneacute une liste de questions qursquoil est neacutecessaire de se poser avant de mettre en place une deacutemarche participative Afin drsquoillustrer certains de ces eacuteleacutements trois projets sont briegrave-vement preacutesenteacutes Srsquoil peut pa-raicirctre difficilement envisageable de les reproduire dans un autre contexte il nrsquoen demeure pas moins que ces exemples doivent permettre de saisir certains en-
jeux relatifs aux processus participatifsEn deacutefinitive crsquoest dans le dessein drsquoapporter une meilleure compreacutehension de la participation en ma-tiegravere de promotion de la santeacute que les cantons latins et Promotion Santeacute Suisse se sont donneacute pour ob-jectif de deacutefinir un cadre conceptuel commun et drsquoidentifier les possibiliteacutes drsquoapplications concregravetes dans les strateacutegies et projets agrave venir dans ce do-maine Cette maniegravere de proceacuteder est fon damentale puisque comme le notent Fournier et Potvin laquoca-racteacuteriser puis mesurer la participation commu-nautaire ne sont pas des exercices de style futiles Au moment ougrave cette notion occupe une place preacute-pondeacuterante dans le discours des professionnels de la santeacute il serait utile de preacuteciser ce que lrsquoon entend et surtout ce que lrsquoon attend de la participation com-munautaire Cette clarification permettrait de reacuteeacuteva - luer des strateacutegies qui se basent sur cette notion et drsquoeacutevi ter une deacuterive rheacutetoriqueraquo (Fournier amp Potvin 1995 54)
10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

10 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
La premiegravere eacutetape qui a conduit agrave la reacutedaction de ce document a eacuteteacute drsquoopeacuterer une revue de la litteacuterature dans le dessein drsquoidentifier et deacutefinir les concepts et de prendre connaissance des bonnes pratiques en matiegravere de participation communautaire et de pro-cessus participatifsCe premier cadre theacuteorique a dans un deuxiegraveme temps eacuteteacute mis en consultation aupregraves des repreacutesen-tant-e-s de la Commission de Preacutevention et de Pro-motion de la Santeacute (CPPS) et de Promotion Santeacute Suisse qui se sont ensuite reacuteuni-e-s les 8 et 9 feacutevrier 2018 agrave Bellinzona afin de discuter alimenter et preacute-ciser les diffeacuterentes deacutefinitions relatives agrave la partici-pation communautaire dans le domaine de la pro-motion de la santeacuteCes journeacutees ont eacuteteacute ouvertes autour de plusieurs constats relateacutes par les participant-e-s sur la base de leurs expeacuteriences
bull Le concept de participation communautaire est difficile agrave deacutefinir dans le contexte suisse car il nrsquoa pas de correspondance en italien et en alle-mand On observe ainsi une diffeacuterence entre le monde francophone et les autres reacutegions lin-guistiques bull Des deacutefinitions proposeacutees par certaines instances de leacutegitimation (notamment lrsquoOMS et celles que lrsquoon retrouve dans la Charte drsquoOttawa) sont rela-tivement dateacutees et ne peuvent que difficilement ecirctre appliqueacutees au contexte actuel bull La pluridisciplinariteacute et lrsquointerdisciplinariteacute fonc-tionnent plutocirct bien par exemple dans les pro - jets qui associent des ingeacutenieurs et des profes-sionnel-le-s de la santeacute Ceci dit il peut parfois srsquoaveacuterer contraignant drsquoinstaurer un dialogue et drsquoidentifier des probleacutematiques communes entre les acteurs et actrices de la promotion de la santeacute puisque ce domaine reacuteunit aussi bien des tenant-e-s du champ de la santeacute que drsquoautres disciplines bull Si les acteurs et actrices actifs et actives laquosur le terrainraquo parviennent relativement bien agrave collabo-rer la coopeacuteration au niveau politique paraicirct plus
difficile et laborieuse (en raison des visions et objectifs politiques qui peuvent ecirctre tregraves diver-gents) En outre les dif feacuterents services ad-ministratifs srsquoaccordent sur la reconnaissance des problegravemes de santeacute publique mais les personnes peuvent avoir une vision diffeacuterente des solutions agrave apporter pour les reacutesoudre bull Se pose eacutegalement la question de la leacutegitimiteacute des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices notamment celle inheacuterente agrave la fonction (p ex lela meacutedecin) Ainsi il convient de toujours mettre en eacutevidence que les apports de chacun sont de mecircme impor-tance bull La question de lrsquoeacutechelle est eacutegalement impor-tante puisque la preacutevention et la promotion de la santeacute deacutependent en premier lieu du canton il nrsquoest pas toujours eacutevident de consideacuterer lrsquoeacutechelon communal bull Quand bien mecircme les diffeacuterents groupes de population doivent ecirctre partie prenante de la promotion de la santeacute il faut toutefois pouvoir srsquoappuyer sur lrsquoexpertise des professionnel-le-s pour les accom pagner et les guider dans cette deacutemarche bull Ensuite et confirmant ce qui est mentionneacute par certain-e-s auteur-e-s la participation en matiegravere de promotion de la santeacute demeure peu mise en application De plus comme il srsquoagit drsquoun pheacuteno-megravene valoriseacute il est souvent observeacute un deacutecalage entre le degreacute de participation annonceacute et ce qui est reacuteellement fait
Des entretiens semi-directifs ont ensuite eacuteteacute conduits avec des porteurs et des porteuses de projets participatifs romands et tessinois Ces huit entrevues ont eu pour objectif de mesurer la perti-nence la clarteacute et la coheacuterence de ce document mais eacutegalement de lrsquoalimenter au regard des expeacute-riences de ces informateurs et informatrices privileacute-gieacute-e-s Le preacutesent guide compile donc les reacutesultats drsquoune recherche qualitative agrave la fois documentaire et par entretiens
2 Meacutethode
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 11
publieacute par lrsquoOMS laquola participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santeacute [hellip] La participation est essentielle pour que les efforts accomplis soient inscrits dans la dureacuteeraquo (OMS 1999 2)Notons eacutegalement que la participation est un pro-cessus mais qursquoelle produit diffeacuterentes retombeacutees importantes qui ne sont pas forceacutement planifieacutees agrave la base Il convient de garder agrave lrsquoesprit que la finaliteacute reste la promotion de la santeacute En ce sens la parti-cipation est avant tout une meacutethode ou une posture professionnelle qui devrait dans lrsquoideacuteal toujours ecirctre envisageacutee Il ne srsquoagit cependant pas drsquoune fin en soi et elle peut le cas eacutecheacuteant ecirctre abandonneacutee Mais si tel est le cas il semble important de justifier les mo-tivations qui ont conduit agrave une telle deacutecision Ensuite la participation doit permettre gracircce agrave un accom-pagnement approprieacute de conscientiser la population par rapport agrave ses besoins Qui plus est elle peut avoir un effet multiplicateur puisqursquoil est probable
que les participant-e-s repro-duisent le processus dans un autre contexte ou pour une autre probleacute-matique Ce pheacutenomegravene geacutenegravere une plus-value non neacutegligeable en matiegravere de santeacute communautaireSi le terme de laquoparticipation com-munautaireraquo a largement preacutevalu
depuis les anneacutees 1960 et qursquoil est mentionneacute dans la Charte drsquoOttawa il nrsquoest plus vraiment drsquoactualiteacute Drsquoailleurs aucun-e des porteurs et porteuses de projet interrogeacute-e-s ne le mobilise Crsquoest pourquoi il est conseilleacute de parler de deacutemarche ou de proces-sus participatif Il en va de mecircme du concept de communauteacute dont la deacutefinition peut porter agrave confu-sion et sous-entendre un sentiment drsquoappartenance que les individus ne partagent pas neacutecessairement Ainsi ces derniers peuvent ecirctre consideacutereacutes par les professionnel-le-s comme faisant partie drsquoune com-munauteacute alors que ce nrsquoest pas le cas De plus et
3 Deacutefinition de la participation
3 Signalons que crsquoest eacutegalement cette seconde acceptation qui est systeacutematiquement privileacutegieacutee par les responsables de projet qui ont eacuteteacute rencontreacutes
laquoSi les repreacutesentants des auto-riteacutes deacutecident de srsquoengager
dans de telles deacutemarches ils doivent accepter de perdre un
peu de leur maicirctriseraquo(Responsable de projet vaudois)
Plusieurs auteur-e-s ndash et plus particuliegraverement Zask (2011) insistent sur les deux notions distinctes aux-quelles renvoie le terme de participation laquofaire partie deraquo ou laquoprendre part agraveraquo Il est ici proposeacute de rendre compte de la synthegravese que lrsquoon retrouve dans la brochure La participation communautaire en matiegravere de santeacute laquolsaquoFaire partie dersaquo indique une conception passive de la participation elle nrsquoim-plique pas forceacutement une activiteacute au sein du groupe auquel on appartient (ville quartier associationhellip) lsaquoPrendre part agraversaquo se reacutefegravere par contre agrave une notion drsquoengagement une conception active au sein du groupe fondeacutee sur lrsquoacte de participation en lui-mecircmeraquo (Bantuelle et al 2000 10) Les auteur-e-s poursuivent en rappelant que dans le cadre de la promotion de la santeacute crsquoest cette derniegravere accep-tion qui preacutevaut car elle privileacutegie le point de vue actif voire interactif3 Lrsquoessentiel est en effet de permettre agrave lrsquoindividu laquodrsquoobtenir un pouvoir de controcircle sur une deacutecision ou sur la production drsquoun service qui le concerneraquo (ibid 10) Lorsque lrsquoon parle de participation il est en suite important de souli-gner que lrsquoon ne peut reacutesoudre les problegravemes drsquoune population sans que cette derniegravere ne soit associeacutee agrave lrsquoanalyse agrave lrsquoexpression et agrave la reacute solution des problegravemes drsquoougrave lrsquoexpression chegravere agrave Freire qui rappelle que lrsquoon doit laquofaire avec eux pas pour euxraquo et privileacutegier ainsi lrsquohorizontaliteacute (ibid) Ces mecircmes auteurs insistent sur lrsquoideacutee de saisir au mieux les repreacutesentations des individus car notent-ils la notion de santeacute laquone sera pas perccedilue de la mecircme maniegravere par les habi-tants drsquoun quartier en crise que par les profession-nels ou par les eacutelus locaux par exemple Le milieu de vie lrsquoeacuteducation la religion et bien drsquoautres eacuteleacute-ments encore faccedilonnent ces repreacutesentations di-versesraquo (ibid 19) En deacutefinitive et comme mention-neacute dans le glossaire de la promotion de la santeacute
12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

12 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
donc srsquoaveacuterer complexe Et ce drsquoautant plus que ces derniers et derniegraveres peuvent ecirctre des personnes davantage favoriseacutees comparativement agrave lrsquoensemble de la communauteacute et qursquoils ou elles ne repreacutesentent de fait pas toujours lrsquoensemble du groupe en termes de position sociale et drsquoaccegraves aux ressources De mecircme les attentes et les deacutecisions des membres du groupe peuvent aller dans un sens opposeacute agrave lrsquoeacutequiteacute et agrave la justice sociale
Dans ce sens la participation peut favoriser lrsquoem-powerment de lrsquoindividu consideacutereacute comme laquole pro-cessus visant lrsquoaugmentation des ressources per-sonnelles drsquoun individu ou drsquoune communauteacute pour qursquoilelle puisse deacutecider en connaissance de cause et faire les choix favorables agrave la santeacuteraquo Cette notion fait elle-mecircme reacutefeacuterence agrave la notion de capacitation et renvoie agrave lrsquoideacutee de laquolrsquooctroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo crsquoest-agrave-dire au laquoprocessus par lequel les individus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacuteraquo (OMS 1999 7)5 Selon les personnes interrogeacutees la participation induit de lrsquoempowerment car les beacuteneacuteficiaires srsquoap-proprient et incarnent le projet et peuvent agrave travers cette expeacuterience acqueacuterir un pouvoir drsquoagir et deacuteve-lopper des compeacutetences (techniques ou sociales)
Inspireacutee de Rifkin et al (1988) la deacutefinition de la participation en matiegravere de promotion de la santeacute retenue ici est la suivante laquoProcessus social ougrave un groupe drsquoindividus va prendre part 1) agrave lrsquoidentification de ses besoins 2) aux processus deacutecisionnels et 3) agrave lrsquoeacutetablissement des meacutecanismes pour
reacutepondre agrave ses besoinsraquo
comme mentionneacute dans le glossaire de lrsquoOMS laquodans de nombreuses socieacuteteacutes en particulier celles des pays deacuteveloppeacutes les individus nrsquoappartiennent pas agrave une communauteacute unique mais sont membres de diverses communauteacutes reposant sur des variables telles que la geacuteographie la profession la place so-ciale et les loisirsraquo (OMS 1999 6) Enfin cer taines personnes ne srsquoinscrivent que temporairement ou partiellement dans une communauteacuteSrsquoil a eacuteteacute deacutecideacute drsquoabandonner la notion de laquocom-munauteacuteraquo et de privileacutegier celle plus neutre de laquogrouperaquo4 il nrsquoen demeure pas moins que certains eacuteleacutements deacutefinitoires relatifs agrave la premiegravere peuvent parfaitement ecirctre retenus Ainsi et afin de circons-crire au mieux le groupe il est tout agrave fait envisageable de srsquoappuyer sur les trois types de communauteacutes que suggegraverent Hyppolite et Parent agrave savoir
bull laquoLes communauteacutes geacuteographiques qui partagent un mecircme territoire consideacutereacute comme un lieu significatif drsquoappartenance sociale (quartier ville reacutegion) bull Les communauteacutes drsquointeacuterecirct qui partagent des problegravemes sociaux communs (les sans-emploi les locataires les assisteacutes sociaux etc) bull Les communauteacutes drsquoidentiteacute et drsquoaffiniteacutes qui partagent une identiteacute acquise ou souhaiteacutee (les jeunes femmes les minoriteacutes culturelles les personnes homosexuelles les utilisateurs de drogues etc)raquo (Hyppolite amp Parent 2017 182-183)
Finalement en termes drsquoenjeux il convient de souli-gner que les groupes ne sont pas homogegravenes et sont constitueacutes de personnes qui ont des valeurs et des points de vue diffeacuterents (Hyppolite amp Parent 2017) Lrsquoidentification des repreacutesentant-e-s du groupe peut
4 Ce choix a eacutegalement eacuteteacute motiveacute suite aux entretiens Agrave titre drsquoexemple une porteuse de projet a deacuteclareacute laquoQuand on parle de communauteacute en franccedilais on parle beaucoup de communauteacutes migrantes Donc pour eacuteviter la confusion on parle de groupe de personnes qui srsquoidentifient par des eacuteleacutements qui leur sont propres qui partagent des inteacuterecircts qui sont inscrits dans un reacuteseau et qui sont en lienraquo
5 La deacutefinition complegravete de laquolrsquooctroi des moyens drsquoagir en matiegravere de santeacuteraquo proposeacutee par lrsquoOMS figure dans le glossaire du preacutesent document
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 13
Les parties prenantes drsquoun processus participatif sont geacuteneacuteralement de trois types les personnes concerneacutees par la probleacutematique (les beacuteneacuteficiaires) les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) et les instances deacutecisionnelles1 Les personnes concerneacutees par la probleacutematique
(ou les leaders communautaires qui beacuteneacuteficient de suffisamment de leacutegitimiteacute pour les repreacute-senter) Ces beacuteneacuteficiaires peuvent constituer un groupe heacuteteacuterogegravene composeacute drsquoindividus qui vivent des situations qui laquodeacutetermineront le caractegravere spontaneacute de la participation ou les attitudes de rejet et de meacutefiance vis-agrave-vis drsquoelleraquo (Bantuelle et al 2000 32) Ce groupe peut ecirctre constitueacute en communauteacute a priori crsquoest-agrave-dire qursquoil peut srsquoagir de personnes qui srsquoorganisent spontaneacutement dans le dessein de deacutefendre un inteacuterecirct commun (par exemple Act Up) Dans ce cas il convient drsquoecirctre conscient que cette com-munauteacute peut avoir des attentes auxquelles il peut ecirctre difficile de reacute-pondre crsquoest pourquoi il est important de re-deacutefinir et de preacuteciser ceux de leurs besoins qui pourront ecirctre pris en consideacuteration La com-munauteacute peut eacutegalement ecirctre initieacutee de lrsquoexteacuterieur crsquoest-agrave-dire a posteriori et en aval de lrsquoidentification du problegraveme qui les reacuteunit et qui a eacuteteacute identifieacute par drsquoautres acteurs et
actrices impliqueacute-e-s dans le processus de parti-cipation Dans ce cas il faut se montrer patient-e jusqursquoagrave ce que le sentiment drsquoappartenance soit partageacute par toutes et tous Il est parfois difficile drsquoidentifier clairement les beacuteneacuteficiaires (par exemple les laquoenfantsraquo) crsquoest pourquoi il peut ecirctre utile selon la teneur et lrsquoobjectif du projet de faire participer des personnes susceptibles de les repreacutesenter (des parents drsquoeacutelegraveves des ensei-gnant-e-s des deacuteleacutegueacute-e-s agrave la jeunesse etc)
2 Les acteurs et actrices de proximiteacute (profession-nel-le-s ou non) est un groupe composeacute par
I Les professionnel-le-s qui gegraverent et coor-donnent le processus (animateurs et ani-matrices co or dinateurs et coordinatrices in-tervenant-e-s) Ilselles ont un rocircle important agrave jouer car ce sont euxelles qui sont char-
geacute-e-s de donner un rocircle drsquoacteur aux personnes concerneacutees par la probleacute-matique et drsquoassurer la dy namique du processus Ilselles doivent donc srsquoim-merger dans la commu-nauteacute ou tout le moins en connaicirctre les valeurs les codes les perceptions les repreacutesentations etc Ces personnes doivent ecirctre au beacuteneacutefice de solides com-
peacutetences en matiegravere de conduite de processus partici patifs
4 Les parties prenantes drsquoun processus participatif
laquoIl faut faire preuve drsquoagiliteacute et de souplesse et ne pas fixer des objectifs trop
stricts Cela permet de srsquoadapter aux besoins des beacuteneacuteficiaires et de se laisser
convaincre par le terrain De mecircme il ne faut pas creacuteer trop drsquoattente et accompa-
gner et valoriser les parties prenantes Drsquoailleurs si les personnes srsquoinvestissent
il faut rapidement leur donner des reacutesultatsraquo
(Responsable de projet jurassien)
14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

14 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
II Les multiplicateurs et multiplicatrices (meacutede-cins enseignant-e-s infirmiersegraveres travail-leurseuses sociauxales animateurstrices de rue beacuteneacutevoles membres drsquoassociation diffeacute-rents groupes de population qui endossent le rocircle de personne-ressource repreacutesentant-e-s drsquoEMS ou de paroisses parents drsquoeacutelegraveves com-merccedilant-e-s policiersegraveres etc) Leurs pra-tiques leurs savoirs techniques et psycho-logiques et les relations qursquoils entretiennent avec les habitant-e-s constituent une source de connaissance importante Par contre ilselles peuvent parfois ecirctre coupeacute-e-s de certaines reacutealiteacutes du terrain et ne pas toujours entretenir des relations entre eux
III Les expert-e-s (eacutevaluateurs et eacutevaluatrices speacutecialistes) De par leur eacuteloignement ilselles sont les garant-e-s de la neutraliteacute et peuvent le cas eacutecheacuteant laquojouer un rocircle de meacute-diation entre les acteurs eacutetant donneacute qursquoils se situent agrave la mecircme distance par rapport agrave cha-cun drsquoentre euxraquo (Bantuelle et al 2000 38-39) Ces expert-e-s peuvent ecirctre des collabora-teurs et collaboratrices drsquouniversiteacutes ou de hautes eacutecoles ou de centres de compeacutetences de promotion de la santeacute
3 Les instances deacutecisionnelles sont repreacutesenteacutees par
I Les repreacutesentant-e-s politiques II Les financeurs (priveacutes ou publics) Il peut
srsquoagir de la Confeacutedeacuteration des cantons des communes de fondations drsquoassociations ou drsquoentreprises priveacutees
III Les services administratifs ou autres
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 15
La participation agrave un projet quel qursquoil soit ne neacuteces-site pas toujours le mecircme investissement des indivi-dus et il existe donc diffeacuterents niveaux de participa-tion Comme le souligne en effet Hyppolite et Parent laquola preacutesence de personnes de groupes ou de repreacute-sentants de communauteacutes nrsquoimplique pas neacutecessai-rement une participation significative Autrement dit on peut ecirctre preacutesent et mecircme participer mais ne rien influencer ou deacuteciderraquo (Hyppolite amp Parent 2017 187) Par ailleurs au niveau de la preacutevention et de la promotion de la santeacute toutes les actions ne neacuteces-sitent pas neacutecessairement une approche participa-tive et tout projet participatif ne doit pas forceacutement tendre vers la co-deacutecision (qui peut ecirctre admis comme un degreacute eacuteleveacute de participation) En effet selon la teneur du programme les ressources hu-maines et financiegraveres agrave disposition etou le profil des participant-e-s il est difficile voire impossible que certain-e-s acteurs et actrices soient intenseacute-
ment associeacute-e-s agrave lrsquoensemble des eacutetapes du pro-cessus et qursquoilselles contribuent agrave toutes les deacuteci-sions inheacuterentes agrave celui -ci Comme le rappelle une des porteuses de projet rencontreacutee laquoIl ne faut pas faire de la participation pour faire de la participation parfois lrsquoinformation est suffisante Selon les be-soins des diffeacuterentes parties pre nantes il faut adap-ter le type de participation attenduraquoCeci dit il est toutefois fondamental de se poser la question de savoir jusqursquoougrave les acteurs et actrices doivent ecirctre impliqueacute-e-s et de les informer tregraves clairement sur les formes drsquoaction auxquelles ilselles peuvent prendre part En srsquoinspirant des eacutechelles proposeacutees par diffeacuterents auteur-e-s (no-tamment lrsquourbaniste Sherry Arnstein voir tableau 3 annexe 2) ou organismes (recomposeit6 lrsquoInsti-tut du Nouveau Monde) la CPPS et Promotion Santeacute Suisse ont deacuteveloppeacute le modegravele suivant (voir ta-bleau 1)
5 Les types drsquoimplication des parties prenantes
6 Recomposeit est un collectif de personnes qui a pour ambition de laquomettre lrsquointelligence au service de la reacuteduction du gaspillage avec les parties prenantes des organisations collectiviteacutes et collectifsraquo (recomposeit 2018 sp) Lrsquoobjectif est de tisser des connexions entre ces diffeacuterents acteurs afin drsquoeacutelaborer ensemble des solutions pour reacuteduire le gaspillage
TABLEAU 1
Description des quatre types de participation des acteurs
Type de participation Description
Information Les participant-e-s sont informeacute-e-s (ou srsquoinforment) au sujet des enjeux lieacutes agrave un problegraveme agrave reacutesoudre ou agrave un projet Il est donc indispensable de leur donner accegraves agrave lrsquoinformation et de leur permettre de poser des questions afin de srsquoassurer que tout le monde partage la mecircme compreacutehension de la probleacutematique
Consultation Les participant-e-s sont inviteacute-e-s agrave donner leur avis pour nourrir le processus par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion des auditions publiques des entretiens de groupes etc En eacutechange lrsquoanimateur et lrsquoanimatrice ou le modeacuterateur et la modeacuteratrice se met en situation drsquoeacutecoute Cette consultation nrsquoassure toutefois pas aux groupes de population concerneacutes que leurs preacuteoccupations et leurs ideacutees seront prises en compte
(Co-)construction Les participant-e-s co-eacutelaborent le plan drsquoaction le projet ou les activiteacutes mais ilselles ne deacutetiennent pas le pouvoir de lrsquoadopter Le plan drsquoaction ainsi eacutelaboreacute pourrait ecirctre par la suite soumis agrave un comiteacute de pilotage qui deacutetient ce pouvoir de deacutecider
(Co-)deacutecision Les participant-e-s travaillent dans une relation drsquoeacutequivalence au pouvoir La gestion se fait par consentement et toutes les eacutetapes du projet sont inscrites dans un processus de co-deacutecision Cette co-deacutecision est surtout possible agrave une eacutechelle reacuteduite (quartier eacutecole etc) Il convient drsquoopeacuterer une distinction entre la deacutecision politique drsquooctroyer un financement un terrain un soutien mateacuteriel ou en ressources humaines et les deacutecisions plus opeacuterationnelles prises par les parties prenantes durant la deacutemarche
16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

16 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Srsquoappuyant sur ce modegravele il est envisageable de faire correspondre le type de participation souhaiteacute etou constateacute pour chacune des parties prenantes ainsi que le moment auquel ces derniegraveres sont inteacute-greacutees au projet
Le projet laquoDiagnostic des quartiersraquo de lrsquoAssociation transports et environnement (ATE)
Cet exemple a pour objectif drsquoillustrer la maniegravere dont il est possible de remplir le tableau relatif aux diffeacuterents types de participationSur demande du service drsquourbanisme de la Ville de Genegraveve et en collaboration avec le Deacutepartement de la santeacute et celui de la mobiliteacute lrsquoantenne ro-mande de lrsquoATE (Association transports et environ-nement) eacutetablit depuis une vingtaine drsquoanneacutees des diagnostics dans les quartiers afin drsquoadapter lrsquoes-pace public aux besoins des seniors qursquoil srsquoagisse du temps qui est deacutefini pour la traverseacutee des rues doteacutees de feux de signalisation de la hauteur des bancs ou des trottoirs de lrsquoemplacement des toi-lettes publiques etc Ces diagnostics srsquoeacutetalent sur environ une anneacutee et sont reacutealiseacutes via des deacute-marches participatives avec les personnes acircgeacutees ce ne sont donc pas les porteurs et porteuses du projet qui deacutefinissent lesdits besoins mais bien les principales et principaux concerneacute-e-s Dans un premier temps une prise de contact est faite avec les uniteacutes drsquoaction communautaire
afin de rencontrer les beacuteneacuteficiaires et les per-sonnes relais (repreacutesentant-e-s des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne) Les besoins sont ensuite identifieacutes sur la base drsquoen-tretiens ndash individuels puis collectifs ndash conduits avec des seniors Dans le dessein de veacuterifier ce qui ressort des entretiens des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes directement sur le terrain avec quelques volontaires Sur cette base lrsquoATE formule des recommandations agrave lrsquointention des services concerneacutes Puisqursquoil srsquoagit drsquoameacutenager lrsquoespace urbain crsquoest donc le service drsquourbanisme qui deacutecide en dernier lieu si des modifications seront ou non apporteacuteesParmi toutes les parties prenantes de ce pro - jet (personnes acircgeacutees repreacutesentant-e-s de lrsquoATE des services sociaux ou drsquoaide agrave la personne expert-e-s services administratifs repreacutesen-tant-e-s politiques) voici comment il est envisa-geable de signifier la participation des princi - paux et principales beacuteneacute ficiaires
TABLEAU 2
Participation des beacuteneacuteficiaires dans le cadre drsquoun projet genevois
Beacuteneacuteficiaires Type de participation Description
Les personnes acircgeacutees vivant dans le quartier et qui souhaitent participer agrave la deacutemarche
Information Degraves le deacutebut du processus toutes les personnes acircgeacutees inteacutegreacutees agrave la deacutemarche (geacuteneacuteralement une quinzaine) sont informeacutees du projet
Consultation 1) Les besoins des personnes acircgeacutees sont identifieacutes par lrsquoATE sur la base drsquoentretiens individuels puis collectifs
2) Des accompagnements itineacuterants sont reacutealiseacutes par lrsquoATE avec quelques repreacutesentant-e-s
(Co-)construction Agrave la suite de la consultation des solutions sont envisageacutees par lrsquoATE avec des repreacutesentant-e-s des beacuteneacuteficiaires
(Co-)deacutecision ndash
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 17
Le projet de skatepark de lrsquoAssociation Skate In Le Locle (SKILL)
Cet exemple a pour objectif de deacutemontrer qursquoil est des situations ougrave la participation peut devenir telle que les beacuteneacuteficiaires co-construisent physiquement une infrastructure qui leur sera destineacuteeEn 2014 une dizaine de jeunes garccedilons loclois adeptes du skateboard de la trottinette et du BMX souhaitent beacuteneacuteficier drsquoun terrain de jeu pour srsquoadonner agrave leurs activiteacutes Ne sachant vers qui se tourner ils srsquoapprochent drsquoun skateur plus acircgeacute qui srsquoavegravere ecirctre chercheur et enseignant dans une haute eacutecole et speacutecialiste de la theacutematique des associations Ce dernier qui a endosseacute un rocircle de facilitateur et de laquolocomotiveraquo durant tout le processus les invite dans un premier temps agrave creacuteer une association (SKILL ndash Skate In Le Locle) et agrave srsquoapprocher des autoriteacutes communales afin drsquoexpo-ser leur projet et de demander un financement Cependant plutocirct que la ville deacutepense une somme consideacuterable pour construire une infrastructure qui ne reacuteponde pas forceacutement aux besoins des futur -e-s usagers et usagegraveres il est deacutecideacute de mettre en place un chantier participatif Lrsquoobjectif de la deacutemarche est simple ce sont les beacuteneacutefi-ciaires eux-mecircmes qui participent agrave lrsquoeacutelaboration du terrain sous la supervision drsquoanimatrices et drsquoanimateurs et de lrsquoaccompagnateur susmen-tionneacute Pour rendre le projet reacutealisable ils de-mandent preacutealablement agrave la commune qursquoelle leur mette un espace agrave disposition qursquoelle leur offre certaines prestations des travaux publics (notam-ment le transport de mateacuteriaux) et qursquoelle leur precircte de lrsquooutillage Sensibles au fait que des jeunes se mobilisent pour obtenir ce qursquoils deacutesirent les repreacutesentant-e-s du Conseil communal deacute-cident immeacutediatement de soutenir le projet Une fois le permis de construire obtenu et les
fonds leveacutes pour lrsquoachat des mateacuteriaux de construc-tion les travaux peuvent deacutemarrer Agrave ce stade la principale difficulteacute reacuteside dans le temps qursquoil faut deacutegager et dans les forces vives qursquoil convient de mobiliser En effet dans la mesure ougrave la par-ticipation deacutecoule drsquoune deacutemarche eacuteminemment volontaire il est exclu drsquoobliger les jeunes agrave ecirctre preacutesents le jour du chantier Ce sont les raisons pour lesquelles le chantier se deacuteroule de maniegravere ponctuelle principalement durant les peacuteriodes de vacances scolairesSrsquoagissant des avantages ils sont de plusieurs ordres Premiegraverement lrsquoutilisation de lrsquoespace est optimale et lrsquoinfrastructure reacutepond agrave des besoins concrets car ce sont les futurs usagers qui par-ticipent directement agrave sa construction Deuxiegraveme-ment les beacuteneacutefices sont particuliegraverement tangibles puisque les beacuteneacuteficiaires peuvent rapi-dement utiliser le lieu Troisiegravemement le projet est eacutevolutif et permet drsquointeacutegrer au fur et agrave mesure de nouveaux et nouvelles participant-e-s Drsquoail-leurs certains nrsquoont pris part qursquoau premier chan-tier et se sont ensuite retireacutes Quatriegravemement les jeunes prennent soin et respectent scrupuleu-sement ce terrain qursquoils ont contribueacute agrave ameacutenager Incidemment ils sensibilisent leurs pairs au travail qursquoils ont fourni Cinquiegravemement ils deacuteve-loppent des compeacutetences aussi bien techniques (fabrication de beacuteton maccedilonnerie etc) que trans-versales (montage drsquoun projet reacutecole de fonds reacutesolution de problegraveme travail en eacutequipe etc) Sixiegravemement des liens se (re)creacuteent entre les jeunes entre ceux-ci et les autoriteacutes communales entre les entreprises qui fournissent des pres-tations et les parties prenantes du projet etc
18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

18 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Un autre scheacutema proposeacute par Santeacute Canada (2000) donne agrave voir graphiquement cinq niveaux de partici-pation Si les termes retenus sont diffeacuterents de ceux eacutevoqueacutes ci-avant cette figure a le meacuterite de preacute-senter les interactions entre les participant-e-s (les
personnes concerneacutees par la probleacutematique sont repreacutesenteacutees par les petites sphegraveres et les acteurs et actrices de proximiteacute et les instances deacutecision-nelles sont repreacutesenteacutes par les grandes sphegraveres)
FIGURE 1
Niveaux de participation communautaire adopteacutes par Santeacute Canada
Source inspireacute de Patterson Kirk Wallace
Faible degreacute de participation du public et drsquoinfluence
Informer et sensibiliser
Communications
Recueillir de lrsquoinformation
Eacutecoute
Degreacute moyen de participation du public et drsquoinfluence
Discuter
Consultation
Engager
Engagement
Degreacute eacuteleveacute de participation du public et drsquoinfluence
Creacuteer des partenariats
Partenariat
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 19
La mise en application drsquoun processus participatif peut prendre plusieurs formes (selon le profil des diffeacuterentes parties prenantes lrsquoobjet le contexte geacuteographique et socioculturel etc) mais il est important de respecter certaines eacutetapes Inspireacutees de documents reacutedigeacutes par le Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) et drsquoHyppolite et Parent (2017) ainsi que des entretiens semi-directifs voici celles qui sont ici recommandeacutees
1 Eacutetapes de preacuteparationa) Identifier le problegraveme que ce soit par les per-
sonnes concerneacutees par la probleacutematique les ac-teurs et actrices de proximiteacute ou les instances deacutecisionnelles
b) Identifier des partenaires volontaires et moti-veacute-e-s et deacutefinir le groupe de personnes concer-neacutees que celui-ci preacuteexiste agrave la deacutemarche ou qursquoelle se construise dans le cadre de cette der-niegravere Parmi ces partenaires identifier ceux et celles qui seront fondamentaux et sans lesquels le projet ne pourrait avoir lieu
c) Reacuteunir les participant-e-s et preacuteciser le peacuteri-megravetre du projet les rocircles et les responsabiliteacutes de chacun-e ainsi que les contraintes et les limites du processus participatif
d) Saisir les repreacutesentations des participant-e-s afin que tous parlent de la mecircme chose et que les perceptions soient partageacutees En ce sens adop-ter une approche participative axeacutee sur lrsquoem-powerment en mobilisant les acteurs et les ac-
trices concerneacute-e-s et en recherchant leurs points de vue sur la probleacutematique gracircce agrave des
meacutecanismes assurant des es-paces drsquoeacutechanges de discus-sions et de neacutegociations afin que tous les acteurs et actrices puissent srsquoentendre sur les deacute-marches agrave venir et puissent in-fluencer les deacutecisions qui les concernent Crsquoest eacutegalement agrave ce moment qursquoil faut identifier et mobiliser les leaders for - mel -le-s et informel-le-s Ces
derniers et derniegraveres devront faci liter la mobili-sation de lrsquoeacutequipe de projet et des partenaires Ilselles doivent avoir des compeacutetences tech-niques communicationnelles et humaines parti-culiegraveres et ecirctre inteacuteresseacute-e-s et convaincu-e-s par le projet
e) Approfondir les besoins les souhaits ou les pro-blegravemes releveacutes par les participant-e-s et veacuterifier comment la situation est perccedilue par les autres membres de la communauteacute
f) Utiliser des approches quantitatives et qualita-tives pour dresser un portrait drsquoune probleacutema-tique ou du groupe concerneacute agrave partir de donneacutees eacutepideacutemiologiques et statistiques et agrave partir des per ceptions et des repreacutesentations des personnes concerneacutees Il srsquoagit donc drsquoallier les savoirs scien-tifiques pratiques et expeacuterientiels pour disposer drsquoun portrait global
g) Identifier les reacutepercussions du partenariat et les questions juridiques possibles
h) Deacuteterminer les ressources neacutecessaires et la fa-ccedilon de les obtenir
6 Les eacutetapes drsquoun processus participatif
laquoUn coordinateur est indispensable dans une deacutemarche participative
Cette personne doit faire preuve de certaines compeacutetences pour acceacute-der agrave des services administratifs pour ecirctre prise au seacuterieux par les
eacutelus locaux pour reacutediger un dossier et trouver des argumentsraquo
(Responsable de projet neuchacirctelois)
20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

20 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
2 Eacutetapes de reacutealisationa) Planifier les actions et les strateacutegies Lors de
cette eacutetape il est neacutecessaire de deacuteterminer les objectifs viseacutes et de choisir les actions les plus adapteacutees Et ce en fonction des eacuteleacutements sui-vants de la volonteacute et de la capaciteacute drsquoengage-ment du groupe des reacutesultats anticipeacutes des ac-tions des appuis actuels au sein du groupe de la disponibiliteacute des ressources financiegraveres du temps requis pour mener les actions du contexte social politique et eacuteconomique
b) Deacuteterminer qui fera quoi (rocircles et responsabi-liteacutes) en gardant agrave lrsquoesprit que la reacuteussite et la peacuterenniteacute drsquoune deacutemarche participative pour - ront ecirctre assureacutees par un accompagnement des eacutequipes agrave diffeacuterents niveaux (sensibilisation reacuteu-nions de suivi et visites de supervision)
c) Donner les moyens aux participant-e-s afin qursquoilselles puissent laquoprendre part agraveraquo (plutocirct qursquoilselles fassent simplement laquopartie deraquo)
d) Mettre en œuvre des actions collectives afin de reacutealiser les objectifs preacuteceacutedemment deacutefinis
3 Eacutetapes de suivi et drsquoeacutevaluationa) Assurer le suivi et eacutevaluer le processus et les ac-
tiviteacutes du partenariat En drsquoautres termes il faut eacutevaluer le chemin parcouru et les changements produits depuis le deacutebut de lrsquointervention Cela implique drsquoadopter un regard critique sur le pro-cessus meneacute sur les forces et les faiblesses des interventions et sur les eacuteventuels changements agrave apporter Il est important de deacutefinir des indica-teurs drsquoeacutevaluation au deacutebut de la deacutemarche dans le but de pouvoir mesurer les impacts du projet et de disposer de paramegravetres valideacutes qui lui donnent de la valeur et qui permettent donc une reproduc-tion de la deacutemarche dans drsquoautres contextes
b) Deacuteterminer les prochaines eacutetapes (orientations futures)
c) Deacuteterminer comment srsquoadapter et poursuivre ou mettre un terme au partenariat (reacutevision renou-vellement et clocircture)
d) Preacuteparer la fin du mandat crsquoest-agrave-dire plani - fier lrsquoautonomisation des beacuteneacuteficiaires et le cas eacutecheacuteant redeacutefinir les rocircles ou planifier la mobili-sation de nouveaux acteurs et nouvelles actrices
Degraves le deacutepart et durant tout le processus il est indispensable de tenir compte des valeurs drsquoeffi-caciteacute drsquoefficience et drsquoeacutequiteacute (qui doit ecirctre une valeur transversale afin drsquoeacuteviter toute forme de discrimination) De mecircme il est fondamental drsquoinsister sur la communication et la mobilisa-tion sociale Ce nrsquoest en effet que gracircce agrave une bonne communication qursquoune prise de conscience des problegravemes et des solutions pourra ecirctre envi-sageacutee par les beacuteneacuteficiaires et les partenaires que des fonds pourront ecirctre mobiliseacutes et que drsquoautres groupes pourront beacuteneacuteficier des expeacuteriences acquises
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 21
Le projet laquoQuartiers Solidairesraquo de Pro Senectute
Cet exemple a pour objectif de preacutesenter une maniegravere singuliegravere drsquoarticuler les diffeacuterentes eacutetapes qui ponctuent un projet participatif inteacutegrant des seniorsIl y a plus de 15 ans Pro Senectute Vaud a deacutecideacute de deacutevelopper un programme devant permettre de renforcer lrsquointeacutegration des personnes acircgeacutees Pour ce faire lrsquoorganisation a mis en place un pro-cessus participatif dans le dessein drsquoeacutevaluer les besoins de ces derniegraveres et de leur permettre de formuler des solutions Le projet repose sur une meacutethodologie respectant les eacutetapes suivantes0 Analyse preacuteliminaire Prise de contact avec les
organisations professionnelles et associatives actives dans la commune afin de sonder les col-laborations possibles et lister les prestations existantes Agrave ce stade un premier sondage est eacutegalement reacutealiseacute aupregraves de quelques seniors afin drsquoeacutevaluer lrsquointeacuterecirct pour un tel projet
1 Diagnostic Une fois que le lancement est deacuteci-deacute un diagnostic est reacutealiseacute sur une peacuteriode drsquoune anneacutee afin de dresser un eacutetat des lieux de la qualiteacute de vie des aicircneacute-e-s dans le quar - tier la ville ou le village concerneacute Les premiers mois les animateurs et animatrices srsquoimmer-gent dans la commune et tissent des liens avec les habitant-e-s Ensuite la commune envoie aux seniors une invitation personnaliseacutee agrave parti-ciper agrave une seacuteance drsquoinformation Au cours de cette derniegravere les repreacutesentant-e-s les plus engageacute-e-s peuvent participer au groupe- habitant-e-s qui a pour mission de reacutediger le questionnaire drsquoenquecircte de conduire les inter-views avec les autres seniors et drsquoorganiser le forum au cours duquel les reacutesultats sont res-titueacutes et discuteacutes Sur la base de lrsquoensemble des informations collecteacutees un rapport est reacutedi-geacute et soumis agrave la commune Crsquoest eacutegalement sur cette base que les seniors sont inviteacute-e-s dans le cadre de groupes de travail agrave reacutefleacutechir agrave des solutions reacutepondant aux besoins identifieacutes
2 Phase de construction Durant la deuxiegraveme anneacutee du projet les solutions et les activiteacutes sont mises en œuvre Par exemple la pro-bleacutematique de la solitude ndash en particulier le
dimanche ndash ayant eacuteteacute mentionneacutee dans une commune le groupe-habitant-e-s a proposeacute la creacuteation drsquoun cafeacute -rencontre le dimanche apregraves-midi
3 Phase drsquoeacutemergence Durant la 3e anneacutee les activiteacutes deacutemarrent concregravetement le projet est alors clairement deacuteployeacute les activiteacutes de-viennent reacuteguliegraveres
4 Phase de reacutealisation Durant la 4e anneacutee les porteurs et porteuses et les beacuteneacuteficiaires se concentrent sur le renforcement de ce qui a eacuteteacute mis en place Agrave ce stade le projet fonc-tionne et le groupe est organiseacute
5 Phase drsquoautonomisation Le projet arrive agrave terme lrsquoanimateur ou lrsquoanimatrice responsable du projet se retire progressivement et une structure (geacuteneacuteralement associative) est consti-tueacutee pour permettre aux seniors de reprendre agrave leur compte lrsquoorganisation des activiteacutes Une ceacutereacutemonie officielle de passation est orga-niseacutee avec les autoriteacutes communales pour marquer symboliquement lrsquoautonomi sation du projet
6 Suivi du projet Depuis 2016 le canton subven-tionne un poste pour assurer un accompa-gnement des projets autonomes Pro Senectute demeure donc une ressource agrave laquelle les beacuteneacuteficiaires peuvent se reacutefeacuterer srsquoilselles ren-contrent des difficulteacutes speacutecialement dans le fonctionnement de lrsquoassociation (reacutepartition des rocircles finances relations avec les autres organismes preacutesents dans la commune etc) Par contre lrsquoanimation des activiteacutes est en - tiegrave rement assureacutee par les seniors
7 Eacutevaluation des impacts du projet via une seacuterie drsquoindicateurs Tout au long du projet des objec-tifs standards conformeacutement agrave la meacutethodolo-gie et speacutecifiques en fonction des speacutecificiteacutes du lieu et des personnes participantes sont deacutetermineacutes Des indicateurs de performance permettent de mesurer lrsquoavancement du projet (outputs) et dans la mesure du possible ses effets sur le public cible (outcomes) et sur le tissu social en geacuteneacuteral (impact)
22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

22 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Il est aussi important de signaler que la participa - tion peut srsquoaveacuterer inapproprieacutee et ne pas directement reacutepondre aux besoins du groupe En effet comme lrsquoeacutecrivent Fournier et Potvin laquoune autre dimension de nature plus instrumentale preacutevaut chez bon nombre de promoteurs de la participation commu-nautaire et se retrouve dans plusieurs modegraveles agrave savoir le souci de voir les interventions ou les pro-grammes recueillir lrsquoadheacutesion de la population pour que le nombre drsquoutilisateurs soit maximal et que lrsquointervention soit jugeacutee lsaquocoucirct-efficacersaquoraquo (Fournier amp Potvin 1995 48) Agrave cela viennent srsquoajouter drsquoautres difficulteacutes qui peuvent concregravetement entraver les processus par-ticipatifs Les propos de Mouterde et al (2011) ainsi que les entretiens reacutealiseacutes permettent de mettre en eacutevidence les obstacles suivants 1) Des deacutelais significatifs sont souvent neacutecessaires
pour arriver agrave lrsquoautonomisation du groupe la san-teacute communautaire ne peut se penser sur des deacute-lais courts crsquoest pourquoi ses effets doivent ecirctre appreacutehendeacutes sur le long terme Or il peut ecirctre difficile de susciter de maniegravere durable un enga-gement des participant-e-s et un soutien de la part des instances deacutecisionnelles Crsquoest pourquoi il faut soumettre des projets tregraves preacutecis fournir une laquoboicircte agrave outilsraquo adeacutequate ecirctre attentifs aux besoins des personnes et les accompagner dans le processus
2) La deacutemarche participative peut repreacutesenter un coucirct financier que certaines instances administra-tives ou certaines institutions ne peuvent assumer
3) Le peacuterimegravetre drsquoefficaciteacute drsquoactions de santeacute com-munautaire est limiteacute par la dimension et la taille du groupe Ce peacuterimegravetre qui doit ecirctre clairement deacutefini degraves le deacutepart est drsquoailleurs bien souvent local et paraicirct peu transposable agrave des champs plus larges de niveau communal ou cantonal a fortiori national Ceci dit bien que les reacutesultats drsquoune participation en matiegravere de promotion de la santeacute reacutealiseacutee dans un contexte particulier soient peu transposables il nrsquoen demeure pas moins que la meacutethodologie peut ecirctre appliqueacutee agrave drsquoautres eacutechelles geacuteographiques et dans drsquoautres contextes
4) Les eacuteventuelles dissonances entre inteacuterecircts indi-viduels et collectifs les premiers primant sou-vent sur les seconds La motivation sera plus durable pour les besoins continus et communs agrave tous et agrave toutes (eacutecole materniteacute deuils creacutedits etc) que pour les besoins plus occasionnels (transport des urgences soins aux malades etc)
5) Les actions de santeacute communautaire remettent en cause les postures traditionnelles le statut drsquoexpert-e doit srsquoeffacer au profit drsquoune posture de coproducteur ou coproductrice de savoirs et lrsquoeacutelu-e peut se sentir deacuteposseacutedeacute-e de sa capaciteacute agrave deacutecider au nom de la communauteacute Il faut donc parfois convaincre drsquoentrer dans une deacutemarche qui peut srsquoaveacuterer inhabituelle
6) Il peut ecirctre difficile de faire collaborer des per-sonnes qui ont des valeurs des histoires ou qui viennent de milieux socioculturels diffeacuterents Ain-si constituer un groupe autonome et dynamique nrsquoest pas toujours eacutevident Crsquoest agrave lrsquoanimateurtrice de sensibiliser les participant-e-s au fait que les meacutecanismes drsquoexclusion sont totalement bannis
7) Certaines populations vulneacuterables peuvent de-meurer invisibles drsquoautant plus que le laquochoix eacuteclaireacuteraquo deacutemocratique peut preacutesenter des limites et empecirccher lrsquoaccegraves agrave lrsquoinformation et agrave la connais-sance La faible capaciteacute participative des popula-tions vulneacuterables peut accentuer leur exclusion des deacutecisions Crsquoest pourquoi il est important de les inciter agrave prendre la parole en leur offrant un soutien De mecircme certaines personnes ndash notam-ment celles agrave mobiliteacute reacuteduite ndash peinent agrave se deacutepla-cer et ne peuvent de fait pas prendre part au projet
8) Certain-e-s porteurs et porteuses de projet peuvent deacutemontrer une volonteacute de mettre en place des deacutemarches participatives mais se sentir deacute-muni-e-s pour les conduire de maniegravere optimale Crsquoest pourquoi il est important drsquoinclure des ac-teurs et actrices qui sont agrave lrsquoaise avec les meacutethodes et les outils neacutecessaires agrave lrsquoapplication de tels pro-cessus Drsquoailleurs il est tregraves important qursquoune per-sonne soit engageacutee au moins partiellement sur le projet afin drsquoen assurer la coordination et ce jusqursquoau processus drsquoautonomisation Ideacutealement cette personne doit pouvoir ecirctre reacutemuneacutereacutee
7 Les eacutecueils les difficulteacutes et les conditions de possibiliteacute
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 23
8 Liste des questions agrave se poser avant drsquoentamer une deacutemarche participative
Questions
1) Que recherche-t-on avec la mise en place drsquoun processus participatif Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisageacute
a Une deacutemarche participative est-elle reacuteellement pertinente b Srsquoagit-il drsquoune demande des financeurs et financeuses de laquofaire de la participationraquo c Srsquoagit-il drsquoune recherche drsquoameacutelioration de la qualiteacute de vie de la population
2) Quel est lrsquoobjet de la participation
3) Srsquoagit-il drsquoune deacutemarche eacutepheacutemegravere ou peacuterenne
4) Dans quelle mesure la deacutemarche peut-elle ecirctre reproductible dans drsquoautres contextes
5) Quels moyens financiers et humains faut-il allouer
6) Qui peut srsquoengager dans le processus participatif Et comment a Quels sont les acteurs et actrices important-e-s b Comment les participant-e-s arrivent-ilselles dans le processus c Quel reacuteseau de partenariat institutionnel peut ecirctre mobiliseacute d Comment faire participer les populations vulneacuterables
7) Qui deacutefinit et circonscrit le groupe de participant-e-s a Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir agrave ce groupe
8) Quel est le degreacute de participation des beacuteneacuteficiaires (information consultation co-construction ou co-deacutecision) attendu par le canton ou la commune
9) Quel est le rocircle des diffeacuterent-e-s acteurs et actrices impliqueacute-e-s
10) La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les inteacuterecircts et points de vue importants sont exprimeacutes Les personnes repreacutesentant le groupe cible sont-elles vraiment repreacutesentatives
LISTE DES QUESTIONS Agrave SE POSER AVANT DrsquoENTAMER UNE DEacuteMARCHE PARTICIPATIVE
Avant drsquoinitier une deacutemarche participative il est re-commandeacute de se poser une seacuterie de questions Voici quelques propositions7
7 Ces questions ont eacuteteacute formuleacutees en srsquoinspirant de Giorgis (2016) et du guide eacutediteacute par le Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses ndash CEP (2016)
24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

24 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Bantuelle M Dargent D amp Morel J (2000) La participation communautaire en matiegravere de santeacute Bruxelles Santeacute Communauteacute Participation
CEP (2016) Participation Guide de planification des processus participatifs dans lrsquoameacutenagement et lrsquoutilisation de lrsquoespace public BacircleZurich CEP ndash Centre de lrsquoespace public de lrsquoUnion des villes suisses
Deschamps J-P (2003) laquoUne lsaquorelecturersaquo de la Charte drsquoOttawaraquo Santeacute Publique 3 (Vol 15) pp 313-325 httpszora-cepchcmsfileszora_broschuere_partizipation_frpdf
Fournier P amp Potvin L (1995) laquoParticipation communautaire et programmes de santeacute les fondements du dogmeraquo Sciences sociales et santeacute no 2 (Vol 13) pp 39-59
Giorgis S (2016) laquoDu passeacute faisons table ronderaquo Revue Urbanisme no 55 (hors-seacuterie) pp 34-35Hyppolite S R amp Parent A-A (2017) laquoChapitre 7 Strateacutegies drsquoaction communautaireraquo in E Breton
F Jabot J Pommier amp W Sherlaw La promotion de la santeacute Comprendre pour agir dans le monde francophone Rennes Presses de lrsquoEHESP pp 177-208
Lamoureux H Mayer J amp Panet-Raymond J (2002) La pratique de lrsquoaction communautaire Queacutebec Presses de lrsquoUniversiteacute du Queacutebec
Lannes L amp Sanni Yaya H (2012) laquoConclusionraquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retom-beacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 83-87
Lorenzo P (2012) laquoPenser et agir localement dans une perspective globale ou de la promotion de la santeacute et des chemins qui y megravenent lrsquoexemple drsquoEacutecole 21raquo in L Lannes (sous la dir de) 25 ans drsquohistoire les retombeacutees de la Charte drsquoOttawa pour la promotion de la santeacute dans divers pays francophones Montreacuteal Eacuteditions du REFIPS pp 61-67
Ministegravere de la santeacute du Royaume du Maroc (2013) Guide sur la participation communautaire en santeacuteMouterde F Proult E amp Massot C (2011) Pour un deacutebat citoyen sur la santeacute plus actif Eacutetude sur les modes
de participation des usagers citoyens agrave la prise de deacutecision en santeacute Paris Planegravete PubliqueOrganisation mondiale de la santeacute (1986) Charte drsquoOttawa Ottawa OMSOrganisation mondiale de la santeacute (1999) Glossaire de la promotion de la santeacute Genegraveve OMSPromotion Santeacute Suisse (2016) Santeacute et qualiteacute de vie des personnes acircgeacutees Bases pour les programmes
drsquoaction cantonaux Berne Promotion Santeacute SuisseReCompose (2015) Ougrave se trouve le pouvoir dans un processus participatif in httpwwwrecomposeit2015
0211pouvoir-processus-participatifRifkin S B Muller F amp Bichmann W (1988) laquoPrimary health care on measuring participationraquo Social
Science and Medicine 26(9) 931-940Santeacute Canada (2000) Politiques et boicircte agrave outils concernant la participation du public agrave la prise de decisions
in httpswwwcanadacafrsante-canadaorganisationa-propos-sante-canadarapports-publica-tionspolitiques-boite-outils-concernant-participation-public-prise-decisionshtml
Zask J (2011) Participer Essai sur les formes deacutemocratiques de la participation Lormont Eacuteditions Le Bord de lrsquoEau
9 Bibliographie
La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

La participation en matiegravere de promotion de la santeacute 25
Action communautaire
Lrsquoaction communautaire pour la santeacute deacutesigne les laquoefforts collectifs deacuteployeacutes par les communauteacutes en vue drsquoaccroicirctre leur maicirctrise des deacuteterminants de la santeacute et drsquoameacuteliorer ainsi cette derniegravereraquo (OMS 1999 6) Compilant cette deacutefinition et celle plus orienteacutee vers le domaine du travail social de Lamoureux
et al (2002)8 Hyppolite et Parent proposent la deacutefi-nition suivante laquoLrsquoaction communautaire en promo-tion de la santeacute deacutesigne toute initiative de personnes drsquoorganismes communautaires de communauteacutes (territoriale drsquointeacuterecircts drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin commun contribuant agrave exer-cer un plus grand controcircle sur les deacuteterminants de la santeacute agrave ameacuteliorer leur santeacute et agrave reacuteduire les ineacute-galiteacutes sociales de santeacuteraquo (Hyppolite amp Parent 2017 180)
Approche communautaire
Inspireacutee drsquoune deacutefinition proposeacutee par le ministegravere autrichien de lrsquoenvironnement9 Promotion Santeacute Suisse deacutetermine lrsquoapproche communautaire en ces termes laquoLrsquoapproche communautaire est un principe de travail participatif qui via la collaboration de la population et la prise en consideacuteration cibleacutee drsquoinsti-tutions drsquoorganisations et drsquoautres acteurs contribue agrave ameacuteliorer les conditions de vie de personnes ainsi que la coheacutesion sociale et lrsquoassurance de prestations sociales Dans ce contexte les activiteacutes communau-taires srsquoorientent vers les besoins et les inteacuterecircts de cercles de personnes speacutecifiques et souvent sociale-ment deacutefavoriseacutes Elles les soutiennent et les aident agrave reacutesoudre leurs problegravemes de faccedilon autonome via la prise en consideacuteration drsquoautres acteurs et ainsi agrave ameacuteliorer leur position au sein de la socieacuteteacute (rarr em-powerment ou autonomisation)raquo (Promotion Santeacute Suisse 2016 119)
Annexe 1 Glossaire
Octroi de moyens drsquoagir en matiegravere de santeacute (Empowerment for health)
Dans le domaine de la promotion de la santeacute lrsquooctroi de moyens drsquoagir est un processus par lequel les in-dividus maicirctrisent mieux les deacutecisions et les actions qui influent sur leur santeacutelaquoLrsquooctroi de moyens drsquoagir peut ecirctre un processus social culturel psychologique ou politique qui per-met aux individus et aux groupes sociaux drsquoexprimer leurs besoins drsquoindiquer leurs preacuteoccupations de concevoir des strateacutegies en vue drsquoune participation agrave la prise de deacutecision et de mener une action poli-tique sociale et culturelle en vue de satisfaire ces besoins Gracircce agrave ce processus les individus constatent une meilleure correspondance entre leurs buts dans la vie et une ideacutee de la faccedilon de les atteindre ainsi qursquoun lien entre leurs efforts et les reacutesultats obtenus dans lrsquoexistence La promotion de la santeacute comprend des actions visant non seulement agrave renforcer les aptitudes fondamentales utiles dans la vie et les capaciteacutes des individus mais eacutegalement agrave influencer les conditions sociales et eacuteconomiques de base et les environnements physiques qui ont des effets sur la santeacute Dans ce sens la promotion de la santeacute vise agrave creacuteer des conditions plus favorables agrave lrsquoexistence drsquoune relation entre les efforts des indi-vidus et des groupes et les reacutesultats ulteacuterieurs en matiegravere de santeacute de la faccedilon deacutecrite plus haut On eacutetablit une distinction entre lrsquooctroi de moyens drsquoagir agrave un individu et agrave une communauteacute En ce qui concerne lrsquoindividu les moyens drsquoagir deacutesignent avant tout lrsquoaptitude agrave prendre des deacutecisions sur sa vie personnelle et agrave maicirctriser celle-ci Une commu-nauteacute dispose de moyens drsquoagir lorsque les individus agissent collectivement pour obtenir une plus grande influence et une maicirctrise accrue sur les deacute-terminants de la santeacute et la qualiteacute de la vie dans leur communauteacute lrsquoobtention de moyens drsquoagir par une communauteacute est un important but de lrsquoaction communautaire pour la santeacuteraquo (OMS 1999 7)
8 laquoToute initiative issue de personnes de groupes communautaires drsquoune communauteacute (geacuteographique drsquointeacuterecirct drsquoidentiteacute) visant agrave apporter une solution collective et solidaire agrave un problegraveme social ou agrave un besoin communraquo (Lamoureux et al 2002 4)
9 Agrave consulter sur le site httpwwwpartizipationatgemeinwesenarbeithtml
26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

26 La participation en matiegravere de promotion de la santeacute
Annexe 2 Eacutechelle de participation citoyenne drsquoArnstein
TABLEAU 3
Type de participation Action Deacutefinition
Pouvoir effectif Le controcircle citoyen Agrave ce niveau les citoyens ont le pouvoir de deacutecider ils acquiegraverent le controcircle complet et sont capables de neacutegocier les conditions sous lesquelles les personnes contestataires pourraient influencer les deacutecisions Ils sont complegravetement autonomes
La deacuteleacutegation de pouvoir Par deacuteleacutegation des autoriteacutes les citoyens acquiegraverent une autoriteacute dominante sur les deacutecisions
Le partenariat La prise de deacutecision se fait agrave partir de processus de neacutegociation entre les citoyens et les deacutetenteurs du pouvoir Les parties deviennent responsables des deacutecisions agrave travers des structures regroupant les parties
Coopeacuteration symbolique La nomination Agrave ce niveau les citoyens commencent agrave exercer une certaine influence Ils sont autoriseacutes et inviteacutes agrave donner des conseils et agrave faire des propositions tout en laissant ceux qui ont le pouvoir les seuls juges de la leacutegitimiteacute et de la faisabiliteacute des conseils formuleacutes
La consultation Agrave ce niveau les citoyens sont consulteacutes par exemple agrave travers des enquecirctes drsquoopinion ou des auditions publiques Toutefois la consultation nrsquoassure pas aux citoyens que leurs preacuteoccupa-tions et leurs ideacutees seront prises en compte
Lrsquoinformation Agrave ce niveau les citoyens reccediloivent des informations justes sans qursquoils puissent donner leur avis On privileacutegie ici une information agrave sens unique des autoriteacutes vers les citoyens sans retour pos-sible ni pouvoir de neacutegociation
Non participation La manipulation Lrsquoobjectif viseacute est de manipuler les citoyens pour obtenir leur appui Il srsquoagit drsquoune participation qui vise agrave obtenir le soutien du public au profit de ceux qui deacutetiennent le pouvoir
Source Arnstein reproduit par Hyppolite amp Parent 2017 188
Eacutechelle de participation citoyenne
010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech

010
281
FR 0
420
19
Wankdorfallee 5 CH-3014 BerneTeacutel +41 31 350 04 04officebernpromotionsantech
Avenue de la Gare 52 CH-1003 LausanneTeacutel +41 21 345 15 15officelausannepromotionsantech
wwwgesundheitsfoerderungchwwwpromotionsantechwwwpromozionesalutech