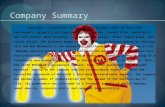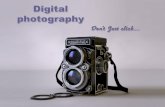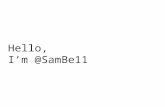Conscienceetineffable
Click here to load reader
-
Upload
clement-philippe-olivier -
Category
Business
-
view
333 -
download
0
Transcript of Conscienceetineffable

1
L'INEFFABLE ET LA CONSCIENCE:
SUR LA MUSICALITE DE LA PAROLE ET DU GESTE.
Jean Vion-Dury
Unité de Neurophysiologie et Psychophysiologie, Pôle de Psychiatrie Universitaire, Hôpital
Ste Marguerite (CHU), 13009 Marseille.
Institut des Neurosciences Cognitives de la Méditerranée (UMR-CNRS 6193)
Chercheur associé au Centre de Recherches en Epistémologie Appliquée (CREA CNRS 7656)
Ecole Polytechnique, Paris.

2
Résumé.
Pour des raisons d’ordre philosophique, la linguistique s’est tournée vers une analyse structurale et logico-
symbolique du langage. Cette approche a favorisé une conception de la pensée basée sur des processus de
représentation et de computation. Cependant la mimogestualité ainsi que les phénomènes prosodiques font
intervenir d’autres modes d’interactions entre des interlocuteurs. Cet article analyse les liens entre d’une part la
prosodie et la mimogestualité relative au discours en acte et d’autre part la notion centrale de geste dans la
musique. Il met l’accent sur la notion « d’affects de vitalité » et sur l’importance probablement déterminante de
la conscience pré-réflexive dans ce qui, dans le langage, est ineffable.
Summary :
Due to philosophical reasons, linguistics has developed a structural , logical and symbolic approach of language.
This choice has facilitated a conception of mind based on both representation and computation processes.
However, gestures, face and body motions and prosody associated to speech involve other interaction modes
between interlocutors. This paper analyses the link between both prosody, face and body motions and gestures
in speech and, in other hand, the musical gesture which appears to be central in music. This paper emphasises the
notion of “vitality dynamics” and pinpoints the critical importance of pre-reflexive consciousness in the
ineffable which is present in speech.

3
I) Une introduction philosophiqueAborder le problème conjoint de l’ineffable et de la conscience à propos de la musicalité de la
parole et du geste, c’est s’aventurer sur des chemins mal balisés, à la périphérie de ce que
Thomas Kuhn (1983) appelle la science normale. Or la science normale fonde le plus souvent
ses hypothèses et ses expérimentations sur l’amoncellement de résultats préalablement
obtenus et insérés dans un paradigme donné, sans que celui-ci ne soit questionné quant à son
fondement philosophique.
Prendre les chemins de traverse, explorer la jonction de champs disciplinaires variés ne
semble pouvoir se faire sans remonter à la source de la science standard, et sans en réaliser
une épistémologie critique. En d’autres termes, explorer des champs disciplinaires limites ne
peut se construire que sur une réflexion philosophique (et non plus sur des amoncellements de
données empiriques) qui prend du recul par rapport aux fondements philosophiques implicites
ou explicites de la science normale. C’est pourquoi nous commencerons cet article par cette
introduction philosophique.
A) le regard égaré .Selon Jean François Mattéi (2007), l’Occident, dans sa recherche d’une explication du monde,
a posé sur celui-ci un regard réflexif. Cette attitude exceptionnelle dans le monde de
l’Antiquité, associée aux spécificités de cette autre culture du pourtour méditerranéen qu’est
le judéo-christianisme (Athènes, Rome et Jérusalem, donc) a conduit l’Europe à développer
un mode de pensée au centre du duquel se trouve la raison, c’est à dire le rapport (ratio)
mathématique et logique entre les choses. Pour cet auteur, la culture européenne s’est
construite à partir de trois commandements : « la persistance d’un regard dirigé vers le
lointain, le culte de l’abstraction issu de la visée théorique de l’âme et l’éloge de l’infini porté
par une attente messianique » (p.31). Dans cette Europe1, dont l’étymologie grecque elle-
même a à voir avec l’œil et le regard (opsis), la téoria, contemplation des spectacles du
monde fondatrice de cette civilisation conduira à une position particulière qui cherche l’idée
transcendante de tout objet, dans un regard d’emblée universel et abstrait portant sur le
monde, sur la cité et sur l’âme elle même. Or ce regard critique et distancié, formidable
moyen de connaissance de monde parce que donnant le goût du dépassement vers un autre
que soi, s’est selon Jean François Mattéi progressivement dévoyé, en perdant notamment la
capacité d’assumer ses racines grecques et chrétiennes.
1 fille de Phoenix enlevée par Zeus

4
La critique de Jean-François Mattéi quant à ce qui s’est perdu, au fur et à mesure de
l’évolution de la civilisation occidentale initialement construite sur cet l’élan original de la
pensée grecque enrichie par le judéo-christianisme, trouve un écho saisissant dans la réflexion
d’Olivier Rey (2003). Celui-ci remarque que l’élan rationnel à la base de la mathématisation
du monde initiée dès les pythagoriciens (« les choses sont des nombres », Jean-François
Mattéi, 1993, p.57), et qui s’est orienté avec Platon vers la recherche du Bon, du Beau et du
Vrai grâce aux mathemata (« ce que nous portons en nous même des choses », Olivier Rey,
p.67), s’est égaré en perdant le sens même de sa démarche.
Pourquoi un tel égarement ? Sur cette fascination pour la mathématique et le calcul qu’avait le
monde antique, Galilée fonda toute analyse du monde : « [l’Univers] est écrit dans la langue
mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures
géométriques» (cité par François. Lurçat, 1995, p.23). Héritage à la fois pythagoricien et
platonicien, le projet galiléen de mathématisation du monde, associé à la tradition du regard
réflexif et distancié, allait constituer ainsi le socle, à partir du XVIIème siècle, du
développement formidable de la science contemporaine. Or, la mathématisation du monde
s’est rapidement adossée à une évolution technique conjointe aux différentes découvertes de
la physique, une technique dont le développement semble incoercible et dont les succès
amènent se demander à quel point elle n’orienterait pas de manière quasi systématique la
démarche de connaissance.
La philosophie mécaniste fondée par René Descartes n’est sans doute pas étrangère à cette
emprise de la technique. Celui-ci se propose en effet « …de diviser chacune des difficultés
que j’examinerais en autant de parcelles qu’il se pourrait ;… de conduire par ordre mes
pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour
monter peu à peu jusques à la connaissance des plus composés. » (René Descartes, 1637/1970
, p.45) l’amenant à considérer que « ma philosophie ne considère que des grandeurs, des
figures et des mouvements comme fait la mécanique » (cité par Joseph Beaude, 2006).
Naissait ainsi, sur de telles bases, le mécanisme, c’est à dire une philosophie de la nature selon
laquelle l'Univers et tout phénomène qui s'y produit peut et doit s'expliquer d'après les lois
physiques des mouvements matériels.
Il était logique dès lors de considérer (certes initialement de manière métaphorique) le corps
humain et plus spécifiquement le cerveau comme des machines dotées de mécanismes, tels
des automates et, de proposer, pour en comprendre le fonctionnement, d’une part de les
démonter et, d’autre part, de tenter d’en construire des simulacres (des modèles), justifiant
ainsi la maxime de Giambatista Vico : « verum et factum convertuntur » (cf Jean-Pierre

5
Dupuy, 1999). Donc, pour comprendre la machine humaine, la première chose à faire semble
être de la dissocier en ses parties les plus petites (selon une position proche de l’atomisme
démocritien) et de les associer ensuite progressivement – par l’esprit -, pour en comprendre
les mécanismes partiels, puis, éventuellement, globaux.
En ce qui concerne l’effort conduit pour comprendre le cerveau et la pensée, la technique a
participé considérablement au soubassement rationnel de la démarche de connaissance. On
n’insistera jamais assez sur l’impact des développements techniques dans la manière dont on a
construit les conceptions successives du cerveau et de la pensée (Jean Vion-Dury, 2008).
Transposée aux « mécanismes » psychologiques, la méthode cartésienne ainsi comprise nous
conduit à l’atomisme associationnisme que William James (cité par Natalie Depraz, 2006, p.
120) critique en ces termes:« Ils commencent par « des idées simples de sensations » qu’ils considèrent comme autant d’atomes pour
élaborer ensuite des états supérieurs de l’esprit à partir de leur « association » ou leur « intégration » ou de leur
fusion comme on construit une maison en assemblant des briques…Cela nous engage dans une théorie très
discutable selon laquelle nos états de conscience supérieurs sont des combinaisons d’unités… La méthode qui
consiste à aller du simple au compliqué est illusoire…[Ce que l’on connaît ] immédiatement …ce sont les états
mentaux concrets et globaux … [et non] un ensemble d’idées censées être « simples », avec lesquelles [on] se
trouve à la merci de n’importe quelle expression plausible pour désigner leurs interactions supposées. »
Malgré de nombreuses réserves émises sur cette philosophie mécaniste par des penseurs
éminents (comme Blaise Pascal ou Emmauel Kant), l’évolution de la pensée occidentale
allait, en raison du double mouvement conjoint de mathématisation systématique du réel et
d‘abandon des transcendances, perdre sa dynamique initiale, son regard critique : d’une part
en ne s’intéressant plus qu’à l’immanent et en opérant une déconstruction du sens (Jean-
François Mattéi, 2007) et, d’autre part, en oubliant le sujet, en raison du postulat scientifique
(critiquable) que seule l’objectivité permet la connaissance, conduisant ainsi à une conception
mécanisée de la pensée (Olivier Rey, 2003).
L’abandon de l’attention au sujet explique probablement en grande partie l’incapacité des
neurosciences cognitives et de la philosophie de l’esprit à comprendre la conscience Si
l’homme est pensé comme mécanique, analysé seulement sur un mode objectif, en « 3ème
personne », ce qu’il trouve au bout de cette démarche c’est ce fameux « hard problem » de la
conscience (Denis Fisette et Pierre Poirier, 2000), laquelle ne peut être décrite finalement
(hors de ses corrélats neurologiques) qu’en première personne, puisqu’elle est ce que chacun
de nous vit. Ce problème si difficile souligne que la « vraie » vie, la nôtre, celle que nous
vivons, échappe largement à l’objectivation scientifique, laquelle n’est qu’une activité
particulière de cette vie, limitée de plus à certaines communautés humaines. C’est ainsi que la

6
science, comme le pense Henri Bergson (1939/ 2004), amène à ce que l’écoulement continu
de la vie est « artificiellement décomposé pour la plus grande commodité de la connaissance
usuelle» (p.207), nous conduisant à préférer « l’analyse des objets plutôt que celle des
progrès » (p.135).
B) Le langage mécanisé.De là, il semble possible de soutenir que, dans cette logique de mécanisation et de
mathématisation, les savants qui s’occupaient des langues, les philologues, se sont
progressivement mués en linguistes et, portés par le positivisme et le mécanisme ambiants, se
sont tournés à la fin du XIXème siècle vers une analyse scientifique du langage, lequel fut pris
alors comme un objet d’une science descriptive : la linguistique structurale (Françoise Farago,
1999).
Il n’est pas question ici, pour un neurobiologiste, de rentrer dans les détails de l’histoire de la
linguistique dans laquelle il n’est pas compétent, sinon pour signaler à quel point le
développement de la linguistique structurale dans ses différentes formes a eu un impact
considérable sur la conception que l’on avait de la pensée humaine. Le « tournant
linguistique » (« linguistic turn ») du début du XXème siècle a orienté durablement les
recherches sur le fonctionnement de l’esprit humain. La convergence de l’algèbre de Boole
qui cherchait les lois mathématiques de la pensée, avec les recherches d’une part en
cybernétique et intelligence artificielle et, d’autre part, en linguistique a conduit les
spécialistes de la psychologie cognitive, puis ceux des neurosciences cognitives à concevoir le
fonctionnement de l’esprit selon une approche logico-sémantique et représentationnelle. Le
calcul sur les symboles (la computation) compatible avec le paradigme d’un cerveau compris
comme traitant de l’ information (au sens des spécialistes du traitement du signal), est devenu
la base admise des processus de pensée (pour revue, voir Jean Vion-Dury, 2007). Puisque la
philosophie analytique (fondamentalement une philosophie du langage) postule que la
philosophie est analyse logique linguistique (phrase, proposition, signification), la philosophie
cognitive et les sciences cognitives qui s’en inspirent assument largement les évolutions
remarquables de la linguistique du XXème siècle tout autant que sa structure paradigmatique.
Ce « tournant linguistique » sera à l’origine d’une conception de l’esprit dans laquelle a) les
pensées sont « localisées » dans le langage, b) l’explication philosophique de la pensée se
résout dans l’explication philosophique du langage et, c) de même que la modularité est
postulée dans la structure du langage conçu comme un système de centres de traitements

7
reliés entre eux par des voies de communication de l’information, elle est également postulée
en sciences cognitives entre des zones cérébrales investies d’une fonction spécifique.
On notera d’ailleurs la proximité épistémologique entre, d’une part cette conception logiciste
du langage et, d’autre part, le physicaliste réductionniste du cercle de Vienne (dérivé de la
doctrine mécaniste cartésienne) qui s’est emparé des sciences biologiques en général et des
neurosciences en particulier.
On pressent dès lors qu’il existe un lien puissant entre l’attitude distanciée, réflexive et
mathématisante qui gouverne avec une grande efficacité les activités techniques et
scientifiques des humains du XXIème siècle et une conception très structurale,
computationnelle et logique du langage et de la pensée. Le langage, devient alors un jeu
créateur d’associations entre une nombre fini de signes (d’« atomes ») et de règles dans le but
de créer un nombre infini de phrases, selon la logique de la grammaire générative de
Chomsky, qui postule le caractère inné des mécanismes profonds du langage (Françoise
Farago, 1999). Jusqu’à la musique qui subit également sa part de réductionnisme
computationnel au travers de la théorie générative de la musique tonale (TGMT) de Fred
Lerdahl et Ray Jackendoff (1983), sur des bases similaires.
Il existe donc une cohérence de fait entre la mathématisation du réel, le projet mécaniste sous-
tendant la biologie contemporaine, les (neuro)sciences cognitives, l’intelligence artificielle, la
linguistique structurale, et la TGMT. Cette cohérence est basée sur la conception postulant
que l’association adéquate des parties (atomes) au sein de structures données permet de
comprendre le tout.
II) Le geste et l’ineffable.On peut donc soutenir, dogmatiquement, que la pensée de l’homme se réduit effectivement au
langage, voire à un système de computation logique objectivable. Mais, d’une part la
pragmatique et une conception interactionniste du langage se sont glissées dans la
linguistique moderne et, d’autre part, il semble le langage (tel que le pense la linguistique
structurale et les sciences cognitives) ne puisse épuiser ou décrire entièrement la pensée.
A) Au delà de la linguistique des codesC’est ainsi que tout d’abord il existe des mots particuliers (les petits mots) dont les fonctions
sémantiques sont ou floues ou variables et dont le rôle relève de l’amadouage, de la co-
construction du sens, de modulations ou d’hypo-corrections (Claire Maury–Rouan, 2007).
Leurs fonctions ne sont intégrables que dans une linguistique interactionniste. Dans une telle
linguistique, la co-énonciation du discours et la co-construction de sens, dont on imagine

8
l’extrême complexité puisque relevant de celle des relations sociales, jouent un rôle
fondamental. Cette complexité se surajoute à celle de la structure des phrases ou du discours
prononcé. L’analyse des interactions (qu’on pourrait dire en 2de personne) montre à quel point
se produit, ainsi que l’indique Claire Maury-Rouan (2007a), une véritable mise en scène du
discours, qui en dépasse la structure logico-sémantique et en relativise une présentation sous
la forme d’un codage, même complexe, d’informations.
La communication verbale ne se réduisant pas à des codes linguistiques, elle met en jeu, outre
ces mots aux fonctions floues, des actions du corps dans son entier incluant la motricité
phonatoire, la mimogestualité et ce que l’on convient d’appeler une organisation verbo-
viscéro-motrice (Jacques Cosnier, 2003). Nous y reviendrons.
Paradoxalement, il semble ainsi qu’au sein même de la parole humaine se tient l’ineffable,
c’est à dire ce dont on ne peut parler, en tout cas dans le cours du discours. De ce point de
vue, Ludwig Wittgenstein, un des plus éminents philosophes du langage et de la logique, nous
signale où se trouve la limite du langage : « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le
silence » (Tractatus, § 7). Or, mettre l’accent sur une communication verbale dont une grande
partie des informations passe par des processus à proprement parler non linguistiques mais
corporels, a une conséquence épistémologique considérable pour les neurosciences. La pensée
(au sens large et non réduite à un raisonnement logique, abstrait et réflexif sur le monde)
risque bien de ne pas se limiter à un processus simplement computationnel et ne pas être de
type représentationnel. Le socle des sciences cognitives s’en trouve alors ébranlé.
B) Pragmatique linguistique et philosophie de l’action.L’importance désormais accordée à la mimogestualité dans la linguistique contemporaine
nous oblige donc à changer de point de vue. Ainsi que le souligne Claire Maury-Rouan
(2008), c’est en continu que la régulation de l’activité mimogestuelle a lieu au cours de
l’interaction, alors que le jeu des réponses verbales est discontinu chez chaque interlocuteur.
Non seulement ces emblèmes gestuels jouent un rôle dans les processus d’interaction, mais ils
apparaissent aussi comme des processus d’échoïsation corporelle et possèdent de ce fait une
fonction régulatrice sur l’émission du discours. Ainsi, le message transmis dans l’échange
verbal est un complexe de parole et de motricité (au sens le plus large), interprété par les
interlocuteurs en fonction du contexte, grâce à ce que l’on appelle l’analyseur corporel à
l’œuvre dans la perception et l’interprétation de cette mise en corps des mots.
Cependant on peut discuter le caractère potentiellement réducteur d’une interprétation de cette
voie corporalisée de la communication telle qu’en donne par exemple Jacques Cosnier (2003,

9
2008) comme composante fondamentale de l’empathie, notamment au travers du transfert
d’émotions. D’une part, il existe un risque de réduire ces processus complexes à la seule
activation des neurones miroirs supposée constituer la base du processus empathique. D’autre
part, très souvent, dans le domaine des sciences cognitives, les émotions sont plutôt
considérées de manière simplifiée sous la forme de ce qu’il est convenu d’appeler les
émotions fondamentales (colère, joie…), oubliant de la sorte le Descartes du Traité des
passions pour ne plus que considérer que celui de la doctrine mécaniste. Sans doute pouvons
nous retrouver parfois, dans notre vie quotidienne, ces émotions correspondant à ces émotions
fondamentales, mais ces catégorisations peu subtiles de la psychologie cognitive ne semblent
pas adéquates pour penser les transferts d’affects survenant au cours d’un processus
d’interaction aussi sophistiqué que le langage. Nous préférerions dire que les émotions sont au
bout du compte tout ce qui nous « é-meut » ou nous affecte au sens le plus large du terme, et
ce de la manière la plus subtile (c’est à dire par l’intermédiaire des affects de vitalité dont
nous parlerons plus loin), et que les processus d’empathie, en raison de leur complexité même
engagent, comme on le sait maintenant, beaucoup plus la matière cérébrale que les seuls
neurones miroirs, notamment en raison de la régulation de l’empathie par le contexte.
Tout autant que le sens dans l’acception saussurienne, le geste se trouve alors au coeur de la
communication linguistique, qu’il soit exprimé directement dans la mimo-gestualité, ou
suggéré dans la métaphore (George Lakoff et Mark Johnson) laquelle concerne à la fois la
pensée et l’action et s’enracine dans l’expérience même.
L’importance théorique (philosophique) de l’emphase mise par Claire Maury-Rouan sur la
mimogestualité nous semble considérable. En effet, cette attention à l’aspect moteur du
discours qui ne se réduit pas à l’énoncé logique linguistique ou même au simple partage des
émotions fondamentales, est en accord avec les positions de John Austin (pragmatique
linguistique, notion d’illocutoire), mais surtout de John Searle. Si l’on suit celui-ci, le langage
n’est pas une simple production de sens au travers de mots, c’est véritablement un acte, un
comportement régi par des règles et un acte moteur en particulier que l’on peut intégrer plus
généralement dans une philosophie de l’action...(Françoise Farago, 1999).
Penser le langage notamment comme un geste accompagné de sens, c’est à dire « poser » en
quelque sorte le sens sur l’action et non l’action comme conséquence du sens, nous amène,
avec Henri Bergson dans deux directions à notre avis fécondes. D’une part dans une critique
du langage qui considère que celui-ci discrétise, fragmente, réduit et, en définitive, déforme la
pensée et masque l’expérience immédiate (Henri Bergson 1940/2002) et, d’autre part, dans
l’idée que la matière vivante, l’animal, et donc l’homme, sont tournés vers l’action (Henri

10
Bergson, 1939/2004). Si l’homme est fait pour agir, et si la base du fonctionnement de l’être
vivant est un processus sensorimoteur tendu au départ et par réflexe vers l’action sur le
milieu, on n’a plus besoin de la notion de représentation, en tout cas dans la conception qu’en
ont les sciences cognitives. L’esprit n’est plus comme le disent Francesco Varela et coll.
(1993) « parachuté dans un monde pré donné » (p.234), et la cognition devient « énaction »
c’est-à-dire avènement conjoint d’un corps et d’un esprit, à partir de l’histoire des diverses
actions accomplies dans le monde2. En renvoyant dos à dos idéalisme et réalisme, en
repensant les liens entre la matière et la mémoire (l’esprit) en dehors de processus
représentationnels et en nous amenant à penser l’être vivant comme par principe tourné vers
l’action, Henri Bergson nous permet de concevoir philosophiquement l’énonciation d’un
discours comme un conglomérat de processus sensorimoteurs, comme une nébulosité de
gestes et de postures en actes, et non comme la seule association logico-sémantique d’atomes
linguistiques.
C) La musique de la voix.Certes l’on parle avec des mots sémantiquement stables ou flous, des mimiques et des gestes,
mais on ne parle pas sans mélodie. Beaucoup a été dit sur l’importance de la prosodie dans le
langage (Jean-Louis Calvet et Robert Sctrick, 2007). La parole est tout autant mélodie que
sens, et qui dit mélodie suggère la notion d’inflexions et de rythmes, puisque dans la prosodie
on distingue, comme en musique, des caractéristiques métriques, tonales et temporelles
(Claire Maury-Rouan, 2007) auxquelles il faut aussi ajouter des caractéristiques de timbre.
Dans une parole, il y a donc une sorte de chant qui se tapit et se module, en chaque instant,
d’inflexions subtiles. La nature de la mélodie vocale, sa texture, ses modulations, tout autant
que la mimogestualité, nous renseignent sur l’habitus intime et sur la personnalité du sujet qui
parle.
Les travaux de Daniel Stern (2004) ont montré l’importance de la prosodie, c’est à dire des
vocalisations non verbales dans le développement des interactions mère-enfant,
particulièrement dans les processus de synchronisation et la création précoce de la matrice
intersubjective. Stern écrit même : « La nature a eu la sagesse de n’initier les bébés au langage
symbolique qu’au bout d’un an et demi pour qu’ils aient le temps d’apprendre comment le
monde humain fonctionne vraiment sans la distraction de la complication des mots mais avec
l’aide de la musique du langage » (p.139).
2 Signalons ici la parenté entre la pensée Bergsonienne et la neurophénoménologie initiée parFrancesco Varéla.

11
Les médecins, les politiques, les pédagogues et les acteurs savent implicitement comment, en
jouant de cette musique vocale, ils sont capables de faire adhérer l’auditeur à leurs discours et
à leurs arguments.
Dans le récit, comme dans le discours, la narration s’organise dans une enveloppe proto-
narrative c’est à dire « l’élan de la phrase, le rythme de la voix, sa musique … ce qui est en
deçà du roman ».(Michel Imberty, p 170 et seq). Or, l’enveloppe proto-narrative possède un
contour temporel et met en jeu les affects (ou dynamiques) de vitalité décrits par Daniel Stern.
Ces affects de vitalité se composent« de la dynamique temporelle des changements de sentiments consistant en des modifications analogiques,
millième de seconde par millième de seconde, en temps réel, d’affects, de pensées de perceptions de
sensations…se produisant en parallèle avec les contours temporels de stimulations » (Michel Imberty, p.277).
On pourrait dire ainsi, que les processus prosodiques, mélodieux de la voix parlée,
transmettent, tout autant que la mimogestualité, essentiellement des dynamiques de vitalité,
qui forment le socle de l’empathie dans le discours.
D) Le geste musical.Non seulement la musique peut-être appréhendée comme un groupement savant et complexe
de sons inscrit dans une tradition culturelle donnée, ou comme une macrostructure, c’est à
dire un schéma de structuration du temps, ou comme un style, mais elle peut aussi être pensée
comme exemplificatrice de sentiments ou d’affects, lesquels sont souvent en fait représentés
par des mouvements ou des actions se déroulant dans le temps (Michel Imberty, 2005) :« Le geste et le mouvement sont pour une grande part à l’origine de la représentation mentale musicale, mais
d’une représentation qui est ici de nature dynamique et non liée directement à des encodages d’écriture de l’objet
musical figé sur la partition »… « Tout se passe comme si pensée et représentation ne pouvaient se stabiliser – et
donc s’enraciner dans les codes sociaux - que par projection dans le geste et le mouvement du corps propre. »
(p.91).
C’est ainsi que les unités sémiotiques temporelles (UST) constituent par exemple des gestes
épurés (descente, montée…) et forment une sorte de « squelette moteur » de nombreuses
partitions musicales.
Le geste donc, pour Michel Imberty, est élément structurant de la forme musicale :« c’est une énergie déployée dans une trajectoire temporelle orientée, consubstantielle à l’ expérience intérieure
vécue, et sans laquelle le sujet ne pourrait sans doute s’en approprier le sens ; le geste constitue le ressort
psychologique essentiel de toute la pensée musicale. »…(p.98).
Cette « épopée de l’énergie » qu’est la pièce musicale, pensée comme succession de gestes,
est une récapitulation de ce qui s’est déjà produit au cours d’actions antérieures - puisque
« tout geste est trace de processus qui se sont déjà produits » (p.99) - , sorte de mémoire

12
motrice individuelle et collective. Les figures musicales, ces groupements de gestes
(musicaux) inscrits dans une temporalité en quelque sorte repliée, correspondent à des
concepts concrets, à des schèmes de la pensée imageante, à des « figures de pensée » (p.100)
exemplifiant des processus temporels ou des évènements antérieurs. Nous retrouvons ici la
notion ancienne mais pertinente d’ « idées concrètes » de Boris de Schoelzer (1947).
E) ConvergencesLe puzzle est désormais en place. Pour peu que l’on admette à la fois que le langage n’est pas
cette transmission aride et codée d’informations qu’une société de robots pourrait produire et
que l’action est au cœur du processus vital, il nous est enfin loisible de penser autrement
l’ineffable et de lui donner toute sa place dans le discours linguistique ou musical.
Communiquer n’est pas seulement produire un discours codé dans lequel des lettres et des
mots correctement agencés ont un sens logique, compréhensible, décodable. Produire un
discours, c’est faire une action, c’est à dire effectuer un nombre considérables de gestes : des
mimiques, des mouvements du tronc et des membres, des modifications viscérales
détectables par d’infimes indices (variations du diamètre pupillaire), etc. C’est présenter aussi
des comportements et utiliser des mots qui régulent les positions respectives des
interlocuteurs. Toutes ces modifications continues et extrêmement rapides des dynamiques de
vitalité semblent insaisissables alors que notre conscience semble toute occupée à mettre (ou
extraire) du sens dans ce qui est vocalisé.
Nous faisons passer des variations des dynamiques de vitalité à la fois dans la mimogestualité
et dans la prosodie du discours, ou, si l’on veut, dans le chant continu de la vocalisation, c’est
à dire dans un type de gestes musicaux particuliers (respiratoires et pharyngés) qui
accompagnent les gestes et les mimiques du discours. Il nous semble qu’il n’y a en fait qu’une
différence de quantité et non de nature entre le chant de la voix du discours (la prosodie) et le
chant musical. Tous les deux ont en commun des gestes inscrits dans la temporalité,
récapitulant d’autres gestes (ou d’autres processus) appris dès les premières interactions mère-
enfant. Tous ces gestes (ou subtiles équivalences de gestes) produits au fil du discours ont
pour particularité d’être transmis en continu entre les protagonistes, de ne pas relever de ce
qui serait racontable (en cela ils sont largement ineffables), et d’échapper, le plus souvent, lors
de la production vocale, à l’analyse réflexive de la conscience.
Ainsi, dans l’échange discursif entre deux personnes, deux types de pensée semblent à
l’œuvre. D’une part une pensée logico-sémantique, celle des linguistes structuralistes et des
philosophes analytiques. D’autre part une pensée concrète, largement musicale et gestuelle,

13
figuration temporelle de l’action passée présente ou à venir. C’est là la pensée ineffable, le
point intraduisible, ce dont on ne peut parler et qu’il faut taire, et sans doute le moyen de
l’accès à l’être.
La mise en corps du langage, c’est à dire en fait son incarnation, nous ramène, on le voit à la
prise en compte nécessaire de cette subjectivité dont on a plus haut signalé le regrettable
oubli. C’est alors qu’il nous faut parler de la conscience.
III) L’ineffable, le geste et la conscience.Claire Maury-Rouan soulève fréquemment dans ses écrits, la question du type de conscience
dans lequel s’inscrivent les processus de mimogestualité et de prosodie avec leur cortège de
significations immédiatement saisies. Le plus souvent on parle de processus implicites sans
savoir si, finalement, ces processus relèveraient de simples automatismes ou bien des
structures et du fonctionnement de l’inconscient freudien.
La phénoménologie depuis Husserl, son fondateur, a porté son attention sur les contenus et la
structure de la conscience. Notre conscience ne se limite pas à la réflexivité, c’est à dire la
conscience que l’on a d’être conscient. Cette conscience réflexive, médiate, attentive constitue
en quelque sorte une couche « superficielle » de notre conscience au sens large, c’est à dire de
ce qui dans notre vie n’est pas inconscient. Un second niveau de conscience est celui d’une
vigilance ouverte, d’un accueil panoramique, d’une conscience de base minimale, graduelle et
ouverte (Natalie Depraz, 2001) C’est ce que l’on dénomme « awareness ». Ce second niveau,
cette conscience pré-réflexive, couche profonde de notre expérience subjective est
multimodale, pré-conceptuelle et pré-cognitive. Elle est présente avant toute séparation de nos
modalités sensorielles. L’accès à la conscience pré-réflexive est possible par des méthodes
spécifiques (Claire Petitmengin, 2007).
Or, d’une part Daniel Stern insiste sur le caractère pré-réflexif, implicite, des affects de
vitalité, et d’autre part, nous avons montré, dans l’analyse de la conscience pré-réflexive, lors
de l’écoute musicale (Claire Petitmengin et coll, 2009), à quel point, justement, l’écoute de la
musique engageait des gestes, des processus multimodalitaires et des actions, qui relèvent
largement des dynamiques de vitalité.
Nous voudrions proposer ainsi l’hypothèse suivante. Sous la structure logique et syntaxique
du langage sont présentes ces dimensions implicites qui relèvent d’une gestualité généralisée :
la métaphore d’une part, la mimogestualité d’autre part et enfin la prosodie (la musique). Elles
étayent l’idée que la vie est action. Ces dimensions implicites du langage ne sont pas, d’une
manière générale, présentes dans la conscience réflexive, analytique, comme le sont par

14
exemple le sens du discours, la conceptualisation et la catégorisation. Ces dimensions
implicites, qui précèdent l’acquisition du langage par l’enfant et constituent le « socle non
verbal » du langage verbal sont présentes non pas seulement dans l’inconscient
(éventuellement défini dans le sens freudien) mais elles remplissent probablement la
conscience pré-réflexive. Ainsi, une double acception du sens peut apparaître : d’une part, le
sens (l’orientation et la dynamique) des gestes (musicaux, de langage) qui se tient, se construit
et se perçoit dans la conscience pré réflexive ; d’autre part, le sens abstrait, qui s’organise
dans la conscience réflexive et semble émerger ontologiquement et pratiquement du « sens
gestuel ».
Par la mimogestualité, la métaphore, mais aussi le mélisme de la parole, le geste, c’est à dire
l’action signifiante, se love au cœur du langage humain. C’est ainsi que toute parole est
fondamentalement incarnée, et grâce à cette incarnation nous indique en chaque instant tout
ce qu’il y a à comprendre de l’autre et que le langage logique et structuré ne nous dit pas.
Notre conscience pré-réflexive saisit ainsi en permanence les multiples aspects, combinaisons
et irisations de la circulation subtile qui se produit entre les gestes de la musique, les gestes du
langage, le chant de la voix, les gestes du corps, la voix des choses (les sons), nous présentant
en permanence ce dont nous ne pouvons parler, qui remplit notre mémoire dans laquelle
s’entasse toutes nos actions passées, crée une atmosphère spécifique et que l’on nomme
l’ineffable. Dans cet ineffable, l’épaisseur (expérientielle et temporelle) de la vie de l’autre
nous est donnée ; et nous lui proposons ainsi la nôtre.
IV) Conclusions.Il nous semble ainsi que l’ineffable est au cœur de la communication verbale, tapi, caché
dans la conscience pré-réflexive. De lui, nous ne pouvons parler qu’au prix d’un effort
d’explicitation de cette conscience pré-réflexive ; nous en découvrons alors, parfois
lentement, la richesse et la profondeur, qu’il participe d’un discours linguistique ou d’un
discours musical.
Nous donnons ainsi vie à notre vie subjective, celle des contenus de notre conscience et, en
faisant cela, nous savons, nous expérimentons même, que toutes nos pensées ne sont pas de
nature linguistique. Nous saisissons à quel point dans cette conscience pré-réflexive le geste,
sensori-moteur par essence, consubstantiel à l’action, lui donnant sens et la définissant fonde
la quotidien de notre vie humaine. Nous découvrons à quel point le geste contient de la
musique et la musique du geste, et combien parler à l’autre c’est l’amener, par des gestes
remplis de musique et une prosodie toute entière gestualisée, à saisir instantanément dans sa

15
conscience pré-réflexive, le contexte personnel expérientiel (sédimenté au cours du temps) du
discours qu’il analyse dans sa conscience réflexive. Ce contexte est la condensation de ce
qu’il doit savoir de nous ; il le met en position d’appréhender ce que nous lui disons. Faire
attention à ce qui est présent dans notre conscience pré-réfexive lors de la communication
verbale et musicale nous montre ce qu’il en est de notre manière d’être au monde mais surtout
à l’autre.
Le travail de linguistes comme Claire Maury-Rouan ouvre un chemin vers l’humanisation de
la compréhension du langage. Tournant le dos à la seule appréhension mécaniste des
processus linguistiques, ces linguistes ouvrent la voie d’une véritable prise en compte de
l’infinie complexité de l’intersubjectivité. Dès lors, ils nous éloignent du monde des robots, et
nous donnent des outils pour comprendre comment, humains en société, nous nous disons les
uns aux autres. La compréhension de l’incarnation du langage n’a pas à se faire contre
l’analyse des structures et la contemplation des formes. Il nous faut rester admiratifs devant
le travail de notre conscience réflexive, devant la richesse des structures du langage , devant
ces efforts de conceptualisation que notre raison nous permet de faire. Mais d’une certaine
manière la compréhension de l’incarnation du langage rejoint le programme de Maurice
Merleau-Ponty (1945) : joindre « l’extrême subjectivisme et l’extrême objectivisme dans sa
notion du monde ou de la rationalité » (p.XV).

16
RÉFÉRENCES
Jospeh Beaude. Mécanisme Encyclopædia Universalis. 2006.
Bergson Henri. Matière et Mémoire. PUF Quadrige , 1939/2004.
Bergson Henri. Le rire. PUF Quadrige, 1940 /2002.
Calvet Jean-Louis et Sctrick Robert. La prosodie , Encyclopaedia universalis, 2007
Cosnier Jacques. « Les deux vois de communication de l‘émotion » in Coletta Jean-Marc et
Tcherkassof Anna. Perspectives actuelles sur les émotions. Cognition, langage et
développement. Hayen, Mardaga, 2003 : 59-67.
Cosnier Jacques. « Empathie et communication. Comprendre autrui et percevoir ses
émotions ». in La communication, état des savoirs . Paris, Editions sciences humaines, 2008 :
149-154.
Depraz Natalie. La conscience approches croisées des classiques aux sciences cognitives.
Paris, Armand Colin 2001.
Depraz Natalie. Comprendre la phénoménologie, une pratique concrète. Paris Armand Colin,
2006.
Descartes René. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison , et chercher la vérité
dans les sciences. 1637, Paris Gallimard, 1970.
Dupuy Jean-Pierre. Aux origines des sciences cognitives. Paris . La Découverte. 1999.
Imberty Michel. La Musique creuse le temps. De Wagner à Boulez : Musique, psychologie,
psychanalyse. Paris L’Harmattan, 2005.
Farago Françoise. Le langage. Paris, Armand Colin, 1999.

17
Fisette Denis et Poirier Pierre. Philosophie de l’esprit. Etat des lieux. Paris. Vrin, 2000.
Kuhn Thomas : La structure des révolutions scientifiques. Paris Flammarion, 1983,
Lakoff George et Johnson Mark . La métaphore dans la vie quotidienne. Paris, Editions de
Minuit, 1980/ 1985.
Lerdahl Fred, Jackendoff Ray. A generative theory of tonal music. Cambridge Mass MIT
Press, 1983.
Lurçat François. L’autorité de la Science , Paris Cerf, 1995,
Mattéi Jean François. Pythagore et les pythagoriciens. Paris, Presses Universitaires de France,
1993.
Mattéi Jean François. Le regard vide. Essai sur l’épuisement de la culture européeenne Paris.
Flammarion, 2007.
Maury-Rouan Claire. « Le flou des marques discursives est-il un inconvénient ? Vers la
notion de ‘leurre discursif ‘»: sous presse in Robert Vion Analyse linguistique des
Interactions. Paris L’Harmattan, 2007.
Maury-Rouan Claire, Vion Robert., Bertrand Roxane. « Voix de discours et positions du
sujet. Dimensions énonciatives et prosodiques » . in Jean-Marie Barberis Cahiers de
Praxématique, 49, Numéro spécial :: A la recherche des voix dans le Discours.2007, pp. 133-
158
Maury-Rouan Claire. « Gestualité, énonciation et présence de l'autre dans le discours ». In :
Régine Delamotte-Legrand. Dialogues, mouvements discursifs, significations. Bruxelles,
EME, Collection Sciences du Langage. 2008 pp. 49-63.
Merleau-Ponty Maurice. Phénoménologie de la perception. Paris Gallimard, 1945.

18
Petitmengin Claire. Towards the sources of thoughts. The gestural and transmodal dimension
of lived experiences. J. Consciousness Studies, 2007, 14 (3) : 54-82.
Petitmengin Claire, Bitbol Michel., Nissou Jean.Michel., Pachoud Bernard., Curallucci
Hélène., Cermolacce Michel., and Vion-Dury Jean. Listening from Within, sous presse dans
J. Consciousness Studies, 2009
Rey Olivier. Itinéraire de l’égarement. Du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine.
Paris, Seuil, 2003.
Schloezer, Boris de. Introduction à J.-S. Bach. Essai d'esthétique musicale.. Paris
Bibliothèque des Idées.1947.
Stern Daniel N. Le moment présent en psychothérapie : un monde dans un grain de sable.
Paris, Odile Jacob, 2004
Varela Francesco., Thomson Evan. et Rosch Eleanor. L’inscription corporelle de l’esprit.
Paris, Seuil, 1993.
Vion-Dury Jean. Entre mécanisation et incarnation. Réflexions sur les neurosciences
cognitives fondamentales et clinique. Rev Neuropsychol, 2007, 17 (4), 293-361.
Vion-Dury Jean. « Le monde imaginaire des neurobiologistes ou comment a-t-on toujours
rêvé d’un cerveau qui n’existait pas ».In Jean. Vion-Dury J et François Clarac. La
construction des concepts scientifiques : entre l’artéfact, l’image et l’imaginaire , Paris
L’Harmattan, 2008, 123-149
Wittgenstein Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Paris Gallimard, 1922/1993.