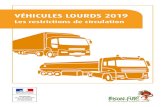Ces accidents sont situØs à la sortie du village de St ... · En 2009, il a ØtØ comptabilisØ 3...
Transcript of Ces accidents sont situØs à la sortie du village de St ... · En 2009, il a ØtØ comptabilisØ 3...

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 112 -
6. JUSTIFICATION ET PRESENTATION DU PROJET
6.1. POURQUOI MODIFIER LA ROUTE ACTUELLE ?
Une réflexion sur la modification de la RD720 actuelle à Vayrac a été rendue nécessaire du fait des constatations suivantes :
− le trafic est en perpétuelle augmentation sur cette portion de la RD720 avec un trafic poids lourds non négligeable,
− la configuration actuelle de la RD720 génère des zones accidentogènes,
− problème de traverser le village � améliorer la sécurité : les habitants du bourg de Vayrac sont gênés par le passage de la RD720 à leur porte.
6.1.1. Un trafic en perpétuelle augmentation
En 2006, il a été comptabilisé 3 351 véhicules par jour sur la RD720 à la limite départementale Lot � Corrèze. Les poids lourds représentaient à eux seuls environ 6% du trafic.
L�analyse des trafics constatés sur la RD720 montre que le trafic moyen a progressé en moyenne de 3.6% entre 2002 et 2006.
Le trafic augmente sur la RD720 en période estivale et plus spécialement les mois de juillet et d�août. Ces déplacements sont essentiellement liés à des déplacements touristiques dans l�aire d�étude.
En 2008, il a été comptabilisé 3 778 véhicules par jour sur la RD720 entre St Michel de Bannières et Condat dont 6.5% de poids lourds (en hausse de 12.6% par rapport à l�année 2006). Cette hausse pourrait s�expliquer par le déplacement de la station de comptage de la limite départementale Lot � Corrèze au Nord de St Michel de Bannières ainsi que par l�interdiction de circulation des poids lourds excédant 7.5 tonnes sur la RD840 (ex RN140), axe parallèle à la RD720 et reliant Brive à Figeac via Rodez.
En 2009, il a été comptabilisé 3 753 véhicules par jour sur la RD720 (dont 5,7% de poids lourds), soit une baisse de 0,7% par rapport à 2008. Les dernières évolutions sont peu sensibles et le trafic reste stable. En effet, les comptages réalisés en 2010 indiquait un TMJA de 3 756 véhicules par jour dont 5,3% de poids-lourds sur la RD720.
L�accroissement du trafic routier estimé à partir des évolutions des TMJA entre 2004 et 2009 (croissance annuelle moyenne de 2,9% par an) devrait toutefois se poursuivre dans les prochaines années. En 2029, sans aménagement de la déviation de Vayrac et en appliquant le taux d�évolution actuel, soit + 2.7% par an, le trafic devrait avoisiner 5 500 véhicules par jour.
Les aménagements envisagés au droit de Vayrac devraient permettre de délester le centre bourg du trafic de transit, en particulier celui des poids lourds et donc, de réduire la gêne aux riverains.
6.1.2. Améliorer la sécurité
Selon les données de la Mission Sécurité Routière et Défense de la DDT, on comptabilise, entre 2000 2011, 5 accidents sur la RD720 de St Michel de Bannières à Vayrac. Les bilans font état de 4 blessés hospitalisés et 3 blessés non hospitalisés.
Ces accidents sont situés à la sortie du village de St Michel de Bannières, sur la partie rectiligne de la RD720 et au carrefour « en Té » avec la route de Bretenoux (RD803). La RD720, étroite et tortueuse, traverse le bourg de Vayrac. L�église et son centre ancien sont longés par la route.
La traversée du village de Vayrac, par un trafic de transit important (surtout en été), réduit la capacité de la route à cause des caractéristiques faibles des voies urbaines et de la limitation des vitesses. De plus, piétons, cyclistes, véhicules légers, poids lourds et véhicules agricoles se côtoient dans le bourg, ce qui participe à l�effet d�insécurité routière.
Les aménagements envisagés devraient permettre d�améliorer les conditions de circulation sur la RD720 au droit de Vayrac.
6.1.3. Réduire la gêne des riverains
Les habitants de bourg de Vayrac sont gênés par le passage de la RD720. Ils subissent des nuisances en termes de bruit, d�odeurs, de poussières, de pollutions et de vibrations.
Le projet, au droit de Vayrac, devrait permettre de réduire fortement ces préjudices.
6.1.4. Conclusions
La RD720, à la limite départementale Lot - Corrèze, supporte un trafic en 2006 de l�ordre de 3 350 véhicules par jour avec un fort taux de poids lourds, combiné à un trafic de véhicules légers saisonnier marqué. L�accroissement du trafic routier devrait se poursuivre voire s�accentuer dans les prochaines années.
Cette section de la RD720 aux caractéristiques géométriques inadaptées au trafic génèrent des zones accidentogènes.
Enfin, ce tronçon, de RD720 se place dans le cadre plus global de l�aménagement de la liaison entre le bassin du Nord du Lot et l�autoroute A20.
Toutes ces constatations impliquent la nécessité d�une réorganisation de la route actuelle et des échanges avec la voirie locale ; réorganisation qui fait l�objet de la présente opération.
6.2. LES INTERETS D�UN TEL AMENAGEMENT
Le projet de déviation de Vayrac permettra notamment :
− de dévier le trafic de transit du village de Vayrac,
− de renforcer la sécurité routière des usagers de la RD720 et d�améliorer leur confort,
− d�améliorer les conditions de vie des habitants de Vayrac par la réduction des nuisances liées au trafic (bruit et pollution de l�air entre autre), et de renforcer la sécurité routière des riverains,
− d�adapter la RD720 à sa nouvelle fonction, en termes de fluidité de trafic et de cohérence d�itinéraire.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 113 -
6.3. PRESENTATION DES SOLUTIONS ETUDIEES
Une étude préalable portant sur le réaménagement de la RD720 sur la commune de Vayrac a été réalisée à la fin des années 90.
Pour ce secteur, une variante dite variante « 0 » a été étudiée. Elle consiste à conserver le tracé actuel de la RD720 en l�aménageant légèrement au « fil de l�eau » sans investissement coûteux ni modification importante : aménagement de carrefour et renforcement de chaussée par exemple.
Pour l�agglomération de Vayrac, 4 variantes ont été présentées :
− la variante V1 évite le bourg par le Nord par un tracé tendu,
− la variante V2 évite le bourg par le Nord avec un tracé plus incurvé en reprenant la RD110,
− la variante V3 évite le bourg par le Sud et reprend en outre le tracé de la RD116,
− la variante V4 évite le bourg par le Sud et se raccorde à une éventuelle déviation de Bétaille.
6.4. COMPARAISON DES VARIANTES
Dans ce paragraphe, sont examinés les principaux avantages et inconvénients de chacune des variantes étudiées.
� Variante VO
Avantages :
− bonne irrigation du c�ur du village de Vayrac et de ses commerces malgré un trafic important et perturbateur.
Inconvénients :
− conditions de sécurité relativement mauvaises pour l�ensemble de la traversée (RD720 et RD803),
− nuisances sonores élevées ne favorisant pas la réhabilitation de l�habitat en bordure immédiat des deux rues principales de Vayrac.
� Variante V1
Avantages :
− bonnes conditions de sécurité,
− bon report de trafic pour la liaison RD803 � RD720,
− nuisances sonores pratiquement éliminées dans la traversée de Vayrac et tracé s�éloignant de l�habitat,
− tracé valorisant l�habitat du bourg sans limiter l�extension urbaine à la périphérie.
Inconvénients :
− tracé relativement perturbant pour l�agriculture et pour certains commerces.
� Variante V2
Avantages :
− conditions de sécurité acceptables malgré la superposition du trafic de transit et du trafic local pour la partie de la route de la Chapelle-aux-Saints aménagée sur place,
− effets positifs semblables à V1 en ce qui concerne le bruit et l�habitat.
Inconvénients :
− tracé relativement perturbant pour l�agriculture et pour certains commerces,
− problème de gestion des accès riverains sur la route de la Chapelle-aux-Saints,
− effet de coupure franche du paysage au niveau de la traversée des ruisseaux et du hameau de la Brousse.
� Variante V3
Avantages :
− déviation de la RD803 vers Martel assurée.
Inconvénients :
− problèmes de sécurité à plusieurs niveaux :
� superposition du trafic de transit et du trafic local sur la route de la Gare (RD116),
� gestion des deux passages à niveau aux deux carrefours (tracé proche de la voie ferrée),
� débouché sur le carrefour avec la RD803 depuis le Nord après une descente à 5% sur 1,3 km,
� débouché sur ce même carrefour dans l�autre sens juste après une courbe serrée.
− nécessité de démolir 5 à 7 habitations placées sur le fuseau et perturbation de la zone d�habitat sur la route de la gare et à proximité du tracé entre la RD803 et la RD720,
− difficulté de gestion des accès riverains route de la gare,
− coupure de plusieurs chemins avec allongement de parcours,
− interférences avec le périmètre de protection de l�église de Vayrac,
− projet relativement coûteux eu égard au trafic estimé,
− contraintes paysagères fortes pour la partie Nord et difficultés d�intégration des murs anti-bruit route de la gare,
− traversée de sites potentiels Natura 2000.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 114 -
� Variante V4
Avantages :
− conditions de sécurité améliorées malgré la présence d�une courbe serrée au niveau de la zone artisanale relativement dangereuse pour les véhicules venant du Nord.
Inconvénients :
− coupure d�une zone de prairie agricole sans respect du parcellaire. Perturbation des cheminements agricoles et faunistiques,
− fort impact sur le paysage dans toute la partie Nord avec effets de coupures notamment au niveau du franchissement de la RD803, du ruisseau et de la voie SNCF,
− accès difficile au centre de Vayrac avec un tracé risquant de « court-circuiter » le village et certains de ces commerces,
− tracé à proximité du camping de la Palanquière difficilement protégeable des nuisances sonores compte tenu de la gêne d�un merlon en zone inondable,
− projet relativement coûteux en égard au trafic prévisible estimé,
− route submersible par les eaux dans sa partie Sud en cas de forte inondation,
− coupure de plusieurs chemins avec allongement de parcours,
− nécessité d�acquérir pour la démolition de 2 ou 3 habitations situées sur le tracé,
− tracé dépendant de la déviation de Bétaille,
− traversée de sites potentiels Natura 2000.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 115 -
Planche 10 : présentation des variantes

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 116 -
6.5. SYNTHESE DE LA CONCERTATION ET CHOIX DE LA SOLUTION PROPOSEE
Suite à la concertation auprès des élus et du public (réalisée du 8 juin au 18 juillet 1998) et à la recherche de tracé, les variantes V3 et V4 au Sud de Vayrac ont été abandonnées et les variantes V1 et V2 au Nord ont été acceptées sous réserves d�adaptations sensibles.
Le choix de la solution s�est opéré en tenant compte des critères environnementaux, socio-économiques, des résultats de la concertation, et dans le respect des objectifs fixés, à savoir, une solution courte pour Vayrac en évitant le bourg par un tracé tendu (variante V1 adaptée) a été retenue en raison de son impact moindre sur le bâti et l�environnement.
6.6. PRESENTATION DE LA SOLUTION RETENUE
Au vu de l�analyse des solutions étudiées et suite à la concertation auprès des élus, le choix du Maître d�Ouvrage s�est porté sur une déviation de Vayrac au Nord du bourg.
L�opération consiste en :
− un tracé neuf à 2x1 voie,
− l�aménagement définitif du carrefour de type tourne à gauche au lieu-dit « La Brousse »,
− la création du carrefour giratoire à l�extrémité Sud au niveau de la route de Bretenoux (RD803),
− un passage supérieur au niveau de la RD116.
La réalisation de bassins de rétention est prévue pour recueillir et traiter les eaux de ruissellement de la plate forme routière. Dans la cadre du projet de déviation de Vayrac, un dossier d�autorisation au titre de la loi sur l�eau a été réalisé. L�enquête a eu lieu en décembre 2007 et l�arrêté portant autorisation des aménagements a été accordé en date du 12 mai 2009.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 117 -
Planche 11 : présentation de la solution retenue

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 118 -
7. ANALYSE DES IMPACTS
7.1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
7.1.1. Impacts en période de chantier
Les principales nuisances temporaires occasionnées lors de la phase chantier sont les suivantes :
− la pollution des eaux, des sols ou de l'air (risques de rejet d'huile, de graisse, d'hydrocarbures et de gaz d'échappement provenant des engins de chantier ou des produits bitumineux utilisés),
− les émissions éventuelles de poussières lors des travaux de terrassements,
− les émissions sonores dues aux engins du chantier et aux explosifs employés pour les terrassements,
− les vibrations éventuelles lors du compactage des matériaux de chaussée,
− l�augmentation du nombre de poids lourds due aux transports de matériaux et au trafic des engins de chantier,
− les perturbations ponctuelles ou gêne de la circulation.
7.1.2. Impacts en phase d�exploitation
Pour chaque thème, les principaux impacts sont décrits
7.1.2.1. Relief, géologie et sols
Compte tenu du relief assez mouvementé au droit du tracé neuf de la déviation de Vayrac, le projet n�est pratiquement jamais au niveau du terrain naturel (déblai au nord du tracé et remblai dans la vallée de la Sourdoire et du Maumont).
La zone de remblais la plus importante est localisée au niveau des vallées du Maumont et de la Sourdoire (environ 4.6 m maximum).
La profondeur maximale des déblais est de 9,65 mètres située au lieu-dit Caurrieux.
7.1.2.2. Eaux souterraines
� Aspect quantitatif
Les impacts d�un projet tel que la réalisation d�une voie nouvelle concernent essentiellement :
− l�alimentation de la nappe sous-jacente après imperméabilisation des terrains naturels,
− la modification des écoulements souterrains par les déblais profonds et les remblais en zone compressible,
− leur incidence sur les captages situés à proximité.
� Aspect qualitatif
D�un point de vue qualitatif, les risques de pollution sont toujours possibles lorsque aucune couche imperméable n�est présente entre la surface du sol et l�aquifère sous-jacent. Ces pollutions auront un impact d�autant plus important que l�aquifère est karstique : la propagation de la pollution pourra être très rapide et aucune autoépuration du sol ne se réalisera si la pollution tombe rapidement sur un réseau karstique. Ces pollutions peuvent être chroniques ou accidentelles, les pollutions accidentelles ayant un impact plus fort.
7.1.2.3. Eaux superficielles
� Incidences quantitatives
Les perturbations possibles d�un projet routier sans mesure corrective ou compensatoire sont essentiellement de trois natures. Elles concernent :
− l�imperméabilisation de terrains naturels qui va générer des ruissellements de surface plus importants et donc participer à l�augmentation des débits de pointe vers l�aval,
− la création d�obstacles à l�écoulement des crues au droit de franchissements hydrauliques ou de zones inondables qui va générer l�exhaussement de la ligne d�eau et la submersion de surfaces plus importantes que celles actuelles,
− la suppression de volume de stockage nécessaire à l�étalement des eaux pendant les crues pour limiter les débits de pointe aval.
� Incidences qualitatives
Les cours d�eau présents sur le site sont susceptibles d�être pollués par le projet. Les risques de pollution sont de 4 types :
− la pollution chronique : elle est engendrée entre autres par la circulation automobile, l�usure des revêtements, � Elle est entraînée par les intempéries. Les charges en pollution ainsi entraînées peuvent être très importantes.
D�une manière générale, on retiendra comme charge annuelle, par kilomètre de chaussée à 2 voies et pour 10.000 véhicules par jour :
. Matières en suspension (MES) : 1.200 kg
. Demande chimique en oxygène (DCO) : 400 kg
. Plomb (Pb) : 1,3 kg
. Zinc (Zn) : 2,5 kg
. Hydrocarbures et graisses : 5,0 Kg
Ces valeurs sont tirées du guide du SETRA « L�eau et la route ».
Des événements « chocs » peuvent intervenir après une pluie de 10 mm, de durée 15 mn, faisant suite à une période de temps sec de 15 jours. Dans ce cas de figure, les charges entraînées durant cet événement correspondent au 1/10ème des charges annuelles pour chaque paramètre.
− la pollution accidentelle : le développement d�activités humaines, la réalisation de voiries, �, sont sources de pollutions accidentelles telles que le renversement d�un camion citerne contenant des hydrocarbures ou autres produits toxiques ou polluants. La fréquence de ce type de pollution est souvent très faible mais il est très difficile de l�évaluer. Elle est en relation, par exemple, avec le nombre de poids lourds journalier et la présence de situations accidentogènes.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 119 -
− la pollution saisonnière : deux types de pollution saisonnière peuvent intervenir. La première concerne le salage des routes, parkings, � D�une manière générale, les quantités utilisées, suivant les traitements (préventif ou curatif) varient entre 4 et 30 g/m². Une grande partie se retrouve sur le sol aux alentours de la voirie salée à cause du vent, de la circulation, � le reste est récupéré dans les eaux de ruissellement.
La seconde concerne le déversement de produits phytosanitaires. Pour le traitement des voiries, les produits utilisés liquides, de formulation spéciale, comprennent à la fois des matières actives à action foliaire et des matières actives à action racinaire. Des risques de contamination des milieux récepteurs existent notamment lorsqu�une pluie imprévue intervient quelques heures seulement après l�épandage des pesticides.
− la pollution liée aux travaux : Les risques de pollution durant la phase travaux sont de trois types. Ils concernent premièrement l�entraînement des fines (matières en suspension) par des pluies plus ou moins violentes sur des zones fraîchement terrassées. Ces fines vont ensuite colmater les milieux récepteurs en aval.
Le second risque de pollution concerne une pollution préalable des eaux souterraines. A proximité des zones de stockage des carburants ou d�entretien des engins, des produits types hydrocarbures peuvent être répandus involontairement puis ruisseler rapidement si aucun dispositif n�est là pour les stopper.
Enfin, des eaux usées produites au sein des baraques de chantier sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux superficielles.
7.1.2.4. Milieux naturels liés à l�eau
Le franchissement de cours d�eau par une infrastructure peut avoir plusieurs effets négatifs :
− artificialisation du lit mineur,
− création d�obstacles aux déplacements de la faune terrestre et aquatique,
− dégradation de la qualité de l�eau en phase définitive quand il y a des rejets.
7.1.2.5. Climat
Les aménagements projetés ne sont pas de nature à modifier les conditions climatiques locales. En effet, ils n�engendrent pas de perturbation particulière au niveau de la circulation des vents, de l�ensoleillement, de la formation de brouillard, de verglas.
7.1.2.6. Qualité de l�air
L�intégration des études d�impact sur la santé a été introduite par le décret n°2003-767 du 1er août 2003. Aujourd�hui, l�ensemble des procédures réglementaires relatives aux études d�impact et à la prise en compte de l�impact de la pollution de l�air sur la santé figure dans les articles R.122-1 à R.122-16 du Code de l�Environnement. Conformément à ces articles, les maîtres d�ouvrage sont tenus de réaliser des études particulières sur la santé et le coût social dès lors qu�un projet d�aménagement ou d�occupation des sols présente des impacts significatifs pour l�environnement.
La circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 définit le contenu des études Air et Santé, qui se veut plus ou moins conséquent selon les enjeux du projet en matière de pollution de l�air. Quatre niveaux d�étude sont ainsi définis en fonction des niveaux de trafics attendus au niveau du projet et de la densité de population à proximité du projet.
� Niveau d�études à effectuer
Compte tenu des trafics attendus à la mise en service de l�opération (inférieur à 10 000 véh/j), de la densité de population présente de part et d�autre du projet (≤ 2 000 hbts/km2), une étude air et santé de niveau III est nécessaire selon la réglementation.
Trafic à l�horizon d�étude23 et densité hab./
km2 dans la bande d�étude
> 50 000 véh/jou
5 000 uvp/h
25 000 véh/j à 50 000 véh/j
ou 2 500 uvp/h
à 5 000 uvp/h
≤≤≤≤ 25 000 véh/jou
2 500 uvp/h
≤≤≤≤ 10 000 véh/j ou
1 000 uvp/h
G I Bâti avec densité
≥≥≥≥ 10 000 hab./ km2 I I II
II si L projet > 5 km ou III si L projet < ou
= 5 km
G II Bâti avec densité > 2 000 et < 10 000 hab./ km2
I II II
II si L projet > 25 km ou III si L projet < ou
= 25 km
G III Bâti avec densité < 2000 hab./ km2 I II II
II si L projet > 50 km ou III si L projet < ou
= 50 km
G IV Pas de Bâti III III IV
IV
Conformément à la circulaire de février 2005, une étude prévisionnelle « Air et Santé » de niveau III comprend les éléments suivants :
− estimation des émissions de polluants et de la consommation énergétique au niveau du domaine d'étude,
− rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé.
Les éléments relatifs aux émissions et à la consommation énergétique sont présentés ci-après. Le deuxième point concernant les effets de la pollution atmosphérique sur la santé est exposé au chapitre 9 « Analyse des effets du projet sur la santé humaine ».
� Evaluation des émissions et de la consommation énergétique induite par l�opération
La quantification de la consommation des carburants et des émissions des principaux polluants émis par le flux de véhicules induit par la déviation de Vayrac à un horizon donné a été réalisée à l�aide du logiciel IMPACT ADEME (version 2 - 2003) développé par l�Agence de l�Environnement et de la Maîtrise de l�Énergie, en négligeant les émissions à froid.
23 (selon tronçons homogènes de plus de 1 km)

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 120 -
La quantification de la consommation des carburants et des émissions des principaux polluants ont été menées pour trois situations :
− l�état actuel (2006),
− l�état de référence correspondant à la projection à l�horizon 2025 de l�existant,
− l�état projeté correspondant à la projection à l�horizon 2025 du projet d�aménagement de la déviation de Vayrac.
Les trafics retenus pour 2006 ont été établis d�après les données fournies par le Conseil général du Lot. Les vitesses des véhicules correspondent à celles utilisées dans l�étude bruit.
Les projections de trafics à l�horizon 2025 ont été calculées selon une hypothèse de poursuite de la croissance de 2,7% par an (croissance annuelle moyenne entre 2004 et 2008).
La déviation de la RD720 ne devrait pas induire de trafic supplémentaire à celui rencontré en 2025 sans cet aménagement. Le trafic estimé en 2025 avec la déviation de la RD720 est donc le même que celui estimé sans le réaménagement la RD720. Seules les vitesses moyennes des véhicules seront modifiées par cet aménagement.
Les vitesses moyennes, sur le projet, ont été évaluées dans le cadre de l�étude bruit. L�étude air reprend ces mêmes vitesses. Les vitesses moyennes sur la route actuelle à l�horizon 2025 sont identiques à l�existant.
Les données de base nécessaires à l�utilisation du logiciel sont :
− l�horizon d�étude : 2025,
− le flux de véhicules : 5 070 véh./j (TMJA 2025) dont 5,7% de poids lourds,
− la vitesse moyenne de circulation :
� à l�état de référence :
� 50 km/h pour les VL et 40 km/h pour les PL dans la traversée de St Michel de Bannières et de Vayrac,
� 90 km/h pour les VL et 80 km/h pour les PL sur le reste du tracé actuel.
� à l�état projeté :
� 90 km/h pour les VL et 80 km/h pour les PL sur le tracé futur,
− la longueur du tronçon de voirie étudié :
� à l�état de référence :
� 2,6 km correspondant au tracé actuel,
� à l�état projeté :
� 2 km correspondant à la déviation de Vayrac.
Concernant l�état projeté, la modélisation est effectuée sur la base des deux hypothèses suivantes :
− la totalité des véhicules empruntent la déviation (correspondant à l�état projeté 2),
− 50% des véhicules empruntent la déviation et 50% empruntent la RD720 actuelle passant par Vayrac (correspondant à l�état projeté 2�).

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 121 -
Les émissions estimées pour les différents polluants sont les suivantes :
Émission des polluants indicateurs majeurs
Conso.
énergétiqueCO2 CO NOx Particules SO2 COV Benzène
en g/jour
Etat actuel 2006 (0) 601 628 1 874 109 13 591 7 262 458 48 1 580 52
Etat de référence (1) 666 838 2 088 614 5 950 5 736 342 53 769 17
Comparaison (1) / (0) +11% +12% -56% -21% -25% +10% -51% -67%
Etat projeté (2) � 100% empruntent la déviation
483 565 1 515 033 3 873 4 198 280 39 499 12
Comparaison (2) / (0) -20% -19% -72% -42% -39% -19% -68% -77%
Etat projeté (2�) � 50% empruntent la déviation
575 006 1 801 210 4 911 4 966 311 46 634 15
Comparaison (2�) / (0) -4% -4% -64% -32% -32% -4% -60% -71%
(2) � (1) (en g/jour) -183 273 -573 581 -2 077 -1 538 -62 -14 -270 -5
Comparaison (2) / (1) -27% -27% -34% -27% -18% -26% -35% -29%
(2�) � (1) (en g/jour) -91 832 -287 404 -1 039 -770 -31 -7 -135 -2
Comparaison (2�) / (1) -14% -14% -17% -13% -9% -13% -18% -12%
Émission des polluants métalliques
Plomb Cadmium
en g/jour
Etat actuel 2006 (0) 0.43 0
Etat de référence (1) 0.28 0
Comparaison (1) / (0) -35% -
Etat projeté (2) 0.18 0
Comparaison (2) / (0) -58% -
Etat projeté (2�) 0.22 0
Comparaison (2�) / (0) -49%
(2) � (1) (en masse/jour) -0.1 0
Comparaison (2) / (1) -36% -
(2�) � (1) (en masse/jour) -0.06 0
Comparaison (2�) / (1) -21%
D�après les résultats présentés précédemment, on constate :
− par comparaison des bilans obtenus pour 2006 et pour 2025 sans déviation de Vayrac, que :
� l�ensemble des émissions des polluants indicateurs majeurs du trafic automobile (excepté CO2
et SO2 n�étant pas normalisés) va diminuer, du fait des évolutions technologiques,
� les bilans globaux pour la consommation énergétique et le CO2 augmentent d�un peu plus de 10% ; la hausse des émissions de ce gaz est directement liée à l�augmentation globale du trafic, et donc à la consommation énergétique,
� les émissions des éléments métalliques (plomb et cadmium) devraient rester stables ou diminuer dans des proportions variables.
− par comparaison des bilans obtenus entre 2006 et 2025 avec déviation de Vayrac, l�ensemble des émissions des polluants diminue notamment en raison de la diminution du linéaire du nouveau tracé.
Ces résultats montrent que malgré une augmentation considérable du trafic, le renouvellement du parc automobile est le premier facteur de réduction des nuisances atmosphériques pour les polluants indicateurs majeurs sur le moyen et long terme, excepté pour le CO2.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 122 -
La comparaison des situations 2025 avec et sans déviation de Vayrac indique que le linéaire de la déviation de Vayrac étant plus court, celle-ci permettra une réduction des émissions des différents polluants selon la substance envisagée de 18 à 36%.
En situation réelle, la diminution des émissions exprimées ci-dessus ne sera pas aussi importante puisque certains véhicules continueront à emprunter la RD720 actuel qui dessert le bourg de Vayrac. En considérant que seulement la moitié du trafic emprunte la déviation, les émissions sont malgré tout largement inférieures à la situation de référence, avec une diminution des émissions comprise entre 9 et 21%.
On peut donc conclure que du fait d�un linéaire moins important, plus les usagers emprunteront la déviation de Vayrac, plus les émissions de polluants diminueront.
Le projet de déviation de Vayrac a donc un impact positif sur la qualité de l�air par rapport à la traversée de Vayrac actuelle.
Néanmoins, le projet aura un impact sur la qualité de l�air au droit de la déviation de Vayrac, à l�heure actuelle non soumis aux émissions de polluants. L�impact est cependant négligeable en raison du faible nombre d�habitation se trouvant au droit du tracé en comparaison avec l�itinéraire actuel.
7.2. IMPACTS RELATIFS À L�ENVIRONNEMENT URBAIN ET SOCIO ECONOMIQUE
7.2.1. Activités agricoles
Sur l�ensemble du tracé, les impacts du projet sur l'activité agricole sont de trois ordres, à savoir :
− effets de substitution induits par l'emprise du projet sur des terrains à vocation agricole (environ 78 000 m2),
− effets de coupure des parcelles (déstructuration du parcellaire),
− intersection des accès et des cheminements agricoles.
7.2.2. Activités non agricoles
La déviation de Vayrac aura surtout un effet bénéfique sur l'économie locale. En effet, en améliorant les conditions d'accessibilité et, par conséquent, en accentuant l'attractivité de la zone, le projet peut stimuler un développement économique et favoriser l'installation de nouvelles entreprises. Enfin, le potentiel touristique de la région sera valorisé par de meilleures conditions d'accessibilité.
L�opération est susceptible d�exercer des emprises sur des espaces privatifs.
7.2.3. Bâti
Globalement, le projet aura un impact positif sur l�habitat puisqu�il permet d�améliorer le cadre de vie des habitations situées le long de l�actuelle RD720 (bourg de Vayrac notamment).
Le report du trafic de transit sur la nouvelle voie contribuera en effet à réduire les nuisances causées par l�actuelle RD720 (bruit, pollution atmosphérique, poussières, vibrations, insécurité, �).
Toutefois, l�aménagement entraîne la démolition de quelques immeubles situés dans les emprises du projet ou à proximité, à savoir :
− une construction agricole de faible surface située dans les 1ères pentes du coteau dominant le vallon de la Sourdoire et du Maumont,
A ce jour, cette contruction n�est toujours pas propriété du Conseil général du Lot.
En outre, le projet aura un impact indirect en modifiant l'environnement proche des habitations situées à proximité de l�opération. Du plus contraignant au moins contraignant, ils peuvent être classés comme suit :
− nuisances sonores et vibrations liées au passage des véhicules (notamment les poids lourds),
− gênes visuelles, cet aspect rejoint l�impact paysager traité dans une partie spécifique,
− pollutions de l�air, poussières et odeurs.
7.2.4. Ambiance sonore
Au vu des habitations présentes au droit de la future déviation de Vayrac, une étude acoustique prévisionnelle a été réalisée par le bureau d�études INGEROP en mars 2006.
Afin d�évaluer l�impact sonore de l�opération dans sa configuration future, il a été réalisé une modélisation acoustique de l�ensemble du site.
Les calculs ont été réalisés à l�aide du logiciel Artemis version 4.1. Les niveaux sonores continus équivalents ou LAeq en avant des façades des habitations ont été estimés à partir de la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB 96). Cette méthode prend en compte le bâti, la topographie du site, les données des trafics routiers ainsi que tous les phénomènes propres à la propagation des ondes sonores (réflexion, absorption, effets météorologiques, �).
� Conditions météorologiques
Dans le strict cadre réglementaire, la prise en compte des effets météorologiques est obligatoire pour les bâtiments situés au-delà de 250 m de la voie. Par souci de continuité de traitement du bâti riverain, les calculs ont été effectués pour tous les bâtiments en conditions dites « favorables » à la propagation du bruit soit avec des valeurs d�occurrences météorologiques forfaitaires de 50 % en période diurne et de 100 % en période nocturne. Cette option va dans le sens de la sécurité puisqu�elle a tendance à surestimer les niveaux sonores calculés.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 123 -
� Hypothèses de trafic
Les trafics intégrés dans le modèle sont ceux prévisionnels à l�horizon 2029.
Le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) empruntant la RD720 pour l�année 2004, est de 3 273 véhicules par jour dont 5.7% de PL.
Le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) empruntant la RD720 pour l�année 2029, avec et sans mise en service de la déviation, est estimé à 5 500 véhicules par jour dont 5.7% de PL. Il est obtenu en appliquant une croissance annuelle de 2,7% par an au trafic 2004.
La répartition jour/nuit de ce trafic est obtenue en appliquant aux TMJA la répartition moyenne constatée du 6 au 26 décembre 2005 (comptage routier). On obtient donc un Trafic Moyen Horaire Annuel sur la RD720 avec et sans aménagement décomposé comme suit :
Répartition constatée jour (06H -22H) nuit (22H - 06H)
Type de véhicule VL PL VL PL
Trafic journalier 95.4 % 94.4 % 4.6 % 5.6 %
ANNEE 2028 jour (06H -22H) nuit (22H - 06H)
Type de véhicule VL PL VL PL
Trafic horaire 309 19 30 2
� Ecoulement du trafic
Les allures et les vitesses de circulation influent sur l�émission des nuisances sonores. On propose de prendre en compte une vitesse de 90 km/h pour les VL et 80 km/h pour les PL et ce, avec un écoulement de type fluide.
� Rappel de la réglementation
Dans le cas d�un projet routier neuf, la contribution sonore de la route nouvelle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Nature des locaux
Niveau sonore ambiant initial
(avant réalisation de la voie nouvelle)
Contribution sonore de la seule route nouvelle (LAeq)
6h - 22 h
(diurne)
22h - 6h
(nocturne)
Logements
modéré de jour et de nuit 60 dB(A) 55 dB(A)
non modéré de jour et modéré de nuit
65 dB(A) 55 dB(A)
modéré de jour et non modéré de nuit
65 dB(A) 60 dB(A)
non modéré de jour et de nuit
Bureaux modéré de jour et de nuit 65 dB(A) aucune
autres cas aucune obligation obligation
L'étude acoustique prévisionnelle fournit une estimation des niveaux sonores perçus par les habitations les plus proches sur la déviation de Vayrac à l�horizon 2029.
Toutes les habitations situées à proximité de la future déviation de Vayrac étant initialement en zone d'ambiance sonore modérée, les niveaux sonores en façade après réalisation de la déviation ne doivent pas dépasser 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 124 -
Planche 12 : mesures compensatoires en faveur de l�eau

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 125 -
7.2.5. Documents d�urbanisme
Les aménagements projetés sur la commune de Vayrac traversent essentiellement des zones A (agricoles). L�extrémité Sud du tracé (sur environ 400 m et autour du carrefour giratoire d�Issartoux) se situe en zones UI (zone d�activités) et N (zone naturelle).
Un emplacement réservé (n°1) a été arrêté pour la déviation de Vayrac dans le PLU en date de décembre 2007, au bénéfice du Conseil général du Lot. Son emprise n�était pas suffisante et nécessitait donc une modification pour être rendue compatible avec le projet retenu.
Cette modification a été effectuée lors de la réalisation de l�enquête publique portant sur la première partie du programme, à savoir, le projet d�aménagement sur place entre Saint-Michel-de-Bannières et Vayrac. Cette enquête publique, réalisée préalablement à la présente, a déjà permis donc de rendre compatible le projet de déviation de Vayrac avec le PLU de la commune.
Le projet n�a pas de conséquence sur le développement actuel de l�urbanisation, qui n�ait pas déjà été prévue dans le cadre du PLU de Vayrac.
7.2.6. Réseaux
Le projet est concerné par des réseaux (eau potable, réseau téléphonique, réseau électrique, �), situés sous les emprises du projet ou à proximité.
7.2.7. Trafic et sécurité
L�amélioration des conditions de déplacement constitue un des principaux objectifs du projet. L�aménagement facilitera en effet les communications aux échelles régionale et locale :
− à l�échelle régionale, la nouvelle voie offrira au trafic de transit un itinéraire confortable et fluide s�affranchissant des problèmes de circulation que posaient la traversée de Vayrac où la RD720 était la rue principale du bourg,
− à l�échelle locale, la RD720 actuelle sera délestée du trafic de transit. Elle assurera la desserte des riverains et les communications locales s�effectueront indépendamment du réseau de transit.
La déviation de Vayrac permettra, en outre, d�améliorer la sécurité routière :
− tous les accès directs sur la voie nouvelle seront interdits. Les rétablissements des voies de communications se concentreront au niveau des carrefours plans prévus. Les habitations seront désenclavées par des voies parallèles. Ainsi, les risques de collision au droit des intersections seront supprimés,
− la séparation des trafics de transit et d�échange local, aux comportements différents, limite les risques de collision entre usagers.
Les riverains de l�actuelle RD720 ainsi déviée (bourg de Vayrac) bénéficieront d�une meilleure sécurité grâce à la suppression du trafic de transit et notamment des poids lourds.
Le projet interfère avec l'actuelle RD720 et le réseau de voies de communication locales (voies communales et chemins agricoles) assurant la desserte des hameaux et des terres agricoles.
Il convient de noter que le chantier génèrera des impacts temporaires positifs en matière de socio-économie. Ainsi le personnel du chantier génèrera une augmentation de consommation dont bénéficiera l'économie locale (hébergement, restauration, �) pendant toute la durée des travaux.
7.3. IMPACTS RELATIFS AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE
7.3.1. Contraintes patrimoniales
7.3.1.1. Monuments historiques
La déviation de Vayrac déviera les flux de circulation du périmètre de protection de l�église de Vayrac.
7.3.1.2. Archéologie
Les travaux projetés, se situant dans un secteur propice aux vestiges archéologiques, sont susceptibles d�affecter des éléments du patrimoine archéologique.
7.3.2. Paysage
Les modifications paysagères engendrées par le projet seront importantes, compte tenu du relief accidenté et de l'importance des terrassements.
− Après le carrefour plan simple, la voie descend les coteaux de la dernière terrasse de la Dordogne. La voie est en déblai dans un relief relativement mouvementé. Des parcelles de vergers bordent la voie.
− Ensuite, la voie traverse l�espace de la vallée du Maumont et de la Sourdoire où les vues sont limitées aux lignes boisées accompagnant ces deux ruisseaux. Les talus de déblais disparaissent progressivement et la voie est en remblai avant de se raccorder sur le giratoire Est de Vayrac. Ce giratoire s�inscrit en limite de l�espace vallée du ruisseau du Maumont, mais en limite également d�une zone marquée par une urbanisation de type industriel.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 126 -
7.4. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL
7.4.1. Introduction
Il s�agit de présenter de manière générique les effets écologiques avérés et potentiels sur les milieux naturels, la flore et la faune, en prenant en compte les effets directs et indirects, temporaires ou permanents, en phase travaux ou d�exploitation d�un projet d�aménagement. Les effets désignent la conséquence objective du projet sur l�environnement (Corieaulys et al., 2009). Ils sont évalués en confrontant les caractéristiques écologiques du site avec les modalités techniques des travaux et de la phase d�exploitation. Les impacts désignent la transposition de cette conséquence (effet) en fonction d�une échelle de valeur : sensibilité ou enjeux (Corieaulys et al, 2009).
Enjeux Effets
Impacts
Il faut noter que les effets décrits ci-dessous peuvent affecter les espèces et écosystèmes de manière isolée mais ils sont fréquemment associés et peuvent alors agir de manière synergique. Dans ce cas, les impacts réels peuvent atteindre un niveau supérieur à la somme des impacts individuels. De même, les effets peuvent avoir des conséquences variables selon l�échelle considérée : habitat, écosystème, paysage, etc. Les principaux effets du projet sur l�environnement concernent la perte, la dégradation et la fragmentation de l�habitat (et la perte de biodiversité associée), ainsi que l�augmentation de la mortalité de la faune du fait du trafic routier, etc.
� Effets généraux
� Destruction ou dégradation d�habitats naturels (formations végétales)
Le projet routier engendre trois principaux types d�impacts :
- une destruction directe et irréversible des habitats au droit de l�emprise et des équipements (bassins de rétention par exemple) ;
- une destruction temporaire des habitats au droit de la zone travaux si ces derniers peuvent être restaurés en fin de chantier ;
- une destruction ou une dégradation indirecte, réversible ou non, des habitats situés aux abords de l�infrastructure, liée à des modifications de conditions écologiques (assèchement d�une zone humide par exemple).
Ces effets peuvent être permanents ou temporaires compte tenu des possibilités de réhabilitation écologique si la nature de l�habitat s�y prête. L�importance des impacts dépendra notamment de la surface concernée et du type de milieu existant : par exemple on considère que la perte d�une zone humide est plus dommageable que celle d�une culture compte tenu de son importance écologique. Le défrichement provoque une modification brutale des conditions microclimatiques qui engendrera des effets directs sur les arbres situés après travaux en lisière mais auparavant au sein des boisements. En particulier, on observe :
- un risque plus élevé de chute d�arbres et de bris de branches ;
- la levée de la dormance des bourgeons latéraux présents sur le tronc qui donnent des petites branches appelées accrus ou gourmands suite à leur mise en lumière brutale. Ils consomment la sève au détriment des branches sommitales pouvant ainsi entraîner une descente de cime ;
- une exposition plus grande au froid (gel hivernal ou gelée printanière tardive) qui peut entraîner un dépérissement partiel ou total de l�arbre notamment pour le Chêne pédonculé ;
- une fréquence accrue des bris de branches sous le poids de la neige, du givre ou du verglas.
Avec le temps, ces risques de chablis ou de dépérissement s�atténueront compte tenu de l�adaptation progressive des arbres aux nouvelles conditions stationnelles. Par ailleurs, les arbres situés à proximité immédiate du chantier seront exposés à un certain nombre de perturbations :
- blessures des troncs à la suite de coups donnés par les engins circulant sur le chantier ;
- chocs sans blessure mais pouvant couper des racines ;
- tassement du sol ;
- remblaiement du collet et de la base du tronc ;
- coupure de racines par déblai ou creusement de tranchées ;
- déversement de gravats, de fioul ou d�autres produits nocifs ;
- feux allumés à proximité immédiate du tronc.
La plupart de ces impacts pourront être réduits, voire supprimés, si des mesures adéquates sont prises lors des chantiers.
Si des boisements compensatoires sont prévus, des précautions doivent être prises quant au choix de leur localisation et des espèces (risque d�introduction d�essences exotiques ou envahissantes). En effet, l�implantation de ces derniers peut induire la destruction et/ou la dégradation possible d�habitats remarquables (pelouses calcicoles, prairies, etc.) ou d�habitats d�espèces d�intérêt patrimonial.
� Destruction ou dégradation d�habitats d�espèces animales
Il s�agit des sites de reproduction, de recherche alimentaire, d�hivernage, de halte migratoire, les abris, etc. L�impact est d�autant plus élevé que les espèces et les habitats d�espèces concernés sont rares et menacés dans la région considérée. Concernant les chauves-souris, le déboisement et la disparition des haies peuvent perturber les routes de vol et limiter ainsi l�exploitation des territoires de chasse. Les effets décrits dans le paragraphe précédent sont susceptibles d�affecter la faune associée à ces milieux.
� Destruction d�espèces végétales
C�est le cas lors de la destruction d�habitats, mais également lorsque le projet entraine une dégradation du milieu (même si celui-ci n�est pas directement impacté) ou impacte des processus nécessaires à la viabilité des populations. Les impacts dépendent de l�importance des populations et du niveau de rareté des espèces détruites.
� Destruction d�espèces animales
Cela concerne principalement les espèces et individus peu mobiles (chiroptères au gîte, reptiles et amphibiens, invertébrés, petits mammifères, individus hibernant, jeunes, etc.). Les impacts dépendent du nombre et du niveau de rareté des espèces détruites. Certaines espèces pionnières ou vagabondes sont en outre susceptibles de coloniser les milieux remaniés lors de la phase travaux. Pour ces espèces, le risque de destruction est donc accru.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 127 -
� Dérangement de la faune
Le dérangement dû aux travaux (présence humaine, bruit, poussière, etc.) peut induire un abandon du site par les espèces les plus sensibles. L�impact du dérangement varie selon le degré de perturbation et les espèces considérées.
� Artificialisation des milieux
Les travaux liés au projet vont entraîner une forte perturbation des milieux se traduisant notamment par la perturbation physique du substrat (remaniement et tassement du sol, changement dans la microtopographie, ou le fonctionnement hydrologique, etc.), la rudéralisation et l�eutrophisation des milieux, l�imperméabilisation du sol au droit du projet, etc. Ces bouleversements risquent de favoriser les espèces envahissantes, opportunistes, rudérales, nitrophiles, (etc.), et une banalisation de la faune et de la flore. Les effets sur les espèces peuvent être importants et durables, même en cas de réhabilitation du milieu (d�autant plus délicate que le milieu est perturbé). L�utilisation éventuelle de cultivars horticoles pour végétaliser les talus générerait une banalisation et une artificialisation végétale et paysagère par opposition à l�utilisation d�espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques du site. Afin de diminuer cet effet, des préconisations portant sur la nature des essences indigènes seront développées dans les paragraphes ultérieurs. D�autre part, l�installation artificielle d�une flore empêche l�installation spontanée de certaines espèces peu concurrentes à valeur patrimoniale forte. Suivant la nature des matériaux utilisés pour les remblais, une artificialisation et une dégradation des milieux peuvent être attendues. L�importance de ces effets dépendra en partie des différences entre les matériaux utilisés et les caractéristiques locales du sol.
� Risques liés aux espèces invasives
Les perturbations décrites précédemment sont en outre susceptibles de favoriser la prolifération d�espèces (surtout des plantes) exotiques invasives. Celles-ci constituent une menace pour les écosystèmes et les espèces, voire pour la santé humaine (Ambroisie).
� Risques de pollution
En phase chantier, l�utilisation d�engins entraîne un risque de pollution (huiles de vidange, etc.) du milieu en cas de fuite.
� Risques liés aux aménagements fonciers
Une dégradation des milieux environnants peut intervenir notamment par le biais d�impacts indirects et induits entraînant une perturbation des processus écologiques, des changements dans la gestion et l�utilisation du milieu, etc. Les perturbations des écoulements d�eau notamment peuvent entraîner des impacts notables sur les milieux environnants. L�impact indirect principal peut résulter des opérations de réorganisation foncière éventuellement engagées pour compenser l�impact du projet routier sur les exploitations agricoles. Ces aménagements fonciers peuvent avoir des conséquences bien supérieures à celles engendrées directement par la construction de l�infrastructure. Les principaux impacts indirects liés aux opérations de réorganisation foncière induites par le projet routier peuvent concerner :
- la régression des espaces prairiaux extensifs (retournement et mise en culture des prairies, augmentation de la pression de pâturage, etc.) ;
- la régression des zones humides (drainage, remblaiement, etc.) ;
- l�abandon des pratiques agro-pastorales traditionnelles entraînant la fermeture des milieux par embroussaillement ;
- la disparition des haies bocagères en tant que supports de biodiversité, corridors biologiques et éléments structurants du paysage.
La consommation d�espaces naturels peut également résulter :
- de travaux d�emprunts ou de dépôts de matériaux en dehors de la zone d�emprise du projet ;
- du développement local de l�urbanisation (zones d�activités).
� Effets spécifiques à un projet de route (cf. Forman & Alexander, 1998 ; Spellerberg, 1998 ; Seiler, 2001 ; Coffin, 2007)
Il faut noter que le projet s�inscrit au sein d�un réseau routier existant et que ses effets vont donc s�ajouter à ceux des autres routes du secteur. Il existe donc des effets cumulatifs qui seront particulièrement sensibles pour la fragmentation et la mortalité.
Représentation schématique des principaux effets des routes (adapté de Seiler, 2001)
� Perte et dégradation d�habitat
Dans le cas d�infrastructures linéaires comme les projets routiers, les surfaces affectées par la perte et la dégradation de l�habitat sont très supérieures à la surface de l�emprise au sens strict. Selon les critères considérés, ces effets peuvent être restreints aux abords immédiats de la route ou sensibles jusqu�à plusieurs centaines de mètres. Les aménagements routiers engendreront notamment une modification de la composition floristique en bordure des voies. Les principales causes sont la modification des conditions microclimatiques (vents, éclairement, température), en particulier en lisière des boisements traversés, et la modification des caractéristiques du sol :
- minéralisation de l�humus accélérée sur les lisières forestières sous l�effet de l�augmentation de lumière et de chaleur. L�accroissement de l�activité des micro-organismes met à disposition des plantes une quantité plus grande d�éléments nutritifs (azote en particulier) ;
- assèchement ou engorgement des sols par modification du niveau de la nappe phréatique à la suite des terrassements (déblais ou remblais) ;
- perturbations pendant les travaux (tassements par les engins, pollutions, etc.) ;
- modifications des écoulements des eaux superficielles ;
- création de surfaces nouvelles (sans végétation) ou remaniées : emprunts, talus, dépôts de matériaux, etc. ;
- apport de substances nouvelles dans le milieu (air, sol, eaux) : sels, hydrocarbures, oxydes d�azote, particules diverses, etc.
L�évolution des groupements forestiers vers « l�Ormaie rudérale » est un phénomène fréquent en bordure des routes. L�apparition des plantes du cortège floristique de l�Ormaie rudérale est favorisée par l�augmentation de l�azote disponible dans le sol.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 128 -
Une rudéralisation progressive des abords de l�infrastructure peut aussi être attendue du fait qu�ils sont souvent utilisés comme décharges sauvages. Il faut en outre noter que certains des impacts décrits ci-dessous peuvent entraîner directement ou indirectement une perte d�habitat pour la faune.
� Fragmentation de l�habitat
La fragmentation s.s. (cf. Fahrig, 2003) consiste en la « séparation » d�habitats en plusieurs taches d�habitats se caractérisant par une surface plus petite, un isolement et une lisière plus importants. La fragmentation est couramment associée à la perte d�habitat, leurs effets étant d�ailleurs fréquemment confondus. Dans certains cas, les effets de la perte d�habitat et de la fragmentation peuvent intervenir de manière synergique et avoir une importance accrue. La fragmentation de l�habitat constitue probablement l�un des principaux impacts écologiques des routes. Les impacts varient en fonction de la structure du paysage, des espèces considérées, de la nature (route, caniveaux, etc.) et donc de la perméabilité des barrières, ainsi que de leur localisation.
- La diminution de la taille des parcelles d�habitat peut entraîner la disparition des populations ayant besoin de grandes surfaces ;
- L�isolement des taches d�habitat entraîne une baisse de la connectivité entre sous-populations (effet barrière) avec une diminution des échanges et de la probabilité de colonisation/recolonisation des habitats (donc un risque d�extinction accru) ; il s�agit là d�un des principaux effets de la fragmentation par les routes dans le contexte étudié. La baisse de la connectivité résultant de l�isolement des milieux par la route peut être due :
- à des modifications comportementales pour les déplacements ou la dispersion ; de nombreuses espèces dépendent en effet fortement de la structure du paysage (perméabilité et configuration spatiale) pour se déplacer et la route est considérée par beaucoup de taxons comme une barrière ;
- à une mortalité accrue lors du passage.
La fragmentation provoque donc une rupture des continuités biologiques avec d�une part un isolement des populations pouvant conduire à leur extinction (problème d�appauvrissement génétique, etc.) et, d�autre part, une réduction ou un isolement des différents compartiments du domaine vital utilisés à différentes étapes du cycle biologique (par exemple, chez les amphibiens, le projet peut s�intercaler entre les habitats terrestres et les sites de reproduction).
� Mortalité de la faune par collision avec les véhicules
Ce risque est plus ou moins élevé selon les groupes faunistiques, certains étant particulièrement vulnérables : rapaces nocturnes, certains chiroptères (notamment rhinolophes), carnivores, Hérisson d�Europe, amphibiens et reptiles, certains insectes (papillons, libellules), etc. Cette mortalité peut avoir des conséquences significatives, lorsqu�elle concerne des espèces rares ou qu�elle atteint une proportion importante des effectifs locaux (amphibiens, grands mammifères, etc.). Dans certains cas, la route peut jouer un rôle de piège écologique, par exemple pour les espèces qui cherchent leur alimentation le long des routes (risque de mortalité par collision), etc. Il faut noter que les caniveaux peuvent également constituer des pièges pour de nombreuses espèces.
La configuration des haies et lisières de part et d�autre de la route peut également influencer l�importance de la mortalité routière. Lors de configurations peu favorables, il peut y avoir une augmentation de la mortalité si les animaux sont orientés vers la route (haies perpendiculaires, absence d�ouvrages adaptés, etc.). Une attention particulière doit donc être portée à la configuration spatiale des aménagements paysagers et plantations compensatoires.
� Pollutions
La création de la route entraînera diverses pollutions chimiques chroniques (gaz d�échappement, hydrocarbures, poussières, particules, métaux lourds, etc.), saisonnières (salage) ou accidentelles (déversement de produits toxiques). La circulation automobile est à l'origine de plusieurs dépôts polluants : hydrocarbures (huile et essence), oxydes d'azote (issus des gaz d'échappement), chlorures (sels de déverglaçage), métaux provenant de l�usure des pneus (zinc, cadmium), des freins (cuivre) ou de la chaussée (érosion de revêtements en bitume, zinc des glissières de sécurité). Ces polluants pourront entraîner une toxicité sur la végétation ainsi qu�une eutrophisation des abords. Ces effets sont surtout sensibles aux abords immédiats des routes; les polluants peuvent cependant diffuser dans une certaine mesure à distance des routes (par exemple jusqu�à 150 m pour des métaux lourds). Les pollutions phoniques peuvent affecter diverses espèces, en particulier celles pour lesquelles, l�ouïe et/ou la communication sonore joue un rôle important. Ainsi, une diminution locale des densités d�oiseaux chanteurs peut être attendue, par exemple à cause de difficultés pour attirer un conjoint. Des modifications comportementales peuvent aussi subvenir. Les chiroptères sont aussi affectés par le bruit, en particulier les espèces chassant par « écoute passive », comme le Grand Murin (Myotis myotis), avec pour conséquence une moindre fréquentation des abords des routes (Schaub et al., 2008). La pollution lumineuse entraîne également un dérangement local des espèces, en particulier des oiseaux nocturnes, des chiroptères et des insectes. Ses effets peuvent être localement significatifs et entraîner par exemple, l�abandon de gîtes, de terrains de chasse ou de routes de vol.
� Habitat et corridor
Les bords de route constituent des habitats et possiblement des corridors pour certaines espèces. Ces nouveaux milieux pourront être colonisés par certaines espèces : Lézard des murailles, orthoptères, etc. Néanmoins, il s�agit essentiellement d�espèces communes, généralistes, opportunistes et/ou profitant d�une dégradation du milieu (espèces rudérales ou nitrophiles, etc.). Les infrastructures linéaires favorisent aussi la progression des espèces invasives. Ce phénomène est d�autant plus prégnant lorsque l�infrastructure pénètre dans des espaces peu anthropisés.
� Dérangement de la faune
Le trafic routier entraîne un dérangement important de la faune sauvage, du fait du bruit, des diverses pollutions, de la présence de véhicules, etc. Ces effets ont surtout été étudiés chez les oiseaux et mammifères. Ils peuvent notamment entraîner une diminution de la fréquentation, de la diversité s.l., de la densité, du succès de reproduction (etc.) à proximité des routes, particulièrement chez les espèces sensibles aux perturbations et/ou au stress.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 129 -
7.4.2. Impacts sur les habitats
L�ensemble de ces mesures ne permet pas de réduire de manière significative l�impact sur la zone humide. Les impacts résiduels restent donc assez forts sur la prairie humide en rive droite du Maumont, et faibles à moyens ailleurs. Une mesure de compensation est prévue, l�acquisition et la restauration de 10 ha de zone humide.
Unités de végétation
Valeur écologique Effet Effet Intensité de l�Impact
avant mesures Mesures Impact résiduel Mesures de
compensation
Végétation associée aux cultures
Globalement faible Faible
Faible superficie détruite et habitat pouvant se reconstituer après remise en culture de la zone travaux
0.09 ha impactés sur 4.89 ha inclus dans la zone d�étude, soit 1.8% impactés
1.6
ha
de
zon
e h
um
ide
dét
ruit
e
Faible
- le stockage de la couche superficielle du sol lors des travaux, afin de la régaler sur les
nouveaux talus pour favoriser la reconstitution de la végétation. Cette mesure
fera l�objet d�une clause du cahier des charges environnemental et sera intégrée au PRE de l�entreprise en charge des travaux,
- le balisage et la mise en défense des secteurs sensibles,
- l�interdiction de dépôts (remblais, matériaux végétaux, etc.) dans les zones humides et les
secteurs sensibles, en particulier dans les cours d�eau et leurs ripisylves, le secteur en rive gauche de la Sourdoire et celui entre le Maumont et la haie arborée de la Rabanie.
Assez fort
Oui
Acquisition (ou conventionnement selon opportunités) de 10 ha de zones humides en ciblant
en priorité des milieux dégradés ou anthropisés
(plantations, cultures, remblais, etc.) pour les
reconvertir pour partie en mégaphorbiaies et pour partie en prairie humide
de fauche.
Cariçaies Moyenne Assez fort
Destruction directe de 0,11 ha et risque de disparition de la cariçaie du sud du fuseau
0.11 ha impactés sur 0.71 ha inclus dans la zone d�étude, soit 15.5% impactés
Moyen
Terrains en friche Globalement moyenne à localement assez
forte
Moyen
0.34 ha impactés sur 3.29 ha inclus dans la zone d�étude, soit 10.3% impactés
0.4
ha
de
zon
e h
um
ide
à va
leu
r p
hyt
o-é
colo
giq
ue
asse
z fo
rte
Moyen
Prairies humides pâturées à joncs (avec localement des suintements)
Globalement moyenne à localement assez
forte
Assez fort
Destruction minimale de 0,05 ha et risque de dégradation (assèchement, etc.) à proximité de l�emprise de la prairie du sud du fuseau (rive droite du Maumont)
0.05 ha impactés sur 7.14 ha inclus dans la zone d�étude, soit 0.7% impactés
Assez fort
Prairies humides à régime mixte pâture/fauche
Faible à localement moyenne
Assez fort
Destruction de 0,42 ha (prairie du sud du fuseau en rive gauche de la Sourdoire) avec risque d�assèchement pouvant entraîner la disparition de l�habitat
0.42 ha impactés sur 2.52 ha inclus dans la zone d�étude, soit 16.7% impactés
Moyen
Pâture thermo-atlantique, mésophile à mésohygrophiles
Globalement faible (est) à moyenne (ouest
du fuseau)
Moyen
0.36 ha impactés sur 27.36 ha inclus dans la zone d�étude, soit 1.3% impactés
Moyen
Prairies thermo-atlantiques à régime mixte pâture/fauche, mésophiles à mésohygrophiles
Globalement moyenne à localement assez
forte
Moyen
0.15 ha impactés sur 40.31 ha inclus dans la zone d�étude, soit 0.4% impactés Moyen

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 130 -
Unités de végétation
Valeur écologique Effet Effet Intensité de l�Impact
avant mesures Mesures Impact résiduel Mesures de
compensation
Chênaie-charmaie fraîche
Faible Faible
0.08 ha impactés sur 2.87 ha inclus dans la zone d�étude, soit 2.8% impactés
Faible
Haies et fourrés Moyenne Moyen
1203 m impactés sur 6520 m inclus dans la zone d�étude, soit 18.5% impactés
Moyen
- la limitation du défrichement des boisements et de l�arasement des haies au
strict minimum,
- l�interdiction de tout dépôt de matériaux en lisière de boisement, de tout allumage de feux ou d�installation d�autres sources de chaleur à proximité des lisières, de toute fixation de cordes, câbles, chaînes sans mesures de protection adéquate sur les
troncs, etc. Cette mesure fera l�objet d�une clause du cahier des charges
environnemental et sera intégrée au PRE de l�entreprise en charge des travaux,
Moyen
Oui
Plantation et restauration de corridors boisés au
sein de la zone de compensation
Chênaie thermophile
Globalement faible à localement moyenne
Faible
0.11 ha impactés sur 2.39 ha inclus dans la zone d�étude, soit 4.6% impactés
Faible - la limitation du défrichement des boisements et de l�arasement des haies au
strict minimum, Faible non
Végétation des vergers
Globalement moyenne à localement assez
forte
Moyen
0.27 ha impactés sur 9.51 ha inclus dans la zone d�étude, soit 2.8% impactés
Faible _ Faible non
Végétation des bermes de routes et chemins
Globalement moyenne Faible
Habitat pouvant se reconstituer sur les nouveaux accotements
579 m impactés sur 2629 m inclus dans la zone d�étude, soit 22% impactés
Faible _ Faible non
Végétation des mares et de la Sourdoire
Faible (mares), moyenne à localement assez forte (Sourdoire)
Faible
Risque de destruction de la mare (jouxtant l�emprise)
Sourdoire non impactée
0 ha impacté sur 0.025 ha inclus dans la zone d�étude, soit 0% impacté
Faible _ Faible non
Végétation des zones d�habitation et jardins
Faible Faible
Habitat pouvant se reconstituer sur les nouveaux accotements
0.14 ha impactés sur 7.74 ha inclus dans la zone d�étude, soit 1.8% impactés
Faible _ Faible non

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 131 -
7.4.3. Impacts sur la flore
La destruction d�habitat entraînera la disparition d�espèces remarquables localisées sous l�emprise. Les impacts sur ces espèces sont détaillés dans le tableau ci-après. Les impacts sont forts pour le Brome faux-seigle et le Crépis de Nice, du fait de la destruction de leur seule station recensée sur le site d�étude. Pour l�Orge faux-seigle, le Trèfle étalé et la Prêle des marais, les impacts peuvent être considérés comme assez forts du fait de la destruction de tout ou partie des stations et des risques de dégradation à proximité du projet. Les impacts sur les autres espèces sont nuls à moyens.
L�impact du projet sur la flore peut être considéré comme assez fort à fort, selon les espèces considérées.
Espèce Enjeu
Ecologique Effet du projet Type Durée Phase Intensité de l�Impact avant mesures
Brome faux-seigle (Bromus secalinus) � LRN (II) / R
Fort Fort
Destruction de 0,09 ha sur 0,12 ha de la station observée (risque de disparition locale de l�espèce)
Direct Permanente Travaux Fort
Crépis de Nice (Crepis nicaeensis) � DZ / R
Fort Fort
Destruction de la station Direct Permanente Travaux Fort
Aigrimoine odorante (Agrimonia procera) � R ?
Assez Fort Nul
Station non impactée - - - Nul
Orge faux-seigle (Hordeum secalinum) - R
Fort Assez fort
Destruction directe de 1,16 ha sur 2 stations sur les 4 inventoriées
Risque de dégradation (assèchement, etc.) autour des stations impactées avec risque important de disparition de la station en rive gauche de la Sourdoire
Direct Permanente Travaux Assez fort
Glycérie pliée (Glyceria notata) - R
Fort Nul
Station non impactée
Nul
Trèfle étalé (Trifolium patens) - R
Fort Assez fort
Destruction de 0,88 ha sur les trois stations Direct Permanente Travaux Assez fort
Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) � LRN (II) / AR
Assez fort Nul
Stations non impactées - - - Nul
Scrofulaire à oreillettes (Scrofularia auriculata) � LRN (II) / AR
Assez fort Nul
Station non impactée - - - Nul
Petite amourette (Briza minor) � LRR / DZ / AR
Assez fort Nul
Station non impactée - - - Nul
Euphorbe velue (Euphorbia villosa) � DZ / AR
Assez fort Nul
Station non impactée - - - Nul
Camomille romaine (Anthemis nobilis) - AR
Assez fort Nul
Station non impactée - - - Nul
Laîche ovale (Carex ovalis) - AR
Assez fort Nul
Station non impactée - - - Nul
Corroyère (Coriaria myrtifolia) - AR
Assez fort Nul - - - Nul

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 132 -
Espèce Enjeu
Ecologique Effet du projet Type Durée Phase Intensité de l�Impact avant mesures
Station non impactée
Souchet brun (Cyperus fuscus) - AR
Assez fort Nul
Station non impactée - - - Nul
Prêle des marais (Equisetum palustre) - AR
Assez fort Fort
Destruction de 0,02 ha sur 0,04 ha et risque de disparition de la station du fait de la dégradation de l�habitat
Direct Permanente Travaux Assez fort
Trèfle élégant (Trifolium hybridum subsp. elegans) - AR
Assez fort Nul
Station non impactée - - - Nul
Trèfle jaunâtre (Trifolium ochroleucon) - AR
Assez fort Nul
Stations non impactées - - - Nul
Véronique luisante (Veronica polita) - AR
Assez fort Nul
Station non impactée - - - Nul
Le Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus) - AR
Assez fort Assez fort
Destruction de la station
Cette espèce pourrait se réinstaller sur les nouveaux accotements routiers et bords de chaussée
Direct Réversible Travaux Moyen
Brome rameux (Bromus racemosus) � DZ / PC
Moyen Faible (station hors habitat principal, liée à un arrosage régulier)
Destruction de 0,02 ha sur 0,92 ha
Direct Permanente Travaux Faible
Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia) - DZ / AC
Moyen Assez fort
Destruction d�une station et de 0,67 ha sur 2,04 ha sur les deux autres stations
Direct Permanente Travaux Moyen
Gesse sauvage (Lathyrus sylvestris) � DZ / AC
Moyen Assez fort
Destruction d�une station sur les deux stations recensées
Direct Permanente Travaux Moyen
Matricaire camomille (Matricaria recutita) � DZ / AC
Moyen Assez fort
Destruction d�une station sur les deux stations recensées
Direct Permanente Travaux Moyen
Orpin reprise (Sedum telephium) � DZ / AC
Moyen Nul
Station non impactée - - - Nul

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 133 -
7.4.4. Impacts sur l�Avifaune
La phase travaux entraînera :
− un risque de destruction directe d�individus, d��ufs ou de nichées en fonction de la période de déboisement ;
− une destruction partielle de l�habitat de reproduction (8,77 ha dont 695 m de haies bocagères et 17 gros arbres). La plupart des espèces concernées sont des espèces ubiquistes des milieux boisés et systèmes bocagers ; un recul vis-à-vis de la route et une réorganisation des territoires scindés par la route peuvent être attendus pour certaines espèces, en particulier celles à petit rayon d�action ; la pérennité des populations locales n�est cependant pas remise en question pour ces espèces fréquentes et peu exigeantes. Les arbres à cavités constituent des sites de nidification pour les espèces cavernicoles (Chouettes, Pics, Rougequeue à front blanc, Huppe fasciée, etc.). Leur destruction sera donc plus problématique pour ces espèces du fait de la difficulté à trouver des sites de remplacement. Néanmoins, celle-ci devrait être limitée (466 m de haies bocagères avec gros arbres et 17 arbres). Parmi les espèces patrimoniales, seuls la Chevêche d�Athéna et le Rougequeue à front blanc sont concernés (les bosquets utilisés par le Pic mar ne seront pas impactés). L�habitat du Martin-pêcheur d�Europe ne sera impacté que de manière marginale (ripisylves et enrochement des berges).
− un dérangement temporaire en phase travaux pour l�avifaune nicheuse aux abords, qui peut cependant entraîner l�abandon du nid, en particulier pour le Faucon hobereau dont le site de nidification en 2009 se situe à 140 m de l�emprise.
La phase d�exploitation entraînera :
− un dérangement susceptible d�entraîner un évitement des abords par certains oiseaux. Ces effets devraient cependant être nuls ou faibles pour la plupart des espèces. Il est possible que le site de nidification du Faucon hobereau soit abandonné, ce qui ne remettra pas en cause sa présence locale du fait de son adaptabilité et de sa capacité à trouver d�autres sites de nidification (nids abandonnés de Corvidés ou rapaces) au sein de son territoire.
− des risques importants de mortalité par collision, essentiellement pour la Chevêche d�Athéna (2 territoires fragmentés par la route) qui présente une forte sensibilité à cet effet ; ces risques existent également mais dans une moindre mesure, pour le Martin-pêcheur, en l�absence de mesures de réduction.
Les impacts peuvent donc être considérés comme assez forts sur l�avifaune. Ils sont liés aux risques de mortalité par collision pour la Chevêche d�Athéna, ainsi que dans une moindre mesure à la destruction d�habitat et de sites de nidification (Chevêche d�Athéna, Rougequeue à front blanc, etc.) et au risque d�abandon du site du Faucon hobereau.
Espèce � Groupe d�espèces
Enjeu Ecologique
Effet du projet Type Durée Phase Intensité de l�Impact avant mesures
Cortège des Oiseaux nicheurs du bocage
Assez Fort Destruction directe d�individus, d��ufs ou de nichées en fonction de la période de déboisement
Direct Permanente Travaux Fort
Cortège des Oiseaux nicheurs du bocage Assez Fort Destruction partielle de l�habitat de
reproduction (8,77 ha dont 695 m de haies bocagères et 17 gros arbres)
Direct Permanente Travaux Moyen
Cortège des Oiseaux nicheurs du bocage Assez Fort Dérangement en phase travaux
Direct Réversible Travaux Moyen
Cortège des Oiseaux nicheurs du bocage Assez Fort Dérangement en phase exploitation
Direct Permanente Exploitation Nul à Faible
Cortège des Oiseaux nicheurs du bocage Assez Fort Mortalité par collision
Direct Permanente Exploitation Assez fort

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 134 -
7.4.5. Impacts sur la Mammolofaune
� Impacts sur les chiroptères (cf. Limpens et al., 2005 ; Nowicki et al., 2008)
Destruction de gîtes (et d�individus au gîte)
Plusieurs espèces recensées sur le secteur d�études sont arboricoles (Barbastelle, Oreillard, etc.) : elles gîtent tout ou partie de l�année dans des arbres à cavités (arbres creux, fendus, à écorce décollée, etc.). Il est possible que certains des arbres qui vont être abattus servent de gîte à ces espèces. 695 m de haies, 272 m de lisières et 70 m de ripisylves sont concernés, les secteurs présentant a priori le plus de risques étant le chemin arboré de « la Rabanie », la ripisylve du Maumont et les grands arbres isolés présents aux alentours. Ces formations sont dominées par les Chênes pédonculé et pubescent. Or, les chênes correspondent aux essences les plus utilisées en tant que gîte par les chiroptères (Tillon, 2008) et le diamètre des arbres présents sur la bande d�étude est suffisant pour accueillir des cavités favorables. Le défrichement des boisements et haies pourra donc se traduire par :
- une perte de gîtes d�hibernation, de transit ou de reproduction. La présence de chiroptères arboricoles est généralement conditionnée par l�existence d�un réseau de gîtes ; ainsi, la destruction de certains d�entre eux peut devenir problématique, même dans les cas où d�autres gîtes subsistent dans les environs. D�une façon générale, la perte d�habitat liée au projet est assez faible au vu de la surface boisée du secteur ;
- un risque élevé de destruction des individus présents, lors de l�abattage des arbres ; les effets sont d�autant plus significatifs que le défrichement s�effectue généralement en hiver. Même si les animaux survivent à l�abattage des arbres, il apparaît alors de très forts risques de mortalité (froid, épuisement, nécessité de trouver un autre gîte, etc.).
> Dans ces conditions, les effets peuvent être considérés comme assez forts pour les espèces arboricoles (Barbastelle, Noctules, etc.).
Perte de territoire de chasse
Le projet entraînera une destruction directe de 2,40 ha d�habitats boisés ou semi-boisés (haies, ripisylves, boisements et arbres isolés), constituant des territoires de chasse pour la plupart des espèces et de 1,48 ha de prairies utilisées par certaines espèces. La perte réelle d�habitat sera supérieure à l�emprise de la route, du fait des effets induits sur l�habitat à proximité de la route, de la coupure des routes de vol et des pollutions sonores (Schaub et al., 2008).
> Une perte modérée de territoire de chasse peut être attendue, du fait de l�emprise de la route et du dérangement associé. Ces effets peuvent être considérés comme moyens à assez forts selon les espèces considérées. Cette perte est en effet plus dommageable pour les espèces des milieux boisés et semi-boisés, celles à faible rayon d�action et celles se reproduisant à proximité (Murin à oreilles échancrées) que pour les espèces de haut vol.
Mortalité (cf. Lesi�ski, 2007, 2008 ; Gaisler et al., 2009). La fragmentation du paysage va entraîner un risque fort de mortalité routière pour les chiroptères. En effet, les chauves-souris utilisent les éléments structurants du paysage pour se déplacer et pour chasser. Même si une réorganisation de l�utilisation de l�espace par les chiroptères devrait suivre la création de la route, il subsistera des situations à risque au niveau des secteurs de traversée. La mortalité routière varie en fonction de nombreux paramètres, notamment de la structure du paysage, des espèces concernées et des habitats habituellement utilisés.
- Structure du paysage et insertion de la route dans celui-ci : les secteurs les plus sensibles sont ceux situés dans les territoires habituels de chasse, les routes de vol utilisées pour rejoindre ces secteurs et celles utilisées lors du transit entre les gîtes estivaux, automnaux et hivernaux. Dans ces conditions, les points noirs se situent généralement lorsque les routes coupent des corridors boisés ou rivulaires. Sept haies, deux lisières et deux ripisylves, constituant autant de corridors de transit, seront interceptées par le tracé, induisant des risques de mortalité sur tous ces secteurs. En outre, la portion sud du tracé traversant la vallée présente des risques plus importants du fait d�un passage en remblai : les chiroptères traversant à faible hauteur seront plus vulnérables que dans les passages en déblai.
- Peuplement chiroptérologique : la mortalité est généralement associée à la richesse et à l�abondance des espèces présentes, les espèces les plus fréquentes étant les plus touchées. Les espèces se déplaçant à faible hauteur ou à proximité de la végétation sont particulièrement vulnérables : ce sont notamment les Rhinolophes (qui franchissent les routes à très faible hauteur), les Oreillards et certains Murins. En tenant compte des différences de vulnérabilité entre espèces, la mortalité est proportionnelle à l�activité chiroptérologique. Le chemin arboré entre « la Rabanie » et la vallée, ainsi que la ripisylve du Maumont présentent tous deux un enjeu majeur du fait de l�abondance de chiroptères les utilisant comme corridors. De même, la présence de trois gîtes connus induit une forte fréquentation aux alentours et donc de forts risques de mortalité routière. Tous les corridors seront donc concernés : les ripisylves et le chemin arboré de « la Rabanie » du fait de leur très forte fréquentation et de la présence de gîtes (Noctule à « la Rabanie » et chiroptère indéterminé au Moulin de Censol) ; les haies et lisières du nord du fuseau du fait de la proximité de la colonie de Murin à oreilles échancrées.
- Âge : les jeunes sont plus touchés que les adultes. En effet, leur vol est moins vif et plus hasardeux que les adultes, les rendant plus vulnérables. Les premiers kilomètres entourant les colonies sont d�autant plus importants qu�ils servent à l�émancipation (apprentissage du vol et de la chasse) des jeunes. Une mortalité de Murins à oreilles échancrées en phase d�émancipation peut donc être attendue, principalement sur le nord du fuseau. Ailleurs, la présence de gîtes permet de supposer l�existence de colonies de reproduction et donc un impact possible également sur d�autres espèces.
- Période de l�année : au printemps les adultes sortent de léthargie et sont très actifs en chasse. De même la période automnale voit l�activité des chiroptères s�intensifier du fait de la proximité de la phase d�hibernation induisant une forte recherche de nourriture, de la recherche de partenaires sexuels de ces animaux et enfin de l�augmentation de la population par l�envol des jeunes (cf. paragraphe précédent). En période de reproduction, les abords des colonies de reproduction seront également sensibles du fait de la présence de femelles gestantes qui restreignent leur activité de chasse sur un périmètre plus petit.
- Trafic : la mortalité par collision augmentera avec l�augmentation du trafic, la vitesse des véhicules, le nombre de camions (du fait de leur hauteur), etc.
> La présente étude a permis de mettre en évidence une forte activité chiroptérologique au niveau des linéaires boisés. La coupure de ceux-ci par la route induit donc des situations à risque notamment pour des espèces telles que les Rhinolophes (se déplaçant à faible hauteur et très vulnérables au trafic routier) ou le Murin à oreilles échancrées lors de l�envol des jeunes (individus inexpérimentés gravitant autour de la colonie) et en période de reproduction (les femelles exploitent de manière importante les abords de la colonie). Les effets peuvent notamment être considérés comme forts pour ces espèces.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 135 -
Coupure de routes de vols
695 m de haies, 272 m de lisières et deux ripisylves utilisés par les chiroptères seront traversées par la route. La plupart ayant un enjeu très fort et deux un enjeu majeur, la création de la route aura donc un effet barrière d�autant plus important que beaucoup de chiroptères (Rhinolophes, Murins, etc.) dépendent de la structure du paysage pour leurs déplacements, en particulier des linéaires boisés (haies, lisières, chemins forestiers, ripisylves, etc.). Outre la mortalité, les modifications de la structure du paysage liées à la route sont suceptibles d�entraîner une réorganisation des territoires et voies de déplacement des espèces, ainsi qu�un isolement partiel des colonies et des territoires de chasse.
> La coupure de routes de vol aura des effets forts pour les espèces les plus sensibles à la structure du paysage (Rhinolophes, Oreillards, etc.) et pour le Murin à oreilles échancrées du fait de la proximité de la colonie.
En conclusion, les impacts peuvent être considérés comme très forts sur les chiroptères, notamment pour les Rhinolophes et le Murin à oreilles échancrées.
� Impacts sur les autres espèces de mammifères
Pour la Loutre d�Europe, l�impact du projet sera faible compte tenu de la préservation du lit mineur des deux cours d�eau et de la configuration des ouvrages de franchissement, avec la présence d�une banquette pour chaque ouvrage (risque de mortalité a priori faible).Pour les autres espèces, le projet induit principalement un dérangement temporaire en phase travaux et l�apparition d�un risque de mortalité au droit du tracé neuf. Ce risque est accentué par l�utilisation de 1340 m de caniveaux rectangulaires (dont 240 m dans un contexte de moindre enjeu) qui peuvent devenir des pièges mortels pour certains petits mammifères en l�absence de système de sortie. Ces impacts sont estimés faibles à moyens car ces espèces sont communes et ils ne remettent pas en cause la pérennité des populations ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques.
Espèce � Groupe d�espèces
Enjeu Ecologique
Effet du projet Type Durée Phase Intensité de l�Impact avant mesures
Chiroptères Fort Destruction de gîtes (et d�individus au gîte)
695 m de haies, 272 m de lisières et 70 m de ripisylves
Direct Permanente Travaux Assez Fort
(pour espèces arboricoles)
ChiroptèresFort Perte de territoire de chasse
2,40 ha d�habitats boisés ou semi-boisés et 1,48 ha de prairies
Direct Permanente Travaux Moyen à assez fort
ChiroptèresFort Dérangement en phase travaux Direct Réversible Travaux Nul à Faible
ChiroptèresFort Dérangement en phase exploitation Direct Permanente Exploitation Moyen
ChiroptèresFort Mortalité par collision Direct Permanente Exploitation Fort
Chiroptères Fort Coupure des routes de vols
695 m de haies, 272 m de lisières et deux ripisylves
Direct PermanenteTravaux &
Exploitation Fort
Autres mammifèresFort Dérangement en phase travaux Direct Réversible Travaux Faible
Autres mammifèresFort Dérangement en phase exploitation Direct Permanente Exploitation Faible
Autres mammifèresFort Piègeage par le système d�assainissement Direct Permanente Exploitation Moyen
Autres mammifèresFort Mortalité par collision Direct Permanente Exploitation Faible
Autres mammifèresFort Fragmentation des habitats Direct Permanente Exploitation Moyen

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 136 -
7.4.6. Impacts sur l�Herpétofaune
Les impacts du projet sur l�herpétofaune sont localisés principalement au sud du fuseau.
- Grenouille agile (Rana dalmatina) : destruction d�un site de reproduction de 0.08 ha (5 pontes observées) sur les 11 sites recensés (160 pontes)24 ; il s�agit d�une dépression inondée située dans une prairie du sud du fuseau, en rive gauche de la Sourdoire.
- Triton palmé (Lissotriton helveticus) : destruction d�un site de reproduction sur les sept sites recensés (même site que pour la Grenouille agile).
- Destruction de 3,31 ha d�habitat terrestre pour le Triton palmé et la Salamandre tachetée, de 9,01 ha d�habitat terrestre pour la Grenouille agile et le Crapaud commun et de 1071 mètres de boisements linéaires (haies, lisières, ripisylves) pour la Rainette méridionale.
La route aura un effet barrière sur toutes les espèces d�amphibiens du fait de son évitement (substrat hostile) et surtout de la mortalité liée au trafic routier et à l�effet piège des caniveaux. La fragmentation de l�habitat par la route entraînera un isolement (diminution de la connectivité) entre les habitats terrestres et les habitats de reproduction, ainsi qu�un isolement entre les différents noyaux de populations, qui peut aller jusqu�à remettre en cause localement la pérennité de certains sites de reproduction.
La mortalité et la fragmentation seront augmentées par l�utilisation de 1340 m de caniveaux rectangulaires (dont 240 m dans un contexte de moindre enjeu) qui peuvent devenir des pièges en l�absence de système de sortie. Etant donné le caractère unique des observations de Crapaud calamite et de Triton marbré et les incertitudes quant à leur statut, les impacts peuvent être difficilement évalués, mais devraient être modérés.
La présence de Crapaud calamite induit cependant un risque en phase travaux, du fait de sa tendance à utiliser des milieux pionniers pour sa reproduction. Les ornières créées par les engins sont alors susceptibles de constituer des pièges si le Crapaud vient s�y reproduire lorsqu�elles sont en eau. La plupart des autres amphibiens, notamment la Salamandre tachetée peuvent aussi utiliser ces milieux pionniers.
Pour les reptiles, les impacts seront principalement liés à la perte d�habitat terrestre (9.28ha) et à la mortalité routière, mais demeureront modérés du fait des enjeux faibles que présentent les taxons rencensés.
Les impacts bruts peuvent être considérés comme assez forts pour les amphibiens, notamment dans la vallée où sont situés les sites de reproduction ; ils sont principalement liés à la fragmentation de l�habitat et à la mortalité associée à la route (collision, caniveaux et effet barrière).
Espèce � Groupe d�espèces
Enjeu Ecologique
Effet du projet Type Durée Phase Intensité de l�Impact avant mesures
Amphibiens Assez Fort Destruction de site de reproduction
1 site sur 11 Direct Permanente Travaux
Assez Fort
Amphibiens Assez Fort Destruction d�habitat terrestre Direct Permanente Travaux Assez Fort
Amphibiens Assez Fort Mortalité en phase travaux Direct Permanente Travaux Assez Fort
Amphibiens Assez Fort Fragmentation des habitats Direct Permanente Exploitation Assez Fort
Amphibiens Assez Fort Piègeage par le système d�assainissement Direct Permanente Exploitation Assez Fort
Amphibiens Assez Fort Mortalité par collision Direct Permanente Exploitation Assez Fort
ReptilesFaibles Destruction d�habitat terrestre Direct Permanente Travaux Moyen
ReptilesFaibles Piègeage par le système d�assainissement Direct Permanente Exploitation Moyen
ReptilesFaibles Mortalité par collision Direct Permanente Exploitation Moyen
24 Comprend les sites avec Grenouille agile avérée et les sites à « Grenouille agile/rousse » non identifiée avec certitude.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 137 -
7.4.7. Impacts sur l�Ichtyofaune
Les impacts du projet sur l�ichtyofaune sont localisés dans la vallée de la Sourdoire et du Maumont. Les travaux dûs à la mise en place de l�enrochement entraîneront une perte locale d�habitat et un risque de destruction d�individus, ainsi qu�une dégradation de l�habitat en aval. Une éventuelle fragmentation de l�habitat par les ouvrages devrait être limitée, du fait des caractéristiques techniques du projet (hauteur des ouvrages, etc.), et la connectivité pour les poissons entre l�amont et l�aval sera conservée.
Les impacts peuvent donc être considérés comme localement assez forts (suivant l�intensité des perturbations sur le milieu aquatique).
Espèce � Groupe d�espèces
Enjeu Ecologique
Effet du projet Type Durée Phase Intensité de l�Impact avant mesures
Poissons Assez fort à Fort
Perte locale d�habitat
(enrochement) Direct Permanente Travaux
Assez Fort (localement)
Poissons Assez fort à Fort
Risque de destruction d�individus Direct Permanente Travaux Assez Fort (localement)
Poissons Assez fort à Fort
Dégradation de l�habitat en aval Direct Permanente Travaux Assez Fort
7.4.8. Impacts sur l�Odonatofaune
Les impacts du projet sur l�odonatofaune sont localisés dans la vallée de la Sourdoire et du Maumont.
- Destruction d�une petite partie d�une station d�Agrion de Mercure sur les trois recensées. La population locale est de faible taille (quelques individus observés) et la partie concernée de la station est la moins favorable : habitat de reproduction occasionnel du fait du fréquent assèchement estival du secteur. Il existe des risques d�assèchement à proximité immédiate, mais les principales sources situées plus à l�ouest ne devraient pas être impactées. En revanche, l�Agrion de Mercure étant très sensible à la fragmentation, le projet contribuera à augmenter l�isolement des populations de part et d�autre de la route. La principale station (ruisseau en rive gauche de la Sourdoire) héberge une population importante et donc peu menacée ; en revanche, les populations des sources en rive droite du Maumont seront plus vulnérables.
- Risque de destruction de la mare située au sud du fuseau et hébergeant possiblement l�Aeshna affine (Aeshna affinis).
- Perte locale d�habitat, risque de destruction d�individus et dégradation de l�habitat en aval pour les odonates des cours d�eau.
- Une éventuelle fragmentation de l�habitat par les ouvrages devrait être limitée, du fait des caractéristiques techniques du projet (hauteur des ouvrages, etc.), et la connectivité entre l�amont et l�aval sera conservée.
La surface impactée totale pour ce groupe faunistique est de 0.17 ha.
Les autres espèces d�intérêt patrimonial ne seront pas impactées directement par le projet.
Les impacts bruts peuvent être considérés comme faibles sur l�Agrion de Mercure compte tenu de l�évitement de la station principale et de la préservation de la partie la plus favorable de celle impactée (station secondaire) et moyens pour les autres espèces impactées.
Espèce � Groupe d�espèces Enjeu Ecologique
Effet du projet Type Durée Phase Intensité de l�Impact avant mesures
Odonates (particulièrement l�Agrion de Mercure)
Fort Destruction de site de reproduction
1 site sur 3 Direct Permanente Travaux
Faible
Odonates Fort Fragmentation des habitats Direct Permanente Travaux Moyen
Odonates Fort Dégradation de l�habitat Direct Permanente Travaux Moyen

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 138 -
7.4.9. Impacts sur la Lépidoptérofaune
Les impacts du projet sur la lépidoptérofaune sont localisés principalement au sud du fuseau.
- Destruction de 0,77 ha sur 2 stations de Cuivré des marais (Lycaena dispar) sur les quatre recensées (4,68 ha), avec risque de disparition de la station au sud en rive gauche de la Sourdoire et risque de dégradation de l�habitat sur l�autre station impactée (assèchement, etc.).
- Destruction directe de 1,76 ha d�habitat d�Azuré du trèfle (Cupido argiades) sur les 23,48 ha recensés.
L�Azuré du serpolet n�étant pas autochtone, il ne sera pas impacté directement par le projet. La parcelle occupée par le Damier de la succise en 2010 ne sera pas non plus impactée. Les autres parcelles concernées pourraient héberger occasionnellement cette espèce en fonction de leur utilisation, mais le Damier n�y a pas été observé. La route contribuera cependant à augmenter l�isolement des populations avec celles situées au sud du site d�étude. Les autres espèces d�intérêt patrimonial ne seront pas impactées directement par le projet.
Les impacts bruts peuvent être considérés comme forts sur les prairies humides du sud du site d�étude, qui constituent les habitats du Cuivré des marais, et faibles pour le Damier de la succise.
Espèce � Groupe d�espèces
Enjeu Ecologique
Effet du projet Type Durée Phase Intensité de l�Impact avant mesures
Cuivré des marais Fort Destruction d�habitat � Dégradation d�habitat
0.77 ha sur 4.68 ha Direct Permanente Travaux
Fort
Azuré du trèfle Moyen Destruction d�habitat
1.76 ha sur 23.48 ha Direct Permanente Travaux Faible
Autres lépidoptères (Damier, Azuré du serpolet�)
Fort Dégradation de l�habitat
Nul Direct Permanente Travaux Faible
Lépidoptères Moyen Fragmentation de l�habitat Direct Permanente Exploitation Faible
7.4.10. Impacts sur l�Orthoptérofaune
Les impacts du projet sur l�orthoptérofaune sont localisés principalement au sud du fuseau.
- Criquet des larris (Chorthippus mollis) : destruction de 1,18 ha sur 8,14 ha recensés et fragmentation de l�unique station recensée ; de plus, l�essentiel des effectifs ayant été noté au droit de l�emprise, sur le haut des prairies, la pérennité de la population n�est pas assurée.
- Barbitiste des Pyrénées (Isophya pyrenaea) : la haie où a été observée l�espèce ne sera pas impactée, mais il est possible que d�autres haies impactées hébergent cette espèce très difficile à contacter.
- Destruction directe de 0.34 ha et fragmentation d�habitat de l�Aïlipe émeraudine (Aiolopus thalassinus) et de quatre autres orthoptères peu communs et liés aux prairiies humides, dont le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) pour lequel la principale station est impactée. Ces prairies présentent également des risques de dégradation (assèchement) à proximité du projet.
Les autres espèces d�intérêt patrimonial ne seront pas impactées directement par le projet.
Les impacts bruts peuvent être considérés comme forts sur les prairies humides du sud du site d�étude et la station de Criquet des larris.

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 139 -
Espèce � Groupe d�espèces
Enjeu Ecologique
Effet du projet Type Durée Phase Intensité de l�Impact avant mesures
Criquet des larris Fort Destruction d�habitat et Fragmentation de la station
1.18 ha sur 8.14 ha
Direct Permanente Travaux Fort
Barbotiste des Pyrénées Assez fort Destruction d�habitat
Nul ou faible Direct Permanente Travaux Faible
Moyen Destruction, Dégradation de l�habitat et Fragmentation
0.34 ha
Direct Permanente Travaux Nul
Faible Destruction d�habitat
Nul Direct Permanente Travaux Nul
7.4.11. Impacts sur les Autres taxons
La Cigale rouge (Tibicina haematodes) et le Paon de nuit (Satyrium pavonia/pavoniella) ont été recensés à l�écart du projet et ne devraient pas être concernés directement. En outre des habitats favorables sont présents aux alentours. Les impacts bruts sur ces espèces peuvent donc être considérés comme faibles.
Le Grand capricorne présente des enjeux moyens, notamment dûs à son caractère saproxylique ; il est indicateur de la présence de vieux chênes montrant généralement un intérêt écologique notable (cavités pour les chiroptères, oiseaux, etc. ; autres insectes saproxyliques, etc.). Le projet entraînera la destruction de 0,95 ha de haies bocagères, bosquets et ripisylves dont 0,67 ha sur les 8,17 ha où l�espèce a été recensée. L�abattage localisé des arbres hôtes entraînera la destruction d�individus de Grand capricorne et une perte d�habitat, somme toute limitée, compte tenu de l�habitat favorable présent.
Les impacts peuvent donc être considérés comme moyens sur le Grand capricorne.
Espèce � Groupe
d�espèces
Enjeu Ecologique
Effet du projet
Type Durée Phase Intensité de
l�Impact avant mesures
Grand capricorne
Moyen Destruction d�habitat
0,67 ha de haies
bocagères, bosquets et ripisylves
sur les 8,17 ha.
Direct Permanente TravauxMoyen

INGEROP Conseil et Ingénierie Route départementale N°720 � Déviation de Vayrac Pièce E
SS149504 Mars 2014 Page - 140 -
7.5. IMPACTS PORTANT SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS OU FORESTIERS INDUIT PAR LE PROJET
La surface globale des terrains qui sera remaniée en phase travaux est estimée à 78000 m², soit 7,8 ha. Le Conseil général devrait acquérir environ 81000 m² (surface mentionnée dans le dossier parcellaire), mais certaines parcelles acquises en totalité ne seront pas remaniées dans leur intégralité et restituées après travaux aux propriétaires intéressés. Ces opérations de restructuration de parcelles agricoles seront négligeables. Elles seront affinées après la réalisation de l�enquête parcellaire. Les rétablissements d�accès aux parcelles et exploitations agricoles seront assurés depuis les voies existantes. Les surfaces d�emprise nécessaires aux rétablissements ont été prises en compte dans le dossier parcellaire.
Sur la surface du projet (cf. carte ci-après), environ 50% sont représentés par des pâtures thermo-atlantiques, mésophiles à mésohygrophiles, 20 % par des prairies thermo-atlantiques à régime mixte fauche/pâture mésophies à mesohygrophiles, 20 % de zones humides (5% de prairies humides à régime mixte pâture et fauche) et par 10 % de boisements, haies et fourrés. Ainsi, 75% des surfaces concernent la profession agricole. Ces mêmes surfaces sont conjointement très intéressantes du point de vue des milieux naturels.
La consommation de ces espaces à vocation agricole, naturelle et boisée entraînera une perturbation fonctionnelle de l�écologie du milieu induite par la fragmentation de celui-ci. Cette perturbation sera limitée dans le temps et dans l�espace par la mise en �uvre de mesures d�évitement, de réduction des impacts.