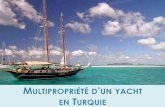Analyse de la démocratie à travers la répartition de la ... · RICHESSE NATIONALE (LE CAS DE LA...
Transcript of Analyse de la démocratie à travers la répartition de la ... · RICHESSE NATIONALE (LE CAS DE LA...
-
Analyse de la democratie a travers la repartition de la
richesse nationale : le cas de la Turquie
Irem Berksoy
To cite this version:
Irem Berksoy. Analyse de la democratie a travers la repartition de la richesse nationale : lecas de la Turquie. Droit. Universite Rene Descartes - Paris V, 2014. Francais. .
HAL Id: tel-01138099
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01138099
Submitted on 1 Apr 2015
HAL is a multi-disciplinary open accessarchive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come fromteaching and research institutions in France orabroad, or from public or private research centers.
Larchive ouverte pluridisciplinaire HAL, estdestinee au depot et a la diffusion de documentsscientifiques de niveau recherche, publies ou non,emanant des etablissements denseignement et derecherche francais ou etrangers, des laboratoirespublics ou prives.
https://hal.archives-ouvertes.frhttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01138099
-
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Ecole doctorale Sciences juridiques, politiques, conomiques et de
gestion- ED 262
UNIVERSITE MARMARA
Institut des Sciences sociales
Thse de doctorat en Droit public
soutenue le 26 novembre 2014
ANALYSE DE LA DEMOCRATIE A TRAVERS LA REPARTITION DE LA
RICHESSE NATIONALE (LE CAS DE LA TURQUIE)
rem BERKSOY
Sous la direction de
Monsieur Jacques BUISSON, Professeur mrite lUniversit Paris
Descartes (Paris 5) et Monsieur brahim KABOLU, Professeur lUniversit Marmara
Membres du jury :
Monsieur Eser KARAKA, Professeur lUniversit Istanbul,
rapporteur
Monsieur Mahmut KAIKI, Matre de confrence HDR lUniversit
Istanbul, rapporteur
-
2
RESUME: Cette tude traite de la rpartition de la richesse nationale en Turquie vis--vis des principes dmocratiques. La richesse
nationale peut tre formule des fins d'utilisation dans le domaine juridique comme le total du patrimoine des mnages et des personnes
morales de droit public de lanne prcdente additionn au produit national net de l'anne donne. La dmocratie exprime la possibilit pour chacun de
participer la politique (la participation) avec ses diffrences (dans ses intrts- selon son revenu, son ge, son tat de sant et des tats similaires- et son idologie) et davoir ainsi une influence en politique
travers ses diffrences (le pluralisme). Cette tude se base sur l'ide que doit tre analyse avant tout la manire dont est rpartie la richesse du
peuple pour savoir si l'Etat revt un caractre dmocratique. En effet, lattente de chacun dune organisation comme lEtat ne peut tre quune meilleure vie et cette dernire satisfaisant tous les besoins des hommes tels
que lhbergement, la sant, lenseignement, la libert, la culture, les espaces verts a une contrepartie montaire.
Mots-cls: Dmocratie, participation, pluralisme, budget, droits de lhomme, rpartition quitable, richesse nationale, ingalit, transparence, dpenses publiques, droits sociaux.
Title: ANALYSIS OF DEMOCRACY THROUGH THE DISTRIBUTION OF
THE NATIONAL WEALTH (THE CASE OF TURKEY)
ABSTRACT: This study deals with the distribution of the national wealth in Turkey according to the principles of democracy. National wealth
can be formulated for use in the legal field as the sum of the previous years household assets and the assets of legal persons governed by public law
added to the net national product of the current year. Democracy is the possibility for everyone to participate in politics (participation) with his or her differences (in his or her interests based on income, age, state of health
and similar conditions and his or her ideology) and thus to have an influence in politics through his or her differences (pluralism). This study is
based on the idea that the way which the national wealth is distributed must be brought up before anything else, in order to find out whether a state has a democratic nature or not. Indeed, everyone expects a better life
from an organization like the state, and such a life satisfying all human needs such as housing, health, education, freedom, culture, green spaces
has a monetary consideration.
Keywords: Democracy, participation, pluralism, public budget, human rights, equitable distribution, national wealth, inequality,
transparency, public expenditure, social rights.
-
3
LISTE DES ABREVIATIONS
a. : article.
AGCC : Assemble gnrale de la Cour de cassation.
AKP : Adalet ve Kalknma Partisi (Parti de la justice et du
dveloppement).
AMK : Anayasa Mahkemesi Karar (Dcision de la Cour
constitutionnelle).
AMKD : Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi.
ANAP : Anavatan partisi (Parti de la mre patrie).
AHFD : Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi.
Ba-kur : Esnaf ve Sanatkarlar ve Dier Bamsz alanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu (Institution dassurance sociale pour les artisans
et les artistes et les autre professionnels libraux).
BDDK : Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu
(Institution de rglementation et de surveillance des activits bancaires).
BMKO : Bte ve Mali Kontrol Genel Mdrl (Direction
gnrale de budget et de contrle financier).
CEDH : Cour europenne des droits de lhomme.
CET : Contribution conomique territoriale.
Cf. : Comparer.
CHP : Cumhuriyet Halk Partisi (Parti rpublicain du peuple).
CIR : Code de l'impt sur le revenu.
CIS : Code de l'impt sur les socits.
-
4
CJUE : Cour de justice de lUnion europenne.
CMK : Ceza Muhakemeleri Kanunu (Loi sur la procedure
criminale).
CPT : Code pnal turc.
CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette
sociale.
CRFPGD : Code relatif la rglementation du financement public
et de la gestion des dettes.
CSG : Contribution sociale gnralise.
CTCS : Code de la taxe sur la consommation spcifique.
CTVA : Code de la taxe sur la valeur ajoute.
CUJCC : Le Comit dunification de la jurisprudence de la Cour
des comptes.
DDK : Devlet Denetleme Kurulu (Conseil de contrle de
lEtat).
DSK : Trkiye Devrimci i Sendikalar Konfederasyonu
(Confdration des syndicats ouvriers rvolutionnaires de la Turquie).
DPT : Devlet Planlama Tekilat (Organisme de planification
d'Etat).
DSP : Demokratik Sol Parti (Parti dmocratique de la
gauche).
DYP : Doru Yol Partisi (Parti de la juste voie).
ESSPROS : European system of integrated social protection
statistics.
-
5
FMI : Fonds montaire international.
GAP : Gneydou Anadolu Projesi (Projet dAnatolie Sud-
orientale).
GRECO : le Groupe dEtats contre la corruption.
HSYK : Hakimler ve Savclar Yksek Kurulu (Haut conseil des
juges et des procureurs).
IBP : International Budget Partnership.
HAUM : Trkiye Barolar Birlii nsan Haklar ve Aratrma ve
Uygulama Merkezi.
IISS : International Institute for Strategic Studies.
INTOSAI : Organisation internationale des institutions suprieures
de contrle des finances publiques.
IAP : instrument daide de pradhsion.
INSEE : Institut national de la statistique et des tudes
conomiques.
ISSAI : Les standards internationaux des institutions
suprieures de contrle des finances publiques).
KUR : Kurumu (Institution de lemploi).
KASDEP : Krsal Alanda Sosyal Destek Projesi (Projet de soutien
social en milieu rural).
KT : Kamu ktisadi Teebbs (entreprise publique).
LCC : Loi sur la Cour des comptes.
LFP : Loi sur les fonctionnaires publiques.
-
6
LGFPC : Loi sur la gestion financire publique et le contrle.
LPA : Loi sur la procdure administrative.
LPC : Loi sur la procdure civile.
LPP : Loi sur les partis politiques.
LTO : Loi turque des obligations.
MHP : Milliyeti Hareket Partisi (Parti de laction nationaliste).
nbp : note de bas de page.
NUTS : nomenclature des units territoriales statistiques.
OCDE : Organisation de coopration et de dveloppement
conomique.
ONG : Organisation non gouvernementale.
OTAN : Organisation du trait de lAtlantique Nord.
OYAK : Ordu Yardmlama Kurumu (Institution d'entraide
militaire).
PACS : pacte civil de solidarit.
PIB : produit intrieur brut.
PNB : produit national brut.
PNN : produit national net.
QUANGO : quasi-autonomous non-governmental organisation.
RP : Refah partisi (Parti du bien-tre).
R.T. : Rpublique de Turquie.
-
7
RTK : Radyo ve Televizyon st Kurulu (Commission
suprieure de la radiotlvision).
SGK : Sosyal Gvenlik Kurumu (Institution de la scurit
sociale).
SGKK : Saytay Genel Kurul Karar (dcision du Conseil
gnral de la Cour des comptes).
SHP : Sosyaldemokrat Halk Parti (Parti populiste social-
dmocrate).
SIPRI : Stockholm International Peace Research Institute.
SODES : Sosyal Destek Program (Programme de soutien social).
SPK : Commission du march de capitaux (Semaye Piyasas
Kurulu).
SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu (Institution des assurances
sociales).
SYDGM : Sosyal Yardmlar Genel Mdrl (Direction gnrale
des aides sociales).
SYDTF : Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Fonu
(Fonds dencouragement de lassistance et la solidarit sociale).
SYDV : Sosyal Yardmlama ve Danma Vakflar (fondations
de lassistance et de la solidarit sociale).
T. : Tome.
TBMM : Trkiye Byk Millet Meclisi (Grande assemble
nationale de Turquie).
TCS : Taxe sur la consommation spcifique.
-
8
TESEV : Trkiye Ekonomik ve Sosyal Etdler Vakf.
TFPB : Taxe foncire sur les proprits bties.
TFPNB : Taxe foncire sur les proprits non bties.
TK : Trkiye Kmr letmeleri (Entreprises de charbon de
Turquie).
TL : livres turques.
TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (Fonds dassurance des
comptes dpargne).
TOK : Toplu Konut daresi Bakanl (Direction du service des
logements collectifs).
TBTAK : Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu
(Institution de recherches scientifiques et technologiques de Turquie).
Trk- : Trkiye i Sendikalar Konfederasyonu (Confdration
des syndicats ouvriers de la Turquie).
TSEV : Trkiye nc Sektr Vakf (la Fondation du troisime
secteur de Turquie).
TRT : Trkiye Radyo Televizyon Kurumu (Institution de radio
et tlvision).
TK : Trkiye statistik Kurumu (Institution des statistiques
de Turquie).
UE : Union europenne.
V. : Volume.
YCGK : Yargtay Ceza Genel Kurulu (le Conseil gnral pnal de
la Cour de cassation).
-
9
YHGK : Yargtay Hukuk Genel Kurulu (Conseil gnral civil de la
Cour de cassation).
YSK : Yksek Seim Kurulu (Haute commission lectorale).
-
10
Sommaire
RESUME.. 2
LISTE DES ABREVIATIONS.. 3
SOMMAIRE 10
INTRODUCTION... 13
PARTIE 1. ANALYSE DE LA DEMOCRATIE DE LA PART DE LA
PARTICIPATION AU PROCESSUS BUDGETAIRE
23
Titre 1 Une lgislation qui ne permet pas la participation 23
Chapitre 1 Lingalit des acteurs du droit au budget. 24
Section 1 La formation antidmocratique de lorgane qui exercera le droit au
budget..
24
A Lingalit dans laccs aux postes politiques 25
B Un parlement en dficit de reprsentation.. 35
Section 2 Des comptences sans responsabilits 42
A Des comptences sans responsabilits au regard des actes juridiques
de lexcuteur..
55
B Des comptences sans responsabilits au regard des actes juridiques
du juge.
71
C Des comptences sans responsabilits au regard des actes juridiques
du lgislateur...
75
Chapitre 2 Des finances publiques non-ouvertes au contrle populaire... 87
Section 1 Un processus budgtaire non contrl 88
A Ladoption dun budget non-transparent. 88
B Un contrle insuffisant des comptes dfinitifs 113
Section 2 Une gestion financire centralise.. 133
A Une politique librale concernant les privatisations... 134
B Une administration centrale qui ne veut pas partager ses prrogatives
publiques financires...
138
i Labsence de volont politique concernant le transfert de comptence
aux collectivits locales et aux autres personnes dans le cadre du
principe de subsidiarit...
138
-
11
ii Labsence de volont politique concernant la responsabilisation des
gestionnaires...
143
iii Labsence de volont politique concernant lexistence des organismes
indpendants de surveillance..
144
Titre 2 La quasi-inexistence de fonds publics allous la ralisation de la
participation..
147
Chapitre 1 Linsuffisance des dpenses publiques en affranchissement de
lindividu embourb dans les problmes de survie.
150
Section 1 Linsuffisance du financement de la scurit sociale.. 154
A Un systme de scurit sociale fonde sur les cotisations des
employs et des employeurs...
155
B Le montant insuffisant des dpenses de la scurit sociale... 160
Section 2 Linexistence des dpenses daide sociale.. 168
Chapitre 2 Linsuffisance des dpenses publiques en affranchissement de
lindividu de la crainte de se mler des affaires de la socit.
170
Section 1 Linsuffisance des fonds publics allous au justiciard 170
Section 2 La part importante des tablissements pnitentiaires dans les dpenses
de justice.
172
Chapitre 3 Linsuffisance des dpenses publiques en individu ayant conscience
de ses intrts et des acquis de lactivit collective
173
Section 1 La quasi-inexistence dun systme de financement public de la socit
civile
176
A Une administration qui veut prserver le monopole de service public... 176
B Une administration qui na pas une culture de coopration au sujet de
la dfense des droits
188
Section 2 Un systme de subvention centralis et non-transparent 191
Chapitre 4 Linsuffisance des dpenses publiques en dveloppement des peuples
du monde.
199
Section 1 Leffet correctif des politiques financires errones des aides au
dveloppement
199
Section 2 Linsuffisance des fonds publics allous laide au dveloppement. 202
PARTIE 2 ANALYSE DE LA DEMOCRATIE DE LA PART DUN
BUDGET PLURALISTE OU DE LA REPARTITION
EQUITABLE DE LA RICHESSE NATIONALE.
207
-
12
Titre 1 La violation du droit lgale protection face la charge de
contribution aux dpenses publiques..
226
Chapitre 1 La facult contributive: une mesure dimposition qui ne sapplique
pas...
237
Section 1 Une fiscalit indirecte qui porte atteinte au principe dgalit... 237
A La grande part des impts indirects dans la totalit des revenus fiscaux 238
B La non-adoption des techniques de personnalisation.. 239
Section 2 Une fiscalit directe qui porte atteinte au principe dgalit.. 241
A La violation du droit la vie par la fiscalit directe 241
B Une fiscalit directe supporte par les contribuables ayant une facult
contributive moins leve...
247
Chapitre 2 La non-conformit au principe dgalit des motifs de ne pas imposer
selon la facult contributive
257
Section 1 Des motifs non-concrtiss. 258
Section 2 Un traitement ingal fond sur la croyance 264
Titre 2 La violation du droit lgale protection face aux dpenses
publiques
267
Chapitre 1 Un traitement discriminatoire du fait de son revenu.. 267
Section 1 Une protection ingale concernant les droits sociaux. 268
Section 2 Une protection ingale concernant le droit la vie. 283
Chapitre 2 Un traitement discriminatoire du fait de son ge: linsuffisance des
dpenses publiques en ducation
286
Chapitre 3 Un traitement discriminatoire du fait de sa croyance. 293
CONCLUSION. 305
BIBLIOGRAPHIE 326
-
13
INTRODUCTION
La richesse nationale est un concept d'conomie politique.
Lconomie politique a pour objet, parmi les rapports des hommes vivant
en socit, ceux-l seulement qui tendent la satisfaction de leurs besoins
matriels, tout ce qui concerne leur bien-tre1. Suivant la division
tripartite de Jean Baptiste SAY qui est reste classique, ces rapports sont
traits sous trois grands chapitres: production, rpartition, consommation2.
En conomie politique,la richesse qui est lobjet de la production, de la
rpartition et de la consommation, dsigne, selon SAY, tout bien matriel,
tout produit qui peut tre un objet de proprit3. Ce qui est richesse pour
une personne prive lest pour une nation (qui nest que la runion des
personnes prives aux yeux de l'conomie politique, laquelle ne raisonne
pas sur des valeurs imaginaires)4.
Cependant, dans le domaine conomique, le concept de la richesse
nationale est utilis au sens de la croissance conomique dun pays pour
fonder ensuite sa place dans la hirarchie des nations par rapport au niveau
de celle-ci5. Cette croissance est principalement mesure de nos jours6
1 GIDE, Charles: Principes dEconomie Politique, 1931, p.13.
2 GIDE, p.14.
3 Trsor de la Langue franaise informatis, Centre national de ressources textuelles et
lexicales, http://www.cnrtl.fr/definition/richesse. 4 SAY, Jean-Baptiste: Trait dconomie politique ou simple exposition de la manire dont se
forment, se distribuent et se consomment les richesses, Imprimerie de C. J. de Mat Fils et H. Remy, Bruxelles 1827, p.25.
5 FREMEAUX, Philippe/ TOUAL, Louisa: Comment mesurer la richesse?, Alternatives
Economiques no: 193, juin 2001, http://www.alternatives-economiques.fr/comment-mesurer-la-richesse-_fr_art_148_15629.html.
6 La Richesse des nations", pour reprendre le titre de luvre la plus connue dAdam Smith
(1723-1790), na pas toujours t pense dans les termes actuels. La comptabilit nationale, celle qui fournit les outils de calcul du PIB, a t mise au point pour lessentiel, entre les annes 1930 et 1970, et le premier rapport sur les comptes de la nation date, en France, de 1951. Dimportantes hsitations ont marqu cette priode, et cest par exemple seulement en 1976 que les conventions en vigueur en France ont intgr les services non marchands des administrations dans la dfinition de la richesse nationale (le PIB). Ils en taient exclus avant cette date, premier indice de lintervention de choix de type
http://www.cnrtl.fr/definition/richessehttp://www.alternatives-economiques.fr/comment-mesurer-la-richesse-_fr_art_148_15629.htmlhttp://www.alternatives-economiques.fr/comment-mesurer-la-richesse-_fr_art_148_15629.html
-
14
travers lindicateur dit du produit intrieur brut (PIB). Le PIB est calcul
en additionnant la contribution de chaque agent conomique la production
de richesses. Le changement de PIB est accept comme lindicateur de la
croissance conomique. Pour autant, cet indicateur est de plus en plus
critiqu pour ne pas sinterroger sur lutilit relle de ce quil additionne7, ni
sur les conditions sociales et environnementales telles que l'extinction des
ressources non renouvelables, dans lesquelles les richesses mesures sont
produites et pour rduire les richesses aux seules activits marchandes et
politique dans une mesure qui nous parat aujourdhui naturelle que parce quon a oubli les dbats fondateurs (Voir J. Gadrey et F. Jany-Catrice, 2005, chapitre VIII). Mais bien dautres indices peuvent tre trouvs en remontant plus loin dans lhistoire. On saperoit alors que ce sont largement les intrts et les ides des dtenteurs du pouvoir conomique, des puissants, qui ont t chaque poque au cur de la conception dominante de la richesse (GADREY, Jean: Richesse (Dfinition et Mesures de la), Encyclopdia Universalis France 2014, http://www.universalis.fr/encyclopedie/definitions-et-mesures-de-la-richesse/). L'mergence des Etats-nations centraux correspond au XVe sicle. La priode ayant prcd est celle lors de laquelle l'Europe occidentale apparat comme un ensemble de rgions et de provinces constituant des units conomiques partiellement autonomes. A cette poque, la richesse est mesure en relation avec le montant de minraux prcieux dtenus en faisant un parallle avec la puissance conomique de la nation et celle d'un commerant (GZE, Ayferi: Liberal, Marxiste, Faist, Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet (Etat librale, marxiste, fasciste, national-socialiste et sociale), Beta, 4
e dition, stanbul 2005,
p.11). Le systme mercantiliste qui se focalise sur le dveloppement du commerce extrieur et l'industrie de la production pour dtenir les minraux prcieux a t suivi par l'Ecole physiocrate qui considre la terre comme seule source de richesses (GIDE, p.15-16). Lapparition du livre Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nationsd'Adam Smith en 1776 a marqu un tournant dans l'histoire de l'Economie politique (GIDE, p.16-17). Selon SMITH, considr comme le pre fondateur de l'Economie Politique classique, auquel se sont rfrs ses disciples pendant tout un sicle, la richesse repose avant tout sur la production industrielle. MALTHUS considre que la richesse d'un pays repose sur les biens matriels changeables, dont la valeur est mesurable grce aux prix. Chez lui comme chez Smith, le seul crateur de cette richesse est le travail. Cette conception de la richesse a marqu la totalit du 19
e sicle et une partie du 20
e et a t largement adopte par Karl MARX (1818-1883)
(GADREY). Tel quindiqu dj par SAY en 1803, l'Ecole Marginaliste et la Thorie noclassique sinscrivent dans la reprsentation marchande de la richesse en dfendant que le critre de contribution la richesse ne repose pas dans la matrialit des productions, mais dans le fait quelles ont une valeur changeable. Depuis deux sicles, ces deux approches coexistent. En France- comme mentionn ci-dessus- ce n'est que depuis 1976 que les services non marchands des administrations sont pris en compte dans le calcul de la richesse nationale. Depuis 1990, ce contenu jug trs insuffisant fait l'objet de critiques (GADREY) de ne pas sinterroger sur lutilit relle de ce quil additionne, ni sur des conditions sociales et environnementales, par exemple sur l'extinction des ressources non renouvelables, dans lesquelles les richesses mesures sont produites et de rduire la richesse aux seules activits marchandes et celles qui leur sont assimilables (FREMEAUX/ TOUAL).
7 Comme exemple de recherche qui dmontre que la croissance conomique/ laugmentation
de la production prsente comme la solution tous les problmes constitue en fait le problme lui-mme, voir GADREY, Jean: Adieu la Croissance: Bien Vivre dans un Monde Solidaire, Les Petits Matins, Alternatives Economiques, Paris 2010.
http://www.universalis.fr/encyclopedie/definitions-et-mesures-de-la-richesse/
-
15
celles qui leur sont assimilables8. Quant toute la partie de l'conomie
politique qui traite de la rpartition, elle n'est autre que l'tude des
instruments de mise en uvre tant bien que mal du principe juridique
cuique suum ( chacun ce qui lui revient)9. A ce point, l'indicateur PIB qui
ne fournit pas d'information sur les volutions de lventail des revenus et
surtout sur le patrimoine qui est un lment essentiel des ingalits, reste
galement insuffisant pour fournir des informations sur la rpartition.
Contrairement aux sciences positives qui tudient la relation de
cause effet pour constituer des donnes, la science juridique est une
science normative (dterminant une norme/ un jugement de valeur). C'est
pourquoi,- comme expliqu ci-dessus- une notion telle que la croissance
conomique dont on ne connat pas les rpercussions sur les titulaires de
droits et liberts, n'est pas utilisable en droit. Conformment la dfinition
de SAY cite ci-dessus, la richesse nationale peut tre formule des fins
d'utilisation dans le domaine juridique comme le total du patrimoine10 des
mnages et des personnes morales du droit public de lanne prcdente
additionn au produit national net (PNN)11 de l'anne donne. Cette
formule, tout en tant utilisable pour valuer le partage de la richesse
nationale au sein du peuple, demeure toujours incomplte pour rpondre
aux autres critiques adresses l'indicateur PIB.
8 FREMEAUX/ TOUAL. Pour plusieurs indicateurs prenant en compte les conditions sociales et
environnementales dans lesquelles les richesses mesures sont produites voir GADREY, Jean/ JANY- CATRICE, Florence: Les Nouveaux Indicateurs de Richesses, La Dcouverte, Paris 2005.
9 GIDE, p.13.
10 Le patrimoine est le restant aprs avoir diminu le passif total du total des biens et droits
ayant une valeur dchange, qui se trouvent sous la possession des personnes- entre autres des personnes de droit public, donc du peuple- selon les principes du droit priv (Pour les dfinitions du patrimoine utilises pour limpt sur le patrimoine, voir TUNCER, Selahattin: Servet Vergileri (Les Impts sur le patrimoine), Maliye Enstits Konferanslar: 7, stanbul niversitesi, stanbul 1961, p.159).
11 Pour obtenir le PNN, il faut retrancher au produit national brut (PNB) la valeur de la
dprciation des actifs. Le PNB correspond la somme des revenus primaires perus, pendant une priode donne, par les agents conomiques nationaux.
-
16
Il convient galement de clarifier ce que la dmocratie, en fonction
de laquelle le partage de la richesse nationale sera analys dans l'tude,
signifie. La dmocratie, selon la clbre dfinition d'Abraham Lincoln est le
gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Il est largement
accept que la dmocratie dans la prise de dcision et dans la pratique de
celle-ci est le modle le plus convenable pour l'objectif du dveloppement
continu des droits de l'homme12 qui est la raison dexistence de lEtat13.
Dans ce sens, un Etat dmocratique est, pour l'ensemble des peuples du
monde- indpendamment des diffrences culturelles, politiques, sociales et
conomiques-, un droit qui repose sur des valeurs communes et
universelles14. Donc, la dmocratie a dpass le statut de rgime idal pour
la continuit des droits de lhomme et a atteint le statut de droit part
entire. Ce droit exprime la possibilit pour chacun de participer la
politique (participation) avec ses diffrences (dans ses intrts selon ses
revenus, son tat de sant, son ge, son sexe- et son idologie) et davoir
ainsi une influence en politique travers ses diffrences (pluralisme). Les
personnes peuvent participer la politique pour dfendre leurs propres
intrts ou les droits des autres.
La Constitution de la Rpublique de Turquie (R.T.)15 dfinit la
dmocratie dans son article 2 comme l'une des caractristiques de l'Etat. Au
motif de l'article 5 de la Constitution, il est galement expos que la
dmocratie, tant le rgime le plus adapt la ralisation et la garantie des
droits de lhomme et des liberts fondamentales, est la raison d'tre de
12
KUURAD, onna: Yirmibirinci Yzyln Eiinde Demokrasi Kavram ve Sorunlar (La Notion de dmocratie et ses problmes la veille du 21
e sicle), Hacettepe niversitesi Edebiyat
Fakltesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yl zel Says, Ankara 1998, p.26. Churcill a dfini la dmocratie comme "le moins mauvais" des rgimes (DER LNDEN, Ren Van, (communication), Le Rle des Partis Politiques Dans La Construction de la Dmocratie, Conseil de lEurope, Moscou 2006, p.159).
13 KUURAD, p.24.
14 La Dclaration Universelle Sur La Dmocratie art.1, http://www.ipu.org/cnl-f/161-dem.htm.
15 No: 2709, J.O.: 9.11.1982, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf.
http://www.ipu.org/cnl-f/161-dem.htmhttp://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
-
17
l'Etat16. Par ailleurs, dans le prambule de la Constitution apparat
l'expression la dmocratie libertaire indique dans cette Constitution. Au
lieu de se contenter des expressions de la dmocratie universelle ou de
l'Etat dmocratique, le pouvoir constituant a limit ds la Constitution les
liberts et la dmocratie reposant sur les liberts par la lettre de celle-ci.
Les autorits turques ont d'ailleurs voulu mettre des rserves concernant
plusieurs droits et liberts, commencer par la libert d'expression et
d'association, lorsqu'elles ont fait la demande aux autorits europennes
concernant le droit de requte individuel prvu par la Convention
europenne des droits de l'homme afin de ne pas faire un compromis sur la
perception des liberts et de la dmocratie aux turcs17 dans les limites
16
La Constitution de la R.T. (avec lexpos des motifs) TBMM, Ankara 2011, p.8, https: //yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/gerekceli_1982_anayasasi.pdf.
17 En Turquie, depuis la Loi "Tekilt- Essiyye" de 1924 (No: 491, J.O.: 24.4.1924) sont
considrs comme "Turcs" tous les citoyens indpendamment de leur religion et de leur race. Cette formule qui figure l'article 88 de la Constitution de 1924 a t reprise l'article 54 de la Constitution de 1961 (No: 334, J.O.: 20.7.1961) et l'article 66 de la Constitution de 1982 actuellement en vigueur. Les expressions "l'Etat de Turquie" figurant l'article 3 de la Constitution de 1921 et l'expression "Le Public de la Turquie" figurant l'article 88 de la Constitution de 1924 qui sont les Constitutions de la rvolution rpublicaine sont remplaces par l'expression "L'Etat Turc" dans les Constitutions de 1961 et 1982. Car le qualificatif "Turc" qui est l'quivalent d'un concept juridique (de la citoyennet) est galement l'origine ethnique de la majorit de ceux qui vivent en Turquie, permettant ainsi au nationalisme turc de faire interdire par la loi une langue au point d'arriver un barbarisme culturel (TANR, Blent/ YZBAIOLU, Necmi: 1982 Anayasasna Gre Trk Anayasa Hukuku (Le Droit constitutionnel turc selon la Constitution de 1982), Yap Kredi Editions-1447, Cogito-102, 3. Edition, stanbul 2002, p.81), il fait l'objet de critiques adresses par les citoyens d'une autre origine ethnique qui vivent en Turquie ainsi que de certains juristes et activistes. La loi portant cette interdiction linguistique est la loi intitule "La loi sur les publications faites dans une autre langue que le Turc" (No: 2932, J.O.: 22.10.1983). L'article premier de la loi intitul Objectif et contenu se lit ainsi: Cette loi dfinit les principes et les procdures relatives aux langues interdites dans l'expression et la diffusion des opinions, dans le but de prserver l'intgrit indivisible de l'Etat et de la nation, de la souverainet nationale, de la Rpublique, de la scurit nationale et de l'ordre public." Ainsi, "il est interdit d'exprimer, de diffuser et de publier des opinions dans une quelconque autre langue que la premire langue officielle des Etats reconnus par l'Etat turc. Ceci ne porte pas prjudice aux dispositions des Conventions internationales auxquelles l'Etat turc est partie ainsi que les publications des institutions d'ducation, d'enseignement, de recherche scientifique et des institutions publiques.Avec son article 3 qui rgit la langue maternelle des citoyens turcs, la loi dispose que, La langue maternelle des citoyens turcs est le turc. Sont interdites a) les activits visant utiliser et diffuser d'autres langues que le turc comme langue maternelle b) les affiches, les pancartes, les slogans, les panneaux et d'autres supports rdigs ainsi que la radiodiffusion faite travers des disques, des bandes sonores ou visuelles dans une autre langue que le turc, ports et utiliss lors de runions et des manifestations sauf en cas d'autorisation obtenue du plus haut responsable administratif". Les articles 4 et 5 de la loi compose de huit articles dfinissent les sanctions et prvoient le rappel. Cette loi prpare par le Conseil national de scurit a t abroge par l'article 23 de la loi sur la lutte anti-terrorisme (No: 3713, J.O.: 12.4.1991); ses dispositions constitutionnelles ont t abroges par l'amendement constitutionnel de 2001 (Trkiye
https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/gerekceli_1982_anayasasi.pdfhttps://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/gerekceli_1982_anayasasi.pdf
-
18
approuves par les autorits turques. Cependant, ces demandes de
rserves ne furent pas acceptes par les autorits europennes18. La
dmocratie ne peut seulement tre limite si les liberts sont abuses en
vue de la dtruire ou de dtruire les liberts elles-mmes19. Hormis ce
dernier cas, la non-correction de la lgislation engendrant des restrictions
antidmocratiques qui contredisent les liberts et la dmocratie universelle,
fait natre la responsabilit des dputs et des juges.
Cette tude se base sur l'ide que doit tre analyse avant tout la
faon dont est partage la richesse nationale au sein du peuple pour savoir
si l'Etat, lequel constitue la personnalit morale de ce dernier, revt un
caractre dmocratique de la part du peuple et ses principaux organes (le
lgislatif, l'excutif et le judiciaire). En effet, lattente de chacun dune
organisation comme lEtat ne peut tre quune meilleure vie et cette
dernire, satisfaisant tous les besoins des hommes tels que lhbergement,
la sant, lenseignement, la libert, la culture et les espaces verts, a une
contrepartie montaire. Dans les dmocraties, la richesse nationale est
utilise par le biais du droit au budget dont le peuple est titulaire20 et qui
donne ce dernier les comptences pour imposer, dpenser, prparer le
budget, sendetter et grer les biens publics21. Cest pour cette raison que le
Cumhuriyeti Anayasasnn Baz Maddelerinin Deitirilmesi Hakknda Kanun, No: 4709, J.O.: 17.10.2001- 24556 (mkerrer)) (TANR/ YZBAIOLU, p.81, nbp.28).
18 TANR/ YZBAIOLU, p.86-88.
19 Voir ce sujet, HAKYEMEZ, Yusuf evki: Militan Demokrasi Anlay (La Conception de la
dmocratie militante), Editions Sekin, Ankara 2000 ve KANADOLU, O. Korkut: Almanyada Mcadeleci Demokrasi (La Dmocratie militante en Allemagne), Ouz mregne Armaan, HF Editions, stanbul 1998, p.977-990, cit par: TANR/ YZBAIOLU, p.87-89.
20 Le droit au budget appartient au peuple, donc aux citoyens. C'est pourquoi, il est possible
de parler de la comptence budgtaire des parlements ou des gouvernements et des fonctions et responsabilits qui en dcoulent et non pas de leur droit au budget. (AAN, Nami: Modern Bte Srecinde Parlamentonun Rol (Le Rle du Parlement dans le processus budgtaire moderne), Bte Srecinde Parlamentonun Deien Rol, TBMM Basmevi, Ankara 2009, p.183).
21 AAN, p.183.
-
19
droit au budget est lindicateur le plus clair travers lexcution duquel peut
tre valu si un peuple a le droit ou non de se gouverner lui-mme22.
Aprs avoir mis les problmes montaires au centre de la discussion
sur la dmocratie, il faut constater cette harmonie ou cette dysharmonie en
tudiant les dispositions procdurales et matrielles du droit financier. Nous
avons dj dfini la dmocratie en se basant sur les principes de
participation et de pluralisme. La participation est relative la procdure et
permet de mesurer la conformit du droit financier la dmocratie du point
de vue des normes procdurales. Le pluralisme est, dautre part, relatif au
rsultat atteindre, et il est lindicateur de la conformit du droit financier
la dmocratie du point de vue des normes substantielles. La procdure
financire doit tre rgle de faon permettre chaque citoyen de
participer, personnellement ou par lintermdiaire de leurs reprsentants,
la gestion financire et, une telle gestion financire participative devrait
rsulter comme un budget qui reflte lintrt et lidologie de tous
concernant la rpartition de la richesse nationale. Les personnes, jeunes ou
ges, malades ou en bonne sant, riches ou pauvres ou dans d'autres
situations, ont besoin de bnficier de certains droits de l'homme en
priorit, en fonction de leur tat. Un budget qui reflte lintrt et lidologie
de tous signifie le fait que le budget reflte le financement des droits de
lhomme qui correspondent ces intrts et idologies. Sinon, il est
vident que linsatisfaction des groupes sociaux dont la jouissance de la
richesse nationale est empche, donnera lieu la dsintgration sociale
dans une dmocratie. Cependant, le fait de connatre ses intrts et la
participation au gouvernement par la connaissance de ces deniers ne sont
possible quen liminant les obstacles rendant les individus timides,
insuffisants, indiffrents ou intolrables lgard de la participation aux
affaires publiques.
22
FEYZOLU, Bed N: Modern Anayasalarda Bte Hakk (Le Droit au budget dans les constitutions modernes), .. ktisat Fakltesi Maliye Aratrma Merkezi Konferanslar, 29. Seri, 1983-1984, p.3.
-
20
Cette tude qui vise dterminer le caractre dmocratique de la
Turquie travers la rpartition de sa richesse nationale et donc travers le
budget, instrument principal de la politique23, est compose de deux
grandes parties qui tudient le thme des points de vue participatif (Partie
1) et pluraliste (Partie 2). L'examen de la conformit la dmocratie de
l'utilisation de la richesse nationale permettra galement de mesurer la
qualit du service dmocratique offert par le personnel public- commencer
par ceux qui sont dots des comptences les plus importantes, savoir les
dputs, les juges et les ministres- qui reoit une grande partie de la
richesse nationale sous forme de salaire.
L'tude se limite l'ordre juridique prvu par le systme
conomique capitaliste, lequel a deux aspects: l'conomie librale (dun Etat
limit) et l'conomie sociale (d'un Etat interventionniste). La doctrine
socialiste ou communiste n'a pas t prise en compte24. C'est pourquoi cette
23
Dans la quasi-totalit des pays dans le monde, le budget est l'unique instrument de tout acte de l'Etat (CANGZ, Cokun: Redistribution of Power and Status Through Public Finance: The Case of Turkey, Republic of Turkey Ministry of Finance Strategy Development Unit, Issue No: 2010/401, Ankara 2010, p.19).
24 Lquivalent de lEconomie librale dans le domaine constitutionnel est le
constitutionnalisme libral qui a marqu le XIXe sicle. L'Etat libral instaur par les mouvements du constitutionnalisme libral est une organisation politique qui rsulte de la ncessit de sanctionner par un organe suprieur les individus qui ne se conforment pas aux lois naturels selon lesquels les individus sont supposs vivre de faon libre et gale dans la nature (GZE, p.3-4). L'objectif des organes de l'Etat est de protger les droits naturels (acquis la naissance) des individus qui ne se sont pas perdus avec le temps. Ces droits naturels sont les liberts, le droit la scurit, le droit de proprit et le droit de rsistance loppression (GZE, p.8).
Le mouvement du constitutionnalisme socialiste ayant marqu le XXe sicle, reflte un
systme d'ides fondamentalement oppos celui qui faonne le mouvement constitutionnel libral selon lequel "les individus naissent libres", "qu'ils sont gaux dans une atmosphre de libert". On ne peut parler de la libert d'un individu dont les besoins vitaux fondamentaux ne sont pas satisfaits. Il n'y a pas de libert et une galit mais une rpression et une exploitation l'origine. L'histoire de l'humanit est faite de guerres entre les classes, une guerre qui oppose les minorits exploitantes et les masses exploites, les matres et les esclaves, les seigneurs et les serfs. Avec la Rvolution industrielle, cette guerre est transforme en une lutte entre les capitalistes dtenant les moyens de production et les proltaires qui leur louent leurs forces de travail. L'Etat n'est donc que l'instrument de rpression au service de la classe dominante. L'appareil tatique, arrach aux mains de cette minorit, doit passer aux
-
21
tude ne rpond pas aux questions de savoir si la production de base doit
tre publique ou prive pour atteindre le niveau optimal de production et si,
lorsque l'objectif est la prosprit pour tous, l'objectif datteindre le niveau
optimal de production peut tre nglig ou dans quelles mesures il pourra
ltre pour dterminer le systme conomique idal.
De plus, avec sa formule utilise dans cette tude, la richesse
nationale est lacunaire du fait quelle ne remet pas en cause lutilit relle
mains de la majorit constitue d'ouvriers, de paysans et dintellectuels jusqu ce que se forme une socit sans classe et sans exploitation en socialisant les moyens de production (KABOLU, brahim: Anayasa Hukuku (Anayasa), 5
e dition rvise, LEGAL, stanbul 2009, p.93).
Avec l'effet du mouvement socialiste, une part du monde sest transforme au systme
socialiste. Dans le systme conomique socialiste, les principaux appareils de production et d'change appartiennent la socit (MANDEL, Ernest: Marksist Ekonomi El Kitab (Manuel de lconomie marxiste), zgr niversite Kitapl: 68, Edition Maki Basn, 3. Edition, Ankara 2008 (traduit par: Orhan Suda), p.609). Cela tant, le seul facteur crant de la valeur dans une conomie socialiste est le travailleur. Une partie de la valeur ajoute cre par le travailleur est oriente au financement des nouveaux investissements publics et autres dpenses publiques; le reste prenant la forme de salaires pays aux travailleurs (TRKKAN, Erdal: Ekonomi ve Demokrasi (Economie et dmocratie), Ekonomik ve Sosyal Aratrmalar: 2, Turhan Kitabevi, Ankara 1996, p.93). En revanche, dans le systme capitaliste, profitent d'une grande partie de cette valeur ajoute cre, non pas les travailleurs ou la socit, mais les particuliers et ce, sous les dnominations de profit, rente et intrt (HARRIS, Laurence/ KIERNAN, V. G/ MILIBAND, Ralph: Marksist Dnce Szl (Dictionnaire de la pense marxiste), Edition letiim, 4
e
dition, stanbul 2005 (traduit par: Mete Tunay), p.46-47). Dans lautre partie du monde, les constitutions librales ont commenc se socialiser: Les
droits sociaux, autrement dit les obligations sociales de lEtat ont commenc figurer dans les constitutions aux cts des liberts conomiques et intellectuelles (KABOLU, Anayasa, p.96-97). La reconnaissance des droits sociaux est dfinie comme une sorte de rconciliation entre la classe capitaliste et les masses populaires de travailleurs afin de lassurance de la protection du systme conomique capitaliste (TANR, Blent: Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar (Les Droits sociaux dans le droit constitutionnel), Editions May, stanbul 1978, p.121).
Avec l'affaiblissement du bord socialiste partir de 1980, le pouvoir de reprsentation des
masses populaires constituant la majorit et ayant prioritairement besoin de bnficier des droits sociaux s'est affaibli au niveau des constitutions. Ce processus est appel dans le domaine conomique le nolibralisme (KABOLU, Anayasa, p.9).
L'conomie librale et la dmocratie sociale se distinguent l'une de l'autre quant au partage
dans une conomie capitaliste. A l'origine de la diffrence entre un Etat social/ interventionniste et un Etat conomie librale, rside "la productivit marginale". A la diffrence de l'idologie de la dmocratie sociale, dans le systme conomique libral, la part de la valeur ajoute paye aux ouvriers et aux autres composantes considres comme facteur de production par le systme conomique capitaliste est apprcie en lien avec la productivit marginale seule et non pas avec les droits sociaux (TRKKAN, p.94).
-
22
de ce quelle additionne, ni les conditions sociales et environnementales
telles que l'extinction des ressources non renouvelables dans lesquelles les
richesses mesures sont produites.
-
23
PARTIE 1. ANALYSE DE LA DEMOCRATIE DE LA PART DE LA
PARTICIPATION AU PROCESSUS BUDGETAIRE
Le droit et le devoir25 de participer lgal accs la prise de
dcisions publiques et lexercice de celles-ci de chaque citoyen (et dans
certaines limites des trangers galement26) travers ses diffrences (dans
ses intrts selon son ge, son sexe, ses revenus et des tats similaires-
et son idologie) constitue lun pilier de la dmocratie. Il sagit ici de traiter
si la lgislation du pays en question permet la participation (Titre 1) et le
montant de fonds allous pour surmonter les obstacles qui se posent la
ralisation de la participation (Titre 2).
Titre 1. Une lgislation qui ne permet pas la participation
Jusquaujourdhui, la Turquie a appliqu la dmocratie sous sa forme
reprsentative dans le domaine financier. Dans la dmocratie
reprsentative, le droit de participation la gestion des affaires publiques
25
Linclusion la gestion publique constitue un devoir auprs du citoyen plutt quune responsabilit. La responsabilit est ne du Droit et soumise des rgles juridiques, sa violation fait lobjet de sanctions. Lorigine de devoirs en revanche repose sur la morale (KABOLU, brahim: zgrlkler Hukuku, 6. Bask, mge Kitabevi, Ankara 2002, (zgrlkler), p.562). Il est possible de parler ce stade dun devoir confr au citoyen puisque limposition des rgles contraignantes afin que chaque citoyen accomplisse sa tche dmocratique nest ni suffisant, ni tout fait possible dans les dmocraties.
26 Le Parlement europen avait dcid en 1989 de confrer le droit de vote aux lections
municipales aux trangers rsidant et travaillant sur le territoire de douze Etats membres de lUnion europenne. Le droit de vote aux lections municipales a t confr aux trangers au Danemark, en Sude, aux Pays-Bas, en Irlande et en Grande Bretagne; dans ce dernier pays, le droit d'lire et d'tre lu a t confr aux citoyens du Commonwealth l'instar des citoyens britanniques (KABOLU, zgrlkler, p.420, nbp.286).
-
24
se concrtise au sein de deux droits: le droit lgalit politique (Chapitre
1) et le droit de contrle populaire27 (Chapitre 2).
Chapitre 1. Lingalit des acteurs du droit au budget
Lgalit politique signifie premirement la possibilit pour chaque
citoyen, condition quil possde les qualifications objectives pralablement
dfinies, de se charger lui-mme de la gestion des affaires publiques.
Lgalit politique signifie deuximement la possibilit dinfluencer
indirectement la gestion des affaires publiques, en respectant galement
lgalit des chances, par le biais, notamment, dun parlement pluraliste28.
Ces deux piliers de lgalit politique se rapportent la formation de
lorgane qui exercera au nom du peuple le droit au budget dans les
dmocraties reprsentatives (Section 1). Lgalit politique tmoigne
galement quil nexiste pas dans lEtat de personnes distingues vis vis
des responsabilits juridiques (Section 2).
Section 1. La formation antidmocratique de lorgane qui
exercera le droit au budget
Il sagit ici de rvler si les postes de dcision sont accessibles par
toutes les composantes de la socit (A) et si les organes de dcisions
portent un caractre reprsentant galement toutes les composantes de la
socit (B).
27
BEETHAM, David: La Dmocratie: Principes Essentiels, Institutions et Problmes, La Dmocratie: Principes et Ralisation, Union Interparlementaire, Genve 1998, p.23.
28 BEETHAM, p.31.
-
25
A. Lingalit dans laccs aux postes politiques
Le premier pilier de lgalit politique, qui est de lgalit dans
laccs aux postes politiques, concerne, dans les dmocraties
reprsentatives, le systme des partis politiques dun pays. Pour valuer
lgalit dans laccs aux postes politiques, il faut voir si les mcanismes
institutionnels et lgislatifs en place concernant limmatriculation des partis
politiques ont un caractre encourageant ou ardu et ensuite, si le
financement public des partis politiques sert son objectif. Dans le cadre de
ltude, il sagira de sintresser seulement au financement public des partis
politiques.
Dans les dmocraties, la libert de parler existe; si vous voulez
vous faire entendre, cela a cependant un prix. Ce prix a beaucoup
augment avec lutilisation du support professionnel et des moyens de
communication de masse29. Lorsque cest le cas, le parti dune personne
riche ou les partis supports par des personnes riches peuvent attirer les
voix des indcis et des apolitiques laide des campagnes de publicit et de
promotion. Pour cette raison, des lections libres et comptitives ne sont
pas possibles, sauf si les partis et les candidats ont la possibilit de
communiquer suffisamment avec les lecteurs30.
29
KIRBA, Sadk: Trkiyede Kaytd Ekonomi (Economie souterraine en Turquie), Yolsuzluk Siyasetin Finansman, Phoenix, Ankara 2012, p.163- 164. Le fait que, pendant les lections parlementaires de 2002 de la Turquie, Gen Parti, un parti politique qui ne dispose pas dune organisation, dune idologie claire concernant les problmes du pays, dun programme bien tabli et de membres connus par le public sauf le prsident et un chanteur, a gagn 2,3 millions de votes, un pourcentage de 7,25% au bout dune campagne de trois mois, dmontre bien le pouvoir de largent dans la politique, dans une socit apolitique. (UZUN, Cem Duran: Siyasi Partilerin Finansman (Financement des partis politiques), Adalet Yaynevi, Ankara 2010, p.18- 19).
30 GENKAYA, mer Faruk: Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Destei, Balar ve Seim
Giderlerinin Snrlandrlmas (Support tatique aux partis politiques et aux candidats, les dons et la limitation des dpenses lectorales), Siyasi Partilerde Reform, Editions TESEV, stanbul 2000, p.140.
-
26
Laide publique aux partis politiques par lEtat entre en jeu cette
occasion. La raison de la subvention des partis par lEtat est de garantir
lgalit du pouvoir comptitif des partis. Cela vise supporter, contre les
partis et programmes politiques supports par les personnes qui prosprent
dans le statu quo, les petits partis politiques dont le programme ne plat pas
du tout aux intrts tablis et les nouveaux partis nayant pas de relation
avec les groupes dintrt, au nom de la dmocratie pluraliste et librale.
Dans les nouvelles dmocraties, au cours de la priode post-communiste en
particulier, il a t trs important de supporter les nouveaux partis contre
lavantage matriel et financier des partis successeurs des partis
communistes31. On empche ainsi la monopolisation de la politique par des
magnats de mdia comme Berlusconi ou Thaksin Shinawatra32, qui ont
atteint le succs grce leur fortune personnelle et le pouvoir mdiatique.
Cependant, cette ncessit pourrait galement tre satisfaite laide des
rglementations limitatives concernant les relations des partis politiques
avec les mdias et leur financement et on pourrait ainsi canaliser les
immenses ressources alloues aux partis politiques aux autres priorits
selon la prfrence politique.
Le point le plus important est que cette aide ne soit pas utilise pour
consolider la position des partis dj existants. La scne politique doit tre
ouverte aux nouveaux partis des conditions gales. Sinon ce transfert
public signifiera la destruction totale de la lgitimit du systme des partis
en opprimant financirement lexistence et la concurrence politique et en
obligeant les individus supporter des partis et des programmes opposs
leurs intrts ou leurs opinions politiques.
31
BIEZEN, p.38. 32
FERDINAND, p.106.
-
27
Traditionnellement, les partis politiques de lEurope occidentale ont
financ leurs activits laide des supports privs. Les partis socialistes et
sociaux-dmocrates ont profit des cotisations des membres et des dons
des syndicats associs pendant que les partis libraux et conservateurs ont
profit des dons des personnes riches et du secteur priv. Le financement
public des partis politiques a, son tour, eu lieu de manire indirecte par
les revenus publics renoncs; les dpenses fiscales33.
La Rpublique fdrale dAllemagne est la premire parmi les pays
dEurope occidentale qui a prvu une aide directe des partis politiques par
lEtat. Un petit crdit de budget a t mis en place partir de 1959 et, en
1967, la base lgale des aides publiques aux partis politiques a t
constitue. Plusieurs pays ont suivi lexemple de lAllemagne et ont prvu la
subvention, dabord des groupes parlementaires et ensuite, des
organisations centrales des partis. Les dmocraties prcoces comme le sud
de lEurope et lEurope orientale ont aussi prvu des aides publiques
importantes aux partis politiques en vue de ltablissement du pluralisme en
galisant le pouvoir comptitif politique et en facilitant lintgration des
nouveaux partis au systme34.
La Suisse est la seule dmocratie dEurope occidentale o les
organisations des partis ou les campagnes lectorales ne peuvent profiter
daucune subvention fdrale. En Irlande et au Royaume-Uni, seul le groupe
parlementaire peut profiter du financement public. Au Royaume-Uni,
lobjectif de la subvention dont seuls les partis dopposition peuvent profiter
dans le cadre des rgles spcifiques est de les supporter pour remplir leurs
fonctions parlementaires, en particulier, la fonction de contrler le
gouvernement. Ce transfert est utilis pour financer les tudes des
33
BIEZEN, p.35. 34
BIEZEN. p.35.
-
28
responsables de lopposition, les services du groupe dopposition et le
secrtariat du leader de lopposition. Au Royaume-Uni, la question de la
subvention publique des partis politiques a t dbattue pour longtemps
pendant la rdaction de la loi sur les partis politiques, les lections et les
referendums et a t enfin rejete. Un montant de seulement 2 millions de
livres sterling est prvu au titre de subvention de dveloppement pour
financer les travaux dtudes politiques des partis35. Les autres exemples
des pays o les partis politiques ne peuvent pas profiter de la subvention
directe de lEtat sont lArmnie, Chypre du sud, la Moldavie, la Lettonie,
Malte, lUkraine, le Venezuela, les Etats-Unis dAmrique et la Nouvelle-
Zlande36. Aux Etats-Unis, les contribuables dcident si une subvention
indirecte des partis politiques sera effectue au moment o ils font leur
dclaration fiscale37. Largument le plus important contre la subvention des
partis politiques par lEtat est que le fait dobliger le citoyen supporter des
partis et des programmes politiques qui ne se sont pas conformes ses
intrts ou ses sensibilits politiques est contraire aux liberts
fondamentales38.
Le financement public des partis politiques est ralis directement
en trois domaines; le financement oprationnel des partis, le financement
des campagnes lectorales et le financement des groupes parlementaires;
ou indirectement par la reconnaissance dun temps gratuit de diffusion sur
les chanes de tlvision publique, les paiements aux groupes
parlementaires en titre de laide dtude, de papeterie et de consultation, le
financement des associations de recherche et dducation et les exemptions
et autres avantages fiscaux relatif aux frais et aux aides prives39.
35 BIEZEN, p.34- 35.
36 TJERNSTRM, Maja: Matrix on Political Finance Law and Regulations Funding of Political
Parties and Election Campaigns, International IDEA, Trydells Tryckeri UE, Sude, p.209- 213. 37
GENKAYA, p.143. 38
BIEZEN, p.34- 35. 39
GENKAYA, p. 145- 153; UZUN, p.46 et suiv.
-
29
Les partis politiques doivent avoir gagn un certain soutien
populaire pour pouvoir profiter de la subvention publique directe. Sinon, des
partis pouvaient tre fonds pour le seul objectif de profiter de la richesse
nationale40. En revanche, un seuil trs lev de soutien comme condition de
bnfice de laide publique liminerait la raison dtre, cest--dire le motif
dmocratique de cette subvention. En Autriche, les partis qui ont au moins
cinq siges au parlement ou qui ont reu plus de 1% des votes peuvent
profiter de largent public. Au Portugal, les partis doivent avoir reu 50.000
votes qui correspondent 0,6% de llectorat pour pouvoir profiter de la
subvention publique. Parfois, les partis ou les listes des minorits
linguistiques sont exempts du seuil de vote et peuvent toujours profiter de
la subvention publique. En Espagne, on affirme que le seuil de votes de 3%
est trs lev et que cela cre une situation injuste pour les minorits vu le
systme lectoral dj dsquilibr41. En Turquie, le seuil pour la
subvention publique est de 7%42.
Le montant transfr aux partis politiques ou aux candidats peut
tre soit un montant fixe soit un montant proportionnel au pourcentage des
votes ou des siges. Les Etats, en gnral, adoptent un systme qui
combine ces deux mthodes. Ce qui dtermine la mesure de laugmentation
du pouvoir comptitif des nouveaux partis et des petits partis face aux
grands partis ayant plus de ressources et ce qui facilite lentre des
nouveaux partis sur la scne politique est le mthode de lallocation de la
subvention publique. Cette subvention, pour quelle puisse satisfaire sa
raison dtre, ne doit pas tre exclusivement lie au support lectoral des
partis. En Hongrie, 25% de la subvention publique est distribue en parts
gales aux partis ayant des siges au parlement et 75%, selon le
pourcentage des votes. En Rpublique tchque, un parti doit avoir reu au
40
LARRIEU, p.187. 41
BIEZEN, p.49- 50. 42
Loi sur les partis politiques (LPP) (Siyasal Partiler Kanunu, No: 2820, J.O.: 24.4.1983- 18027), art. annexe 1/4.
-
30
moins 3% des votes pour pouvoir profiter de la subvention publique.
Ensuite, cette subvention est distribue en parts de 0,1%, 3% et 5% selon
le pourcentage des votes reus. De plus, une subvention annuelle fixe par
sige est prvue. LAllemagne prvoit 0,85 euro pour les premiers 4 millions
de votes et 0,7 euro pour le reste43. Dans la Fdration de Russie, en
Azerbadjan et en Thalande, la subvention publique est distribue aux
partis en parts gales44. La subvention des partis politique par lEtat na pas
pour fonction de rcompenser les partis qui reoivent un soutien populaire
lev. Pour cette raison, les rglementations concernant les subventions
publiques doivent prvoir la distribution galitaire et quitable de ressources
fondamentales ncessaires pour les travaux lectoraux tous les partis et
tous les candidats qui peuvent influencer les lections45. Un pays o les
subventions publiques sont dtermines selon le nombre des siges dans un
systme lectoral inquitable de manire mpriser les minorits
supporterait financirement, en effet, le dsquilibre du systme lectoral46.
En Turquie, le seuil lectoral national de 10%, sans prcdent dans les pays
dmocratiques, est galement la condition pour profiter de la subvention
publique qui correspond 1/2500 des revenus du budget47.
Face au risque que les partis arrtent le contact avec la base
politique et se centralisent en comptant sur cette subvention, la subvention
publique doit tre la fois quitable et modre48.
43
BIEZEN, p.47- 48. 44
TJERNSTRM, p.209- 213. 45
GENKAYA, p.140. 46
BIEZEN, p.48 47
LPP art. annexe 1/1. 48
Ce principe correspond larticle 68 de la Constitution turque avec le concept suffisant et quitable, conformment aux standards internationaux du financement public des partis politiques. Cependant, la pratique est perptue laide des rglementations lgales anticonstitutionnelles. La subvention suffisante signifie un niveau qui supporte les organisations politiques petites et faibles et les partis pour quils puissent achever leur but de produire de la politique et quils ne soient pas subordonns aux donneurs privs. Il ne sagit pas du financement de toutes les dpenses des partis politiques; en effet, les partis politiques ne sont pas des organes de lEtat. Conformment leurs motifs dmocratiques, ils doivent rester des personnes prives. Pour cette raison, personne ne peut tre oblig
-
31
En France, la limite maximale de la subvention publique est 73
millions deuros qui correspondent 1/3200 du budget de 200749, lesquels
sont distribus entre plus de cinquante partis et organisations politiques50.
Au Portugal, lequel est un exemple plus similaire la Turquie avec son
niveau de vie relativement plus bas, son exprience dmocratique
relativement rcente et les membres des partis moins nombreux, le
montant annuel allou aux partis politiques est li au salaire minimum. Pour
chaque vote reu pendant la dernire lection parlementaire, les partis
politiques reoivent 1/225 du salaire minimum titre de subvention. 20%
de ce montant sont distribus de manire gale entre les partis et les
candidats et les 80% restants, selon le rsultat des lections51. En Turquie,
de financer les partis politiques totalement. En vue de donner aux petits partis une chance raliste, il est raisonnable de considrer une subvention minimale distribue en parts gales ajoute un montant proportionnel la taille des partis pour quils puissent avoir une existence oprationnelle. (NASSMACHER, Karl- Heinz: Political Parties, Funding and Democracy, Funding of Political Parties and Election Campaigns, International IDEA, Trydells Tryckeri EU, Sude, p. 14). part cela, les partis politiques doivent survivre laide du soutien quils reoivent du peuple. Comme cela rendra les partis politiques financirement dpendants au peuple, cela entranera une politisation du peuple de leur part, conformment leur raison dtre dmocratique. La distribution quitable de la subvention publique doit aussi tre dtermine en tenant compte des deux principes prcits. En Turquie, par contre, les consquentes subventions publiques dont seulement quelques partis peuvent profiter constituent presque la totalit du revenu de certains partis. AKP est un exemple stupfiant de cette situation. Le pourcentage de la subvention publique dans les revenus dAKP remonte 90%. Les 10% restants se composent essentiellement des revenus du patrimoine acquis principalement par largent public (Voir le bilan de revenu- dpense du Centre gnral dAKP entre 1.1.2013- 30.11.2013, http://www.akparti.org.tr/site/akparti/gelir-gider). En consquence du systme financier public antidmocratique, AKP est devenu un vritable organe dEtat du point de vue financier avec son budget de 151 millions grce son pourcentage de vote lev, la liquidit venant des annes prcdentes et les revenus de dpts bancaires ainsi que de la subvention publique indirecte. Linstitution de la subvention des partis politiques par lEtat cre mme des revenus dintrt cause de lutilisation arbitraire (sans rapport la raison dtre dmocratique de linstitution) de largent public. Ainsi, les partis politiques ralisent leurs propagandes politiques laide de la presse crite et visuelle, qui est trs chre (UZUN, p.185) Cela transforme les campagnes lectorales en des oprations dispendieuses de commercialisation et dtruit la dignit des lections. Dautre part, la mme situation cre un dsavantage considrable de concurrence pour les organisations plus petites et rend leur libert dexpression politique inutilisable. (Voir TBB Anayasa nerisi (Proposition de constitution du TBB (lUnion des barreaux de Turquie)) a.45/ 5,6,7 et leurs motifs, Editions Trkiye Barolar Birlii: 131, 4
e
dition, Ankara, p.96 et suiv). 49
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLR2011/PLR2011.pdf, p.15.
50 Snat, Le financement de la vie politique,
http://www.senat.fr/role/fiche/financ_vie_pol.html. 51
BIEZEN, p.51- 52.
http://www.akparti.org.tr/site/akparti/gelir-giderhttp://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLR2011/PLR2011.pdfhttp://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLR2011/PLR2011.pdfhttp://www.senat.fr/role/fiche/financ_vie_pol.html
-
32
1/2500 du budget gnral est distribu entre les partis qui ont dpass le
seuil lectoral de 10% et qui avaient le droit de participer aux dernires
lections nationales. Cette subvention est multiplie par trois en priode
dlection nationale et par deux, en priode dlections municipales. En plus
de cette allocation, le budget contient une allocation supplmentaire pour la
subvention des partis politiques qui ont reu plus de 7% des votes52. Les
candidats indpendants, pourtant, ne peuvent pas profiter de ces
subventions pour entendre leurs voix53. cause de ce montant immodr
de subvention et de cette mthode dsquilibre de distribution, lallocation
du budget pour les partis politiques est distribue entre trois partis depuis
2007. Le montant total que nous avons transfr ces trois partis (AKP,
CHP, MHP) est 456 millions de livres turques (TL) juste pour 2011 et 2012
et juste en tant quaide directe.
Il est important que le montant de la subvention soit fix par une
loi. Sinon, le parti au pouvoir peut en abuser. Par exemple, en Autriche, la
subvention qui tait 4 millions de schillings autrichiens est remonte 14
millions en 1985 et a diminu de 3 millions en 1987 avec lentre de 8
parlementaires du Parti vert54. En Turquie aussi, les aides ont t doubles
par une loi transitoire de 1991 qui a ensuite t rendue permanente55.
Les partis politiques ont adopt des lois qui leur permettent de
mettre les subventions dans leurs caisses immdiatement. Selon la Loi sur
52
LPP art. annexe 1. 53
Le droit dlire, dtre lu et de sengager aux activits politiques prvu larticle 67 de la Constitution de la R.T. nonce que le droit politique des citoyens consiste sengager dans des activits individuellement ou au sein dun parti politique. Par contre, le fait que les candidats indpendants se trouvent face des candidats profitant de la subvention publique constitue une violation de larticle 67 de la Constitution. (IIK, H. Fehim: Parti i Demokrasi Asndan Yasa Deiiklii Gerei (La Ncessit damendement du point de vue de la dmocratie interne des partis politiques), Anayasa Yargs Dergisi, V. 16, 1999, p. 357).
54 BIEZEN, p.48.
55 YKSEL, Nahit: Siyasetin Kamusal Finansman (Financement public de la politique), T.C.
Maliye Bakanl Strateji Gelitirme Bakanl Edition No: 2007/373, Ankara 2007, p.95, 97.
-
33
les partis politiques (LPP)56, ces subventions sont payes dans les 10 jours
suivant lentre en vigueur de la loi du budget gnral annuel. Les
paiements multiplis des annes dlection sont faits dans 10 jours suivant
la dcision de la Commission lectorale centrale (YSK) concernant le
calendrier de llection57.
Dans les pratiques dmocratiques, les dpenses que les partis et les
candidats peuvent faire sont limites lgalement en quantit ainsi quen
qualit. Par consquent, les dpenses permises sont numres dans les
lois de plusieurs pays europens et la limite maximale de dpenses pour les
lections parlementaires, municipales et du Parlement europen est fixe,
gnralement de manire proportionnelle aux nombres dlecteurs58. En
Turquie, par contre, il ny a aucune limitation sauf la disposition qui nonce
que les dpenses des partis politiques doivent tre conformes leurs
objectifs. De plus, les revenus et les dpenses des candidats ainsi que les
revenus et les dpenses en nature et en service des partis sont hors
contrle59. GRECO (le Groupe dEtats contre la corruption) a recommand
la Turquie de limiter les dpenses, en particulier celles de campagne, des
partis politiques60. Une enqute effectue en Turquie dmontre que 91,8%
du peuple pense que les articles de dpenses de campagnes lectorales
doivent tre dtermins de manire claire. La mme enqute dmontre
aussi quune grande majorit du peuple pense que les dpenses lectorales
des partis et des candidats doivent tre effectues, non en espce, mais en
56
Siyasi Partiler Kanunu (No: 2820, R.G: 22.4.1983- 18027). 57
LPP a. annexe 1/2 et 5. 58
Voir Direction de lInitiative Parlementaire er des Dlgations, Note sur la limitation des dpenses lectorales et les comptes de campagne, dcembre 2010, http://www.senat.fr/lc/lc212/lc212.pdf et UZUN, p.76- 79.
59 KIRBA, p.188, 207.
60 GRECO, Rapport dvaluation de la Turquie sur la transparence du financement des partis
(GRECO), Strasbourg 22- 26 mars 2010 p.18, http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uluslararas%C4%B1_isbirligi/uluslararasi_orgutler/greco_turkiye_raporlar/TEMA%20II%20-%20greco_siyasi_partiler.pdf.
http://www.senat.fr/lc/lc212/lc212.pdfhttp://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uluslararas%C4%B1_isbirligi/uluslararasi_orgutler/greco_turkiye_raporlar/TEMA%20II%20-%20greco_siyasi_partiler.pdfhttp://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uluslararas%C4%B1_isbirligi/uluslararasi_orgutler/greco_turkiye_raporlar/TEMA%20II%20-%20greco_siyasi_partiler.pdf
-
34
chque pour un meilleur contrle et que les dpenses lectorales doivent
tre limites61.
Dans les pays dEurope occidentale, parfois le support direct aux
institutions de recherche et de formation des partis ainsi quaux branches
femmes et branches jeunesse des partis peut dpasser62 le montant
transfr au centre du parti. En Turquie, par contre, ces aides sont
transfres aux centres gnraux des partis. Le fait que lallocation de cette
subvention aux organisations locales et aux institutions associes charges
des activits de formation et de recherche est exclusivement dtermine
linitiative du centre entrane la centralisation et lanti-dmocratisation des
partis63.
Quant la subvention publique indirecte des partis politiques, le
moyen gnralement utilis pour encourager les dons privs aux partis
politiques est dexonrer les dons au dtriment du trsor public ou de les
rendre dductibles. Pour viter de supporter les donneurs riches par ce
systme davantage fiscal et pour ne pas crer un obstacle devant lgalit
des chances entre les partis, ces avantages fiscaux doivent tre limits aux
dons dimportance faible ou moyenne. De ce fait, la Cour constitutionnelle
allemande a jug, en 1958, que lavantage fiscal gal pour tous les
donneurs est anticonstitutionnel. En effet, les personnes haut revenus et
les partis drivs de cette section de llectorat profitent davantage de ces
avantages par rapport aux autres. Dans plusieurs pays, il ne sagit daucune
rduction fiscale concernant les dons et les cotisations. On peut citer le
61
SUSMU, p. 11. 62
GENKAYA, p. 148. 63
UZUN, p.182-183.
-
35
Royaume Uni avec le motif de refus de toutes subventions publiques en
faveur des partis politiques64.
B. Un parlement en dficit de reprsentation
Le droit au budget, c'est--dire le droit de dcider comment
partager au sein de la socit la richesse produite dans un pays par le biais
des politiques de dpenses publiques ainsi que des politiques fiscales et de
gestion des biens publics65; est un droit relevant de l'Etat. L'Etat cependant;
-avant la reconnaissance de l'Etat de droit dmocratique actuel- a eu
diffrentes significations au cours de l'volution de l'histoire fiscale.
La personnalit juridique de lEtat n'a pas longtemps t admise,
except celle de la couronne66. Par consquent, les revenus et les dpenses
qui sont aujourd'hui considrs comme public; ont t raliss
auparavant, au sein de la proprit prive du monarque67. Donc, il n'existait
pas dans les temps anciens une distinction entre finance prive et finance
publique.
La conception dintrt public a merg antrieurement aux
concepts de personnalit publique, proprit publique et finances
publiques.
64
BIEZEN, p.44-45. 65
AAN, p.183. 66
DOEHRING, Karl: Genel Devlet Kuram (Thorie gnrale de lEtat), nklap Kitabevi, Ankara 2002 (traduit par: Ahmet Mumcu), p.48.
67 JOUANNET, Emmanuelle: De La Personnalit et La Souverainet de lEtat dans la
Constitution de 58. Thorie Franaise de lEtat et Intgration Europenne, La France et Le Droit International, Pedone, Paris 2007, par.10-2.
-
36
En prcisant les charges financires et en crant les assembles des
reprsentants du peuple dont les charges exceptionnelles sont soumises
leur approbation, La Magna Carta68 est dcrite comme la premire
acquisition de la lutte pour la dmocratie dans lhistoire. Nanmoins,
l'augmentation des dpenses militaires, notamment pendant la guerre de
Cent Ans, a conduit le Roi remettre en cause le caractre exceptionnel et
fond sur le consentement du Parlement de ses revenus perus sous le nom
daide69. Dautre part, le Roi esprait briser le pouvoir de l'Eglise, son rival
politique70. Durant la mme priode, les bourgeois ayant augment
l'accumulation du capital la suite de lextension des possibilits de
commerce; ont eu, la ncessit d'un modle d'organisation centralise
comportant un systme juridique, administratif et de scurit stable et
uniforme leur garantissant leurs activits commerciales, acclrant
l'accumulation du capital et permettant galement de protger leurs intrts
l'extrieur du pays est apparue71. En instituant l'Arme royale
permanente, L'Ordonnance royale de 1439 a rpondu la demande de
scurit des bourgeois comme la justification de lgitimit des charges
financires recueillies auprs du peuple. Dsormais, les impts la charge
du peuple et le service militaire obligatoire seront utiliss pour l'arme
permanente qui est au service du Royaume, et non pas pour l'arme prive
du Roi combattant pour le Roi72. Ainsi, la fin du Moyen-Age l'impt, outre
le fait quil signifie la suppression de corves, a permis de renforcer le
sentiment d'appartenance une communaut dorigine. Afin d'assurer la
continuit de l'impt, le monarque doit se montrer comme le garant
d'intrt gnral. Dans ce sens, en plus de la scurit nationale qu'il assure
68
Pour la traduction partielle en turc voir MUSULIN, Janko: Hrriyet Bildirgeleri (Les Dclarations de liberts), Editions Belge, stanbul 1983 (traduit par: Necmi Zeka), p.30-33.
69 FEYZOLU, p.4-5; MONNIER, Jean- Marie: LImpt et La Contrainte ou La Dialectique de
lAutonomie et de la Responsabilit, European Journal of Economic and Social Systems, V.19, N.1, p.99. 70
KAPAN, Mnci: Politika Bilimine Giri (Introduction la Science politique), Bilgi, 23. Edition, Ankara 2009, p.59.
71AKIN, lhan: Kamu Hukuku (Droit public), Beta, 5
e dition, stanbul 1987, p.76.
72MONNIER, p.99.
-
37
avec son arme permanente, le monarque est la force motrice du
dveloppement conomique; il organise par exemple la tche d'irrigation
des terres. Une fois encore, le monarque rgit la relation entre les individus
et leur Dieu en exerant les activits religieuses. D'autre part, une
administration fiscale a t tablie pour la dtermination de ce qui serait
impos et du montant maximal qui n'empchera pas la reproduction de la
richesse73.
La notion de souverainet a vu le jour au cours de cette priode74.
La perception de la souverainet de Bodin qui rejette le fodalisme et toutes
autres formes de systmes politiques mixtes dans lesquels le peuple et les
aristocrates partagent le pouvoir politique avec le souverain75 a t utilise
comme une affirmation politique par les Rois, aussi bien l'intrieur
(contre les seigneurs fodaux) qu' l'extrieur du pays (contre la Papaut et
l'Empire romain-germanique) pour exprimer qu'ils ne reconnaissaient pas
un pouvoir rival contre eux-mmes76. En consquence, la monarchie fodale
a laiss sa place la monarchie absolue, institutionnalise de manire
centrale dans le pays et souveraine pour l'intrt public. Sur cette
structure juridique, ont commenc tre fonds les Etats-nations,
aujourd'hui admis comme des Etats modernes.
L'influence de la philosophie des Lumires sur la vie politique a
conduit une rupture conceptuelle dans l'identit des concepts de l'Etat et
du souverain. Il est possible d'observer cette volution dans la clbre
citation de Frdric le Grand, qui se dsignait lui-mme comme le premier
serviteur de l'Etat. Mais le monarque demeure la personne inviolable et
irresponsable et ne peut tre poursuivi devant la justice du fait dune
73
ARDANT, Gabriel: Histoire de lImpt, C.1, Fayard, Paris 1971, p.431. 74
KAPAN, p.59. 75
AKIN, p.92-93. 76
KAPAN, p.59.
-
38
injustice quil aurait engendre. A la suite de cette situation qui suscitait de
plus en plus d'agitation, un trsor public, outre la fortune du monarque, a
t cr dans certaines limites comme une grce du Roi77.
La philosophie des Lumires a t l'une des raisons qui a facilit la
naissance de la monarchie constitutionnelle aprs la rvolution de 1789.
Dans une monarchie constitutionnelle, le monarque avec les reprsentants
du peuple constituait les deux partenaires du pouvoir de lEtat78.
R. Carr de Malberg exprime que dans la Constitution franaise de
1791 instaurant le rgime rpublicain la place de la monarchie, le
constituant a identifi l'Etat et le peuple ou nation en utilisant la notion de
la souverainet nationale: la Nation en tant que personne sappelle
lEtat79.
En revanche, l'Etat comme personne morale de droit public ne
devient llment principal de la thorie de lEtat en France qu' partir de la
troisime Rpublique. Cette construction juridique a t utilise pour la
reconnaissance de la souverainet nationale contre le Parlement qui tait
dot d'une autorit large et illimite durant la troisime Rpublique. Les
tudes de J. Chevallier et M.J. Rdor dmontrent bien la stratgie de la
littrature de cette poque qui tait de transformer l'Etat lgal de 1875 en
un Etat de droit (l'Etat limit par le droit dans lequel le Parlement et la loi
sont eux-mmes soumis au droit). Depuis, l'Etat est le statut de la
communaut souveraine compose d'individus ayant acquis la personnalit
morale80. Le systme budgtaire franais a ainsi atteint sa maturit cette
77
DOEHRING, p.49. 78
DOEHRING, p.49. 79
JOUANNET, par.6. 80
JOUANNET, par.9.
-
39
poque et le Dcret rglementant la comptabilit publique est pris comme
modle par de nombreux pays tels que la Turquie, dans la construction de
systmes budgtaires81.
Le droit au budget constitue donc aujourd'hui, comme tous les droits
rsultant de lexistence dun Etat de droit dmocratique, un droit qui
appartient au peuple. Le peuple peut exercer ce droit directement ou
indirectement par l'intermdiaire de reprsentants. Lgalit politique exige
que chacun puisse influencer la gestion publique. En dmocratie directe
applique dans les communes et les cantons en Suisse, le droit au budget
est exerc par des citoyens qui votent pour les recettes et dpenses
publiques aprs en avoir discut dans des forums82. En revanche, dans les
dmocraties semi-directes dans lesquelles les techniques de dmocratie
directe sont appliques, les citoyens peuvent tre directement impliqus
dans le processus lgislatif travers le droit de veto lgislatif, l'initiative de
lgislation du peuple et le rfrendum83.
Le droit au budget en Turquie a t utilis jusqu' ce jour dune
faon reprsentative par lentremise du Parlement. Dans les tudes sur la
dmocratie, une importance spciale est attribue aux parlements. En ce
sens, on insiste sur la ncessit de laugmentation du rle et des
comptences budgtaires des parlements. Dans ce cas, en tenant compte
du fait que le gouvernement, aujourdhui, est pour la plupart form par des
dputs lus contrairement au pass, il est possible de se demander ce qui
lui impartit un statut dmocratique ce point exceptionnel.
81
FEYZOLU, p.6. 82
KABOLU, Anayasa, p.176. 83
KABOLU, Anayasa, p.185 et suiv.
-
40
Le gouvernement est form par un nombre suffisant de dputs,
cest--dire un nombre permettant datteindre le vote de confiance. Si un
parti possde une majorit suffisante pour former un gouvernement de parti
unique, le leader ou un autre membre dsign peut former le gouvernement
en qualit de premier ministre et obtenir le vote de confiance sans difficult
grce sa majorit parlementaire. En revanche, pour que le leader ou un
autre membre dsign dun parti minoritaire forme le gouvernement, il est
ncessaire quil ait le soutien des autres partis. Donc, la majorit du
parlement est encline supporter le gouvernement.
Toutefois, le parlement est une institution o toutes les opinions
politiques ayant un certain soutien dans la socit doivent tre
reprsentes. Limportance attache au parlement provient du fait que la
voix de lopposition ne peut se faire entendre que dans celui-ci.
Cependant, le systme politique turc, qui comporte un barrage
lectoral territorial de 10%, a une valeur dmocratique limite84. La valeur
attribue au parlement en Turquie nest pas la dmocratie, mais le fait que
ressortent, en assurant la majorit dun seul parti, des gouvernements qui
resteront longtemps au pouvoir. Pour la premire fois depuis 1983 o le
barrage de 10% a t mis en place, 45% des voix ont t exclues aux
lections nationales de 2002 et le parti AKP a obtenu 66,4% des siges, ce
qui constitue une majorit presque suffisante pour amender la constitution,
avec seulement 34,4% des voix. On pense que la confiance en la justice,
une autre institution constitutionnelle, prvient une crise de lgitimit
cause par cette majorit parlementaire artificielle85.
84
KABOLU, p.195- 196. 85
SABUNCU, Yavuz: Seim Barajlar ve Siyasal Sonular (Seuils lectoral et ses effets politiques), Anayasa Yargs: 23, Editions dAnayasa Mahkemesi, Ankara 2006, p.193, 195-197.
-
41
En plus du barrage lectoral, la Turquie est un pays o la culture
dmocratique ne trouve pas son reflet au sein du gouvernement. Le leader
de lAKP qui est seul au pouvoir depuis 2002 rpond toutes demandes et
rsistances dmocratiques, quelles sexpriment au niveau national ou local,
avec un discours de rgler les comptes aux urnes. La mme culture
dmocratique est aussi partage par les autres dputs du parti. Selon une
tude base sur le compte de Twitter officiel de la Grande assemble
nationale de Turquie (TBMM), pendant quatre-cent-quarante jours entre
2012 et 18me juin 2013, lensemble des cinquante motions dinvestigation
propos par lAKP a t approuv alors que lensemble des deux cent seize
propos par lopposition concernant des sujets divers des droits sociaux la
libert dexpression, de la loi des forts au dficit public a t refus86. Le
TBMM ne partage pas dinformation qui rendrait une telle analyse possible.
Les dputs du mme parti ont collectivement refus une proposition de loi
dpose par leur parti quand lopposition a vot positivement, en pensant
quelle tait propose par lopposition87.
Il y a certaines mthodes utilises afin de rendre possible la force
effective de lopposition dans le domaine de la gestion financire. Lune est
de permettre lopposition de prsider les comits financiers. Dans plusieurs
pays, le prsident de la commission des comptes dfinitifs est
traditionnellement dsign parmi les membres de l'opposition. Cela convient
la tradition non partisane du systme de Commission des comptes
publics88. Une telle tradition nexiste pas en Turquie. Une majorit qualifie