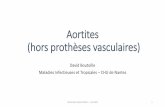Affections cardio-vasculaires chez les patients à...
Transcript of Affections cardio-vasculaires chez les patients à...

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
1
CHU Treichville Abidjan : 1 Institut de Cardiologie d’Abidjan 2 Clinique de maladies infectieuses et tropicales
C Adresse pour correspondance : Professeur agrégé Anzouan-Kacou J. B. Ŕ Service des explorations externes, Institut de Cardiologie d’Abidjan. BP : V 206 Abidjan - République de Côte d’Ivoire. Mail : [email protected] Fax : + 225 21 25 92 10
AArrttiiccllee oorriiggiinnaall.. OOrriiggiinnaall AArrttiiccllee
Affections cardio-vasculaires chez les patients à sérologie VIH positive non traités par
anti-rétroviraux.
Cardiovascular diseases in HIV patients not receving antiretroviral therapy.
ANZOUAN-KACOU J.B. 1, DOGOUA P. 1, KONIN C. 1, COULIBALY I. 1, OUATTARA I. 2, EHOLIÉ S.P. 2, ABOUO-N’DORI R. 1
Le but de notre étude était de décrire les atteintes cardiaques et vasculaires rencontrées chez les patients infectés par le VIH et non traités par anti-rétroviraux. Il s’agit d’une étude rétrospective, portant sur l’analyse des dossiers de patients hospitalisés de janvier 2001 à février 2007 (6 années) à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan (Côte d’Ivoire). 244 patients ayant bénéficié d’une sérologie VIH ont été répartis en deux groupes : Groupe S+ (119 patients ayant une sérologie VIH positive ) et Groupe S- (125 patients ayant une sérologie VIH négative). L’âge, le sexe, les motifs de consultation, les données de l’examen clinique, les diagnostics lésionnels, les principaux traitements médicamenteux et l’évolution ont été comparés entre les 2 groupes. La série se composait de 137 hommes (56,1%) et de 107 femmes (43,9 %) d’âge moyen de 37,9 +/-13 ans, superposable dans les 2 groupes. La dyspnée et la toux constituaient des motifs statistiquement plus fréquents dans le groupe S+. L’état général était moins souvent bon dans le groupe S+ (28,2 % vs 57,7 %, p = 0,000005). Les patients S+ étaient plus souvent hospitalisés pour péricardite liquidienne (41,1 % vs 20 %, p = 0,003) et hypertension artérielle pulmonaire d’allure primitive (10,9 % vs 0,8 %, p = 0,0006). Il existait une plus forte prévalence de cardiomyopathie dans la population S+ que dans la population S- (42,8 % vs 31,2 %, p = 0,05), à la limite de la significativité statistique. L’évolution hospitalière était favorable chez 89,9 % des patients dans le groupe S+ et 90,4 % des patients dans le groupe S- (p = 0,89). Le taux de perdus de vue à 1 mois était plus important dans le groupe S+ (46,2 % vs 32,8 %, p = 0,03). Ce travail souligne la fréquence particulière des péricardites, des hypertensions artérielles pulmonaires d’allure primitive et des cardiomyopathies et donc la nécessité de dépister
l’infection à VIH chez les patients atteints de ces pathologies. Maladies cardio-vasculaires, VIH-SIDA.
RESUME
MOTS CLES
We aimed to describe cardio-vascular manifestations in patients
infected with HIV and not receiving anti-retroviral therapy. This is a
retrospective study based on the analysis of records of patients
hospitalized from January 2001 to February 2007 (6 years) at the
Institute of Cardiology of Abidjan (Côte d'Ivoire).
244 with HIV screening results were divided into two groups : Group
S +: (119 HIV positive patients) , group S- (125 HIV negative
patients). The parameters of age, sex, reasons for consultation, data
from clinical examination, echographic parameters, main drug
treatments and trends were compared between the 2 groups. The series
consisted of 137 men (56.1%) and 107 women (43.9%), mean age 37.9
+ / -13 years, superimposable in the 2 groups. Dyspnea and cough
were statistically more frequent patterns in group S +. The general
condition was less often good in the S + group (28.2% vs. 57.7%, p =
0.000005). S + patients were more hospitalized with pericarditis
(41.1% vs 20%, p = 0.003) and pulmonary hypertension (10.9% vs
0.8%, p = 0.0006 ). There was trend towards a higher prevalence of
cardiomyopathy in the group S+ (42.8% vs. 31.2%, p = 0.005).
Clinical outcome was similar into the 2 groups: the in hospital
evolution was favorable in 89.9 % of patients in the group S+ and in
90.4 % in the group S- (p = 0.89). The rate of lost patients at 1 month
was greater in the group S+ (46.2% vs. 32.8%, p = 0.03). We
emphasize the particular frequency of pericarditis, pulmonary arterial
hypertension and cardiomyopathies and hence the need to detect HIV
infection in these conditions.
Cardiovascular diseases, HIV-AIDS.
SUMMARY
KEY WORDS

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
2
INTRODUCTION
L’infection à VIH est devenue une cause majeure d’atteinte cardiaque, vasculaire, et d’insuffisance cardiaque [1]. Ces atteintes sont multifactorielles, pouvant être liées au virus lui-même ou aux affections opportunistes [1,2]. Leur prévalence est mal connue et varie largement entre 30 et 80 % en fonction de la définition de l’atteinte cardiaque, de la méthode de dépistage et du niveau d’immunodépression [1 Ŕ 4]. Leurs expressions cliniques parfois dissimulées par les manifestations extracardiaques peuvent engager le pronostic vital des patients. Au cours de l’infection par le VIH, toutes les tuniques cardiaques peuvent être touchées [5], rendant compte du polymorphisme des tableaux cliniques. Le but de notre étude était de décrire les atteintes cardiaques et vasculaires rencontrées chez les patients infectés par le VIH et non traités par anti-rétroviraux.
MATERIEL ET METHODE Il s’agit d’une étude rétrospective, transversale, portant sur l’analyse des dossiers de patients hospitalisés sur une période de 6 années, de janvier 2001 à février 2007, à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan (Côte d’Ivoire).
Critères d’inclusion Ont été inclus tout patient d’âge supérieur ou égal 18 ans, hospitalisés à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan, ayant fait l’objet d’une demande de sérologie VIH avec résultat documenté.
Critères de non inclusion Les patients ayant un résultat de sérologie VIH discordant, des facteurs de risques cardio-vasculaires préexistants, ceux qui ont pris des anti-rétroviraux, ou qui ont eu une sérologie VIH dans le cadre d’un bilan systématique en vue d’une intervention chirurgicale, n’ont pas été inclus. Dans la période considérée, nous avons répertorié 1180 demandes de sérologie. En
tenant compte de nos critères de sélection, nous avons retenu 244 patients. Ceux-ci ont été répartis en deux groupes : Groupe S+ : 119 patients ayant une sérologie VIH positive. Groupe S- : 125 patients ayant une sérologie VIH négative.
Paramètres analyses L’âge, le sexe, les motifs de consultation, les données de l’examen clinique, les diagnostics lésionnels et les principaux traitements médicamenteux ont été analysés. L’évolution clinique a également été étudiée. L’évolution favorable était définie par une amélioration et une disparition des signes cliniques à la sortie du malade. Une évolution défavorable était définie par le décès des malades en hospitalisation. Le taux de perdus de vue à un mois de la sortie de l’hospitalisation a été évalué. Etaient considérés comme perdus de vue les patients ne s’étant pas présentés en consultation de contrôle 1 mois après l’hospitalisation.
Analyse statistique Les résultats des différents paramètres ont été analysés par le logiciel Epi Info 6.04 (CDC Atlanta). Les variables continues ont été exprimées sous forme de moyenne plus ou moins la déviation standard. La comparaison des moyennes entre les 2 groupes a été réalisée par analyse des variances (test t de Student pour 2 échantillons) ; celle des proportions entre les 2 groupes a été effectuée par le test de test de chi 2. Une valeur de p < 0,05 était considérée comme étant statistiquement significative.
RESULTATS La série se composait de 137 hommes (56,1%) et de 107 femmes (43,9 %) avec un sex ratio H/F de 1,2. L’âge moyen était de 37,9 +/-13 ans avec des extrêmes de 18 et 88 ans (tableau I). La moyenne d’âge était superposable dans les 2 groupes. Dans le groupe S+, 94 patients (79 %) étaient infectés par le VIH1, 9 patients (7,6 %) étaient infectés par le VIH 2 et 16 patients (13,4 %) présentaient une co-infection VIH1-VIH2.

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
3
Dans la population générale d’étude, les 6 principaux motifs de consultation étaient la dyspnée (67,6 % des motifs), la toux (22,1 %), un œdème unilatéral inflammatoire (15,6 %), des œdèmes des membres inférieurs non inflammatoires (15,6 %), la douleur thoracique (14,3 %) et la cardiomégalie radiologique (6,6 %). La comparaison de la prévalence de ces motifs dans les 2 groupes apparaît dans le tableau 1. La dyspnée et la toux constituaient des motifs statistiquement plus fréquents dans le groupe S+. L’état général était moins souvent bon dans le groupe S+ (28,2 %) que dans le groupe S- (57,7 %), p = 0,000005. Le tableau II résume les diagnostics lésionnels retrouvés chez tous les patients et permet la comparaison entre les 2 groupes S+ et S-. Les patients S+ étaient de façon statistiquement significative plus souvent hospitalisés pour péricardite liquidienne et hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) d’allure primitive. Toutes les péricardites liquidiennes ont été considérées comme étant d’étiologie tuberculeuse, sur la base d’épanchements exsudatifs et lymphocytaires. Il existait une tendance à une plus forte prévalence de cardiomyopathie dans la population S+ que dans la population S-, à la limite de la significativité statistique. Les traitements digitaliques et anti-tuberculeux étaient significativement plus utilisés dans le groupe S+. Les anti-arythmiques étaient plus utilisés dans le groupe S- (tableau III). Pour l’ensemble des patients de la série, l’évolution hospitalière a été jugée favorable pour 215 patients (88,1% des patients). L’évolution a été favorable chez 107 patients dans le groupe S+ (89,9 %) et chez 113 patients dans le groupe S- (90,4 %), p = 0,89 Le taux de perdus de vue à 1 mois était de 39,3 % sur l’ensemble de la population d’étude. Ce taux était de 46,2 % dans le groupe S+ et de 32,8 % dans le groupe S- (p = 0,03).
DISCUSSION
Cette étude rétrospective connaît des limites. La sélection des patients a été réalisée dans les registres d’archivage, sur la base des résultats des sérologies VIH. Celles-ci n’ont pas été toujours réalisées systématiquement et consécutivement. Les sérologies étaient
demandées sur une suspicion clinique en fonction de l’état général, des antécédents des patients et des pathologies retrouvées (par exemple la péricardite), faisant suspecter un terrain d’infection VIH. La non évaluation du taux de CD4 et de la charge virale de façon systématique chez les patients S+ entraîne une impossibilité d’évaluer avec exactitude le niveau de dépression immunitaire et ainsi d’identifier le type d’affection cardio-vasculaire en fonction du niveau de dépression. Les stades de séropositivité et de SIDA maladie n’ont pas pu être clairement identifiés. Il n’existait pas de renseignement fiable après un mois de suivi, notamment sur l’orientation des patients S+ vers les centres spécialisés pour la prise en charge de leur infection par le VIH. En tenant compte de ces limites , nous avons pu établir le panorama des atteintes cardiaques et vasculaires qui semblaient plus fréquentes en contexte d’infection à VIH, en comparant des patients à sérologie VIH positive avec des patients à sérologie VIH négative. La prévalence exacte de l’atteinte cardio-vasculaire au cours de l’infection à VIH est mal connue, variant largement entre 20 et 80 % en fonction de la méthode utilisée [1, 3,4]. Dans notre étude, les patients du groupe S+ étaient de façon statistiquement significative plus souvent hospitalisés pour péricardite liquidienne (41,1 % vs 20 %, p = 0,003, tableau II) et HTAP d’allure primitive (10,8 % vs 0,8 %, p = 0,006, tableau II). Il existait une tendance à une plus forte prévalence de cardiomyopathie dans le groupe S+ que dans le groupe S-, à la limite de la significativité statistique. La prévalence importante de la dyspnée (67,6 % des motifs) et de la toux (22,1 %), dans le groupe S+ pourrait s’expliquer par ces causes. Ces résultats corroborent plusieurs données de la littérature, en particulier avant l’ère des traitements anti-rétroviraux [2-5] . En Afrique Subsaharienne, les péricardites
liquidiennes sont très fréquentes avec une
prévalence hospitalière de 2,4 à 13,2 % [6].
Elles apparaissent souvent isolées et sont pour
la plupart inaugurales du SIDA, fréquemment
abondantes. Elles sont généralement associées
à la tuberculose [7-10]. En République
Démocratique du Congo, 70% des cas de
péricardites sont associés à une infection à VIH
[11].

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
4
Les séries autopsiques [12, 13] révèlent une prévalence de 10 à 64% de péricardite chez les patients infectés par le VIH. Il n’y aurait aucune corrélation entre le stade de l’infection à VIH et la survenue et l’importance de l’atteinte péricardique. Dans notre travail, nous n’avons pas pu classer de façon fiable le niveau de dépression immunitaire. Un épanchement péricardique serait associé à une plus grande mortalité chez le patient VIH + [14]. La tuberculose est retrouvée chez plus de 90 % des patients ayant un épanchement péricardique en Afrique du Sud et au Malawi [15 - 17]. Dans notre série, l’étiologie tuberculeuse a é été retenue chez tous les patients ayant une péricardite ; ce qui explique que le traitement antituberculeux était significativement plus prescrit chez les patients du groupe S+ que chez ceux du groupe S-. L’HTAP d’allure primitive (10,8 % de prévalence chez les S+ dans notre série) est également relativement fréquente en cas d’infection à VIH comparativement à la population générale (incidence de 1 / 200 comparativement à 1/200 000 [18]) et se retrouverait particulièrement chez les patients jeunes de sexe masculin. Il n’y a aucune relation entre sa survenue et le niveau de dépression immunitaire. Elle affecte environ 0,5 % des patients VIH + et est responsable au stade terminal d’insuffisance cardiaque droite sévère avec cœur pulmonaire et d’un fort taux de décès [19]. Sa pathogénie est multifactorielle et encore incomplètement élucidée. Le VIH pourrait être responsable d’une atteinte directe de l’endothélium vasculaire pulmonaire et de vasoconstriction par l’intermédiaire de l’endothéline, 1’interleukine 6 et de tumor necrosis factor. Le virus a été identifié dans des macrophages alvéolaires qui produisent des enzymes protéolytiques et du tumor necrosis factor en réponse à l’infection [20]. La tendance à une prévalence élevée des cardiomyopathies dans la population S+ a déjà été signalée dans la littérature. Dans notre série, la plus grande utilisation des digitaliques dans le groupe S+ par rapport au groupe S- (40,3 vs 23,2, p = 0,003) pourrait en être la conséquence. Les cardiomyopathies surviennent à un stade tardif de l’infection en contexte de réduction significative des lymphocytes CD4 [4, 5, 20]. Ces cardiomyopathies font généralement suite à un épisode de myocardite [4, 5]. La pathogénie
des lésions myocardiques au cours de l’infection à VIH associe l’infection directe des myocytes par le VIH avec ou sans co-infection à d’autres virus cardiotropes ou atteinte auto-immune faisant suite à une infection virale. La malnutrition et la cachexie y joueraient un rôle [4, 5]. Une équipe camerounaise rapporte une prévalence de 23,3 % de cardiomyopathies en contexte d’infection à VIH [21]. La prévalence de la dysfonction ventriculaire dans l’infection à VIH varie de 2% à plus de 40 %, l’insuffisance cardiaque symptomatique survenant chez 6 % d’entre eux, la plupart au stade de SIDA [22]. Le pronostic de ces atteintes myocardiques est mauvais, avec une médiane de survie de 101 jours après la découverte de l’insuffisance cardiaque, comparé à 472 jours de survie chez des patients ayant le même stade d’infection à VIH et ayant une échocardiographie normale [23]. Il faut relever la faible prévalence des valvulopathies et des endocardites infectieuses dans le groupe S+. Les endocardites valvulaires au cours de l’infection à VIH sont exceptionnellement infectieuses. Elles sont décrites dans moins de 10% des cas en Occident ; en Afrique elles seraient retrouvées chez 30 % des patients. Les endocardites marastiques abactériennes sont les plus fréquentes [24] mais sont devenues rares avec les progrès thérapeutiques. Le risque d’endocardite infectieuse est plus marqué chez le sujet VIH positif toxicomane [24]. Dans ce contexte, l’endocardite du cœur droit est la plus fréquente [24]. L’évolution a été favorable chez 107 patients dans le groupe S+ (89,9 %) et chez 113 patients dans le groupe S- (90,4 %), p = 0,89, rendant compte d’un pronostic hospitalier superposable entre les 2 groupes. Cet apparent bon pronostic a peu de signification car il s’agit d’un pronostic hospitalier immédiat. Le pronostic des atteintes cardiaques et vasculaires de l’infection à VIH s’établit mieux sur le moyen et le long terme [7]. Le taux de perdus de vue à 1 mois était de 53,8 % dans le groupe S+ et de 67,2 % dans le groupe S- (p = 0,03). La signification de ce taux est difficile à apprécier. Il pourrait s’agir d’un surcroit de mortalité à un mois de la sortie dans le groupe S+, ou de l’orientation vers les structures prenant en charge les personnes vivant avec le VIH.

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
5
CONCLUSION
L’infection à VIH, en dehors de tout traitement anti-rétroviral, est responsable de complications cardio-vasculaires. Celles-ci sont capables d’aggraver un pronostic déjà lourd. Ce travail souligne la fréquence particulière des péricardites, des hypertensions artérielles
pulmonaires d’allure primitive et des cardiomyopathies et donc la nécessité de dépister l’infection à VIH dans ces pathologies. Une attention particulière devrait donc être portée à ces patients non encore bénéficiaires d’une tri-thérapie anti-rétrovirale sans méconnaître le fait que ce traitement est lui aussi pourvoyeur de complications cardiaques et métaboliques.
Paramètres Population Total
n = 244 %
Groupe S+
n = 119 %
Groupe S-
n = 125 %
P
Age et sexe
Age (ans) ±13 37,9 ± 12 38,2 ± 13,6 37,6 0,7
Sexe masculin n (%) 137 56,1 68 57,1 69 55,2 0,75
Motif de consultation
Dyspnée n (%) 165 67,6 88 73,9 77 61,6 0,03*
Toux n (%) 54 22,1 32 29,4 22 17,6 0,02*
Œdème unilatéral inflammatoire n (%)
38
15,6
15
12,6
23
18,4
0,21
Œdèmes des membres inférieurs non inflammatoires n (%)
38
15,6
19
15,9
19
15,2
0,86
Douleur thoracique n (%) 35 14,3 19 15,9 16 12,8 0,4
Cardiomégalie radiologique n ( %)
16
6,6
11
9,2
5
4
0,09
Données d’examen
Insuffisance cardiaque globale
88
36
42
35,2
46
36,8
0,8
Insuffisance cardiaque droite
25
19,6
13
10,9
12
9,6
0,73
Insuffisance cardiaque gauche
16
6,5
8
6,7
8
6,4
0,9
* différence statistiquement significative.
Tableau 1
Caractéristiques d’âge et de sexe, principaux motifs de consultation et données d’examen clinique.

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
6
Tableau 3
Caractéristiques des médicaments utilisés
Traitement
Population
Totale
n =244 %
Groupe S+
n = 119 %
Groupe S-
n = 125
%
p
Diurétiques 115 47,5 54 45,3 61 48,8 0,59
Anticoagulants 81 33,3 36 30,2 45 36 0, 34
Digitaliques 77 31,6 48 40,3 29 23,2 0,003*
Antituberculeux 74 30,3 51 42,8 23 18,7 0,00003*
Antibiotiques 42 17,2 18 15,12 24 19,2 0,39
Anti-arythmiques 33 13,5 10 8,4 23 18,4 0,02*
Les données sont exposées sous la forme n (%). * différences statistiquement significative.
Tableau 2
Prévalence des principaux diagnostics lésionnels
Paramètres
Population Totale
n = 244 %
Groupe
S+
n = 119 %
Groupe
S-
n = 125 %
p
Cardiomyopathie dilatée hypokinétique
90
36,9
51
42,8
39
31,2
0,05
Péricardite liquidienne 74 30,3 49 41,1 25 20 0,003*
Valvulopathies 25 10,2 3 2,5 22 17,6 0,0001*
Thrombose veineuse profonde
43 36,1 18 15,1 25 20 0,31
HTAP d’allure primitive 14 5,7 13 10,9 1 0,8 0,0006*
Embolie pulmonaire 6 2,4 3 2,5 3 2,4 0,72
Endocardite infectieuse 6 2,4 0 0 6 4,8 0,04* Les données sont exposées sous la forme n (%). * différences statistiquement significative.

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
7
1. Hecht SR, Berger M, VanTosh A, Crokson S. Unsuspected cardiac
abnormalities in the acquired immune deficiency syndrome: an
echocardiographic study. Chest 1989; 96:805-808.
2. Martínez-García T, Sobrino JM, Pujol E, Galvez J, Benítez E,
Girón-González JA. Ventricular mass and diastolic function in
patients infected by the human immunodeficiency virus. Heart
2000; 84: 620Ŕ624.
3. Bissagnéné E, Eholié S, Kacou R, Kadio A. Guide pratique de
prescription des traitements antirétroviraux dans les pays à
ressources limitées. Cas de la Côte d’Ivoire. Edition 2005.UFR des
Sciences Médicales de Cocody, Département de Maladies
Infectieuses et Tropicale Université de Cocody, Abidjan, Côte
d’Ivoire.
4. Prendergast B. HIV and cardiovascular medicine. Heart 2003;
89:793-800.
5. Barbaro G, Di Lorenzo G, Grisorio B, Barbarini G. Gruppo
Italiano per lo Studio Cardiologico dei pazienti affetti da AIDS
Investigators. Cardiac involvement in the acquired
immunodeficiency syndrome: a multicenter clinicalpathological
study. AIDS Res Hum Retroviruses 1998; 14:1071Ŕ1077.
6. Kengne AP, Dzudie A, Sobngwi E. Heart failure in sub-Saharan
Africa: A literature review with emphasis on individuals with
diabetes. Vasc Health Risk Manag 2008: 4 ; 123 Ŕ 130.
7. Mayosi BM, Wiysonge CS, Ntsekhe M, Gumedze F, Volmink JA,
Maartens G, Aje A, Thomas BM, Thomas KM, Awotedu AA,
Thembela B, Mntla P, Maritz F, Blackett KN, Nkouonlack DC, Burch
VC, Rebe K, Parrish A, Sliwa K, Vezi BZ, Alam N, Brown BG, Gould
T, Visser T, Magula NP, Commerford PJ. Mortality in patients
treated for tuberculous pericarditis in sub-Saharan Africa. S Afr
Med J 2008 : 36-40.
8. Niakara A, Drabo YJ, Kambiré Y, Nebie LVA, Kaboré NJP, Simon
F. Atteintes cardiovasculaires et infection par le VIH: étude de 79
cas au CHN de Ouagadougou (Burkina Faso). Bull Soc Pathol Exot
2002; 95:23-26.
9. Mouanodji M. Profil clinique de 55 patients sidéens avec
manifestations cardiaques en milieu Africain: expériences de
l’hôpital central de N’djamena (Tchad). Méd Afr Noire 1996; 43 : 273
- 278.
10. Bouramoué C, Ekoba J, Nkoua JL, Kimbally-Kaki G, Mbizi R.
Cardiopathies au cours du syndrome d’immuno-déficience acquise
(SIDA): Etude de 77 cas cliniques. Cardiologie Tropicale 1992; 18
:77-84.
11. Longo-Mbenza B, Tonduangu K, Kintonki Vita E, Seghers KV.
The effect of HIV on incidence of heart diseases in Kinshasa (Zaire).
Echocardiographic study. Ann Cardiol Angéiol 1997; 46: 81-87.
12. Clumeck N, Lemoine FM, Marcelis L. Acquired syndrom in
black Africans. Lancet 1983; 1: 38.
13. Lewis W. AIDS: Cardiac findings from 115 autopsics. Prog
Cardiovas Dis 1989; 3: 207- 215.
14. Silva ŔCardoso J, Moura B , Martins L, Mota-Miranda A, Rocha-
Gonçalves F, Lecour H. Pericardial involvement in Human
Immunodeficiency Virus infection. Chest 1999 :115:418-422.
15. Maqula NP, Mayosi BM. Cardiac involvement in HIV-infected
people living in Africa: a review. Cardiovasc J S Afr 2003; 14: 231-
237.
16. Reuter H, Burgess LJ, Doubell AF. Epidemiology of pericardial
effusions at a large academic hospital in South Africa. Epidemiol
Infect. 2005; 133:393-399.
17. Mather D, Harries AD. Tuberculosis pericardial effusion: a
prospective clinical study in a low resource setting-Blantyre,
Malawi. Int J Tuberc Lung Dis 1997; 1: 358-364.
18. Mesa RA, Edell ES, Dunn WF, Edwards WD. Human
immunodeficiency virus infection and pulmonary hypertension.
Mayo Clin Proc 1998; 73:37- 44.
19. Rerkpattanapipat P, Wongpraprut N, Jacobs LE, Kotler MN.
Cardiac manifestations of acquired immunodefiency syndrome.
Arch Intern Med 2000; 160: 602-608.
20. Barbaro G. Pathogenesis of HIV-associated heart disease. AIDS.
2003; 17: S12ŔS20.
21. Nzuobontane D, Blackett KN , Kuaban C. Cardiac Involvement
in HIV Infected people in Yaounde, Cameroon . Postgrad Med J
2002 ; 78: 678-681.
22. Herskowitz A, Vlahov D, Willoughby S . Prevalence and
Incidence of Left Ventricular Dysfunction in Human
Immunodeficiency Virus Infection. Am J Cardiol 1993; 71: 955-958.
23. Lipshultz SE. Dilated cardiomyopathy in HIV-infected patients
[editorial]. N Engl J Med 1998; 339:1153-1155.
24. Chapelon-Abric C. Atteinte cardiaque au cours de l’infection par
le virus de l’immunodéficience humaine. Encycl Méd Chir
Cardiologie, 11-048-B-10, 2000, 4 p.
R E F E R E N C E S

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
8
INTRODUCTION La coarctation aortique est une malformation congénitale siégeant au niveau de l’aorte thoracique le plus souvent [1]. Elle passe parfois inaperçue. Sa découverte est souvent tardive en Afrique généralement au stade de complications (HTA, insuffisance cardiaque, dissection aortique).
1Service de Cardiologie CHU du Point G (Bamako) 2Service de Cardiologie CHU Gabriel Touré (Bamako) 3Service de Cardiologie Hôpital Mère Enfant (Bamako)
La dissection aortique est une complication grave, souvent mortelle des affections de l’aorte (coarctation, anévrisme, maladies du tissu conjonctif, HTA) [2,3]. Son diagnostic, évoqué cliniquement dans nos pays, ne peut pas toujours être confirmé en raison de l’inaccessibilité des examens paracliniques [4,5]. Le fait clinique que nous rapportons a la particularité de rassembler chez un même patient les deux affections Adresse pour correspondances : Ilo Bella Diall : Service de Cardiologie, CHU du Point G, Bamako. E-mail : [email protected]. Tel : 0022366797120.
Association de malformations aortiques et d’une dissection de l’aorte, à propos d’un cas.
Association of aortic malformations and aortic dissection, a case report.
DIALL I.B.1, DIAKITÉ S.1, COULIBALY S.1, MINTA I.2, KEÏTA L1, DIARRA M.B. 3,
DIALLO B.A.1, TOURÉ M.K.1.
L’association d’une coarctation de l’aorte, d’un anévrisme avec dissection de l’aorte ascendante et d’une malformation des troncs supra aortiques est rare et redoutable. Nous rapportons le cas d’un homme de 57 ans adressé en consultation pour un souffle diastolique latéro-sternal gauche et une hypertension artérielle. La différence de tension des deux membres supérieurs, l’abolition des pouls fémoraux et le souffle diastolique 3/6ème perçu au 2ème espace intercostal droit, et le long du bord sternal gauche ont fait évoquer le diagnostic de coarctation de l’aorte. L’écho-Doppler cardiaque a mis en évidence une aorte ascendante dilatée à 4,7 cm avec un voile intimal au niveau de sa portion moyenne, une insuffisance aortique de grade I sur des valves aortiques tricuspides et une sténose isthmique courte. L’angio-scanner thoraco-abdominal a confirmé la coarctation de l’aorte au niveau de l’isthme avec dilatation de la crosse et dissection de l’aorte ascendante. Le traitement a été médical faute de possibilités chirurgicales adaptées à ce genre de pathologie dans notre contexte. Coarctation de l’aorte, dissection de l’aorte
RESUME
MOTS CLES
The association of a coarctation of the aorta, an aneurism with dissection of the ascending aorta and a malformation of the aortic arch is extremely rare and frightening. We report the case of a 57 year old man seen in consultation for a diastolic left laterosternal murmur and an arterial hypertension. The difference of blood pressure at the two upper limbs, the abolition of
the femoral pulses and a diastolic murmur of 3/6 intensity heard on the
2nd right intercostal space, and at the left sternal border lead to the
diagnosis of coarctation of the aorta. Cardiac echo-Doppler highlighted
a dilated ascending aorta (diameter = 4.7 cm) with an intimal flap, a
mild aortic regurgitation with otherwise normal valves and a short
isthmian stenosis. The thoracic and abdominal CT scan confirmed the
coarctation of the aorta with a dilated aortic arch and dissection of the
ascending aorta. The treatment was only medical because of the lack of
surgical conditions adapted to this kind of pathology in our context.
Coarctation of the aorta, aortic dissection
SUMMARY
KEY WORDS
Cas Clinique . Case Report

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
9
avec leurs principales caractéristiques cliniques, paracliniques et évolutives.
Fait clinique Monsieur KA, âgé de 57 ans, nous a été adressé le 13 Décembre 2008 pour un souffle diastolique latéro-sternal gauche et une HTA. La symptomatologie fonctionnelle peu marquée est faite d’une dyspnée d’effort. Il ne signale ni douleur thoracique, ni trouble du rythme cardiaque. L’examen clinique retrouve un rythme cardiaque régulier à 90 battements/min, un éclat du B2 aortique, un souffle diastolique 3/6ème perçu au 2e espace intercostal droit et le long du rebord sternal gauche et un B3 apexien. La tension artérielle est mesurée à 180/100 mm Hg au bras droit et à 240/110 mm Hg au bras gauche. Les pouls fémoraux sont faiblement perçus. En l’absence de souffle artériel, le diagnostic d’insuffisance aortique sur coarctation aortique est évoqué. L’électrocardiogramme inscrit une hypertrophie ventriculaire gauche sans troubles primaires de la repolarisation. La radiographie thoracique de face montre un volume cardiaque normal avec élargissement du médiastin supérieur droit. L’écho-Doppler cardiaque trans-thoracique met en évidence une aorte ascendante dilatée (diamètre mesuré à 47 cm) avec un voile intimal au niveau de sa portion moyenne, une insuffisance aortique de grade I sur des valves aortiques tricuspides et une sténose isthmique courte. La probabilité d’une dissection aortique de type 2 de De Bakey avec insuffisance aortique est évoquée sur une coarctation aortique diaphragmatique. L’angio-scanner thoraco-abdominale par acquisition hélicoïdale de 1 mm x 16 avant et après contraste iodé met en évidence une disparité de calibre entre la crosse de l’aorte et sa jonction avec la portion descendante thoracique. Il apparaît un élargissement modéré de la crosse aortique (dont le diamètre était de 47 mm) par rapport à la région sus sigmoïdienne (mesurée à 43 mm) peu déformée, contenant une fine bande lacunaire correspondant à un voile intimal. La carotide droite émerge directement de la partie droite de la crosse aortique, puis le tronc brachio-céphalique gauche. L’artère sous-clavière droite émerge après le tronc brachio-céphalique gauche au niveau de la partie
gauche de la crosse, juste après la zone de rétrécissement, décrit une courbe vers le bas et passe derrière l’œsophage. Le reste de l’aorte est de calibre normal (figure 1). Ainsi, l’aspect angio-tomodensitométrique est en faveur d’une coarctation de l’aorte au niveau de la jonction de la crosse et de l’aorte descendante avec dilatation de la crosse et dissection de l’aorte ascendante sus- sigmoïdienne (type 2 de De Bakey) et malformation vasculaire des troncs supra aortiques de type artère sous clavière droite rétro-œsophagienne (artera lusoria). L’évolution de la maladie a été simple avec un recul de 24 mois. L’insuffisance cardiaque et l’HTA ont été contrôlées avec les diurétiques, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les bêta-bloquants.
DISCUSSION
Les particularités de ce cas sont multiples. Il s’agit d’une coarctation : - découverte tardivement chez un hypertendu ayant une anisotension aux membres supérieurs, - compliquée d’anévrisme de l’aorte pré sténotique et d’insuffisance aortique, - avec une dissection aortique peu douloureuse, - associée à une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne. Cette pathologie qui constitue 5 à 9% des cardiopathies congénitales, et qui prédomine chez les sujets de sexe masculin ne semble pas plus rare dans la population africaine [6]. Son diagnostic est simplifié par un examen clinique minutieux comportant notamment la mesure de la tension artérielle aux deux bras, la palpation des pouls fémoraux et la recherche d’un souffle cardiaque chez tout hypertendu. Le traitement chirurgical, et pour les recoarctations, l’angioplastie percutanée avec mise en place d’une endoprothèse, constituent le traitement de choix de la coarctation de l’adulte. Son pronostic est sombre, le décès étant le plus souvent dû aux complications de l’HTA. L’hypertension artérielle est le mode de découverte chez l’adulte mais aussi le problème le plus fréquent après traitement [7]. Un dépistage précoce dès l’enfance s’avère nécessaire devant la découverte d’un souffle, la constatation d’une HTA et l’abolition des pouls fémoraux. Les données cliniques seront

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
10
confirmés par des examens complémentaires simples et disponibles (électrocardiogramme, radiographie thoracique, échographie
transthoracique) afin d’orienter la prise en
charge.
Image A Image B
(A) Reconstruction sagittale passant par l’aorte (B) Coupe axiale passant par les articulations thoracique sterno- claviculaires 1. Artère sous-clavière. 4. Sous-clavière droite 2. Aorte 5. Clavicule
3. Cavité cardiaque 6. Œsophage
7. Vertèbre
Figure 1. Images scanographiques et leurs schémas
1 3 2 4
5 6
7
R E F E R E N C E S
1) Marçon F, Bosser G, Worms AM. Coarctation de l'aorte. Encycl. Méd Chir (Elsevier, Paris), Cardiologie, 11-041-Q-10, 1996, 8 p. 2) Veyssier- Belot C. Dissections aortiques. EMC, Cardiologie, 11-650-A-10,1999. 3) Kirkorian G, Bonnefoy E, Chevalier P et al. Dissection aigue de l’aorte thoracique : symptômes et complications. Arch Mal Cœur Vaiss, 1997; 90 : 1793-1797. 4) Konin KC, Ake-Traboulsi E, Kakou-Guikahue M et al.
Dissection aortique juvénile et coarctation aortique. Cardiologie Tropicale 2002 ; 28 : 6.
5) Bouramoué C, Kimbally-Kaky G, Nkoua JL et al. La dissection aortique chez les noirs. A propos de six cas congolais. Ann Cardiol Angéiol 2001; 50 :133-141. 6) Van Der Horst RL. The pattern and frequency of congenital heart disease among blacks. S Afr Med J, 1985; 68 : 375-378. 7) Auriacombe L. Les coarctations de l’adulte, opérées ou non. Arch Mal Cœur Vaiss 2002; 95: 1081-1087.

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
11
1Centre Hospitalier et Universitaire de Cotonou
Correspondance : Dr HOUENASSI Dèdonougbo Martin 011BP 33 Ŕ camp Guézo, Cotonou Bénin. Tél/ Fax : (229) 97721649 E mail : [email protected] ou [email protected]
Etude échographique de la thrombose et du contraste spontané intra-auriculaire chez les
patients en fibrillation auriculaire.
Echographic study of intraatrial thrombus and spontaneous contrast in patients with atrial fibrillation.
D.M. HOUÉNASSI1, Y. TCHABI1, J. SACCA-VÉHOUNKPÉ1, R. AKINDÈS DOSSOU-YOVO1,
R.K. KOHOUN1, M. D’ALMEIDA MASSOUGBODJI1, H. AGBOTON1.
KIMBALLY KAKY G., VOUMBO Y., GOMBET T., IKAMA - MÉO S., BOLANDA J.D.,
GOKABA CH., BITSINDOU P., LOUMOUAMOU D., EKOBA, NKOUA J.L., BOURAMOUÉ C.
L’objectif de cette étude est d’étudier la taille des oreillettes et la présence de thrombose ou de contraste spontané intra-auriculaire au cours de la fibrillation auriculaire. Les auteurs ont réalisé une étude prospective qui a inclus tous les patients pris en charge pour fibrillation auriculaire au service de cardiologie du CNHU de Cotonou pendant une période de 29 mois. L’analyse comportait l’étude clinique, la réalisation d’une échocardiographie Doppler transthoracique (ETT) et transoesophagienne (ETO), l’étude des facteurs de risque cardio-vasculaire associés. Le seul critère d’exclusion était la non réalisation d’un ETT. Quarante trois patients ont été retenus dont 24 ont été soumis à l’ETO pour des raisons économiques. L’âge moyen des 43 patients retenus était de 63,7 ans ± 13,42. L’étiologie de la FA était une cardiopathie dans 83,7%. A l’ETT, l’oreillette gauche était dilatée dans 60,46% et l’oreillette droite dans 32,6%. Il n’y avait aucun marqueur de thrombose auriculaire. A l’ETO (24 patients) aucun marqueur de thrombose n’a été retrouvé dans l’oreillette droite. Dans l’oreillette gauche (OG), un contraste spontané a été retrouvé chez 66,66%. Un thrombus a été noté chez 29,16% et tous ces thrombi étaient associés à un contraste spontané. Quatre thrombi sur 7 étaient localisés dans l’auricule gauche qui était dilatée chez 79,2% des patients. Parmi les facteurs que sont l’âge, le sexe, la présence d’une cardiopathie sous jacente, l’existence de facteurs de risque cardio-vasculaire, la taille de l’oreillette et de l’auricule gauches, seule la dilatation de l’OG était corrélée à la présence de thrombose et de contraste spontané (p= 0,03). Les auteurs concluent, au terme de cette étude échographique, que la thrombose auriculaire gauche est fréquente au cours de la fibrillation auriculaire et que sa présence est corrélée à l’existence d’une dilatation de l’oreillette gauche. Fibrillation auriculaire, contraste spontané, thrombus
The aim of this prospective study is to research the left atrium
dilatation and the presence of thrombus or spontaneous contrast in the
atrium in patients with atrial fibrillation.
All consecutive patients have been included during 29 months.
Transthoracic (TTE) and transesophageal echocardiography (TEE)
were planified to detect cardiopathy , left atrium dilatation and
presence of thrombus or spontaneous contrast. Cardiovascular risk
factors and clinical presentation were also studied.
Only 43 patients satisfied the study conditions and 24
transoesophageal echocardiographies have been performed because of
poor social conditions. Mean age were 63.7 ± 13.42 years, heart disease
was present in 83.7 %. TTE showed a left atrial dilatation in
60.46%and a right atrium dilatation in 32.6%. There was no
thrombus or spontaneous contrast demonstrated by TTE. TEE (24
patients) showed no thrombosis or spontaneous contrast in right
atrium. In left atrium, it showed spontaneous contrast in 66.66% and
thrombus in 29.16%. Four (4) thrombi within the 7 detected were
localized in the left atrial appendage which were dilated in 79.2%.
Among age, sex, heart disease, cardiovascular risk factor, left atrium
dilatation, only the latter is correlated with presence of spontaneous
contrast or thrombus.
The authors conclude that atrial thrombosis are frequent in the atrium
of patients with atrial fibrillation and that its presence is associated
with left atrial dilatation.
Atrial fibrillation, spontaneous contrast, thrombus
RESUME
MOTS CLES
SUMMARY
KEY WORDS
AArrttiiccllee oorriiggiinnaall .. OOrriiggiinnaall AArrttiiccllee

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
12
INTRODUCTION
La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble du rythme auriculaire le plus fréquent dans le monde. Elle est caractérisée par un risque embolique significatif [1,2]. Or, Bertrand et coll ont rapporté une tendance à l’hypocoagulabilité chez l’africain de race noire [3]. Cette hypocoagulabilité pourrait se traduire chez les patients noirs en FA par une moins grande fréquence de thrombose intra-auriculaire. C’est pour vérifier cette hypothèse que ce travail a été initié avec comme objectif l’étude échographique de la taille de l’oreillette gauche et de la présence de thrombose intra-auriculaire ou de contraste spontané.
MATERIEL ET METHODE
Nous avons réalisé une étude prospective descriptive à l’Unité de Soins d’Enseignement et de recherche en Cardiologie du Centre Hospitalier et Universitaire de Cotonou. Nous avons inclus systématiquement tous les patients porteurs de FA pris en charge dans notre service entre le 1er janvier 2002 et le 31 mai 2004, soit une période de 29 mois. Le diagnostic de la FA a été fait sur un ECG de surface réalisé au repos. Une échocardiographie Doppler par voie transthoracique (ETT) et par voie transoesophagienne (ETO) ont été systématiquement prescrits de même que les examens nécessaires à la recherche des facteurs de risque cardio-vasculaire et de l’étiologie de la FA. La non réalisation de l’ETT était le seul critère d’exclusion. Nous avons recueilli les données suivantes : les
caractères démographiques, l’existence d’un
antécédent de FA, le syndrome clinique
révélateur, l’étiologie de la FA, le traitement
antithrombotique en cours, les facteurs de
risque cardio-vasculaires associés, la taille des
oreillettes, la taille et la cinétique de l’auricule
gauche, la présence d’un contraste spontané ou
de thrombose auriculaire. L’oreillette gauche
(OG) a été considérée comme dilatée si son
diamètre transversal mesuré en mode TM sur
une coupe parasternale grand axe était
supérieure à 40 mm ; comme l’oreillette droite
(OD), elle a également été considérée comme
dilatée si sa surface mesurée en mode 2D sur
une coupe apicale 4 cavités était supérieure à
20 cm2. A l’ETO, l’auricule gauche a été
considérée comme dilatée si sa surface était
supérieure à 6 cm2. Une vitesse inférieure à 25
cm/s au Doppler dans l’auricule a été
considérée comme un signe de baisse de la
cinétique. Les échographies ont été réalisées
sur un échographe Hewlett Packard Sonos
1000 ; l’ETO a été réalisée avec une sonde
biplan.
Les données ont été consignées sur un
questionnaire informatisé et traitées dans le
logiciel SPSS. Le test de X2 de PEARSON a été
utilisé pour la comparaison des proportions
mais lorsque l’effectif des sous groupes ne
dépassait pas 5 le test exact de Ficher a été
préféré.
RESULTATS
Caractères de l’échantillon Au total 65 patients ont présenté une FA dans
la période. Quarante trois (43) ont été retenus
et l’ETO n’a été réalisée que chez 24 d’entre
eux. Ces patients étaient tous en FA
persistante. L’âge moyen des 43 patients était
de 63,72 ans ± 13,42 avec des extrêmes de 34 et
97 ans. Le sex-ratio était de 1,26 en faveur des
hommes. Les circonstances de découverte de la
FA sont présentées par le tableau 1. Onze
patients soit 25,6 % avaient un antécédent de
FA. Parmi eux, 6 étaient sous acide
acétylsalycilique et 3 sous acénocoumarol. Les
étiologies de la FA sont présentées par le
tableau 2. Les facteurs de risque cardio-
vasculaire retrouvés étaient, en dehors de
l’HTA déjà répertoriée dans les étiologies :
l’hyperlipidémie (11 cas), le surpoids et
l’obésité (10 cas), le diabète (6 cas) et le
tabagisme (4 cas).

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
13
Tableau 1
Circonstances de découverte de la FA
Nombre (% )
Asymptomatique 03
07
Symptôme isolé Palpitations/ dyspnée/ lipothymie/angor
07
16,3
Complications
Insuffisance cardiaque Embolie cérébrale
33
23 10
76,7
53,5 23,2
Total
43 100
Tableau 2
Etiologies de la FA
Nombre (%)
Cardiopathies
-hypertensives - dilatées -valvulaires - ischémiques Embolie pulmonaire Communication inter-auriculaire
36
10
10 09 03
03
01
83,7
20,9 23,2 23,2
07
07
02,3
Pneumonie 03 07
FA isolée 05 11,6
Total 43 100
Caractéristiques des oreillettes à l’ETT
L’oreillette gauche
Chez les 43 patients, le diamètre moyen de l’OG était de 44,88 ± 7, 69 mm avec des extrêmes de 26 et 57,1 mm. L’OG était dilatée chez 26 patients soit 60,46 %. Elle ne contenait ni contraste spontané, ni thrombus.
L’oreillette droite Elle était dilatée chez 14 patients soit 32,6 %. Sa
surface moyenne était de 25,71cm2 avec des
extrêmes de 15 et 35,60 cm2. Elle ne contenait
ni contraste spontané, ni thrombus.
Caractéristiques des oreillettes à l’ETO (24 patients)
L’auricule gauche Elle était dilatée chez 19 des 24 patients (79,2%)
chez qui l’ETO a été réalisée. La taille moyenne
de l’auricule gauche était de 06,63 ± 0,99 avec
des extrêmes de 5 et 8,2 cm2. Sa cinétique était
diminuée chez 18 patients soit 75%.
La thrombose et le contraste spontané Ils étaient absents dans l’OD. Dans l’OG, un
contraste spontané a été observé chez 16
patients soit 66,66 % ; un thrombus a été
observé chez 07 patients soit 29,16 %. Tous les
thrombi étaient associés à un contraste
spontané ; leur taille moyenne était de 1,81cm2
± 1,43 cm2 avec des extrêmes de 0,5 et 3,39 cm2.
La localisation de la thrombose et du contraste
spontané est précisée dans le tableau 3.
Tableau 3
Localisation de la thrombose et du contraste
spontané
Contraste
spontané isolé
Thrombus +contraste spontané
Oreillette gauche 06
02
Auricule gauche -
04
Oreillette et auricule gauche
03
01
Total 09 07

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
14
Corrélations entre les facteurs cliniques et la présence de thrombose Le tableau 4 présente la relation entre les facteurs cliniques étudiés et la présence de marqueurs de thrombose.
Tableau 4
Relation entre marqueurs de thrombose et variables cliniques pour les 24 patients ayant
eu une ETO
Variables : Type - effectifs
Marqueurs de
thrombose ( %)
p
Facteurs Risque cardiovasculaire
Présent : 16 Absent : 08
18,8 50
0,16
Cardiopathie sous jacente Présente : 16 Absente : 08
76,2 75
1
Dilatation oreillette gauche
Présente : 14 Absente : 10
85,7 40
0,03
Dilatation auricule gauche
Présente : 10 Absente : 14
20 50
0,07
Dilatation oreillette droite
Présente : 5 Absente : 19
80 32,2
0,63
Discussion
La petite taille de cette série illustre les difficultés d’exploration qui sont courantes dans notre milieu et sont liées au faible niveau de vie des populations. Malgré ce handicap, cette série reflète la réalité de la FA. En effet, l’existence d’une cardiopathie sous jacente dans plus de ¾ des cas est une caractéristique de la FA aussi bien en Europe [4] qu’en Afrique [5,6]. La révélation fréquente par une insuffisance cardiaque ou une embolie
cérébrale, la prédominance dans les étiologies de l’HTA, de la myocardiopathie dilatée et des valvulopathies avaient été déjà rapportées par une précédente étude de notre service [7]. L’existence, chez 66,66 % des patients ayant bénéficié de l’ETO, d’une thrombose ou d’un contraste spontané intra-auriculaire témoigne de l’important risque d’embolie auxquels sont exposés les patients atteints de FA dans notre milieu. Ce constat est concordant avec les résultats d’une étude de notre service qui avait rapporté que l’embolie cérébrale était la seconde cause d’hospitalisation chez les porteurs de FA [8]. Avec 29,16% de thrombose auriculaire et 66,66 % de contraste spontané auriculaire, notre série présente une plus grande fréquence de thrombose que celle de Tribouillouy [9] qui a rapporté 14, 6 % de thrombose et 32% de contraste spontané. Cette découverte incite à la prudence quant à l’extrapolation des résultats de l’étude de Bertrand et coll [3] qui ont rapporté en Côte d’ivoire une réduction de l’agrégabilité plaquettaire et une majoration de la fibrinolyse chez 50 ivoiriens comparativement à 50 européens vivant dans le même environnement depuis au moins 10 ans. L’hypocoagulabilité ainsi rapportée est ici relativisée. Cette étude n’a retrouvé aucun lien entre la présence d’une cardiopathie sous jacente, l’existence de facteur de risque cardio-vasculaire associé et la présence de thrombose. Sa petite taille incite à la prudence dans cette affirmation qui pourrait faire croire à une particularité de la FA dans notre milieu. Il a été rapporté, en effet, que le risque de thrombose de la FA est bien corrélée à l’existence de facteurs de risque cardio-vasculaire en particulier le diabète ainsi qu’à la présence et la nature d’une cardiopathie sous jacente. Le risque est en effet multiplié par 17 en cas de valvulopathie rhumatismale [1]. Par contre la corrélation positive entre la dilatation de l’oreillette et l’auricule gauche que nous rapportons est tout à fait classique. La découverte exclusive de thrombose et de contraste spontané à l’ETO et la présence de 4 thrombi sur 7 dans l’auricule nous rappelle la nécessité de développer cette technique. En son absence, les marqueurs échographiques habituels de thrombose auriculaire sont peu identifiables. La thrombose qui s’est manifestée par un
accident vasculaire cérébral chez 23 à 27 % de
nos 2 séries pose le problème de la prévention

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
15
de la thrombose auriculaire liée à la FA. Celle-
ci a été bien étudiée par les études AFASAK
[10] et EAST [11] et bien codifiée par les
recommandations [12]. Le traitement
anticoagulant est la base de la pratique et nous
ne devrions pas avoir de crainte particulière
quant au risque hémorragique car comme l’ont
rapporté Adoubi et coll [13], ce risque ne
parait pas plus élevé en Afrique qu’ailleurs et
les facteurs prédictifs de cette complication ne
semblent pas non plus particuliers.
CONCLUSION
La thrombose et le contraste spontané intra-auriculaire gauche sont fréquents à l’échocardiographie chez le patient de race noire en fibrillation auriculaire. Leur présence est corrélée à la dilatation de l’oreillette gauche. Leur recherche, en particulier par l’échographie trans-œsophagienne, devrait permettre une meilleure prévention des accidents emboliques.
R E F E R E N C E S
1-Kannel WB, Abbott RD, Savage DD et al. Epidemiologic features of chronic atrial fibrillation : the Framingham study. N Engl J Med 1982; 306: 1018 Ŕ 1022. 2-Frost L, Engholm G, Johnsen S et al. Incident stroke after discharge from hospital with a diagnosis of atrial fibrillation. Am J Med 2000; 108: 36-40. 3-Bertrand E, Cloitre B, Ticolat R et al. Activité plaquettaire, fibrinolyse et facteurs d’environnement comparés chez 50 africains et 50 européens. Rôle de la consommation de poisson. Nouv Rev fr Hematol 1987 ; 29 : 237 Ŕ 245. 4-Levy S. Epidémiologie et nosologie de la fibrillation auriculaire. Arch Mal cœur 1994 ; 87 (spécial III) ; 11-15. 5-Longo S, Kraim S, Slimane H et al. La fibrillation auriculaire. La Tunisie Médicale 2001 ; 79 : 613 - 616. 6-Serme D, Lengani A, Drabo JY et al. Symptômes, étiologies et évolution de 47 cas de fibrillation auriculaire permanente. Cardiologie Tropicale 1993 ; 19 : 13 - 18. 7-Houenassi M, Tchabi Y, Sacca- Vehounkpé J et al. Etiologies de la fibrillation auriculaire en milieu noir africain au Bénin à propos de 44 cas. Le Bénin Médical, 2001 ; 19 : 34 - 36. 8-Houenassi M, Sacca-Vehounkpe J, Tchabi Y et al. Complications thrombo-emboliques de la fibrillation auriculaire en milieu noir africain. A propos de 15 cas observés sur 44 fibrillations auriculaires. Le Bénin Médical 2002 ; 20 : 5- 8.
9-Tribouilloy C, Lucas G, Rey JL et al. Echocardiographie
transoesophagienne avant cardioversion électrique pour
trouble du rythme supraventriculaire. La Presse Méd 1998 ;
27 : 106 - 109.
10-Petersen P, Boysen G, Godtfresen J et al. Placebo
controlled randomised trial of warfarin and aspirin for
prevention of thromboembolic complications in chronic
atrial fibrillation . The Copenhagen AFASAK study. Lancet
1989; 1: 175-179.
11-European Atrial Fibrillation Study Group : Secondary
prevention in non rheumatic atrial fibrillation after
transient ischaemic attack or minor stroke. Lancet 1993;
342 : 1255-62.
12-Fuster V, Ryden LE, Cannom DS et al. 2011
ACCF/AHA/HRS focused updates incorporated into the
ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of
patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2011 ; 57 :
e101-98.
13-Adoubi AK, Kandem FD, Diby FK et al. Le risque
hémorragique chez les patients ambulatoires traités par
anticoagulant oral. Cardiologie Tropicale 2006. 32 : 3-5.

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
16
INTRODUCTION Les cardiopathies valvulaires sont rares chez le sportif dans les pays occidentaux où elles relèvent généralement de causes dégénératives, touchant essentiellement les sujets âgés, ou de l’endocardite infectieuse [1]. Hôpital Général de Grand Yoff, Service de cardiologie
Les valvulopathies (essentiellement la sténose aortique congénitale et le prolapsus valvulaire mitral) semblent ainsi être des causes rares de mort subite du sportif en Occident [2]. En Afrique, où le rhumatisme articulaire aigu est encore endémique, les valvulopathies sont fréquentes, en particulier chez le sujet jeune. En utilisant des critères échocardiographiques,
Correspondance: Pr Abdoul Kane Hôpital Général de Grand Yoff BP : 3270, [email protected]
Valvulopathies et sport
Valvular heart diseases and Sport
A. KANE
Les valvulopathies sont des causes rares de mort subite du sportif en Europe et aux Etats-Unis. En Afrique, la forte prévalence des cardiopathies rhumatismales, associée à la présence d’autres causes d’atteinte valvulaire (infectieuses ou inflammatoires, congénitales, dégénératives), fait redouter une plus grande fréquence de la pathologie valvulaire chez les sportifs africains. Dans la recherche d’une valvulopathie chez un sportif, le praticien doit tenir compte des pièges diagnostiques liés aux particularités du cœur d’athlète. Il faudra ensuite rechercher les éléments pouvant conditionner la pratique du sport, à savoir la sévérité de l’atteinte valvulaire, son retentissement, les lésions associées ainsi que le type de sport pouvant être effectué. Le sport de compétition est contre-indiqué si la valvulopathie est symptomatique. A l’inverse, si l’atteinte valvulaire est légère, asymptomatique à l’effort, sans retentissement significatif (dimensions cardiaques normales, fonction systolique ventriculaire conservée, pressions pulmonaires normales), la plupart des sports de compétition peuvent être autorisés. Le traitement anticoagulant est une contre indication aux sports avec risque de collision. Sport, valvulopathie, rhumatisme articulaire aigu
RESUME
MOTS CLES
Valvular heart diseases are uncommun causes of sudden cardiac death
of athletes in Europe and the United States.
The high prevalence of rheumatic heart diseases, associated with other
possible causes of valvular lesions (infectious or inflammatory diseases,
congenital or degenerative heart diseases) may lead to a higher
frequency of valvular heart diseases in young african athlets.
The physician should pay attention to the diagnostic pearls of the
athlet’s heart when he is looking for valvular diseases. He must
evaluate the parameters that can influence the practice of sport (the
severity of the valvular disease, the associated lesions, the
complications and also the sport that can be indicated).
Competition is contra indicated if the athlet is symptomatic.
If the valvular disease is mild, the subject is asymptomatic, without
any significant complication and cardiac abnormality (normal cardiac
dimensions, good ventricular systolic function, normal pulmonary
pressures), almost all the sports can be allowed.
Anticoagulant therapy is a contra indication of sports with risk for
bodily contact.
Sport, valvular heart disease, rheumatic fever
SUMMARY
KEY WORDS
Mise au Point . Review Article

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
17
la prévalence du rhumatisme articulaire aigu a été récemment estimée à 30,4 cas pour 1000 chez des enfants mozambicains âgés de 6 à 17 ans [3,4]. La place exacte de la pathologie valvulaire chez le sportif africain est mal connue. Toutefois, la forte prévalence des cardiopathies rhumatismales, associée à la présence d’autres causes d’atteinte valvulaire (infectieuses ou inflammatoires, congénitales, dégénératives), fait redouter une plus grande fréquence de la pathologie valvulaire chez les sportifs africains. Le faible niveau socio-économique des populations, l’insuffisance du dépistage et les difficultés de la prise en charge marquées notamment par l’absence dans la plupart des pays de chirurgie cardiaque ou de traitement par cardiologie interventionnelle expliquent que les valvulopathies peuvent être non dépistées chez le sportif et ne sont reconnues qu’à un stade évolué dans un contexte d’impossibilité de correction du vice valvulaire [5].
Recherche d’une valvulopathie chez un sportif Dans l’évaluation du sportif pour la recherche d’une valvulopathie, le praticien doit considérer deux (02) étapes [6-12] : le dépistage de la valvulopathie, et la recherche, le cas échéant, d’éléments pouvant conditionner la pratique du sport à savoir la sévérité de l’atteinte valvulaire, son retentissement ainsi que le type de sport pouvant être pratiqué. Il est important de garder à l’esprit que le bilan clinique et paraclinique du sportif peut comporter des pièges pouvant faire porter à tort le diagnostic de valvulopathie [11]. Le bilan est avant tout clinique et commence par un interrogatoire méthodique. L’examen clinique comporte en particulier la mesure de la tension artérielle aux 2 bras, la prise des pouls, l’auscultation cardiaque en position couchée et debout ainsi que la recherche de signes évoquant le syndrome de Marfan [11]. Un souffle systolique d’intensité modérée ou d’autres bruits surajoutés (B3 ou plus rarement B4) peuvent être perçus chez le sportif normal [11,12]. Un souffle systolique d’intensité supérieur à 3/6ème, un souffle diastolique ou continu doivent faire suspecter une pathologie cardiaque [11,12]. L’électrocardiogramme peut comporter de nombreuses atypies chez le sportif de race
noire, pouvant faire porter à tort le diagnostic de cardiopathie [11]. De même, une cardiomégalie modérée peut être observée à la radiographie du thorax chez le sportif [6,11]. L’échocardiographie permet généralement de faire le diagnostic de valvulopathie et d’apprécier son retentissement (hypertrophie pariétale, dilatation cavitaire, anomalie de la fonction ventriculaire, hypertension artérielle pulmonaire, élévation des gradients transvalvulaires) [13,14]. Cependant, une dilatation modérée des cavités cardiaques, une hypertrophie pariétale modérée et harmonieuse sont possibles chez le sportif [6,11]. Par ailleurs, 90% des sportifs présentent au Doppler des fuites minimes avec des valves fines [6,11]. Les fuites tricuspides sont plus fréquentes, suivies des fuites pulmonaires. Les insuffisances aortiques et mitrales doivent faire rechercher une valvulopathie organique [11]. D’autres examens peuvent être utiles en fonction du contexte clinique (enregistrement électrocardiographique de longue durée, épreuve d’effort, échocardiographie d’effort). Les tests d’effort (épreuve d’effort, échographie d’effort) renseignent sur les adaptations à l’effort (arythmies cardiaques, ischémie myocardique, profil tensionnel, fonction ventriculaire, pressions pulmonaires, gradient transvalvulaire, évolution du pouls d’oxygène) [11]. Ils sont surtout indiqués en cas de discordance entre les données cliniques et échocardiographiques [11]. Lorsque la cardiopathie valvulaire est confirmée, d’autres investigations peuvent être nécessaires : recherche de foyers infectieux (cutanées, ORL, bucco-dentaires…), recherche d’évolutivité rhumatismale (numération formule sanguine, vitesse de sédimentation érythrocytaire, fibrinémie, C-réactive protéine, ASLO).
Retentissement du sport en fonction de la valvulopathie Les valvulopathies peuvent être longtemps méconnues chez le sportif, avec parfois une conservation surprenante de la capacité à l’effort ; ce qui souligne l’importance d’un examen clinique soigneux chez le sportif [9-11].

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
18
Le rétrécissement mitral La sténose mitrale se définit comme une sténose permanente de l’orifice auriculo-ventriculaire gauche dont la surface est < 2,5 cm2 [1, 13,14]. Elle est presque toujours secondaire au rhumatisme articulaire aigu [1, 13,14]. Les causes congénitales ou celles liées à d’autres affections (polyarthrite rhumatoïde, lupus systémique) sont exceptionnelles [1]. La sténose mitrale réalise un barrage diastolique entre l’oreillette et le ventricule gauche gênant le remplissage ventriculaire. Il s’ensuit une élévation des pressions auriculaires gauches et pulmonaires, parfois associée à une diminution du débit cardiaque [1]. Outre le degré de la sténose, ce sont la tachycardie et l’augmentation du débit cardiaque - situations favorisées par l’effort - qui sont responsables de l’élévation des pressions auriculaires gauches et pulmonaires et donc de l’aggravation des signes et symptômes [1]. L’exercice physique augmente le gradient diastolique entre l’oreillette et le ventricule gauche provoquant une élévation des pressions pulmonaires pouvant entraîner une dyspnée voire un œdème aigu du poumon [1,6]. Chez le patient présentant un rétrécissement mitral, l’exercice physique est également associé à une faible augmentation de la VO2 et probablement à un risque accru d’arythmies cardiaques, surtout de fibrillation auriculaire, et d’accidents thrombo-emboliques (accidents vasculaires cérébraux, ischémie aiguë des membres, embolie pulmonaire) [1,6] ; ce qui rend souvent nécessaire la prescription d’anticoagulants, posant le problème spécifique de la contre-indication aux sports avec risque de contact et de collision [9-11].
L’insuffisance mitrale Elle correspond à une perte de l’étanchéité de la valve mitrale réalisant une régurgitation de sang du ventricule gauche vers l’oreillette gauche en systole [1, 13,14]. Les causes sont plus variées. Certes, elles sont dominées en Afrique par le rhumatisme articulaire aiguë, mais plusieurs autres étiologies sont possibles : endocardite infectieuse, prolapsus valvulaire mitral (pouvant être isolé ou associé à des dystrophies du tissu élastique tels que le
syndrome de Marfan ou le syndrome d’Ehlers-Danlos), autres causes inflammatoires (lupus systémique, polyarthrite rhumatoïde), cardiopathies ischémiques, causes congénitales, causes médicamenteuses (ergotamine, anorexigènes) [1, 13,14]. Au plan physiopathologique, la régurgitation de sang du ventricule gauche vers l’oreillette gauche entraîne une surcharge volumétrique du ventricule gauche responsable d’une élévation des volumes et des pressions télédiastoliques ventriculaires gauches ainsi que d’une augmentation de la pression auriculaire gauche et pulmonaire expliquant les signes d’œdème pulmonaire (dyspnée, orthopnée), voire d’insuffisance cardiaque globale [1]. Les effets de l’exercice physique varient en fonction de l’intensité et du type d’exercice effectué : un exercice dynamique modéré est associé à une baisse des résistances périphériques et n’entraîne qu’une faible modification de la fraction régurgitée ; à l’inverse, un exercice statique intense augmente les résistances vasculaires périphériques et la fréquence cardiaque et, par conséquent, le débit cardiaque, favorisant ainsi la fuite mitrale et l’élévation des pressions pulmonaires [6]. Par ailleurs, une rupture des cordages mitraux serait possible aggravant la régurgitation mitrale lors d’exercices physiques intenses chez des patients présentant des insuffisances mitrales dystrophiques ou secondaires à une endocardite infectieuse [6,11].
Le rétrécissement aortique Il se définit comme une réduction permanente de l’orifice valvulaire aortique dont la surface devient inférieure à 2 cm2 [1, 13,14]. Les causes sont surtout représentées par le rhumatisme articulaire aigu, les étiologies congénitales telles que la bicuspidie aortique et la sténose aortique congénitale. Chez le sujet âgé, la principale cause est le rétrécissement aortique dégénératif calcifié (ou maladie de Mönckeberg) [1]. Le rétrécissement aortique réalise un obstacle à l’éjection systolique du ventricule gauche. Les conséquences sont : le développement d’une hypertrophie ventriculaire gauche, l’élévation des pressions ventriculaires gauches puis auriculaires gauches et pulmonaires responsable d’une dyspnée, la baisse du débit cardiaque avec possible

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
19
hypoperfusion des organes pouvant entrainer un angor, une syncope ou des lipothymies [1]. Enfin l’hypertrophie ventriculaire gauche, l’ischémie et la fibrose myocardiques peuvent être responsables de troubles du rythme auriculaire ou ventriculaire [1]. Les conséquences de l’exercice physique sont variables et dépendent du type et de l’intensité de l’effort. L’effort isométrique augmente les résistances périphériques et la pression intra ventriculaire gauche [6, 11]. Un exercice dynamique intense entraine une baisse des résistances périphériques qui, associée à l’obstacle valvulaire, peut entrainer une chute de la pression artérielle et une hypoperfusion tissulaire avec comme principale conséquence une ischémie myocardique et cérébrale [6, 11]. Une arythmie cardiaque peut être déclenchée par l’effort ; elle est favorisée par la stimulation sympathique, l’ischémie myocardique et l’hypertrophie ventriculaire gauche [6, 11]. Les modifications à l’effort peuvent provoquer un œdème pulmonaire voire la mort subite [11].
L’insuffisance aortique Elle réalise une régurgitation de sang en diastole de l’aorte vers le ventricule gauche, en rapport avec une perte de l’étanchéité des sigmoïdes aortiques [1, 13,14]. Les causes sont variées, dominées en Afrique par le rhumatisme articulaire aigu. Les autres étiologies sont les maladies de système (spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde), l’endocardite infectieuse, la bicuspidie aortique, la dissection aortique, le syndrome de Marfan et les autres dystrophies du tissu élastique [1, 13,14]. Le reflux du sang en diastole de l’aorte vers le ventricule gauche réalise une augmentation des volumes et des pressions télé diastoliques du ventricule gauche ainsi que du volume d’éjection systolique et du débit cardiaque [1]. A la longue, survient une dysfonction systolique ventriculaire gauche [1]. Une insuffisance coronarienne fonctionnelle est fréquente ; elle relève de plusieurs mécanismes : augmentation des besoins en oxygène par hypertrophie et dilatation du ventricule gauche, diminution des apports par baisse de la pression artérielle diastolique et de la pression de perfusion coronaire [1].
Chez le sportif au repos, la bradycardie pourrait augmenter la régurgitation aortique par allongement de la diastole [6,11]. L’exercice physique dynamique entraine une vasodilatation artérielle et une tachycardie pouvant réduire le volume régurgité ; il s’ensuit une augmentation du débit cardiaque effectif, sans augmentation substantielle du volume et de la pression télédiastolique ventriculaire gauche [6,11]. L’effort isométrique augmente les résistances vasculaires périphériques et donc le gradient entre l’aorte et le ventricule gauche avec risque d’aggravation de l’insuffisance aortique. Les dimensions de l’aorte sont importantes à considérer : un diamètre supérieur à 45 mm est associé à un risque accru de dissection aortique [6,11].
Les valvulopathies tricuspides Les fuites tricuspides minimes sont fréquentes et sont souvent physiologiques. Elles ne représentent pas une contre-indication à la pratique du sport [7-11]. Les insuffisances tricuspides significatives sont souvent fonctionnelles, s’intégrant dans le tableau d’une autre cardiopathie valvulaire ou non. Les principales étiologies des insuffisances tricuspides sont représentées par les causes fonctionnelles, l’atteinte rhumatismale, la maladie carcinoïde, l’endocardite infectieuse et le prolapsus valvulaire dystrophique [1]. Le rétrécissement tricuspidien est exceptionnel. Il est très souvent d’origine post-rhumatismal et s’associe presque toujours à une autre valvulopathie, en particulier un rétrécissement mitral [1].
Les atteintes poly valvulaires Elles sont particulièrement fréquentes en Afrique où elles compliquent généralement une atteinte post-rhumatismale [3,5]. Les indications à la pratique du sport dépendent des atteintes valvulaires et de leur retentissement (dilatation cavitaire, hypertrophie des parois, fonctions systoliques ventriculaires gauche et droite, pressions pulmonaires, complications hémodynamiques, rythmiques ou thrombo-emboliques). Les recommandations à la pratique du sport se baseront sur la valvulopathie la plus significative [8-11].

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
20
Les valvulopathies corrigées par chirurgie ou cathétérisme interventionnel Du fait de l’inaccessibilité de la chirurgie et du traitement par cardiologie interventionnelle, la plupart des patients en Afrique au Sud du Sahara ne peuvent pas bénéficier d’une correction de leur valvulopathie. Cependant ce traitement est souvent indispensable pour la poursuite de l’activité sportive ou tout simplement pour améliorer la qualité de vie et la survie des patients. La chirurgie ou le cathétérisme interventionnel n’entrainent pas la guérison complète du sujet. En effet, il peut persister une fuite et/ou une sténose résiduelles [1]. En fonction de l’état pré-opératoire du patient ou des conditions de l’intervention chirurgicale, il est possible de retrouver une arythmie, une dysfonction ventriculaire ou d’autres complications pouvant être des facteurs limitant la pratique du sport [1,11]. Dans tous les cas, il persiste souvent après remplacement valvulaire ou commissurotomie mitrale, un gradient valvulaire de repos et d’effort. Une dysfonction systolique ventriculaire gauche à l’effort est également possible [8,9]. Chez les patients porteurs de prothèse valvulaire mécanique ou ceux ayant gardé des facteurs de risque thrombo-embolique (fibrillation auriculaire, dilatation de l’oreillette gauche), le traitement anticoagulant doit être poursuivi. Ce traitement expose au risque hémorragique et représente une contre-indication aux sports de contact [8, 9,11]. Les bioprothèses et les plasties pourraient
permettre de s’affranchir du traitement
anticoagulant. Les bioprothèses se détériorent
rapidement surtout chez le sujet jeune. Les
plasties semblent être le meilleur traitement
chirurgical [1, 5, 13, 14].
D’autres traitements peuvent s’avérer
nécessaires (antibioprophylaxie des récidives
rhumatismales, traitements digitalique,
diurétique, vasodilatateur). Ils doivent être
pris en compte dans la détermination des
indications à la pratique du sport.
Le tableau 1 donne les recommandations à la
pratique du sport chez les patients ayant une
valvulopathie.
La poussée évolutive rhumatismale Elle réalise généralement une atteinte des 3 tuniques : à l’atteinte valvulaire, s’associent une myocardite souvent asymptomatique et une péricardite qui est généralement sèche ou de faible abondance [3-5]. Elle est reconnue par la présence d’une fièvre, d’arthralgies qui peuvent manquer, d’une élévation des anticorps antistreptococciques (antistreptolysines O-ASLO, antistreptodornases, antihyaluronidase) et de signes biologiques inflammatoires (hyperleucocytose, élévation de la Protéine C-Réactive, augmentation de la vitesse de sédimentation érythrocytaire, hyperfibrinémie) [3-5]. Sa prise en charge repose essentiellement sur la pénicillinothérapie, les anti-inflammatoires (corticoïdes, aspirine à fortes doses), associés éventuellement au traitement des complications de la cardiopathie [3-5]. Les recommandations internationales ne donnent pas d’indications spécifiques sur la pratique du sport après une poussée de rhumatisme articulaire aigue. En se fondant sur la possibilité d’une pancardite, la découverte d’une évolutivité rhumatismale chez le sportif devrait conduire à l’arrêt de toute compétition pendant au moins 6 mois (Tableau 2).
Recommandations générales au sportif atteint de cardiopathie valvulaire ou de rhumatisme articulaire aigu La guérison définitive n’est presque jamais obtenue après la survenue d’une valvulopathie rhumatismale ou non, même si celle-ci a été opérée. Certaines règles doivent être observées par le sportif et le corps médical [1, 5, 13, 14]: surveillance clinique régulière et au besoin paraclinique tous les 6 mois à 1 an ; prévention du risque d’endocardite infectieuse par la prophylaxie des plaies cutanées et par la recherche systématique tous les 6 mois de foyers infectieux (dentaires, ORL) ; antibiothérapie prophylactique pour éviter les poussées rhumatismales ; surveillance régulière du traitement anticoagulant lorsque celui-ci est indiqué ; éducation du patient et de son entourage sur la maladie et les traitements prescrits.

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
21
CONCLUSION La pratique du sport chez le sujet atteint de valvulopathie pose des problèmes différents en fonction du degré de sévérité de la valvulopathie, de son retentissement, de la présence ou non de symptômes et d’éventuelles lésions associées. Une fois la valvulopathie reconnue, il convient de rechercher des éléments pouvant déterminer le type de sport pouvant être pratiqué. La pratique du sport de compétition ne se discute que chez les sujets asymptomatiques. Les sujets présentant une valvulopathie légère à modérée, asymptomatique, sans retentissement cavitaire et sans hypertension artérielle pulmonaire peuvent en principe être autorisés à pratiquer un sport de compétition. La pratique du sport peut également être conditionnée par d’autres éléments comme l’existence d’une dilatation de l’aorte proximale qui représente une contre indication à la pratique du sport de compétition ou à une limitation à un sport de faible intensité. Le traitement anticoagulant constitue une contre indication aux sports comportant un risque de collision. La découverte d’une évolutivité rhumatismale doit conduire à l’arrêt de toute compétition pendant au moins 6 mois.
Tableau 1
Recommandations à la pratique du sport chez le patient atteint de valvulopathie * A
Dynamique faible
B Dynamique moyen
C Dynamique
fort I
Statique faible
Groupe 1 Groupe 2 , 3 et 4
Groupe 3 et 4
II Statique moyen
Groupe 2, 3 et 4
Groupe 2, 3 et 4
Groupe 3 et 4
III Statique
fort
Groupe 3 et 4
Groupe 3 et 4
Groupe 4
* Chaque cellule indique le type de sport pouvant être pratiqué
en fonction de la valvulopathie. Ces recommandations sont
valables si le sujet est asymptomatique à l’effort et en l’absence
d’arythmie sévère.
Groupe 1 Insuffisance aortique avec diamètre télédiastolique
ventriculaire gauche > 65 mm
Rétrécissement aortique serrée avec surface aortique
< 1 cm2
Insuffisance mitrale modérée avec des signes
d’insuffisance ventriculaire gauche ou
d’hypertension artérielle pulmonaire
Rétrécissement mitral serré avec surface mitrale
< 1 cm2
Dilatation de l’aorte (diamètre > 45 mm)
Groupe 2 Insuffisance aortique avec un diamètre
télédiastolique ventriculaire gauche compris entre
60 et 65 mm
Rétrécissement aortique serré avec surface aortique
comprise entre 1 et 1,5 cm2
Insuffisance mitrale modérée avec un diamètre
télédiastolique ventriculaire gauche supérieure à
60 mm
Rétrécissement mitral avec une surface mitrale
comprise entre 1 et 1,5 cm2, sans hypertension
artérielle pulmonaire sévère (pression artérielle
pulmonaire systolique < 50 mm Hg)
Insuffisance tricuspide minime ou modérée
Sténose tricuspide
Patients ayant bénéficié d’une valvuloplastie ou
sujets porteurs de prothèse valvulaire (ces derniers
doivent éviter les sports de collision s’ils sont sous
traitement anticoagulant)
Groupe 3 Rétrécissement mitral avec surface mitrale > 1 cm2,
sans hypertension artérielle pulmonaire (pression
artérielle pulmonaire systolique < 35 mm Hg)
Groupe 4 Bicuspidie aortique sans insuffisance aortique, sténose aortique ou dilatation de l’aorte Insuffisance aortique modérée avec un diamètre télédiastolique ventriculaire gauche < 60 mm Rétrécissement aortique avec une surface aortique > 1,5 cm2 Insuffisance mitrale modérée avec un ventricule gauche gardant des dimensions, une fonction systolique, ainsi que des pressions pulmonaires normales

Cardiologie Tropicale . N° 131 . Jan. - Fév. - Mars 2012
22
1-Otto CM, Bonow RO. Valvular heart disease. In Braunwald’s Heart Disease , Philadelphia, Saunders Elsevier edition, 8th edition : 1625-1693. 2-Crawford MH. Screening athletes for heart disease. Heart, 2007, 93 : 875-879. 3-Marijon E, Ou P, Celermajer DS et al. Prevalence of rheumatic heart disease detected by echocardiographic screening. New Engl J Med, 2007, 357 : 470-476. 4-Marijon E, Celermajer DS, Tafflet M et al. Rheumatic heart disease screening by echocardiography : the inadequacy of world health organization criteria for optimizing the diagnosis of subclinical disease. Circulation, 2009 ; 120 : 663-668. 5-Ba SA, Kane A, Hane L et al. Cardiomyopathies rhumatismales au Sénégal : aspects cliniques et thrapeutiques. Cardiologie Tropicale, 1998 ; 24 : 31-36. 6-Balady GJ, Ades PA. Exercise and sports cardiology. In Braunwald’s Heart Disease, Philadelphia, Saunders Elsevier edition, 8th edition : 1983-1991. 7-Mellwig KP, Van Buuren F, Gohlke-Baerwolf C. Recommendations for the management of individuals with acquired valvular heart diseases who are involved in leisure-time physical activities or competitive sports. Eur J of Cardiovasc Prev Rehabil, 2008, 15 : 95-103. 8-Maron BJ, Zipes DP. 36th Bethesda Conference :
Eligibility Recommendations for Competitive Athletes
with cardiovascular abnormalities. J Am Coll Cardiol
2005; 45 : 1321-1375.
9-Pellicia A, Fagard R, Bjornstad HH et al. Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease. A consensus document from the study group of sports cardiology of the working group of cardiac rehabilitation and exercise physiology and the working group of myocardial and pericardial disease of the european society of cardiology. Eur Heart J, 2005; 26: 1422-1445. 10-Pelliccia A, Zipes DP, Maron BJ. Bethesda Conference 36th and the European Society of Cardiology Consensus Recommendations Revisited, a Comparison of U.S. and European Criteria for Eligibility and disqualification of Competitive Athletes with Cardiovascular Abnormalities. J Am Coll Cardiol, 2008; 52 : 1990-2006. 11-Carré F. Guide pratique de cardiologie du sport. Paris, éditions expressions santé, 2008, 141 pages. 12-Carré F. Qu’est ce qu’un cœur de sportif ? Arch Mal Cœur Vaiss, 2006, 99 : 951-954. 13-Vahanian A, Baumgartner H, Bax J et al for the task force on the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology. Guidelines on the management of valvular heart disease. Eur Heart J, 2007, 28 : 230-268. 14-Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with valvular heart disease : a report of the ACC/AHA task force on practice guidelines. J Am Coll Cardiol, 2006, 48 : e1.
Tableau 2
Conduite à tenir devant un sportif présentant une poussée évolutive rhumatismale
Conduite à tenir
Arrêt de toute compétition pendant au moins 6 mois
Reprise de la compétition au-delà de 6 mois si toutes les conditions suivantes
sont réunies :
- Absence de valvulopathie significative
- Bonne fonction ventriculaire gauche
- Absence de péricardite
- Electrocardiogramme normal
- Disparition des signes biologiques inflammatoires
R E F E R E N C E S