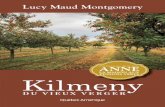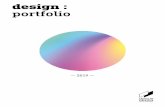Application de la distance d’édition à la correction de dictées musicales
A Hubert - jauneflux.com · Aux éditions pas d’édition : - Voi 1988 -Cocotte minette 1992 -Mr...
Transcript of A Hubert - jauneflux.com · Aux éditions pas d’édition : - Voi 1988 -Cocotte minette 1992 -Mr...
A Hubert que vive sa passion !
Ce document a été conçu comme support de « l’exposillon » se déroulant à la médiathèque de Boëge du 18 Mars au 11 Mai 2014 Intitulée :
« Dans le sillon du disque » Cette exposition contextualise l’histoire du disque en montrant le cheminement du stockage de l’information. Elle permet aussi de s’interroger sur les fondements et la forme de cette mémoire collective.
Dans le sillon du disque
Nicolas Gasquet
Avec la participation de Michel Delajoud pour la partie « Question de disques »
Edition pas d’édition
Aux éditions pas d’édition : - Voi 1988 -Cocotte minette 1992 -Mr Coquibus 1990 -Catalogue de sculptures plates 2013 -Les mimis mimétiques 2013
Couverture
Recto : K.P. Brehmer « composition für Tim Wilson II »1986, encre indienne et tempera. Tim Wilson aurait été capable, tout comme Arthur B. Lintgen, d’identifier la musique en regardant les sillons d’un disque !
Verso : Fabien Pellier affiche de l’expo « dans le sillon du disque » 2014. Imprimé en février 2014 à St Jeoire/imprimerie Saint-Jeoirienne
Dans le sillon du disque
Préambule
De prime abord, le disque évoque la musique. Il nous permet d’écouter nos
artistes préférés et de les faire partager. C’est un objet fabuleux de divertissement et
d’ouverture sur le monde qui produit de l’émotion. Le dictionnaire Larousse le définit
comme étant « une plaque circulaire contenant un enregistrement en vue de la
reproduction phonographique ».
C’ est donc un support sur lequel sont stockées des informations sonores, auxquelles on
accède grâce à un appareil pouvant les décoder. Le disque est donc un espace de
stockage. En ce sens, il contient une partie du savoir, des connaissances et de la
mémoire de l’homme. D’ailleurs, un disque, le « Voyager Golden Record »
est embarqué à bord de la sonde spatiale Voyager , lancée en 1977 en espérant
croiser le chemin des extraterrestres ! S2
Toujours en quête de connaissance, l’homme accumule les savoirs afin
d’améliorer sa condition, d’imposer son pouvoir, de montrer son appartenance à une
tribu, un clan ou tout simplement de survivre. Cette accumulation des savoirs passe par
la transmission des connaissances. Cette transmission ne présuppose pas
nécessairement de support et peut passer par l’oralité et la monstration ; mais il a été
très tôt nécessaire de fixer d’autres types de savoirs, plus immatériels. Le stockage des
apprentissages s’opère donc soit directement dans la mémoire du cerveau, transmis par
le langage et le geste, soit par l’interface d’un langage inscriptible sur un support :
graphisme, pictogrammes, écriture, enregistrement, codage numérique.
La mise en mémoire de la musique, art immatériel s’il en est, n’a évidemment pas
échappé à cette logique pour passer de l’oralité à sa mise en matière.
7
Voyager Golden Record :
Disque de 12 pouces contenant des sons et des images sélectionnés pour dresser un
portrait de la diversité de la vie et de la culture sur Terre, destiné à d'éventuels êtres
extraterrestres qui pourraient le trouver. Sur le couvercle du vidéodisque est gravé le
schéma explicatif du mode de lecture. Le disque lui-même comprend de nombreuses
informations sur la Terre et ses habitants, allant des enregistrements de bruits
d'animaux et de cris de nourrisson, jusqu'au bruit du vent, du tonnerre, ou d'un
marteau-piqueur. Sont aussi compris les enregistrements du mot « Bonjour » dans une
multitude de langues, des extraits de textes littéraires et de musique classique et
moderne.
8
Evolution des stockages de données dans une mémoire
« De la roche au Cloud »
-Proto-écriture sur roche, bois, os…
Lascaux et Almira Peinture rupestre Aborigène
Bien avant l’apparition de l’écriture, l’homme a mis en place des systèmes
graphiques de proto-écriture fixant le récit :
A l’âge préhistorique, certains graphismes pourraient correspondre à des aides
mémoires avec un système sémiologique propre. Ces réalisations graphiques associant
des pictogrammes, des figures humaines et animales parfois par métonymie et des
idéogrammes traits, points, quadrillages étaient à même de fixer sur un support
durable une histoire, un mythe que tous pouvaient comprendre.
Chez les aborigènes, malgré une stylisation très poussée, les panneaux peints avaient
une signification tangible (scène de cérémonie, personnages, lieu, éléments naturels,
animaux)
Pour les tribus d’Océanie ou chez les amérindiens, les pictogrammes servaient à
transmettre la mémoire d’un groupe. (Exploits de guerriers, chant de guerre, rituels
chamaniques). On peut identifier une sorte d’alphabet avec des stéréotypies
graphiques.
9
-Ecriture sur tablettes, papyrus, codex, livres…
A l’Antiquité, en Mésopotamie et en Egypte en -3500 avant J-C, l’apparition de l’écriture permet de coder pour transmettre et conserver des notions abstraites. Les hommes ont pu graver des textes sur les monuments puis sur des tablettes en pierre. Les Grecs et les Romains se servaient de tablette en glaise ou en cire et de rouleau en papyrus (volumen). Progressivement, le parchemin remplace le papyrus. Au Moyen Âge, le codex est une révolution comparable à l'invention de l'écriture. Le livre n'est plus un rouleau continu, mais un ensemble de feuillets reliés au dos. A partir du XIVe siècle, le papier remplace progressivement le parchemin. Il permet une diffusion plus large grâce à l’imprimerie.
-La remémoration par des images
Dans l’Antiquité et au Moyen âge, les écrits étaient rares et la transmission du savoir se faisait avec des techniques de mémorisation par cœur (Cicéron : « avoir toutes les idées gravées dans l’esprit et tout l’attirail de mots disposés en bel ordre ») Les Grecs et les Romains ont élaboré des techniques permettant la mémorisation des textes ou des longs discours en ayant recours à des images mentales (architecturale notamment). Les moines se servent des productions artistiques (vitraux, sculptures, enluminures) pour se représenter un texte à mémoriser. A la Renaissance, dans les livres, des dessins servent à visualiser le chemin de lecture. Par exemple dans l’encyclopédie publiée par l’Académie vénitienne (1557), on retrouve « des arbres de connaissances ». Les connaissances sont ainsi spatialisées. On retrouve aussi des schémas en forme de roues (giason Denores) permettant la mémorisation du savoir.
10
Roue du savoir de Giason Denores
-Le stockage séquentiel et numérique Après l’invention de l’imprimerie, une autre révolution en matière de stockage d’information voit le jour au 18ème siècle avec les débuts de l’industrie. Il s’agit du système de stockage séquentiel et numérique. En 1725, Basile Bouchon met au point le premier système de programmation grâce à un ruban perforé, perfectionné par la suite par Jacquard (1804) pour programmer des métiers à tisser. S3
Début 1800, Charles Babbage imagina une machine analytique inspirée des cartes du métier Jacquard dont la lecture séquentielle lui fournissait des instructions et des données qui permettaient d’effectuer des calculs. C’est l'ancêtre mécanique des ordinateurs modernes. L'invention d'une machine à cartes perforées par Herman Hollerith, utilisée pour le recensement de 1890 aux Etats unis, a été à la base du développement des ordinateurs (IBM, Bull) qui utiliseront ces cartes perforées qui disparaitront à partir de 1970 lorsque sont apparues les unités d'entrée-sortie à bandes magnétiques et à disquettes souples de format « 8 pouces ». 11
Disquette
Dans les années 1980, des supports optiques, tels que le disque compact remplacent les
bandes magnétiques.
Dans les années 2000, les mémoires flash (clé USB, carte SD) tendent à supplanter les
supports optiques.
Depuis quelques années, des systèmes de stockage, permettent de stocker sur des
serveurs distants (les Cloud). Nous entrons dans l’ère de la dématérialisation…
12
Que dire de la mise en mémoire de la musique ?
Le stockage de la musique sur un support matériel n’a évidemment pas échappé à l’évolution du stockage de données décrites dans le chapitre précédent.
-La notation de la musique
Entre le VIII et IXème siècle, le renouveau intellectuel carolingien a permis
l’apparition des premières notations de la musique. A partir de ce moment, l’écriture de
la musique jusqu’alors transmise par oral fut écrite et cela distingue la culture
occidentale de toutes les autres. Seul l’occident a développé un système complexe
visant à traduire les sons en signes. La partition devient un lien entre la pensée d’un
compositeur et un interprète... La notation musicale consacre donc la prédominance de
la relation graphique sur la relation orale.
Revenons au moyen Âge où l’apprentissage et la transmission de la musique est orale.
Le Viva Voce assure la pérennité de la tradition du répertoire. Les premières graphies,
les « neumes » sont apparues pour fixer la mélodie des chants. Chaque neume était
associée à une syllabe, phonème, ou mot et donnait une indication sur la durée et la
hauteur de la note par rapport à la précédente.
La lecture des notes est alors dépendante de la lecture du texte et laisse une part d’improvisation. S4
13
Fin XII, l’écriture de la musique s’est peu à peu affranchie de la lecture d’un texte. L’écriture de la musique a imposé un outil prescriptif et normatif important, mais jamais la notation n’est parvenue à traduire en signes écrits, même avec le secours des nuances, ce qui fait la particularité de la musique : les subtilités de l’interprétation vivante ne peuvent pas s’écrire car on ne peut traduire dans la matière et la durée, ni figer dans les limites de l’écriture ce qui est, par essence immatériel et fugitif. S5
Des compositeurs contemporains ont tenté de représenter autrement la musique avec des partitions aux formes nouvelles comme Xenakis avec ses partitions « mathématiques », les stripsody de Cathy Berberian, les collages en « jam-cut » de John Zorn… S6 S7 S8
14
-Support non enregistré mais sur lequel la musique était mémorisée. Même si au IX siècle, à Bagdad, une flûte mue par des picots atteste des recherches pour automatiser la restitution musicale, et que les carillons des églises dès le XIIIème siècle pouvaient jouer automatiquement, il aura fallu attendre le 17ème siècle pour stocker de la musique sur un support matériel, et pouvoir rediffuser de la musique à volonté.
-Le cylindre picoté ou disque à ergots
Au XVIIème siècle, la serinette contiendrait le 1er support d’une mémoire musicale en Occident. La musique est inscrite sur un cylindre de bois picoté mue par une manivelle tournée par l’homme et qui actionne des soufflets qui soufflent dans des flûtes. Le morceau noté sur le cylindre dure de 10 à 20 secondes. Certains modèles plus évolués disposent d'un système permettant de décaler le cylindre pouvant ainsi jouer d’autres mélodies. S9 Les premiers orgues de barbarie fonctionnent sur le même principe que la serinette. S10 Avec la démocratisation des bals les pianos mécaniques fonctionnant aussi avec des cylindres qui, en plus d’actionner les touches du piano, permettent l’activation de percussions … S11
Parallèlement, se développe la boîte à musique avec son invention attribuée en
1796 à l'horloger genevois Antoine Favre. Un cylindre, puis plus tard un disque à ergots,
entrainé par la force d’un ressort va soulever des lames métalliques qui, par vibration,
vont produire un son. On peut noter ici la naissance du 1er disque, voire du 1er juke
boxe, puisque certaines boites à musique dotées d’un monnayeur étaient capables de
changer de disque automatiquement. S12 S13 S14
15
Polyphon changeur ancêtre du juke boxe Limonaire
-Le carton, le papier ou le métal perforé
Orgue de barbarie disques d’Ariston
Dans le même temps, des systèmes de programmation musicale à carton, papier ou métal perforé voient le jour, inspirés par les innovations de Jacquard. Les cartons perforés rigides, pliés en accordéon ou en bandes, permettront de faire jouer de manière automatique des orgues, parfois monumentaux (limonaires, etc.) S15
16
Les rouleaux de papier perforé permettront notamment le fonctionnement des pianos pneumatiques. ( S16) Dans les salons, les musiciens pouvaient s'entrainer à jouer à 4 mains, ou simplement donner des concerts privés sans musicien, puisque les plus grands pianistes s'enregistraient sur bandes perforées. Certains pianos étaient même accompagnés de violons eux aussi programmés grâce au papier perforé. D’autres instruments, orgues, saxophone, accordéon, harmonica… pouvaient également jouer « seuls » grâce au papier perforé. S17 D’autres systèmes utilisaient comme support le disque en métal ou carton perforé pour faire jouer des anches comme c’est le cas pour l’Ariston (1er tourne disque !) S18
-Les supports enregistrés
-Enregistrement sur une feuille de papier !
Dès 1807, l'anglais Thomas Young imagine, pour étudier les phénomènes sonores, d'utiliser la pointe d'un stylet, rendu solidaire d'un corps capable de vibrer, en la faisant glisser sur la surface d'un cylindre tournant.
Le français Édouard-Léon Scott de Martinville invente le premier dispositif permettant l'enregistrement du son, sans toutefois pouvoir le restituer. Il dépose en 1857 un brevet sous le nom de phonautographe. L'appareil se compose d'un pavillon relié à un diaphragme qui recueille les vibrations acoustiques transmises à un stylet qui les grave sur une feuille de papier enduite de noir de fumée, enroulée autour d'un cylindre tournant. On voit les lignes sinueuses représentant le son. Des chercheurs de l'université de l'Indiana ont réussi en 2008 à restituer le son de cet enregistrement papier. L'analyse informatique des tracés des premiers exemplaires fait entendre une voix qui serait celle de Martinville lui-même chanter « Au clair de la lune ». S19
17
Phonautographe « Au clair de la lune »
-Enregistrement par photogravure !
Le 30 avril 1877, Charles Cros invente le Paléophone, procédé qui permet de déposer par photogravure sur un disque métallique les courbes sonores obtenues par le phonautographe, de façon à les lire avec une pointe solidaire d'une membrane élastique. Il développe l’idée d’un tracé en relief ou en creux sur un matériau résistant comme support d’enregistrement. Il pense à des procédés photographiques alors bien connus ce qui renvoie à la photogravure. On photographie une feuille enduite de noir de fumée enregistrée avec le procédé de Martainville sur une plaque de verre. On “pellicule” alors la plaque de verre de l’appareil photographique, c’est-à-dire qu’on en tire un film souple négatif le dessin des ondes devient un tracé noir. Après avoir préparé une plaque de zinc ou de cuivre enduite de bitume de Judée, dont la propriété physique est de durcir s’il est exposé à la lumière, on superpose le film souple et la plaque métallique puis on expose le tout au soleil. Le tracé de couleur noire correspondant à l’enregistrement ne laisse pas passer la lumière tandis que les parties vierges, transparentes sur le film, laissent passer la lumière et se durcir le bitume. On dépose alors un acide qui creusera la plaque en la mordant aux endroits où le bitume de Judée n’aura pas durci.
18
-Enregistrement sur feuille en étain puis sur cylindre en cire
En fait, si Charles Cros a énoncé de façon très claire les principes du phonographe et déposer le brevet, seul Edison a été capable d'en fabriquer un, en décembre 1877. Un diaphragme, ici en mica, transmet les vibrations sonores à un stylet. Celui-ci grave directement ces vibrations sur un cylindre recouvert d’une feuille d'étain. Inversement, le passage de l'aiguille sur le sillon gravé à l'enregistrement fait vibrer le diaphragme, permettant d'entendre faiblement le son enregistré. Il y enregistre en 1878 une petite comptine pour enfant : "Mary had a little lamb", premier enregistrement jamais réalisé mais jamais retrouvé.
En 1880, Graham Bell, va reprendre le concept du phonographe pour l'améliorer et le rebaptise Graphophone. Entre autres changements, il utilise un rouleau de carton enduit de cire, matière plus malléable et moins bruyante que l'étain, et une pointe de saphir, inusable et qui abîme moins le sillon que l'acier. S20
Comme on ne sait pas reproduire les cylindres, les musiciens enregistrent toute la journée devant des murs d'appareils, pour faire le maximum de copies. Plus tard, par un système de pantographie, on pouvait tirer 25 copies à la fois.
D’autres marques voient le jour. En France, les frères Pathé, qui avaient gagné de l'argent en plaçant un phonographe payant dans un café, commencent à fabriquer leur propre matériel et à faire des enregistrements. En 1889, leur catalogue contient déjà 1500 titres, 12 000 en 1904, et en 1897, l'industrie du disque est née.
Mais il a fallu attendre 1901 pour pouvoir reproduire les cylindres par moulage et 1909 pour que leur durée passe à 4 minutes. Il est déjà trop tard, les cylindres disparaissent peu à peu au profit du disque, même s'il s'en produit jusqu'en 1929, pour alimenter les milliers d'appareils déjà vendus.
19
-Enregistrement sur disque
Disque en vulcanite, un caoutchouc dur, puis dans une matière plastique appelée Durinoïd et enfin sur vinyle.
Le problème de la duplication des enregistrements était un frein important à la commercialisation du phonographe. En 1887, Emile Berliner dépose un brevet pour un lecteur à disque plat en zinc enduit de cire que l'on grave avec un burin métallique. Le burin se déplace latéralement et non en profondeur comme le fut celui d'Edison. On attaque ensuite à l'acide chromique le zinc qui a été mis à nu par la gravure. Ce disque peut alors être facilement reproduit en un nombre infini de copies en fabricant un moule par galvanoplastie. Les disques étaient ensuite reproduits par pressage de copies à partir de la matrice. Les premiers disques sont pressés en vulcanite, un caoutchouc dur, puis dans une matière plastique appelée Durinoïd. Le sillon en gravure étant latéral, il s'use moins rapidement que la gravure en profondeur des cylindres, le poids du bras ne reposant pas directement dessus. Le succès est énorme, il se vend pour un million de dollars de gramophones aux USA. En 1898, Berliner et ses associés fondent en Angleterre « The Gramophone Company », qui deviendra « His Master's Voice » puis « E.M.I. ». En 1904, l'usine de Hanovre presse 25 000 disques par jour et le catalogue contient déjà plus de 5000 titres ; en 1929, elle fabrique 10 millions de disques par an! La technique s'affine et, en 1910, on propose la première gravure orchestrale, le premier mouvement du Concerto pour piano de Grieg par Wilhelm Backhaus et le New Symphony Orchestra dirigé par Landon Ronald et, en 1913, la première œuvre intégrale, la 5° symphonie de Beethoven par la philharmonie de Berlin dirigée par Arthur Nikisch.
20
Les frères Pathé adoptent également le disque gravé (verticalement) à partir de 1906, et fabriquent, sous le nom de « Pathéphone » l'appareil de reproduction approprié. (S21) Pathé se convertit à la gravure latérale en 1920 car elle pose moins de problème. (S22) En effet, du fait de l'enregistrement en profondeur, il était indispensable de prévoir une épaisseur de matière gravée assez considérable. Or cette matière est fragile et la solidité du disque s'en ressent. Du fait de la profondeur des sillons, le saphir est de forme sphérique et s'encastre dans le sillon. Le saphir monte et descend sur le sillon au rythme du son enregistré. La surface de contact est très importante d'où un fort bruit de fond. La gravure latérale est encore le système utilisé pour les disques vinyles.
Malgré l'essor croissant de la musique enregistrée, le son des disques ou cylindres à enregistrement acoustique, ou mécanique, n'est pas excellent. En effet, les enregistrements sont effectués sans amplification, seules les vibrations sonores actionnent le burin graveur. Mais leur force mécanique est très faible et l'on ne peut enregistrer que des instruments au fort volume sonore, à condition, encore, qu'ils soient très près du cornet acoustique.
Les séances d'enregistrement sont assez épiques et les orchestres sont réduits à quelques musiciens, les violons remplacés par des clarinettes ou des violons Stroh ou strohviol (les cordes sont montées directement sur un diaphragme amplifié par un cornet), les contrebasses par un tuba, ce qui donne une sonorité bizarre à l'ensemble. Les voix passent plus ou moins bien -les masculines mieux que les féminines- à cause de la très faible bande passante, 250 à 2.500 Hz, à peine celle du téléphone, et le bruit de fond est très important.
Du coup, on enregistre surtout des chanteurs, des orchestres de cuivres ou de jazz, le violon n'est guère fameux, pas plus que le piano, où l'avantage du piano mécanique est certain. S22
21
Voici comment le pianiste Gerald Moore décrit une séance d'enregistrement dans les
années 1920 :
"Le studio d'enregistrement était purement utilitaire : les murs - ou dirai-je les palissades ! étaient en planches non polies, le sol en bois dur ; en l'absence de tout matériau pour absorber le son, mes pas tonnaient sur le parquet nu, ma voix retentissait comme si ma tête se fût trouvée dans la caisse de résonance de quelque gigantesque contrebasse. Je fis courir mes doigts sur les touches du piano, et fus atterré par la rudesse métallique de sa sonorité [É] : à l'examen, je découvris que l'art de l'accordeur avait rendu le piano aussi percutant que possible en limant les feutres des marteaux. Un énorme cor ou une énorme trompette faisait saillie dans la pièce, et s'effilait en s'enfonçant dans le mur ; de toute évidence, il communiquait avec la chambre des machines, recueillant les sons et les enregistrant sur le disque de cire tendre [...]
Il faut se rappeler que le cornet constituait le nombril de notre monde, inamovible, et que bien entendu le chanteur devait se tenir debout devant. Que dis-je ! Cela ne suffisait pas : il enfonçait la tête jusqu'au milieu du cornet. L'on ne pouvait déplacer que le piano, tantôt ici, tantôt là, et je me retrouvais souvent, une fois l'équilibre mis au point et quand nous étions prêts à faire les matrices des disques, avec une vue en perspective du chanteur; je ne distinguais de lui que ses fesses, tandis que mon piano se trouvait éloigné de toute la longueur d'une salle de billard.
Mais c'était l'enregistrement des duos qui me divertissait le plus. Il se transformait souvent en empoignade entre les protagonistes : ténor et basse, ou soprano et baryton. Chacun voulait briller, chacun voulait monopoliser le cornet ; étant donné les charges et les poussées qui s'ensuivaient, je m'émerveillais qu'il leur restât le moindre souffle pour chanter."
L'idée est donc d'amplifier le signal avant de le graver, en utilisant les technologies mises au point pour la radio, afin d'éviter les distorsions des signaux les plus faibles. Le microphone existe depuis 1876 -les premiers essais d'enregistrement avec micro datant de 1896- et la lampe triode, permettant d'amplifier les signaux électriques, depuis 1906.
De premiers essais de gravure amplifiée sont tentés par des ingénieurs de HMV en 1920, mais il s'agit d'amplifier le son par un haut-parleur avant de le graver avec un graveur mécanique. Ce n'est qu'en 1925 qu'apparaissent les premiers véritables enregistrements électriques, aux USA puis en Europe, d'abord avec des micros au charbon, dérivés de ceux utilisés dans les téléphones, assez médiocres, puis avec des micros à condensateur, très proches de ceux toujours utilisés aujourd'hui.
22
Tout va alors très vite, Western Electric fabrique les premiers micros électrostatiques et General Electric les premiers haut-parleurs dynamiques dès 1928 (avec une bande passante de 40 à 13 000 Hz dès le début des années 30 pour les haut-parleurs de cinéma), le pick-up électrique, apparu en 1926, remplaçant peu à peu les phonos à pavillons.
Le disque peut alors prétendre à une certaine fidélité avec une gamme de fréquence de 50-6 000 Hz en 1925, jusqu'à 30-8 000 Hz à la fin des années 30 et l'enregistrement s'attaque à toutes les musiques. Cette fidélité a d'ailleurs de grandes conséquences pour les artistes, car, si les séances d'enregistrement gagnent en confort, le disque met en valeur tous les défauts de leur technique ou de leur interprétation, ce qui passe en concert ne supportant pas forcément des écoutes répétées. Les exigences des musiciens et du public ne seront plus jamais les mêmes.
Cependant, certaines contraintes restent, une durée limitée à 4'30 par face, ou le bruit de fond constant et la faible dynamique liées à la lecture mécanique avec un bras très lourd, qui oblige à utiliser une matière très dure et légèrement abrasive pour que les disques ne soient pas traversés par l'aiguille des phonos.
Dès 1931, on savait qu'il serait possible d'améliorer la qualité du son et d'augmenter la durée du disque en employant une tête plus légère et en faisant des sillons plus fins lus par saphir. (S12) Mais il était économiquement impossible de remplacer toutes les machines existantes et, jusqu'à l'après-guerre, il fallut donc se contenter de ces limites, même si RCA avait expérimenté les premières gravures microsillons 33 tours en 1931. De même, les premiers essais de stéréophonie, peu exploitables, remontent à 1920, les premiers disques étant enregistrés en 1933 par EMI (symphonie 41 de Mozart par Thomas Beecham) qui avait déposé des brevets en 1931.
23
Disque en polychlorure de vinyle
-1939 : Suite à la Guerre mondiale, on est obligé de trouver un autre produit pour fabriquer les disques. On découvre alors le polychlorure de vinyle, produit plastique dérivé du pétrole. -1944 : Les premiers disques vinyle 78t aux États-Unis furent commercialisés. S23 -1944 : Réalisation à titre expérimental du premier 33 tours par le Belge René Snepvangers. -1946 : La firme Columbia vend aux États Unis les premiers microsillons de 33 tours, ce sont des disques de musique classique de Mendelssohn et de Tchaïkovski. S24
-1949 : Apparition aux États-Unis du premier disque 45 tours minute de format 17 cms.
24
1951 : Sortie du premier 45 tours en France, le microsillon va s'imposer durant les années 50, pressé par Pathé Marconi. 1957 : Abandon du 78 tours, naissance de la stéréophonie. La lecture ne s’effectue pas seulement en latérale mais en bilatérale, le saphir lit les deux parties du « V » du sillon. 1958-1980 : Période la plus faste du vinyle. S25 S26 S27 S28 S29
Les formats particuliers :
Certaines marques comme Pathé ont sorti des disques de différents diamètres dont la lecture commence par le centre ce qui permettait un son de meilleure qualité en fin de morceau. Ils sont vite abandonnés car le ressort entrainant le disque peinait en fin de lecture.
Au milieu des années 1970, une firme spécialisée (M.D.R - Magnetic Disc Recordings) avait mis sur le marché des disques vinyles 33 tours dits « Trimicon » qui proposaient près de 60 minutes par face, là où la durée moyenne est de 20 à 30 min, selon la qualité. Ce procédé utilisait l'espace non gravé entre chaque tour de disque (1 sillon - 2 espaces vides - 1 sillon) pour y graver 2 sillons supplémentaires sur la même surface, ce qui triplait la durée de ceux-ci. Ces disques rares sont très fragiles, mais permettent de faire tenir une œuvre classique intégrale sur un seul et même disque 33 tr/min.
1976 : Arrivée du maxi 45 tours en France, mais l'invention du maxi 45 tours voit le jour par accident, suite à une pénurie de vinyle 45 tours, Tom Moulton grave un disque single sur un 33 tours. L'espacement entre les sillons plus grand modifie les tonalités du son, un meilleur rendement au niveau sonore, la durée du morceau rallongée.
25
Le picture disc
Picture disc années 40 carte postale années 60 années 70
Les disques publicitaires S30
Dans les années 1980, les ventes de vinyles baissent avec l’avènement du CD.
Depuis les années 2000, le vinyle connaît un certain renouveau. Des artistes ressortent des Maxi 45 tours, Picture disc, vinyles 180 grammes. De nos jours, les ventes de vinyles augmentent alors que les ventes de CD diminuent.
Gravure et pressage d’un vinyle :
La première étape consiste à graver une matrice. Elle se présente sous la forme d'une galette lisse constituée d'un disque d'aluminium entièrement recouvert d'acétate de vinyle. Un burin en diamant, monté sur un stylet chauffant grave un sillon hélicoïdal. Le stylet est couplé à un système électromagnétique, la tête de gravure, qui le fait vibrer horizontalement et verticalement pour un disque stéréophonique. Le disque ainsi obtenu peut être lu ou être utilisé pour faire une matrice de pressage. Les disques destinés à être lus sont faits sur des galettes plus résistantes à l'usure. On parle de disques à enregistrement direct. Le disque gravé est recouvert de métal par galvanoplastie. On retire le vinyle. Il reste une matrice qui permettra dans une presse de produire des disques.
26
- le support magnétique
En 1898, Valdemar Poulsen, employé à la compagnie du téléphone danoise, invente un appareil magnétique pour enregistrer les conversations téléphoniques, le Télégraphone, en utilisant une corde à piano enroulée sur un cylindre. En 1900, il remporte le Grand Prix de l'Exposition universelle, mais comme on ne sait pas encore amplifier le signal électrique, le son de l'appareil est trop faible pour être utilisé pour la musique.
Avec l'apparition des amplificateurs dans les années 20, l'idée est reprise en Allemagne par Kurt Stille qui fabrique en 1928 le Textophone, enregistrant sur un fil d'acier, et en 1929, par Ludwig Blattner qui propose le premier enregistreur sur bande d'acier, le Blattnerophone, utilisé par la BBC pour ses émissions rediffusées (mais il pèse une tonne et il faut 1km et demi de bande pour 1/2 heure d'enregistrement).
En 1934, AEG et BASF fabriquent le premier Magnétophone enregistrant sur bande magnétique souple et le premier enregistrement est réalisé dans la salle de concert de BASF le 19 novembre 1936 par le London Philharmonic Orchestra dirigé par Thomas Beecham.
27
Les performances de ces premiers magnétophones sont bien supérieures à celles du 78 tours: bande passante de 50 à 10 000 Hz, 60 dB de dynamique, moins de 1,5% de distorsion: un son déjà proche des standards de la Hi-Fi. Les ingénieurs du son font même quelques essais d'enregistrement stéréophonique.
L'enregistrement sur bande magnétique, qui permet de réaliser des montages alors que la gravure directe des 78 tours n'autorisait aucune correction, se répand dans les studios à partir de 1950 ; grâce à la copie américaine des magnétophones allemands confisqués à la fin de la guerre, les Ampex. Mais ses avantages, comme la haute-fidélité, ne peuvent être exploités qu'avec un nouveau support, le microsillon 1948. Avec le nouveau support magnétique, il est plus facile de réaliser des enregistrements stéréophoniques (d'abord en synchronisant deux machines, puis en divisant la largeur de la bande en deux et en utilisant deux têtes séparées) et les essais sur la stéréo reprennent aux USA à partir de 1952. En 1954, sont réalisés les premiers enregistrements stéréophoniques, d'abord vendus sous forme de bandes magnétiques, les premiers disques stéréophoniques n'apparaissant sur le marché qu'en 1957.
En 1963, Philips, après plusieurs années de recherche développe la cassette audio. Elle contient deux bobines où est enroulée une bande magnétique. Elle permet d'enregistrer et d'écouter de la musique ou tout autre type de son. Elle s'utilise avec un magnétophone spécialement conçu appelé magnétocassette.
K7
Elle connaît un très grand succès et fut la norme d'enregistrement audio domestique jusqu'à l'apparition des disques compacts enregistrables.
La cassette fut aussi à la base du succès mondial du Walkman (baladeur), le lecteur de cassette ultra-portable commercialisé en 1979 par Sony.
Elle a été aussi utilisée comme moyen de stockage informatique sur les premiers ordinateurs personnels. L'enregistrement se faisait de manière analogique (les signaux numériques étaient transformés en modulation sonore) et la restitution était peu fiable. Aucune correction d'erreur n'était possible et le volume de données enregistrées très réduit. Ce support a vite été abandonné au profit de la disquette. 28
En 1992, Philips, avec Matsushita, a essayé de reproduire le succès commercial de la cassette en sortant la cassette compacte digitale ou DCC. Cette cassette digitale était du même format que l'ancienne musicassette, les appareils DCC étant capables de lire les cassettes analogiques… Le DCC n'a pas eu de succès commercial, le grand public s'orientant de plus en plus vers les disques compacts enregistrables (CD-R et CD-RW), MINIDISC et les professionnels étant déjà majoritairement équipés de lecteurs-enregistreurs DAT.
- le support numérique
Le Compact Disque
Dès 1937, Reeves avait inventé la Modulation par Impulsion Codée, fondement de l'enregistrement numérique, mais il fallut attendre les progrès de l'informatique pour généraliser l'enregistrement numérique du son. Les premiers sont réalisés en 1979, conjointement par DECCA ("Concert du nouvel an" par Boskowsky) et D.G. ("Concerto de Tchaikovsky" par Gidon Kremer).
En fait, l'apparition du CD audio est liée aux expérimentations effectuées dès les années 60 pour enregistrer l'image sur disque. En 1978, Philips invente un disque vidéo, le Vidéodisque, lu par un faisceau laser capté par une photodiode, et sort en 1982 le Compact Disc, utilisant la même technologie. Le support numérique a été une révolution pour l'utilisateur domestique plus que pour le professionnel, les principes de la prise de son n'ayant en fait guère varié en 30 ans, même si le support numérique supprime toutes les défauts de la lecture mécanique : plus de bruit de surface lié à la bande magnétique, meilleure dynamique, meilleure pureté sonore. Surtout, le CD permet d'avoir chez soi un support de qualité professionnelle. S31
Il était au départ prévu que le compact ait 11 cm de diamètre pour une durée de 60 mn, mais Mme Morita, la femme du PDG de Sony, voulant avoir la 9° Symphonie de Beethoven sur un seul CD, on augmenta son diamètre à 12 cm, pour une durée moyenne de 75 min, pour pouvoir enregistrer l'œuvre qui dure 70 min.
1996, le CD est en plein boum, seules les discothèques et quelques magasins obtiennent encore des vinyles.
29
Les CD spéciaux : Tout comme les pictures disques, certains musiciens proposent des CD avec un packaging original.
Le format MP3
En 2006, de nouveaux supports voient le jour avec de nouveau système de compression Moving Picture Experts Group (MPEG). C'est un algorithme de compression audio capable de réduire drastiquement la quantité de données nécessaires pour restituer de l'audio, mais qui, pour l'auditeur, ressemble à une reproduction du son original non compressé : avec une bonne compression, la différence de qualité devient difficilement perceptible. Le fait de réduire la quantité des données permet de stocker la musique sur des mémoires flashs.
Ce format de données utilise un système de compression partiellement destructif. Il ne retransmet pas intégralement le spectre des fréquences audio. En revanche, il tente d'annuler d'abord les sons les moins perçus de façon à ce que les dégradations se fassent le moins remarquer possible. Ce n'est pas une compression à proprement parler, mais plutôt une suppression d'informations. Compresser un fichier musical provenant d'un CD audio au format MP3 réduit la qualité. Il suffit de faire plusieurs essais à différents taux de compression pour constater une baisse progressive de la qualité. (Plus la compression est forte, plus le son est dégradé.) Une compression correspondant à 64 kbit/s donne un son « enroué » et à 32 kbit/s, un son médiocre de qualité « grandes ondes ».
30
La compression au format MP3 exploite un modèle psycho acoustique de l'effet dit de « masque » : si deux fréquences d'intensités différentes sont présentes en même temps, l'une peut être moins perçue que l'autre selon que ces deux fréquences sont proches ou non. La modélisation de notre audition, selon ce principe, est au départ empirique, mais assez efficace. Elle exploite en outre les caractéristiques psycho-acoustiques de masquage temporel du filtre en sous-bande hérité du MUSICAM dans la mesure où les sons percussifs (piano, triangle, batterie,..) n'engendrent aucun artefact perceptible de type préécho. Toutefois, si le taux de compression est trop important, on peut être amené à faire ressortir certaines harmoniques de façon non attendue. Cela donne alors l'impression de bruits parasites et désagréables au milieu du son. On peut améliorer la qualité à débit moyen égal en utilisant un débit binaire variable (VBR ou Variable Bit Rate par opposition à un débit constant Constant bit rate, CBR). Dans ce cas, les instants peu complexes (contenant peu de fréquences), comme les silences par exemple, seront codés avec un débit d'information plus faible. Par exemple, 64 kbit/s au lieu de 128, réduisant ainsi la taille totale du fichier tout en gardant une très bonne qualité lors des passages riches en harmoniques. L'amélioration apportée est variable selon le morceau codé. Le codage en VBR peut néanmoins poser des problèmes de compatibilité avec certains lecteurs. De nombreux audiophiles et techniciens du son ayant souvent une oreille sachant décrire des éléments sonores dénigrent ce format qui dénature sensiblement le son à un tel point qu'ils ne l'utilisent jamais. Mais pour la majorité des utilisations, cette perte de qualité est masquée par la moindre qualité des équipements audio : baladeurs mp3 avec oreillettes (incluant également les téléphones portables, iPod, iPad) ainsi que les haut-parleurs très médiocres des ordinateurs portables… Une des causes des aprioris négatifs vis-à-vis du MP3 vient du fait qu'au début de l'utilisation par le grand public (fin des années 1990), les utilisateurs encodaient leurs CD audio en MP3 le plus souvent avec un taux de 128 Kps (à ce propos, dans Windows XP l'encodeur MP3 de Microsoft était limité à 128 kb/s maximum). De nos jours (2011) il est considéré que pour des fichiers de qualité acceptable, on peut choisir de les compresser selon un taux de 192 kbit/s voire 320 kbits/s. Dans tous les cas, il faut noter que la qualité sonore d'un fichier MP3 varie de manière importante selon l'encodage employé (type d'algorithme, taux de compression, etc.). Alors que les fortes compressions (fichier à 64 ou 128 kb/s par exemple) dénaturent radicalement le signal audio, une oreille non initiée ne saurait faire une distinction entre un élément audio non compressé et le même élément compressé en MP3 à 320 kb/s. 31
Les majors compagnies suivent le marché par la vente en ligne de MP3. S32
Depuis peu, avec l’apparition des cloud, la musique n’est même plus stockée chez
l’auditeur mais sur des serveurs distants.
32
Perspectives :
Depuis l’avènement du numérique, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité,
le support est périssable sur un mode binaire. Ainsi, un cylindre picoté, un papier ou un
carton perforé, un disque en cire ou en polychlorure de vinyle peut se dégradé et perdre
en qualité mais il peut être éventuellement restauré, alors que le support numérique
sera soit lisible, soit illisible (présence de son ou absence de son, mais pas de son
dégradé). Il faudra donc penser à sauvegarder les informations sur d’autres supports en
suivant les évolutions technologiques et déterminer quelles informations sauvegarder ?
La dématérialisation actuelle des supports de la musique permettrait-elle de revenir à
l’essence même de la musique ? La musique a-t-elle besoin de matérialité, d’un support
physique ?
Vivement demain !
Joe pengelly « mandrin déménagement »2000
33
Question de disques
La question du disque et du son dans les arts plastiques est un vaste sujet. La
forme et l’abstraction pourraient être évoquées avec Delaunay, Malevitch... Le rapport
au temps et au mouvement avec Tinguely, Vasarely…, l’infini avec Kusuma…, mais le
sujet se focalisera ici sur la correspondance entre son et couleur, le rapport bruit
mouvement vitesse et les expériences contemporaines.
34
A partir de la moitié du XIXème siècle, les grandes inventions relatives au stockage
et à la lecture des sons, associées au tumulte produit par le monde moderne –
machines, trains et voitures, etc. vont amener les artistes plasticiens à s’intéresser au
« sonore ».
- Correspondance entre son et couleur :
L’idée de correspondances entre son et couleur, telle qu'elle est développée au XIXème siècle, introduit un nouveau mode de relation entre la peinture et la musique, très différent de ce que recouvrait l'idée classique de comparaison ou de parallèle.
Par exemple, Vassili Kandinsky motivé par une réelle quête spirituelle dont la démarche artistique n’est que l’outil, cherchera par la peinture à toucher l’âme humaine et à la porter vers des dimensions supérieures. Il décrit bien ses sensations synesthésiques. Il découvre notamment que la peinture converge avec la musique en écoutant Lohengrin : les sons engendrent la perception de couleurs : “Je voyais en esprit toutes mes couleurs, elles se tenaient devant moi”. Lui-même violoniste et fasciné par la puissance émotionnelle de la musique, il écrit en 1907 la pièce de théâtre Der Gelbe Klang (le Son Jaune), associant musique, poésie, théâtre et jeux de lumière.
Vasarely Contrasting sounds Der Gelbe Klang
35
Le courant des « cinépeintres », dont Charles Blanc-Gatti est un des plus éminents représentant, marquera le début du XXème siècle par son intention d’imager le son et la musique. La réalisation de Charles Blanc-Gatti la plus novatrice semble être le premier film d’animation entièrement dédié à la conversion sons / images avec « conservation » de
certaines caractéristiques de la musique. Il est précisé que la cinépeinture est même devenue un label, « sous lequel il (Charles Blanc-Gatti) déposera notamment le brevet d’une « peinture écran » (1934), servant à projeter des « effets lumineux polychromes mouvants et changeants à chaque instant en synchronisme absolu avec un morceau de musique et son orchestration ».
A la même époque, des musiciens s’intéresseront aussi à cette correspondance : Alexandre Scriabine va dès 1911, présenter une œuvre qui lui sera dédiée. Dans le spectacle « Prométhée ou Le poème du Feu », la scène est animée par l’intermédiaire d’un clavier dont chaque touche est reliée à une lampe projetant une couleur correspondante. Les couleurs se succèdent selon des lois définies par l’évolution narrative souhaitée par le compositeur, réactivant par sa féérie chromatique la passion pour l’utopie d’une unification artistique et sociale. S33
36
- Bruit mouvement vitesse
Les futuristes italiens prônent l'amour de la vitesse et de la machine. Russolo et Pratella, à travers une théorisation de la notion de bruit, font l'apologie du son et commencent à faire un classement du bruit. Cette nouvelle approche du phénomène sonore fait son apparition dans L'Art des bruits (L'arte dei Rumori), manifeste contenu dans une lettre que Russolo adresse à Pratella en 1913. Luigi Russolo est souvent considéré comme l'un des premiers compositeurs de musique expérimentale et bruitiste avec ses représentations de «concerts de bruits» dans 1913-1914 et de nouveau après la Première Guerre mondiale, notamment à Paris en 1921. Il est également l'un des tout premiers théoriciens de la musique électronique ". S34
Ses idées sont reprises dans les années 1920 par Edgard Varèse, qui introduit des éléments bruitistes dans sa musique par le biais d'instruments mécaniques. John Cage compose pour sa part en 1939 sa série des Imaginary Landscapes (Paysages Imaginaires), qui combinent des éléments tels que des bruits enregistrés, des percussions, des radios... D'autres compositeurs contemporains tels que Pierre Schaeffer, Iannis Xenakis (C’est par ses « Polytopes », structures immenses et éphémères que I. Xenakis proposera au public des compositions musicales et visuelles simultanées, qui viseront à la synthèse des arts, de son “meta-art” comme il le nomme, pour atteindre des dimensions bien supérieures à celles de la perception humaine.), Pierre Henry s'inscrivent dans cette continuité, et mènent des expériences à base de synthétiseurs, de bandes magnétiques et de radios, produisant les premières formes de musique électronique. Ces recherches donnent naissance à deux nouvelles formes de musique contemporaine: la musique concrète et l'électroacoustique. S35 37
En 1954, tout cela est théorisé par Nicolas Schöffer dans un livre, Le spatiodynamisme. En
1955, il réalise à Paris la première sculpture multimédia interactive au monde, dotée d'un
système d'interaction temps réel avec capteurs. Cette sculpture de 50 m de haut,
sonorisée par une composition temps réel à partir de bandes magnétiques de Pierre
Henry fonctionnera tout l'été 1955.
Exemple d’expression graphique des sons, I. Xenakis
Marcel Duchamp est amené, en 1925, à faire du cinéma expérimental, appelé l'« Optical cinema », avec son unique film Anemic cinema (35 mm, noir et blanc de 7 min). Son film présente des plaques rotatives qui deviendront plus tard, en 1935, les Rotoreliefs. Ces plaques tournantes comportent des jeux optiques, des jeux de mots, et de la géométrie.
38
Kupka, entre 1928 et 1930 reprend le thème du mouvement lié cette fois-ci au machinisme : des rouages, des bielles, des pièces mécaniques circulaires traduisent la puissance de machines imaginaires et écrasantes.
A partir de 1935, il s'intéresse aussi à la musique en ayant été marqué par "Pacific 231" d'Arthur Honegger, mais aussi plein d'intérêt pour une nouvelle musique qui est le jazz tente de conjuguer le machinisme et l'expression de la musique : il peint la série "Jazz Hot" en 1935, puis en 1936 "Musique".
39
-Expériences contemporaines
Fluxus :
Joseph Beuys “stummes Gramphon” 1958 “gramophone mit blutwurstund lautsprechen “ 1968
Henning Christiansen est un compositeur danois, un membre actif du mouvement interdisciplinaire Fluxus. Il a travaillé avec des artistes comme Joseph Beuys et Nam June Paik
40
Laurie Anderson : The Handphone Table, 1977
« J’ai conçu cette table pour le Project Gallery du Museum of Modern Art en 1978. L’idée m’en est venue quand j’étais en train d’écrire une histoire à l’aide d’une machine à écrire électrique : ça n’avançait pas, ça me donnait le cafard, je me suis pris la tête dans les mains et c’est là que je l’ai entendu, cette sorte de bourdonnement très fort émis par la machine, amplifié par la table et qui montait par mes bras jusque dans ma tête. Un son très clair et très fort. Ainsi j’ai pris le parti de fabriquer une table parlante, qui comporterait à l’intérieur des platines cassettes et des compresseurs de sons branchés sur des tiges en acier. Le bout de chaque tige rentre en contact avec une sorte de capteur incrusté dans la surface de la table à la manière d’un nœud. Si l’on met ses coudes sur les prises, le son monte le long des os des bras, il suffit alors de placer les mains sur ses oreilles en guise de casque ».
41
Milan Knizak a édité à 40 exemplaires signés " Broken Music " sous forme de multiples
ERIKM Physical Remix,2003 Objet, vinyle Électronic Music Archive, Kunsthalle St. Gallen, Suisse « Un vinyl 45 tours est disséqué par jets d’eau sous haute pression. Erikm creuse son matériau et fait déraper la lecture pour composer à plat une nouvelle variation syncopée. La pièce rejoue les procédés chers au virtuose des platines : fragments désossés, physiquement remixés et compilés entre eux à la manière d’un puzzle inconscient. » Leïla Quillacq
42
Le travail de Christian Marclay quant à lui explore les connexions entre son, photographie, video, et film. Pionnier dans l‘usage instrumental des platines vinyles pour créer des collages sonores, Christian Marclay est, dans les mots du critique Thom Jurek, peut-être « l’inventeur inconscient du turntablism ». Son utilisation des platines vinyles, commence au milieu des années 1970, mais ce développement sera indépendant de celui du hip-hop. En effet, Christian Marclay est davantage issu des cultures Rock et Punk des années 1970, questionnant et critiquant l'usage marchand du disque vinyle et les industries culturelles. S36
43
Jérémy Chevallier
CD Gravé 2006 Série de 12 CD-R vierges Série de 12 CDs sur lesquels sont gravés manuellement au poinçon des paroles de chansons rock. Concrete Music, 2011-2012 Béton, platine vinyle Réalisation de disques en béton armés. Ces disques sont lus lors de concerts ou présentés en tant qu’installation. S37
Michel Delajoud Audiodafé : 4 images d’un CD dont la surface qui contient l’information se désagrège et fait allusion au nombre impressionnant de langues qui disparaissent (25 chaque année selon Claude Hagège), laminées par les tendances hégémoniques de quelques-unes, dominantes en raison de la puissance économique et politique des états qui les parlent. Plus largement « Audiodafé » évoque le nivellement mondial des traditions culturelles et religieuses et comment les économies de marché, la culture mondialisée sont désormais dominées par les technologies.
44
Audiodafé/M. Delajoud
Jaune Flux/Nicolas Gasquet
« Sculpture plates, exploration aux limites du disque 2007-2014 » : Réflexion sur la
disparition du support et la dématérialisation/rematérialisation/hypermatérialisation de
la musique. Pour illustrer ce phénomène, Nicolas Gasquet, membre du groupe de
musique Jaune Flux, crée pour chaque nouveau morceau une sculpture plaque en
hypermatérialisant un CD.
Il s’agit d’explorer les limites physiques du disque en altérant le plus possible la forme
et le revêtement jusqu’aux limites de son écoutabilité avec un lecteur standard, donc
de le dématérialiser le plus possible pour mieux l’hypermatérialiser ! S38
Avec les nouvelles technologies et le stockage sur des mémoires flash ou des serveurs distants, les auditeurs ne possèdent plus la matérialité de la musique. La musique, art immatériel, reprend alors ses droits et la question de la matérialisation de la musique ne se pose donc plus, ce qui va bouleverser durablement les habitudes des éditeurs et des consommateurs…
45
And the show goes on : Des plasticiens et la musique pop
Depuis le début des années 2000, des artistes plasticiens produisent des œuvres qui ont pour matériaux la musique pop, la variété. Comment exposer ce type de pratique ? Où se situe l’œuvre, quel statut possède le support enregistré, etc… ? La série d’expositions curatées par Frank Lamy, toutes intitulées Popisme, posaient ces questions.
La première exposition de la série Popisme eut lieu à la Villa du Parc centre d’art contemporain d’Annemasse en 2003.
Et encore, pour plonger dans l’univers des labels et du disque des années 70 Phantom of the paradise de Brian de Palma (1974), mais aussi dans l’univers déjanté de Tim Burton, Mars Attack ou la musique des années 60 est capable de faire exploser le cerveau des martiens ! (espérons que cela n’arrivera pas avec le Voyageur gold record !)
46
Remerciements à : Françoise Roskams , Margaux Bel, Claudie Méjean de la
médiathèque de Boëge pour leur accueil et leur intérêt pour ce projet, merci
évidemment à Colette, Laure et Gaëlle qui ont permis à cette exposition d’exister. Merci
à Denis Bouchet, président de l’association de musique mécanique des Gets, à Agnès
Sebbar pour leurs conseils, merci à Fabien Pellier pour la réalisation de l’affiche et des
enregistrements et à Jeremy Chevalier de nous avoir prêter ses disques en ciment.
Table des matières
P7. Préambule
P9. Evolution des stockages de données dans une mémoire
Proto-écriture
Écriture
La remémoration par l’iconographie
Le stockage séquentiel et numérique
P13. Que dire de la mise en mémoire de la musique ?
La notation
Supports non enregistrés mais stockant de la musique
Le cylindre picoté ou disque à ergots Le carton, le papier ou métal perforé Les supports enregistrés Enregistrement sur feuille de papier
Enregistrement par photogravure
Enregistrement sur cylindre en étain puis en cire
Enregistrement sur disque
Le support magnétique
Le support numérique
P34. Questions de disques
Correspondance son et couleurs
Bruit, mouvement, vitesse
Expériences contemporaines
Biblio : - Catalogue « Brocken music » : Encyclopédie de l’usage de l’objet-disque dans l’art depuis l’avant-garde Berlin 1989 - Revue Sciences Humaines N°11 « entre images et écriture » - La chambre de la mémoire ; Lina Bolzoni ; ed Droz - La mémoire et la musique ; cahier de civilisation médiévale vol XLIX O. Ullin et C.Chaillou - stereostory ; ed publisono - Automates et instruments de musiques mécaniques ; ed Office du Livre - Guida al museo di strument musicali meccanici; coll Marino Marini - Les instruments de musique mécanique ; ed Gründ - Histoire illustrée du phonographe ; ed Vilo - La machine parlante ; ed Jean Pierre Gyss
-http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec_more.html -http://fr.maieutapedia.org/wiki/Histoire_de_l'enregistrement_sonore -http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'enregistrement_sonore -http://www.aaimm.org/ -http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique_m%C3%A9canique
-http://jjpalix.free.fr/Sill-v_pal2.htm -http://www.musicmecalesgets.org/ -http://p.g.elec.pagespro-orange.fr/phono.htm
-Jérémy Chevalier : http://www.jeremychevalier.net/ -Christian Marclay : http://www.youtube.com/watch?v=4yqM3dAqTzs Francisbaudevin : http://www.fracplatform.com/fr/ressources/archives/programmation-des-frac/10/2012 -Le gentilGarçon: http://www.ddara.org/fr/oeuvres/LE_GENTIL_GARCON/Page-musicologie/Page-rockmusic -Frederic Post: http://www.fredericpost.net/index.php?/archives/disque/ -Thomas bonny: http://saks.ch/artists-detail-244-1-298-11-THOMAS-BONNY.html -Brocken music: http://www.artperformance.org/40-categorie-10566167.html -Erikm: http://www.erikm.com/visual-art/?id_mot=62 -Tinguely: http://partage-du-sensible.blogspot.fr/2011/06/jean-tinguely-meta-harmonie-i-1978.html -Vasarely: http://frederic-rossille.net/musicalite-vasarely-omf.html - Jaune flux: www.jauneflux.com
Dans le sillon du CD
Piste Ref CD1 1 S1 Tradition orale chants Inuits
2 S2 Disque dans l’espace : extraits de « Voyager Golden Record » 3 S3 Carton perforé : Machine à tisser Jacquard 4 S4 Neumes: Chant Grégorien, « Sanctus XI » 5 S5 Partition occidentale: Mozart, extrait « concerto piano et orchestre N20 » 6 S6 Partitions spéciales: Xenakis, extrait « Polytope » 7 S7 Partitions spéciales: Cathy Berberian « Stripsody» 8 S8 Partitions spéciales: John Zorn, extrait « live jazz in Marciac» 9 S9 Cylindre picoté : Serinette 10 S10 Cylindre picoté : orgue de barbarie Gavioli 11 S11 Cylindre picoté: piano mécanique « de la Mémé » 12 S12 Cylindre Picoté : Boite à musique « Alexandra » 13 S13 Disque picoté : Boite à musique « Polyphon changeur » 14 S14 Disque picoté : Boite à musique « Stella » 15 S15 Carton perforé : orgue Limonaire « La Bohémienne » 16 S16 Papier perforé: piano pneumatique pianola Steck « chant russe » 17 S17 Papier perforé: Orgue « Mignon » 18 S18 Disque perforé: Ariston
CD2 1 S19 Enregistrement sur papier E-S de Martinville « au clair de la lune » 2 S20 Rouleau en cire sur phono col de cygne : Bob Robert « Gratitude Ragtime » 3 S21 Disque durodoide phonographe à saphir : Marcel Marcelly « sur la riviera » 4 S22 Disque durodoide phonographe à aiguille : Les Paul « Mockin’bird » 5 S23 Disque vinyl phonographe à aiguille :Elvis 6 S24 Disque 33t : Tchaïkowski :extrait « Le lac des cygnes » 7 S25 Disque 45t : Little Eva « Locomotion » 8 S26 Disque 33t : Sex Pistols « Holidays in the sun» 9 S27 Disque 45t: Mickael Jackson « Billie jean » 10 S28 Disque 33t: Cabaret Voltaire « Stay out of it » 11 S29 Disque Maxi 45t: Mimetic « Grow and wait » 12 S30 Disque publicitaire: amiante ciment 13 S31 Disque C : Dire Strait « Money for nothing » 14 S32 Mp3: Lady Gaga « Just dance » 15 S33 Lumière: Scriabine extrait « poème du feu » 16 S34 Mouvement: Russolo « macchina tipographica » 17 S35 Musique concrète: Pierre Henry « psyche rock » 18 S36 Disque vinyle: Christian Marclay extrait « On night Music» 19 S37 Disque en béton: Jérémy Chevalier « Musique concrète » 20 S38 Disque hypermaterialisé: Jaune flux «FW3» 21 S39 Tradition orale: Chants Inuits