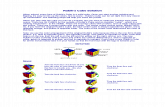1584300
description
Transcript of 1584300
-
Chair, ascse et allgorie sur la gnalogie chrtienne du sujet dsirant selon Michel FoucaultAuthor(s): Bernhard TeuberSource: Vigiliae Christianae, Vol. 48, No. 4 (Dec., 1994), pp. 367-384Published by: BRILLStable URL: http://www.jstor.org/stable/1584300Accessed: 11/05/2009 18:11
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available athttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unlessyou have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and youmay use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.
Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained athttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=bap.
Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printedpage of such transmission.
JSTOR is a not-for-profit organization founded in 1995 to build trusted digital archives for scholarship. We work with thescholarly community to preserve their work and the materials they rely upon, and to build a common research platform thatpromotes the discovery and use of these resources. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
BRILL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Vigiliae Christianae.
http://www.jstor.org
-
Vigiliae Christianae 48 (1994), 367-384, ? E. J. Brill, Leiden
CHAIR, ASCESE ET ALLEGORIE SUR LA GENEALOGIE CHRETIENNE DU SUJET DESIRANT
SELON MICHEL FOUCAULT*
PAR
BERNHARD TEUBER
1. D&clinaison et declin du sujet Quoi qu'on ait pu dire a propos du style de Michel Foucault, nous
doutons que les commentateurs se soient attardes a une observation fort simple, peut-etre meme banale. Si l'on passe en revue ses grands livres publies et qu'on les compare ensuite a ses etudes sur l'Antiquite chre- tienne, on constatera une difference revelatrice. Depuis Folie et deraison jusqu'au Souci de soi, les titres exploitent essentiellement le sens propre des mots qui les composent. 2 I1 en est autrement pour ce qui concerne des titres tels que le Combat de la chastete ou bien les Aveux de la chair. Dans les deux derniers cas, Foucault utilise un langage figure dont la specificite, la provenance et les effets de subjectivation nous semblent reclamer une analyse approfondie. Peut-etre cela nous permettra-t-il d'ebaucher les contours d'une genealogie rhetorique du sujet desirant tel qu'il a ete conCu par le christianisme.
Regardons d'abord l'article de 1982 sur le Combat de la chastete ofu Foucault examine les conseils de continence donnes par Jean Cassien. 3 Pour promouvoir le monachisme naissant de la Gaule meridionale, Cas- sien avait redige dans les annees 420 deux traites de doctrine ascetique.4 Le moine y est considere comme un soldat du Christ (miles Christi),5 qui fera de sa vie une bataille perpetuelle. Les termes de ?combat> (pugna), de (bellum), de (colluctatio), de ?concours> (certamen), de (agon), sont repetes regulierement. Tous ces mots qui le plus souvent impliquent l'idee d'une prouesse et d'un spectacle sportifs, sont employes au sens figure. Il s'agit d'une serie de metaphores qui supposent une analogie entre l'activite du combattant et la vie ascetique. Contentons-nous d'abord de signaler, en modifiant la fameuse definition qu'Aristote donne de la metaphore, au IIIe livre
-
BERNHARD TEUBER
de la Rhetorique, que le guerrier et l'ascete se ressemblent ?parce que tous les deux sont doues d'un courage viril?> (6ta Tx yap aico avopeious MTVal). 6
Que signifiera done le combat de la chastete? Au long de son article, Foucault emploie a plusieurs reprises cette expression. Nous en retien- drons deux exemples. A la page 18, nous lisons: ?L'essentiel du combat de la chastete porte sur une cible qui n'est pas de l'ordre de l'acte ou de la relation?>, et Foucault d'ajouter, a la page suivante, que dans ?les differentes traces d'impurete) on trouverait ?l'indication de ce contre quoi il faut se battre dans le combat de la chastete)). Evidemment, le combat de la chastete reunit en lui trois elements: a savoir un sujet qui lutte, c'est l'ascete; ensuite une technique de soi que celui-ci met en oeuvre, c'est le combat qu'il mene, et finalement l'objectif qui'il s'efforce d'atteindre et qu'on identifiera a la chastete. C'est un combat dont le sujet est l'ascete et dont l'objet est la chastete. En suivant les categories de la grammaire latine, nous dirions que, dans le combat de la chastete, le substantif ?combat>) regit un genitif objectif puisque la chastete fait l'objet du combat.
Mais qu'en est-il de la deuxieme occurrence de notre expression? Cette fois-ci, Foucault cite un passage tire du De institutis coenobiorum de Cassien ofu celui-ci recommande aux moines d'eviter autant que pos- sible le trouble des sens que risquent d'eveiller les pollutions nocturnes:
II faut nous efforcer de reprimer les mouvements de l'ame et les passions de la chair jusqu'a ce que la chair satisfasse aux exigences de la nature sans susciter de volupte, se debarrassant de la surabondance de ses humeurs sans aucune demangeaison malsaine et sans susciter de combat pour la chastete.
Que veut dire dans ce contexte le ?combat pour la chastete), selon la traduction de Jean-Claude Guy dans les Sources chretiennes que nous avons suivie avec Foucault? Cassien a-t-il devant les yeux une situation ou le sujet asc6tique jouit de sa chastete sans qu'il soit oblige de mener un combat pour y atteindre? Le ?combat pour la chastete>) serait-il tout simplement le ?combat de la chastete>) dans l'acception du genitif objec- tif? Les choses se compliquent, helas! des que nous etudions la phrase dans le texte: donec ista carnis condicio necessitatem naturae expleat [...] non pugnam suscitans castitati. Dans la proposition participiale, le sujet grammatical sous-entendu est carnis condicio, le verbe suscitans regit l'accusatif pugnam comme complement d'objet direct, tandis que castitati se trouve au datif et ne designe pas l'objet, mais le protagoniste
368
-
CHAIR, ASCtSE ET ALLEGORIE
du combat. On traduira donc: ?jusqu'a ce que notre condition charnelle remplisse sa fonction naturelle sans engager la chastete dans un combat?.
Du coup, le combat de la chastete n'accomplit plus une mediation entre un sujet desirant, c'est-a-dire l'ascete, et un objet desire, c'est-a- dire la continence. Tout au contraire, la bataille se fait desormais - ou du moins risque-t-elle de se faire - entre la chair et la chastete. I1 y a affrontement entre deux principes qui s'opposent, entre deux sujets combattants pour ainsi dire. Quant au statut grammatical de la chastete, il change egalement: de genitif objectif, il devient genitif subjectif puis- que la chastete sera l'une des actrices du combat. En plus, ces effets de la declinaison latine entrainent presque automatiquement le declin du sujet desirant qui soudain se voit banni du theatre des operations. II est remplace par ces etranges personnages que sont non seulement la chas- tete, mais aussi la chair. Par consequent, la metaphore du combat se fond ici avec une autre figure de rhetorique, a savoir la personnification qui selon Fontanier peut etre rapportee a l'allegorie et . 8
Integrant le genitif objectif et le genitif subjectif simultanement, le combat de la chastete doit etre compris de deux manieres contradictoires et complementaires. Quant aux Aveux de la chair, titre prevu du qua- trieme volume de l'Histoire de la sexualite et qui n'est pas paru, la struc- ture grammaticale en est la meme. En tant que genitif objectif, la chair constitue le contenu d'un aveu a faire par le sujet. En tant que genitif subjectif, la chair est en meme temps le support qui permet de formuler l'aveu. En faisant accomplir l'acte d'aveu a la chair, on attribue la faculte de parole a quelque chose d'inanime. C'est la figure de la proso- popee qui, toujours d'apres Fontanier,
-
BERNHARD TEUBER
objectif et le genitif subjectif s'entrecroisent. 10 Au niveau de la themati- que d'un sujet toujours problematique et, pour cela meme, problema- tise sans cesse, on decouvre sans doute une continuite fascinante dans la pensee de Foucault. Mais en meme temps, il suggere qu'avec l'avene- ment du christianisme, une rupture majeure s'est produite a l'interieur de l'histoire occidentale de la subjectivation. N'est-ce pas un regard fon- cierement critique qu'il jette sur l'histoire des pratiques sociales et dis- cursives a partir du Moyen Age? Et n'est-ce pas d'un oeil attendri et profondement bienveillant qu'il regarde les civilisations de 1'Antiquite grecque et meme romaine? En bref: c'est comme si depuis le Moyen Age, le gouvernement des autres et la science sexuelle l'avaient emporte sur une sagesse qu'avaient enseignee les philosophes anciens et qui s'etait definie par un art et par une erotique de soi ou le sujet mettait a profit sa capacite de se gouverner lui-meme. Cette transition d'un regime du gouvernement de soi a un regime du gouvernement des autres est evidemment centree autour d'une epoque que Foucault a souvent evoquee, mais que la mort l'a empeche d'etudier a fond, a savoir l'Anti- quite chretienne qui comprend environ la periode du IIIe au VIe siecles. Cette periode forme pour ainsi dire une charniere ou une plaque tour- nante dans laquelle s'articulent deux types contradictoires du sujet desi- rant qui semblent s'opposer de la meme maniere que s'oppose un style librement choisi a une discipline coercitive; une esthetique de l'existence a une codification minutieuse du quotidien; un examen de conscience volontaire a l'extorsion de l'aveu. Quant au sujet desirant de l'Antiquite chretienne, Foucault indique par endroits son antinomie constitutive: il est voue a l'ascese et au renoncement de soi, mais pour y parvenir, il doit rigoureusement surveiller et dechiffrer cette partie de soi qu'on appelle la chair. L'homme de desir du christianisme, le vir desideriorum selon l'expression figurant dans le livre de Daniel, " se constitue de la sorte comme un sujet charnel et ascetique a la fois.
2. L'allegorie des rheteurs a l'usage des theologiens
L'hypothese que nous voudrions avancer ici, est la suivante, L'impro- priete de langage et la diction figuree ou allegorique, que nous avons decouvertes dans les etudes foucaldiennes respectives, refletent les parti- cularites du style qu'ont employe certains auteurs de l'Antiquite chre- tienne, notamment les Peres de l'Eglise. On sait bien que l'allegorie y a occupe une place tres importante. Ne serait-ce donc pas souhaitable
370
-
CHAIR, ASCtSE ET ALLtGORIE
d'analyser de plus pres cette rhetorique specifique? Sans doute cela permettrait-il de mieux comprendre une lente transformation qui s'est realisee en Occident et qui a fini par substituer a l'art erotique ou a l'art de soi des Anciens, la science sexuelle jusqu'alors inedite des Modernes. Dans cette evolution, le discours patristique des IVe et Ve siecles de notre ere pourrait bien avoir opere a la maniere d'un aiguillage. Retour- nons donc encore une fois aux questions de rhetorique et partons de la definition de l'allegorie que Quintilien propose dans l'Institution oratoire:
L'allegorie [...] presente un sens autre que celui des mots, et meme parfois contraire. Dans le premier cas, c'est surtout une suite continue de meta- phores:
O nef! de nouveaux flots Vont t'emporter encore Sur la mer! que fais-tu? Rentre resolument au port...>
et ainsi de suite, dans tout le passage d'Horace ou le navire represente 1'Etat, les flots et les tempetes les guerres civiles, le port la paix et la concorde. 12
L'allegorie peut donc etre considere comme une suite continue d'expressions figurees qui ressortissent toutes au meme champ semanti- que. Dans le poeme horatien, c'est le theme traditionnel de la navigation qui se trouve applique a l'Etat. Quintilien distingue d'ailleurs l'allegoria tota de l'allegoria permixta. Tandis que l'allegorie complete ne consiste qu'en metaphores et se passe entierement de mots employes au sens pro- pre, l'allegorie mixte est un melange d'expressions renvoyant au sens figure, ainsi que de locutions gardant leur sens propre. II va de soi que l'allegorie mixte est bien plus frequente que l'allegorie complete. Tout naturellement, une allegorie aura tendance a se transformer en person- nification des qu'une chose abstraite et inanimee sera representee a l'aide d'une image animee. Quintilien appelle cette espece de figure une fictio personae ou bien une prosopopee, c'est-a-dire la creation imagi- naire d'un personnage. I1 signale en outre que bien souvent les orateurs donneront aux personnifications un corps, une voix et un discours tout a la fois.13
I1 faudra se garder de confondre cette allegorie des rheteurs avec l'allegorie des theologiens. On sait que depuis Philon d'Alexandrie et Origene, les auteurs chretiens ont elabore la doctrine des differents sens
371
-
BERNHARD TEUBER
des Saintes Ecritures. Pour plus de renseignements, il suffira ici de nom- mer les profondes analyses de Jean Pepin, de Johan Chydenius et d'Armand Strubel. 4 Adoptant le terme d'allegorie dans l'acception que saint Paul lui avait donnee dans son epitre aux Galates, 15 les Peres de l'Eglise commencerent a distinguer le sens litteral du sens spirituel ou allegorique. Mais a part certaines exceptions, on supposait que le sens litteral des Ecritures contenait lui aussi une verite historique. Certes il renvoyait a une verite spirituelle plus elevee, mais il n'en comportait pas moins la signification propre d'une histoire concrete et solide. C'est notamment l'ecole d'Antioche qui insista avec vehemence sur l'incon- testable historicite du sens litteral, et elle n'hesita point a s'opposer en cette matiere a la conception plus spiritualiste des docteurs alexandrins.
Dans l'allegorie des rheteurs, par contre, le sens litteral etait purement imaginaire, il ne possedait pas sa propre verite. Pour cette raison, saint Augustin introduisit, dans le De trinitate, le distinguo, entre l'?allegoria in verbis> et 1'?allegoria in facto>. 16 L'allegorie verbale etait un truche- ment mensonger qu'on apprenait dans les ecoles des rh6teurs et dont se servaient les poetes profanes; l'allegorie evenementielle, au contraire, relevait du domaine de la verite; on ne la discernait que dans les Ecritu- res puisque Dieu avait voulu que les faits qu'on y transcrivait portassent en eux une signification spirituelle qui les depassait. Se fondant sur cette distinction, reprise aussit6t par de nombreux auteurs, Dante opposera encore au debut du XIVe siecle dans le Convivio, l'allegorie des poetes a celle des theologiens.17
Or, ce qui nous interesse ici, ce n'est point l'allegorie des theologiens, mais l'allegorie profane des rheteurs et des poetes en tant que figure pra- tiquee aussi par les Peres de l'Eglise. Ceux-ci avaient recu le plus sou- vent une formation de rhetorique ou avaient enseigne eux-memes l'elo- quence, comme le montre 1'exemple de saint Augustin. II est vrai que l'influence de l'allegorie s'etait deja fait ressentir dans les lettres paien- nes, mais le procede se repand de plus en plus pendant les premiers sie- cles de notre ere et il connait son apogee dans la litterature profane et religieuse du Bas-Empire. Ce sont en effet tres souvent les memes ecri- vains qui developpent une conception chretienne de la chair, qui preco- nisent une ascese plus rigoureuse que celle des infideles, et qui montrent un goft pousse pour les metaphores prolongees, pour les personnifica- tions et pour les allegories. Si, d'apres Foucault, le christianisme a lie etroitement la chair a l'ascese, la genealogie du sujet desirant devra prendre en compte les presupposes langagiers et notamment rhetoriques
372
-
CHAIR, ASCESE ET ALLEGORIE
qui rendent possible ce nouveau rapport a soi, dans le monde chretien. On notera egalement que cette fascination pour l'allegorie des rheteurs, qu'eprouvent les Peres de l'Eglise, se situe en marge de leur reflexion proprement theologique sur le sens allegorique des Ecritures. Si per- sonne ne peut nier que les auteurs du Bas-Empire doivent beaucoup a une tradition anterieure, on admettra neanmoins avec le chercheur anglais Clive Lewis qu'en matiere d'allegorie, ils surpassent de beau- coup les ecrivains des epoques precedentes. 18 De Seneque et de Stace jusqu'aux poetes de l'Antiquite tardive tels que Martianus Capella, Pru- dence, Claudien ou meme Boece, le prestige accorde a l'allegorie croit continuellement.
3. La chair cette inconnue
I1 est temps de nous interroger sur la conception chretienne de la chair. Revenons a cet effet encore une fois a Cassien, mais occupons- nous a present de ses Collationes ou Conferences. Dans la quatrieme conference que l'abbe Daniel prononce dans le desert de Scete en Basse- Egypte, il traite de la concupiscence de la chair et de l'esprit. On lui demande des le debut les causes de la sterilite d'esprit dont les moines souffrent par moments. Daniel trouve a cet inconvenient trois raisons possibles: la sterilite d'esprit (de dispensatione domini ac probatione descendit). 19 Par la suite, Daniel commentera largement cette troisieme possibilite:
C'est en vue de notre bien que nos membres eux-memes sont devenus un foyer de guerre. Nous le lisons chez l'Ap6tre:
-
BERNHARD TEUBER
Encore faut-il expliquer ce que l'Apotre veut dire par le mot de chair. >21 En s'appuyant sur de nombreuses citations scripturaires, l'abbe Daniel enumere quatre locutions diff6rentes dont aucune ne correspond d'ailleurs au sens propre du mot.22 La chair designe premierement , comme cela se voit dans le verset biblique: (interdum pro ipsis peccatisponitur), comme en temoigne le verset: 25 Quatriemement, la chair peut signifier la consanguinite et la parente, comme dans le verset: >26
Meme si un commentaire rhetorique detaille de ce passage doit se heurter a des difficultes, nous voudrions du moins retenir que dans les premier, deuxieme et quatrieme exemples, la chair est employee comme une synecdoque qui prend la partie pour le tout, c'est-a-dire la chair humaine ou pour l'homme tout entier ou pour un pecheur ou pour un proche parent. Il n'en est pas ainsi pour l'alternative restante, qui influera bien plus profondement sur la tradition chretienne. La chair y signifie, comme explique Daniel, le peche en general, et rappelons ici que par la suite la chair comptera parmi les trois ennemis classiques de l'ame, a l'egal du Diable et du monde. Cette chair designant le peche serait-elle donc une metonymie qui prend la cause pour l'effet parce qu'elle considere la nature charnelle comme une predisposition a la faute?
L'abbe Daniel ne dit pas ceci. II place la formule paulinienne qu'il commente plut6t du cote de l'allegorie et de la personnification: car lorsque l'Ap6tre ecrit dans son epitre aux Galates: >, il donne inevitablement l'impression de parler de deux etres animes, voire de deux substances qui s'opposent. Toutefois Daniel affirme que saint Paul > (cum quadam tempo- ris uicissitudine et mutatione).27 Ensuite Daniel explique:
-
CHAIR, ASCESE ET ALLEGORIE
devons donc pas prendre dans ce passage la chair pour une personne humaine, je veux dire pour la substance d'un homme, mais pour la volonte de la chair et les mauvais desirs>> (quamobrem in hoc loco car- nem non hominem, id est hominis substantiam, sed uoluntatem carnis et desideria pessima debemus accipere).28 Quoique l'Apotre donne, dans son tour verbal, les apparences d'une substance a la chair, celle-ci appartient en realite au domaine des phenomenes temporels et par con- sequent accidentels. Bien plus tard, Dante aussi se referera a cette dicho- tomie traditionnelle entre la substance et l'accident pour caracteriser la personnification allegorique de l'Amour, dans la Vita nova:
Je parle de l'amour comme si c'6tait une chose en soi et non seulement une substance intelligible, mais comme si c'etait une substance corporelle, ce qui, a la verite, est faux, car l'Amour n'est pas en soi comme une sub- stance, mais c'est un accident dans une substance (che Amore non e per se si come sustanzia, ma e uno accidente in sustanzia). 29
Apres avoir elucide de la sorte la nature allegorique du passage pauli- nien, l'abbe Daniel se sert lui aussi des personnifications accreditees par l'usage scripturaire. II decrira la chair et l'esprit comme si c'etaient des personnages concrets, ayant des predilections et des defauts, dont il fau- drait tracer le portrait. > (intestinum cotidie intra nos geritur bellum). 30 Cette guerre allegorique comprend trois acteurs:
-
BERNHARD TEUBER
4. Parcours de patrologie incomplet
Outre les passages mentionnes de Cassien, nous voudrions encore commenter deux ou trois fragments de patrologie datant de la meme epoque et qui nous semblent significatifs quant a la conception de la subjectivite qui s'y articule. Prenons comme premier exemple la Vie de saint Antoine, ecrite en grec vers l'an 357 par saint Athanase d'Alexan- drie. Pourtant nous nous refererons de preference a une tres ancienne version latine, redigee peu de temps apres par Evagre d'Antioche. 33 Elle a connu un succes considerable en Occident, et le travail de stylisation en direction de l'allegorie y est encore plus marque que dans le modele grec. Au cinquieme chapitre, on nous decrit les premieres epreuves de saint Antoine qui vient a peine de se retirer dans la solitude. Des le debut, les tentations sont presentees comme une oeuvre du Diable qui essaie de le dissuader de l'ascese (rcEipocev oauov ro t ati axija Xo xar- ay?yElv). 34
Le Demon n'apparait pas en personne, mais il tourmente le jeune ermite en lui envoyant des souvenirs, des doutes et des desirs sensuels. Antoine parvient, pour un temps, a les chasser et a se liberer ainsi de l'emprise du Malin. Or, l'emergence des pensees tentatrices dans la conscience d'Antoine, de meme que ses efforts pour les repousser aussi- tot relevent d'une realite purement psychique. Neanmoins tout cela nous est transmis par une suite continue de metaphores qui evoquent l'allegorie d'une guerre entre Satan et l'ermite. Celui-la (ille), c'est-a- dire le Diable, attaque (aggressus est); emploie se armes usuelles (con- sueta arma); se lance sur lui, des javelots nus a la main (apertis in eum telis irruebat) - par contre, celui-ci (hic), c'est-a-dire saint Antoine, lutte (dimicaret); s'oppose (opponebat); se retranche (vallabat). Dans ce combat, la chair de l'ermite n'est pas l'alliee du Diable, mais le corps est la cible qu'il faut defendre contre les assauts de l'agresseur: ?Antoine fortifiait tout son corps par les remparts de la foi et des jeu- nes>> (hic fide et jejuniis omne corpus vallabat). Aussi sera-ce precise- ment le corps charnel de l'ascete qui remportera une eclatante victoire sur l'Esprit de fornication qui le harcele (ab homine carnem gestante superabatur). 3
Cette bataille de saint Antoine porte elle aussi les traits d'un spectacle. Au dixieme chapitre, au bout de plusieurs triomphes sur le Tentateur, le Christ apparait a l'ermite, et lorsque celui-ci demande au Seigneur pourquoi il ne l'a pas secouru, Jesus lui repond:
-
CHAIR, ASCtSE ET ALLEGORIE
j'attendais pour voir le spectacle de ton combat> (hic eram; sed exspec- tabam videre certamen tuum - TO aov aywvt ua).36 II se peut qu'au debut le sujet ascetique soit un acteur inconscient devant un spectateur qui le regarde. Mais les paroles qu'il entend lors de cette apparition du Christ lui apprennent qu'a l'avenir il agira devant un public. Le champ de bataille se transforme de nouveau en scene de theatre.
Les Confessions de saint Augustin, ecrites vers l'an 400, nous fournis- sent sans aucun doute d'autres beaux exemples du phenomene de style que nous sommes en train de decrire. Rappelons-nous d'abord, au VIIIe livre, les personnifications des bagatelles (nugae nugarum et vani- tates vanitatium [sic]) et aussi l'allegorie de la chaste et digne continence (casta dignitas continentiae).37 Rappelons-nous les gestes lascifs ou majestueux de ces personnages imaginaires. Rappelons-nous enfin leurs prosopopees: il y a d'une part les paroles que semblent chuchoter d'anciennes maitresses effrontees, il y a d'autre part un discours solen- nel qui ressemble ai celui d'une venerable matrone. Tout cela se passe peu avant la conversion de saint Augustin et donne lieu a une dispute au fond de son coeur et dans laquelle il s'affronte a lui-meme (controver- sia in corde meo non nisi de me ipso adversus me ipsum). 38
Tres souvent, les allegories augustiniennes creent un personnage inte- rieur; elles pretent ainsi au coeur des oreilles, des yeux ou meme des mains pour en faire un organisme independant. 39 Mais elles inventent egalement un espace imaginaire qui se trouve au dedans du sujet. L'exemple le plus admire en est certainement la description de la memoire au Xe livre: ?J'entre dans les domaines, les vastes palais de ma memoire>> (et venio in campos et lata praetoria memoriae). 4 L'alle- gorie de la memoire presente le sujet comme un personnage qui est venu chercher un document dans les archives, ou un aliment dans une cave. Mais les choses cherchees se derobent a lui; elles deviennent des allego- ries qui commencent a lui parler, qui se cachent devant lui ou apparais- sent la oiu il ne les attendait pas.4'
Les contenus de la memoire sont loin d'etre sans rapport a la chair. Comme la memoire garde l'empreinte des experiences charnelles, les images des choses vecues pourront toujours assaillir le sujet (talium rerum imagines [...] mihi occursantur). 42 A l'etat de veille, le sujet sera sur ses gardes, mais dans les reves, il risque d'etre attaque sans merci, et c'est alors que les images de la memoire pourront l'entrainer malgre lui non seulement jusqu'au flux charnel, mais, qui pis est, jusqu'au con- sentement (usque ad carnisfluxum - usque ad consensionem). 43 Chez
377
-
BERNHARD TEUBER
saint Augustin aussi, le sujet desirant est invite a pratiquer l'ascese, mais pour que l'homme de desir puisse se constituer comme sujet charnel et ascetique, il a besoin d'un theatre interieur ou il jouera son role au milieu d'autres allegories.
Nos lecteurs auront sans doute remarque que le phenomene que nous evoquons depuis longtemps sans le nommer, est celui dit de la psycho- machie. C'est notamment Prudence, poete chretien de la seconde moitie du IVe siecle, qui en intitulant Psychomachie une epopee allegorique a acquis au terme un droit de cite dans la tradition litteraire de l'Occident. S'inspirant sans doute lui aussi de !'allegorie paulinienne du combat entre chair et esprit, et suivant peut-etre une suggestion de Tertullien,44 Prudence nous peint les peripeties d'une guerre meurtriere dans laquelle les vertus personnifiees expulsent brutalement autant de vices, du fond de la caverne de notre poitrine (nostri de pectoris antro).45 Parmi les autres personnages, entrent aussi en scene la Pudeur et la Convoitise que Prudence appelle Libido, ensuite la Luxure et la Sobriete. Chaque cou- ple d'amazones s'engage a bras-le-corps dans un duel sanglant jusqu'a ce que la bonne cause ait gagne. Apres la defaite complete des vices, on edifiera, sous 1'egide de la Foi et de la Concorde, un temple interieur qui represente l'ame.
-
CHAIR, ASCtSE ET ALLEGORIE
de Constantin, car les mouvements asc6tiques restaient souvent margi- naux par rapport a elle. Si d'ailleurs le monachisme etait en effet issu de la legalisation du culte chretien, la psychomachie pourrait reclamer un sort comparable. Dans son livre sur le Conflit des vices et des vertus, saint Ambroise ecrit expressement que les tourments exterieurs qu'ont endures tant de martyrs, cederont desormais la place a une persecution interieure plus brutale et plus funeste, a savoir celle perpetree par les vices (persecutio immanior et magis noxia, quam [...] vitiorum gignit adversitas). 47
Resumons donc a partir de nos observations les resultats que nous avons obtenus jusqu'ici.
1. L'allegorie de la psychomachie est regie par une rigoureuse volonte d'ascese qui cherche a amener le sujet desirant au gouvernement parfait de soi. (I1 resterait encore a discuter comment ce dispositif de la psycho- machie a pu etre assimile plus tard aux techniques du gouvernement des autres.)
2. L'allegorie cree, au dedans du sujet desirant, un espace interieur qui est aussi un theatre dans lequel le sujet ascetique se constitue comme spectateur.
3. L'allegorie permet au sujet ascetique de se representer la chair comme une instance qui lui appartient et lui reste etrangere a la fois. En meme temps, la prosopopee vient douer la chair et les desirs charnels d'un discours qui leur est propre et que le sujet s'entend adresser.
4. Les differentes representations allegoriques sont mises en scene sur un modele du combat, a l'interieur d'un sujet unique qui est acteur et spectateur a la fois.
5. I1 en resulte une allegorie guerriere qui sert sans doute a integrer l'ancienne morale de la virilite au systeme chretien base sur la valorisa- tion de la virginite.48
Constatons en l'occurrence que l'allegorie de la psychomachie est essentiellement ambivalente, sinon contradictoire. D'une part elle exige la virilite du sujet qui doit se conduire comme le ferait un guerrier coura- geux, d'autre part elle conseille une ethique du renoncement reclamant au sujet une virginite parfaite. I1 s'ensuit qu'une allegorie proprement chretienne et ascetique ne saurait guere etre la psychomachie, mais un autre type d'allegorie qu'on pourrait nommer une psychomnestie ou une psychogamie, c'est-a-dire la mise en scene rhetorique d'une cour d'amour, voire d'un mariage entre une ame humaine et un Divin Epoux. A cet egard, il est tout significatif que dans certains ecrits sur la virgi-
379
-
BERNHARD TEUBER
nite, datant de 1'epoque que nous avons etudiee, une allegorie de la psychomnestie basee sur une interpretation spirituelle du Cantique sem- ble deja etre en formation.49 On connait d'ailleurs l'importance qu'allait acquerir plus tard l'allegorie de la psychomnestie pour la mysti- que nuptiale.
5. Que signifient les ideaux ascetiques, aujourd'hui? La conception de l'allegorie que nous soumettons a la discussion n'est
pas anodine quant a la question de la subjectivite ascetique. Se construi- sant a partir de simples metaphores plus ou moins eparses, l'allegorie finit par mettre en place un dispositif rhetorique coherent et qui permet au sujet desirant d'instituer son rapport a soi, a travers un jeu de lan- gage (Sprachspiel) au sens de Wittgenstein.50 Pendant les dernieres decennies, les presupposes semiotiques et meme philosophiques du lan- gage allegorique ont ete mis en cause notamment par certains ecrits de Paul de Man, critique litteraire qui s'etait situe dans le sillage des tra- vaux de Jacques Derrida, mais aussi de Walter Benjamin.5' Qu'on accepte de telles hypotheses sur la nature necessairement rhetorique, voire allegorique du langage ou qu'on les refuse, nos reflexions nous ont du moins conduit a affirmer que l'allegorie est elle aussi un art de soi. Hegel avait critique l'allegorie dans son Esthetique parce qu'en person- nifiant les etats et les qualites, elle leur reconnaissait une subjectivite feinte qui pourtant ne pouvait etre que
-
CHAIR, ASCISE ET ALLEGORIE
de contrainte, d'esth6tique plut6t que de savoir, de fiction plutot que de verite. Tout austeres que nous paraissent les avis doctrinaux de l'asce- tisme, les moyens rhetoriques qu'on employait pour les mettre en prati- que ne 1'etaient suirement pas. Dans la troisieme partie de la Ge'nealogie de la morale, consacree expressement aux ideaux ascetiques, Nietzsche a beau deplorer
-
BERNHARD TEUBER
demanderons-nous dans une perspective nietzscheenne, ces citations venues ?des domaines, des vastes palais> d'une memoire desormais intertextuelle pour remplacer les personnifications desuetes d'autrefois, n'avaient-elles pas ete sapees, elles aussi, par l'allegorie des rheteurs? Mefions-nous bien de l'ineptie qui d'apres Flaubert consiste a vouloir conclure, 57 et deplaCons plutot la question, quitte a la laisser en suspens. Si l'ascese est une scene ou le sujet desirant regarde le spectacle des alle- gories qui viennent le constituer, la chair au sens chretien du terme, dont Michel Foucault inaugura l'archeologie, ce n'est ni une notion ni un concept, mais c'est, a proprement parler, une figure de rhetorique. Ori- gene n'avait-il pas anticipe sur cette genealogie en designant comme charnelle la lettre de l'allegorie? 58
NOTES
* Une version anterieure de cette etude a ete presentee au premier colloque Tarnier (
-
CHAIR, ASCESE ET ALLEGORIE
blematization of "Parrhesia", document dactylographi6e consulter au fonds Foucault de la Bibliotheque du Saulchoir de Paris. Quant a > (oculus cordis), in id., Enarratio in ps. XCVI,19 (CCSL XXXIX).
383
-
BERNHARD TEUBER
40 Id., Confessiones X,8,12 (traduction par Moreau). 41 Ibid., X,8,12. 42 Ibid., X,30,41. 43 Ibid., X,30,42 et X,30,41. 44 Cf. Tertullien, De spectaculis 29. 45 Prudence, Psychomachie 6, ed. et trad. francaise M. Lavarenne, Les Belles Lettres (Paris, 1963). 46 Ibid., 814 (trad. Lavarenne). 47 Ambroise, De vitiorum virtutumque conflictu (PL XVII 1151 A). 48 Quant a la substitution de l'ancienne morale de la virilite par une valorisation nouvelle de la virginite, cf. Foucault, Le Souci de soi, pp. 262-266. 49 Cf. p. ex. Ambroise, De virginibus; id., De virginitate (PL XVI). Cf. 6galement Tho- mas Camelot,